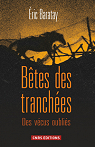A l'occasion du 26ème "Rendez-vous de l'Histoire" à Blois, Eric Baratay vous présente son ouvrage "Les animaux dans l'histoire" aux éditions Tallandier.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2826514/les-animaux-dans-l-histoire
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
On ne s'attache pas à un chien ou un à chat. On s'attache à Dora ou à Minouche.
Les fluctuations de la domestication et de l’élevage modifient sans cesse les animaux. La domestication du néolithique change la pression sélective, désormais plus exercée par l’homme que par la nature.
Au Proche-Orient, les allures sauvages persistent quelques temps. Puis apparaissent des transformations morphologiques, physiologiques, comportementales souvent irrémédiables du fait de la dérive génétique.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le régime du chien est de la bouillie de céréales, la viande étant jugée inutile voire dangereuse pour son équilibre. Les traités mondains d’éducation canine introduisent eau grasse et chair cuite dans la seconde moitié du siècle alors que la consommation de viande progresse dans la société. La viande arrive dans les écuelles modestes autour des années 1960 lorsque l’élevage industriel abaisse les prix et permet le développement des mets préparés. Issus des Etats-Unis (d’Amérique), les aliments secs à base de farine et les conserves à base de viande sont produits en France à partir de 1955. Ils profitent de l’essor des produits prêts proposés par les supermarchés et représentent, de nos jours la moitié des dépenses alimentaires. Depuis peu arrivent des pays anglo-saxons, où le végétarisme se développe, des préparations sans viande alignant une fois de plus le régime de l’animal sur celui du maître.
La transformation du statut du chien est parallèle à celle intervenue pour l’enfant avec la répression de l’errance et de la délinquance, la réduction puis la suppression du travail, la mise en responsabilité des parents. D’ailleurs ce sont souvent les mêmes notables qui œuvrent, au XIXe siècle, pour la protection des enfants et des bêtes domestiques.

Cubitus est un chien parlant. Il appartient donc à la famille des chiens de BD doués de parole. Autrement dit, lorsqu’il naît en 1968, il hérite de quarante années d’expérimentations de la bande dessinée franco-belge en la matière. Le personnage s’inscrit dans la tradition de la bande animalière ; sa série relève du genre de la chronique domestique humoristique ; ses gags mettent en scène un chien, comme les strips des Peanuts ou les planches de Boule et Bill. À travers le parler de Cubitus, un certain nombre de ses ancêtres « parlent » : des chiens, bien sûr, mais aussi d’autres personnages de bande dessinée qui ont, pour diverses raisons et éventuellement à son insu, marqué le dialoguiste Dupa. Ainsi, les premiers gags de la série évoquent indubitablement l’influence graphique et textuelle de Greg (l’auteur notamment d’Achille Talon). Dupa reconnaît cette filiation manifeste, lui qui fut son assistant pendant de nombreuses années, il admet que « la ressemblance de style en découle tout naturellement ». Bien entendu, le personnage de Cubitus ne s’inféode pas à ce seul modèle. Voilà donc la double question de cet article : « Qui parle à travers Cubitus ? » et « Comment parle-t-il ? ». Autrement dit, à supposer que le chien soit « la voix de son maître », de quel(s) maître(s) a-t-il reçu la parole et quel usage fait-il de ce don ?

Les équidés réagissent vivement à la douleur et l'extériorisent fortement, à l'inverse de beaucoup d'espèces qui la cachent pour ne pas attirer les prédateurs. Les chevaux gazés aux suffocants, observés à l'arrière par les vétérinaires, ont la tête basse et l'encolure tendue, la respiration discordante, les naseaux dilatés ; ils ont des quintes de toux, des faciès anxieux, la mousse aux lèvres et poussent des "plaintes aiguës", de "véritables cris". Dans tous les cas des faciès expriment l'épuisement, la douleur, la souffrance, comme le note un cavalier en 1914 : "On distinguait souvent la cavité des salières, creuses à y plonger le pouce, le pli de souffrance bridant leurs paupières." La tête est souvent marquée par le regard fixe, les naseaux dilatés, les oreilles à l'arrière, des grincements de dents, les paupières mi-closes, des grimaces. Les bêtes soufflent, tremblent, suent, piétinent, soulèvent le membre atteint, boitent, se prosternent, s'affalent. Après une blessure de guerre, des chevaux, en état de choc comme des soldats, ne bougent plus, respirent mal, ont une température et un pouls bas, deviennent insensibles, notamment s'ils sont maigres, malades, fragiles. Car beaucoup de chevaux endurent des pathologies multiples, s'ajoutant les unes aux autres.
On connaît mal les bêtes avant le XVIIIe siècle. Le bétail gaulois est constitué d’une mosaïque de races locales rustiques.
Les romains apportent des animaux plus grands, conformés différemment, issus d’une zootechnie élaborée.
Du Moyen Âge au XIXe siècle, l’élevage le plus répandu est celui du mouton. Cet animal rustique, polyvalent, utilisé pour la laine, la fumure des champs ou la viande, est partout, des plaines céréalières aux montagnes, réparti en quelques unités dans les fermes ou en grands troupeaux de communautés religieuses, de seigneurs, de riches bourgeois.
Dans le sud, la chèvre assure souvent les mêmes fonctions auprès des foyers les plus pauvres.
A l’inverse, la place du porc est plus réduite, contrairement à une idée reçue.
Ce n’est qu’entre 1750 et 1850 que les effectifs (de porcs) remontent grâce à la sédentarisation dans les fermes et à de nouveaux aliments : maïs, dérivés de lait et surtout pommes de terre. Une forte diffusion géographique et sociale se produit dans les campagnes alors que l’élevage disparaît des villes. Elle est à l’origine de l’actuelle image d’Epinal liant le porc à la vie rurale depuis les origines.
L’élevage apparaît en France au Ve millénaire avant J.-C.
Son développement est lent et inégal en raison de la résistance de l’ancienne économie de chasse, et l’animal domestique est rare.
L’incapacité de l’agriculture sur brûlis à faire face à une croissance démographique provoque l’expansion pastorale au IIIe millénaire.