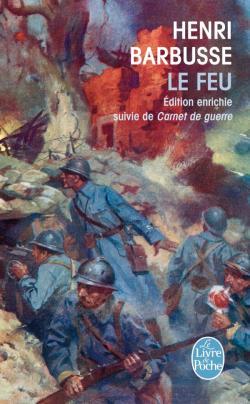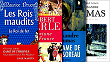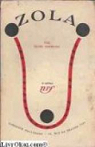J'ai débuté la lecture de ce roman directement après avoir refermé À l'ouest rien de nouveau qui m'avait littéralement époustouflée. Je m'attendais à revivre quelque peu ce qu'Erich Maria Remarque avait fait naître, mais du côté français, cette fois.
J'ai été à la fois comblée et déçue. Comblée car oui, Henri Barbusse fut un témoin lucide de la Grande Guerre : pas qu'un témoin, mieux qu'un témoin, un acteur. Il sait parfaitement ce qu'est le front, l'arrière, tout. Il sait tout ça et il veut en témoigner. Entendons-nous bien, l'opinion que je vais émettre ne concerne absolument pas la valeur ou l'utilité du témoignage, qui tous deux, selon moi, sont indiscutables et indispensables.
Ce que je questionne, c'est la pertinence du format choisi. En effet, il n'est jamais très clair dans le Feu si l'on a affaire à un roman ou à un reportage journalistique ; on navigue constamment dans ce no-man's land inconfortable et pas trop bien maîtrisé d'après moi.
Il y a un côté Zola chez Barbusse, un côté exhaustif, un côté « je vais tout vous montrer et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. » En 1916, en plein conflit, ça se comprend, c'est défendable et même plus que souhaitable, mais c'est du ressort du journaliste, pas du romancier.
Ce qu'il nous explique très bien, c'est qu'à l'époque des faits, les journalistes étaient largement investis dans une mission de propagande et donc, seul le roman pouvait avoir les coudées franches pour accomplir le véritable travail d'information du public.
Soit. Je suis pleinement consciente des contraintes qui pesaient sur le romancier. Ajoutons-y la contrainte ô combien lourde et pressante du temps, l'impératif du témoignage RAPIDE. Je sais tout ça, le comprends et l'excuse amplement.
Toutefois, pour les lecteurs du XXIème siècle et de tous les siècles à venir, seul demeure le roman car le contexte et son urgence ont disparu. Et là, je ne puis m'empêcher de tiquer sur des problèmes inhérents à la construction romanesque et qui amoindrissent et la satisfaction du lecteur, et le pouvoir de conviction de l'oeuvre.
C'est l'écueil dans lequel ne tombe pas Erich Maria Remarque : il a bâti un vrai roman, avec tous les codes et les impératifs propres au roman, d'où son incroyable pouvoir de conviction. Henri Barbusse, lui, dit tout, absolument tout, si bien qu'il dilue son histoire.
Remarque se focalise sur un nombre volontairement limité de personnages, qui tous quittent la scène les uns après les autres pour cause de décès ou de blessure affligeante ; toujours dans un but romanesque précis qui fait mouche à chaque fois. En gros, Remarque a opéré un tri, fait une synthèse de son expérience du conflit là où Barbusse nous fait un reportage à chaud, sans trop avoir hiérarchisé ses informations.
Autre différence notable, Remarque utilise un narrateur qui a une identité, qui parle avec des mots simples de soldat, qui souffre et qui ressent la guerre. Barbusse, lui, se cache derrière une espèce d'ectoplasme qui est lui sans jamais être clairement assumé comme étant bien lui, qui porte un regard distancié sur ce qu'il vit et qui, du coup, nous distancie également. Si bien que j'ai ressenti, moi lectrice du XXIème s., beaucoup moins d'intensité chez Barbusse que chez Remarque, alors même que la violence et l'horreur décrites sont rigoureusement les mêmes.
Quand Remarque fait mourir un soldat, il a pris le soin au préalable de nous le faire connaître, de nous y attacher, de nous faire compatir à l'atrocité quotidienne qu'il subit. Barbusse, lui, nous décrit vraiment beaucoup de personnages, souvent à peine esquissés, une bande de rouspéteurs pour lesquels on ne ressent pas forcément grand-chose, en tout cas, vis-à-vis desquels on n'est pas très attaché.
Étonnamment, le seul moment où Barbusse parvient à nous prendre aux tripes, à nous faire crever de chagrin, c'est lorsqu'il aborde le cas de la jeune femme, Eudoxie, pour laquelle Lamuse en pince, et que ce même Lamuse découvre quelques semaines plus tard, à moitié décomposée en creusant une tranchée. Ici, Barbusse obéit aux codes romanesques et c'est exceptionnellement bon, puissant comme jamais. La scène du soldat noyé parce qu'il n'arrive pas à sortir d'un trou d'obus à cause de la boue, vers la fin du roman est presque aussi intense et pour les mêmes raisons : on a eu le temps de s'attacher au personnage.
En revanche, quand il fait son Zola bas de gamme, à décrire avec un souci du terme poétique les bombardements, les bourbiers, les blessures, je trouve que le décalage entre l'horreur vécue et les termes pour l'exprimer est préjudiciable.
Le décalage, encore lui, est si grand entre ce pseudo lyrisme et l'authenticité des dialogues de poilus qui eux sentent le vécu à plein nez et qui jouent justes quasiment tout le temps est, d'après moi, mal senti. J'écris que les dialogues jouent juste quasiment tout le temps car il est manifeste que dans le dernier chapitre, intitulé L'Aube, les dialogues ne masquent que très grossièrement et très imparfaitement l'expression des convictions de l'auteur et cela sonne faux, malheureusement.
Balzac reprochait exactement cela à Hugo (à propos de ces dialogues) dans sa critique restée fameuse sur la Chartreuse de Parme de Stendhal (oui, je sais, c'est un peu compliqué, la critique concernait Stendhal mais il parle aussi un peu de Hugo et de quelques autres) ; le fait de mettre les paroles de l'auteur dans la bouche des personnages au lieu de s'oublier et de se mettre lui, l'auteur, dans la peau du personnage. (Hugo en tiendra d'ailleurs compte bien des années plus tard en écrivant Les Misérables et son fameux passage sur Waterloo.)
Au-delà de ces problèmes de construction romanesque, l'auteur décrit admirablement l'enfer de cette guerre, et de toutes les guerres en général. Il montre, selon moi de façon assez convaincante, que l'ennemi est au moins autant si ce n'est plus le gouvernement qui envoie ses enfants se faire tuer que les pauvres bougres d'en face qui font le même sale boulot en sens inverse. Tout cela, évidemment, pour des intérêts qui dépassent largement les infortunés soldats commis d'office.
Bref, souvenons-nous de cette leçon d'atrocité que nous évoque courageusement Henri Barbusse et demandons-nous qui est le véritable ennemi : l'État qui vous dit « Allez vous battre et fermez vos gueules ! » ou les pauvres types d'en face auxquels leur propre État a intimé le même ordre ? En outre, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, vraiment pas grand-chose à mettre sur le feu.
P. S. : Je suis allée récemment tâcher de retrouver la tombe de mon arrière-grand-père, tombé le 12 février 1915 à Souain-Perthes-lès-Hurlus lors de la fameuse et ô combien meurtrière première bataille de la Marne. Le cimetière y est parfaitement tondu et une adorable mousse recouvre le sol à beaucoup d'endroits. Pourtant, l'autre jour, rien qu'avec les fortes pluies et les rejets de terre sous forme de tortillons imputables aux vers de terre, j'avais les chaussures entièrement pleines de boues en moins de cinq minutes.
Donc, oui, j'imagine très bien la boue et le bourbier que cela pouvait être à l'époque quand rien qu'à marcher sur une pelouse bien entretenue on en a déjà plein ses bas de pantalon ! Je n'ai d'ailleurs pas réussi à retrouver la tombe de mon aïeul car les tombes sont disposées au hasard ou à peu près et j'avais l'impression de rejouer la scène du truand, à la fin du Bon, la Brute et le Truand quand il cherche une tombe précise dans un cimetière immense.
Mais j'ai été moins courageuse que lui, j'ai abandonné quand j'ai eu deux kilos de terre à chaque pied et que mon manteau a été entièrement transpercé par la fine pluie qui tombait alors sans discontinuer… On n'a pas tous la fibre héroïque, pardon, très cher aïeul (je reviendrai par temps sec).
J'ai été à la fois comblée et déçue. Comblée car oui, Henri Barbusse fut un témoin lucide de la Grande Guerre : pas qu'un témoin, mieux qu'un témoin, un acteur. Il sait parfaitement ce qu'est le front, l'arrière, tout. Il sait tout ça et il veut en témoigner. Entendons-nous bien, l'opinion que je vais émettre ne concerne absolument pas la valeur ou l'utilité du témoignage, qui tous deux, selon moi, sont indiscutables et indispensables.
Ce que je questionne, c'est la pertinence du format choisi. En effet, il n'est jamais très clair dans le Feu si l'on a affaire à un roman ou à un reportage journalistique ; on navigue constamment dans ce no-man's land inconfortable et pas trop bien maîtrisé d'après moi.
Il y a un côté Zola chez Barbusse, un côté exhaustif, un côté « je vais tout vous montrer et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. » En 1916, en plein conflit, ça se comprend, c'est défendable et même plus que souhaitable, mais c'est du ressort du journaliste, pas du romancier.
Ce qu'il nous explique très bien, c'est qu'à l'époque des faits, les journalistes étaient largement investis dans une mission de propagande et donc, seul le roman pouvait avoir les coudées franches pour accomplir le véritable travail d'information du public.
Soit. Je suis pleinement consciente des contraintes qui pesaient sur le romancier. Ajoutons-y la contrainte ô combien lourde et pressante du temps, l'impératif du témoignage RAPIDE. Je sais tout ça, le comprends et l'excuse amplement.
Toutefois, pour les lecteurs du XXIème siècle et de tous les siècles à venir, seul demeure le roman car le contexte et son urgence ont disparu. Et là, je ne puis m'empêcher de tiquer sur des problèmes inhérents à la construction romanesque et qui amoindrissent et la satisfaction du lecteur, et le pouvoir de conviction de l'oeuvre.
C'est l'écueil dans lequel ne tombe pas Erich Maria Remarque : il a bâti un vrai roman, avec tous les codes et les impératifs propres au roman, d'où son incroyable pouvoir de conviction. Henri Barbusse, lui, dit tout, absolument tout, si bien qu'il dilue son histoire.
Remarque se focalise sur un nombre volontairement limité de personnages, qui tous quittent la scène les uns après les autres pour cause de décès ou de blessure affligeante ; toujours dans un but romanesque précis qui fait mouche à chaque fois. En gros, Remarque a opéré un tri, fait une synthèse de son expérience du conflit là où Barbusse nous fait un reportage à chaud, sans trop avoir hiérarchisé ses informations.
Autre différence notable, Remarque utilise un narrateur qui a une identité, qui parle avec des mots simples de soldat, qui souffre et qui ressent la guerre. Barbusse, lui, se cache derrière une espèce d'ectoplasme qui est lui sans jamais être clairement assumé comme étant bien lui, qui porte un regard distancié sur ce qu'il vit et qui, du coup, nous distancie également. Si bien que j'ai ressenti, moi lectrice du XXIème s., beaucoup moins d'intensité chez Barbusse que chez Remarque, alors même que la violence et l'horreur décrites sont rigoureusement les mêmes.
Quand Remarque fait mourir un soldat, il a pris le soin au préalable de nous le faire connaître, de nous y attacher, de nous faire compatir à l'atrocité quotidienne qu'il subit. Barbusse, lui, nous décrit vraiment beaucoup de personnages, souvent à peine esquissés, une bande de rouspéteurs pour lesquels on ne ressent pas forcément grand-chose, en tout cas, vis-à-vis desquels on n'est pas très attaché.
Étonnamment, le seul moment où Barbusse parvient à nous prendre aux tripes, à nous faire crever de chagrin, c'est lorsqu'il aborde le cas de la jeune femme, Eudoxie, pour laquelle Lamuse en pince, et que ce même Lamuse découvre quelques semaines plus tard, à moitié décomposée en creusant une tranchée. Ici, Barbusse obéit aux codes romanesques et c'est exceptionnellement bon, puissant comme jamais. La scène du soldat noyé parce qu'il n'arrive pas à sortir d'un trou d'obus à cause de la boue, vers la fin du roman est presque aussi intense et pour les mêmes raisons : on a eu le temps de s'attacher au personnage.
En revanche, quand il fait son Zola bas de gamme, à décrire avec un souci du terme poétique les bombardements, les bourbiers, les blessures, je trouve que le décalage entre l'horreur vécue et les termes pour l'exprimer est préjudiciable.
Le décalage, encore lui, est si grand entre ce pseudo lyrisme et l'authenticité des dialogues de poilus qui eux sentent le vécu à plein nez et qui jouent justes quasiment tout le temps est, d'après moi, mal senti. J'écris que les dialogues jouent juste quasiment tout le temps car il est manifeste que dans le dernier chapitre, intitulé L'Aube, les dialogues ne masquent que très grossièrement et très imparfaitement l'expression des convictions de l'auteur et cela sonne faux, malheureusement.
Balzac reprochait exactement cela à Hugo (à propos de ces dialogues) dans sa critique restée fameuse sur la Chartreuse de Parme de Stendhal (oui, je sais, c'est un peu compliqué, la critique concernait Stendhal mais il parle aussi un peu de Hugo et de quelques autres) ; le fait de mettre les paroles de l'auteur dans la bouche des personnages au lieu de s'oublier et de se mettre lui, l'auteur, dans la peau du personnage. (Hugo en tiendra d'ailleurs compte bien des années plus tard en écrivant Les Misérables et son fameux passage sur Waterloo.)
Au-delà de ces problèmes de construction romanesque, l'auteur décrit admirablement l'enfer de cette guerre, et de toutes les guerres en général. Il montre, selon moi de façon assez convaincante, que l'ennemi est au moins autant si ce n'est plus le gouvernement qui envoie ses enfants se faire tuer que les pauvres bougres d'en face qui font le même sale boulot en sens inverse. Tout cela, évidemment, pour des intérêts qui dépassent largement les infortunés soldats commis d'office.
Bref, souvenons-nous de cette leçon d'atrocité que nous évoque courageusement Henri Barbusse et demandons-nous qui est le véritable ennemi : l'État qui vous dit « Allez vous battre et fermez vos gueules ! » ou les pauvres types d'en face auxquels leur propre État a intimé le même ordre ? En outre, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, vraiment pas grand-chose à mettre sur le feu.
P. S. : Je suis allée récemment tâcher de retrouver la tombe de mon arrière-grand-père, tombé le 12 février 1915 à Souain-Perthes-lès-Hurlus lors de la fameuse et ô combien meurtrière première bataille de la Marne. Le cimetière y est parfaitement tondu et une adorable mousse recouvre le sol à beaucoup d'endroits. Pourtant, l'autre jour, rien qu'avec les fortes pluies et les rejets de terre sous forme de tortillons imputables aux vers de terre, j'avais les chaussures entièrement pleines de boues en moins de cinq minutes.
Donc, oui, j'imagine très bien la boue et le bourbier que cela pouvait être à l'époque quand rien qu'à marcher sur une pelouse bien entretenue on en a déjà plein ses bas de pantalon ! Je n'ai d'ailleurs pas réussi à retrouver la tombe de mon aïeul car les tombes sont disposées au hasard ou à peu près et j'avais l'impression de rejouer la scène du truand, à la fin du Bon, la Brute et le Truand quand il cherche une tombe précise dans un cimetière immense.
Mais j'ai été moins courageuse que lui, j'ai abandonné quand j'ai eu deux kilos de terre à chaque pied et que mon manteau a été entièrement transpercé par la fine pluie qui tombait alors sans discontinuer… On n'a pas tous la fibre héroïque, pardon, très cher aïeul (je reviendrai par temps sec).
J'ai été amenée à lire le Feu des éditions Invenit dans le cadre d'un de mes cours. Nous devions choisir parmi une sélection d'ouvrages d'éditeurs indépendants de la région, et la violence hypnotisante de la couverture de cet album m'a tout de suite attirée. Et en commençant ma lecture, je me suis pris une claque !
Je n'avais jamais lu, ni même entendu parler du Feu d'Henri Barbusse. Pourtant ce roman, sous-titré Journal d'une escouade, est un des témoignages pionniers de la Grande Guerre. Publié en 1916, il est l'un des premiers à contredire ouvertement le discours officiel et à raconter la vérité sans filtre sur l'enfer des tranchées, la barbarie des combats et l'absurdité de la guerre. le Feu rencontre un important succès dès sa parution et obtient même le prix Goncourt en 1917.
Près d'un siècle après la parution de cette oeuvre emblématique, les éditions Invenit se sont emparées du Feu et en proposent leur vision dans un magnifique album. Bien plus qu'une simple réédition de ce célèbre texte, un véritable travail de (re)création a été fourni. Quatre parties structurent cet album : « Un drame humain », « La vie en ruine », « L'enfer » et « La mort en héritage ». Et dans chacune d'elles, une sélection d'extraits soigneusement choisis pour leur pertinence et où chaque mot sonne comme un coup de poing reçu en plein coeur. Bien que l'on ne lise alors qu'une petite partie du roman, la force du texte nous frappe de plein fouet et nous plonge au coeur d'un enfer à peine imaginable.
Lire la suite sur : https://lesmarquespagedunecroqueusedelivres.wordpress.com/2017/12/25/le-feu-henri-barbusse-et-francois-boucq/
Lien : https://lesmarquespagedunecr..
Je n'avais jamais lu, ni même entendu parler du Feu d'Henri Barbusse. Pourtant ce roman, sous-titré Journal d'une escouade, est un des témoignages pionniers de la Grande Guerre. Publié en 1916, il est l'un des premiers à contredire ouvertement le discours officiel et à raconter la vérité sans filtre sur l'enfer des tranchées, la barbarie des combats et l'absurdité de la guerre. le Feu rencontre un important succès dès sa parution et obtient même le prix Goncourt en 1917.
Près d'un siècle après la parution de cette oeuvre emblématique, les éditions Invenit se sont emparées du Feu et en proposent leur vision dans un magnifique album. Bien plus qu'une simple réédition de ce célèbre texte, un véritable travail de (re)création a été fourni. Quatre parties structurent cet album : « Un drame humain », « La vie en ruine », « L'enfer » et « La mort en héritage ». Et dans chacune d'elles, une sélection d'extraits soigneusement choisis pour leur pertinence et où chaque mot sonne comme un coup de poing reçu en plein coeur. Bien que l'on ne lise alors qu'une petite partie du roman, la force du texte nous frappe de plein fouet et nous plonge au coeur d'un enfer à peine imaginable.
Lire la suite sur : https://lesmarquespagedunecroqueusedelivres.wordpress.com/2017/12/25/le-feu-henri-barbusse-et-francois-boucq/
Lien : https://lesmarquespagedunecr..
Avant d' avoir lu le Feu, j'ignorais que l'on pouvait mourir noyé dans un trou d'obus, sur le champ de bataille.
Le livre de Barbusse est devenu un classique de cette littérature née d'une guerre aussi atroce qu'absurde (quelle guerre ne l'est pas? d'ailleurs)
Ce récit est l' hommage rendu à tous ces combattants, et en particulier à ceux qui ne s' en sont pas sortis ou en sont revenus mutilés, amoindris.
Des fragments de cette guerre atroce qui a fait se jeter pendant quatre horribles années, deux peuples l' un contre l'autre...et qui portait déjà le ferment putride ce celle d'après.
Le livre de Barbusse est devenu un classique de cette littérature née d'une guerre aussi atroce qu'absurde (quelle guerre ne l'est pas? d'ailleurs)
Ce récit est l' hommage rendu à tous ces combattants, et en particulier à ceux qui ne s' en sont pas sortis ou en sont revenus mutilés, amoindris.
Des fragments de cette guerre atroce qui a fait se jeter pendant quatre horribles années, deux peuples l' un contre l'autre...et qui portait déjà le ferment putride ce celle d'après.
J'ai reçu ce livre dans le cadre de Masse critique, merci à Babelio et aux éditions archipoche !
Le Feu sonne terriblement, profondément juste.
Le sujet est très dur, pourtant à aucun moment Barbusse ne sombre dans le pathos. En effet, si il a lui-même été au front et qu'il base le propos de son livre sur des faits dont il a été témoin, le soldat Barbusse, auteur et narrateur, préfère se mettre en retrait de l'histoire pour se concentrer sur ses camarades de combat. Peut-être est-ce par pudeur, ou plutôt pour rendre ainsi un ultime hommage aux membre de son escouade dont beaucoup ne reviendront pas de la guerre.
A travers 24 chapitres de longueurs variées, ce qui fait penser aux 24 heures d'une journée, Barbusse aborde les différents épisodes de la vie quotidienne de l'escouade. On découvre ainsi que la vie du poilu, c'est bien sûr les combats, mais aussi beaucoup, beaucoup d'attente. Il y a la seconde ligne, le cantonnement, les permissions, les corvées... toute une organisation autour du soldat d'infanterie que je ne soupçonnais pas : le ravitaillement, l'artillerie, le génie, l'administration... l'armée est une immense machine. La tension monte au fur et à mesure de la lecture, jusqu'au moment où enfin, les soldats vont se retrouver sous "le feu", mettant fin à l'attente des poilus mais aussi du lecteur.
Le soldat Barbusse dépeint d'une manière extrêmement réaliste l'atmosphère des tranchées. Il allie des descriptions de l'environnement et de l'action d'une grande qualité littéraire à des dialogues au vocabulaire souvent très "cru", qui retranscrit fidèlement le parler des poilus. Ce parti pris est justifié par un chapitre, "Les gros mots", dans lequel l'un de ses camarades le voyant écrire, lui demande de ne pas dénaturer leur parler, dans un souci de vérité et d'authenticité. Il en résulte donc une écriture très contrastée, mais qui se marrie très bien.
A travers le Feu qui est le premier roman sur la Grande Guerre, Barbusse dénonce le bourrage de crâne dans la presse et l'hypocrisie de la société bourgeoise, qui vit en sécurité et dans le confort à l'arrière et fait des profits sur la guerre et les souffrances des soldats. La dénonciation de la guerre devient indissociable de la critique politique, et l'on sent dans les dernières pages le pressentiment qu'a l'auteur d'une révolte du peuple, qui se manifestera avec la Révolution russe de 1917.
Tout cela fait du Feu un livre absolument essentiel pour saisir la réalité de la 1ère guerre mondiale et comprendre ses conséquences sur les mentalités et la vie politique des années 20 et 30.
Le Feu m'a permis de réaliser à quel point nous avons le devoir de nous souvenir de tous ces hommes qui ont souffert inutilement et ont été sacrifiés à la guerre.
Le Feu sonne terriblement, profondément juste.
Le sujet est très dur, pourtant à aucun moment Barbusse ne sombre dans le pathos. En effet, si il a lui-même été au front et qu'il base le propos de son livre sur des faits dont il a été témoin, le soldat Barbusse, auteur et narrateur, préfère se mettre en retrait de l'histoire pour se concentrer sur ses camarades de combat. Peut-être est-ce par pudeur, ou plutôt pour rendre ainsi un ultime hommage aux membre de son escouade dont beaucoup ne reviendront pas de la guerre.
A travers 24 chapitres de longueurs variées, ce qui fait penser aux 24 heures d'une journée, Barbusse aborde les différents épisodes de la vie quotidienne de l'escouade. On découvre ainsi que la vie du poilu, c'est bien sûr les combats, mais aussi beaucoup, beaucoup d'attente. Il y a la seconde ligne, le cantonnement, les permissions, les corvées... toute une organisation autour du soldat d'infanterie que je ne soupçonnais pas : le ravitaillement, l'artillerie, le génie, l'administration... l'armée est une immense machine. La tension monte au fur et à mesure de la lecture, jusqu'au moment où enfin, les soldats vont se retrouver sous "le feu", mettant fin à l'attente des poilus mais aussi du lecteur.
Le soldat Barbusse dépeint d'une manière extrêmement réaliste l'atmosphère des tranchées. Il allie des descriptions de l'environnement et de l'action d'une grande qualité littéraire à des dialogues au vocabulaire souvent très "cru", qui retranscrit fidèlement le parler des poilus. Ce parti pris est justifié par un chapitre, "Les gros mots", dans lequel l'un de ses camarades le voyant écrire, lui demande de ne pas dénaturer leur parler, dans un souci de vérité et d'authenticité. Il en résulte donc une écriture très contrastée, mais qui se marrie très bien.
A travers le Feu qui est le premier roman sur la Grande Guerre, Barbusse dénonce le bourrage de crâne dans la presse et l'hypocrisie de la société bourgeoise, qui vit en sécurité et dans le confort à l'arrière et fait des profits sur la guerre et les souffrances des soldats. La dénonciation de la guerre devient indissociable de la critique politique, et l'on sent dans les dernières pages le pressentiment qu'a l'auteur d'une révolte du peuple, qui se manifestera avec la Révolution russe de 1917.
Tout cela fait du Feu un livre absolument essentiel pour saisir la réalité de la 1ère guerre mondiale et comprendre ses conséquences sur les mentalités et la vie politique des années 20 et 30.
Le Feu m'a permis de réaliser à quel point nous avons le devoir de nous souvenir de tous ces hommes qui ont souffert inutilement et ont été sacrifiés à la guerre.
Merci aux éditions Archipoche et à Babelio pour cet envoi tombé pile dans ma boîte aux lettres. Ce sont de fins artilleurs. Heureusement que ce n'est qu'un livre.
Pourtant ce livre est bien plus puissant qu'un obus. Paru en 1916, en France, en plein effort de guerre, sous la forme d'un journal, il révèle le quotidien, les drames et les horreurs d'une escouade en première ligne dans les tranchées et suggère l'absurdité du conflit quand, dans un champ de boue , Allemands et Français se confondent et s'allongent les uns à côté des autres sans discernement , à bout de force.
Céline a hurlé son dégoût de la guerre -et de la vie en général- dans son « voyage au bout de la nuit ». Mais Barbusse se met en retrait de la narration, à aucun moment il ne parle de lui et il n'expose pas une rage comme Céline. Il s'en tient aux faits d'armes de ses compagnons.
Cependant, un message subliminal est sussuré, dans le fracas de fer et de feu, qui passe à travers la censure et les lignes du front : qu'on arrête le bourrage de crâne et toute cette boucherie !
Ce prix Goncourt, de 1916, est un centenaire toujours vif dans l'action et dans le style avec des dialogues que ne renieraient pas Dard ou Audiard.
C'est un témoignage qu'il faut avoir absolument lu pour comprendre ce qui se passe sur un même endroit occupé pendant 6 mois par deux énormes armées qui s'affrontent au corps à corps après avoir labouré la terre grâce à une artillerie incessante qui mélange le sang et le fer tout en exhumant ceux que les brancardiers n'ont pu ramasser lors de la précédente attaque...
Aujourd'hui il pleut et mes habits sont mouillés. Je les ai changés. Je ne vais pas dormir dans le froid, l'humidité, les rats et la vermine en attendant l'ordre d'avancer de nuit dans un boyau le fusil à la main. Je vais revoir ma famille et je pense à Cocon, Biquet, Poterloo, Fouillade et à la multitude, dont le nom orne les cimetières militaires , et qui n'ont jamais revu la leur.
Pourtant ce livre est bien plus puissant qu'un obus. Paru en 1916, en France, en plein effort de guerre, sous la forme d'un journal, il révèle le quotidien, les drames et les horreurs d'une escouade en première ligne dans les tranchées et suggère l'absurdité du conflit quand, dans un champ de boue , Allemands et Français se confondent et s'allongent les uns à côté des autres sans discernement , à bout de force.
Céline a hurlé son dégoût de la guerre -et de la vie en général- dans son « voyage au bout de la nuit ». Mais Barbusse se met en retrait de la narration, à aucun moment il ne parle de lui et il n'expose pas une rage comme Céline. Il s'en tient aux faits d'armes de ses compagnons.
Cependant, un message subliminal est sussuré, dans le fracas de fer et de feu, qui passe à travers la censure et les lignes du front : qu'on arrête le bourrage de crâne et toute cette boucherie !
Ce prix Goncourt, de 1916, est un centenaire toujours vif dans l'action et dans le style avec des dialogues que ne renieraient pas Dard ou Audiard.
C'est un témoignage qu'il faut avoir absolument lu pour comprendre ce qui se passe sur un même endroit occupé pendant 6 mois par deux énormes armées qui s'affrontent au corps à corps après avoir labouré la terre grâce à une artillerie incessante qui mélange le sang et le fer tout en exhumant ceux que les brancardiers n'ont pu ramasser lors de la précédente attaque...
Aujourd'hui il pleut et mes habits sont mouillés. Je les ai changés. Je ne vais pas dormir dans le froid, l'humidité, les rats et la vermine en attendant l'ordre d'avancer de nuit dans un boyau le fusil à la main. Je vais revoir ma famille et je pense à Cocon, Biquet, Poterloo, Fouillade et à la multitude, dont le nom orne les cimetières militaires , et qui n'ont jamais revu la leur.
Ce livre est difficile à lire, le langage est difficile à comprendre puisque le vocabulaire utilisé est celui des soldats au coeur des tranchées. Il y a beaucoup de dialogues, mais aussi de longs passages descriptifs. Les personnages ne sont pas nombreux, le narrateur est accompagné du début jusqu'à la fin par les mêmes camarades de guerre. le début est un peu long à démarrer, l'auteur raconte tous les détails, c'est-à-dire la gare, le train qui les emmène sur les champs de batailles, le voyage, les poilus...
Sans doute le meilleur “roman” sur la Grande Guerre. Avec un paquet de guillemets vu la masse de recherches et la part d'autobiographie. Une documentation de première main puisque Barbusse passe les deux premières années de la guerre dans les tranchées. Il SAIT de quoi il parle.
Le récit est très direct, “coup de poing” dirait-on aujourd'hui, très cru aussi bien dans ce qu'il décrit que dans la façon de le faire. L'argot des tranchées n'a pas que vocation à enrober le récit d'authenticité, c'est la langue de ceux qui ont passé assez de temps avec les pieds dans la merde pour s'économiser les artifices d'une bienséance hypocrite.
Réaliste et minutieux, le Feu dépeint l'enfer des quatre éléments déclenchés par un cinquième, l'Homme (Mila Jovovitch n'était pas née). La pluie, le froid et surtout la boue, qui aurait pu lui donner son titre tellement on patauge dans un monde de gadoue. Enfin, le feu. Celui d'une guerre qui se donne les moyens. Moderne, totale, inédite. Entre les escouades pulvérisées par l'artillerie et les charges à la baïonnette, les poilus (les nôtres comme ceux d'en face) découvrent la modernité et retrouvent le Moyen Age.
Une boucherie d'une autre trempe que les “grands” films de guerre, qui te balancent des discours patriotiques justificateurs, de la violence esthétisée “qui rend bien à l'écran”, sur fond de musique héroïque et pompière.
Barbusse, la guerre, la vraie. Et il la déteste.
Lien : https://unkapart.fr/critique..
Le récit est très direct, “coup de poing” dirait-on aujourd'hui, très cru aussi bien dans ce qu'il décrit que dans la façon de le faire. L'argot des tranchées n'a pas que vocation à enrober le récit d'authenticité, c'est la langue de ceux qui ont passé assez de temps avec les pieds dans la merde pour s'économiser les artifices d'une bienséance hypocrite.
Réaliste et minutieux, le Feu dépeint l'enfer des quatre éléments déclenchés par un cinquième, l'Homme (Mila Jovovitch n'était pas née). La pluie, le froid et surtout la boue, qui aurait pu lui donner son titre tellement on patauge dans un monde de gadoue. Enfin, le feu. Celui d'une guerre qui se donne les moyens. Moderne, totale, inédite. Entre les escouades pulvérisées par l'artillerie et les charges à la baïonnette, les poilus (les nôtres comme ceux d'en face) découvrent la modernité et retrouvent le Moyen Age.
Une boucherie d'une autre trempe que les “grands” films de guerre, qui te balancent des discours patriotiques justificateurs, de la violence esthétisée “qui rend bien à l'écran”, sur fond de musique héroïque et pompière.
Barbusse, la guerre, la vraie. Et il la déteste.
Lien : https://unkapart.fr/critique..
Ce livre a comme point de départ les notes prises par Barbusse dès le début de la guerre, notes qu'il envoyait à L'oeuvre pour être publiées et rendre compte de la vie des soldats « Il s'agit de décrire une escouade de soldats à travers les diverses phases et péripéties de la campagne ». le journal censure ces notes, en enlevant les passages critiques par rapport à la guerre et à la façon dont elle est menée, et aussi par rapport au vocabulaire employé. Par ailleurs cette publication suscitant un vrai intérêt, Barbusse décide d'en faire un livre, qui sera publié fin 1916, et obtiendra immédiatement le prix Goncourt.
Le livre se situe entre reportage et création littéraire. Les personnages décrits dans le feu sont inspirés par les soldats rencontrés par Barbusse, les événements décrits sont en grande partie ceux qu'il a vécus, le langage employé dans les dialogues est celui parlé réellement dans les tranchées. Mais en même temps Barbusse est un écrivain, et il utilise aussi un langage littéraire très lyrique dans les descriptions, et il est a un objectif qui dépasse la simple description de faits, il s'agit clairement d'un manifeste anti-militariste et d'une critique sociale, qui s'appuie sur la description et l'inhumanité de la guerre comme argument.
S'opposent dans le livre, l'humanité des soldats, hommes simples, dont nous découvrons des bribes de vies antérieures à la guerre, et que nous suivons dans les gestes du quotidien (cantonnement, repas…) et l'atrocité et l'horreur des combats, la souffrance, la mort sans raison. Et monte peu à peu le refus, l'idée « de faire la guerre à la guerre ».
Le livre est composé de chapitres qui décrivent chacun un moment particulier, limité dans le temps et centré autour d'un thème, il n'y a pas de liaison véritable entre les chapitres, même si nous retrouvons les personnages, qui sont une sorte de fil rouge. Les qualités littéraires de l'oeuvre sont réelles et font que l'on suit ces soldats avec beaucoup d'intérêt, même si les dialogues, sont parfois un peu plus difficiles à comprendre, puisque Barbusse a voulu restituer le parler vrai de ses personnages, qui étaient des gens simples, et ne s'exprimaient pas comme dans les livres.
Un de grand atout de ce livre est son authenticité, l'auteur raconte des choses qu'il a vécues et nous donne son ressenti d'une façon très directe, c'est pour cela que ce livre touche. Mais évidemment, à l'inverse, cette immédiateté dans la description, ne permet pas un certain recul et une construction plus littéraire peut être plus ambitieuse. Néanmoins un oeuvre plus qu'intéressante, dont la lecture marque incontestablement.
Le livre se situe entre reportage et création littéraire. Les personnages décrits dans le feu sont inspirés par les soldats rencontrés par Barbusse, les événements décrits sont en grande partie ceux qu'il a vécus, le langage employé dans les dialogues est celui parlé réellement dans les tranchées. Mais en même temps Barbusse est un écrivain, et il utilise aussi un langage littéraire très lyrique dans les descriptions, et il est a un objectif qui dépasse la simple description de faits, il s'agit clairement d'un manifeste anti-militariste et d'une critique sociale, qui s'appuie sur la description et l'inhumanité de la guerre comme argument.
S'opposent dans le livre, l'humanité des soldats, hommes simples, dont nous découvrons des bribes de vies antérieures à la guerre, et que nous suivons dans les gestes du quotidien (cantonnement, repas…) et l'atrocité et l'horreur des combats, la souffrance, la mort sans raison. Et monte peu à peu le refus, l'idée « de faire la guerre à la guerre ».
Le livre est composé de chapitres qui décrivent chacun un moment particulier, limité dans le temps et centré autour d'un thème, il n'y a pas de liaison véritable entre les chapitres, même si nous retrouvons les personnages, qui sont une sorte de fil rouge. Les qualités littéraires de l'oeuvre sont réelles et font que l'on suit ces soldats avec beaucoup d'intérêt, même si les dialogues, sont parfois un peu plus difficiles à comprendre, puisque Barbusse a voulu restituer le parler vrai de ses personnages, qui étaient des gens simples, et ne s'exprimaient pas comme dans les livres.
Un de grand atout de ce livre est son authenticité, l'auteur raconte des choses qu'il a vécues et nous donne son ressenti d'une façon très directe, c'est pour cela que ce livre touche. Mais évidemment, à l'inverse, cette immédiateté dans la description, ne permet pas un certain recul et une construction plus littéraire peut être plus ambitieuse. Néanmoins un oeuvre plus qu'intéressante, dont la lecture marque incontestablement.
Avec Dorgelès, Genevoix, Duhamel, Jünger, Remarque, Giono, Barbusse nous livre une vision horrifiée de ce que fut la boucherie 14-18 et de ce que ces hommes ont vécu, noyés dans la boue, broyés par les obus, affamés et dévorés par les poux. Il faut les relire sans cesse pour ne jamais oublier ce qu'est la guerre...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Henri Barbusse (31)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Chefs-d'oeuvre de la littérature
Quel écrivain est l'auteur de Madame Bovary ?
Honoré de Balzac
Stendhal
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
8 questions
11242 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chef d'oeuvre intemporels
, classiqueCréer un quiz sur ce livre11242 lecteurs ont répondu