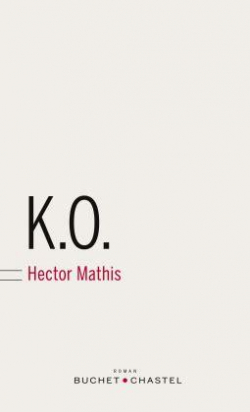Critiques filtrées sur 3 étoiles
"Me voilà bien seul, maintenant. Ici le froid dévore tout. le vent flotte et la lumière s'épuise." Voici la manière dont commence K.O. le rythme est donné, l'univers du roman dépeint, en cet incipit. le lecteur est désormais prévenu, l'atmosphère de l'histoire risque d'être pesante.
Sitam, jeune de banlieue, un peu paumé dans son époque, rêve sa vie, erre dans la ville. Il a une passion pour la musique et plus particulièrement le jazz. Il tombe amoureux de Capu, dite la « Môme Capu » (qui n'est pas sans rappeler la Môme Piaf et son univers parisien). Un peu bohème, ils vivent au jour le jour jusqu'au choc qui viendra entamer l'insouciance et la légèreté de ces deux êtres. Les voilà confronter à la réalité, au choc et au chaos des attentats, telle une guerre en plein Paris. Ils décident de prendre la fuite, de quitter ce monde chaotique, en perdition pour un ailleurs.
Le style du roman est particulier, haletant. Comme le disent beaucoup de critiques, le roman est comme un voyage au bout de la nuit. Référence à Céline dont l'auteur avoue volontiers sa passion pour l'auteur.
Cependant, le livre m'est totalement tombé des mains. Pas par manque de style, non, pas que la lecture soit désagréable mais je n'ai pas été emballée par ce roman. Peut-être n'était-ce pas le bon moment, tout simplement, peut-être était-ce l'écriture de Hector Mathis qui ne m'a pas séduite. Un texte réalisé telle une partition de jazz avec ses modulations, ses changements, ses improvisations… Bref, je me suis essoufflée. Dommage ! Je suis décidément sceptique face à ces livres de la rentrée littéraire dont la plupart des romans sont décevants avec des thématiques tragiques, des romans où tout n'est que désespoir. Est-ce la société actuelle qui veut cela ? « La vie ce n'est qu'une foutue partition pour détraqués » dit le roman… Quel optimisme ! Dans tous les cas, ce n'est pas la littérature que j'ai envie de lire pour le moment.
Malgré tout, K.O. peut être un véritable choc, un uppercut dirigé vers le lecteur qui plaira certainement aux amateurs du genre.
Merci à Babelio et aux éditions Buchet Chastel.
Sitam, jeune de banlieue, un peu paumé dans son époque, rêve sa vie, erre dans la ville. Il a une passion pour la musique et plus particulièrement le jazz. Il tombe amoureux de Capu, dite la « Môme Capu » (qui n'est pas sans rappeler la Môme Piaf et son univers parisien). Un peu bohème, ils vivent au jour le jour jusqu'au choc qui viendra entamer l'insouciance et la légèreté de ces deux êtres. Les voilà confronter à la réalité, au choc et au chaos des attentats, telle une guerre en plein Paris. Ils décident de prendre la fuite, de quitter ce monde chaotique, en perdition pour un ailleurs.
Le style du roman est particulier, haletant. Comme le disent beaucoup de critiques, le roman est comme un voyage au bout de la nuit. Référence à Céline dont l'auteur avoue volontiers sa passion pour l'auteur.
Cependant, le livre m'est totalement tombé des mains. Pas par manque de style, non, pas que la lecture soit désagréable mais je n'ai pas été emballée par ce roman. Peut-être n'était-ce pas le bon moment, tout simplement, peut-être était-ce l'écriture de Hector Mathis qui ne m'a pas séduite. Un texte réalisé telle une partition de jazz avec ses modulations, ses changements, ses improvisations… Bref, je me suis essoufflée. Dommage ! Je suis décidément sceptique face à ces livres de la rentrée littéraire dont la plupart des romans sont décevants avec des thématiques tragiques, des romans où tout n'est que désespoir. Est-ce la société actuelle qui veut cela ? « La vie ce n'est qu'une foutue partition pour détraqués » dit le roman… Quel optimisme ! Dans tous les cas, ce n'est pas la littérature que j'ai envie de lire pour le moment.
Malgré tout, K.O. peut être un véritable choc, un uppercut dirigé vers le lecteur qui plaira certainement aux amateurs du genre.
Merci à Babelio et aux éditions Buchet Chastel.
Sitam est un détraqué de la vie qui cherche sur quelle partition il pourrait jouer la sienne. Il se disperse entre musique et écriture, barguigne entre nomadisme et sédentarisation, se perd entre Paris et les Pays-Bas, tortille et tergiverse entre compagnie et solitude.
K.O. restitue pour le lecteur le périple de Sitam et de son amie la môme Capu. C'est l'urgence et la panique qui les mettra à bord de la 309 : s'échapper de Paris et des attentats qui enflamment les capitales européennes, s'éloigner de la tenancière du bar de « la grisâtre » et de sa bavure tragique et plus tard nier la maladie pour la tenir à distance … C'est l'urgence, qui transparaît dans le rythme de l'écriture, des phrases courtes qui cognent et martèlent, c'est la musique qui habite l'écrivain fiévreux qui donne l'allure et c'est la poésie qui harmonise l'ensemble.
C'est ce que j'ai préféré dans le livre, une musicalité, un rythme, une précipitation dans l'écriture. Mais il n'y a pas eu de vraie rencontre entre Sitam et moi. L'intrigue est trop légère, les comparses trop superficiels pour me mettre en mode « lecture saisissante et palpitante ».
Je remercie Babelio et les éditions Buchet.Chastel pour leur confiance.
K.O. restitue pour le lecteur le périple de Sitam et de son amie la môme Capu. C'est l'urgence et la panique qui les mettra à bord de la 309 : s'échapper de Paris et des attentats qui enflamment les capitales européennes, s'éloigner de la tenancière du bar de « la grisâtre » et de sa bavure tragique et plus tard nier la maladie pour la tenir à distance … C'est l'urgence, qui transparaît dans le rythme de l'écriture, des phrases courtes qui cognent et martèlent, c'est la musique qui habite l'écrivain fiévreux qui donne l'allure et c'est la poésie qui harmonise l'ensemble.
C'est ce que j'ai préféré dans le livre, une musicalité, un rythme, une précipitation dans l'écriture. Mais il n'y a pas eu de vraie rencontre entre Sitam et moi. L'intrigue est trop légère, les comparses trop superficiels pour me mettre en mode « lecture saisissante et palpitante ».
Je remercie Babelio et les éditions Buchet.Chastel pour leur confiance.
Couverture épurée, titre minimal, que peut bien receler ce livre ? Un narrateur personnage avoue dès les premières lignes ce que lui contient. Il « pense à la littérature, à la musique, [qu'il] n'a plus que ça dans l'estomac » (p.9). Entrant dans un cabane pour s'abriter, il rencontre un vieil homme auquel il raconte son histoire. Sitam, jeune homme pauvre d'un quartier défavorisée, choisit de fuir Paris avec ses amis, Capu et Benji, après des attentats. Les lieux traversés, imprégnés de méfiance et de douleur, posent toujours la question de la survie : comment vas-tu gagner de l'argent pour vivre jusqu'à demain ? Les personnages ne peuvent jamais vraiment se reposer. Comme le lecteur, d'ailleurs, toujours retenu par le rythme du récit.
Le style a vite fait de prendre sa place : rythmes cassés, effrénés, dislocations et inversions à la pelle, argot parfois vieillot et bousculades imprévues. On pense à Céline et au Voyage, à la fuite du docteur Destouches dans D'un Château l'autre. le style passe sans trop d'encombres et fraie son chemin propre, mais peut s'avérer dépassé à certains moments. Je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que le temps du récit était plus proche de moi que de Bardamu et son auteur. Il m'a fallu attendre la moitié du livre pour être convaincu, comme si peu à peu, l'auteur se rapprochait réellement d'un langage oral plus actuel, plus libre et moins encrassé de vieilleries – peut-être moins réfléchi. À d'autres moments, le livre prend soudainement des pincettes, sort quelques beaux mots qui semblent tombés du ciel. Tandis que la syntaxe, aux clauses disloquées trop présentes, s'alourdit au détriment du nécessaire. Et cela pêche parfois la musicalité recherchée du texte.
Car musique il y a, évidemment. Si Sitam n'en joue pas, il en écoute. Et même du bruit, du vacarme, quitte à lui donner le nom de musique après l'avoir vécu. On aime entendre les machines, les gens et les rues. Mais lorsque la littérature pointe le bout de son nez et qu'il y a une tentative de mélange entre les deux … aïe. Sitam pense qu'il faut écrire comme le jazz, que sa vie est une partition, etc. Autres comparaisons et métaphores. le tout, plutôt bancal. Trop distant, pas assez entrelacé, comme si des choses superposées essayaient de se mélanger, mais trop tardivement. On sent l'importance de chaque élément pour l'auteur, mais le mix des deux semblent ici encore trop artificiel. Cette note à côté du temps ne se rattrappe pas au cours du roman. J'ai cru qu'il en serait de même avec les attentats…
Les premiers qui ont lieu à Paris se font rapidement, presque discrets même, au point que la réaction de Sitam paraît démesurée. Mais passons jusqu'en Hollande. La focalisation en macro sur le narrateur et son monde font oublier le contexte de peur qui enveloppe l'Europe qui ne montre son aileron que par le biais des médias. Quand un nouvel attentat vient rappeler le danger. On s'y accroche ferme. Pile dans le temps. Sitam à l'hôpital – décrit avec une finesse terrible (« Tout l'imaginaire morbide était là, se déployant sur le gris des murs, semblant nous engloutir l'infirmière et moi », p.127) – voit défiler les blessés, attendant son tour. Pas de surplus dramatique. Lui souffre d'une maladie, il n'est pas concerné directement par l'attentat. Et on comprend ce choix de faire des attentats un motif discret, comme un objet du quotidien qui soudainement se montre, avant qu'on retourne à ses occupations. Puis Sitam narre son passage dans les salles, son propre diagnostic, le retour à soi. Soi qui est bien senti, à la fois socialement et physiquement. Maladie inattendue, qui permet de donner de la tripe à l'ouvrage. « Dans l'estomac » (p.9), enfin en voilà plus. D'autres lignes plus crues viennent réveiller des réminiscences céliniennes (ou parfois une proximité avec Artaud – « Éjaculation du mauvais sang ! La jouissance de l'insupportable », p.162 – offrant un aperçu de ce corps bouillant, malade et plein à craquer de choses à nous livrer). Ce mouvement est ici bien décrit : on voit le monde souffrir, puis on en revient insensiblement à soi, à ses problèmes. La santé défaillante s'ajoute à la précarité.
Croque-poussière. Voilà les pauvres. Les rejetés dont vient Sitam, qui gentiment, disparaissent : « le génocide des croque-poussière a commencé, lentement. Bientôt plus personne n'échappera à la bourgeoisie. [...] Bourgeois classe moyenne, bourgeois crève la dalle, mais bourgeois tout de même » (p.17). Cette pique n'est pas la seul, et l'auteur rend avec force les idées révoltées de certains personnages, les critiques cyniques contre le monde bourgeois et le sentiment de délaissement par les politiciens. de la colère, mais pas au point de ressentir quelqu'un de « furieux permanent » (p.162) en Sitam. Suffisamment pour se sentir chauffer à l'intérieur, en tant que lecteur.
Alors que contient ce livre ? Un test, je dirais. Convaincant épisodiquement, mais surtout porteur d'un nouveau champ du possible dans la littérature actuelle. Un roman qui a le mérite de vouloir dire autre chose que de la philosophie au rabais et du développement personnel romancé. Un premier coup, juste de quoi étourdir un peu. Un style à affiner, des éléments à lier avec plus de profondeur, pour que la musique dépasse le rang d'outil formel et prenne chair. Une légèreté à travailler encore, pour que cette phrase : « le plus terrible doit être léger pour accéder à la musique » (p.177), sonne juste au sujet de la prochaine surprise – j'espère plus virulente encore ! – que réserve Hector Mathis.
PS : je tiens à souligner le beau travail d'édition qu'offre la maison Buchet/Chastel, la présentation du texte est impeccable !
Le style a vite fait de prendre sa place : rythmes cassés, effrénés, dislocations et inversions à la pelle, argot parfois vieillot et bousculades imprévues. On pense à Céline et au Voyage, à la fuite du docteur Destouches dans D'un Château l'autre. le style passe sans trop d'encombres et fraie son chemin propre, mais peut s'avérer dépassé à certains moments. Je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que le temps du récit était plus proche de moi que de Bardamu et son auteur. Il m'a fallu attendre la moitié du livre pour être convaincu, comme si peu à peu, l'auteur se rapprochait réellement d'un langage oral plus actuel, plus libre et moins encrassé de vieilleries – peut-être moins réfléchi. À d'autres moments, le livre prend soudainement des pincettes, sort quelques beaux mots qui semblent tombés du ciel. Tandis que la syntaxe, aux clauses disloquées trop présentes, s'alourdit au détriment du nécessaire. Et cela pêche parfois la musicalité recherchée du texte.
Car musique il y a, évidemment. Si Sitam n'en joue pas, il en écoute. Et même du bruit, du vacarme, quitte à lui donner le nom de musique après l'avoir vécu. On aime entendre les machines, les gens et les rues. Mais lorsque la littérature pointe le bout de son nez et qu'il y a une tentative de mélange entre les deux … aïe. Sitam pense qu'il faut écrire comme le jazz, que sa vie est une partition, etc. Autres comparaisons et métaphores. le tout, plutôt bancal. Trop distant, pas assez entrelacé, comme si des choses superposées essayaient de se mélanger, mais trop tardivement. On sent l'importance de chaque élément pour l'auteur, mais le mix des deux semblent ici encore trop artificiel. Cette note à côté du temps ne se rattrappe pas au cours du roman. J'ai cru qu'il en serait de même avec les attentats…
Les premiers qui ont lieu à Paris se font rapidement, presque discrets même, au point que la réaction de Sitam paraît démesurée. Mais passons jusqu'en Hollande. La focalisation en macro sur le narrateur et son monde font oublier le contexte de peur qui enveloppe l'Europe qui ne montre son aileron que par le biais des médias. Quand un nouvel attentat vient rappeler le danger. On s'y accroche ferme. Pile dans le temps. Sitam à l'hôpital – décrit avec une finesse terrible (« Tout l'imaginaire morbide était là, se déployant sur le gris des murs, semblant nous engloutir l'infirmière et moi », p.127) – voit défiler les blessés, attendant son tour. Pas de surplus dramatique. Lui souffre d'une maladie, il n'est pas concerné directement par l'attentat. Et on comprend ce choix de faire des attentats un motif discret, comme un objet du quotidien qui soudainement se montre, avant qu'on retourne à ses occupations. Puis Sitam narre son passage dans les salles, son propre diagnostic, le retour à soi. Soi qui est bien senti, à la fois socialement et physiquement. Maladie inattendue, qui permet de donner de la tripe à l'ouvrage. « Dans l'estomac » (p.9), enfin en voilà plus. D'autres lignes plus crues viennent réveiller des réminiscences céliniennes (ou parfois une proximité avec Artaud – « Éjaculation du mauvais sang ! La jouissance de l'insupportable », p.162 – offrant un aperçu de ce corps bouillant, malade et plein à craquer de choses à nous livrer). Ce mouvement est ici bien décrit : on voit le monde souffrir, puis on en revient insensiblement à soi, à ses problèmes. La santé défaillante s'ajoute à la précarité.
Croque-poussière. Voilà les pauvres. Les rejetés dont vient Sitam, qui gentiment, disparaissent : « le génocide des croque-poussière a commencé, lentement. Bientôt plus personne n'échappera à la bourgeoisie. [...] Bourgeois classe moyenne, bourgeois crève la dalle, mais bourgeois tout de même » (p.17). Cette pique n'est pas la seul, et l'auteur rend avec force les idées révoltées de certains personnages, les critiques cyniques contre le monde bourgeois et le sentiment de délaissement par les politiciens. de la colère, mais pas au point de ressentir quelqu'un de « furieux permanent » (p.162) en Sitam. Suffisamment pour se sentir chauffer à l'intérieur, en tant que lecteur.
Alors que contient ce livre ? Un test, je dirais. Convaincant épisodiquement, mais surtout porteur d'un nouveau champ du possible dans la littérature actuelle. Un roman qui a le mérite de vouloir dire autre chose que de la philosophie au rabais et du développement personnel romancé. Un premier coup, juste de quoi étourdir un peu. Un style à affiner, des éléments à lier avec plus de profondeur, pour que la musique dépasse le rang d'outil formel et prenne chair. Une légèreté à travailler encore, pour que cette phrase : « le plus terrible doit être léger pour accéder à la musique » (p.177), sonne juste au sujet de la prochaine surprise – j'espère plus virulente encore ! – que réserve Hector Mathis.
PS : je tiens à souligner le beau travail d'édition qu'offre la maison Buchet/Chastel, la présentation du texte est impeccable !
GUÈRE PLUS O.K. QUE K.O.
Être un jeune homme de vingt-quatre ans, "sortir" de la banlieue (sous-entendue : parisienne, puisqu'il est connu que, définitivement, il n'est de bon bec que de Paris et de "vraie" banlieue, sans avoir à citer laquelle, que d'Île de France), avoir été parolier et écrire du rap mais croire, encore, en la force du livre, sans pour autant crier au "courage", comme il est habituel de le faire, souvent par facilité, souvent parce qu'on a rien d'autre à dire (comme si l'expression d'un art devait absolument ressortir et avant tout de cette qualité-là), on peut tout de même estimer cela méritoire. D'autant qu'il y croit, Hector Mathis, à la pérennité de l'oeuvre écrite, à sa primordialité, quand bien même la musique est de tous ses environs, qu'elle aussi est affaire de style et, bien plus encore, de rythme ; il y met du sien pour nous montrer, nous rappeler comme cet acte lui est essentiel, viscéral, inhérent et constitutif de tout son être. Urgent. Rien moins. Et à condition de prendre ce texte pour ce qu'il est en large part, quoi que jamais totalement : un roman intensément intime sans être forcément auto-biographique. du moins, jamais tout à fait.
Mais reprenons.
K.O., c'est, avant toute autre chose, l'histoire de Sitam, un jeune un peu pommé, un peu artiste (dans l'âme), un peu sans le sous et qui, son désir de littérature mis à part, se fiche éperdument des représentations et obligations de notre monde "post-moderne", conchie ses poses et ses rêves bourgeois, aime rien moins que l'errance, la gratuité des relations - et son corollaire : l'absence d'attachement total, définitif, du moins en apparence -, la liberté - jusqu'à un certain point -.
Mais K.O., c'est aussi le roman d'une - longue - fuite. Fuite devant les remous que vivent nombres de pays d'Europe (on nage dans une vague ambiance d'apocalypse mal définie quoi que, semble-t-il, générale), sans qu'on en sache beaucoup plus ; fuite du coeur de Paris dont on apprendra au détour d'une phrase que les bombes y ont fait entendre leur souffle de mort et que les forces de l'ordre y pullulent ; fuite de la banlieue - "La Grisâtre " - devant les risques de poursuites judiciaires inopportunes, après que son ami barman ait pris une balle des mains de sa maîtresse oublieuse et alcoolisée ; fuite dans un autre pays, un lieu dont on ne connait pas la langue (la Hollande), une capitale dont il ne sait aucune règle, où il ne connait personne en dehors de sa "môme" qui l'a accompagné-là ; fuite de soi-même et de ce que les éventuelles racines peuvent dire de vous (à commencer par les mots, inéchangeables désormais) et vous renvoyer à la trogne. Fuite de l'autre, l'aimée, l'aimante, "la môme", comme on disait "la môme Piaf" au temps jadis, en ces temps si lointains où une môme, c'était déjà plus qu'un flirt mais moins qu'une épouse, avec toute la tendresse (un rien paternaliste et sexiste) en dedans, mais qu'il va abandonner par peur de lui, de ce qui vient de lui tomber dessus, oui, c'est vachard, un truc dont on sait qu'on ne guérira jamais, à quelques vingt piges. D'ailleurs, ce coup de semonce médical (un rien ridicule, hors contexte. Et d'ailleurs assez maladroitement, naïvement conté, derrière le besoin de s'essayer à du Kafka hospitalier, comme s'il s'agissait d'un nouveau Château en blouses blanches - l'hommage est visible. Trop -), ça va être le point de départ de son ultime fuite : celle au cours de laquelle il abandonne môme, ami blessé retrouvé, relation de travail forte d'avec un imprimeur libertaire, intellectuel et apôtre résolut du jeu de mot et de la charade à tiroirs (avec, en prime, une plongée dans les classiques du genre dont l'auteur aurait pu se passer sans dommage : "Vic tue Ail", et compagnie). Cependant, cette fuite terminale lui permet aussi de se retrouver en compagnie d'Archibald, un de ces derniers "mange-poussière" que l'embourgeoisement généralisé n'a pas encore atteint - n'atteindra jamais -, un "détraqué" comme Sitam, saxophoniste cacochyme ayant loupé sa carrière (et sa fille) mais pas totalement aveugle puisqu'il sait comme la place du jeune littérateur en herbe n'est pas ici, perdu dans le parc d'un château aux fausses et baroques féeries en ruines et que le jeune homme surnomme de manière générique "le domaine" (une autre interprétation de l'Extension du domaine de la lutte ? La filiation ne plairait peut-être pas à son auteur mais, à une génération d'intervalle, les points communs sont évidents).
Roman du désenchantement, roman de la fuite face au temps présent, invariablement moche et violent, face aux engagements pour soi-même ou pour les autres, roman d'une révolte sans révolution possible, ou l'aigreur le cède souvent à une forme de politiquement correct de l'incorrect qui refuse de se voir tel : les envolées contre les bourgeois, contre nos souffreteuses démocraties, contre la vulgarité et la médiocrité ambiantes, la "modernitude" technologique, l'idée que nous en sommes à la fin d'un monde - DU monde ? - dont il ne resterait plus qu'à rédiger l'épitaphe (je reprends les propres mots de Sitam/Mathis en verlan) sont très certainement sincères et, pour une large part, nous les partageons... Mais elles sont exprimées avec une telle naïveté - niaiserie ? - qu'elle finissent souvent à plat ou, pire encore, parfaitement hors contexte et sans grande profondeur car donnant généralement dans l'expectoration malhabile, dans l'expression un rien convenue d'un mal être qui peine à se définir pour ce qu'il est réellement : l'impossibilité fondamentale à être dans cet univers désenchanté. Roman du Je (du moi-je) comme ultime fin - même terne, déprimé et sombre - de tout, O.K. pourrait presque passer pour une auto-fiction, n'était que cela se déroule dans des temps qui ne sont pas tout à fait les nôtres - voire ! Car en étirant un peu le propos, l'Europe qu'Hector Mathis décrit, sans détail précis, ce pourrait-être celle de l'après Charlie Hebdo, cette Europe qui oscille entre peur horrifique à l'égard du terrorisme, réel ou "ressenti", et reprise en main liberticides des gouvernants sous prétexte, véridique et fallacieux à la fois, de la lutte contre les précédents cités -, un texte dans lequel les proches, supposés ou de passage, de Sitam n'en sont, finalement, que les faire-valoir très flous, aux visages et aux psychologies très peu définis, quasiment interchangeables, comme si ce soleil terne qu'est le narrateur n'avait plus assez de force pour éclairer les reliefs de ses semblables avec la force d'une lumière intérieure en sursis, tellement pâlichonne et auto-centrée.
Certes, il ne se passe pas grand chose au cours de ces quelques deux cents pages tenant autant du road-movie sans cheminement réel (puisque notre narrateur finit par tourner globalement en rond) que du roman grisâtre - à l'instar de cette banlieue elle-même très floue - à défaut d'être noir. Mais, en soi, cela n'est aucunement la marque d'un mauvais ouvrage. On peut exprimer une foultitude de choses, être passionnant, bouleversant parfois, avec un personnage totalement immobile, par le biais d'une oeuvre contemplative, onirique, dense ou en ne décrivant qu'une seule et même action jusqu'à en atteindre l'acmé. La littérature contemporaine est pleine de chef-d’œuvres de ce type-là. Pour cela, il faut aussi du style. Mieux : un style. De fait, Hector Mathis mise beaucoup - tout ? - sur le sien, sur cette langue mi-verte, mi-blette (parce que cherchant absolument ses racines dans un argot antédiluvien) qui, il est vrai, surprend plutôt agréablement au cours des trente premières pages mais qui finit par devenir trop évidente, trop attendue, redondante, systématique au fur et à mesure où l'on avance dans cette absence d'avancée. C'est vrai, cette langue est très travaillée, très construite derrière ses perceptibles et, souvent, intelligentes déconstructions. Tout cela est très référencées et l'on y sent de manière permanente l'hommage à quelques grands anciens - tellement. Trop. - à quelques uns des auteurs de son Panthéon intime : Céline, bien évidemment. Mais aussi le méconnu (bien qu'en vogue dans certains milieux depuis une petite dizaine d'année) Jehan Rictus, poète des miséreux et du parler populaire. On pourrait aussi déceler, mais c'est une simple hypothèse, une certaine connaissance du cinéma réaliste et populaire de l'entre deux guerres, au moins en ce qui concerne les passages dialogués. Il faudrait, nous explique la presse, y reconnaître la violence sensuelle et lumineuse d'un Louis Calaferte, mais nous n'avons pu nous y résoudre, tant il est difficile de retrouver ici les fulgurances de l'auteur de Septentrion ou de la mécanique des femmes. Quant à Louis-Ferdinand Céline, cité plus haut et, indubitablement, le premier des inspirateurs d'Hector Mathis... Il écrase tant le jeune écrivain de son génie atrabilaire et aigre que cela en devient parfois gênant. Il y le jazz, enfin, dont il est question presque page après page, à la manière d'une litanie destinée à faire venir sur le texte sa force brute, sauvage et sa poésie endiablée, dont on peine pourtant à ressentir l'intensité élémentaire, car ce n'est pas tout d'invoquer sempiternellement les Mannes, encore faut-il savoir leur donner un visage... Et c'est un long chemin pour y parvenir vraiment.
Pourtant... Oui, pourtant, il y a de l'envie, du désir de bien faire (et de le faire sincèrement, avec le cœur et la tripaille), de l'intention pure et, ne le dénions pas, les prémices d'une voix dans ce premier roman, dont nous remercions au passage les éditions Buchet-Chastel, via une Masse Critique spéciale - et visiblement d'importance pour l'éditeur, vu le nombre de contributeurs - à l'initiative de Babelio, de nous l'avoir fait découvrir. Malgré des mots sans doute invariablement durs d'une critique plutôt à charge, il y a ce sentiment d'avoir - peut-être- découvert un romancier en devenir, à l'oeuvre première pétrie de bonnes intentions quoi que gâchée, presque de bout en bout, par toutes les erreurs de jeunesse possibles, les chausse-trapes dans lesquelles il s'agit pourtant de ne pas se fouler l'encrier. Ni K.O debout, ni "OK c'est génial", sans doute pour ce texte au chaos bien raisonnable une fois passée la surprise du style et de la forme ; un chaos thématique tellement fourre-tout dans lequel Hector Mathis essaie de (dé)ranger presque tout, tellement, tellement : l'amour, le désenchantement, l'art, le sexe, la musique, l'écriture et la littérature, la mort, la misère, l'amitié, l'égotisme, la maladie, l'errance, l'absence d'avenir sur fond d'apocalypse, de fiction moderne, d'auto-fiction, de roman crépusculaire, d'apprentissage... Certains des plus grands y ont mis l'entièreté de leur existence à traiter tout ce que ce jeune écrivain tente de résoudre en deux cent pages. Maladresse ou prétention, le résultat est à l'image de notre avis : en demi-teinte, et c'est, réellement, bien dommage car il y a du désir vrai chez cet Hector Mathis. Pour plagier Julien Gracq, on a ici de la littérature, sans nul doute, mais on n'a pas encore l'estomac. Espérons pour lui comme pour nous autres, humbles lecteurs, que cela lui viendra !
Être un jeune homme de vingt-quatre ans, "sortir" de la banlieue (sous-entendue : parisienne, puisqu'il est connu que, définitivement, il n'est de bon bec que de Paris et de "vraie" banlieue, sans avoir à citer laquelle, que d'Île de France), avoir été parolier et écrire du rap mais croire, encore, en la force du livre, sans pour autant crier au "courage", comme il est habituel de le faire, souvent par facilité, souvent parce qu'on a rien d'autre à dire (comme si l'expression d'un art devait absolument ressortir et avant tout de cette qualité-là), on peut tout de même estimer cela méritoire. D'autant qu'il y croit, Hector Mathis, à la pérennité de l'oeuvre écrite, à sa primordialité, quand bien même la musique est de tous ses environs, qu'elle aussi est affaire de style et, bien plus encore, de rythme ; il y met du sien pour nous montrer, nous rappeler comme cet acte lui est essentiel, viscéral, inhérent et constitutif de tout son être. Urgent. Rien moins. Et à condition de prendre ce texte pour ce qu'il est en large part, quoi que jamais totalement : un roman intensément intime sans être forcément auto-biographique. du moins, jamais tout à fait.
Mais reprenons.
K.O., c'est, avant toute autre chose, l'histoire de Sitam, un jeune un peu pommé, un peu artiste (dans l'âme), un peu sans le sous et qui, son désir de littérature mis à part, se fiche éperdument des représentations et obligations de notre monde "post-moderne", conchie ses poses et ses rêves bourgeois, aime rien moins que l'errance, la gratuité des relations - et son corollaire : l'absence d'attachement total, définitif, du moins en apparence -, la liberté - jusqu'à un certain point -.
Mais K.O., c'est aussi le roman d'une - longue - fuite. Fuite devant les remous que vivent nombres de pays d'Europe (on nage dans une vague ambiance d'apocalypse mal définie quoi que, semble-t-il, générale), sans qu'on en sache beaucoup plus ; fuite du coeur de Paris dont on apprendra au détour d'une phrase que les bombes y ont fait entendre leur souffle de mort et que les forces de l'ordre y pullulent ; fuite de la banlieue - "La Grisâtre " - devant les risques de poursuites judiciaires inopportunes, après que son ami barman ait pris une balle des mains de sa maîtresse oublieuse et alcoolisée ; fuite dans un autre pays, un lieu dont on ne connait pas la langue (la Hollande), une capitale dont il ne sait aucune règle, où il ne connait personne en dehors de sa "môme" qui l'a accompagné-là ; fuite de soi-même et de ce que les éventuelles racines peuvent dire de vous (à commencer par les mots, inéchangeables désormais) et vous renvoyer à la trogne. Fuite de l'autre, l'aimée, l'aimante, "la môme", comme on disait "la môme Piaf" au temps jadis, en ces temps si lointains où une môme, c'était déjà plus qu'un flirt mais moins qu'une épouse, avec toute la tendresse (un rien paternaliste et sexiste) en dedans, mais qu'il va abandonner par peur de lui, de ce qui vient de lui tomber dessus, oui, c'est vachard, un truc dont on sait qu'on ne guérira jamais, à quelques vingt piges. D'ailleurs, ce coup de semonce médical (un rien ridicule, hors contexte. Et d'ailleurs assez maladroitement, naïvement conté, derrière le besoin de s'essayer à du Kafka hospitalier, comme s'il s'agissait d'un nouveau Château en blouses blanches - l'hommage est visible. Trop -), ça va être le point de départ de son ultime fuite : celle au cours de laquelle il abandonne môme, ami blessé retrouvé, relation de travail forte d'avec un imprimeur libertaire, intellectuel et apôtre résolut du jeu de mot et de la charade à tiroirs (avec, en prime, une plongée dans les classiques du genre dont l'auteur aurait pu se passer sans dommage : "Vic tue Ail", et compagnie). Cependant, cette fuite terminale lui permet aussi de se retrouver en compagnie d'Archibald, un de ces derniers "mange-poussière" que l'embourgeoisement généralisé n'a pas encore atteint - n'atteindra jamais -, un "détraqué" comme Sitam, saxophoniste cacochyme ayant loupé sa carrière (et sa fille) mais pas totalement aveugle puisqu'il sait comme la place du jeune littérateur en herbe n'est pas ici, perdu dans le parc d'un château aux fausses et baroques féeries en ruines et que le jeune homme surnomme de manière générique "le domaine" (une autre interprétation de l'Extension du domaine de la lutte ? La filiation ne plairait peut-être pas à son auteur mais, à une génération d'intervalle, les points communs sont évidents).
Roman du désenchantement, roman de la fuite face au temps présent, invariablement moche et violent, face aux engagements pour soi-même ou pour les autres, roman d'une révolte sans révolution possible, ou l'aigreur le cède souvent à une forme de politiquement correct de l'incorrect qui refuse de se voir tel : les envolées contre les bourgeois, contre nos souffreteuses démocraties, contre la vulgarité et la médiocrité ambiantes, la "modernitude" technologique, l'idée que nous en sommes à la fin d'un monde - DU monde ? - dont il ne resterait plus qu'à rédiger l'épitaphe (je reprends les propres mots de Sitam/Mathis en verlan) sont très certainement sincères et, pour une large part, nous les partageons... Mais elles sont exprimées avec une telle naïveté - niaiserie ? - qu'elle finissent souvent à plat ou, pire encore, parfaitement hors contexte et sans grande profondeur car donnant généralement dans l'expectoration malhabile, dans l'expression un rien convenue d'un mal être qui peine à se définir pour ce qu'il est réellement : l'impossibilité fondamentale à être dans cet univers désenchanté. Roman du Je (du moi-je) comme ultime fin - même terne, déprimé et sombre - de tout, O.K. pourrait presque passer pour une auto-fiction, n'était que cela se déroule dans des temps qui ne sont pas tout à fait les nôtres - voire ! Car en étirant un peu le propos, l'Europe qu'Hector Mathis décrit, sans détail précis, ce pourrait-être celle de l'après Charlie Hebdo, cette Europe qui oscille entre peur horrifique à l'égard du terrorisme, réel ou "ressenti", et reprise en main liberticides des gouvernants sous prétexte, véridique et fallacieux à la fois, de la lutte contre les précédents cités -, un texte dans lequel les proches, supposés ou de passage, de Sitam n'en sont, finalement, que les faire-valoir très flous, aux visages et aux psychologies très peu définis, quasiment interchangeables, comme si ce soleil terne qu'est le narrateur n'avait plus assez de force pour éclairer les reliefs de ses semblables avec la force d'une lumière intérieure en sursis, tellement pâlichonne et auto-centrée.
Certes, il ne se passe pas grand chose au cours de ces quelques deux cents pages tenant autant du road-movie sans cheminement réel (puisque notre narrateur finit par tourner globalement en rond) que du roman grisâtre - à l'instar de cette banlieue elle-même très floue - à défaut d'être noir. Mais, en soi, cela n'est aucunement la marque d'un mauvais ouvrage. On peut exprimer une foultitude de choses, être passionnant, bouleversant parfois, avec un personnage totalement immobile, par le biais d'une oeuvre contemplative, onirique, dense ou en ne décrivant qu'une seule et même action jusqu'à en atteindre l'acmé. La littérature contemporaine est pleine de chef-d’œuvres de ce type-là. Pour cela, il faut aussi du style. Mieux : un style. De fait, Hector Mathis mise beaucoup - tout ? - sur le sien, sur cette langue mi-verte, mi-blette (parce que cherchant absolument ses racines dans un argot antédiluvien) qui, il est vrai, surprend plutôt agréablement au cours des trente premières pages mais qui finit par devenir trop évidente, trop attendue, redondante, systématique au fur et à mesure où l'on avance dans cette absence d'avancée. C'est vrai, cette langue est très travaillée, très construite derrière ses perceptibles et, souvent, intelligentes déconstructions. Tout cela est très référencées et l'on y sent de manière permanente l'hommage à quelques grands anciens - tellement. Trop. - à quelques uns des auteurs de son Panthéon intime : Céline, bien évidemment. Mais aussi le méconnu (bien qu'en vogue dans certains milieux depuis une petite dizaine d'année) Jehan Rictus, poète des miséreux et du parler populaire. On pourrait aussi déceler, mais c'est une simple hypothèse, une certaine connaissance du cinéma réaliste et populaire de l'entre deux guerres, au moins en ce qui concerne les passages dialogués. Il faudrait, nous explique la presse, y reconnaître la violence sensuelle et lumineuse d'un Louis Calaferte, mais nous n'avons pu nous y résoudre, tant il est difficile de retrouver ici les fulgurances de l'auteur de Septentrion ou de la mécanique des femmes. Quant à Louis-Ferdinand Céline, cité plus haut et, indubitablement, le premier des inspirateurs d'Hector Mathis... Il écrase tant le jeune écrivain de son génie atrabilaire et aigre que cela en devient parfois gênant. Il y le jazz, enfin, dont il est question presque page après page, à la manière d'une litanie destinée à faire venir sur le texte sa force brute, sauvage et sa poésie endiablée, dont on peine pourtant à ressentir l'intensité élémentaire, car ce n'est pas tout d'invoquer sempiternellement les Mannes, encore faut-il savoir leur donner un visage... Et c'est un long chemin pour y parvenir vraiment.
Pourtant... Oui, pourtant, il y a de l'envie, du désir de bien faire (et de le faire sincèrement, avec le cœur et la tripaille), de l'intention pure et, ne le dénions pas, les prémices d'une voix dans ce premier roman, dont nous remercions au passage les éditions Buchet-Chastel, via une Masse Critique spéciale - et visiblement d'importance pour l'éditeur, vu le nombre de contributeurs - à l'initiative de Babelio, de nous l'avoir fait découvrir. Malgré des mots sans doute invariablement durs d'une critique plutôt à charge, il y a ce sentiment d'avoir - peut-être- découvert un romancier en devenir, à l'oeuvre première pétrie de bonnes intentions quoi que gâchée, presque de bout en bout, par toutes les erreurs de jeunesse possibles, les chausse-trapes dans lesquelles il s'agit pourtant de ne pas se fouler l'encrier. Ni K.O debout, ni "OK c'est génial", sans doute pour ce texte au chaos bien raisonnable une fois passée la surprise du style et de la forme ; un chaos thématique tellement fourre-tout dans lequel Hector Mathis essaie de (dé)ranger presque tout, tellement, tellement : l'amour, le désenchantement, l'art, le sexe, la musique, l'écriture et la littérature, la mort, la misère, l'amitié, l'égotisme, la maladie, l'errance, l'absence d'avenir sur fond d'apocalypse, de fiction moderne, d'auto-fiction, de roman crépusculaire, d'apprentissage... Certains des plus grands y ont mis l'entièreté de leur existence à traiter tout ce que ce jeune écrivain tente de résoudre en deux cent pages. Maladresse ou prétention, le résultat est à l'image de notre avis : en demi-teinte, et c'est, réellement, bien dommage car il y a du désir vrai chez cet Hector Mathis. Pour plagier Julien Gracq, on a ici de la littérature, sans nul doute, mais on n'a pas encore l'estomac. Espérons pour lui comme pour nous autres, humbles lecteurs, que cela lui viendra !
Hector Mathis joue de l'écriture comme de la musique.
Des syllabes, des mots, qui font les notes et les résonances.
Avant d'être une histoire, ce livre est une écriture, une partition au rythme saccadé, tourmenté, poétique, qui comporte quelques notes tragi-comiques.
Avant d'être une histoire ce livre est une musique.
Sans nul doute l'auteur manie la plume avec brio. Trop sans doute… car souvent je suis restée devant ma page à relire une phrase, un passage qui me plaisait, plutôt que de penser à continuer à lire l'histoire.
Une histoire finalement bien pâlotte, peu importante, qui a glissé sur moi comme l'eau sur un rocher, et ceci même si elle a son intérêt en étant un éloge à la vie, où coup bas et coup d'éclat se répondent.
A côté les personnages sont eux-mêmes peu marquants. Certes, ils sont sympas, agréables, simples, ce sont des gens de tous les jours, mais ayant été hypnotisée par l'écriture je ne peux en dire plus. A part, finalement, que je suis passée à côté de ce court roman.
Finalement ce qui m'a le plus plu, c'est l'écriture profonde et poétique, c'est certaines phrases dans l'action, mais pas tant l'histoire, et je retiendrai de ce livre cela.
Merci à Babelio et aux éditions Buchet-Chastel.
Lien : http://voyagelivresque.canal..
Des syllabes, des mots, qui font les notes et les résonances.
Avant d'être une histoire, ce livre est une écriture, une partition au rythme saccadé, tourmenté, poétique, qui comporte quelques notes tragi-comiques.
Avant d'être une histoire ce livre est une musique.
Sans nul doute l'auteur manie la plume avec brio. Trop sans doute… car souvent je suis restée devant ma page à relire une phrase, un passage qui me plaisait, plutôt que de penser à continuer à lire l'histoire.
Une histoire finalement bien pâlotte, peu importante, qui a glissé sur moi comme l'eau sur un rocher, et ceci même si elle a son intérêt en étant un éloge à la vie, où coup bas et coup d'éclat se répondent.
A côté les personnages sont eux-mêmes peu marquants. Certes, ils sont sympas, agréables, simples, ce sont des gens de tous les jours, mais ayant été hypnotisée par l'écriture je ne peux en dire plus. A part, finalement, que je suis passée à côté de ce court roman.
Finalement ce qui m'a le plus plu, c'est l'écriture profonde et poétique, c'est certaines phrases dans l'action, mais pas tant l'histoire, et je retiendrai de ce livre cela.
Merci à Babelio et aux éditions Buchet-Chastel.
Lien : http://voyagelivresque.canal..
En pleine panique face à une situation de guerre ou d'attaques terroristes, le narrateur / héros fuit la ville avec la la môme Capu ( !). Direction, le nord, du moins pour un temps. K.O. se veut donc une sorte de road movie sur fond de conflit (nombreuses références littéraires, dont Les saisons de Maurice Pons pour la littérature ou le transperceneige de Rochette et Legrand pour la BD, Céline et le voyage étant hors compétition). Il ne s'y passe pas grand-chose mais on y fait de belles rencontres dont un clochard céleste jazzeux, un vieil ami garçon de café amoureux de la patronne du bistrot (ce qui ne lui, portera pas chance) ou une voisine charitable (« Il y a des gens comme ça qui se mettent au service de la moindre ambition, ça leur donne l'impression de participer à quelque chose de moins médiocre que leur anéantissement différé. ») le héros / narrateur conte par ailleurs son expérience du monde du travail (bistrot, imprimerie) et livre quelques réflexions sur l'existence, tout en poursuivant la rédaction d'un premier roman.
Roman très sombre sur la fuite en avant, constat sans appel d'un mode qui change pour le pire, portraits de quelques losers plus ou moins magnifiques, K.O. se laisse lire sans déplaisir mais donne une impression de déjà lu ou déjà vu. Certains seront sensibles aux phrases courtes et simples (Proust est mort depuis belle lurette), très syncopées (« C'était du ska ce que j'écrivais, ça sautillait sans cesse, puis ça frôlait le jazz avec les cuivres pour faire la liaison. »), proches de l'écriture cinématographique de Dos Passos, On regrettera que l'auteur n'évite pas toujours le cliché (« Qu'est-ce-que c'est beau l'horizon quand il bave ses couleurs jusqu'au délire. »).
Cela étant, le premier roman d'Hector Mathis n'est pas à négliger. Ce livre très écrit sur le pouvoir des mots contre le désespoir et la mort (de la charade à tiroirs au slogan publicitaire en passant par le toman en gestation) révèle un réel désir d'écriture qui augure bien des prochaines livraisons. Une fois digérées toutefois les influences trop présentes de Céline et de certains auteurs de la Beat Generation.
Merci à Babelio et à Buchet-Chastel pour leur confiance.
Roman très sombre sur la fuite en avant, constat sans appel d'un mode qui change pour le pire, portraits de quelques losers plus ou moins magnifiques, K.O. se laisse lire sans déplaisir mais donne une impression de déjà lu ou déjà vu. Certains seront sensibles aux phrases courtes et simples (Proust est mort depuis belle lurette), très syncopées (« C'était du ska ce que j'écrivais, ça sautillait sans cesse, puis ça frôlait le jazz avec les cuivres pour faire la liaison. »), proches de l'écriture cinématographique de Dos Passos, On regrettera que l'auteur n'évite pas toujours le cliché (« Qu'est-ce-que c'est beau l'horizon quand il bave ses couleurs jusqu'au délire. »).
Cela étant, le premier roman d'Hector Mathis n'est pas à négliger. Ce livre très écrit sur le pouvoir des mots contre le désespoir et la mort (de la charade à tiroirs au slogan publicitaire en passant par le toman en gestation) révèle un réel désir d'écriture qui augure bien des prochaines livraisons. Une fois digérées toutefois les influences trop présentes de Céline et de certains auteurs de la Beat Generation.
Merci à Babelio et à Buchet-Chastel pour leur confiance.
Cela fait dix jours que je tourne autour de cette chronique et que je n'arrive pas à l'écrire.
Aujourd'hui, je suis encore incapable de dire si j'ai aimé ou pas ce livre.
À certains moments, j'étais subjuguée par l'écriture que je trouvais très percutante et poétique, puis, lorsque le monologue durait sur plusieurs pages, j'étais envahie par la lassitude.
Certains passages ont retenu mon attention, en particulier lorsqu'il y avait de l'action, mais d'autres ne me captivaient pas, je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir.
Je n'ai pas eu vraiment d'attachement aux personnages, aussi, je suis restée en dehors de l'histoire. Il n'y a que la fin qui m'a beaucoup touchée et émue.
Je pense que c'est la première fois que cela m'arrive, dans ma vie de lectrice, mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir compris l'histoire. Je me suis beaucoup questionnée sur ce livre. En effet, certains éléments de ce livre sont restés opaques pour moi, je n'ai pas saisi le sens.
Je remercie beaucoup les Éditions Buchet Chastel et Netgalley pour ce service presse et je suis vraiment désolée de ne pas réussir à en dire plus sur k.o.
#Ko #NetGalleyFrance
Lien : http://www.valmyvoyoulit.com..
Aujourd'hui, je suis encore incapable de dire si j'ai aimé ou pas ce livre.
À certains moments, j'étais subjuguée par l'écriture que je trouvais très percutante et poétique, puis, lorsque le monologue durait sur plusieurs pages, j'étais envahie par la lassitude.
Certains passages ont retenu mon attention, en particulier lorsqu'il y avait de l'action, mais d'autres ne me captivaient pas, je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir.
Je n'ai pas eu vraiment d'attachement aux personnages, aussi, je suis restée en dehors de l'histoire. Il n'y a que la fin qui m'a beaucoup touchée et émue.
Je pense que c'est la première fois que cela m'arrive, dans ma vie de lectrice, mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir compris l'histoire. Je me suis beaucoup questionnée sur ce livre. En effet, certains éléments de ce livre sont restés opaques pour moi, je n'ai pas saisi le sens.
Je remercie beaucoup les Éditions Buchet Chastel et Netgalley pour ce service presse et je suis vraiment désolée de ne pas réussir à en dire plus sur k.o.
#Ko #NetGalleyFrance
Lien : http://www.valmyvoyoulit.com..
Ce court roman, à peine plus de 200 pages, est percutant, extrêmement rythmé. On pourrait penser à une dystopie, tout autant qu'à un roman ancré dans notre réel. L'auteur nous emmène dans une fuite en avant aux côtés de Sitam, directement dans sa tête, le jeune homme étant le narrateur. le résumé m'attirait énormément, mais le roman m'a perdue… Les références de l'auteur ne sont pas forcément les miennes, et si j'avais lu ou entendu une interview d'Hector Mathis, j'aurais clairement su que ce livre risquait de me passer au-dessus.
Il y a une chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est sa musicalité. Quand je lis un livre, j'aime m'en lire des passages à voix haute, pour mieux apprécier son rythme. C'est une habitude de musicienne sans doute^^ Et on a ici un roman qui se déclame comme un slam. le texte est vivant, le rythme entraînant… C'est un beau travail de composition.
Mais je n'ai pas accroché à l'intrigue. Sûrement parce que je n'ai éprouvé aucune empathie pour Sitam. Je ne suis pas persuadée que l'auteur ait considéré comme un prérequis d'éprouver ce genre de proximité avec le lecteur, mais je ne suis pas capable d'apprécier un roman rédigé à la première personne si je n'accroche pas avec le narrateur.
Aussi, si j'ai aimé en lire des passages à voix haute, ce n'est pas un roman qui m'a convenu. Je l'ai trouvé trop alambiqué, avec un protagoniste principal trop pédant par rapport au monde qui l'entoure. Peut-être suis-je passée complètement à côté, mais il est clair que ce livre n'était pas pour moi...
Lien : https://leslecturesdesophieb..
Il y a une chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est sa musicalité. Quand je lis un livre, j'aime m'en lire des passages à voix haute, pour mieux apprécier son rythme. C'est une habitude de musicienne sans doute^^ Et on a ici un roman qui se déclame comme un slam. le texte est vivant, le rythme entraînant… C'est un beau travail de composition.
Mais je n'ai pas accroché à l'intrigue. Sûrement parce que je n'ai éprouvé aucune empathie pour Sitam. Je ne suis pas persuadée que l'auteur ait considéré comme un prérequis d'éprouver ce genre de proximité avec le lecteur, mais je ne suis pas capable d'apprécier un roman rédigé à la première personne si je n'accroche pas avec le narrateur.
Aussi, si j'ai aimé en lire des passages à voix haute, ce n'est pas un roman qui m'a convenu. Je l'ai trouvé trop alambiqué, avec un protagoniste principal trop pédant par rapport au monde qui l'entoure. Peut-être suis-je passée complètement à côté, mais il est clair que ce livre n'était pas pour moi...
Lien : https://leslecturesdesophieb..
Tout d'abord, je remercie le Furet du Nord qui m'a permis de lire ce livre en avant-première en m'incluant dans leur Cercle des lecteurs. K.O. d'Hector Mathis est un premier roman, mais un roman-coup de poing. Il nous plonge au plus profond des ténèbres. Mais dans quel but ?
Dans la lignée de la route de Cormac McCarthy, K.O. est le roman de la fuite de Sitam face à la destruction et à la mort. D'emblée, l'atmosphère est lourde, défaitiste et sombre. Mais alors que les deux troubles-fête cités grignotent du terrain, Sitam se laisse davantage gagner par le désenchantement et le pessimisme tandis qu'il prend conscience de la vanité de sa fuite. Même si j'ai parfois eu du mal avec ce ton extrêmement défaitiste, le roman est saisissant et nous prend par les tripes.
« La vie ce n'est qu'une foutue partition pour détraqués »
Et si c'était là la réponse ? Et si la musique des mots était la seule porte de sortie face au chaos ? Sitam fuit, puis est brusquement rattrapé par l'annihilation. Et pourtant, malgré tout ce qui lui arrive et tout ce qui l'entoure, il trouve du réconfort dans l'écriture. Alors il rédige frénétiquement son roman (celui que nous lisons?). À croire que la littérature, les mots et leur musique sont notre seule échappatoire et notre seule source de réconfort dans ce monde en déclin.
Lire la suite sur : https://lesmarquespagedunecroqueusedelivres.wordpress.com/2018/08/17/k-o-hector-mathis/
Lien : https://lesmarquespagedunecr..
Dans la lignée de la route de Cormac McCarthy, K.O. est le roman de la fuite de Sitam face à la destruction et à la mort. D'emblée, l'atmosphère est lourde, défaitiste et sombre. Mais alors que les deux troubles-fête cités grignotent du terrain, Sitam se laisse davantage gagner par le désenchantement et le pessimisme tandis qu'il prend conscience de la vanité de sa fuite. Même si j'ai parfois eu du mal avec ce ton extrêmement défaitiste, le roman est saisissant et nous prend par les tripes.
« La vie ce n'est qu'une foutue partition pour détraqués »
Et si c'était là la réponse ? Et si la musique des mots était la seule porte de sortie face au chaos ? Sitam fuit, puis est brusquement rattrapé par l'annihilation. Et pourtant, malgré tout ce qui lui arrive et tout ce qui l'entoure, il trouve du réconfort dans l'écriture. Alors il rédige frénétiquement son roman (celui que nous lisons?). À croire que la littérature, les mots et leur musique sont notre seule échappatoire et notre seule source de réconfort dans ce monde en déclin.
Lire la suite sur : https://lesmarquespagedunecroqueusedelivres.wordpress.com/2018/08/17/k-o-hector-mathis/
Lien : https://lesmarquespagedunecr..
Je n'ai pas été mise K.O. par cette lecture car je suis restée en dehors. C'est le principal reproche que l'on peut faire à Hector Mathis.
Il nous donne à voir ou à entendre mais on n'est pas pris aux tripes, embarqués ; comme avec Calaferte par exemple, qui, dès la première phrase, vous ferre et ne vous lâche plus que cela vous plaise ou non. Et alors vous émergez de votre lecture complètement déboussolés, transformés et le monde n'est plus comme avant. Il vous a contraint à le suivre et vous le détestez et l'adorez pour cela.
C'est un peu ce que j'espérais en entamant ce livre.
J'ai toutefois aimé cette lecture qui comporte de beaux passages comme
« Qu'est-ce que c'est beau l'horizon quand il bave ses couleurs jusqu'au délire. On commettait comme une indiscrétion à ce moment précis. Ce ciel-là on n'étaient pas censés le voir. On était entrés sans frapper, au moment le plus délicat.(…) On ne parlait pas, on laissait résonner les couleurs… »
Je dirais peut faire mieux, plus percutant, plus charnel, laissant des traces, réveillant de vieilles blessures mal cicatrisées. J'attends le prochain…
Il nous donne à voir ou à entendre mais on n'est pas pris aux tripes, embarqués ; comme avec Calaferte par exemple, qui, dès la première phrase, vous ferre et ne vous lâche plus que cela vous plaise ou non. Et alors vous émergez de votre lecture complètement déboussolés, transformés et le monde n'est plus comme avant. Il vous a contraint à le suivre et vous le détestez et l'adorez pour cela.
C'est un peu ce que j'espérais en entamant ce livre.
J'ai toutefois aimé cette lecture qui comporte de beaux passages comme
« Qu'est-ce que c'est beau l'horizon quand il bave ses couleurs jusqu'au délire. On commettait comme une indiscrétion à ce moment précis. Ce ciel-là on n'étaient pas censés le voir. On était entrés sans frapper, au moment le plus délicat.(…) On ne parlait pas, on laissait résonner les couleurs… »
Je dirais peut faire mieux, plus percutant, plus charnel, laissant des traces, réveillant de vieilles blessures mal cicatrisées. J'attends le prochain…
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Hector Mathis (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1101 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1101 lecteurs ont répondu