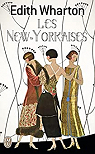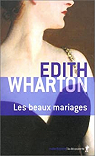Bret Easton Ellis, que je n'ai plus lu depuis des années (mais que j'aimerais peut-être toujours si je le relisais) a évoqué ce livre comme une de ses références littéraires majeures. Il introduit certes, à une époque encore précoce, ce thème fondamental pour Bret Easton Ellis en particulier, et pour nous tous en général, du vertige et de l'angoisse existentiels dans la libéralisation des modes de vie. J'ai malheureusement succombé face au style, qui me rappelait par trop celui d'une Virginia Woolf, à moi imbuvable quand bien même le résumé de ses histoires paraît plutôt intéressant sur le papier. Je me résolus ainsi à abandonner cette lecture 100 pages avant la fin.
Deux ans plus tard, il ne m'en reste plus rien, comme bien d'autres choses.
Deux ans plus tard, il ne m'en reste plus rien, comme bien d'autres choses.
Lily Bart, soucieuse de faire un mariage qui lui assurerait tout le confort et la facilité de vie dont elle rêve, se surprend à aimer Lawrence Selden, intellectuel distingué mais pauvre.
Je n'ai ressenti aucune sympathie pour cette jeune femme incapable d'agir, paralysée par son double désir d'épanouissement spirituel et de liberté financière.
Je n'ai pas aimé ce roman, sans toutefois que le mettre vraiment en cause.
Je me demande seulement pourquoi depuis quelques années, je suis fâchée avec la littérature classique qui m'a procuré tellement de bonheur dans le passé.
Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? A vrai dire je ne sais pas trop.
Peut-être l'écriture trop travaillée, trop détaillée.
Peut-être l'ambiance dans laquelle je n'ai plus envie de me retrouver.
Peut-être les personnages qui me semblent mièvres bien souvent.
J'ai toujours en mémoire quelques romans magnifiques du 18ème siècle que j'ai tellement envie de relire, sans pour autant le faire par peur d'être déçue en ne retrouvant pas l'émotion passée.
Je n'ai donc pas, vous l'aurez compris, trouvé le bonheur escompté « Chez les heureux du monde. »
Je n'ai ressenti aucune sympathie pour cette jeune femme incapable d'agir, paralysée par son double désir d'épanouissement spirituel et de liberté financière.
Je n'ai pas aimé ce roman, sans toutefois que le mettre vraiment en cause.
Je me demande seulement pourquoi depuis quelques années, je suis fâchée avec la littérature classique qui m'a procuré tellement de bonheur dans le passé.
Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? A vrai dire je ne sais pas trop.
Peut-être l'écriture trop travaillée, trop détaillée.
Peut-être l'ambiance dans laquelle je n'ai plus envie de me retrouver.
Peut-être les personnages qui me semblent mièvres bien souvent.
J'ai toujours en mémoire quelques romans magnifiques du 18ème siècle que j'ai tellement envie de relire, sans pour autant le faire par peur d'être déçue en ne retrouvant pas l'émotion passée.
Je n'ai donc pas, vous l'aurez compris, trouvé le bonheur escompté « Chez les heureux du monde. »
J'aime beaucoup Edith Wharton et c'est avec délice que je me suis plongée dans The Age of Innocence qui relate l'histoire de Lily Bart. La femme y est décrite comme un objet de désir perpétuel, c'est sa seule source d'existence et il faut l'entretenir. Lily est une oeuvre d'art qui se réinvente, mais ce qu'elle croit être sa liberté n'est en fait que ce que la société lui autorise. Prisonnière d'elle même, elle est vouée à être broyée. Une superbe leçon littéraire, un bonheur à lire !
Lily Bart, orpheline de la bonne société, mais issue d'une famille ruinée, doit absolument se trouver un riche mari. Mais à presque 30 ans, elle est toujours célibataire, ne se résignant pas à se marier pour l'argent.
J'avais déjà lu cette autrice, notamment des nouvelles sur la même haute-société décrite ici, dont je garde un bon souvenir, et des nouvelles sur le thème des fantômes.
Chez les heureux du Monde est un titre ironique compte-tenu du fait que tous les personnages rencontrés dans ce roman, à commencer par son héroïne, m'ont semblé profondément malheureux. On serait plutôt « chez les nantis très snobs », pour qui seules les apparences et l'argent comptent. le récit est une succession de mesquineries, de trahisons et de manigances où les protagonistes jouent à qui est le plus riche ou le plus puissant. La condition des femmes de ce milieu semble assez effroyable: condamnées à épouser un homme riche ou à vivre dans la pauvreté si elles n'ont pas le sou; destinées à épouser un homme riche et à écraser leurs rivales si elles sont déjà riches. Lily, dont la pauvreté est somme toute relative, a été éduquée dans ce but.
L'ensemble du roman traite des occasions manquées, de la futilité des apparences et de la déchéance d'une femme qui se laisse emprisonner par sa condition et l'éducation qu'elle a reçue. L'histoire est intéressante, malgré des longueurs (la vie des personnages est assez répétitive), et permet de découvrir les dessous cachés de la vie de la haute-société new-yorkaise à l'époque. Je recommande si les thèmes abordés ou l'autrice vous intéresse, mais je vous conseille de ne pas lire ce livre à un moment où vous seriez déprimé-e-s 😆
Bonne lecture, un peu plombante.
Lien : https://bienvenueducotedeche..
J'avais déjà lu cette autrice, notamment des nouvelles sur la même haute-société décrite ici, dont je garde un bon souvenir, et des nouvelles sur le thème des fantômes.
Chez les heureux du Monde est un titre ironique compte-tenu du fait que tous les personnages rencontrés dans ce roman, à commencer par son héroïne, m'ont semblé profondément malheureux. On serait plutôt « chez les nantis très snobs », pour qui seules les apparences et l'argent comptent. le récit est une succession de mesquineries, de trahisons et de manigances où les protagonistes jouent à qui est le plus riche ou le plus puissant. La condition des femmes de ce milieu semble assez effroyable: condamnées à épouser un homme riche ou à vivre dans la pauvreté si elles n'ont pas le sou; destinées à épouser un homme riche et à écraser leurs rivales si elles sont déjà riches. Lily, dont la pauvreté est somme toute relative, a été éduquée dans ce but.
L'ensemble du roman traite des occasions manquées, de la futilité des apparences et de la déchéance d'une femme qui se laisse emprisonner par sa condition et l'éducation qu'elle a reçue. L'histoire est intéressante, malgré des longueurs (la vie des personnages est assez répétitive), et permet de découvrir les dessous cachés de la vie de la haute-société new-yorkaise à l'époque. Je recommande si les thèmes abordés ou l'autrice vous intéresse, mais je vous conseille de ne pas lire ce livre à un moment où vous seriez déprimé-e-s 😆
Bonne lecture, un peu plombante.
Lien : https://bienvenueducotedeche..
En octobre 1905, un roman paraît et se hisse rapidement en tête des ventes, House of Mirth, d'Edith Wharton. Si nous tentons de le traduire littéralement, le titre signifie « La maison de la liesse » (ou du bonheur). N'allez toutefois pas croire que c'est un récit édulcoré que renferme cet ouvrage absolument écrasant : au contraire, Chez les heureux du monde (car ainsi fut traduit le roman lorsqu'il parut enfin en France en 1908) se présente comme une peinture caustique et inexorable de l'aristocratie de New York qui était déjà sur le déclin au XIXe siècle, et qui entame son chant du cygne alors que commence une nouvelle ère. Edith Wharton dénonce dans son roman l'hypocrisie de la grande bourgeoisie américaine, microcosme exlusif pour qui « l'essentiel est de paraître s'amuser plus que le voisin et, par conséquent, de sembler plus riche », comme l'écrit le Temps. L'auteur démontre et analyse les travers de cette « aristocratie du chèque », ainsi que l'explique Paul Bourget, écrivain français qui connut Edith Wharton. Dans la préface ajoutée en 1936, la romancière explique les démarches de son projet : « Lorsque j'ai écrit Chez les heureux du monde, j'avais deux atouts en main. L'un était le fait que la société new-yorkaise des années 1890 était un domaine encore inexploité par un romancier qui avait grandi dans cette petite serre pleine de traditions et de conventions ; et l'autre, que ces traditions et conventions n'avaient pas encore été critiquées et étaient tacitement considérées comme inattaquables ». Il s'agit donc pour l'auteur de faire voler en éclat le décorum et de révéler ses failles. L'histoire se présente ainsi : nous découvrons Lily Bart, l'héroïne, vient d'une famille ruinée issue de la noblesse. Convaincue par sa mère que sa beauté est le seul atout qui puisse lui permettre de se frayer un chemin vers le sommet de la pyramide sociale, elle tente de trouver un époux qui pourrait lui apporter une situation stable afin de préserver le climat insouciant dans lequel elle vit auprès de la haute société. Qu'à cela ne tienne, les prétendants sont nombreux... mais Lily manque cruellement de psychologie : superficielle et frivole, l'héroïne se montre inconséquente et gâche les chances qui se présentent sur son chemin. Elle n'a cependant rien à voir avec l'ambitieuse Rebecca Sharp, l'héroïne de la Foire aux Vanités de William Thackeray Makepeace qui déploie toutes les machinations possibles pour parvenir à ses fins. Lily a en effet un sens de l'éthique et de la respectabilité qui lui permet de ne pas se muet en scélérate. Vous vous en doutez, Lily va connaître une véritable descente aux enfers, et se heurter aux fourberies, à l'hypocrisie et à la perfidie de ce milieu uniquement fondé sur l'argent. de ce fait, c'est une véritable fresque désenchantée que dresse Edith Wharton qui débusque la férocité de la haute société de New York. Lily s'accroche de tout son désespoir à une société insignifiante qui ne la reconnaît pas et ne voit en elle qu'un délicieux ornement, et ne se doute pas qu'au moindre faux-pas, elle sera répudiée par ceux qui l'auront courtisée. de ce fait, Lily contribue indirectement à sa propre déchéance. En ce qui concerne le style du roman, j'avoue que je suis très agréablement surpris par le classicisme si inhérent à la plume d'Edith Wharton : l'auteur évite soigneusement les écueils ornementaux pour nous offrir une analyse minutieuse des différentes figures qui surgissent dans cet ouvrage. La traduction est très bonne et rend justice à la perspective de la romancière. C'est en lisant ce roman que l'on prend conscience que la périphrase « l'ange de la dévastation », employée par Henry James pour décrire Edith Wharton seyait à ravir à cette dernière.
Edith Wharton confirme, après ma découverte du Temps de l'innocence, tout son talent et tout l'intérêt que je porte à ses écrits avec Chez les heureux du monde. le contexte est globalement similaire, même si l'ampleur de cet autre roman élargit les perspectives : nos chers New-Yorkais se rendent en Angleterre, en France, à Monte-Carlo…
Je ne saurais pas dire de manière ferme si je me suis attachée à Lily Bart, c'est une jeune femme particulière, mais elle m'a touchée. En effet, la grande différence entre cette héroïne et la Comtesse Ellen Olenska, c'est leur origine. Alors que la comtesse faisait partie de ce monde de privilégiées convaincus d'être les maîtres de l'univers, elle en avait été désavouée parce qu'elle avait osé quitter son époux. Lily ne fait pas vraiment partie de ce monde : sa mère et elles ont de la famille qui en font partie, elles côtoient cet univers aussi cinglant que scintillant. Lily charme par sa grâce, sa beauté, sa finesse et sa vivacité d'esprit. Mais Lily n'est pas assez riche pour suivre le rythme. Elle sera donc admise, tant qu'elle ne fera pas d'erreur. A la moindre incartade, tous se souviendront que, déjà, elle n'était pas des leurs. Et puis, évidemment, Lily commettra des erreurs. Souvent, elle sera même victime des complots de ses soi-disant amis qui savent qu'elle risque plus gros qu'eux.
L'héroïne est toujours déchirée entre deux désirs : celui de faire partie de ce monde et celui de rester libre. C'est ce constant balancement qui la poussera à rejeter des unions prometteuses et des passions amoureuses. Par définition incomplète, Lily n'appartient à aucun des deux mondes.
En cela, et j'ose le parallèle (à vous de me dire si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque), elle m'a fait penser à Nana du roman éponyme de Zola. Bien sûr, elle est plus classe, plus gracieuse et bien plus intelligente qu'Anna Coupeau, mais je n'ai pas pu me défaire, surtout dans la deuxième moitié du roman, de cette image de la Mouche d'or, venue des classes moins glorieuses de la société pour pourrir les hautes sphères. Dès lors, à l'instar d'Anna Coupeau, même ceux qui semblent aimer Lily ne peuvent pas prendre ouvertement son parti. Cet engouement de tous suivi par ce rejet unanime, ces brusques passages de la lumière à l'ombre m'ont rappelé la destinée tragique de Nana. Sans compter les personnages assez odieux - Gus Trenor et George Dorset - qui rappellent inévitablement le Comte Muffat. Sans compter aussi la fameuse scène des tableaux vivants, dans laquelle Lily époustoufle tous les spectateurs comme Nana dans son rôle de Vénus.
Le destin de Lily est celui d'une étoile qui à force de vouloir briller trop fort va être contrainte à s'éteindre.
Dans toute la galerie de personnages représentée par Edith Wharton, on trouve des individus moins manichéens, comme Gerty Farish, une femme bienveillante qui voudrait protéger Lily contre son attrait pour les paillettes, Lawrence Selden, lui-même déchiré entre son appartenance à ce monde et son mépris pour tous ces gens, trop idéaliste pour être dans la réalité, trop lâche pour agir quand il en est temps, Rosedale le parvenu qui reste presque plus humain que les autres.
J'ai vraiment apprécié de me replonger dans cet univers. Si le sort s'acharne contre Lily Bart, rien n'est trop facile dans l'intrigue. On vibre avec elle, même si, comme moi, on ne comprend pas tous ses choix, on tremble pour elle et on se révolte quand personne ne le fait.
Lien : https://livresque78.com/2021..
Je ne saurais pas dire de manière ferme si je me suis attachée à Lily Bart, c'est une jeune femme particulière, mais elle m'a touchée. En effet, la grande différence entre cette héroïne et la Comtesse Ellen Olenska, c'est leur origine. Alors que la comtesse faisait partie de ce monde de privilégiées convaincus d'être les maîtres de l'univers, elle en avait été désavouée parce qu'elle avait osé quitter son époux. Lily ne fait pas vraiment partie de ce monde : sa mère et elles ont de la famille qui en font partie, elles côtoient cet univers aussi cinglant que scintillant. Lily charme par sa grâce, sa beauté, sa finesse et sa vivacité d'esprit. Mais Lily n'est pas assez riche pour suivre le rythme. Elle sera donc admise, tant qu'elle ne fera pas d'erreur. A la moindre incartade, tous se souviendront que, déjà, elle n'était pas des leurs. Et puis, évidemment, Lily commettra des erreurs. Souvent, elle sera même victime des complots de ses soi-disant amis qui savent qu'elle risque plus gros qu'eux.
L'héroïne est toujours déchirée entre deux désirs : celui de faire partie de ce monde et celui de rester libre. C'est ce constant balancement qui la poussera à rejeter des unions prometteuses et des passions amoureuses. Par définition incomplète, Lily n'appartient à aucun des deux mondes.
En cela, et j'ose le parallèle (à vous de me dire si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque), elle m'a fait penser à Nana du roman éponyme de Zola. Bien sûr, elle est plus classe, plus gracieuse et bien plus intelligente qu'Anna Coupeau, mais je n'ai pas pu me défaire, surtout dans la deuxième moitié du roman, de cette image de la Mouche d'or, venue des classes moins glorieuses de la société pour pourrir les hautes sphères. Dès lors, à l'instar d'Anna Coupeau, même ceux qui semblent aimer Lily ne peuvent pas prendre ouvertement son parti. Cet engouement de tous suivi par ce rejet unanime, ces brusques passages de la lumière à l'ombre m'ont rappelé la destinée tragique de Nana. Sans compter les personnages assez odieux - Gus Trenor et George Dorset - qui rappellent inévitablement le Comte Muffat. Sans compter aussi la fameuse scène des tableaux vivants, dans laquelle Lily époustoufle tous les spectateurs comme Nana dans son rôle de Vénus.
Le destin de Lily est celui d'une étoile qui à force de vouloir briller trop fort va être contrainte à s'éteindre.
Dans toute la galerie de personnages représentée par Edith Wharton, on trouve des individus moins manichéens, comme Gerty Farish, une femme bienveillante qui voudrait protéger Lily contre son attrait pour les paillettes, Lawrence Selden, lui-même déchiré entre son appartenance à ce monde et son mépris pour tous ces gens, trop idéaliste pour être dans la réalité, trop lâche pour agir quand il en est temps, Rosedale le parvenu qui reste presque plus humain que les autres.
J'ai vraiment apprécié de me replonger dans cet univers. Si le sort s'acharne contre Lily Bart, rien n'est trop facile dans l'intrigue. On vibre avec elle, même si, comme moi, on ne comprend pas tous ses choix, on tremble pour elle et on se révolte quand personne ne le fait.
Lien : https://livresque78.com/2021..
"Percy Gryce l'avait assommée tout l'après-midi -rien que d'y songer semblait réveiller un écho de sa voix monotone-, et pourtant elle ne pouvait l'ignorer le lendemain, il lui fallait poursuivre son succès, se soumettre à plus d'ennui encore, être prête à de nouvelles complaisances, à de nouvelles souplesses, et tout cela dans l'unique espoir que finalement il se déciderait peut-être à lui faire l'honneur de l'assommer à vie."
Lily Bart est une jeune américaine de bonne famille mais sans argent. Nous sommes au début du 20° siècle (le roman a été écrit en 1905), elle a 20 ans et il est donc urgent qu'elle fasse un beau mariage. Pour cela Lily sait qu'elle peut compter sur son charme et sa beauté:
"L'endroit était charmant, et Lily n'était pas insensible à son charme, ni au fait que sa propre présence le rehaussait encore ; mais elle n'était accoutumée à goûter les joies de la solitude qu'en société, et cette combinaison d'une belle jeune fille et d'un site romanesque lui semblait trop parfaite pour être ainsi gaspillée. Personne toutefois n'apparaissait pour profiter de la circonstance, et, après une demi-heure d'attente stérile, elle se leva et continua d'errer."
Seulement voilà, malgré sa soif de vivre dans l'opulence, il y a chez Lily un fond de morale qui, à plusieurs reprises, alors qu'elle était prête à toucher au but, l'a amenée à saboter ses efforts et a fait capoter une demande en mariage qui semblait pourtant acquise.
Je découvre une société oisive qui, entre la saison en ville et les vacances à la campagne, me fait beaucoup penser à l'aristocratie britannique de la même époque. Sauf qu'ici les femmes fument et qu'il y a des divorcé-e-s. Les plus riches sont prêts à inviter Lily chez eux voire à lui payer un séjour en Europe pour profiter de sa bonne compagnie. On attend cependant qu'elle rende quelques services en échange : faire des travaux de secrétariat ou servir d'alibi à l'amie adultère.
A mesure que le temps passe et qu'elle se lie d'amitié avec Lawrence Selden, un avocat qui évolue dans ces mêmes cercles mais sans en être dépendant, Lily a de plus en plus de mal à concilier ses aspirations contradictoires. Elle ne peut pas envisager de vivre pauvrement, c'est-à-dire sans acheter fréquemment de nouvelles robes et de nouveaux bijoux mais elle prend conscience que ces distractions ne peuvent pas donner de sens profond à sa vie. Faute d'arriver à trancher sa situation devient très inconfortable et nous mène à une fin pathétique qui m'a fait venir des larmes aux yeux.
J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Edith Wharton dresse un portrait critique de cette haute société new-yorkaise dont elle était elle-même issue. A l'occasion, quand Lily découvre la vraie pauvreté, elle nous montre aussi les dures conditions de vie des gens du peuple. Néanmoins je relève l'expression de préjugés antisémites qui me hérissent :
"Il tenait de sa race l'art d'apprécier exactement les valeurs, et le fait d'être vu arpentant le quai bondé, à cette heure de l'après-midi, en compagnie de miss Lily Bart lui représentait, pour parler sa langue, de l'argent comptant." Et pourtant le personnage décrit ici, juif et nouveau riche, apparait finalement comme un brave homme.
A côté de ça la condescendance masculine prêterait presque à rire : "Mon droit d'agir comme je le fais est tout simplement le droit universellement reconnu qu'a un homme d'éclairer une femme quand il la voit inconsciemment placée dans une position fausse."
Lien : http://monbiblioblog.revolub..
Lily Bart est une jeune américaine de bonne famille mais sans argent. Nous sommes au début du 20° siècle (le roman a été écrit en 1905), elle a 20 ans et il est donc urgent qu'elle fasse un beau mariage. Pour cela Lily sait qu'elle peut compter sur son charme et sa beauté:
"L'endroit était charmant, et Lily n'était pas insensible à son charme, ni au fait que sa propre présence le rehaussait encore ; mais elle n'était accoutumée à goûter les joies de la solitude qu'en société, et cette combinaison d'une belle jeune fille et d'un site romanesque lui semblait trop parfaite pour être ainsi gaspillée. Personne toutefois n'apparaissait pour profiter de la circonstance, et, après une demi-heure d'attente stérile, elle se leva et continua d'errer."
Seulement voilà, malgré sa soif de vivre dans l'opulence, il y a chez Lily un fond de morale qui, à plusieurs reprises, alors qu'elle était prête à toucher au but, l'a amenée à saboter ses efforts et a fait capoter une demande en mariage qui semblait pourtant acquise.
Je découvre une société oisive qui, entre la saison en ville et les vacances à la campagne, me fait beaucoup penser à l'aristocratie britannique de la même époque. Sauf qu'ici les femmes fument et qu'il y a des divorcé-e-s. Les plus riches sont prêts à inviter Lily chez eux voire à lui payer un séjour en Europe pour profiter de sa bonne compagnie. On attend cependant qu'elle rende quelques services en échange : faire des travaux de secrétariat ou servir d'alibi à l'amie adultère.
A mesure que le temps passe et qu'elle se lie d'amitié avec Lawrence Selden, un avocat qui évolue dans ces mêmes cercles mais sans en être dépendant, Lily a de plus en plus de mal à concilier ses aspirations contradictoires. Elle ne peut pas envisager de vivre pauvrement, c'est-à-dire sans acheter fréquemment de nouvelles robes et de nouveaux bijoux mais elle prend conscience que ces distractions ne peuvent pas donner de sens profond à sa vie. Faute d'arriver à trancher sa situation devient très inconfortable et nous mène à une fin pathétique qui m'a fait venir des larmes aux yeux.
J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Edith Wharton dresse un portrait critique de cette haute société new-yorkaise dont elle était elle-même issue. A l'occasion, quand Lily découvre la vraie pauvreté, elle nous montre aussi les dures conditions de vie des gens du peuple. Néanmoins je relève l'expression de préjugés antisémites qui me hérissent :
"Il tenait de sa race l'art d'apprécier exactement les valeurs, et le fait d'être vu arpentant le quai bondé, à cette heure de l'après-midi, en compagnie de miss Lily Bart lui représentait, pour parler sa langue, de l'argent comptant." Et pourtant le personnage décrit ici, juif et nouveau riche, apparait finalement comme un brave homme.
A côté de ça la condescendance masculine prêterait presque à rire : "Mon droit d'agir comme je le fais est tout simplement le droit universellement reconnu qu'a un homme d'éclairer une femme quand il la voit inconsciemment placée dans une position fausse."
Lien : http://monbiblioblog.revolub..
J'ai découvert Edith Wharton pendant ma licence d'anglais, en étudiant l'adaptation cinématographique du Temps de l'innocence. J'avais été frappée par les thématiques féministes qui se dégageaient de son oeuvre : l'autrice dénonce une société étroite d'esprit, qui s'évertue à mettre les femmes dans des cases desquelles elles ne peuvent pas sortir.
The House of Mirth, traduit en français sous le titre Chez les heureux du monde, fait partie des classiques de la littérature américaine et aborde les mêmes thématiques, un peu plus brutalement.
Lily Bart est une jeune femme non mariée, d'une vingtaine d'année. Au début des années 1900, ce n'est pas convenable aux yeux de la société.
A cela s'ajoute une certaine « pauvreté » (je mets des guillements parce qu'elle fréquente tout de même les hauts cercles de l'aristocratie new-yorkaise, mais ne possède pas de rente et vit aux crochets de sa tante) qui la met dans des situations peu aisées.
J'ai aimé cette héroïne qui, bien que sous la pression sociale de son cercle, refuse de se marier. Elle ne veut pas se mettre en ménage avec un homme et devenir une ménagère, une mère. Elle ne veut pas abandonner son indépendance relative et sa liberté de mener sa vie comme elle l'entend.
Mais son refus de se plier aux règles de la société la met en difficulté.
Difficulté financière d'abord, puisqu'elle doit subvenir à ses besoins de manière autonome. Une femme de l'aristocratie ne travaille pas, elle vit donc avec la maigre rente que lui verse sa tante, et essaie de faire fructifier son argent par des jeux de cartes (activité peu recommandable pour une jeune femme !) et par le biais d'hommes qui investissent pour elle (encore une fois, activité peur recommandable pour une jeune femme, d'autant plus qu'elle doit faire face à des demandes de dédommagement des plus incorrectes de la part des hommes en question !)
Difficulté sociale ensuite : une femme seule est vue soit comme une proie par les hommes, soit comme une menace de détruire leur couple par les femmes mariées.
Alors Lily navigue dans cette société étroite d'esprit et hypocrite qu'Edith Wharton dénonce. Elle tente de survivre à sa manière, jonglant entre la bienséance et la nécessité de s'en sortir.
On assiste, impuissant·e, à l'étau qui se ressert autour d'elle. Elle en vient même à envisager d'épouser un homme riche, malgré son rejet du mariage.
La plume de l'autrice est à la fois subtile et incisive. Edith Wharton nous plonge dans la vie bouillonnante de l'aristocratie new-yorkaise, et la décortique avec cynisme. J'aime beaucoup son style. Si certain·e·s lui ont reproché des longueurs, je n'en ai pas trouvé !
The House of Mirth confirme mon envie de découvrir un peu plus de l'oeuvre littéraire d'Edith Wharton. Non seulement, c'est une autrice de talent (elle est la première femme à recevoir un prix Pullitzer en 1921) mais c'est également une femme fascinante. Je pense que le prochain livre que je lirai d'elle sera son autobiographie !
Lien : https://furyandfracas.wordpr..
The House of Mirth, traduit en français sous le titre Chez les heureux du monde, fait partie des classiques de la littérature américaine et aborde les mêmes thématiques, un peu plus brutalement.
Lily Bart est une jeune femme non mariée, d'une vingtaine d'année. Au début des années 1900, ce n'est pas convenable aux yeux de la société.
A cela s'ajoute une certaine « pauvreté » (je mets des guillements parce qu'elle fréquente tout de même les hauts cercles de l'aristocratie new-yorkaise, mais ne possède pas de rente et vit aux crochets de sa tante) qui la met dans des situations peu aisées.
J'ai aimé cette héroïne qui, bien que sous la pression sociale de son cercle, refuse de se marier. Elle ne veut pas se mettre en ménage avec un homme et devenir une ménagère, une mère. Elle ne veut pas abandonner son indépendance relative et sa liberté de mener sa vie comme elle l'entend.
Mais son refus de se plier aux règles de la société la met en difficulté.
Difficulté financière d'abord, puisqu'elle doit subvenir à ses besoins de manière autonome. Une femme de l'aristocratie ne travaille pas, elle vit donc avec la maigre rente que lui verse sa tante, et essaie de faire fructifier son argent par des jeux de cartes (activité peu recommandable pour une jeune femme !) et par le biais d'hommes qui investissent pour elle (encore une fois, activité peur recommandable pour une jeune femme, d'autant plus qu'elle doit faire face à des demandes de dédommagement des plus incorrectes de la part des hommes en question !)
Difficulté sociale ensuite : une femme seule est vue soit comme une proie par les hommes, soit comme une menace de détruire leur couple par les femmes mariées.
Alors Lily navigue dans cette société étroite d'esprit et hypocrite qu'Edith Wharton dénonce. Elle tente de survivre à sa manière, jonglant entre la bienséance et la nécessité de s'en sortir.
On assiste, impuissant·e, à l'étau qui se ressert autour d'elle. Elle en vient même à envisager d'épouser un homme riche, malgré son rejet du mariage.
La plume de l'autrice est à la fois subtile et incisive. Edith Wharton nous plonge dans la vie bouillonnante de l'aristocratie new-yorkaise, et la décortique avec cynisme. J'aime beaucoup son style. Si certain·e·s lui ont reproché des longueurs, je n'en ai pas trouvé !
The House of Mirth confirme mon envie de découvrir un peu plus de l'oeuvre littéraire d'Edith Wharton. Non seulement, c'est une autrice de talent (elle est la première femme à recevoir un prix Pullitzer en 1921) mais c'est également une femme fascinante. Je pense que le prochain livre que je lirai d'elle sera son autobiographie !
Lien : https://furyandfracas.wordpr..
Autres sources :https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4150&context=etd
Set in the Gilded Age of the late 19th century, with a widening income gap comparable to our own, The House of Mirth is a relevant and electrifying classic for our times
Jennifer Egan
Sat 11 Jan 2020 05.00 EST
The House of Mirth was the first literary classic that I picked up entirely on my own, without prodding from a teacher or a parent, and adored. I read it as a teenager, during a stifling summer visit to my grandparents, when my literary tastes were unsophisticated (Archie comics were high on my list). I recall the experience as my coming of age as a reader – when I learned, years before discovering that I wanted to write, what transformative power a work of fiction can have.
Because my attachment to the book is so personal, I tend to reread it with slight trepidation that the magic may have fled. After all, the world and I have both changed quite a bit since I was a teenager. But each time, I find the novel's tragic power intact, even as the nature of the tragedy seems to shift – from the perils of living by one's looks (teenage reading) to the cruelty of the world towards women (early adult reading) to the struggle for personal freedom in a money-obsessed culture (adult reading) to my most recent (middle-aged, I'll reluctantly call it) appreciation of the novel as an artefact of the Gilded Age that lays bare that era's pathologies. All of which moves me to assert that Edith Wharton's second novel is a masterpiece that remains electrifying and relevant in our 21st century.
On its surface, The House of Mirth reads like a 19th-century novel. Although the 20th century's defining technologies had all been invented by the time it was published in 1905, they had yet to substantially alter even the affluent world of the novel's protagonist, Lily Bart. Cars were exotic playthings; telephones hadn't supplanted visiting cards; electric light was a harsher alternative to candles. The first world war was inconceivable. And there is, too, a lingering 19th-century feel to Wharton's disembodied approach to human physicality – especially striking in a novel whose central conundrum is sexual: Lily, a pedigreed virgin without fortune, craves the sensual pleasures of life among the very rich but cannot bring herself to marry a wealthy man, her only means of securing those pleasures for life.
In The House of Mirth, sexual deception is rewarded, while virginity remains a volatile property, inciting suspicion
Where The House of Mirth is decidedly 20th century is in its frank depiction of the changing sexual mores around the behaviour of married women. Wives have begun to divorce their husbands. And married women like Lily's nemesis, Bertha Dorset, can commit serial adultery with impunity so long as their husbands don't make a fuss. Wharton lays out this rule explicitly: “The code of Lily's world decreed that a woman's husband should be the only judge of her conduct; she was technically above suspicion while she had the shelter of his approval, or even of his indifference.”
Here we have the moral double standard at the crux of The House of Mirth: sexual deception is rewarded, while virginity remains a volatile property, inciting suspicion. Reactions to its publication support the novel's indictment of this paradox; according to Hermione Lee's superb biography of Wharton, what most scandalised contemporary readers was not Bertha's adultery, but the fact that Lily goes alone to the apartment of a bachelor, Lawrence Selden, to drink tea!
Like her protagonist, Wharton was born into upper crust New York and coerced by her overbearing mother to choose a husband from within its ranks. In her autobiography, A Backward Glance, she celebrates the passion shared with her husband for travel and dogs. But she never mentions Teddy Wharton's bouts of depression or the fact that her own romantic life had moved outside the marriage before she finally divorced him after 28 years.
Wharton had already written books including a novel set in 18th-century Italy and a volume on interior design when she began drafting a novel set in the rarefied world of moneyed New York. The challenge, she recalls in A Backward Glance, was to find the gravitas in such a world. “The answer was that a frivolous society can acquire dramatic significance only through what its frivolity destroys. Its tragic implication lies in its power of debasing people and ideals. The answer, in short, was my heroine, Lily Bart.”
Wharton intended to serialise her new book in Scribner's magazine. She recalled: “But no date had been fixed for its delivery, and between my critical dissatisfaction with the work and the distractions of a busy and hospitable life, full of friends and travel, reading and gardening, I had let the months drift by without really tackling my new subject.”
Edith Wharton.
Edith Wharton. Photograph: Hulton Archive/Getty Images
Advertisement
When another book fell through at Scribner's, Wharton pledged The House of Mirth to fill the empty slot, and its first chapters were rushed into print before she had finished the rest. “It was good to be turned from a drifting amateur into a professional,” she wrote of the experience. “But that was nothing compared to the effect on my imagination of systematic daily effort.” Published when she was 43, The House of Mirth did more than presage Wharton's disciplined productivity for the remainder of her life; it became a bestseller and made her famous.
The Gilded Age of the late 19th century saw a widening income gap that is often compared with our own era. One would never mistake the rich industrialists and bankers in The House of Mirth for the landed gentry of Trollope's 19th century; what counts for a gentleman in this New World is Percy Gryce, the dullard Lily nearly marries early in the novel, whose father invented “a patent device for excluding fresh air from hotels”. Even the richest men are mostly hard at work; as Gus Trenor, the brutish husband of a lavish hostess, puts it: “You don't know how a fellow has to hustle to keep this kind of thing going.”
A gossamer veil separates the illusion of floating beauty that suffuses the luxury of Lily's world from the human toil required, at every level, to create and sustain it. Book one of The House of Mirth leaves that veil undisturbed except for occasional glimpses of what lies across it; the charwoman, who later returns to blackmail Lily; the charitable projects of her childhood friend Gerty Farish, who, though physically plain, is, like Lily, pedigreed, poor and in love with Lawrence – and thus a narrative foil for her. And there is Simon Rosedale, an ultra-wealthy financier and interloper into Lily's world, described in antisemitic terms that are a blot on the novel and might have been fatal to it, were he not one of its most nuanced and sympathetic characters.
Lily has no wish to look across that veil; even when she gives money to Gerty's needy girls (having taken it, fatally, from Gus Trenor), she does so mostly for the narcissistic pleasure of feeling philanthropic. Yet something of the instability – and hidden brutality – that underlies her languid, moneyed cohort keeps invading Lily's vision of it.
Sometimes, as at the Trenors, Lily's companions seem more than worthy of her aspirations: “She liked their elegance, their lightness … They were lords of the only world she cared for, and they were ready to admit her to their ranks and let her lord it with them.” But by dinnertime, stealing allegiance has turned to revulsion. “That very afternoon they had seemed full of brilliant qualities; now she saw that they were merely dull in a loud way. Under the glitter of their opportunities she saw the poverty of their achievement.”
Advertisement
The catalyst for this reversal of perspective is Lawrence's arrival. Like the work of the modernists Wharton anticipates, The House of Mirth embraces the notion of reality as a landscape shaped by consciousness. What destroys Lily is not so much the frivolity of her world as her own inability to commit to that frivolity – or else to break away. In a narrow-minded society, her resistance to marriage will ultimately be seen as a threat. This, too, she understands, and her failures induce bouts of melancholy that Wharton identifies, tellingly, as depression.
Lily's wobbling perspective and unwillingness to play by the rules of her set finally result in social expulsion. Now her downward spiral accelerates, for, being undisciplined, unskilled and unable to sleep without narcotics, she is even less equipped to thrive as a trimmer of ladies' hats than she was as the lady who wore them. Alone and exhausted, she finds herself on a bench in Bryant Park after dark. There, she is recognised and scooped up by Nettie Struther, a girl Lily once helped, through Gerty, to recover from tuberculosis by paying for her stay in a sanatorium. Nettie coaxes Lily to the tenement apartment where she and her husband live with their newborn.
The 100 best novels: No 45 - The Age of Innocence by Edith Wharton (1920)
Read more
Comforted by Nettie's proximity, Lily sees the “dingy” circumstances she has always dreaded transformed into an orb of warmth, gentleness and physical love. She is aware of having had a revelation – discovering a “central truth of existence” that had been absent from the mannered, childless realm where she has passed her life: “All the men and women she knew were like atoms whirling away from each other in some wild centrifugal dance: her first glimpse of the continuity of life had come to her that evening in Nettie's kitchen.” The revelation comes too late, Lily believes, to save her from poverty and solitude. Yet as she drifts into her final sleep, having overdosed – accidentally or intentionally, it's not clear – she cradles an imaginary infant in her arms with a tender joy that implies redemption.
What form that redemption will take is ambiguous, but I have a theory: Lawrence, arriving the next morning at Lily's boarding house, finds Gerty calmly and expertly managing the scene of Lily's self-destruction. In these dire circumstances, Lawrence sees his plain cousin anew. “He stood up, and as their eyes met, he was struck by the extraordinary light in his cousin's face.” Gerty has always loved Lawrence, and there is the hint that with her, he might at last break free of the arid parlour games that kept him from Lily, and partake, in Lily's aftermath, of her revelation.
That's one interpretation, but there are infinite others – of those scenes, and of the novel as a whole. Fiction is the dream life of the culture that makes it, and its enduring mysteries are what keep us coming back. More than a century after Wharton published The House of Mirth, the novel's power remains, for this reader, eternal.
• Scribner will publish a new edition of The House of Mirth on 14 January
Lien : https://www.theguardian.com/..
Set in the Gilded Age of the late 19th century, with a widening income gap comparable to our own, The House of Mirth is a relevant and electrifying classic for our times
Jennifer Egan
Sat 11 Jan 2020 05.00 EST
The House of Mirth was the first literary classic that I picked up entirely on my own, without prodding from a teacher or a parent, and adored. I read it as a teenager, during a stifling summer visit to my grandparents, when my literary tastes were unsophisticated (Archie comics were high on my list). I recall the experience as my coming of age as a reader – when I learned, years before discovering that I wanted to write, what transformative power a work of fiction can have.
Because my attachment to the book is so personal, I tend to reread it with slight trepidation that the magic may have fled. After all, the world and I have both changed quite a bit since I was a teenager. But each time, I find the novel's tragic power intact, even as the nature of the tragedy seems to shift – from the perils of living by one's looks (teenage reading) to the cruelty of the world towards women (early adult reading) to the struggle for personal freedom in a money-obsessed culture (adult reading) to my most recent (middle-aged, I'll reluctantly call it) appreciation of the novel as an artefact of the Gilded Age that lays bare that era's pathologies. All of which moves me to assert that Edith Wharton's second novel is a masterpiece that remains electrifying and relevant in our 21st century.
On its surface, The House of Mirth reads like a 19th-century novel. Although the 20th century's defining technologies had all been invented by the time it was published in 1905, they had yet to substantially alter even the affluent world of the novel's protagonist, Lily Bart. Cars were exotic playthings; telephones hadn't supplanted visiting cards; electric light was a harsher alternative to candles. The first world war was inconceivable. And there is, too, a lingering 19th-century feel to Wharton's disembodied approach to human physicality – especially striking in a novel whose central conundrum is sexual: Lily, a pedigreed virgin without fortune, craves the sensual pleasures of life among the very rich but cannot bring herself to marry a wealthy man, her only means of securing those pleasures for life.
In The House of Mirth, sexual deception is rewarded, while virginity remains a volatile property, inciting suspicion
Where The House of Mirth is decidedly 20th century is in its frank depiction of the changing sexual mores around the behaviour of married women. Wives have begun to divorce their husbands. And married women like Lily's nemesis, Bertha Dorset, can commit serial adultery with impunity so long as their husbands don't make a fuss. Wharton lays out this rule explicitly: “The code of Lily's world decreed that a woman's husband should be the only judge of her conduct; she was technically above suspicion while she had the shelter of his approval, or even of his indifference.”
Here we have the moral double standard at the crux of The House of Mirth: sexual deception is rewarded, while virginity remains a volatile property, inciting suspicion. Reactions to its publication support the novel's indictment of this paradox; according to Hermione Lee's superb biography of Wharton, what most scandalised contemporary readers was not Bertha's adultery, but the fact that Lily goes alone to the apartment of a bachelor, Lawrence Selden, to drink tea!
Like her protagonist, Wharton was born into upper crust New York and coerced by her overbearing mother to choose a husband from within its ranks. In her autobiography, A Backward Glance, she celebrates the passion shared with her husband for travel and dogs. But she never mentions Teddy Wharton's bouts of depression or the fact that her own romantic life had moved outside the marriage before she finally divorced him after 28 years.
Wharton had already written books including a novel set in 18th-century Italy and a volume on interior design when she began drafting a novel set in the rarefied world of moneyed New York. The challenge, she recalls in A Backward Glance, was to find the gravitas in such a world. “The answer was that a frivolous society can acquire dramatic significance only through what its frivolity destroys. Its tragic implication lies in its power of debasing people and ideals. The answer, in short, was my heroine, Lily Bart.”
Wharton intended to serialise her new book in Scribner's magazine. She recalled: “But no date had been fixed for its delivery, and between my critical dissatisfaction with the work and the distractions of a busy and hospitable life, full of friends and travel, reading and gardening, I had let the months drift by without really tackling my new subject.”
Edith Wharton.
Edith Wharton. Photograph: Hulton Archive/Getty Images
Advertisement
When another book fell through at Scribner's, Wharton pledged The House of Mirth to fill the empty slot, and its first chapters were rushed into print before she had finished the rest. “It was good to be turned from a drifting amateur into a professional,” she wrote of the experience. “But that was nothing compared to the effect on my imagination of systematic daily effort.” Published when she was 43, The House of Mirth did more than presage Wharton's disciplined productivity for the remainder of her life; it became a bestseller and made her famous.
The Gilded Age of the late 19th century saw a widening income gap that is often compared with our own era. One would never mistake the rich industrialists and bankers in The House of Mirth for the landed gentry of Trollope's 19th century; what counts for a gentleman in this New World is Percy Gryce, the dullard Lily nearly marries early in the novel, whose father invented “a patent device for excluding fresh air from hotels”. Even the richest men are mostly hard at work; as Gus Trenor, the brutish husband of a lavish hostess, puts it: “You don't know how a fellow has to hustle to keep this kind of thing going.”
A gossamer veil separates the illusion of floating beauty that suffuses the luxury of Lily's world from the human toil required, at every level, to create and sustain it. Book one of The House of Mirth leaves that veil undisturbed except for occasional glimpses of what lies across it; the charwoman, who later returns to blackmail Lily; the charitable projects of her childhood friend Gerty Farish, who, though physically plain, is, like Lily, pedigreed, poor and in love with Lawrence – and thus a narrative foil for her. And there is Simon Rosedale, an ultra-wealthy financier and interloper into Lily's world, described in antisemitic terms that are a blot on the novel and might have been fatal to it, were he not one of its most nuanced and sympathetic characters.
Lily has no wish to look across that veil; even when she gives money to Gerty's needy girls (having taken it, fatally, from Gus Trenor), she does so mostly for the narcissistic pleasure of feeling philanthropic. Yet something of the instability – and hidden brutality – that underlies her languid, moneyed cohort keeps invading Lily's vision of it.
Sometimes, as at the Trenors, Lily's companions seem more than worthy of her aspirations: “She liked their elegance, their lightness … They were lords of the only world she cared for, and they were ready to admit her to their ranks and let her lord it with them.” But by dinnertime, stealing allegiance has turned to revulsion. “That very afternoon they had seemed full of brilliant qualities; now she saw that they were merely dull in a loud way. Under the glitter of their opportunities she saw the poverty of their achievement.”
Advertisement
The catalyst for this reversal of perspective is Lawrence's arrival. Like the work of the modernists Wharton anticipates, The House of Mirth embraces the notion of reality as a landscape shaped by consciousness. What destroys Lily is not so much the frivolity of her world as her own inability to commit to that frivolity – or else to break away. In a narrow-minded society, her resistance to marriage will ultimately be seen as a threat. This, too, she understands, and her failures induce bouts of melancholy that Wharton identifies, tellingly, as depression.
Lily's wobbling perspective and unwillingness to play by the rules of her set finally result in social expulsion. Now her downward spiral accelerates, for, being undisciplined, unskilled and unable to sleep without narcotics, she is even less equipped to thrive as a trimmer of ladies' hats than she was as the lady who wore them. Alone and exhausted, she finds herself on a bench in Bryant Park after dark. There, she is recognised and scooped up by Nettie Struther, a girl Lily once helped, through Gerty, to recover from tuberculosis by paying for her stay in a sanatorium. Nettie coaxes Lily to the tenement apartment where she and her husband live with their newborn.
The 100 best novels: No 45 - The Age of Innocence by Edith Wharton (1920)
Read more
Comforted by Nettie's proximity, Lily sees the “dingy” circumstances she has always dreaded transformed into an orb of warmth, gentleness and physical love. She is aware of having had a revelation – discovering a “central truth of existence” that had been absent from the mannered, childless realm where she has passed her life: “All the men and women she knew were like atoms whirling away from each other in some wild centrifugal dance: her first glimpse of the continuity of life had come to her that evening in Nettie's kitchen.” The revelation comes too late, Lily believes, to save her from poverty and solitude. Yet as she drifts into her final sleep, having overdosed – accidentally or intentionally, it's not clear – she cradles an imaginary infant in her arms with a tender joy that implies redemption.
What form that redemption will take is ambiguous, but I have a theory: Lawrence, arriving the next morning at Lily's boarding house, finds Gerty calmly and expertly managing the scene of Lily's self-destruction. In these dire circumstances, Lawrence sees his plain cousin anew. “He stood up, and as their eyes met, he was struck by the extraordinary light in his cousin's face.” Gerty has always loved Lawrence, and there is the hint that with her, he might at last break free of the arid parlour games that kept him from Lily, and partake, in Lily's aftermath, of her revelation.
That's one interpretation, but there are infinite others – of those scenes, and of the novel as a whole. Fiction is the dream life of the culture that makes it, and its enduring mysteries are what keep us coming back. More than a century after Wharton published The House of Mirth, the novel's power remains, for this reader, eternal.
• Scribner will publish a new edition of The House of Mirth on 14 January
Lien : https://www.theguardian.com/..
Début XXème siècle
Lily Bart est une jeune fille de 29 ans évoluant dans la haute bourgeoisie New-yorkaise. de bonne naissance mais ruinée, elle n'a qu'une ambition : faire un riche mariage avec un homme de son milieu.
Lily Bart est à la fois intelligente (elle a conscience de ce que le mariage, tel que la société dans laquelle elle évolue le conçoit, est une prison), mais d'un autre côté elle ne peut se résoudre à abandonner cette vie futile et oisive pour être indépendante. Elle ne sait pas distinguer ses vrais amis de ceux qui la trahiront.
Je l'ai trouvée à la fois superficielle et émouvante, futile une minute et l'instant d'après profonde.
Qu'elle soit toujours célibataire à 29 ans prouve d'ailleurs qu'elle n'est pas prête à se « vendre au plus offrant » ....elle cherche un « parti » et quand les choses se précisent, elle « sabote » ses chances...
Jusqu'au jour où la société dans laquelle elle a toujours vécu lui tourne le dos...
La belle se débat, essaie de se défendre ....contre des rumeurs infondées...
Quelle ironie du sort : Lily Bart qui est la plus honnête de toute la « bande » se retrouve seule ...
Un roman très intéressant qui dissèque une certaine société « bien sous tout rapport » en apparence mais terriblement cruelle.......
Lily Bart est une jeune fille de 29 ans évoluant dans la haute bourgeoisie New-yorkaise. de bonne naissance mais ruinée, elle n'a qu'une ambition : faire un riche mariage avec un homme de son milieu.
Lily Bart est à la fois intelligente (elle a conscience de ce que le mariage, tel que la société dans laquelle elle évolue le conçoit, est une prison), mais d'un autre côté elle ne peut se résoudre à abandonner cette vie futile et oisive pour être indépendante. Elle ne sait pas distinguer ses vrais amis de ceux qui la trahiront.
Je l'ai trouvée à la fois superficielle et émouvante, futile une minute et l'instant d'après profonde.
Qu'elle soit toujours célibataire à 29 ans prouve d'ailleurs qu'elle n'est pas prête à se « vendre au plus offrant » ....elle cherche un « parti » et quand les choses se précisent, elle « sabote » ses chances...
Jusqu'au jour où la société dans laquelle elle a toujours vécu lui tourne le dos...
La belle se débat, essaie de se défendre ....contre des rumeurs infondées...
Quelle ironie du sort : Lily Bart qui est la plus honnête de toute la « bande » se retrouve seule ...
Un roman très intéressant qui dissèque une certaine société « bien sous tout rapport » en apparence mais terriblement cruelle.......
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Edith Wharton (75)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Chefs-d'oeuvre de la littérature
Quel écrivain est l'auteur de Madame Bovary ?
Honoré de Balzac
Stendhal
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
8 questions
11223 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chef d'oeuvre intemporels
, classiqueCréer un quiz sur ce livre11223 lecteurs ont répondu