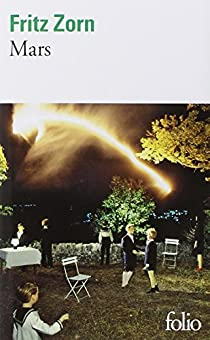Critiques filtrées sur 4 étoiles
C'est un livre que je relirai un jour et je n'en suis pas sortie indemne. le livre, un essai autobiographique de Fritz Angst (ça ne s'invente pas), relate sa vie sous le nom de Zorn (colère) et comment le cancer qui l'a frappé vers 30 ans lui a permis de comprendre quand, comment et pourquoi cela devait en être ainsi. J'ai trouvé la deuxième partie, Ultima Necat, la plus courte, absolument remarquable par la force de son écriture à la fois totalement libre et complètement maîtrisée. La première partie est la plus longue, elle décrit la vie bourgeoise de Zorn et la naissance de sa dépression et de sa névrose. Elle est indispensable mais je l'ai trouvée parfois un peu "répétitive". La troisième partie conclue cet essai et livre une analyse très fine de Zorn et la position qu'il veut occuper dans le monde, vivant ou mort, de la nécessité de se faire remarquer et d'une révolution contre la bourgeoisie qu'il juge inévitable.
C'est un ovni ce livre, Fritz Zorn ne cache rien de ses peurs, de ses faiblesses et de ses haines, explorant, analysant méthodiquement son éducation et les dégâts que cela a provoqué. Ce sont les dernières paroles libres de toute concession d'un homme qui voit la mort venir sans jamais avoir vécu. Je pense que tout lecteur peut le prendre comme une leçon de vie et continuer, sur le temps qu'il nous reste à "tourner" et "fonctionner" même quand rien n'a de sens. Magistral.
C'est un ovni ce livre, Fritz Zorn ne cache rien de ses peurs, de ses faiblesses et de ses haines, explorant, analysant méthodiquement son éducation et les dégâts que cela a provoqué. Ce sont les dernières paroles libres de toute concession d'un homme qui voit la mort venir sans jamais avoir vécu. Je pense que tout lecteur peut le prendre comme une leçon de vie et continuer, sur le temps qu'il nous reste à "tourner" et "fonctionner" même quand rien n'a de sens. Magistral.
Au debut de la lecture, j'avoue avoir été lassée par ce qui me semblait être d'incessantes répétitions.
L'auteur raconte, de diverses manières, à travers de nombreux prismes, à quel point son éducation fut nocive.
Mais ces répétitions, ne sont que le désir de l'auteur de bien faire comprendre au lecteur le mécanisme, le rouage subtil de ce qui l'a créé. Comment son environnement a planté, puis fait poussé la graine de la névrose en lui.
Comment se forme les schémas de pensées, comment l'environnement construit notre structure mentale, à nos dépend et parfois à notre détriment.
Il déroule le fil de ses réflexions, avec une lucidité incroyable.
J'ai été saisie par le détachement ( pas total bien sûr, mais remarquable) et le recul que ce pauvre homme a face à sa maladie.
Quelle incroyable force que celle de regarder en face sa propre névrose, qu'elle soit psychique, physique, ou un mélange des deux.
Je suis très impressionnée par la force de l'auteur.
Sa qualité d'auto analyse, sa volonté de ne pas baisser les armes, encore une fois, sa lucidité m'ont beaucoup touché.
J'ai parfois été déstabilisée par ce que j'interprétais comme une certaine froideur, puis émue par la colère et la tristesse qui s'en suivait.
C'est une histoire triste, révoltante, mais aussi pleine d'espoir et de vie.
Une ode à la vie. Une invitation à vivre plutôt que mourir, la mort n'étant pas celle que l'on croit avant de lire ce témoignage bouleversant.
La toute dernière phrase du livre m'a bouleversée, tant elle est puissante et en même temps pleine de désespoir :
On en ressort pas indemne.
L'auteur raconte, de diverses manières, à travers de nombreux prismes, à quel point son éducation fut nocive.
Mais ces répétitions, ne sont que le désir de l'auteur de bien faire comprendre au lecteur le mécanisme, le rouage subtil de ce qui l'a créé. Comment son environnement a planté, puis fait poussé la graine de la névrose en lui.
Comment se forme les schémas de pensées, comment l'environnement construit notre structure mentale, à nos dépend et parfois à notre détriment.
Il déroule le fil de ses réflexions, avec une lucidité incroyable.
J'ai été saisie par le détachement ( pas total bien sûr, mais remarquable) et le recul que ce pauvre homme a face à sa maladie.
Quelle incroyable force que celle de regarder en face sa propre névrose, qu'elle soit psychique, physique, ou un mélange des deux.
Je suis très impressionnée par la force de l'auteur.
Sa qualité d'auto analyse, sa volonté de ne pas baisser les armes, encore une fois, sa lucidité m'ont beaucoup touché.
J'ai parfois été déstabilisée par ce que j'interprétais comme une certaine froideur, puis émue par la colère et la tristesse qui s'en suivait.
C'est une histoire triste, révoltante, mais aussi pleine d'espoir et de vie.
Une ode à la vie. Une invitation à vivre plutôt que mourir, la mort n'étant pas celle que l'on croit avant de lire ce témoignage bouleversant.
La toute dernière phrase du livre m'a bouleversée, tant elle est puissante et en même temps pleine de désespoir :
On en ressort pas indemne.
Quelle horreur de vie. Pauvre jeune homme. Je comprends son besoin d'écrire le récit de sa vie. Pur produit de la bourgeois zurichoise. Mais surtout produit d'une éducation bourgeoise si l'on veut mais particulièrement intransigeante. Comment sans en avoir l'air, instiller des préceptes de vie à son enfant en dehors de toute réalité sociale. Ce livre est le récit de 30 ans de souffrance. Même s'il a su donner le change partout où il est passé, école, lycée, fac... avec des amis, des voyages, sa manière de se faire accepter par une certaine originalité. Mais intérieurement, effectivement, ce devait être catastrophique. Je ne suis pas loin de penser, que, dans n'importe quel milieu social, l'éducation parentale de classe peut produire de l'exclusion comme ici. Pour autant, j'ai du mal à incriminer la société. Il s'agit d'abord des méfaits d'une éducation parentale.
C'est un livre qui ne se lit pas aisément. D'emblée on est confronté à un style précis mais assez lourd, avec moultes redondances et répétitions. Parfois on aura compris le propos en une phrase alors que l'auteur utilise toute une page pour en faire la démonstration. C'est certainement à mettre à l'actif de l'auteur qui tient à expliciter dans les plus intimes détails, sa vie de souffrances. Mais pour le lecteur, ça devient parfois assez pénible. On se raccroche alors au fond du récit.
C'est un livre à recommander pour lecteur vraiment intéressé.
C'est un livre qui ne se lit pas aisément. D'emblée on est confronté à un style précis mais assez lourd, avec moultes redondances et répétitions. Parfois on aura compris le propos en une phrase alors que l'auteur utilise toute une page pour en faire la démonstration. C'est certainement à mettre à l'actif de l'auteur qui tient à expliciter dans les plus intimes détails, sa vie de souffrances. Mais pour le lecteur, ça devient parfois assez pénible. On se raccroche alors au fond du récit.
C'est un livre à recommander pour lecteur vraiment intéressé.
Probablement, dans un monde d'inertie comme le nôtre où la vacuité agréable prend la forme d'une poursuite impersonnelle de traditions, dans une humanité où le régime d'existence est la continuation passive confinant la représentation de l'initiative à une variation du connu, dans un siècle incapable d'admettre que la pensée véritable se départit de facilité et qui envisage comme événementielles de simples circonstances qui n'ont pas la valeur d'une action, il n'est pas d'entreprise d'esprit sans quelque violente réforme, sans saccage iconoclaste ni destruction méthodique de ce qui précède l'individualité et qui entretient le vide-simulacre des contenances bourgeoises, quelle que soit la forme de bourgeoisie à laquelle on réfère. Quiconque regarde le passé avec une objectivité philosophique, avec les science et bravoure du sceptique d'examen, reconnaît que presque rien de propre et de pur n'a émané de ses prédécesseurs, que la poursuite des mentalités est un crime et le défaut de conflit un manque critique – n'en déplaise aux quiets, Orientaux ou non, pour qui la sagesse est l'acceptation de tout comme patrimoine et providence. En somme, pour trouver un philosophe de génie, il faut commencer par chercher un mécontent, quelqu'un que l'état de la pensée ordinaire insatisfait, celui qui s'agace de ce que réfléchir et écrire se limitent à un vague approfondissement du su, à une extension du cru. On doit bâtir de la grandeur comme on fait un feu : on peut se servir de brindilles et de bois déposés là par autrui, mais ne pas craindre et même s'attendre que beaucoup se consume dans l'ouvrage. Il y a dans l'oeuvre d'esprit authentique un goût assumé de tuer le parent mauvais : toute fausseté dans la filiation du penseur induit chez lui la volonté d'une déviation de la lignée. En ce sens, le génie est un eugénisme c'est-à-dire la recherche de la faille génétique ou, disons, généalogique, c'est-à-dire l'extermination méthodique et impitoyable de l'erreur originelle et conséquente.
« Je crois que c'est justement là que le bât blessait : tout allait toujours trop bien. Dans ma jeunesse, j'aurai été préservé non seulement de la plupart des petits malheurs, mais on m'aura épargné tous les problèmes. Il me faut m'exprimer plus précisément encore à ce sujet : je n'ai jamais eu de problèmes, je n'ai jamais connu le plus petit problème. Ce qui me fut épargné dans mes jeunes années, ce ne fut ni la souffrance ni le malheur, mais les problèmes, et, partant, la capacité d'y faire face. » (page 25)
Mars est le récit d'un être qui n'a pas seulement songé à une révolte contre un ascendant. C'est l'anti « crise d'adolescence », le « contre-rebelle », la négation même de toute possibilité de désaccord, et par suite la fabrication d'un être sans esprit de vérité.
Contrairement à ce que notre ère pseudo-scientifique déclare, rien de moins constructif que le consensus, que la paix, que le sanctuaire et l'inoffensif ; rien de plus stérile et anodin que le bain d'anesthésique où par exemple on voudrait immerger l'enfant à l'école – bain d'ailleurs impossible et illusoire, la souffrance étant relative, le peu de douleur ne signifiant rien d'autre que le déplacement du sentiment du mal vers de petites importunités prenant des proportions considérables. le respect moral de ce principe d'innocuité devient vite une perpétuité, et toute infraction au credo se change alors en intolérable cruauté, jusqu'à dissolution de la faculté de mesurer, jusqu'à suppression de la capacité objective, celle qui sied au penseur supérieur ; alors, on apprend les formules par lesquelles on dissout le vrai dur dans le sociable amolli, comme :
« On observait chez ma pauvre mère un goût très prononcé pour la locution « à moins que ». À peine avait-elle fait une constatation qu'elle ajoutait aussitôt : À moins qu'il n'en soit autrement. Il était courant de l'entendre dire : Je partirai pour Zurich vendredi prochain à dix heures trente du matin, à moins que je ne reste à la maison. Ce soir nous dînerons de spaghettis, à moins qu'il n'y ait du cervelas en salade. Une question s'impose aussitôt : qu'advient-il dès lors de la réalité ? Je vais sortir, à moins que je ne reste chez moi. Je suis présent, à moins que je ne sois absent. La terre est ronde, à moins qu'elle ne soit triangulaire. » (pages 46-47)
Il s'agit au contraire, dans tout exercice de la pensée, d'abattre avec audace le réflexe de permanence, d'aller au combat contre ce qui paralyse et qui est trop entendu, de briser un peu l'appareil des continuités, de cesser de demander pardon pour des divergences, de franchir enfin la zone d'un vide personnel, d'outrepasser ce qui est de l'ordre du collectif impensé, de donner une existence tangible à ce qui n'occupe encore aucune place et de l'imposer par l'irréfragable, ceci à travers l'effort édifiant de se reconstituer, de se matérialiser en occupant éhontément sa portion d'univers qu'on justifie contre ceux qui voudraient la confisquer, d'analyser ce qui en soi et qui ne peut s'accommoder des autres se laissant mener sans cohérence, de se distinguer de l'uniforme par la théorie d'un vrai neuf qu'on propose en son nom, d'opposer sa résistance à la société méprisable en fondant son noyau de singularité vive, un noyau de compréhension justement alternative, noyau dont la force centripète est le contraire d'une lâche assimilation : une densification, un affrontement, une création, une provocation. le penseur profond cherche à atteindre le point de densité où il n'aura pas à s'excuser, parce que ses outils perfectionnés le défendront de l'erreur commune qu'il pourfendra impitoyablement et même amoralement c'est-à-dire au seul moyen de théorèmes froids, sans parti pris, sans rien de personnel, terme à terme. Toutes ces raisons, il les fourbit comme des armes pour se passer de conventions qui sont autant de lames émoussées, pour les traverser sans tort ; il investit le champ des vérités comme théâtre d'opération, non par politesse en se faisant introduire des riverains, mais parce qu'il est préparé et se moque des autorités antérieures, niant quelconque droit de préemption. Pour lui, une place de l'esprit appartient non à celui qui y habite depuis telle durée mais à celui qui la conquiert, et c'est ce qui le dispense d'être aimable et diplomate – il ne négocie pas la vérité.
Un philosophe est fondamentalement un pionnier. le pionnier se moque qu'il y ait eu là avant lui un chêne vénérable, un ours sauvage ou un indigène : il force son dû de possesseur. le pionnier dont je parle prend la vérité avec des arguments invincibles. Il se bat pour la maîtrise d'une portion de territoire. Il est nécessairement une sorte de guerrier. Son inexpugnabilité se situe dans sa force – d'esprit. La survie des plus intellectuels est aussi affaire de compétition.
La puissance du guerrier vient de ce qu'il se ramasse : il forme la boule gravitationnelle constituée de l'appréhension de ce à quoi il ne veut pas ressembler, de ce qu'il se prépare à ne pas assimiler (au titre où il n'accepte pas que l'arme de l'adversaire perce son corps et y entre) par principe, il rejette et exclut, sa préparation est d'abord un refus d'avance, et, en acquérant l'expérience, il découvre que cette tension de mise à distance est ce qui le rend fort. Il n'existe pas un progrès dans la bataille intellectuelle, ni un support graduel, au sens où l'on s'appuierait sur une poussée préexistante : les premiers rangs peuvent aussi bien vous entraîner à la victoire qu'à la mort, et il importe surtout de ne pas s'y fier, car il s'agit d'aspirer au triomphe de son individu, où un seul homme peut quelquefois terrasser une multitude. Ce combattant est résolu à ne pas se laisser influencer, à ne recevoir franchement que les coups indiquant ses erreurs, et il parvient, grâce à cet entraînement, à repérer et à augurer nombre de mouvements sinueux par lesquels on tâche à le circonscrire : c'est pourquoi il ne regrette pas de se porter à l'exercice de sa distinction. Un esprit ne ressemble pas, ou il faudrait ne jamais le reconnaître, et que le génie ne fût opportunistement qu'une pièce de foule, qu'une imitation, qu'une conformité à un groupe c'est-à-dire qu'une grégarité.
C'est pourtant ce qu'est et ce que vaut la notoriété, presque toujours : la reconnaissance par une masse d'un représentant solidaire.
Un philosophe – il n'y en a guère – est celui qui, à force de connaître son environnement, connaît aussi ce que son environnement a voulu faire de lui, les intéressés conditionnements de son environnement, tout ce par quoi un environnement moule et fédère pour se sentir du génie plutôt que du mépris. On ne doit logiquement reprocher au génie d'identifier et de désamorcer les compromissions en lui issues de l'extérieur, car on dénoncerait injustement sa lucidité dans le mécanisme qui permet de réinstruire son identité : on est quelqu'un parce qu'on se dissocie et seulement par l'endroit où s'opère cette dissociation. Je demande qu'un esprit suprêmement intègre procède de l'extraction de ce qui n'est pas lui, de sorte que par méthodique soustraction d'autrui ce ne soit qu'à volonté qu'il conserve des usages parce qu'il les approuve, plutôt que par habitude selon des hérédités proches ou lointaines qu'il ignore ou qu'il absorbe veulement – j'exige de lui des adhésions et nulle fatalité. Un penseur ne saurait exister sans l'abstraction de la pièce proverbiale en lui, dont l'effort même pour l'en retirer est un repère d'intelligence : or, ce penseur exprimera avec d'autant de virulence la tentative sociale d'immixtion en lui, ce « viol d'âme », que l'insinuation lui aura été profonde et pernicieuse, et c'est assurément le cas lorsqu'il estime avoir sacrifié à la fois son temps, son bonheur et sa santé au respect inconscient d'une société qui a agi en lui et l'a utilisé comme un pantin depuis sa prime jeunesse.
C'est à une telle entreprise supérieure de réinitialisation fondamentale que se livre Zorn qui, se diagnostiquant un cancer d'origine familiale, bourgeoise et zurichoise (dont il mourra l'année de sa publication), réalise un essai philosophique d'exemplaire dureté. En effet, jugeant son malheur entièrement dû à la forme d'une existence dévitalisée, à la manière de Lovecraft dont la tumeur intestinale renverrait à la longue colère rentrée, il admet, selon une interprétation certes trop symbolique, que le cancer serait surtout frustration, bile, angoisse, douleurs ravalées et tues, inaptitude à se désinhiber, torpeur, incompréhension, développement interne de ce qui n'a pas eu le droit de s'épanouir à l'extérieur, volubilis poussé en-dedans faute de lumière et de permission d'autre vitalité. Ici, la souffrance à l'origine du lymphome serait l'impossibilité non seulement d'être heureux mais d'accéder à un semblant de joie, (« Pas plus que je ne puis forcer mes désirs, je ne puis en effet me contraindre à rire. Je ne peux pas rire parce que ça ne rit pas en moi. » (page 241)) imputable à un legs comportemental ayant condamné sa vie au succédané, à l'imitation d'un certain bien absurde et inéprouvé sans valeurs propres, à une copie immuable d'un jour après l'autre s'efforçant d'être aussi lointain et bienséant que possible, en un mode de renoncement à la jouissance, une amputation du sens du plaisir, héritage d'une placidité anodine et discrète, espèce de génie juif historique mais sans fièvre d'excellence, ou disparition de soi comme modèle exclusif de vertu. Zorn raconte cette insignifiance, le sentiment d'une innocuité est son histoire, récit d'un être dont, faute d'avoir été, on ne sait dire qu'il a vécu, sinon comme somme d'opinions consensuelles, d'avis de classe sans examens, catégorisations d'automate, modalité convenue, et il explique comment se construisent les préjugés selon une mondanité conservatrice, usages et convenances, dans l'inexistence continue de soi, dans l'imperceptibilité d'un mouvement et d'une chaleur, dans la négation d'un homme qui vient à croire qu'être au summum revient à se déposséder, sans qu'il y ait là de la fierté à appartenir à une communauté, figure essentiellement anéantie, ratage ontologique et, en quelque vision réaliste, saccage, une destinée oncologique. Qu'y avait-il à conserver de toute façon ? tout était véreux, gangrené par l'esprit du néant, environnement et conditionnement de rien : la vraie vie n'avait pas commencé à poindre quand sont venus les signes de la mort, alors il n'y a pas eu de perte, rien à regretter, juste à comprendre, un itinéraire qui peut-être signifie, qui s'extrapole, qui est une leçon dans sa dimension d'égoïsme collectif c'est-à-dire d'exemple. Zorn révèle et théorise son avorton : comment une forme qui dispose d'un prénom peut exister sans être, et contre sa nature.
Mars est le récit d'un homme qui tient à retracer son inexpérience. C'est la révolte d'un être que son siècle a empêché d'accéder à l'individu, et qui prophétise, comme spécimen parmi d'autres qui lui ressemblent, la destruction d'un environnement maudit qui a permis une telle aberration : la neutralisation forcenée et abjecte d'un homme-possible. Je distingue en sa voie forcée de mort-né, et pourtant sans intention méchante, l'extermination systématique d'un être, comparable à la déshumanisation en camp de concentration, mais à l'échelle d'une vie sociale : rien ne peut s'échapper, toute tentative de verdeur est punie, la fuite est tentable aussi bien que ridicule, on s'en aperçoit non par la brutalité intransigeante de gardiens mais par une forme de nivellement non moins impitoyable, à savoir le regard de ceux qu'on aime qui n'essaient rien, et qui passent pourtant d'emblée pour exemplaires. Toute perspective est limitée davantage que sous des grillages ou des barbelés, sous des prismes psychologiques, tout repère est borné, c'est moralement qu'il n'y a pas de perspective, rien ne s'envisage hors des satisfactions permises, monotones et estimées justes, tout est ennui normal sans espérance de profit, au point que la notion d'avantage est phagocytée par des routines comprises au sein d'une mentalité, tout est sis entre le bien et le digne où jamais le concept de « vitalité » ne trouve sa place. « Voilà à quoi se résume sans doute la quintessence de ce monde où je fus jeté et qui devait aussi devenir le mien : la vie est belle et bonne, mais la vie, ce n'est pas nous ; la vie, ce sont les autres. » (page 70) Zorn témoigne de son courage immense de dénonciation de la vie contemporaine, et même de toute vie héritée et morale, de la vie dont s'emparent les coutumes et conditionnant l'esprit, et j'oserais le paradoxe d'affirmer qu'il a vécu à fond cette vie de néant, la vie de tous sans un soi, vie unique d'un névrosé d'anti-vie, vie d'hystérique sans crise particulière, vie superficielle des habitudes où l'existence confina à une société sans individu. Mars relate l'incarnation, en un non-être, de la mentalité d'un groupe social : Fritz Zorn est foncièrement la société, il a fait, seul, l'expérience radicale et complète d'être entièrement confisqué d'une vie personnelle.
Et c'est ce qu'il dépeint et dénonce avec une sagacité inédite, ce qui, cependant, se reçoit comme analyse et pénétration, comme excavation et remontée, comme émergence au lieu d'une sempiternelle plainte : description originale et lucide, anatomique, d'une vie sans la volonté de vivre, d'une vie sans envie, d'une vie sans déviation. Mars constitue l'extraordinaire dissection d'un mal-être causé par l'imposition familiale et léguée d'absence d'être. Tout un malheur vient de là : une vie entière s'est immobilisée en censure des attributs et insignes de la vie, selon le voeu exacerbé de moeurs ultra-conventionnelles. En somme, l'autobiographie explique l'échec de tout bien-être au sein d'une société qui se présente comme parangon codifié et exquis de la bonne pensée : tout ce qui se conforme en soi néglige le soi. Quand on fixe pour but ou habitude le mondain et l'inessentiel, on se détourne du principal et de l'inconvenant, valeurs triviales et insistantes, part qui non entreprise mais qui insiste et dont la présence salubre se rappelle à soi et accapare, comme un regard posé sur soi et émané de soi, qu'on fuit et qui partout rattrape : « Il subsista dès lors en moi la sensation oppressante que quelque chose restait en suspens, quelque chose qui aurait été bien plus important que toute la littérature et la linguistique du monde, et détournait sans cesse mon attention des sujets relatifs aux études romanes, mais sans que la grande et pénible tâche eût été jamais accomplie. » (page 148) Cette tâche primordiale, c'est la confrontation à la réalité, le conflit larvé qui demande à surgir est enfin l'éclatement de la philosophie c'est-à-dire de l'acte créateur qui nuit à l'antériorité.
Enfin : « Je me déclare en état de guerre totale. » (page 318)
C'est l'émergence du « je » à travers la violence subie, reconnue, assumée :
« Mon âme est envahie elle aussi, de toutes parts, par le corps étranger « parents » qui, semblable en cela aux tumeurs cancéreuses de mon corps, n'aspire qu'à anéantir l'organisme tout entier. Les tumeurs cancéreuses par elles-mêmes, on le sait, ne sont pas douloureuses ; ce qui fait mal, ce sont les organes sains en eux-mêmes, qui se trouvent comprimés par les tumeurs cancéreuses. Je crois qu'un phénomène analogue s'observe pour les maladies de l'âme : partout où la douleur se manifeste, c'est moi. L'héritage de mes parents en moi est pareil à une tumeur cancéreuse gigantesque ; tout ce qui en pâtit, ma détresse, mon désespoir, mon calvaire, c'est moi. Je ne suis pas seulement comme mes parents, je suis aussi différent d'eux ; ce qui constitue mon individualité, c'est la souffrance que je ressens. » (pages 248-249)
C'est l'émergence du « je » à travers l'explication de cette violence :
« Ce qui constitue mon individualité, ce n'est pas seulement la souffrance que j'éprouve face à ma situation, mais également ma capacité à évaluer cette situation. » (pages 263-264),
Enfin, c'est l'émergence du « je » à travers le rejet du manichéisme et de la rancune, et qui forme « un troisième horizon à la vie humaine : la clarté. » (page 244) :
« [Mes parents] n'étaient pas critiquables d'une façon qui tranchait sur l'ordinaire ; ils étaient simplement un tout petit peu plus critiquables que d'autres parents critiquables issus des mêmes milieux bourgeois. Ils ne se sont même pas montrés plus méchants que d'autres parents (j'ai déjà eu l'occasion de souligner au contraire que c'étaient des personnes d'une grande gentillesse), ils étaient simplement encore un tout petit peu plus dégénérés que ne le sont dès l'origine les habitant déjà passablement dégénérés de la Rive dorée du lac
Lien : http://henrywar.canalblog.com
« Je crois que c'est justement là que le bât blessait : tout allait toujours trop bien. Dans ma jeunesse, j'aurai été préservé non seulement de la plupart des petits malheurs, mais on m'aura épargné tous les problèmes. Il me faut m'exprimer plus précisément encore à ce sujet : je n'ai jamais eu de problèmes, je n'ai jamais connu le plus petit problème. Ce qui me fut épargné dans mes jeunes années, ce ne fut ni la souffrance ni le malheur, mais les problèmes, et, partant, la capacité d'y faire face. » (page 25)
Mars est le récit d'un être qui n'a pas seulement songé à une révolte contre un ascendant. C'est l'anti « crise d'adolescence », le « contre-rebelle », la négation même de toute possibilité de désaccord, et par suite la fabrication d'un être sans esprit de vérité.
Contrairement à ce que notre ère pseudo-scientifique déclare, rien de moins constructif que le consensus, que la paix, que le sanctuaire et l'inoffensif ; rien de plus stérile et anodin que le bain d'anesthésique où par exemple on voudrait immerger l'enfant à l'école – bain d'ailleurs impossible et illusoire, la souffrance étant relative, le peu de douleur ne signifiant rien d'autre que le déplacement du sentiment du mal vers de petites importunités prenant des proportions considérables. le respect moral de ce principe d'innocuité devient vite une perpétuité, et toute infraction au credo se change alors en intolérable cruauté, jusqu'à dissolution de la faculté de mesurer, jusqu'à suppression de la capacité objective, celle qui sied au penseur supérieur ; alors, on apprend les formules par lesquelles on dissout le vrai dur dans le sociable amolli, comme :
« On observait chez ma pauvre mère un goût très prononcé pour la locution « à moins que ». À peine avait-elle fait une constatation qu'elle ajoutait aussitôt : À moins qu'il n'en soit autrement. Il était courant de l'entendre dire : Je partirai pour Zurich vendredi prochain à dix heures trente du matin, à moins que je ne reste à la maison. Ce soir nous dînerons de spaghettis, à moins qu'il n'y ait du cervelas en salade. Une question s'impose aussitôt : qu'advient-il dès lors de la réalité ? Je vais sortir, à moins que je ne reste chez moi. Je suis présent, à moins que je ne sois absent. La terre est ronde, à moins qu'elle ne soit triangulaire. » (pages 46-47)
Il s'agit au contraire, dans tout exercice de la pensée, d'abattre avec audace le réflexe de permanence, d'aller au combat contre ce qui paralyse et qui est trop entendu, de briser un peu l'appareil des continuités, de cesser de demander pardon pour des divergences, de franchir enfin la zone d'un vide personnel, d'outrepasser ce qui est de l'ordre du collectif impensé, de donner une existence tangible à ce qui n'occupe encore aucune place et de l'imposer par l'irréfragable, ceci à travers l'effort édifiant de se reconstituer, de se matérialiser en occupant éhontément sa portion d'univers qu'on justifie contre ceux qui voudraient la confisquer, d'analyser ce qui en soi et qui ne peut s'accommoder des autres se laissant mener sans cohérence, de se distinguer de l'uniforme par la théorie d'un vrai neuf qu'on propose en son nom, d'opposer sa résistance à la société méprisable en fondant son noyau de singularité vive, un noyau de compréhension justement alternative, noyau dont la force centripète est le contraire d'une lâche assimilation : une densification, un affrontement, une création, une provocation. le penseur profond cherche à atteindre le point de densité où il n'aura pas à s'excuser, parce que ses outils perfectionnés le défendront de l'erreur commune qu'il pourfendra impitoyablement et même amoralement c'est-à-dire au seul moyen de théorèmes froids, sans parti pris, sans rien de personnel, terme à terme. Toutes ces raisons, il les fourbit comme des armes pour se passer de conventions qui sont autant de lames émoussées, pour les traverser sans tort ; il investit le champ des vérités comme théâtre d'opération, non par politesse en se faisant introduire des riverains, mais parce qu'il est préparé et se moque des autorités antérieures, niant quelconque droit de préemption. Pour lui, une place de l'esprit appartient non à celui qui y habite depuis telle durée mais à celui qui la conquiert, et c'est ce qui le dispense d'être aimable et diplomate – il ne négocie pas la vérité.
Un philosophe est fondamentalement un pionnier. le pionnier se moque qu'il y ait eu là avant lui un chêne vénérable, un ours sauvage ou un indigène : il force son dû de possesseur. le pionnier dont je parle prend la vérité avec des arguments invincibles. Il se bat pour la maîtrise d'une portion de territoire. Il est nécessairement une sorte de guerrier. Son inexpugnabilité se situe dans sa force – d'esprit. La survie des plus intellectuels est aussi affaire de compétition.
La puissance du guerrier vient de ce qu'il se ramasse : il forme la boule gravitationnelle constituée de l'appréhension de ce à quoi il ne veut pas ressembler, de ce qu'il se prépare à ne pas assimiler (au titre où il n'accepte pas que l'arme de l'adversaire perce son corps et y entre) par principe, il rejette et exclut, sa préparation est d'abord un refus d'avance, et, en acquérant l'expérience, il découvre que cette tension de mise à distance est ce qui le rend fort. Il n'existe pas un progrès dans la bataille intellectuelle, ni un support graduel, au sens où l'on s'appuierait sur une poussée préexistante : les premiers rangs peuvent aussi bien vous entraîner à la victoire qu'à la mort, et il importe surtout de ne pas s'y fier, car il s'agit d'aspirer au triomphe de son individu, où un seul homme peut quelquefois terrasser une multitude. Ce combattant est résolu à ne pas se laisser influencer, à ne recevoir franchement que les coups indiquant ses erreurs, et il parvient, grâce à cet entraînement, à repérer et à augurer nombre de mouvements sinueux par lesquels on tâche à le circonscrire : c'est pourquoi il ne regrette pas de se porter à l'exercice de sa distinction. Un esprit ne ressemble pas, ou il faudrait ne jamais le reconnaître, et que le génie ne fût opportunistement qu'une pièce de foule, qu'une imitation, qu'une conformité à un groupe c'est-à-dire qu'une grégarité.
C'est pourtant ce qu'est et ce que vaut la notoriété, presque toujours : la reconnaissance par une masse d'un représentant solidaire.
Un philosophe – il n'y en a guère – est celui qui, à force de connaître son environnement, connaît aussi ce que son environnement a voulu faire de lui, les intéressés conditionnements de son environnement, tout ce par quoi un environnement moule et fédère pour se sentir du génie plutôt que du mépris. On ne doit logiquement reprocher au génie d'identifier et de désamorcer les compromissions en lui issues de l'extérieur, car on dénoncerait injustement sa lucidité dans le mécanisme qui permet de réinstruire son identité : on est quelqu'un parce qu'on se dissocie et seulement par l'endroit où s'opère cette dissociation. Je demande qu'un esprit suprêmement intègre procède de l'extraction de ce qui n'est pas lui, de sorte que par méthodique soustraction d'autrui ce ne soit qu'à volonté qu'il conserve des usages parce qu'il les approuve, plutôt que par habitude selon des hérédités proches ou lointaines qu'il ignore ou qu'il absorbe veulement – j'exige de lui des adhésions et nulle fatalité. Un penseur ne saurait exister sans l'abstraction de la pièce proverbiale en lui, dont l'effort même pour l'en retirer est un repère d'intelligence : or, ce penseur exprimera avec d'autant de virulence la tentative sociale d'immixtion en lui, ce « viol d'âme », que l'insinuation lui aura été profonde et pernicieuse, et c'est assurément le cas lorsqu'il estime avoir sacrifié à la fois son temps, son bonheur et sa santé au respect inconscient d'une société qui a agi en lui et l'a utilisé comme un pantin depuis sa prime jeunesse.
C'est à une telle entreprise supérieure de réinitialisation fondamentale que se livre Zorn qui, se diagnostiquant un cancer d'origine familiale, bourgeoise et zurichoise (dont il mourra l'année de sa publication), réalise un essai philosophique d'exemplaire dureté. En effet, jugeant son malheur entièrement dû à la forme d'une existence dévitalisée, à la manière de Lovecraft dont la tumeur intestinale renverrait à la longue colère rentrée, il admet, selon une interprétation certes trop symbolique, que le cancer serait surtout frustration, bile, angoisse, douleurs ravalées et tues, inaptitude à se désinhiber, torpeur, incompréhension, développement interne de ce qui n'a pas eu le droit de s'épanouir à l'extérieur, volubilis poussé en-dedans faute de lumière et de permission d'autre vitalité. Ici, la souffrance à l'origine du lymphome serait l'impossibilité non seulement d'être heureux mais d'accéder à un semblant de joie, (« Pas plus que je ne puis forcer mes désirs, je ne puis en effet me contraindre à rire. Je ne peux pas rire parce que ça ne rit pas en moi. » (page 241)) imputable à un legs comportemental ayant condamné sa vie au succédané, à l'imitation d'un certain bien absurde et inéprouvé sans valeurs propres, à une copie immuable d'un jour après l'autre s'efforçant d'être aussi lointain et bienséant que possible, en un mode de renoncement à la jouissance, une amputation du sens du plaisir, héritage d'une placidité anodine et discrète, espèce de génie juif historique mais sans fièvre d'excellence, ou disparition de soi comme modèle exclusif de vertu. Zorn raconte cette insignifiance, le sentiment d'une innocuité est son histoire, récit d'un être dont, faute d'avoir été, on ne sait dire qu'il a vécu, sinon comme somme d'opinions consensuelles, d'avis de classe sans examens, catégorisations d'automate, modalité convenue, et il explique comment se construisent les préjugés selon une mondanité conservatrice, usages et convenances, dans l'inexistence continue de soi, dans l'imperceptibilité d'un mouvement et d'une chaleur, dans la négation d'un homme qui vient à croire qu'être au summum revient à se déposséder, sans qu'il y ait là de la fierté à appartenir à une communauté, figure essentiellement anéantie, ratage ontologique et, en quelque vision réaliste, saccage, une destinée oncologique. Qu'y avait-il à conserver de toute façon ? tout était véreux, gangrené par l'esprit du néant, environnement et conditionnement de rien : la vraie vie n'avait pas commencé à poindre quand sont venus les signes de la mort, alors il n'y a pas eu de perte, rien à regretter, juste à comprendre, un itinéraire qui peut-être signifie, qui s'extrapole, qui est une leçon dans sa dimension d'égoïsme collectif c'est-à-dire d'exemple. Zorn révèle et théorise son avorton : comment une forme qui dispose d'un prénom peut exister sans être, et contre sa nature.
Mars est le récit d'un homme qui tient à retracer son inexpérience. C'est la révolte d'un être que son siècle a empêché d'accéder à l'individu, et qui prophétise, comme spécimen parmi d'autres qui lui ressemblent, la destruction d'un environnement maudit qui a permis une telle aberration : la neutralisation forcenée et abjecte d'un homme-possible. Je distingue en sa voie forcée de mort-né, et pourtant sans intention méchante, l'extermination systématique d'un être, comparable à la déshumanisation en camp de concentration, mais à l'échelle d'une vie sociale : rien ne peut s'échapper, toute tentative de verdeur est punie, la fuite est tentable aussi bien que ridicule, on s'en aperçoit non par la brutalité intransigeante de gardiens mais par une forme de nivellement non moins impitoyable, à savoir le regard de ceux qu'on aime qui n'essaient rien, et qui passent pourtant d'emblée pour exemplaires. Toute perspective est limitée davantage que sous des grillages ou des barbelés, sous des prismes psychologiques, tout repère est borné, c'est moralement qu'il n'y a pas de perspective, rien ne s'envisage hors des satisfactions permises, monotones et estimées justes, tout est ennui normal sans espérance de profit, au point que la notion d'avantage est phagocytée par des routines comprises au sein d'une mentalité, tout est sis entre le bien et le digne où jamais le concept de « vitalité » ne trouve sa place. « Voilà à quoi se résume sans doute la quintessence de ce monde où je fus jeté et qui devait aussi devenir le mien : la vie est belle et bonne, mais la vie, ce n'est pas nous ; la vie, ce sont les autres. » (page 70) Zorn témoigne de son courage immense de dénonciation de la vie contemporaine, et même de toute vie héritée et morale, de la vie dont s'emparent les coutumes et conditionnant l'esprit, et j'oserais le paradoxe d'affirmer qu'il a vécu à fond cette vie de néant, la vie de tous sans un soi, vie unique d'un névrosé d'anti-vie, vie d'hystérique sans crise particulière, vie superficielle des habitudes où l'existence confina à une société sans individu. Mars relate l'incarnation, en un non-être, de la mentalité d'un groupe social : Fritz Zorn est foncièrement la société, il a fait, seul, l'expérience radicale et complète d'être entièrement confisqué d'une vie personnelle.
Et c'est ce qu'il dépeint et dénonce avec une sagacité inédite, ce qui, cependant, se reçoit comme analyse et pénétration, comme excavation et remontée, comme émergence au lieu d'une sempiternelle plainte : description originale et lucide, anatomique, d'une vie sans la volonté de vivre, d'une vie sans envie, d'une vie sans déviation. Mars constitue l'extraordinaire dissection d'un mal-être causé par l'imposition familiale et léguée d'absence d'être. Tout un malheur vient de là : une vie entière s'est immobilisée en censure des attributs et insignes de la vie, selon le voeu exacerbé de moeurs ultra-conventionnelles. En somme, l'autobiographie explique l'échec de tout bien-être au sein d'une société qui se présente comme parangon codifié et exquis de la bonne pensée : tout ce qui se conforme en soi néglige le soi. Quand on fixe pour but ou habitude le mondain et l'inessentiel, on se détourne du principal et de l'inconvenant, valeurs triviales et insistantes, part qui non entreprise mais qui insiste et dont la présence salubre se rappelle à soi et accapare, comme un regard posé sur soi et émané de soi, qu'on fuit et qui partout rattrape : « Il subsista dès lors en moi la sensation oppressante que quelque chose restait en suspens, quelque chose qui aurait été bien plus important que toute la littérature et la linguistique du monde, et détournait sans cesse mon attention des sujets relatifs aux études romanes, mais sans que la grande et pénible tâche eût été jamais accomplie. » (page 148) Cette tâche primordiale, c'est la confrontation à la réalité, le conflit larvé qui demande à surgir est enfin l'éclatement de la philosophie c'est-à-dire de l'acte créateur qui nuit à l'antériorité.
Enfin : « Je me déclare en état de guerre totale. » (page 318)
C'est l'émergence du « je » à travers la violence subie, reconnue, assumée :
« Mon âme est envahie elle aussi, de toutes parts, par le corps étranger « parents » qui, semblable en cela aux tumeurs cancéreuses de mon corps, n'aspire qu'à anéantir l'organisme tout entier. Les tumeurs cancéreuses par elles-mêmes, on le sait, ne sont pas douloureuses ; ce qui fait mal, ce sont les organes sains en eux-mêmes, qui se trouvent comprimés par les tumeurs cancéreuses. Je crois qu'un phénomène analogue s'observe pour les maladies de l'âme : partout où la douleur se manifeste, c'est moi. L'héritage de mes parents en moi est pareil à une tumeur cancéreuse gigantesque ; tout ce qui en pâtit, ma détresse, mon désespoir, mon calvaire, c'est moi. Je ne suis pas seulement comme mes parents, je suis aussi différent d'eux ; ce qui constitue mon individualité, c'est la souffrance que je ressens. » (pages 248-249)
C'est l'émergence du « je » à travers l'explication de cette violence :
« Ce qui constitue mon individualité, ce n'est pas seulement la souffrance que j'éprouve face à ma situation, mais également ma capacité à évaluer cette situation. » (pages 263-264),
Enfin, c'est l'émergence du « je » à travers le rejet du manichéisme et de la rancune, et qui forme « un troisième horizon à la vie humaine : la clarté. » (page 244) :
« [Mes parents] n'étaient pas critiquables d'une façon qui tranchait sur l'ordinaire ; ils étaient simplement un tout petit peu plus critiquables que d'autres parents critiquables issus des mêmes milieux bourgeois. Ils ne se sont même pas montrés plus méchants que d'autres parents (j'ai déjà eu l'occasion de souligner au contraire que c'étaient des personnes d'une grande gentillesse), ils étaient simplement encore un tout petit peu plus dégénérés que ne le sont dès l'origine les habitant déjà passablement dégénérés de la Rive dorée du lac
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Autobiographie d'un Zurichois né dans une famille bourgeoise très aisée. Il n'a manqué de rien mais est très malheureux car en complet décalage avec ses congénères à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Jamis il n'arrivera à trouver sa place. Il développe finalement un cancer dont il mourra à 32 ans et reste convaincu que sa tristesse et son enfance ont été déterminant dans sa maladie. Ce texte est d'une infinie tristesse et constitue une condamnation de cette vie aristocrate où l'on doit taire tout sentiment, toute émotion. Fritz meurt en 1972, pas en 1920! C'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette autobiographie. Je l'ai lue en allemand et vais maintenant la lire en français.
L'auteur de Mars, Fritz Zorn est en colère, pas de doute on l'apprend dès la couverture : il adopte pour son nom le pseudo « Zorn » qui signifie colère en allemand.
En colère contre qui, contre quoi ? Contre ses parents d'abord qui l'ont élevé « comme il faut », dans un milieu très bourgeois, dans une grande villa sur la « rive dorée » du lac de Zurich, où il s'est senti « castré » de la capacité à dire « non », d'avoir son propre avis, sa propre personnalité.
Ce fut un enfant bien sage et obéissant, cultivé, mais frustré à l'adolescence et bien davantage encore pendant sa courte vie d'adulte.
Le résultat, c'est cet ouvrage de révolte et ce cancer « une boule au cou » qu'il dit avoir « attrapé » en raison de toutes ces années de dépression et de frustration.
En lisant l'ouvrage on comprend que l'absence de relation sexuelle et d'intimité avec les femmes ont beaucoup joué dans son malheur et sa frustration. Il n'a jamais été amoureux et n'a pas l'air de s'être senti aimé.
Au début de l'ouvrage il nous parle d'un frère dont on regrette que l'auteur n'en parle plus ensuite. Qu'est-il devenu ?
Lucide, l'auteur remarque que fort heureusement, tous les fils de bourgeois ne finisse pas dépressif comme lui. Il dit bien que c'est lié à son caractère, sa sensibilité.
Néanmoins il est en colère, révolté contre la bourgeoisie et la religion chrétienne qui nie la vie, ce sont ses mots. A le lire, il aurait sûrement préféré naître pauvre et vivre. En le suivant, sans doute la pauvreté l'aurait-elle obligé à travailler, gagner de l'argent, comme d'autres, alors que lui au lycée ou plus tard à l'Université n'en avait pas besoin. Cela peut expliquer une partie de sa marginalité même s'il reconnaît à plusieurs reprises qu'il n'a pas toujours manqué d'ami. Il s'est malgré tout toujours senti seul, même entouré. Peut-être incompris, sans ami intime avec qui s'épancher de ses soucis. Diplômé d'un doctorat en langues il deviendra professeur d'Espagnol, il dit aimer son travail car cela lui permet surtout de voir du monde, de moins être dans la solitude. Il a l'esprit, la culture latine, mais c'est comme si son coeur était « froid ».
Faute d'ami intime, ou sans doute parce que le mal était trop profond, c'est donc auprès d'un psychanalyste qu'il se livre. Mais aussi à travers l'écriture de son ouvrage – en espérant peut être un effet catharsis ?
Le ton de l'ouvrage est très pudique, on apprendra rien de bien personnel sur la façon de vivre des bourgeois qu'il critique ou ses relations avec les autres. Pourtant il est prêt à faire la révolution pour que les choses changent. Métaphoriquement il se voit comme le cancer au sein de la bourgeois, révélatrice de ses travers, prête à éclater selon lui. Quelque part, paradoxalement, il souhaite dépasser sa condition de bourgeois, être en dehors. Mais le peut-il vraiment lui qui en a tous les codes et qui a grandit dans ce milieu ?
Il dit se sentir mieux depuis qu'il a appris qu'il était malade, et qu'il a mis un nom sur la maladie. Il se sent maintenant moins dépressif et souhaite vaincre son cancer. Il a un but.
C'est l'histoire d'un homme en manque d'amour, mal dans sa peau, jamais à sa place, qui a oublié de vivre, d'exister.
Très cultivé, s'autoanalysant, l'auteur est un plaisir à suivre, l'écriture est fluide, clair. On se demande dans quel mesure Fritz Zorn était condamné par son milieu social et son caractère. N'a t-il pas eu de chance ou est ce lui qui n'a pas su saisir les opportunités, les rencontres qu'il évoque dans l'ouvrage ?
Mal à l'aise avec son corps au lycée il aura réussi après quelques années à se dépasser dans plusieurs domaines, gymnastique, danse, pourtant on a le sentiment qu'il ne prend pas de plaisir de ses succès. Est-il un frustré-né, incapable de jouir ?
Il ne suffit pas de dire à un ami – qu'il semble n'avoir jamais eu – « va s'y, parle à cette fille », « invite la à boire un verre, à danser, à sortir...», « déclare lui tes sentiments, dis lui que tu l'aimes » – pour que cela se réalise, que l'on passe à l'acte. Vivre c'est agir, prendre des risques – souvent mesuré.
Ainsi c'est comme si il n'avait pas eu suffisamment cette volonté de vivre, de se battre, pour que la vie continue. « Mars » ce titre fait référence mythologiquement à l'esprit combatif. L'auteur n'en aura pas manqué pour achever son ouvrage et lutter par les mots contre son milieu social. Mais ne se bat-il pas trop tard, à 30 ans, lorsqu'il est déjà, sans le savoir, condamné par la maladie ?
Malgré tout la vie manquée de Fritz Zorn n'aura pas été vaine. N'aura t-il pas vécu pour que son histoire nous parvienne, nous montrant s'il fallait encore s'en convaincre, que décidément l'argent ne fait pas le bonheur, et qu'il vaut mieux parfois vider son compte en banque, comme il le dit « faire sauter le crédit suisse » et devenir pauvre comme job. Mais qui fait ça, qui se met à nu lorsqu'il est riche pour vivre une nouvelle vie et se passer de certains « plaisirs » ou dirons nous certaines « facilités » ?
Je ne suis pas sûr à la lecture de l'ouvrage que Fritz Zorn aurait été mieux préparé à affronter la vie en ayant vécu dans un milieu populaire. Peut-être aurait-il été encore davantage brimé par sa sensibilité. A aucun moment il ne parle de timidité, pourtant sa pudeur traduit bien une forme de timidité, comme une peur de déranger.
Dans la dernière partie l'auteur va plus mal du fait de sa maladie, son écriture prend alors l'allure d'un procès ou la société, la religion et ses parents sont jugés. Sans être manichéen, il critique la bourgeoisie mais sans vanter non plus le communisme. S'il en veut à ses parents pour leur éducation, il leur pardonne aussi, leur accordant magnanimement des circonstances atténuantes.
Ce qui aura manqué le plus à la vie de Fritz Zorn c'est l'amour, la joie, ce sentiment d'être vivant, d'être aimé, de partager. Ce qu'on peut reprocher à Fritz c'est d'avoir attendu d'être malade pour se battre, pour exprimer sa colère, se révolter. La leçon de l'ouvrage est la selon moi : vivons avant d'être malade ou d'être trop vieux, n'attendons pas un hypothétique alignement des planètes pour vivre. Vivre c'est aussi ne pas toujours faire ce que la société nous demande de faire selon les conventions morales en vigueur. Alors vivons, sachons nous faire plaisir en écoutant nos désirs, ici et maintenant !
En colère contre qui, contre quoi ? Contre ses parents d'abord qui l'ont élevé « comme il faut », dans un milieu très bourgeois, dans une grande villa sur la « rive dorée » du lac de Zurich, où il s'est senti « castré » de la capacité à dire « non », d'avoir son propre avis, sa propre personnalité.
Ce fut un enfant bien sage et obéissant, cultivé, mais frustré à l'adolescence et bien davantage encore pendant sa courte vie d'adulte.
Le résultat, c'est cet ouvrage de révolte et ce cancer « une boule au cou » qu'il dit avoir « attrapé » en raison de toutes ces années de dépression et de frustration.
En lisant l'ouvrage on comprend que l'absence de relation sexuelle et d'intimité avec les femmes ont beaucoup joué dans son malheur et sa frustration. Il n'a jamais été amoureux et n'a pas l'air de s'être senti aimé.
Au début de l'ouvrage il nous parle d'un frère dont on regrette que l'auteur n'en parle plus ensuite. Qu'est-il devenu ?
Lucide, l'auteur remarque que fort heureusement, tous les fils de bourgeois ne finisse pas dépressif comme lui. Il dit bien que c'est lié à son caractère, sa sensibilité.
Néanmoins il est en colère, révolté contre la bourgeoisie et la religion chrétienne qui nie la vie, ce sont ses mots. A le lire, il aurait sûrement préféré naître pauvre et vivre. En le suivant, sans doute la pauvreté l'aurait-elle obligé à travailler, gagner de l'argent, comme d'autres, alors que lui au lycée ou plus tard à l'Université n'en avait pas besoin. Cela peut expliquer une partie de sa marginalité même s'il reconnaît à plusieurs reprises qu'il n'a pas toujours manqué d'ami. Il s'est malgré tout toujours senti seul, même entouré. Peut-être incompris, sans ami intime avec qui s'épancher de ses soucis. Diplômé d'un doctorat en langues il deviendra professeur d'Espagnol, il dit aimer son travail car cela lui permet surtout de voir du monde, de moins être dans la solitude. Il a l'esprit, la culture latine, mais c'est comme si son coeur était « froid ».
Faute d'ami intime, ou sans doute parce que le mal était trop profond, c'est donc auprès d'un psychanalyste qu'il se livre. Mais aussi à travers l'écriture de son ouvrage – en espérant peut être un effet catharsis ?
Le ton de l'ouvrage est très pudique, on apprendra rien de bien personnel sur la façon de vivre des bourgeois qu'il critique ou ses relations avec les autres. Pourtant il est prêt à faire la révolution pour que les choses changent. Métaphoriquement il se voit comme le cancer au sein de la bourgeois, révélatrice de ses travers, prête à éclater selon lui. Quelque part, paradoxalement, il souhaite dépasser sa condition de bourgeois, être en dehors. Mais le peut-il vraiment lui qui en a tous les codes et qui a grandit dans ce milieu ?
Il dit se sentir mieux depuis qu'il a appris qu'il était malade, et qu'il a mis un nom sur la maladie. Il se sent maintenant moins dépressif et souhaite vaincre son cancer. Il a un but.
C'est l'histoire d'un homme en manque d'amour, mal dans sa peau, jamais à sa place, qui a oublié de vivre, d'exister.
Très cultivé, s'autoanalysant, l'auteur est un plaisir à suivre, l'écriture est fluide, clair. On se demande dans quel mesure Fritz Zorn était condamné par son milieu social et son caractère. N'a t-il pas eu de chance ou est ce lui qui n'a pas su saisir les opportunités, les rencontres qu'il évoque dans l'ouvrage ?
Mal à l'aise avec son corps au lycée il aura réussi après quelques années à se dépasser dans plusieurs domaines, gymnastique, danse, pourtant on a le sentiment qu'il ne prend pas de plaisir de ses succès. Est-il un frustré-né, incapable de jouir ?
Il ne suffit pas de dire à un ami – qu'il semble n'avoir jamais eu – « va s'y, parle à cette fille », « invite la à boire un verre, à danser, à sortir...», « déclare lui tes sentiments, dis lui que tu l'aimes » – pour que cela se réalise, que l'on passe à l'acte. Vivre c'est agir, prendre des risques – souvent mesuré.
Ainsi c'est comme si il n'avait pas eu suffisamment cette volonté de vivre, de se battre, pour que la vie continue. « Mars » ce titre fait référence mythologiquement à l'esprit combatif. L'auteur n'en aura pas manqué pour achever son ouvrage et lutter par les mots contre son milieu social. Mais ne se bat-il pas trop tard, à 30 ans, lorsqu'il est déjà, sans le savoir, condamné par la maladie ?
Malgré tout la vie manquée de Fritz Zorn n'aura pas été vaine. N'aura t-il pas vécu pour que son histoire nous parvienne, nous montrant s'il fallait encore s'en convaincre, que décidément l'argent ne fait pas le bonheur, et qu'il vaut mieux parfois vider son compte en banque, comme il le dit « faire sauter le crédit suisse » et devenir pauvre comme job. Mais qui fait ça, qui se met à nu lorsqu'il est riche pour vivre une nouvelle vie et se passer de certains « plaisirs » ou dirons nous certaines « facilités » ?
Je ne suis pas sûr à la lecture de l'ouvrage que Fritz Zorn aurait été mieux préparé à affronter la vie en ayant vécu dans un milieu populaire. Peut-être aurait-il été encore davantage brimé par sa sensibilité. A aucun moment il ne parle de timidité, pourtant sa pudeur traduit bien une forme de timidité, comme une peur de déranger.
Dans la dernière partie l'auteur va plus mal du fait de sa maladie, son écriture prend alors l'allure d'un procès ou la société, la religion et ses parents sont jugés. Sans être manichéen, il critique la bourgeoisie mais sans vanter non plus le communisme. S'il en veut à ses parents pour leur éducation, il leur pardonne aussi, leur accordant magnanimement des circonstances atténuantes.
Ce qui aura manqué le plus à la vie de Fritz Zorn c'est l'amour, la joie, ce sentiment d'être vivant, d'être aimé, de partager. Ce qu'on peut reprocher à Fritz c'est d'avoir attendu d'être malade pour se battre, pour exprimer sa colère, se révolter. La leçon de l'ouvrage est la selon moi : vivons avant d'être malade ou d'être trop vieux, n'attendons pas un hypothétique alignement des planètes pour vivre. Vivre c'est aussi ne pas toujours faire ce que la société nous demande de faire selon les conventions morales en vigueur. Alors vivons, sachons nous faire plaisir en écoutant nos désirs, ici et maintenant !
Ce n'est pas un coup de foudre, mais peut être le début d'un cheminement intérieur.
Fritz Zorn est un homme « jeune, riche et cultivé » mais « malheureux, névrosé et seul ». Et il nous livre son histoire, de façon intime. Il nous raconte comme la bienséance de sa famille aisée de Zurich l'a coupé de la vie. Fritz Zorn n'a pas vécu, mais par un jeu d'opposition, nous raconte la beauté de la vie, qu'il n'a pas su vivre.
Il a des phrases sublimes sur la sexualité, sur l'éducation, sur la transmission, sur le sens de la vie… écrites par quelqu'un qui n'a rien vécu de tout cela.
Ce livre ouvre une porte… et se faisant, nous donne envie de pleurer quelques fois avec son auteur.
Fritz Zorn est un homme « jeune, riche et cultivé » mais « malheureux, névrosé et seul ». Et il nous livre son histoire, de façon intime. Il nous raconte comme la bienséance de sa famille aisée de Zurich l'a coupé de la vie. Fritz Zorn n'a pas vécu, mais par un jeu d'opposition, nous raconte la beauté de la vie, qu'il n'a pas su vivre.
Il a des phrases sublimes sur la sexualité, sur l'éducation, sur la transmission, sur le sens de la vie… écrites par quelqu'un qui n'a rien vécu de tout cela.
Ce livre ouvre une porte… et se faisant, nous donne envie de pleurer quelques fois avec son auteur.
Jeune suisse, la trentaine écrit sous l'urgence d'une mort imminente: un cancer qu'on ne peut guérir. Il revient sur sa courte vie; d'un milieu bourgeois et aisé il n'a jamais manqué de rien: il a vécu dans une bulle où tout était fait pour l'harmonie: il suffisait de suivre les décisions du père...Zorn (colère) estime avoir vécu dans le mensonge et l'hypocrisie.
Il fait des crises dépressives sur fond de dépression chronique. Il ne parvient pas à se faire des amis, encore moins une petite amie.
Il est un élève modèle: bon travail scolaire et discrétion.
Sans arrêt il cherche à donner le change: il va très mal mais sauve les apparences et a toujours le sourire. Une fois ses études terminées, il devient prof.
Il semble moins préoccupé par son cancer que d'avoir été soumis à une éducation non pas sévère mais mensongère: il ne connait pas le monde et pense que son cancer est l'aboutissement de sa dépression. Il sait qu'il est névrosé et a commencé des psychothérapies.
Sur un certain nombre de points, je me suis identifiée au personnage notamment la dépression mais ma quasi non éducation nous sépare; je partage sa colère quand à l'hypocrisie bourgeoise mais je n'appartiens pas à cette bourgeoisie qui pense rendre heureux un enfant en le coupant du monde.
Un roman amer, touchant mais les redites m'ont agacée.
Il fait des crises dépressives sur fond de dépression chronique. Il ne parvient pas à se faire des amis, encore moins une petite amie.
Il est un élève modèle: bon travail scolaire et discrétion.
Sans arrêt il cherche à donner le change: il va très mal mais sauve les apparences et a toujours le sourire. Une fois ses études terminées, il devient prof.
Il semble moins préoccupé par son cancer que d'avoir été soumis à une éducation non pas sévère mais mensongère: il ne connait pas le monde et pense que son cancer est l'aboutissement de sa dépression. Il sait qu'il est névrosé et a commencé des psychothérapies.
Sur un certain nombre de points, je me suis identifiée au personnage notamment la dépression mais ma quasi non éducation nous sépare; je partage sa colère quand à l'hypocrisie bourgeoise mais je n'appartiens pas à cette bourgeoisie qui pense rendre heureux un enfant en le coupant du monde.
Un roman amer, touchant mais les redites m'ont agacée.
Un livre unique, une sorte de testament, que les hasards de la vie vous remettent dans les mains.
Fritz Zorn l'a écrit, gravement malade, un cancer. le livre est publié en 1977, peu avant son décès des suites de la maladie. Mal préparé à cette épreuve après une enfance et jeunesse sur la « Rive dorée » de Zurich. Mais sommes-nous vraiment préparés à ce type d'épreuves, quelle que soit notre vie ?
Pris dans les profondeurs de cette expérience redoutable, il exprime, sincère et lucide, ses sentiments, sa colère, ses frustrations et ses déceptions.
Face à la vie. Face à la société.
Il dénonce son éducation, ses faiblesses.« Mes parents névrosés ont produit en ma personne un être qui s'il n'était pas assez faible de corps pour mourir dès sa naissance, a été tellement démoli dans son âme par le milieu névrotique où il a grandi qu'il n'est plus apte à une existence qu'on puisse qualifier d'humaine… Cela a-t-il un sens que je ne sois pas mort dès ma naissance ? »
Un jugement sans concession sur ses propres aptitudes et ses comportements.
Il décrit ses névroses, ses difficultés à communiquer, son impossibilité d'aimer.
Les femmes ?« La femme telle que je l'imaginais n'était qu'un accessoire de plus dans mon univers infantile. » Écrit-il.
Un monologue, long, écrit dans une langue brutale, qui exprime de la colère.
Une colère qui, à ses yeux, lui redonne sa dignité L'évocation des souvenirs s'efface alors pour aborder les grandes questions existentielles: la recherche du sens de la vie, la condition humaine, le bonheur.
Le texte est sombre, puissant.
Fritz Zorn l'a écrit, gravement malade, un cancer. le livre est publié en 1977, peu avant son décès des suites de la maladie. Mal préparé à cette épreuve après une enfance et jeunesse sur la « Rive dorée » de Zurich. Mais sommes-nous vraiment préparés à ce type d'épreuves, quelle que soit notre vie ?
Pris dans les profondeurs de cette expérience redoutable, il exprime, sincère et lucide, ses sentiments, sa colère, ses frustrations et ses déceptions.
Face à la vie. Face à la société.
Il dénonce son éducation, ses faiblesses.« Mes parents névrosés ont produit en ma personne un être qui s'il n'était pas assez faible de corps pour mourir dès sa naissance, a été tellement démoli dans son âme par le milieu névrotique où il a grandi qu'il n'est plus apte à une existence qu'on puisse qualifier d'humaine… Cela a-t-il un sens que je ne sois pas mort dès ma naissance ? »
Un jugement sans concession sur ses propres aptitudes et ses comportements.
Il décrit ses névroses, ses difficultés à communiquer, son impossibilité d'aimer.
Les femmes ?« La femme telle que je l'imaginais n'était qu'un accessoire de plus dans mon univers infantile. » Écrit-il.
Un monologue, long, écrit dans une langue brutale, qui exprime de la colère.
Une colère qui, à ses yeux, lui redonne sa dignité L'évocation des souvenirs s'efface alors pour aborder les grandes questions existentielles: la recherche du sens de la vie, la condition humaine, le bonheur.
Le texte est sombre, puissant.
Ce livre prenait la poussière dans ma bibliothèque. Je l'ai lu dans sa traduction originelle après avoir entendu une interview intéressante de son nouveau traducteur. Cela peut d'ailleurs valoir la peine de lire la nouvelle traduction car le style de celle que j'ai eue entre les mains est parfois un peu lourd et désuet. Mais la force de l'écriture simple, directe, souvent véhémente de Fritz Zorn l'emporte. L'auteur à peine âgé de trente ans se bat contre la maladie et craint (avec raison) qu'elle l'emporte rapidement. le plus urgent pour lui est de faire le récit d'une vie qu'il considère comme totalement gâchée du fait l'éducation bourgeoise qu'il a reçue. Fritz Zorn se livre alors à une critique psychologique et sociale extrêmement virulente de la société dans laquelle il a été élevé. Il analyse les grandes étapes de sa courte vie avec la finesse et la froideur d'un entomologiste ou d'un thérapeute. À un premier texte (Mars en exil) qui aurait pu se suffire à lui-même, l'auteur en ajoute un deuxième (Ultima necat) dont il faut souligner la différence de ton : la distance scientifique laisse alors place à la colère. Une colère d'autant plus poignante que j'ai eu le sentiment que Fritz Zorn nourrissait l'espoir que son premier récit aurait sur lui un effet cathartique, qu'il lui permettrait d'accéder à une vie qui ne serait plus tout à fait gâchée, qu'il aurait enfin l'opportunité de se rattraper, mais cette transformation ne s'est pas produite et cet ultime espoir a été déçu. Enfin, Fritz Zorn ajoute une troisième partie (Le chevalier, la mort et le diable) dans laquelle il continue à ressasser ce qu'il a vécu mais en prenant de la hauteur pour proposer des éléments de philosophie morale assez percutants, notamment sur la nature du Bien et du Mal. J'ai failli arrêter ma lecture à la fin du premier récit. Je suis allé jusqu'au bout et je ne le regrette pas.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1713 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1713 lecteurs ont répondu