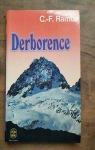Citations de Charles-Ferdinand Ramuz (534)
D'un côté de l'entrée, se trouvait la boulangerie et de l'autre un horloger. Il fallait suivre un long corridor, et monter un petit escalier de pierre. Le bureau était au premier étage ; on lisait en lettres noires sur une plaque de tôle émaillée :
« EMILE MAGNENAT »
« Notaire »
Plus bas :
« Entrez sans heurter. »
C'était donc là.
[C. F. RAMUZ, "Les Circonstances de la vie", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie académique Perrin (Paris), 1907 — Première partie, Chapitre I — page 75 de l'édition "La Pléiade", "C.F. RAMUZ : Romans", Tome I, 2005]
« EMILE MAGNENAT »
« Notaire »
Plus bas :
« Entrez sans heurter. »
C'était donc là.
[C. F. RAMUZ, "Les Circonstances de la vie", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie académique Perrin (Paris), 1907 — Première partie, Chapitre I — page 75 de l'édition "La Pléiade", "C.F. RAMUZ : Romans", Tome I, 2005]
Elle prit dans la direction du village. Elle pensait au soir où elle avait porté la lettre ; c'était autrefois, le temps qui n'est plus. Comme la vie tourne ! La vie a un visage qui rit et un visage qui pleure ; elle tourne, on la voit rire ; elle tourne encore et on la voit pleurer.
Elle s'est assise près de la fenêtre, elle a ouvert son caraco. Et, tout à coup, les cris se taisent. Elle a pris le bout de son sein entre ses doigts, elle se penche en avant ; la petite tête à fin duvet d'oiseau s'est alors tournée de côté. Et il s'est fait un petit bruit, à cause de quelque chose qui va de moi à lui, à cause d'une circulation.
De sorte qu'elle ne bougeait plus ; elle levait seulement les yeux, non pas la tête ; et un sourire était sur sa figure penchée comme une seconde lumière, cependant qu'elle regardait par les petits carreaux la neige qui devenait rose, comme si les œillets de son jardin fleurissaient tous en même temps.
[C.F. RAMUZ, "Si le soleil ne revenait pas", Mermod (Lausanne), 1937 — rééditions : éd. "L'âge d'Homme"(Lausanne) — Intégrale des Romans, coll. "La Pléiade", éd. Gallimard (Paris), 2005, tome 2— chapitre IV]
De sorte qu'elle ne bougeait plus ; elle levait seulement les yeux, non pas la tête ; et un sourire était sur sa figure penchée comme une seconde lumière, cependant qu'elle regardait par les petits carreaux la neige qui devenait rose, comme si les œillets de son jardin fleurissaient tous en même temps.
[C.F. RAMUZ, "Si le soleil ne revenait pas", Mermod (Lausanne), 1937 — rééditions : éd. "L'âge d'Homme"(Lausanne) — Intégrale des Romans, coll. "La Pléiade", éd. Gallimard (Paris), 2005, tome 2— chapitre IV]
Tout près de la maison, il y avait le lac ; pourtant on ne voyait pas le lac de la maison : à peine si on apercevait le ciel, en se penchant par la fenêtre. C'est ces vieilles petites villes du vignoble, qui sont assises entre la pente du mont et l'eau, et la place leur est avarement mesurée, parce que la terre a trop de valeur. Une tête de Vierge sculptée se voyait encore au-dessus de la porte d'entrée.
[C.F. RAMUZ, "La Guérison des maladies, 1917, Chapitre premier, I ( incipit) - page 1117 de la réédition La Pléiade, "C.F. RAMUZ : ROMANS", Tome I, 2005]
[C.F. RAMUZ, "La Guérison des maladies, 1917, Chapitre premier, I ( incipit) - page 1117 de la réédition La Pléiade, "C.F. RAMUZ : ROMANS", Tome I, 2005]
Et il y a bien la tour Eiffel, mais voyez le miracle (car on avait crié au sacrilège et le sacrilège ne s'est pas produit), c'est qu'elle est transparente ; ce n'est pas une construction de pierre opaque, elle est comme airs. C'est la fumée du feu Abel ; on voit au travers le soleil rougir et descendre. C'est un tricotage, c'est un ouvrage de vannerie, c'est fait de mailles lâches, de noeuds qui ne sont reliés entre eux que par des fils presque invisibles ; ce n'est plus un ouvrage terrestre, c'est un ouvrage aérien.
Comme il avait été convenu qu'il irait ,ce dimanche là, voir une chèvre à Sasseneire, Jean-Luc Robille, après avoir mangé prit son chapeau et son bâton. Il alla ensuite embrasser sa femme (car il l'aimait bien et il n'y avait que deux ans qu'ils étaient mariés ).Elle lui demanda:
--Quand seras-tu rentré ?
Il répondit :
--Vers les six heures.
Il reprit:
--Il faut que je me dépêche parce que Simon doit m'attendre,et il n'aime pas qu'on le fasse attendre .
--Quand seras-tu rentré ?
Il répondit :
--Vers les six heures.
Il reprit:
--Il faut que je me dépêche parce que Simon doit m'attendre,et il n'aime pas qu'on le fasse attendre .
" Elle n'a plus de dents, mais moi non plus."
Assis sur sa bille de noyer, il allait compter avec le doigt celles qui lui restaient, deux grandes noires en haut, deux autres grandes noires à la mâchoire inférieure, et elles ne correspondaient même pas, ce qui l'obligeait à mettre tremper son pain dans sa soupe.
" Et elle n'est pas belle non plus, se disait-il, mais moi ? Et d'ailleurs, est-ce que ça compte ? Elle a deux vaches et trois chèvres, une maison bien entretenue ; moi, la mienne va ma tomber dessus un de ces jours, et puis il y a bien mes huit poses, mais pour ce qu'elles me rapportent ! Tandis que si on s'arrangeait ensemble...Comment faire ? Je ne peux pas le lui demander tout crû. Elle doit comprendre. Sûrement même qu'elle comprend. Mais comment savoir avec elle ? Un jour, elle a l'air de dire oui ; le lendemain, c'est non..."
Assis sur sa bille de noyer, il allait compter avec le doigt celles qui lui restaient, deux grandes noires en haut, deux autres grandes noires à la mâchoire inférieure, et elles ne correspondaient même pas, ce qui l'obligeait à mettre tremper son pain dans sa soupe.
" Et elle n'est pas belle non plus, se disait-il, mais moi ? Et d'ailleurs, est-ce que ça compte ? Elle a deux vaches et trois chèvres, une maison bien entretenue ; moi, la mienne va ma tomber dessus un de ces jours, et puis il y a bien mes huit poses, mais pour ce qu'elles me rapportent ! Tandis que si on s'arrangeait ensemble...Comment faire ? Je ne peux pas le lui demander tout crû. Elle doit comprendre. Sûrement même qu'elle comprend. Mais comment savoir avec elle ? Un jour, elle a l'air de dire oui ; le lendemain, c'est non..."
Le taupier
Il va, sa hotte sur le dos,
un bâton d’épine à la main ;
il boite bas sur les chemins
comme quand on sonne une cloche.
Sa blouse bleue à broderies
s’est toute déteinte dans l’air ;
sa barbe est grise dans la peau grise,
il fume une pipe de terre.
Il est pauvre, il dit : « on me donne
deux sous par taupe que je prends ;
en faut-il prendre et tout le temps !
et puis, l’hiver, qu’est-ce qu’on prend ?...
On ne pourrait pas avec ça
s’offrir des habits de fin drap,
ni se payer des redingotes ;
eh bien ! quand même, voyez-vous,
trois décis par jour et vingt sous
de burrus bleu chaque semaine,
je dis quand même que ça mène
un homme content jusqu’au bout. »
Il se met en route quand les oiseaux chantent
il prend en travers des luzernes,
il est salué par le merle
et reconnu par les mésanges.
Il va, sa hotte sur le dos,
un bâton d’épine à la main ;
il boite bas sur les chemins
comme quand on sonne une cloche.
Sa blouse bleue à broderies
s’est toute déteinte dans l’air ;
sa barbe est grise dans la peau grise,
il fume une pipe de terre.
Il est pauvre, il dit : « on me donne
deux sous par taupe que je prends ;
en faut-il prendre et tout le temps !
et puis, l’hiver, qu’est-ce qu’on prend ?...
On ne pourrait pas avec ça
s’offrir des habits de fin drap,
ni se payer des redingotes ;
eh bien ! quand même, voyez-vous,
trois décis par jour et vingt sous
de burrus bleu chaque semaine,
je dis quand même que ça mène
un homme content jusqu’au bout. »
Il se met en route quand les oiseaux chantent
il prend en travers des luzernes,
il est salué par le merle
et reconnu par les mésanges.
" Je ne durerai pas plus que le soleil. Quand ce sera sa fin, ce sera la mienne... Vous me trouverez mort en bas et, lui, vous le chercherez dans le ciel , mais il ne bougera pas davantage que moi. "
(C. F. RAMUZ, "Si le soleil ne revenait pas", 1937, chapitre V)
(C. F. RAMUZ, "Si le soleil ne revenait pas", 1937, chapitre V)
Derborence, le mot chante doux ; il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur et marqué, puis hésite et retombe, pendant qu'on se le chante encore, Derborence, et finit à vide, comme s'il voulait signifier par là la ruine, l'isolement, l'oubli.
10 décembre 1896 - Lire beaucoup vous donne peut-être des idées, - des idées personnelles, non pas. Je cherche... je cherche. Réfléchir longuement sur ce qu'on lit, discuter ses lectures, à l'occasion les réfuter, rechercher le paradoxe au risque de s'attirer un mauvais parti. Car, comme on dit, les extrêmes se touchent. Le paradoxe est souvent très près de la vérité sous son apparente exagération.
1689 - [Œuvres complètes, t. 20, Journal, p. 16]
1689 - [Œuvres complètes, t. 20, Journal, p. 16]
La rancune qui est dite n'est déjà plus rancune. Celui qui a pu se dire se quitte ; il se décharge de lui-même ; sa personne part en avant.
Sur la Route
C’est un vieux qui passe, toussant,
crachant, boitant sur son bâton,
tout fatigué d’avoir marché —
la route est longue —
et tout heureux d’être arrivé,
lorsque le village se montre
comme des enfants en tabliers blancs
qui, las de jouer, se seraient assis
au milieu des prés
pour passer le temps.
Ensuite c’est un char,
avec un vieux cheval,
et la blouse de l’homme,
bossu par derrière à cause du vent,
a l’air d’une cloche.
Le cheval trotte d’un petit trot las
et ses grelots font une chanson triste.
Les peupliers défilent un à un,
la route se déroule ;
et l’homme s’en va
avec un plumet de fumée bleue,
fumant sa pipe.
C’est un vieux qui passe, toussant,
crachant, boitant sur son bâton,
tout fatigué d’avoir marché —
la route est longue —
et tout heureux d’être arrivé,
lorsque le village se montre
comme des enfants en tabliers blancs
qui, las de jouer, se seraient assis
au milieu des prés
pour passer le temps.
Ensuite c’est un char,
avec un vieux cheval,
et la blouse de l’homme,
bossu par derrière à cause du vent,
a l’air d’une cloche.
Le cheval trotte d’un petit trot las
et ses grelots font une chanson triste.
Les peupliers défilent un à un,
la route se déroule ;
et l’homme s’en va
avec un plumet de fumée bleue,
fumant sa pipe.
« Nous n’avons pas eu de 17ème siècle ; car alors nous étions Bernois, c’est-à-dire complètement muets, inexistants. Et c’est précisément pendant ce temps, que la langue « française » prenait sa forme définitive. J’aime votre 17ème siècle, j’aime le français, un certain « français » dont il a définitivement sanctionné l’usage, mais n’y puis voir pourtant (parce que je viens du dehors) qu’un phénomène tout occasionnel, tout contingent (qui aurait pu ne pas se produire), et qui précisément, pour ce qui est de nous et de moi, ne s’est pas produit. Précisément pour ces mêmes raisons, je me refuse de voir dans cette langue « classique » la langue unique, ayant servi, devant servir encore, en tant que langue codifiée une fois pour toutes, à tous ceux qui s’expriment en français.
Car il y a eu, il y a encore des centaines de français ; qui, bien mieux, sont sans cesse en train de se défaire et de se refaire, c’est-à-dire vivent, c’est-à-dire deviennent tandis qu’elle (cette langue « littéraire ») tend de plus en plus à s’immobiliser et à mourir, imposant arbitrairement à ceux qui s’en servent, tout un ensemble de règles.
J’aurais voulu montrer qu’elles étaient l’émanation d’une société qui n’était plus la nôtre, qu’elle a exprimé vraiment une hiérarchie humaine, une hiérarchie naturellement acceptée dans les idées et dans les mœurs. Et admettons encore que ce français dit « classique » soit valable même aujourd’hui pour un certain nombre de Français, il n’en reste pas moins que je ne vois pas très bien comment il serait valable pour moi : il nous faut l’apprendre.
Le pays qui est le mien parle « son » français de plein droit parce que c’est sa langue maternelle, qu’il n’a pas besoin de l’apprendre, qu’il le tire d’une chair vivante. Et mon pays a eu deux langues : une qu’il lui fallait apprendre, l’autre dont il se servait par droit de naissance. Il a longtemps parlé son patois (son patois franco-provençal) ; puis, sous l’influence de l’école, comme beaucoup d’autres provinces, il l’a peu à peu abandonné, mais sans perdre son accent, de sorte qu’il parle avec l’accent vaudois un certain français redevenu très authentiquement vaudois quand même ; plein de tournures, plein de mots à lui, et bien entendu par rapport au français de l’école « plein de fautes ».
Je me rappelle l’inquiétude qui s’était emparée de moi en voyant combien ce fameux « bon français » était incapable de nous exprimer et de m’exprimer, parce qu’il y avait traduction et traduction mal réussie. Je me suis mis à essayer d’écrire comme ils (les paysans, les gens du peuple) parlaient, parce qu’ils parlaient bien, parlant eux-mêmes sans modèles ; à tâcher de les exprimer comme eux-mêmes s’étaient exprimés, de les exprimer par des mots comme ils s’étaient exprimés par des gestes, par des mots qui fussent encore des gestes, leurs gestes.
Cette langue-suite-de-gestes, où la logique cède le pas au rythme même des images, n’est pas très loin de ce que cherche à réaliser avec ses moyens à lui le cinéma. Ces critiques qu’on me fait sont peut-être bien, tout au fond, plus sociales que littéraires ou esthétiques : on fait valoir en somme que j’appartiens à une « classe », que je suis devenu un bourgeois, que je suis devenu un « lettré », que je n’ai pas le droit de me déclasser volontairement. Ce qui suppose qu’un intellectuel est nécessairement supérieur à un non-intellectuel en ce qu’il a appris plus de choses. »
[C.F. RAMUZ, "Lettre à Bernard Grasset", 1941 - publié par la Librairie numérique romande (e-books)]
Car il y a eu, il y a encore des centaines de français ; qui, bien mieux, sont sans cesse en train de se défaire et de se refaire, c’est-à-dire vivent, c’est-à-dire deviennent tandis qu’elle (cette langue « littéraire ») tend de plus en plus à s’immobiliser et à mourir, imposant arbitrairement à ceux qui s’en servent, tout un ensemble de règles.
J’aurais voulu montrer qu’elles étaient l’émanation d’une société qui n’était plus la nôtre, qu’elle a exprimé vraiment une hiérarchie humaine, une hiérarchie naturellement acceptée dans les idées et dans les mœurs. Et admettons encore que ce français dit « classique » soit valable même aujourd’hui pour un certain nombre de Français, il n’en reste pas moins que je ne vois pas très bien comment il serait valable pour moi : il nous faut l’apprendre.
Le pays qui est le mien parle « son » français de plein droit parce que c’est sa langue maternelle, qu’il n’a pas besoin de l’apprendre, qu’il le tire d’une chair vivante. Et mon pays a eu deux langues : une qu’il lui fallait apprendre, l’autre dont il se servait par droit de naissance. Il a longtemps parlé son patois (son patois franco-provençal) ; puis, sous l’influence de l’école, comme beaucoup d’autres provinces, il l’a peu à peu abandonné, mais sans perdre son accent, de sorte qu’il parle avec l’accent vaudois un certain français redevenu très authentiquement vaudois quand même ; plein de tournures, plein de mots à lui, et bien entendu par rapport au français de l’école « plein de fautes ».
Je me rappelle l’inquiétude qui s’était emparée de moi en voyant combien ce fameux « bon français » était incapable de nous exprimer et de m’exprimer, parce qu’il y avait traduction et traduction mal réussie. Je me suis mis à essayer d’écrire comme ils (les paysans, les gens du peuple) parlaient, parce qu’ils parlaient bien, parlant eux-mêmes sans modèles ; à tâcher de les exprimer comme eux-mêmes s’étaient exprimés, de les exprimer par des mots comme ils s’étaient exprimés par des gestes, par des mots qui fussent encore des gestes, leurs gestes.
Cette langue-suite-de-gestes, où la logique cède le pas au rythme même des images, n’est pas très loin de ce que cherche à réaliser avec ses moyens à lui le cinéma. Ces critiques qu’on me fait sont peut-être bien, tout au fond, plus sociales que littéraires ou esthétiques : on fait valoir en somme que j’appartiens à une « classe », que je suis devenu un bourgeois, que je suis devenu un « lettré », que je n’ai pas le droit de me déclasser volontairement. Ce qui suppose qu’un intellectuel est nécessairement supérieur à un non-intellectuel en ce qu’il a appris plus de choses. »
[C.F. RAMUZ, "Lettre à Bernard Grasset", 1941 - publié par la Librairie numérique romande (e-books)]
Et cette vie enfin, on la voit toute entière, voilà pourquoi on l'aime. Elle n'est pas éparpillée, mais resserrée en un seul point. Car tout ce qu'il leur faut, ils le tirent d'ici, ils se suffisent à eux-mêmes. On peut voir où leur blé mûrit, comment ils le coupent, et le lient en gerbes, et où ils vont le moudre, et le four où cuira le pain. Et le lait des vaches qu'on voit paître, qu'on voit traire, c'est dans cette chaudière qu'il deviendra fromage. Pour la viande, ils ont leur bétail, leurs cochons, leurs chèvres ou bien leurs mulets. Pour boire, le vin de leurs vignes. Pour leur habits, la laine des moutons ; pour leur toile encore, des carrés de chanvre. Et leur bon Dieu aussi est un peu à eux, car c'est Celui de la montagne, qui voit de plus près, de son ciel, ces hommes au-dessous de lui [...]
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre IX — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001, page 41]
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre IX — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001, page 41]
Ils sont ce que la montagne les a faits, parce qu'il est difficile d'y vivre, avec ces pentes où l'on s'accroche, avec un tout petit été au milieu de la longue année et comme un désert autour du village. On va sur les chemins longtemps sans rencontrer personne.
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre IX — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001, page 39]
[C.F. RAMUZ, "Le Village dans la montagne", éditions Payot & Cie (Lausanne) / Librairie Académique Perrin (Paris), 1908, chapitre IX — réédition "Bibliothèque des Amis de Ramuz" (Loches), 2001, page 39]
Elle avait une jolie robe de foulard blanc avec des bouquets de fleurs bleues, un col de lingerie. Elle tenait son livre de cantiques dans la main gauche, elle avait des gants de coton blanc. Elle s’était faite belle pour lui. Elle n’avait pas plus de dix-sept ans, lui dix-huit. On lave ses cheveux blonds avec un shampooing à la camomille dans sa cuvette, avant de se coucher ; on en roule les mèches avec soin dans des papillotes de cuir ; et au matin, le soleil revenu, on voit la belle couleur de miel qu’ils ont, – et tout ça inutilement, et toutes ces choses pour rien.
Ils étaient obligés de se donner rendez-vous loin du village, parce qu'il y a toujours des curieux. Il y a toujours des curieux, il y a toujours du monde qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Elle avait un râteau sur l'épaule ; il voyait comment, avec les dents de son râteau, elle accrochait les nuages en passant. Les nuages lui tombaient sur la tête.
Les routes étaient encore blanches en ce temps-là, blanches et sensibles au moindre souffle. Dès qu'un peu de vent se levait, on les voyait de loin se mettre debout et courir le long d'elles-mêmes. (p. 11 / La Guilde du Livre, 1967)
Un soldat en temps de paix est comme une cheminée en été.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Charles-Ferdinand Ramuz
Lecteurs de Charles-Ferdinand Ramuz (1140)Voir plus
Quiz
Voir plus
Aimé Pache, peintre vaudois de Charles-Ferdinand Ramuz
Ce roman, paru en 1911 à Paris chez Fayard et à Lausanne chez Payot, est dédié à un peintre : ...
Alexandre Cingria
René Auberjonois
Cuno Amiet
Ferdinand Hodler
15 questions
3 lecteurs ont répondu
Thème : Aimé Pache, peintre Vaudois de
Charles Ferdinand RamuzCréer un quiz sur cet auteur3 lecteurs ont répondu