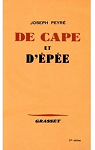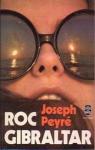Critiques de Joseph Peyré (53)
Le lieutenant Marçay à la tête d'un bataillon de légionnaires s'engage à la poursuite d'un rezzou, en plein cœur du Sahara. Avant de cerner les pillards, les glorieux légionnaires subiront l'épuisement, les fièvres, le martyre de la soif, les tempêtes de sable...jusqu'au baroud. Héroïsme, exotisme et pittoresque dans le Sahara des méharistes et des goumiers.
« La trilogie andalouse » de Joseph Peyré (à ne pas confondre avec « la très jolie andalouse », quoique Cayetana…) regroupe trois beaux romans : « Les lanciers de Jerez » (1961), « Les Remparts de Cadix » (1962) et « L’Alcalde de San Juan » (1963), où l’on suit les aventures de Joseph-Marie de Saint-Armou, officier dans l’armée de Napoléon, au cours des guerres d’Espagne, entre 1808 et 1812.
« Les lanciers de Jerez » se terminaient sur la bataille de Baïlen, où les Espagnols infligèrent aux Français une sérieuse défaite. Notre héros, le jeune lieutenant de Saint-Armou, blessé, ne doit sa vie et son salut qu’à ses amis espagnols, Jaime et Cayetana, qui l’aident même à revenir en France.
Au moment où commence « Les Remparts de Cadix », Saint-Armou brûle de revenir se battre en Espagne, pays pour lequel il a une grande attirance. Mais, mal vu de sa hiérarchie, il se voit refuser cette faveur, et au contraire est muté sur le front de l’Est, il s’illustre particulièrement à la bataille de Wagram. Comme en plus de sa bravoure sur les champs de bataille, il montre aussi de belles dispositions dans le combat rapproché en salons mondains, voire en alcôves, il finit par arriver à ses fins et retrouve l’Espagne. Farouchement attaché à l’Andalousie où il sait retrouver Jaime et Cayetana, il devient espion pour le compte du roi Joseph, qui l’a remarqué. Avec son bataillon béarnais (prêt à le suivre au bout du monde), il se retrouve devant Cadix où le siège durera deux ans. Il répugne à se battre contre les Espagnols et limite ses attaques contre les Anglais. De plus en plus hostile à la politique espagnole de Napoléon, qu’il commence à voir d’un œil plus critique, il va devoir prendre une décision lourde de sens pour son avenir.
Qu’il est regrettable que cette trilogie n’ait pas été rééditée ! Quand Peyré raconte l’épopée de Saint-Armou, il y a du Dumas dans son style, dans son approche du récit, dans la façon dont il nous fait vivre avec les personnages (c’est très différent de faire vivre les personnages devant nous). On le sait, Joseph Peyré est un indéfectible amoureux de l’Espagne, et s’il y a du D’Artagnan dans Saint-Armou, peut-être même parfois du Julien Sorel, il y a beaucoup de Joseph Peyré : il se fait son porte-parole pour une communauté d’idée pacifique entre les deux pays, il partage l’amour de l’Espagne dans toutes ses particularités, historiques et culturelles en particulier.
« La trilogie andalouse » constitue un roman historique de très bonne cuvée, injustement méconnu. La documentation historiques est remarquable, et permet d’avoir un œil neuf sur l’épopée napoléonienne (il est vrai que l’aventure espagnole n’en est pas le fait d’armes le plus reluisant). Napoléon n’est pas le héros de légende qui a nourri tous les ressentiments contre la Restauration, puis la Monarchie de Juillet, avant de « légitimer » l’arrivée au pouvoir de Napoléon III. C’est seulement (aux yeux des Espagnols, et peu à peu de Saint-Armou) l’image d’un conquérant qui, après Alexandre et César, veut assouvir un intense et orgueilleux désir de pouvoir et de domination sur le monde.
Ecrit dans un style très pur, très fluide et très vivant, ce roman constitue un très beau moment d’évasion, à la fois ludique et instructif, peuplé de personnages attachants. On a hâte de connaître la suite.
« Les lanciers de Jerez » se terminaient sur la bataille de Baïlen, où les Espagnols infligèrent aux Français une sérieuse défaite. Notre héros, le jeune lieutenant de Saint-Armou, blessé, ne doit sa vie et son salut qu’à ses amis espagnols, Jaime et Cayetana, qui l’aident même à revenir en France.
Au moment où commence « Les Remparts de Cadix », Saint-Armou brûle de revenir se battre en Espagne, pays pour lequel il a une grande attirance. Mais, mal vu de sa hiérarchie, il se voit refuser cette faveur, et au contraire est muté sur le front de l’Est, il s’illustre particulièrement à la bataille de Wagram. Comme en plus de sa bravoure sur les champs de bataille, il montre aussi de belles dispositions dans le combat rapproché en salons mondains, voire en alcôves, il finit par arriver à ses fins et retrouve l’Espagne. Farouchement attaché à l’Andalousie où il sait retrouver Jaime et Cayetana, il devient espion pour le compte du roi Joseph, qui l’a remarqué. Avec son bataillon béarnais (prêt à le suivre au bout du monde), il se retrouve devant Cadix où le siège durera deux ans. Il répugne à se battre contre les Espagnols et limite ses attaques contre les Anglais. De plus en plus hostile à la politique espagnole de Napoléon, qu’il commence à voir d’un œil plus critique, il va devoir prendre une décision lourde de sens pour son avenir.
Qu’il est regrettable que cette trilogie n’ait pas été rééditée ! Quand Peyré raconte l’épopée de Saint-Armou, il y a du Dumas dans son style, dans son approche du récit, dans la façon dont il nous fait vivre avec les personnages (c’est très différent de faire vivre les personnages devant nous). On le sait, Joseph Peyré est un indéfectible amoureux de l’Espagne, et s’il y a du D’Artagnan dans Saint-Armou, peut-être même parfois du Julien Sorel, il y a beaucoup de Joseph Peyré : il se fait son porte-parole pour une communauté d’idée pacifique entre les deux pays, il partage l’amour de l’Espagne dans toutes ses particularités, historiques et culturelles en particulier.
« La trilogie andalouse » constitue un roman historique de très bonne cuvée, injustement méconnu. La documentation historiques est remarquable, et permet d’avoir un œil neuf sur l’épopée napoléonienne (il est vrai que l’aventure espagnole n’en est pas le fait d’armes le plus reluisant). Napoléon n’est pas le héros de légende qui a nourri tous les ressentiments contre la Restauration, puis la Monarchie de Juillet, avant de « légitimer » l’arrivée au pouvoir de Napoléon III. C’est seulement (aux yeux des Espagnols, et peu à peu de Saint-Armou) l’image d’un conquérant qui, après Alexandre et César, veut assouvir un intense et orgueilleux désir de pouvoir et de domination sur le monde.
Ecrit dans un style très pur, très fluide et très vivant, ce roman constitue un très beau moment d’évasion, à la fois ludique et instructif, peuplé de personnages attachants. On a hâte de connaître la suite.
Joseph Peyré est bien sûr le grand romancier que l’on connaît. Il était également journaliste, écrivant des articles dans les publications de son ami Joseph Kessel et dans d’autres journaux importants comme Gringoire ou Excelsior. Pour ce dernier quotidien, il écrit plusieurs articles qui décrivent les évènements d’Espagne dans les années 30, prélude tragique à la Guerre Civile. Dans Gringoire, il fait paraître les 10, 24 et 36 janvier 1936, une longue nouvelle (ou un court roman) relatant l’insurrection du 6 octobre 1934 : les mineurs de la Cuenca, bientôt rejoints par des rebelles de tous horizons (de gauche essentiellement : anarchistes, socialistes et communistes) créent le mouvement UHP (Union de los Hermanos Proletarios – Union des Frères prolétaires). A Oviedo (capitale des Asturies), de violents combats les opposent aux forces gouvernementales, et 6 jours plus tard la ville capitule. La répression, organisée par un certain général Francisco Franco, est particulièrement brutale et sanglante, malgré les promesses de vie sauve faites aux insurgés.
Le roman raconte l’histoire du Morenu, un des chefs de la rebellion. C’est un mineur porté à la tête de ses camarades, c’est lui « l’homme de choc » (le mot « choc » étant à prendre comme dans « commando de choc » dans le sens d’une action immédiate et violente).
« Le Morenù, piqueur au puits des Arenales, et chef de l’escouade de choc, repoussa la porte, qui avait embarqué un paquet d’air nocturne, chargé de l’odeur suffocante des pommes à cidre ».
Nous assistons avec lui à toutes les péripéties de la bataille urbaine, partageant les heures de répit, les deuils, une brève idylle sans lendemain. L’auteur avec réalisme et émotion montre le combat désespéré de ces hommes et de ces femmes qui luttent pour avoir une meilleure vie, mais surtout qui espèrent que leur mouvement fera tache d’huile et amènera la chute de cette République en pleine décadence, laquelle, on le voit bien prépare la venue au pouvoir des fascistes. Joseph Peyré, en effet, voit se mettre en place les rouages de la machine infernale qui déchirera l’Espagne de 1936 à 1939, puis le monde de 1939 à 1945.
Le style est celui d’un journaliste : comme Kessel, comme Saint-Exupéry, ou comme Hemingway qui seront reporters de guerre, Joseph Peyré garde une langue pure pour raconter avec sobriété, mais émotion, les évènements publics et privés qui rythment le récit.
« La masse silencieuse de la cathédrale et des toitures qui soutiennent son vaisseau de pierre noirci par des siècles de pluie, l’éternelle pluie asturienne, avait été dès la première nuit de la révolution, condamnée et abandonnée comme une épave… »
Joseph Peyré ne sort pas du compte rendu journalistique, même romancé. Les considérations politiques sont énoncées avec objectivité, même si l’auteur montre son inquiétude sur la tournure que prennent les évènements. Mais il y a cependant suffisamment d’émotion pour que le lecteur s’attache à ces personnages : le Morenù, révolutionnaire exalté et de plus en plus déçu ; Marife, la jeune et jolie infirmière qui touchera son cœur l’espace d’une insurrection, Porrita le compagnon si jovial…
Un roman différent de l’œuvre générale de Peyré : ici, pas de désert, ni de montagne. Mais l’Espagne. L’Espagne éternelle, celle que Joseph Peyré porte au cœur depuis toujours
Le roman raconte l’histoire du Morenu, un des chefs de la rebellion. C’est un mineur porté à la tête de ses camarades, c’est lui « l’homme de choc » (le mot « choc » étant à prendre comme dans « commando de choc » dans le sens d’une action immédiate et violente).
« Le Morenù, piqueur au puits des Arenales, et chef de l’escouade de choc, repoussa la porte, qui avait embarqué un paquet d’air nocturne, chargé de l’odeur suffocante des pommes à cidre ».
Nous assistons avec lui à toutes les péripéties de la bataille urbaine, partageant les heures de répit, les deuils, une brève idylle sans lendemain. L’auteur avec réalisme et émotion montre le combat désespéré de ces hommes et de ces femmes qui luttent pour avoir une meilleure vie, mais surtout qui espèrent que leur mouvement fera tache d’huile et amènera la chute de cette République en pleine décadence, laquelle, on le voit bien prépare la venue au pouvoir des fascistes. Joseph Peyré, en effet, voit se mettre en place les rouages de la machine infernale qui déchirera l’Espagne de 1936 à 1939, puis le monde de 1939 à 1945.
Le style est celui d’un journaliste : comme Kessel, comme Saint-Exupéry, ou comme Hemingway qui seront reporters de guerre, Joseph Peyré garde une langue pure pour raconter avec sobriété, mais émotion, les évènements publics et privés qui rythment le récit.
« La masse silencieuse de la cathédrale et des toitures qui soutiennent son vaisseau de pierre noirci par des siècles de pluie, l’éternelle pluie asturienne, avait été dès la première nuit de la révolution, condamnée et abandonnée comme une épave… »
Joseph Peyré ne sort pas du compte rendu journalistique, même romancé. Les considérations politiques sont énoncées avec objectivité, même si l’auteur montre son inquiétude sur la tournure que prennent les évènements. Mais il y a cependant suffisamment d’émotion pour que le lecteur s’attache à ces personnages : le Morenù, révolutionnaire exalté et de plus en plus déçu ; Marife, la jeune et jolie infirmière qui touchera son cœur l’espace d’une insurrection, Porrita le compagnon si jovial…
Un roman différent de l’œuvre générale de Peyré : ici, pas de désert, ni de montagne. Mais l’Espagne. L’Espagne éternelle, celle que Joseph Peyré porte au cœur depuis toujours
Dédicace :
Ce livre est le roman d’un chef et de deux hommes dans la guerre saharienne qui, l’année de Verdun, souleva le désert. Je le dédie aux combattants du Djanet et de Fort Polignac. Puisse-t-il, en attendant l’histoire de cette guerre ignorée, rappeler leur sacrifice, et donner la mesure de leur force.
Joseph Peyré
Tout est dit dans cette dédicace : le sujet : une expédition au cours d’une guerre saharienne ignorée, menée par trois hommes dont un chef. La date : l’année de Verdun, 1916, donc (même si le roman commence en avril 1915). Enfin le propos : montrer l’héroïsme de ces hommes, et en déduire leur grandeur.
L’histoire se passe dans le sud tunisien. La guerre en Europe fait rage. Les tribus arabes en profitent pour entrer en dissidence, et fomentent la révolte semoussiste. Une nouvelle guerre est déclarée, celle du désert.
« Les trois méharistes qui faisaient route vers Rhadamès, aux confins de la Tripolitaine, étaient le Chef à l’Etoile d’argent, de la Compagnie saharienne du Tidikelt, et ses deux compagnons de chasse, Salem, le Chaambi, et Driss, l’Ifora ».
Le Chef à l’Etoile d’argent, c’est le maréchal-des-logis Le Brazidec. L’étoile d’argent, c’est celle qui demeure attachée à la bride de Gazelle, sa chamelle de race. Pour les indigènes, cette étoile est le symbole de son courage invincible et de son invincibilité. Il est vrai qu’il est ce qu’on appelle un baroudeur. La vie de caserne, très peu pour lui. Il ne s’épanouit que dans le désert, lorsqu’il affronte des trafiquants d’armes, des rebelles, ou tout simplement les conditions terribles de la vie entre sable et rochers, avec la chaleur, la soif, le vent, le danger… Pourtant à Fort-Platters, il y a Fatoum, une indigène Ifora qui a accepté de l’épouser alors qu’elle était promise à Kei Harir, le chef des rebelles. Mais l’appel de l’océan des sables est le plus grand. Et puis c’est la guerre. Si à des milliers de kilomètres de là, des hommes meurent dans les tranchées, ici on se bat contre un ennemi invisible, par escarmouches, le danger y est aussi permanent. De bataille en bataille, la poursuite des rebelles s’arrêtera au siège de Fort Polignac. Là, à tous les dangers déjà énumérés, viennent s’ajouter le manque de vivres et pire que tout le scorbut. Pourtant ce n'est pas encore ici que le Chef à l’Etoile d’argent rencontrera son destin…
Encore un grand roman « saharien » de Joseph Peyré, à qui nous devons déjà « L’Escadron blanc ». Cet auteur a un talent certain pour nous plonger dans l’immensité du désert, nous faire ressentir les effets du vent et du sable, nous noyer les yeux dans l’océan des dunes, les contrastes de couleurs entre le sable, le ciel et les silhouettes de la caravane, les bruits étranges de la nuit saharienne, les blatèrements des dromadaires, les ciels étoilés à chavirer…
Bien sûr, le roman a été écrit en 1933. La Tunisie et l’Algérie (là où se situe l’action) faisaient encore partie de l’Empire colonial français. Et les accents patriotiques avaient en ce temps-là une autre signification qu’aujourd’hui. Ce point acquis, reste une magnifique épopée dont l’auteur, avec émotion et reconnaissance, nous retrace les périls encourus, les difficultés sans nombre, et le courage inébranlable de ces méharistes, et par là-même la grandeur de leur sacrifice.
Et, on ne se lasse pas de le rappeler, cette magnifique description de ce monde à lui tout seul, le désert.
Ce livre est le roman d’un chef et de deux hommes dans la guerre saharienne qui, l’année de Verdun, souleva le désert. Je le dédie aux combattants du Djanet et de Fort Polignac. Puisse-t-il, en attendant l’histoire de cette guerre ignorée, rappeler leur sacrifice, et donner la mesure de leur force.
Joseph Peyré
Tout est dit dans cette dédicace : le sujet : une expédition au cours d’une guerre saharienne ignorée, menée par trois hommes dont un chef. La date : l’année de Verdun, 1916, donc (même si le roman commence en avril 1915). Enfin le propos : montrer l’héroïsme de ces hommes, et en déduire leur grandeur.
L’histoire se passe dans le sud tunisien. La guerre en Europe fait rage. Les tribus arabes en profitent pour entrer en dissidence, et fomentent la révolte semoussiste. Une nouvelle guerre est déclarée, celle du désert.
« Les trois méharistes qui faisaient route vers Rhadamès, aux confins de la Tripolitaine, étaient le Chef à l’Etoile d’argent, de la Compagnie saharienne du Tidikelt, et ses deux compagnons de chasse, Salem, le Chaambi, et Driss, l’Ifora ».
Le Chef à l’Etoile d’argent, c’est le maréchal-des-logis Le Brazidec. L’étoile d’argent, c’est celle qui demeure attachée à la bride de Gazelle, sa chamelle de race. Pour les indigènes, cette étoile est le symbole de son courage invincible et de son invincibilité. Il est vrai qu’il est ce qu’on appelle un baroudeur. La vie de caserne, très peu pour lui. Il ne s’épanouit que dans le désert, lorsqu’il affronte des trafiquants d’armes, des rebelles, ou tout simplement les conditions terribles de la vie entre sable et rochers, avec la chaleur, la soif, le vent, le danger… Pourtant à Fort-Platters, il y a Fatoum, une indigène Ifora qui a accepté de l’épouser alors qu’elle était promise à Kei Harir, le chef des rebelles. Mais l’appel de l’océan des sables est le plus grand. Et puis c’est la guerre. Si à des milliers de kilomètres de là, des hommes meurent dans les tranchées, ici on se bat contre un ennemi invisible, par escarmouches, le danger y est aussi permanent. De bataille en bataille, la poursuite des rebelles s’arrêtera au siège de Fort Polignac. Là, à tous les dangers déjà énumérés, viennent s’ajouter le manque de vivres et pire que tout le scorbut. Pourtant ce n'est pas encore ici que le Chef à l’Etoile d’argent rencontrera son destin…
Encore un grand roman « saharien » de Joseph Peyré, à qui nous devons déjà « L’Escadron blanc ». Cet auteur a un talent certain pour nous plonger dans l’immensité du désert, nous faire ressentir les effets du vent et du sable, nous noyer les yeux dans l’océan des dunes, les contrastes de couleurs entre le sable, le ciel et les silhouettes de la caravane, les bruits étranges de la nuit saharienne, les blatèrements des dromadaires, les ciels étoilés à chavirer…
Bien sûr, le roman a été écrit en 1933. La Tunisie et l’Algérie (là où se situe l’action) faisaient encore partie de l’Empire colonial français. Et les accents patriotiques avaient en ce temps-là une autre signification qu’aujourd’hui. Ce point acquis, reste une magnifique épopée dont l’auteur, avec émotion et reconnaissance, nous retrace les périls encourus, les difficultés sans nombre, et le courage inébranlable de ces méharistes, et par là-même la grandeur de leur sacrifice.
Et, on ne se lasse pas de le rappeler, cette magnifique description de ce monde à lui tout seul, le désert.
L’Espagne on le sait est un des thèmes de prédilection de Joseph Peyré, avec le désert et la montagne. Mais même s’il les a très bien décrits dans ses romans, il n’a pas avec ces thèmes la même proximité qu’il a avec l’Espagne. Pour Joseph Peyré, l’Espagne est une deuxième patrie. Il la connaît en voisin (il est né à Aydie, une cinquantaine de kilomètres au nord de Pau) et la connaît comme sa poche. Ses romans « espagnols » montrent une réelle connaissance du pays, son histoire, sa géographie et ses coutumes, mais aussi une belle osmose avec l’âme espagnole, faite de fierté et de grandeur.
Plusieurs romans sont consacrés à la tauromachie, dont deux majeurs « Sang et lumières » (1935) et « Guadalquivir » (1952). Aujourd’hui le débat est enflammé entre les pro-corrida et les anti-corrida. Les uns invoquant la tradition, les autres le bien-être animal. Joseph Peyré, vu son penchant très appuyé pour la civilisation ibérique, est, ne nous le cachons pas plutôt favorable à la « faena », mais reconnaissons-le, il n’appuie pas sur le côté « jeux de l’arène » de cette tradition sanglante, ou de cette boucherie traditionnelle, comme on voudra ; les romans auxquels ce spectacle sert de toile de fond sont avant tout des histoires d’hommes et de femmes, d’amour et de mort.
« Guadalquivir » ne manque pas à la règle. C’est l’histoire d’une jeune femme Alegria, duchesse d’Ayamonte, qui est amoureuse d’un torero (en Espagne il n’y a que des toreros, les toréadors n’existent qu’à l’Opera) Juan-Fernando. Celui-ci n’a pas la réputation d’être un bon matador (littéralement tueur, je n’invente rien), il ne s’attaque qu’à des bêtes de moindre résistance. C’est du moins ce que disent les connaisseurs. Qu’à cela ne tienne ! Alegria, entichée de son torero le suit partout et devient sa maîtresse. Celui-ci, flatté d’avoir une duchesse pour maîtresse, ne la trompe pas moins à qui mieux-mieux, pour ne pas dire à tout venant. Mais comme on dit tras-os-montes « amor es ciego ». Pourtant tout se paye. Les autorités imposent à Juan Fernando de toréer face à un taureau exceptionnel nommé Marismeño. Et là ce n’est plus la même cancion…
Comme dans « Sang et lumières », Joseph Peyré nous donne un aperçu quasi ethnologique de cette société espagnole, liée à ses traditions : c’est ce qui en fait son charme, et c’est aussi ce qui peut la desservir, parce que le monde change, et fait changer les humains. Sur le seul thème de la corrida, Joseph Peyré répond à ses détracteurs : le torero n’est pas tout puissant, il peut même être ridicule, et Marismeño, par sa seule présence, venge tous ses congénères qui entre sol y sombra ont laissé les deux oreilles et la queue…
Ajoutons pour finir ce que nous savons déjà : Joseph Peyré sait à merveille raconter les moments d’intense confrontation : avec le désert, avec la paroi montagneuse, avec la bête dans l’arène, c’est-à-dire avec la mort. Question de courage si l’on veut, de force d’âme, ou peut-être de prise sur soi, avec derrière en filigrane, l’amour.
Ce livre sur la tauromachie ne convaincra personne. Mais si on le lit sans a priori, en goûtant la prose colorée et délicate de l’auteur, on apprend beaucoup de choses sur la mentalité espagnole (mais pas seulement), et on passe somme toute un bon moment de lecture.
Plusieurs romans sont consacrés à la tauromachie, dont deux majeurs « Sang et lumières » (1935) et « Guadalquivir » (1952). Aujourd’hui le débat est enflammé entre les pro-corrida et les anti-corrida. Les uns invoquant la tradition, les autres le bien-être animal. Joseph Peyré, vu son penchant très appuyé pour la civilisation ibérique, est, ne nous le cachons pas plutôt favorable à la « faena », mais reconnaissons-le, il n’appuie pas sur le côté « jeux de l’arène » de cette tradition sanglante, ou de cette boucherie traditionnelle, comme on voudra ; les romans auxquels ce spectacle sert de toile de fond sont avant tout des histoires d’hommes et de femmes, d’amour et de mort.
« Guadalquivir » ne manque pas à la règle. C’est l’histoire d’une jeune femme Alegria, duchesse d’Ayamonte, qui est amoureuse d’un torero (en Espagne il n’y a que des toreros, les toréadors n’existent qu’à l’Opera) Juan-Fernando. Celui-ci n’a pas la réputation d’être un bon matador (littéralement tueur, je n’invente rien), il ne s’attaque qu’à des bêtes de moindre résistance. C’est du moins ce que disent les connaisseurs. Qu’à cela ne tienne ! Alegria, entichée de son torero le suit partout et devient sa maîtresse. Celui-ci, flatté d’avoir une duchesse pour maîtresse, ne la trompe pas moins à qui mieux-mieux, pour ne pas dire à tout venant. Mais comme on dit tras-os-montes « amor es ciego ». Pourtant tout se paye. Les autorités imposent à Juan Fernando de toréer face à un taureau exceptionnel nommé Marismeño. Et là ce n’est plus la même cancion…
Comme dans « Sang et lumières », Joseph Peyré nous donne un aperçu quasi ethnologique de cette société espagnole, liée à ses traditions : c’est ce qui en fait son charme, et c’est aussi ce qui peut la desservir, parce que le monde change, et fait changer les humains. Sur le seul thème de la corrida, Joseph Peyré répond à ses détracteurs : le torero n’est pas tout puissant, il peut même être ridicule, et Marismeño, par sa seule présence, venge tous ses congénères qui entre sol y sombra ont laissé les deux oreilles et la queue…
Ajoutons pour finir ce que nous savons déjà : Joseph Peyré sait à merveille raconter les moments d’intense confrontation : avec le désert, avec la paroi montagneuse, avec la bête dans l’arène, c’est-à-dire avec la mort. Question de courage si l’on veut, de force d’âme, ou peut-être de prise sur soi, avec derrière en filigrane, l’amour.
Ce livre sur la tauromachie ne convaincra personne. Mais si on le lit sans a priori, en goûtant la prose colorée et délicate de l’auteur, on apprend beaucoup de choses sur la mentalité espagnole (mais pas seulement), et on passe somme toute un bon moment de lecture.
Dans notre littérature, Joseph Peyré est un auteur singulier, et attachant. Il est né en 1892, à Aydie, petit village au nord de Pau. Il est donc béarnais, ce qui, aux yeux des personnes de sens rassis, est un critère de qualité, sinon d’excellence (toutes les personnes nées dans la moitié ouest du département des Pyrénées-Atlantiques vous le confirmeront).Et pourtant, il a écrit dans des domaines, où à priori, il n’avait pas de disposition particulière : il n’était pas alpiniste, ni montagnard chevronné, il nous a pourtant laissé un des plus beaux romans jamais écrits sur la conquête des cimes (« Matterhorn – 1939 ») ; il n’était pas espagnol, mais il nous a laissé une douzaine de romans qui révèlent mieux que quiconque (aussi bien que des romanciers hispaniques) l’âme de ce pays, et parmi eux le très beau « Sang et lumières – 1935 » ; il n’était pas légionnaire méhariste, et il nous a décrit le désert aussi bien que n’importe quel chef de caravane (« L’escadron blanc – 1931 ») ; il n’était pas basque (mais béarnais, ça ne vous a peut-être pas échappé) mais il a écrit plusieurs romans qui révèlent une connaissance subtile et profonde de ce peuple à nul autre pareil, parmi eux, ce petit joyau : « Jean le Basque ».
Paru en 1953, « Jean le Basque » est avec le « Ramuntcho » de Pierre Loti (1897), une des rares incursions de la littérature généraliste en Euskadi (Pays basque). L’histoire est celle de Jean Iribarren, un berger d’Artazu, un village près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Un jour un recruteur, Oyamburu, vient à Artazu pour présenter aux jeunes intéressés un film sur l’Ouest américain. Fascinés par les immenses troupeaux et les grands espaces, Jean et son ami Michel se laissent tenter par l’aventure. Après une partie de pelote mémorable (avec son ami le curé Arostéguy), Jean le Basque, accompagné de Michel, prend le départ pour l’Amérique. Ils ne sont pas les seuls à partir, bien d’autres sont partis avant eux, et bien d’autres partiront après eux. L’émigration vers l’Amérique, qu’elle soit du Nord ou du Sud, est un phénomène démographique extrêmement important dans le sud-ouest de la France, dans toute la seconde moitié du XIXème siècle et au début du XXème.
En Amérique, les Etats-Unis, ce n’est pas le Pérou. Nos amis vont l’apprendre à leurs dépens. Le climat n’est en rien comparable à la douce Euskadi, ici c’est le désert du Nevada avec son soleil brûlant, et ses tempêtes soudaines, les attaques de loups, les Indiens, les hors-la-loi, le Far-West dans toute sa splendeur… et sa sauvagerie. Mais les Basques portent leur civilisation avec eux. Jean se réfère constamment au pays, « il fallait à l’Iribarren l’ombre de l’église d’Artazu, ses dorures et son luminaire, son parterre de dévotes, ses deux galeries chargées d’hommes, les rangées de bérets au mur, le chœur puissant qui faisait résonner la voûte, et les cantiques, plus chaleureux que les prières ». Les Basques sont solidaires entre eux, et même exilés, ils mettent en commun leurs souvenirs et leur amour du pays. Et Jean n’oublie pas les derniers mots de son ami, le curé Arostéguy : « Bethi aintzina / Zuzen Zuzena / Dabil Eskualduna » (« Toujours en avant / Tout droit / Marche le Basque »).
« Jean le Basque », c’est deux romans en un seul : un magnifique hommage au Pays Basque, et en même temps un western insolite (on n’a pas souvent l’occasion de voir ce genre de cowboys au pays des Indiens). En tous cas un très beau livre.
Pour rester dans l’ambiance je vous conseille vivement de trouver (sur Internet ou ailleurs) ce film de 1958 « La Caravane vers le soleil » de Russel Rouse avec Jeff Chandler et Susan Hayward : la caravane en question est composée de Basques qui se battent contre les Indiens avec des irrintzinas (long cri basque modulé) et des chisteras (paniers d’osier pour jouer à la pelote). Kitsch, certes, mais réjouissant !
Paru en 1953, « Jean le Basque » est avec le « Ramuntcho » de Pierre Loti (1897), une des rares incursions de la littérature généraliste en Euskadi (Pays basque). L’histoire est celle de Jean Iribarren, un berger d’Artazu, un village près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Un jour un recruteur, Oyamburu, vient à Artazu pour présenter aux jeunes intéressés un film sur l’Ouest américain. Fascinés par les immenses troupeaux et les grands espaces, Jean et son ami Michel se laissent tenter par l’aventure. Après une partie de pelote mémorable (avec son ami le curé Arostéguy), Jean le Basque, accompagné de Michel, prend le départ pour l’Amérique. Ils ne sont pas les seuls à partir, bien d’autres sont partis avant eux, et bien d’autres partiront après eux. L’émigration vers l’Amérique, qu’elle soit du Nord ou du Sud, est un phénomène démographique extrêmement important dans le sud-ouest de la France, dans toute la seconde moitié du XIXème siècle et au début du XXème.
En Amérique, les Etats-Unis, ce n’est pas le Pérou. Nos amis vont l’apprendre à leurs dépens. Le climat n’est en rien comparable à la douce Euskadi, ici c’est le désert du Nevada avec son soleil brûlant, et ses tempêtes soudaines, les attaques de loups, les Indiens, les hors-la-loi, le Far-West dans toute sa splendeur… et sa sauvagerie. Mais les Basques portent leur civilisation avec eux. Jean se réfère constamment au pays, « il fallait à l’Iribarren l’ombre de l’église d’Artazu, ses dorures et son luminaire, son parterre de dévotes, ses deux galeries chargées d’hommes, les rangées de bérets au mur, le chœur puissant qui faisait résonner la voûte, et les cantiques, plus chaleureux que les prières ». Les Basques sont solidaires entre eux, et même exilés, ils mettent en commun leurs souvenirs et leur amour du pays. Et Jean n’oublie pas les derniers mots de son ami, le curé Arostéguy : « Bethi aintzina / Zuzen Zuzena / Dabil Eskualduna » (« Toujours en avant / Tout droit / Marche le Basque »).
« Jean le Basque », c’est deux romans en un seul : un magnifique hommage au Pays Basque, et en même temps un western insolite (on n’a pas souvent l’occasion de voir ce genre de cowboys au pays des Indiens). En tous cas un très beau livre.
Pour rester dans l’ambiance je vous conseille vivement de trouver (sur Internet ou ailleurs) ce film de 1958 « La Caravane vers le soleil » de Russel Rouse avec Jeff Chandler et Susan Hayward : la caravane en question est composée de Basques qui se battent contre les Indiens avec des irrintzinas (long cri basque modulé) et des chisteras (paniers d’osier pour jouer à la pelote). Kitsch, certes, mais réjouissant !
Il est heureux que les lecteurs de Babelio se souviennent de Joseph Peyré, alors que le Petit Larousse l'ignore.... C'est un conteur merveilleux, sachant décrire les lieux et les sensations humaines avec une justesse et une sensibilité extrêmes, ceci dans une langue de qualité, porteuse d'un vocabulaire riche et précis (que, là encore, nos dictionnaires modernes ignorent souvent....).
L'Escadron blanc (livre publié en 1930) nous raconte la poursuite, dans le désert du sud Algérien, d'un "rezzou" de Berabers, par un corps expéditionnaire français de 80 hommes. Nous saurons tout du désert, des difficultés terribles rencontrées par ces hommes et leurs chameaux pour progresser sous des chaleurs accablantes, les points d'eau étant espacés parfois de plus de cent kilomètres. Et ce livre est surtout celui de l'attente: on poursuit un ennemi invisible, et chaque jour, on croit l'avoir rattrapé, mais il n'est pas là. Cette attente du choc, de la confrontation (dont on sait pourtant qu'elle ne se fera pas sans pertes humaines, qui s'ajouteront à celles que le désert torride aura déjà causées) est l'élément essentiel du récit: entre impatience et inquiétude, les sentiments humains se contrarient. N'est-ce pas un peu ce que l'on a retrouvé plus tard dans le Rivage des Syrtes? La guerre est terrible; l'attente de la guerre aussi. Et les militaires ont besoin du combat, qui est la justification de leur engagement. Joseph Peyré maîtrise tout cela: le récit, de vocabulaire, le sens des formules, la description de la rude amitié entre des hommes emportés dans une aventure qui les soude mais où la mort est forcément présente. Qui périra? Qui survivra? Demain, plus tard? Ce que ressentent les hommes face à ce terrible et irréversible suspens nous est narré avec talent. Ne faisons pas comme les rédacteurs de nos dictionnaires: n'oublions pas Joseph Peyré.
L'Escadron blanc (livre publié en 1930) nous raconte la poursuite, dans le désert du sud Algérien, d'un "rezzou" de Berabers, par un corps expéditionnaire français de 80 hommes. Nous saurons tout du désert, des difficultés terribles rencontrées par ces hommes et leurs chameaux pour progresser sous des chaleurs accablantes, les points d'eau étant espacés parfois de plus de cent kilomètres. Et ce livre est surtout celui de l'attente: on poursuit un ennemi invisible, et chaque jour, on croit l'avoir rattrapé, mais il n'est pas là. Cette attente du choc, de la confrontation (dont on sait pourtant qu'elle ne se fera pas sans pertes humaines, qui s'ajouteront à celles que le désert torride aura déjà causées) est l'élément essentiel du récit: entre impatience et inquiétude, les sentiments humains se contrarient. N'est-ce pas un peu ce que l'on a retrouvé plus tard dans le Rivage des Syrtes? La guerre est terrible; l'attente de la guerre aussi. Et les militaires ont besoin du combat, qui est la justification de leur engagement. Joseph Peyré maîtrise tout cela: le récit, de vocabulaire, le sens des formules, la description de la rude amitié entre des hommes emportés dans une aventure qui les soude mais où la mort est forcément présente. Qui périra? Qui survivra? Demain, plus tard? Ce que ressentent les hommes face à ce terrible et irréversible suspens nous est narré avec talent. Ne faisons pas comme les rédacteurs de nos dictionnaires: n'oublions pas Joseph Peyré.
L’incursion dans le roman historique, pour Joseph Peyré, avait eu lieu en 1957, avec ce joli roman « Une fille de Saragosse » qui racontait le siège épique de cette ville en 1808.
En 1961, l’auteur revient au genre, et à la même époque historique, la campagne française de Napoléon en Espagne (1808). Cette fois, nous sommes plus au sud, dans l’Andalousie profonde.
Les troupes françaises pénètrent en Andalousie pour permettre à Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, de monter sur le trône d’Espagne. Joseph-Marie de Saint-Armou, jeune officier français commande le 1er peloton de chasseurs à cheval, composé essentiellement de Béarnais, comme lui. Lors de la prise de Cordoue (7 juin 1808) et du pillage qui s’ensuivit, il s’interpose entre des soudards avinés et la maison d’un gentilhomme espagnol, Jaime de Tovar, Bien qu’adversaires sur le terrain, les deux jeunes gens se lient d’amitié. Mais la guerre continue, et le sac de Cordoue a déclenché une insurrection générale. Jaime et sa sœur la Condesa Cayetana prennent les armes contre les Français. « Los Franceses » vont d’échec en échec, et finissent par sombrer dans la terrible bataille de Bailen. Saint-Armou ne doit sa vie et son salut, finalement, que grâce à ses amis espagnols, qui soignent ses blessures et l’aident même, malgré leur différence de camp, à regagner la France.
Les mêmes recettes, qui avaient si bien marché en 1957, fonctionnent tout aussi bien ici : Joseph Peyré, à partir d’une solide documentation, restitue parfaitement le parcours tragique de l’armée de Napoléon, tout comme la vaillance des insurgés espagnols. Sa connaissance de l’Espagne et surtout de l’âme espagnole, lui permet de mettre en place un véritable « roman national » : la guerre que mènent les français est « inédite, destinée à préfigurer les résistances de l’avenir et les basses besognes qu’elles imposeraient aux soldats ». Le choix même du héros, nouveau d’Artagnan, chevaleresque et batailleur, mais en même temps doté de cet « esprit d’examen, souci de compréhension, de justice, qui fut celui de nombre de jeunes officiers de l’Empire engagés dans la guerre d’Espagne », est à cet égard significatif.
« Les lanciers de Jerez » forment le premier volume d’une trilogie qui comprend également « Les Remparts de Cadix » (1962) et « L’Alcalde de San Juan » (1963), où l’on continue à suivre les aventures de Joseph-Marie, de Jaime et de Cayetana
En 1964, Joseph Peyré précisait la genèse de cette œuvre :
« La vérité historique sur cette première campagne andalouse qui culmina à l’été 1808, effectuée par le « Corps d’Observation de la Gironde », le drame bruyant qui le conduisit au désastre, et les combats des lanciers andalous enrôlés à Menjibar et Bailen sous le nom de « Lanciers de Jerez » forment la trame du premier livre de cette œuvre ».
Il est regrettable que les trois volumes de cette trilogie n’aient pas été réédités : ils constituent un excellent témoignage, à la fois vivant et riche en émotions, sur un conflit peu évoqué dans les romans historiques, celui de la campagne d’Espagne de Napoléon en 1808. Merci, monsieur Peyré de nous l’avoir si bien rappelé.
En 1961, l’auteur revient au genre, et à la même époque historique, la campagne française de Napoléon en Espagne (1808). Cette fois, nous sommes plus au sud, dans l’Andalousie profonde.
Les troupes françaises pénètrent en Andalousie pour permettre à Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, de monter sur le trône d’Espagne. Joseph-Marie de Saint-Armou, jeune officier français commande le 1er peloton de chasseurs à cheval, composé essentiellement de Béarnais, comme lui. Lors de la prise de Cordoue (7 juin 1808) et du pillage qui s’ensuivit, il s’interpose entre des soudards avinés et la maison d’un gentilhomme espagnol, Jaime de Tovar, Bien qu’adversaires sur le terrain, les deux jeunes gens se lient d’amitié. Mais la guerre continue, et le sac de Cordoue a déclenché une insurrection générale. Jaime et sa sœur la Condesa Cayetana prennent les armes contre les Français. « Los Franceses » vont d’échec en échec, et finissent par sombrer dans la terrible bataille de Bailen. Saint-Armou ne doit sa vie et son salut, finalement, que grâce à ses amis espagnols, qui soignent ses blessures et l’aident même, malgré leur différence de camp, à regagner la France.
Les mêmes recettes, qui avaient si bien marché en 1957, fonctionnent tout aussi bien ici : Joseph Peyré, à partir d’une solide documentation, restitue parfaitement le parcours tragique de l’armée de Napoléon, tout comme la vaillance des insurgés espagnols. Sa connaissance de l’Espagne et surtout de l’âme espagnole, lui permet de mettre en place un véritable « roman national » : la guerre que mènent les français est « inédite, destinée à préfigurer les résistances de l’avenir et les basses besognes qu’elles imposeraient aux soldats ». Le choix même du héros, nouveau d’Artagnan, chevaleresque et batailleur, mais en même temps doté de cet « esprit d’examen, souci de compréhension, de justice, qui fut celui de nombre de jeunes officiers de l’Empire engagés dans la guerre d’Espagne », est à cet égard significatif.
« Les lanciers de Jerez » forment le premier volume d’une trilogie qui comprend également « Les Remparts de Cadix » (1962) et « L’Alcalde de San Juan » (1963), où l’on continue à suivre les aventures de Joseph-Marie, de Jaime et de Cayetana
En 1964, Joseph Peyré précisait la genèse de cette œuvre :
« La vérité historique sur cette première campagne andalouse qui culmina à l’été 1808, effectuée par le « Corps d’Observation de la Gironde », le drame bruyant qui le conduisit au désastre, et les combats des lanciers andalous enrôlés à Menjibar et Bailen sous le nom de « Lanciers de Jerez » forment la trame du premier livre de cette œuvre ».
Il est regrettable que les trois volumes de cette trilogie n’aient pas été réédités : ils constituent un excellent témoignage, à la fois vivant et riche en émotions, sur un conflit peu évoqué dans les romans historiques, celui de la campagne d’Espagne de Napoléon en 1808. Merci, monsieur Peyré de nous l’avoir si bien rappelé.
« Ce livre n’a pas d’âge » écrit l’auteur dans son introduction. De son point de vue, il a certainement raison. Son héros, le lieutenant Brécourt, n’aurait pas pu évoluer dans un autre milieu, mais des personnages comme lui ont existé de tous temps, depuis le débarquement de Sidi-Ferruch (14 juin 1830) jusqu’à l’époque où il place l’action (début de le Seconde Guerre mondiale). Cependant, le roman montre quand même un changement d’époque : l’épopée des méharistes, c’est-à-dire des soldats à dos de méhara (dromadaires – pour les non-initiés, je précise : un méhari, deux méhara), est en train de passer la main aux jeeps et autres voitures motorisées, (camions Latil), qui quelque part violent l’intégrité du désert.
Le lieutenant Brécourt, aurait donc pu vivre à une autre époque, mais toujours dans le désert, dans ce décor de sable et de ciel, où il est, à l’instar des Touaregs, un « chevalier du désert ». Il a une connexion particulière avec cet univers, où la notion de liberté absolue avoisine celle d’intense intériorité, ce qui le rapproche de ces mystiques des sables que sont Charles de Foucauld et plus près de nous Théodore Monod (et même notre Saint-Ex dans son escale de Port-Juby).
Son ami le lieutenant Chavannes, n’a pas le même attrait pour ce pays de roche et de sable. Il essaie de faire revenir en vain Brécourt vers la métropole. Mais celui-ci, après avoir hésité, notamment à la vue de la modernisation de son métier, décide de rester au Sahara. « Il a préféré à tout autre pays cette terre de solitude, où il devait, à travers les déceptions, trouver le tête-à-tête avec lui-même, la liberté et la grandeur pour lesquelles il était fait (…). Un Brécourt était né pour l’exaltation du désert ». Cet appel du désert (comme fut l’appel du Hoggar pour Charles de Foucauld), est plus fort que tout, même l’amour d’une femme ne l’arrêtera pas.
« Croix du Sud » est un roman dont l’action ressemble à ces plans de « Lawrence d’Arabie » (le film) où l’image se trouble avec la chaleur : tout se fond en un plan unique où l’action est figée dans une espèce d’intemporalité. Sans doute, ceux qui d’entre vous ont été au cœur du désert ont connu ce moment où l’espace et le temps se rencontrent, en un moment magique, où l’on se sent à la fois grand comme le monde et petit comme le grain de sable sur lequel on marche. Pas beaucoup de mouvement donc, sinon le pas régulier du dromadaire, à la fois lancinant et familier. Mais une intense vie intérieure.
Est-ce une forme d’héroïsme ? L’auteur semble le penser. Il y a certes un petit parfum colonialiste dans cette histoire, et le culte du soldat de l’Armée d’Afrique fait partie de cette histoire coloniale, épique et tragique, qui a fait la grandeur et parfois la honte (mais c’est le cas de toutes les expériences humaines) de notre pays. Mais le désert, comme la haute montagne, comme la mer, est potentiellement quelque chose à quoi se confronter, et c’est bien là une définition de l’héroïsme.
Joseph Peyré, une fois de plus, nous sidère par la représentation magique qu’il nous donne d’un décor qu’il ne connait que par documentation ou témoignages, et très peu par expérience personnelle. La preuve qu’il est un grand écrivain, et qu’il a un don particulier pour créer un univers où le réalisme se mêle à un sorte de fantastique exotique, avec une belle intériorité.
Le lieutenant Brécourt, aurait donc pu vivre à une autre époque, mais toujours dans le désert, dans ce décor de sable et de ciel, où il est, à l’instar des Touaregs, un « chevalier du désert ». Il a une connexion particulière avec cet univers, où la notion de liberté absolue avoisine celle d’intense intériorité, ce qui le rapproche de ces mystiques des sables que sont Charles de Foucauld et plus près de nous Théodore Monod (et même notre Saint-Ex dans son escale de Port-Juby).
Son ami le lieutenant Chavannes, n’a pas le même attrait pour ce pays de roche et de sable. Il essaie de faire revenir en vain Brécourt vers la métropole. Mais celui-ci, après avoir hésité, notamment à la vue de la modernisation de son métier, décide de rester au Sahara. « Il a préféré à tout autre pays cette terre de solitude, où il devait, à travers les déceptions, trouver le tête-à-tête avec lui-même, la liberté et la grandeur pour lesquelles il était fait (…). Un Brécourt était né pour l’exaltation du désert ». Cet appel du désert (comme fut l’appel du Hoggar pour Charles de Foucauld), est plus fort que tout, même l’amour d’une femme ne l’arrêtera pas.
« Croix du Sud » est un roman dont l’action ressemble à ces plans de « Lawrence d’Arabie » (le film) où l’image se trouble avec la chaleur : tout se fond en un plan unique où l’action est figée dans une espèce d’intemporalité. Sans doute, ceux qui d’entre vous ont été au cœur du désert ont connu ce moment où l’espace et le temps se rencontrent, en un moment magique, où l’on se sent à la fois grand comme le monde et petit comme le grain de sable sur lequel on marche. Pas beaucoup de mouvement donc, sinon le pas régulier du dromadaire, à la fois lancinant et familier. Mais une intense vie intérieure.
Est-ce une forme d’héroïsme ? L’auteur semble le penser. Il y a certes un petit parfum colonialiste dans cette histoire, et le culte du soldat de l’Armée d’Afrique fait partie de cette histoire coloniale, épique et tragique, qui a fait la grandeur et parfois la honte (mais c’est le cas de toutes les expériences humaines) de notre pays. Mais le désert, comme la haute montagne, comme la mer, est potentiellement quelque chose à quoi se confronter, et c’est bien là une définition de l’héroïsme.
Joseph Peyré, une fois de plus, nous sidère par la représentation magique qu’il nous donne d’un décor qu’il ne connait que par documentation ou témoignages, et très peu par expérience personnelle. La preuve qu’il est un grand écrivain, et qu’il a un don particulier pour créer un univers où le réalisme se mêle à un sorte de fantastique exotique, avec une belle intériorité.
Joseph Peyré, ici ne nous parle pas de montagne ni de désert. Il nous parle de son troisième sujet de prédilection : l’Espagne ; Mais cette fois ce n’est pas l’Espagne contemporaine. « Une fille de Saragosse » est ce qu’on peut appeler un roman historique.
Nous sommes en 1809, à Saragosse, capitale de l’Aragon. L’année précédente, Napoléon avait assiégé une première fois la ville, mais la défaite de Baïlen (19 au 22 juillet 1808) avait obligé les Français à lever le siège. Cette fois, ils reviennent, bien décidés à l’emporter. Mais les Espagnols, sous le commandement de Palafox sont mieux préparés. Ravitaillés par les Anglais en vivres et en munitions, ils sont prêts à soutenir un siège de longue durée.
C’est ce second siège (20 décembre 1808 – 21 février 1809) que Joseph Peyré se propose de nous fait vivre, à travers la rencontre (et plus si affinités) entre un jeune noble, Juan Ruiz de la Mata, et une roturière, Pilar Garcia. Au début du roman une rumeur fait état de renforts conduits par le général Reding de Biberegg, un suisse au service de l’Espagne. Mais, les assiégés déchantent vite. Ce n’était qu’une fausse nouvelle (les fake-news de l’époque). Le siège commence, avec les travaux de sape des assiégeants et les bombardements incessants. La vie à l’intérieur s’organise, avec ses moments de répits, mais plus souvent ses moments douloureux (maladies – avec en prime une épidémie de typhus-, famines, incendies, problèmes de promiscuité). Palafox essaye d’insuffler à la population un esprit de révolte et de patriotisme. Il y arrive souvent, car les Espagnols ont ancré en eux la défense de leur ville et de leur terre. Et quand les Français pénètrent dans la ville, c’est un autre type de combat qui s’instaure : la guérilla urbaine. Les manuels qui étudient la science des sièges (« poliorcétique » est le terme adéquat), n’avaient pas prévu le cas : dans certains quartiers, les plus pauvres, les murs sont faits d’adobe (argile et paille) et n’offrent guère de résistance, tout dépend des défenseurs, mais ceux-ci sont fins prêts : « Nous sommes des hommes, et qui ont des reins. Et qui tiendront mieux que la pierre ». Il en est ainsi dans tous les quartiers : « Là comme ailleurs dans Saragosse, c'était l'homme qui tenait ». Cette union des défenseurs abolit également les classes sociales : à l’instar de Juan et de Pilar, tous s’unissent contre l’ennemi commun, qu’ils soient nobles ou roturiers, militaires ou civils, prêtres ou laïcs.
Joseph Peyré, n’est pas spécialement historien (pas plus qu’il n’est montagnard ou spécialiste du désert) mais il s’acquitte de son travail, comme d’habitude, d’une merveilleuse façon, sans effort apparent (alors qu’il a dû amasser, compiler et organiser avant de la traiter, une documentation considérable). Il faut dire qu’il est transcendé par cette âme espagnole dont il se sent proche. Pour son personnage principal, il n’a pas dû chercher bien loin : La vraie Pilar s’appelait Agustina Raimunda Maria Saragossa y Domènech, connue comme Agustina de Aragón ou Augustine d'Aragon (1786 - 1857). Cette héroïne espagnole de la Guerre d'indépendance, qui s’illustra particulièrement lors des deux sièges de Saragosse, se battit comme civile, et fut ensuite officier de l'armée espagnole. Célébrée comme la « Jeanne d'Arc espagnole », elle inspira de nombreux artistes (peintres et poètes) et fait partie de la légende, c’est une ancêtre directe de Dolores Ibarurri (la Pasionaria). Comme elle, elle aurait pu dire : « No pasaran ! »
Joseph Peyré à écrit trois autres romans historiques en lien avec l’Espagne : « Les lanciers de Jerez » (1961), « Les Remparts de Cadix » (1962) et « L’Alcalde de San Juan » (1963).
Nous sommes en 1809, à Saragosse, capitale de l’Aragon. L’année précédente, Napoléon avait assiégé une première fois la ville, mais la défaite de Baïlen (19 au 22 juillet 1808) avait obligé les Français à lever le siège. Cette fois, ils reviennent, bien décidés à l’emporter. Mais les Espagnols, sous le commandement de Palafox sont mieux préparés. Ravitaillés par les Anglais en vivres et en munitions, ils sont prêts à soutenir un siège de longue durée.
C’est ce second siège (20 décembre 1808 – 21 février 1809) que Joseph Peyré se propose de nous fait vivre, à travers la rencontre (et plus si affinités) entre un jeune noble, Juan Ruiz de la Mata, et une roturière, Pilar Garcia. Au début du roman une rumeur fait état de renforts conduits par le général Reding de Biberegg, un suisse au service de l’Espagne. Mais, les assiégés déchantent vite. Ce n’était qu’une fausse nouvelle (les fake-news de l’époque). Le siège commence, avec les travaux de sape des assiégeants et les bombardements incessants. La vie à l’intérieur s’organise, avec ses moments de répits, mais plus souvent ses moments douloureux (maladies – avec en prime une épidémie de typhus-, famines, incendies, problèmes de promiscuité). Palafox essaye d’insuffler à la population un esprit de révolte et de patriotisme. Il y arrive souvent, car les Espagnols ont ancré en eux la défense de leur ville et de leur terre. Et quand les Français pénètrent dans la ville, c’est un autre type de combat qui s’instaure : la guérilla urbaine. Les manuels qui étudient la science des sièges (« poliorcétique » est le terme adéquat), n’avaient pas prévu le cas : dans certains quartiers, les plus pauvres, les murs sont faits d’adobe (argile et paille) et n’offrent guère de résistance, tout dépend des défenseurs, mais ceux-ci sont fins prêts : « Nous sommes des hommes, et qui ont des reins. Et qui tiendront mieux que la pierre ». Il en est ainsi dans tous les quartiers : « Là comme ailleurs dans Saragosse, c'était l'homme qui tenait ». Cette union des défenseurs abolit également les classes sociales : à l’instar de Juan et de Pilar, tous s’unissent contre l’ennemi commun, qu’ils soient nobles ou roturiers, militaires ou civils, prêtres ou laïcs.
Joseph Peyré, n’est pas spécialement historien (pas plus qu’il n’est montagnard ou spécialiste du désert) mais il s’acquitte de son travail, comme d’habitude, d’une merveilleuse façon, sans effort apparent (alors qu’il a dû amasser, compiler et organiser avant de la traiter, une documentation considérable). Il faut dire qu’il est transcendé par cette âme espagnole dont il se sent proche. Pour son personnage principal, il n’a pas dû chercher bien loin : La vraie Pilar s’appelait Agustina Raimunda Maria Saragossa y Domènech, connue comme Agustina de Aragón ou Augustine d'Aragon (1786 - 1857). Cette héroïne espagnole de la Guerre d'indépendance, qui s’illustra particulièrement lors des deux sièges de Saragosse, se battit comme civile, et fut ensuite officier de l'armée espagnole. Célébrée comme la « Jeanne d'Arc espagnole », elle inspira de nombreux artistes (peintres et poètes) et fait partie de la légende, c’est une ancêtre directe de Dolores Ibarurri (la Pasionaria). Comme elle, elle aurait pu dire : « No pasaran ! »
Joseph Peyré à écrit trois autres romans historiques en lien avec l’Espagne : « Les lanciers de Jerez » (1961), « Les Remparts de Cadix » (1962) et « L’Alcalde de San Juan » (1963).
Le mot « goumier », comme tant d’autres mots issus de notre histoire coloniale, nous renvoie à un passé que certains réprouvent et que d’autres encensent, et que nous, habitants du XXIème siècle, regardons parfois avec désinvolture en disant, c’est du passé, il faut penser à l’avenir. Mais comme disait Pierre Dac, qui au fond était un grand philosophe : « L’avenir c’est du passé en conserve », faisant le lien de façon définitive entre le passé le présent et l’avenir : on ne peut pas vivre le présent sans se souvenir du passé (essayer d’en retenir les leçons) afin de préparer un avenir meilleur… Suivant qu’on est optimiste ou pessimiste, on appelle ça espérance ou utopie… Ah ! si seulement on y ajoutait la clairvoyance…
Quand les troupes françaises occupaient le Maghreb (Maroc-Algérie-Tunisie) les troupes coloniales faisaient appel à des contingents locaux de soldats indigènes qu’on appelait les « goumiers », c’est-à-dire des soldats faisant partie d’un « goum », le goum étant une unité d’infanterie légère composée exclusivement de troupes indigènes (arabes, touareg ou maures).
« La légende du goumier Saïd » est un hommage à ces supplétifs (puis réguliers) de l’armée française qui l’ont suivie non seulement dans toutes les campagnes d’Afrique mais également dans celles des deux guerres mondiales et même au-delà. Plus particulièrement c’est l’histoire d’un homme, Saïd, berbère d’origine, qui s’attache à son chef le capitaine Sauveterre, avec une fidélité à toute épreuve.
Le roman est tout entier bâti sur cette fidélité, qui n’est pas exceptionnelle, en fait. Les populations indigènes, au tout début, s’étaient engagées auprès des « roumis », tant par admiration et même affection que par obligation. Ceci explique en partie pourquoi ils ont été si présents dans la plupart des conflits. Saïd est aux côtés de Sauveterre dans toutes les campagnes de la pacification marocaine. Par fidélité, il suit son chef dans les campagnes de Tunisie, débarque en Provence, fait partie des libérateurs de la France, et poursuit les Allemands jusque dans leur pays. Après quoi, il rentre chez les siens, et son rôle se borne à raconter sa vie, et comme un conteur de village, il n’a de cesse de l’embellir et d’en faire une légende. Mais dans cette légende, ce n’est pas lui qui tient le premier rôle, c’est son idole et son ami, le capitaine Sauveterre. Celui-ci, devenu colonel, est actuellement en fonction en Indochine, où il combat avec d’autres indigènes, très différents de ceux qu’il a connus en Afrique. Il ne rêve que de retourner au Maroc, terre qui lui est chère, parce qu’il y a accompli des hauts faits d’armes, certes, mais parce qu’il a été subjugué par ce pays, ses habitants, et bien sûr le désert et son incommensurable pouvoir d’attraction. Peut-être aussi parce qu’il pense que c’est là qu’il doit sceller son destin…
Au-delà du récit épique et coloré, Joseph Peyré, dans une louable intention humaniste, a tenu à remettre en lumière le rôle de ces soldats de l’ombre, par ailleurs parmi les plus décorés de la Seconde Guerre Mondiale.
Comme dans tous les autres romans de Joseph Peyré, on ne peut que s’émerveiller devant l’aisance du romancier, qui sans avoir une connaissance approfondie du désert (pas plus que de la montagne, par exemple) sait nous ensorceler dans un récit à la fois vigoureux, chaleureux, d’une grande noblesse, et passionnant de bout en bout.
Quand les troupes françaises occupaient le Maghreb (Maroc-Algérie-Tunisie) les troupes coloniales faisaient appel à des contingents locaux de soldats indigènes qu’on appelait les « goumiers », c’est-à-dire des soldats faisant partie d’un « goum », le goum étant une unité d’infanterie légère composée exclusivement de troupes indigènes (arabes, touareg ou maures).
« La légende du goumier Saïd » est un hommage à ces supplétifs (puis réguliers) de l’armée française qui l’ont suivie non seulement dans toutes les campagnes d’Afrique mais également dans celles des deux guerres mondiales et même au-delà. Plus particulièrement c’est l’histoire d’un homme, Saïd, berbère d’origine, qui s’attache à son chef le capitaine Sauveterre, avec une fidélité à toute épreuve.
Le roman est tout entier bâti sur cette fidélité, qui n’est pas exceptionnelle, en fait. Les populations indigènes, au tout début, s’étaient engagées auprès des « roumis », tant par admiration et même affection que par obligation. Ceci explique en partie pourquoi ils ont été si présents dans la plupart des conflits. Saïd est aux côtés de Sauveterre dans toutes les campagnes de la pacification marocaine. Par fidélité, il suit son chef dans les campagnes de Tunisie, débarque en Provence, fait partie des libérateurs de la France, et poursuit les Allemands jusque dans leur pays. Après quoi, il rentre chez les siens, et son rôle se borne à raconter sa vie, et comme un conteur de village, il n’a de cesse de l’embellir et d’en faire une légende. Mais dans cette légende, ce n’est pas lui qui tient le premier rôle, c’est son idole et son ami, le capitaine Sauveterre. Celui-ci, devenu colonel, est actuellement en fonction en Indochine, où il combat avec d’autres indigènes, très différents de ceux qu’il a connus en Afrique. Il ne rêve que de retourner au Maroc, terre qui lui est chère, parce qu’il y a accompli des hauts faits d’armes, certes, mais parce qu’il a été subjugué par ce pays, ses habitants, et bien sûr le désert et son incommensurable pouvoir d’attraction. Peut-être aussi parce qu’il pense que c’est là qu’il doit sceller son destin…
Au-delà du récit épique et coloré, Joseph Peyré, dans une louable intention humaniste, a tenu à remettre en lumière le rôle de ces soldats de l’ombre, par ailleurs parmi les plus décorés de la Seconde Guerre Mondiale.
Comme dans tous les autres romans de Joseph Peyré, on ne peut que s’émerveiller devant l’aisance du romancier, qui sans avoir une connaissance approfondie du désert (pas plus que de la montagne, par exemple) sait nous ensorceler dans un récit à la fois vigoureux, chaleureux, d’une grande noblesse, et passionnant de bout en bout.
En exergue à « Terre des Hommes », Antoine de Saint-Exupéry (Saint-Ex pour les intimes) écrivait : « La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle ». Cette observation générique, qui s’appliquait à la terre en général, est encore plus juste quand elle touche des entités spécifiques, telles que la mer ou la montagne. L’homme qui leur fait face est obligé en quelque sorte de les affronter. Affrontement sans réciproque en fait, la mer et la montagne n’ont aucune velléité de combat ni de résistance, les éléments ne pensent pas. Mais l’homme, lui, se trouve dans la nécessité de se surpasser pour passer l’obstacle. Et dans son imaginaire, la mer et la montagne ne sont plus des infinités liquides ou des amoncellements de rochers, mais des entités hostiles qu’il faut affronter et battre : « vaincre l’obstacle », et donc aller au-delà de lui-même, se surpasser, et par là-même, se découvrir.
Les familiers de la montagne connaissent bien ce sentiment, au moment d’escalader une paroi, ou d’entamer une longue marche dans la neige. Les guides en ont fait leur quotidien : la montagne est un parent proche, tour à tour ami ou hostile, mais c’est un proche, qui fait partie du cercle restreint de la famille.
Joseph Peyré n’est pas comme Roger Frison-Roche (« Premier de cordée »), Maurice Herzog (« Annapurna premier 8000 ») ou Walter Bonatti (« Victoire sur les Drus ») un professionnel des cimes, mais les amateurs de montagne s’accordent pour dire qu’il nous a laissé un des plus beaux livres jamais écrits sur cet univers de neige et de roc, de froid et de peur.
Matterhorn (littéralement « la corne des prés ») est le nom allemand du Cervin (en italien Cervino), un sommet (4478 m) situé sur la frontière italo-suisse. Jos-Mari Tannewalder est guide de profession et aussi de vocation. Il prend en charge une jeune femme Kate Bergen, épouse d’un riche industriel, qui souhaite gravir le Matterhorn, L’ascension bien entendu sera dramatique, les protagonistes ayant leurs propres problèmes intimes, qu’ils devront cependant mettre de côté pour face aux intempéries et aux pièges tendus par le terrible sommet.
L’histoire en elle-même n’est pas inintéressante mais elle reste assez banale. Mais le roman séduit par d’autres attraits : la couleur locale est très bien respectée, la description du village de Zermatt est particulièrement réussie, notamment par le rendu « technicolor » des habitants en costume traditionnel, le côté technique de l’ascension, sans être indigeste, est très bien restitué, on est carrément au cœur de l’action, plaqué contre la paroi ou pris dans la tempête, le suspense psychologique se maintient de bout en bout… mais le personnage principal, c’est bien le Matterhorn, personnification de la montagne, présentée comme une divinité contrariée, à la fois juge et partie dans ce drame où il tient le premier plan.
Le côté démodé et désuet du roman devient ici un atout : il lui donne un caractère historique bien daté (les montagnards d’aujourd’hui vont sourire de voir l’équipement et l’organisation de l’époque) qui ajoute à l’intensité du récit.
Grand classique de la littérature de montagne, Matterhorn est à placer aux côtés des auteurs déjà cités (Frison-Roche, Herzog, Bonatti), ainsi que de quelques autres qui méritent le détour : la quasi-totalité des ouvrages de Samivel (que tout savoyard doit avoir dans sa bibliothèque) et aussi ce très beau roman de Pierre Moustiers : « La paroi » (1969).
Enfant de la montagne
J’y retourne j’y retourne
Enfant de la montagne
J’y retourne en chantant…
Les familiers de la montagne connaissent bien ce sentiment, au moment d’escalader une paroi, ou d’entamer une longue marche dans la neige. Les guides en ont fait leur quotidien : la montagne est un parent proche, tour à tour ami ou hostile, mais c’est un proche, qui fait partie du cercle restreint de la famille.
Joseph Peyré n’est pas comme Roger Frison-Roche (« Premier de cordée »), Maurice Herzog (« Annapurna premier 8000 ») ou Walter Bonatti (« Victoire sur les Drus ») un professionnel des cimes, mais les amateurs de montagne s’accordent pour dire qu’il nous a laissé un des plus beaux livres jamais écrits sur cet univers de neige et de roc, de froid et de peur.
Matterhorn (littéralement « la corne des prés ») est le nom allemand du Cervin (en italien Cervino), un sommet (4478 m) situé sur la frontière italo-suisse. Jos-Mari Tannewalder est guide de profession et aussi de vocation. Il prend en charge une jeune femme Kate Bergen, épouse d’un riche industriel, qui souhaite gravir le Matterhorn, L’ascension bien entendu sera dramatique, les protagonistes ayant leurs propres problèmes intimes, qu’ils devront cependant mettre de côté pour face aux intempéries et aux pièges tendus par le terrible sommet.
L’histoire en elle-même n’est pas inintéressante mais elle reste assez banale. Mais le roman séduit par d’autres attraits : la couleur locale est très bien respectée, la description du village de Zermatt est particulièrement réussie, notamment par le rendu « technicolor » des habitants en costume traditionnel, le côté technique de l’ascension, sans être indigeste, est très bien restitué, on est carrément au cœur de l’action, plaqué contre la paroi ou pris dans la tempête, le suspense psychologique se maintient de bout en bout… mais le personnage principal, c’est bien le Matterhorn, personnification de la montagne, présentée comme une divinité contrariée, à la fois juge et partie dans ce drame où il tient le premier plan.
Le côté démodé et désuet du roman devient ici un atout : il lui donne un caractère historique bien daté (les montagnards d’aujourd’hui vont sourire de voir l’équipement et l’organisation de l’époque) qui ajoute à l’intensité du récit.
Grand classique de la littérature de montagne, Matterhorn est à placer aux côtés des auteurs déjà cités (Frison-Roche, Herzog, Bonatti), ainsi que de quelques autres qui méritent le détour : la quasi-totalité des ouvrages de Samivel (que tout savoyard doit avoir dans sa bibliothèque) et aussi ce très beau roman de Pierre Moustiers : « La paroi » (1969).
Enfant de la montagne
J’y retourne j’y retourne
Enfant de la montagne
J’y retourne en chantant…
La corrida c’est comme le céleri, on aime ou on n’aime pas, c’est instinctif : moi c’est simple le céleri me fait vomir (en vrai), la corrida aussi (moralement). Mais je peux très bien comprendre que des gens aiment le céleri, ou que des gens aiment la corrida (plus exactement je veux bien l’accepter mais il m’est difficile de le comprendre). Quoi qu’il en soit la corrida existe. Et le concept « corrida » a inspiré plusieurs œuvres artistiques (« Carmen » de Bizet, par exemple) et au moins deux excellents romans : « Arènes sanglantes » (1908) de Vicente Blasco Ibañez, et « Sang et lumières » (1935) de Joseph Peyré, auxquels il faut ajouter le récit d’Ernest Hemingway « Mort dans l’après-midi » (1932) et plus près de nous le reportage historique de Dominique Lapierre et Larry Collins « … Ou tu porteras mon deuil » consacré à la vie d’El Cordobès. Toutes ces œuvres ont comme point commun de présenter la corrida non pas comme simplement la mise à mort d’un animal (ce qu’elle est assurément) mais aussi l’accomplissement d’un rituel, (ce qu’elle est aussi, aussi discutable que soit ce rituel).
Sol y sombra. Ombre et lumière. C’est ainsi que se répartissent pour les spectateurs les gradins des arènes. C’est aussi un résumé fulgurant de la vie du torero (il n’y a qu’à l’Opéra que l’on voit des toréadors). L’habit de lumière qu’il revêt pour effectuer la faena face au taureau contraste avec la face cachée de son métier, particulièrement le fait qu’il remet à chaque fois sa vie en jeu (le taureau aussi, vous me direz, et lui une fois seulement). Sol y sombra, Vie et mort, Lumière et sang. Et pour les deux adversaires.
Le roman de Joseph Peyré, comme d’ailleurs celui de Blasco Ibañez, n’est pas une apologie de la corrida. Il n’y a pas de complaisance dans l’évocation de la mort du taureau, au contraire, les deux écrivains témoignent du respect pour l’animal qui défend sa vie. Car tel est l’enjeu pour les deux combattants : défendre leur vie, même si l’un est mieux armé que l’autre (a priori, parce que ce n’est pas toujours évident). C’est le drame du torero. Il vient un moment où il est plus dans l’ombre qu’au soleil. Il est fragilisé physiquement, et surtout moralement. Jamais peut-être le sens de la vie et de la mort n’est aussi aigu que chez ces êtres sur la corde raide.
Ricardo Garcia, une gloire de l’arène en fin de carrière, est poussé par sa femme et son imprésario (apoderado, dans le texte) à faire une dernière corrida. L’histoire est racontée par don José, un de ses amis. L’adversaire, le taureau, s’il est bien réel, prend également une fonction symbolique : Ricardo se bat contre lui-même, contre ses faiblesses, il se bat contre l’adversité (nous sommes dans une Espagne en pleine crise, à la veille de la Guerre Civile), il se bat contre la Mort, sa propre mort et la mort d’un monde en passe d’être révolu.
Joseph Peyré n’a pas son pareil pour décrire avec finesse et sensibilité, cette âme espagnole, fière et hautaine, et en même temps immensément fragile, il dépeint avec vérité cette Espagne éternelle et contemporaine en même temps, il met toute son expressivité dans ces tableaux aussi dramatiques que pittoresques que représente ce double drame, celui du torero et celui du taureau.
Je comprendrai aisément que les anti-corridas ne lisent pas ce livre. Pourtant je les invite à le lire, ne serait-ce que pour l’évocation du drame humain. Joseph Peyré a l’habitude de mettre en scène des êtres exceptionnels placés dans des situations exceptionnelles : le lieutenant Marçay dans « L’Escadron blanc », Jos-Mari dans « Matterhorn », et ici Ricardo Garcia dans « Sang et lumières », tous en arrivent à un moment donné à se poser les questions essentielles.
Sol y sombra. Ombre et lumière. C’est ainsi que se répartissent pour les spectateurs les gradins des arènes. C’est aussi un résumé fulgurant de la vie du torero (il n’y a qu’à l’Opéra que l’on voit des toréadors). L’habit de lumière qu’il revêt pour effectuer la faena face au taureau contraste avec la face cachée de son métier, particulièrement le fait qu’il remet à chaque fois sa vie en jeu (le taureau aussi, vous me direz, et lui une fois seulement). Sol y sombra, Vie et mort, Lumière et sang. Et pour les deux adversaires.
Le roman de Joseph Peyré, comme d’ailleurs celui de Blasco Ibañez, n’est pas une apologie de la corrida. Il n’y a pas de complaisance dans l’évocation de la mort du taureau, au contraire, les deux écrivains témoignent du respect pour l’animal qui défend sa vie. Car tel est l’enjeu pour les deux combattants : défendre leur vie, même si l’un est mieux armé que l’autre (a priori, parce que ce n’est pas toujours évident). C’est le drame du torero. Il vient un moment où il est plus dans l’ombre qu’au soleil. Il est fragilisé physiquement, et surtout moralement. Jamais peut-être le sens de la vie et de la mort n’est aussi aigu que chez ces êtres sur la corde raide.
Ricardo Garcia, une gloire de l’arène en fin de carrière, est poussé par sa femme et son imprésario (apoderado, dans le texte) à faire une dernière corrida. L’histoire est racontée par don José, un de ses amis. L’adversaire, le taureau, s’il est bien réel, prend également une fonction symbolique : Ricardo se bat contre lui-même, contre ses faiblesses, il se bat contre l’adversité (nous sommes dans une Espagne en pleine crise, à la veille de la Guerre Civile), il se bat contre la Mort, sa propre mort et la mort d’un monde en passe d’être révolu.
Joseph Peyré n’a pas son pareil pour décrire avec finesse et sensibilité, cette âme espagnole, fière et hautaine, et en même temps immensément fragile, il dépeint avec vérité cette Espagne éternelle et contemporaine en même temps, il met toute son expressivité dans ces tableaux aussi dramatiques que pittoresques que représente ce double drame, celui du torero et celui du taureau.
Je comprendrai aisément que les anti-corridas ne lisent pas ce livre. Pourtant je les invite à le lire, ne serait-ce que pour l’évocation du drame humain. Joseph Peyré a l’habitude de mettre en scène des êtres exceptionnels placés dans des situations exceptionnelles : le lieutenant Marçay dans « L’Escadron blanc », Jos-Mari dans « Matterhorn », et ici Ricardo Garcia dans « Sang et lumières », tous en arrivent à un moment donné à se poser les questions essentielles.
L’ouvrage porte en exergue :
"Ces récits ne sont pas du temps d'aujourd'hui mais d'avant juillet 1936, du temps de ma vie d'Espagne." J.P.
En mettant ces mots en tête de son récit « De cape et d’épée », paru en 1938, Joseph Peyré prend ses distances avec l’Espagne profonde, éternelle, qu’il aime profondément, et celle qui, après 1936, a changé de tête, et a basculé « du côté obscur » comme dirait Luke Skywalker.
Joseph Peyré a une relation très forte avec l’Espagne : d’abord, il en est voisin. Son village natal, Aydie, se situe au nord de Pau, à une soixantaine de kilomètres de la frontière. Ensuite il a fait des études à Valladolid, où il a pu découvrir et approfondir les grands textes de la littérature et de la culture espagnoles ; enfin son travail de journaliste, correspondant de plusieurs quotidiens français, concrétisé par de nombreux voyages et séjours à Saragosse, Séville ou Madrid, lui ont permis d’enrichir sa culture d’hispaniste, et d’observer « au plus près » la vie du pays et de ses habitants, leurs coutumes et leurs mentalités. Et ainsi d’intégrer, en quelque sorte, une part de l’âme espagnole.
« De cape et d’épée » comme le nom ne l’indique pas, ne fait pas allusion aux bretteurs illustres du temps des Mousquetaires, ou de Lagardère, mais bel et bien à la corrida, ce phénomène culturel qui, selon qu’on le regarde d’un côté ou de l’autre, apparaît comme un art, ou une boucherie.
Les huit textes qui constituent ce recueil sont un hommage non pas à « l’art tauromachique » mais aux hommes qui le pratiquent au quotidien :
« Mon dessein n’était pas de raconter des courses, mais l’aventure de la cuadrilla [cuadrilla : petite troupe, sous l’autorité du « matador », formée par les « peones » et les « picadors »]. J’ai découpé dans la fatigue de la route et les vicissitudes des huit compagnons de galère, les quatre actes du week-end de représentation de la tournée, veille d’armes, matin, habillage, combat ».
Il ne s’agit donc pas d’un roman (comme « Sang et lumières » ou « Guadalquivir ») sur le thème de la corrida, mais plutôt un reportage en forme d’hommage à ces hommes qui ont choisi ce métier où ils mettent leur vie en jeu.
C’est bien dans le genre de Joseph Peyré : non pas de cautionner ou pas cette pratique admirable ou monstrueuse, (suivant le côté où on se trouve), mais de souligner le côté humain de l’aventure : ce qui passionne Joseph Peyré, ici comme dans ses autres ouvrages : c’est la solitude de l’homme en face de la mort, cette solitude qui l’oblige à choisir le risque ou le défi. Face au taureau, face à la paroi de la montagne, face au désert, l’homme seul cherche sa vérité. Joseph Peyré, lui, cherche à comprendre ce qui pousse ces hommes de chair et de sang, mais aussi de courage et de peur, à mettre leur vie en danger pour se priver qu’ils sont vivants.
C’est en cela que Joseph Peyré est un humaniste. De cet humanisme qui unifie toute son œuvre.
"Ces récits ne sont pas du temps d'aujourd'hui mais d'avant juillet 1936, du temps de ma vie d'Espagne." J.P.
En mettant ces mots en tête de son récit « De cape et d’épée », paru en 1938, Joseph Peyré prend ses distances avec l’Espagne profonde, éternelle, qu’il aime profondément, et celle qui, après 1936, a changé de tête, et a basculé « du côté obscur » comme dirait Luke Skywalker.
Joseph Peyré a une relation très forte avec l’Espagne : d’abord, il en est voisin. Son village natal, Aydie, se situe au nord de Pau, à une soixantaine de kilomètres de la frontière. Ensuite il a fait des études à Valladolid, où il a pu découvrir et approfondir les grands textes de la littérature et de la culture espagnoles ; enfin son travail de journaliste, correspondant de plusieurs quotidiens français, concrétisé par de nombreux voyages et séjours à Saragosse, Séville ou Madrid, lui ont permis d’enrichir sa culture d’hispaniste, et d’observer « au plus près » la vie du pays et de ses habitants, leurs coutumes et leurs mentalités. Et ainsi d’intégrer, en quelque sorte, une part de l’âme espagnole.
« De cape et d’épée » comme le nom ne l’indique pas, ne fait pas allusion aux bretteurs illustres du temps des Mousquetaires, ou de Lagardère, mais bel et bien à la corrida, ce phénomène culturel qui, selon qu’on le regarde d’un côté ou de l’autre, apparaît comme un art, ou une boucherie.
Les huit textes qui constituent ce recueil sont un hommage non pas à « l’art tauromachique » mais aux hommes qui le pratiquent au quotidien :
« Mon dessein n’était pas de raconter des courses, mais l’aventure de la cuadrilla [cuadrilla : petite troupe, sous l’autorité du « matador », formée par les « peones » et les « picadors »]. J’ai découpé dans la fatigue de la route et les vicissitudes des huit compagnons de galère, les quatre actes du week-end de représentation de la tournée, veille d’armes, matin, habillage, combat ».
Il ne s’agit donc pas d’un roman (comme « Sang et lumières » ou « Guadalquivir ») sur le thème de la corrida, mais plutôt un reportage en forme d’hommage à ces hommes qui ont choisi ce métier où ils mettent leur vie en jeu.
C’est bien dans le genre de Joseph Peyré : non pas de cautionner ou pas cette pratique admirable ou monstrueuse, (suivant le côté où on se trouve), mais de souligner le côté humain de l’aventure : ce qui passionne Joseph Peyré, ici comme dans ses autres ouvrages : c’est la solitude de l’homme en face de la mort, cette solitude qui l’oblige à choisir le risque ou le défi. Face au taureau, face à la paroi de la montagne, face au désert, l’homme seul cherche sa vérité. Joseph Peyré, lui, cherche à comprendre ce qui pousse ces hommes de chair et de sang, mais aussi de courage et de peur, à mettre leur vie en danger pour se priver qu’ils sont vivants.
C’est en cela que Joseph Peyré est un humaniste. De cet humanisme qui unifie toute son œuvre.
Dans les années 30, Joseph Peyré pose les jalons – et déjà les premiers chefs-d’œuvre – de sa célébrité : il aborde successivement les trois grands thèmes de son inspiration : Le désert (« L’Escadron blanc » – 1931), L’Espagne (« Sang et lumières » – 1935) et la montagne (« Matterhorn » – 1939).
L’Espagne qu’il connaît en voisin (il est né à Aydie, en Béarn) à quelques encablures de la frontière) est sa deuxième patrie : il en saisit parfaitement l’âme, et en épouse, en ces périodes difficiles, tous les tourments. Il s’attache, dans son œuvre romanesque, à la présenter sous ses divers aspects, du plus folklorique au plus tragique :
« Sang et lumières » (1935) racontait la tragédie intime d’un homme. Pas n’importe quel homme : un Espagnol et un torero. C’est-à-dire un concentré d’émotions fortes, d’orgueil, de virilité, et en même temps de faiblesse, parce que soumis à toutes les passions humaines.
« L’homme de choc » (1936) était plus qu’un roman, une « docufiction » qui relatait l’insurrection (historique) des Asturies en 1934, prélude à la guerre civile : c’est à la fois un portrait d’hommes et de femmes exceptionnels – très « espagnols » de caractère, comme il se doit – mais c’est aussi le portrait d’une Espagne éternelle, qui se bat pour une forme de liberté – et se déchire.
Après ces deux romans très forts, Joseph Peyré revient, en 1937, à un romanesque, un peu plus classique : « Roc-Gibraltar » se présente comme le portrait d’une femme prise en étau entre trois hommes : son mari, malade et aigri, Félipe, un jeune révolutionnaire, jeune et beau, qui lui apporte une bouffée d’oxygène, et le notaire Olivieri qui a des vues sur elle (financières, mais pas que !). Le tout dans le cadre à la fois majestueux et impressionnant du rocher de Gibraltar, masse sombre et grise, qui semble oppresser les habitants de la cité.
« Calmé pour quelques heures, le remous éternel du vent laissait la brume des deux mers se refermer sur la langue de terre qui joint Gibraltar à l'Espagne ».
Il y a cette dimension « spatiale » dans ce roman : l’écrasement du rocher sur la ville donne une impression d’étouffement – ce que ressent Marthe-Marie d’un bout à l’autre du roman. Et en même temps, la mer – le détroit de Gibraltar – fait un pont entre l’Europe et l’Afrique (deux terres ô combien chères à l’auteur !) et évoque le grand large…
« Roc-Gibraltar » est donc, par rapport aux romans qui le précèdent, un peu plus « à la mode » du roman psychologique plus ou moins convenu. Si l’intrigue n’est pas très originale, elle est bien appuyée sur des descriptions tour à tour sombres et lumineuses, et comme d’habitude sur un style souple et élégant, merveilleusement évocateur.
Joseph Peyré est, avec Pierre Benoit, un de ces romanciers des années 30, à la fois témoins et conteurs, disposant d’une grande palette artistique, alliant une belle imagination à un style quasi parfait, dans une langue – le français – qui trouve chez eux sa meilleure expression.
Joseph Peyré, on le sait, n’était pas un grand montagnard, pourtant il a écrit deux des plus grands livres sur la montagne : « Matterhorn » (1939) et « Mont-Everest » (1942). Au point que Roger Frison-Roche (qui sur ce point est un peu une référence) a dit de lui : « Un grand merci, Joseph Peyré, pour m'avoir fortifié par ces récits prémonitoires de la montagne et des déserts, qui m'ont dicté ma propre aventure ».
Il y a une certaine continuité entre ces deux romans : le thème, d’abord : l’ascension d’une montagne mythique, avec tout ce que cela implique au niveau personnel, relationnel, et même spirituel, et ensuite, le fait que ce soit le même héros apporte une cohérence à l’œuvre, semblant dire que chaque ascension est différente, et en même temps, ressemble à la précédente, parce que toute ascension est une remise en question.
L’Everest ne sera vaincu qu’en 1953 (le 29 mai exactement, je m’en souviens comme si c’était hier), par un anglais Sir Edmund Hillary, et le sherpa Tensing Norgay. Le roman, écrit en 1942, est donc pour le moins un roman d’anticipation.
L’expédition de 1953, était la neuvième. Celle (imaginaire) de 1942, se place après deux expéditions tout aussi mythiques en 1922 et 1924. Celle de 1922, conduite par Charles Bruce et Edward Lisle Strutt, avec parmi ses membres un enseignant, George Mallory, intéressa particulièrement Joseph Peyré qui consacra son à ce dernier son troisième roman de montagne « Mallory et son Dieu ».
Il y a deux différences essentielles entre le Matterhorn et l’Everest : la taille, bien entendu (4478 m pour le premier, 8849 m pour le second, ce n’est pas tout à fait la même catégorie), et puis le fait que le Matterhorn a déjà était vaincu alors que l’Everest était encore d’une blancheur… virginale. Il y a donc d’un roman à l’autre un élément nouveau : l’attrait (et la crainte en même temps) de l’inconnu, auquel il faut peut-être ajouter « l’exploit », l’occasion d’inscrire son nom dans l’histoire de l’alpinisme.
La cordée comprend trois hommes : le chef de l’expédition, un Hindou appelé Jewar Singh, en quête mystique autant que sportive, Macpherson, un vieil écossais irascible et à la tête de bois, et enfin Jos-Mari, notre guide suisse, hercule au grand cœur, aussi attentif aux porteurs sherpas, admirables de dévouement, qu’à ses compagnons de cordée. Les différences de caractères se font vite sentir. Et la montagne n’a pas dit son dernier mot…
« Mont-Everest » est bien plus qu’un roman de montagne. Il s’agit ici d’une quête initiatique. (C’était déjà le cas sur le Matterhorn, où les personnages, en quelque sorte, se cherchaient eux-mêmes, mais ici c’est à une autre échelle). La montagne est allégorique, sa conquête symbolise à elle seule tout ce à quoi l’Homme rêve d’aboutir : l’absolu, le bonheur, la sérénité, la communion universelle entre l’Homme et l’Univers, la pureté des neiges éternelles… En même temps, on n’a rien sans rien, il faut souffrir pour y arriver, parfois tomber et repartir (quand on peut), et ne voir le sommet que dans le brouillard, sans être tout à fait sûr du bon chemin…
Joseph Peyré manie à la perfection ces deux outils : le documentaire technique, reportage « sportif » digne des « Coulisses de l’exploit » (ça rappellera des souvenirs à quelques-uns), et la réflexion personnelle sur le sens de la vie, l’engagement, la relation avec les autres… Et en prime de jolies descriptions qui, sans faire « couleur locale », nous plongent d’autant plus dans l’action du roman
Un grand roman de Joseph Peyré à placer dans votre bibliothèque à côté de « Matterhorn » et de « Mallory et son Dieu » (si vous le trouvez), des grands romans de Roger Frison-Roche, ainsi que du très beau livre de Pierre Moustiers « La Paroi ».
Il y a une certaine continuité entre ces deux romans : le thème, d’abord : l’ascension d’une montagne mythique, avec tout ce que cela implique au niveau personnel, relationnel, et même spirituel, et ensuite, le fait que ce soit le même héros apporte une cohérence à l’œuvre, semblant dire que chaque ascension est différente, et en même temps, ressemble à la précédente, parce que toute ascension est une remise en question.
L’Everest ne sera vaincu qu’en 1953 (le 29 mai exactement, je m’en souviens comme si c’était hier), par un anglais Sir Edmund Hillary, et le sherpa Tensing Norgay. Le roman, écrit en 1942, est donc pour le moins un roman d’anticipation.
L’expédition de 1953, était la neuvième. Celle (imaginaire) de 1942, se place après deux expéditions tout aussi mythiques en 1922 et 1924. Celle de 1922, conduite par Charles Bruce et Edward Lisle Strutt, avec parmi ses membres un enseignant, George Mallory, intéressa particulièrement Joseph Peyré qui consacra son à ce dernier son troisième roman de montagne « Mallory et son Dieu ».
Il y a deux différences essentielles entre le Matterhorn et l’Everest : la taille, bien entendu (4478 m pour le premier, 8849 m pour le second, ce n’est pas tout à fait la même catégorie), et puis le fait que le Matterhorn a déjà était vaincu alors que l’Everest était encore d’une blancheur… virginale. Il y a donc d’un roman à l’autre un élément nouveau : l’attrait (et la crainte en même temps) de l’inconnu, auquel il faut peut-être ajouter « l’exploit », l’occasion d’inscrire son nom dans l’histoire de l’alpinisme.
La cordée comprend trois hommes : le chef de l’expédition, un Hindou appelé Jewar Singh, en quête mystique autant que sportive, Macpherson, un vieil écossais irascible et à la tête de bois, et enfin Jos-Mari, notre guide suisse, hercule au grand cœur, aussi attentif aux porteurs sherpas, admirables de dévouement, qu’à ses compagnons de cordée. Les différences de caractères se font vite sentir. Et la montagne n’a pas dit son dernier mot…
« Mont-Everest » est bien plus qu’un roman de montagne. Il s’agit ici d’une quête initiatique. (C’était déjà le cas sur le Matterhorn, où les personnages, en quelque sorte, se cherchaient eux-mêmes, mais ici c’est à une autre échelle). La montagne est allégorique, sa conquête symbolise à elle seule tout ce à quoi l’Homme rêve d’aboutir : l’absolu, le bonheur, la sérénité, la communion universelle entre l’Homme et l’Univers, la pureté des neiges éternelles… En même temps, on n’a rien sans rien, il faut souffrir pour y arriver, parfois tomber et repartir (quand on peut), et ne voir le sommet que dans le brouillard, sans être tout à fait sûr du bon chemin…
Joseph Peyré manie à la perfection ces deux outils : le documentaire technique, reportage « sportif » digne des « Coulisses de l’exploit » (ça rappellera des souvenirs à quelques-uns), et la réflexion personnelle sur le sens de la vie, l’engagement, la relation avec les autres… Et en prime de jolies descriptions qui, sans faire « couleur locale », nous plongent d’autant plus dans l’action du roman
Un grand roman de Joseph Peyré à placer dans votre bibliothèque à côté de « Matterhorn » et de « Mallory et son Dieu » (si vous le trouvez), des grands romans de Roger Frison-Roche, ainsi que du très beau livre de Pierre Moustiers « La Paroi ».
Une merveille ! Une histoire d'Amour avec un cortège de soucis sur fond d'enfer des jeux d'argent, de jalousie, de dettes, d'alcool, même d'envies de meurtres ! Tout ceci avec en image de fond, la montagne, un Hôtel ou de riches vacanciers viennent passer des vacances et ont l'habitude de se retrouver...Les relations entre les personnages clés du roman se fondent, s'aiment ou se trahissent, se séparent. Un superbe roman, je croyais à un simple roman d'amour en le commençant, mais c'est bien plus que ça...C'est un roman de tempête de sentiments poussés à l'extrème ! Comme ces tempêtes de neige qui sévissent autour de l'hôtel ou nos héros séjournent....
Plaidoyer pour la présence française au Sahara à l'heure du dé-colonialisme, ce court essai entreprend de brosser une rapide histoire du Sahara français en faisant une intéressante comparaison entre la conquête de ce désert et la politique de la frontière des États-Unis: deux approches très différentes et deux issues qui le sont tout autant.
Mon premier Joseph Peyré. J’avais douze ans. C’était comme sur la photo de Babélio une BV (Bibliothèque verte), mais l’ancienne édition, souple, qui datait, comme on dit chez nous « de la reine Jeanne » (Jeanne d’Albret, la mère d’Henri IV, ce qui ne nous rajeunit pas vraiment).
C’est le seul ouvrage, à ma connaissance, que Joseph Peyré ait écrit directement pour la jeunesse. Mais d’autres œuvres ont été adaptées, dont « L’Escadron Blanc » (BV et Idéal-Bibliothèque), « Mont-Everest » (BV) et d’autres moins connus, qui n’ont pas été souvent réimprimés comme « Le Chef à l’étoile d’argent », « Sous l’étendard vert », « Sahara », ou « Aïno » (BV première série pour la plupart).
Le titre, quand on le lit en entier, est explicite : Cheval piaffant n’est pas un équidé (même pas un pottok (prononcez pottiok), ces jolis petits poneys du Pays Basque), c’est un homme, un Basque, originaire d’un village perdu près de Saint-Etienne de Baïgorry (grande banlieue de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour ceux qui ne connaissent pas). Il fait partie de ces milliers d’émigrants qui à la fin du XIXème siècle prirent le chemin de l’Amérique (du Nord et du Sud) en quête d’un Eldorado, souvent décevant, mais pour certains plus souriant.
Pour échapper à la maréchaussée, à la suite d’une rixe de village, Sauveur Etchemendy (de la maison de la montagne, littéralement, et Sauveur, quel beau prénom !) se voit dans l’obligation d’émigrer en Amérique du Sud. Passager clandestin sur un voilier, il est reconnu et sert d’homme à tout faire sur le bateau. Grâce à sa force et à son bon caractère (bien que têtu et ombrageux) il s’attire les faveurs de l’équipage, mais tient tout de même à débarquer à Buenos-Aires au lieu de continuer sa route. Retrouvant des compatriotes, il devient gaucho en Uruguay, puis ayant entendu parler de la ruée vers l’or en Californie, il part vers la Terre promise, en passant par les Andes. Arrivé aux Etats-Unis, il prospecte avec plus ou moins de bonheur et se fritte avec les autres mineurs, émigrants comme lui, mais irlandais, ou écossais pour la plupart. Il repart vers l’est où il devient berger chez les Mormons, puis continue sa route à l’intérieur des terres indiennes. C’est en défendant un vieux bison attaqué par une meute de loups blancs qu’il s’attire la sympathie des indiens Cherokees (Les Cherokees ou Creeks sont une tribu amérindienne, située dans l’Est et le Sud-est des Etats-Unis, c’est par erreur que le titre parle de Sioux, cette tribu étant plutôt fixée dans les Grandes Plaines au centre du pays). « Cheval piaffant » est le nom honorifique et respectueux que les Indiens donnent à notre ami Sauveur. Mais il pense au pays, à sa mère, au curé Kochepa qui lui a tout appris, et à sa fiancée, Kattalin…
L’histoire de Sauveur, c’est celle de milliers d’émigrants qui ont fait le voyage dans des conditions parfois très difficiles pour un pays neuf qui ne leur a pas toujours réussi. On estime que plusieurs milliers de jeunes gens, poussés par l’aventure, mais plus souvent encore par la nécessité, ont pris le chemin de l’Amérique.
Joseph Peyré a déjà abordé ce sujet dans le très beau « Jean le Basque » (1953). Dans « Cheval piaffant », il écrit à l’intention des jeunes un magnifique roman d’aventures, qui au-delà, est également un plaidoyer contre l’injustice et les inégalités, notamment racistes. Les vertus inculquées à Sauveur par son peuple basque (héritées de sa mère et du curé), se conjuguent avec la sagesse cherokee : « Cheval piaffant » se veut également un hymne à la tolérance.
C’est le seul ouvrage, à ma connaissance, que Joseph Peyré ait écrit directement pour la jeunesse. Mais d’autres œuvres ont été adaptées, dont « L’Escadron Blanc » (BV et Idéal-Bibliothèque), « Mont-Everest » (BV) et d’autres moins connus, qui n’ont pas été souvent réimprimés comme « Le Chef à l’étoile d’argent », « Sous l’étendard vert », « Sahara », ou « Aïno » (BV première série pour la plupart).
Le titre, quand on le lit en entier, est explicite : Cheval piaffant n’est pas un équidé (même pas un pottok (prononcez pottiok), ces jolis petits poneys du Pays Basque), c’est un homme, un Basque, originaire d’un village perdu près de Saint-Etienne de Baïgorry (grande banlieue de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour ceux qui ne connaissent pas). Il fait partie de ces milliers d’émigrants qui à la fin du XIXème siècle prirent le chemin de l’Amérique (du Nord et du Sud) en quête d’un Eldorado, souvent décevant, mais pour certains plus souriant.
Pour échapper à la maréchaussée, à la suite d’une rixe de village, Sauveur Etchemendy (de la maison de la montagne, littéralement, et Sauveur, quel beau prénom !) se voit dans l’obligation d’émigrer en Amérique du Sud. Passager clandestin sur un voilier, il est reconnu et sert d’homme à tout faire sur le bateau. Grâce à sa force et à son bon caractère (bien que têtu et ombrageux) il s’attire les faveurs de l’équipage, mais tient tout de même à débarquer à Buenos-Aires au lieu de continuer sa route. Retrouvant des compatriotes, il devient gaucho en Uruguay, puis ayant entendu parler de la ruée vers l’or en Californie, il part vers la Terre promise, en passant par les Andes. Arrivé aux Etats-Unis, il prospecte avec plus ou moins de bonheur et se fritte avec les autres mineurs, émigrants comme lui, mais irlandais, ou écossais pour la plupart. Il repart vers l’est où il devient berger chez les Mormons, puis continue sa route à l’intérieur des terres indiennes. C’est en défendant un vieux bison attaqué par une meute de loups blancs qu’il s’attire la sympathie des indiens Cherokees (Les Cherokees ou Creeks sont une tribu amérindienne, située dans l’Est et le Sud-est des Etats-Unis, c’est par erreur que le titre parle de Sioux, cette tribu étant plutôt fixée dans les Grandes Plaines au centre du pays). « Cheval piaffant » est le nom honorifique et respectueux que les Indiens donnent à notre ami Sauveur. Mais il pense au pays, à sa mère, au curé Kochepa qui lui a tout appris, et à sa fiancée, Kattalin…
L’histoire de Sauveur, c’est celle de milliers d’émigrants qui ont fait le voyage dans des conditions parfois très difficiles pour un pays neuf qui ne leur a pas toujours réussi. On estime que plusieurs milliers de jeunes gens, poussés par l’aventure, mais plus souvent encore par la nécessité, ont pris le chemin de l’Amérique.
Joseph Peyré a déjà abordé ce sujet dans le très beau « Jean le Basque » (1953). Dans « Cheval piaffant », il écrit à l’intention des jeunes un magnifique roman d’aventures, qui au-delà, est également un plaidoyer contre l’injustice et les inégalités, notamment racistes. Les vertus inculquées à Sauveur par son peuple basque (héritées de sa mère et du curé), se conjuguent avec la sagesse cherokee : « Cheval piaffant » se veut également un hymne à la tolérance.
Croix du Sud est le récit d'un homme qui est tombé amoureux du désert. Celui-ci préfère une vie en solitaire, comme nomade, à une vie en ville où il doit côtoyer des bavards, des arrivistes, des gens qui ne comprennent pas sa fascination pour le désert.
Une jeune femme tente de s'intéresser à lui, elle semble le comprendre. Mais une fois qu'il est reparti dans le désert, il n'y a plus que celui-ci, avec sa vie particulière, avec sa solitude, qui compte.
Brécourt représente un corps qui a vocation à disparaitre : les méharistes. Face à la mécanisation et l'arrivée de camions en plein Sahara, les caravanes de méharis vivent leurs derniers jours. C'est un corps qui pour Brécourt représente une certaine excellence. Il refuse que certains officiers en portent l'uniforme car il estime qu'ils ne le méritent pas.
Le style de Peyré est assez lapidaire. Il est un peu déroutant au début mais le rythme du roman permet de faire oublier ça. Peyré préfère l'évocation à la description. Lorsqu'un lieu, une ambiance, un personnage sont décrits, cela est fait brièvement par quelques mots juste mis les uns à côté des autres. Ce qui donne une sécheresse au récit. Sécheresse qui colle à l'ambiance du désert et au style de vie économe des Touaregs. Mais le style sec m'a déçu quant à la fin. Une fois arrivé au terme du récit je n'ai pas su à quoi m'en tenir, ça m'a donné l'impression d'être un peu bâclé, fini un peu trop vite.
Une jeune femme tente de s'intéresser à lui, elle semble le comprendre. Mais une fois qu'il est reparti dans le désert, il n'y a plus que celui-ci, avec sa vie particulière, avec sa solitude, qui compte.
Brécourt représente un corps qui a vocation à disparaitre : les méharistes. Face à la mécanisation et l'arrivée de camions en plein Sahara, les caravanes de méharis vivent leurs derniers jours. C'est un corps qui pour Brécourt représente une certaine excellence. Il refuse que certains officiers en portent l'uniforme car il estime qu'ils ne le méritent pas.
Le style de Peyré est assez lapidaire. Il est un peu déroutant au début mais le rythme du roman permet de faire oublier ça. Peyré préfère l'évocation à la description. Lorsqu'un lieu, une ambiance, un personnage sont décrits, cela est fait brièvement par quelques mots juste mis les uns à côté des autres. Ce qui donne une sécheresse au récit. Sécheresse qui colle à l'ambiance du désert et au style de vie économe des Touaregs. Mais le style sec m'a déçu quant à la fin. Une fois arrivé au terme du récit je n'ai pas su à quoi m'en tenir, ça m'a donné l'impression d'être un peu bâclé, fini un peu trop vite.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Joseph Peyré
Quiz
Voir plus
Karine Giebel ou Barbara Abel
Je sais pas ?
Karine Giebel
Barbara Abel
10 questions
66 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur66 lecteurs ont répondu