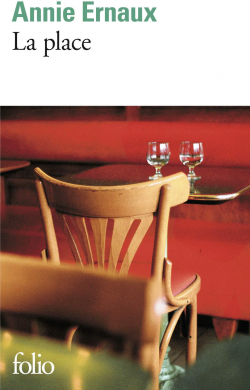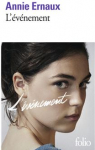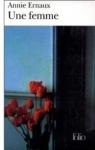Roman autobiographique relativement cours de l'auteure. Une connaissance partielle du père mais compensée par une description pleine d'amour pour ce papa ouvrier devenu commerçant. Une époque révolue cercle cette histoire. 4/5 pour toute la tendresse qui se dégage de ce livre.
J'ai déjà lu plusieurs Annie Ernaux suite à son prix Nobel.
D'abord parce que j'ai été choquée par la vague de détestation qui s'est brisée sur elle. (Je n'ai aucun doute que ce n'est pas juste lié à son style, à sa classe mais au fait qu'elle est une femme.)
Et ensuite parce que son parcours me parle.
Je suis née en Bretagne de parents ouvrier / petit fonctionnaire. J'ai fait des études supérieures et j'ai travaillé pour une société internationale de nombreuses années à des postes tant en France qu'à l'étranger. Je suis une femme et une transfuge de classe.
J'ai toujours eu le sentiment d'avoir « le cul entre deux chaises. » C'est-à-dire le sentiment de ne plus faire vraiment partie de mon milieu d'origine mais de ne pas appartenir vraiment pour autant à celui où j'ai évolué à l'international. Bref un vif sentiment de différence.
Avec les années, j'ai réalisé plusieurs choses :
1- Finalement venir d'ailleurs a été un avantage car cela m'a permis d'oser, j'avais peu d'injonctions de la part de mes parents sur ce que je devais être. Alors que les femmes, qui venaient de familles plus riches avaient des obligations de devenir des « Femmes de ».
2- J'ai parfois senti de la honte de mes origines, de mes parents, parfois de la fierté, parfois en même temps… Tout n'est pas blanc et noir.
3- Il y a des choses biens et moins biens dans tous les milieux dans lesquels j'ai vécu. Je ne glorifie ni les uns, ni les autres. J'ai eu / reçu des encouragements et des coups bas des deux cotés (et pas toujours d'où je les attendais).
4- Tout cela m'a pris beaucoup d'années pour être en paix avec ceci.
Lire des livres comme ceux de A Ernaux peuvent permettre à certain.e.s de réaliser / confirmer qu'ils n'étaient pas seul.e.s.
Tout cela pour dire que « La Place » a vraiment raisonné en moi. J'ai également lu les critiques sur Babelio, dont certaines montrent une susceptibilité à fleur de peau…
L'écriture plate est reprochée à A Ernaux. Je comprends parfaitement ce parti pris. Dans le milieu que décrit A Ernaux, l'art n'existe pas en tant que tel. Il n'y a pas de temps, de ressources, d'apprentissage de l'art pour la génération de mes parents là d'où je viens.
« Par la suite, j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal. Sensation de dégout au milieu du récit.
Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour reprendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de « passionnant », ou d' »émouvant ». Je rassemblerai les paroles, les gestes, les gouts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée.
Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais autrefois en écrivant à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. »
J'aimerais citer ces phrases parce que j'y reconnais mon enfance et surtout mon père. Et je trouve intéressant que le prix Nobel récompense ce type de livre car c'est une partie de la société Française des années 1960/1980.
« Quand je lis Proust ou Mauriac, je ne crois pas qu'ils évoquent le temps où mon père était enfant. Son cadre à lui c'est le Moyen Age. »
Petit aparté Cette réflexion, je me la suis faite en lisant Proust. Il décrit une vie de gosse de famille riche… Il est en admiration devant l'aristocratie (même si…). Mais dans le milieu que décrit A Ernaux, on est au mieux en admiration devant les enfants du vétérinaire… Et oui les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque alors on n'enviait pas les ultra riches... mais ceux que l'on imaginait riche (parfois à tort.).
« Ils n'ont pu se fréquenter tout de suite, ma grand-mère ne voulait qu'on lui prenne ses filles trop tôt, à chaque fois, c'était les trois quarts d'une paie qui s'en allait. »
Dans le cas de ma mère, elle nous a souvent raconté que ses parents lui avaient pris toute sa paie du mois de mars et qu'ils s'attendaient vaguement à ce qu'elle continue à en verser une partie après son mariage….
« Voie étroite, en écrivant, entre la réhabilitation d'un mode de vie considéré comme intérieur, et la dénonciation de l'aliénation qui l'accompagne. Parce que ces façons de vivre étaient à nous, un bonheur même, mais aussi des barrières humiliantes de notre condition (conscience que « ce n'est pas assez bien chez nous »), je voudrais dire à la fois le bonheur et l'aliénation. Impression, bien plutôt de tanguer d'un bord à l'autre de cette contradiction. »
« Comment décrire la vision d'un monde où tout coute cher. »
« Obsession : « qu'est-ce que l'on va penser de nous ? »
« Avoir un jardin sale, aux légumes mal soignés indiquait un laisser-aller de mauvais aloi, comme se négliger sur sa personne ou trop boire. »
« Me voir laisser de la nourriture dans l'assiette lui faisait deuil. »
Tout cela mon père l'a dit ou fait…
alors merci madame Ernaux d'avoir écrit « La Place ».
Je ne partage pas toutes vos opinions ou vos engagements mais je trouve vos ouvrages nécessaires car rares dans le monde littéraire actuel.
D'abord parce que j'ai été choquée par la vague de détestation qui s'est brisée sur elle. (Je n'ai aucun doute que ce n'est pas juste lié à son style, à sa classe mais au fait qu'elle est une femme.)
Et ensuite parce que son parcours me parle.
Je suis née en Bretagne de parents ouvrier / petit fonctionnaire. J'ai fait des études supérieures et j'ai travaillé pour une société internationale de nombreuses années à des postes tant en France qu'à l'étranger. Je suis une femme et une transfuge de classe.
J'ai toujours eu le sentiment d'avoir « le cul entre deux chaises. » C'est-à-dire le sentiment de ne plus faire vraiment partie de mon milieu d'origine mais de ne pas appartenir vraiment pour autant à celui où j'ai évolué à l'international. Bref un vif sentiment de différence.
Avec les années, j'ai réalisé plusieurs choses :
1- Finalement venir d'ailleurs a été un avantage car cela m'a permis d'oser, j'avais peu d'injonctions de la part de mes parents sur ce que je devais être. Alors que les femmes, qui venaient de familles plus riches avaient des obligations de devenir des « Femmes de ».
2- J'ai parfois senti de la honte de mes origines, de mes parents, parfois de la fierté, parfois en même temps… Tout n'est pas blanc et noir.
3- Il y a des choses biens et moins biens dans tous les milieux dans lesquels j'ai vécu. Je ne glorifie ni les uns, ni les autres. J'ai eu / reçu des encouragements et des coups bas des deux cotés (et pas toujours d'où je les attendais).
4- Tout cela m'a pris beaucoup d'années pour être en paix avec ceci.
Lire des livres comme ceux de A Ernaux peuvent permettre à certain.e.s de réaliser / confirmer qu'ils n'étaient pas seul.e.s.
Tout cela pour dire que « La Place » a vraiment raisonné en moi. J'ai également lu les critiques sur Babelio, dont certaines montrent une susceptibilité à fleur de peau…
L'écriture plate est reprochée à A Ernaux. Je comprends parfaitement ce parti pris. Dans le milieu que décrit A Ernaux, l'art n'existe pas en tant que tel. Il n'y a pas de temps, de ressources, d'apprentissage de l'art pour la génération de mes parents là d'où je viens.
« Par la suite, j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal. Sensation de dégout au milieu du récit.
Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour reprendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de « passionnant », ou d' »émouvant ». Je rassemblerai les paroles, les gestes, les gouts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée.
Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais autrefois en écrivant à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. »
J'aimerais citer ces phrases parce que j'y reconnais mon enfance et surtout mon père. Et je trouve intéressant que le prix Nobel récompense ce type de livre car c'est une partie de la société Française des années 1960/1980.
« Quand je lis Proust ou Mauriac, je ne crois pas qu'ils évoquent le temps où mon père était enfant. Son cadre à lui c'est le Moyen Age. »
Petit aparté Cette réflexion, je me la suis faite en lisant Proust. Il décrit une vie de gosse de famille riche… Il est en admiration devant l'aristocratie (même si…). Mais dans le milieu que décrit A Ernaux, on est au mieux en admiration devant les enfants du vétérinaire… Et oui les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque alors on n'enviait pas les ultra riches... mais ceux que l'on imaginait riche (parfois à tort.).
« Ils n'ont pu se fréquenter tout de suite, ma grand-mère ne voulait qu'on lui prenne ses filles trop tôt, à chaque fois, c'était les trois quarts d'une paie qui s'en allait. »
Dans le cas de ma mère, elle nous a souvent raconté que ses parents lui avaient pris toute sa paie du mois de mars et qu'ils s'attendaient vaguement à ce qu'elle continue à en verser une partie après son mariage….
« Voie étroite, en écrivant, entre la réhabilitation d'un mode de vie considéré comme intérieur, et la dénonciation de l'aliénation qui l'accompagne. Parce que ces façons de vivre étaient à nous, un bonheur même, mais aussi des barrières humiliantes de notre condition (conscience que « ce n'est pas assez bien chez nous »), je voudrais dire à la fois le bonheur et l'aliénation. Impression, bien plutôt de tanguer d'un bord à l'autre de cette contradiction. »
« Comment décrire la vision d'un monde où tout coute cher. »
« Obsession : « qu'est-ce que l'on va penser de nous ? »
« Avoir un jardin sale, aux légumes mal soignés indiquait un laisser-aller de mauvais aloi, comme se négliger sur sa personne ou trop boire. »
« Me voir laisser de la nourriture dans l'assiette lui faisait deuil. »
Tout cela mon père l'a dit ou fait…
alors merci madame Ernaux d'avoir écrit « La Place ».
Je ne partage pas toutes vos opinions ou vos engagements mais je trouve vos ouvrages nécessaires car rares dans le monde littéraire actuel.
- Exercice périlleux de décrire l'originalité d'un homme en faisant de son époque et de son milieu social des caractéristiques essentielles.
- Utilise le miroir que lui fournit ses parents pour se définir par rapport à eux
- Un autre des essais d'Annie Ernaux pour retenir le temps ?
- Aborde la question du mépris de classe intériorisé des classes sociales dites "inférieures"
- Ne cherche pas à attirer la sympathie du lecteur sur sa personne, c'est davantage le couple de ses parents qui en bénéficie
- Utilise le miroir que lui fournit ses parents pour se définir par rapport à eux
- Un autre des essais d'Annie Ernaux pour retenir le temps ?
- Aborde la question du mépris de classe intériorisé des classes sociales dites "inférieures"
- Ne cherche pas à attirer la sympathie du lecteur sur sa personne, c'est davantage le couple de ses parents qui en bénéficie
- LA PLACE-
Je voulais découvrir un texte de cette autrice et c'est celui qui m'a était le plus recommandée, son écriture était assez simple et élaboré mais aussi je vois les message que essaye passer l'autrice sur la différence classe sociales que son père ne lisait pas des livres ou que encore il n'avait pas bougé de son village.
Le livre n'a pas vraiment marché sur moi car peut-être cela est lié à mon vécu ou encore à mes expériences. Mais je ne qualifierai pas le livre de mauvais, non il ne l'est pas, c'est juste moi qui n'a pas accroché avec l'histoire.
Alors je le conseillerai à toute personne qui s'intéresse aux classes sociales et aux caste de nos jours ou plutôt des années 80.
Carlaines
Je voulais découvrir un texte de cette autrice et c'est celui qui m'a était le plus recommandée, son écriture était assez simple et élaboré mais aussi je vois les message que essaye passer l'autrice sur la différence classe sociales que son père ne lisait pas des livres ou que encore il n'avait pas bougé de son village.
Le livre n'a pas vraiment marché sur moi car peut-être cela est lié à mon vécu ou encore à mes expériences. Mais je ne qualifierai pas le livre de mauvais, non il ne l'est pas, c'est juste moi qui n'a pas accroché avec l'histoire.
Alors je le conseillerai à toute personne qui s'intéresse aux classes sociales et aux caste de nos jours ou plutôt des années 80.
Carlaines
J'ai trouvé beaucoup de critiques dans ce livre, une frontière nette entre le monde des bourgeois et celui de la classe ouvrière. Certes, c'est tout le sujet du livre mais j'ai parfois ressenti un malaise. L'écriture désorganisée m'a aussi gênée. Je suis mitigée sur cette lecture.
Cette lecture de "La Place "d'Annie Ernaux m'a pas laissé perplexe. le style dépouillé de l'auteure, écriture plate dirons certains, traduit bien le sentiment de tristesse de la jeune fille qui, au fond, éprouve une sorte de honte envers sa condition sociale en se comparant à ses camarades d' Yvetot en Normandie. Un regard froid et détaché, presque clinique sur sa jeunesse. Ce roman est l'archétype de la démarche sociologisante de l'auteure et de son interrogation sur sa trajectoire sociale avec en exergue du roman cette phrase de Jean Genet “ je hasarde une explication: écrire c'est le dernier recours quand on a trahi”. On découvre aussi la distance qui se creuse avec son père qui lui disait “ les livres et la musique, c'est bon pour toi. Moi je n'en ai pas besoin pour vivre”. Beaucoup de lecteur pourront ce retrouver dans cette description d'une certaine souffrance. Mais doit-on pour autant ne pas dépasser ce ressenti?
Ce qui me déplaît dans ce roman, c'est précisément ce regard froid et distancié, dépourvu d'émotions, où le ressentiment de classe l'emporte sur tout le reste. Pour résumer en paraphrasant Spinoza, dans toutes les sociétés, il existe une tension interne entre, d'une part, les « passions tristes » – la haine, la vengeance, le ressentiment, l'envie, la peur – et, de l'autre, les « passions joyeuses » – la bienveillance, la compassion, le respect et la sympathie. Certes on peut comprendre le ressenti de celle qui a déclaré à Stockholm, lors de la remise de son prix Nobel, “j'ai vengé ma race”, mais, pour moi se complaire dans ce ressenti et ne rester qu'à ce stade de perception conduit inévitablement à une radicalité subversive débouchant sur un enferment de soi-même.
Ce qui me déplaît dans ce roman, c'est précisément ce regard froid et distancié, dépourvu d'émotions, où le ressentiment de classe l'emporte sur tout le reste. Pour résumer en paraphrasant Spinoza, dans toutes les sociétés, il existe une tension interne entre, d'une part, les « passions tristes » – la haine, la vengeance, le ressentiment, l'envie, la peur – et, de l'autre, les « passions joyeuses » – la bienveillance, la compassion, le respect et la sympathie. Certes on peut comprendre le ressenti de celle qui a déclaré à Stockholm, lors de la remise de son prix Nobel, “j'ai vengé ma race”, mais, pour moi se complaire dans ce ressenti et ne rester qu'à ce stade de perception conduit inévitablement à une radicalité subversive débouchant sur un enferment de soi-même.
C'est étrangement le premier livre que je lis d'Annie Ernaux. Publié en 1983, il a reçu le prix Renaudot, l'année suivante.
Tout commence par le décès de son père. L'auteur fait le portrait de celui-ci, né en Normandie dans une famille de journaliers agricoles qui deviendra ouvrier avant de se marier et d'ouvrir un café-épicerie à Yvetot. Sa vie fut une lutte continuelle pour s'élever et ne pas retomber dans ses origines.
C'est une description touchante de la relation père-fille et de cet éloignement incontournable lorsque l'auteur part faire ses études. Comment, fille de commerçant, elle accède au monde de la culture et du savoir à travers l'école. Elle prendra le relais du rêve de son père mais le fossé entre les deux mondes se creusera.
Ce livre, á l'écriture dépouillée, est un hommage à son père . Un récit court où la honte d'avoir des parents simples se transforme en respect et fierté.
Tout commence par le décès de son père. L'auteur fait le portrait de celui-ci, né en Normandie dans une famille de journaliers agricoles qui deviendra ouvrier avant de se marier et d'ouvrir un café-épicerie à Yvetot. Sa vie fut une lutte continuelle pour s'élever et ne pas retomber dans ses origines.
C'est une description touchante de la relation père-fille et de cet éloignement incontournable lorsque l'auteur part faire ses études. Comment, fille de commerçant, elle accède au monde de la culture et du savoir à travers l'école. Elle prendra le relais du rêve de son père mais le fossé entre les deux mondes se creusera.
Ce livre, á l'écriture dépouillée, est un hommage à son père . Un récit court où la honte d'avoir des parents simples se transforme en respect et fierté.
Petit récit autobiographique qui m'a attendrie, qui m'a émue. Elle raconte l'histoire de son père. On a l'impression (peut être parce que ce n'est pas qu'une impression) de lire son journal intime. Elle parle de son père de manière très tendre. On comprend les conflits internes qu'elle a pu ressentir à cause de son ascension sociale sans pour autant que ça soit trop en mode regardez comme je suis devenue une petite bourge (un peu quand même).
Le style est froid, descriptif, sans pathos. le lecteur en est prévenu dès les premières pages. Alors si vous voulez des émotions qui vous transportent, laissez tomber ce livre.
En revanche, si vous cherchez des éléments de compréhension de la vie des gens "modestes" dans les années 60, 70, ou avant la guerre, ce livre vous apportera des réponses.
Sans être Normande, j'ai retrouvé des points communs entre sa famille et la mienne ; ce livre peut aider à comprendre nos parents et grands parents, et je suis persuadée, pour qui se pose ces questions, que celà apporte dans la connaissance de soi.
En revanche, si vous cherchez des éléments de compréhension de la vie des gens "modestes" dans les années 60, 70, ou avant la guerre, ce livre vous apportera des réponses.
Sans être Normande, j'ai retrouvé des points communs entre sa famille et la mienne ; ce livre peut aider à comprendre nos parents et grands parents, et je suis persuadée, pour qui se pose ces questions, que celà apporte dans la connaissance de soi.
Elle raconte ses parents.
Les origines paysannes et ouvrières, le petit commerce de quartier (café-épicerie) acheté à crédit, la peur de manquer, de ne pas y arriver, la crainte du regard des autres, le souci de rester à sa place, toujours, pour ne pas attirer la jalousie ou l'envie.
Les repas silencieux, les remarques entre eux, faussement désobligeantes, par habitude, et le fossé qui peu à peu se creuse avec elle qui a fait des études. "Je me sens séparée de moi"...
C'est le récit de vies simples, laborieuses et frugales.
De la connection impossible entre son petit mari bourgeois, son métier de prof, son intérieur peuplé de meubles anciens et tendus de velours rouge.
Un texte épuré, posé, qui dit le respect, l'impuissance, l'écartellement.
Douloureux.
Les origines paysannes et ouvrières, le petit commerce de quartier (café-épicerie) acheté à crédit, la peur de manquer, de ne pas y arriver, la crainte du regard des autres, le souci de rester à sa place, toujours, pour ne pas attirer la jalousie ou l'envie.
Les repas silencieux, les remarques entre eux, faussement désobligeantes, par habitude, et le fossé qui peu à peu se creuse avec elle qui a fait des études. "Je me sens séparée de moi"...
C'est le récit de vies simples, laborieuses et frugales.
De la connection impossible entre son petit mari bourgeois, son métier de prof, son intérieur peuplé de meubles anciens et tendus de velours rouge.
Un texte épuré, posé, qui dit le respect, l'impuissance, l'écartellement.
Douloureux.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Annie Ernaux (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La place (Annie Ernaux)
De quel roman la narratrice doit-elle expliquer un passage pour les épreuves pratiques du Capes ?
Le Père Goriot
Madame Bovary
15 questions
170 lecteurs ont répondu
Thème : La place de
Annie ErnauxCréer un quiz sur ce livre170 lecteurs ont répondu