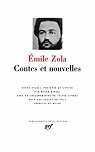Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Et si l'une des meilleures façons de plonger dans l'oeuvre d'un classique était de contourner momentanément ses romans pour découvrir sa correspondance, c'est-à-dire l'homme derrière la statue, l'homme mis à nu ?
La « Correspondance » de Flaubert, c'est à lire en poche chez Folio.

Gustave Flaubert
EAN : 9784798083179
Chapitre.com - Impression à la demande (01/01/2014)
/5
8 notes
Chapitre.com - Impression à la demande (01/01/2014)
Résumé :
Cet ouvrage est une réimpression à l'identique de l'édition originale numérisée par Gallica. Il est possible qu'il présente quelques défauts dus à l'état de l'ouvrage et au procédé de numérisation.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Par les champs et par les grèves (voyage)Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Flaubert a 24 ans , il part vagabonder en Bretagne « par les champs et par les grèves » avec son ami Maxime du Camp. le récit qu'il fait de ce périple ( un chapitre sur deux ,l'autre étant narré par du Camp) dévoile des aspects peu connus du romancier. Qu'il soit un prosateur exceptionnel nul ne l'ignore mais il est aussi un passionné d'histoire ,une observateur tour à tour empathique ou caustique des lieux traversés et des personnes rencontrés . C'est aussi un romantique pris d'exaltation au sein de la nature , ému aux larmes en découvrant les traces De Chateaubriand . C'est enfin un humoriste aux portraits parfois dignes de la Bruyère . Un plaisir de lecture .
Citations et extraits (20)
Voir plus
Ajouter une citation
On se pénètre de rayons, d’air pur, de pensées suaves et intraduisibles ; tout en vous palpite de joie et bat des ailes avec les éléments, on s’y attache, on respire avec eux, l’essence de la nature animée semble passée en vous dans un hymen exquis, vous souriez au bruit du vent qui fait remuer la cime des arbres, au murmure du flot sur la grève ; vous courez sur les mers avec la brise, quelque chose d’éthéré, de grand, de tendre plane dans la lumière même du soleil et se perd dans une immensité radieuse comme les vapeurs rosées du matin qui remontent vers le ciel.
Nous avons quitté la mer au port de Sagone, vieille ville dont on ne voit même pas les ruines, pour continuer notre route vers Vico, où nous sommes enfin arrivés le soir après dix heures de cheval. Nous avons logé chez un cousin de M. Multedo, grand homme blond et doux, parlant peu et se contentant de répéter souvent le même geste de main. Il s’est vaillamment battu contre les Anglais lorsque ceux-ci ont voulu faire une descente à Sagone ; il se sent tout prêt à recommencer. Il y a en effet dans la Corse une haine profonde pour l’Angleterre et un grand désir de le prouver. Sur la route que nous avons faite pour aller à Vico, des paysans nous arrêtaient.
— Va-t-on se battre, demandaient-ils ?
— C’est possible.
— Tant mieux.
— Et contre qui ?
— Contre les Anglais.
À ce mot ils bondissaient de joie et nous montraient en ricanant un poignard ou un pistolet, car un Corse ne voyage jamais sans être armé, soit par prudence ou par habitude. On porte le poignard soit attaché dans le pantalon, mis dans la poche de la veste, ou glissé dans la manche ; jamais on ne s’en sépare, pas même à la ville, pas même à table. Dans un grand dîner à la préfecture et où se trouvait réuni presque tout le conseil général, on m’a assuré que pas un des convives n’était sans son stylet. Le cocher qui nous a conduits à Bogogna tenait un grand pistolet chargé sous le coussin de sa voiture. Tous les bergers de la Corse manquent plutôt de chemise blanche que de lame affilée.
À Vico on commence à connaître ce que c’est qu’un village de la Corse. Situé sur un monticule, dans une grande vallée, il est dominé de tous les côtés par des montagnes qui l’entourent en entonnoir. Le système montagneux de la Corse à proprement parler, n’est point un système ; imaginez une orange coupée par le milieu, c’est là la Corse. Au fond de chaque vallée, de temps en temps un village, et pour aller au hameau voisin il faut une demi-journée de marche et passer quelquefois trois ou quatre montagnes. La campagne est partout déserte ; où elle n’est pas couverte de maquis, ce sont des plaines, mais on n’y rencontre pas plus d’habitations, car le paysan cultive encore son champ comme l’Arabe : au printemps il descend pour l’ensemencer, à l’automne il revient pour faire la moisson ; hors de là il se tient chez lui sans sortir deux fors par an de son rocher où il vit sans rien faire, paresseux, sobre et chaste. Vico est la patrie du fameux Théodore dont le nom retentit encore dans toute la Corse avec un éclat héroïque ; il a tenu douze ans le maquis, et n’a été tué qu’en trahison. C’était un simple paysan du pays, que tous aimaient et que tous aiment encore. Ce bandit-là était un noble cœur, un héros. Il venait d’être pris par la conscription et il restait chez lui attendant qu’on l’appelât ; le brigadier du lieu, son compère, lui avait promis de l’avertir à temps, quand un matin la force armée tombe chez lui et l’arrache de sa cabane au nom du roi. C’était le compère qui dirigeait sa petite compagnie et qui, pour se faire bien voir sans doute, voulut le mener rondement et prouver son zèle pour l’État en faisant le lâche et le traître. Dans la crainte qu’il ne lui échappât il lui mit les menottes aux mains en lui disant : « Compère, tu ne m’échapperas pas », et tout le monde vous dira encore que les poignets de Théodore en étaient écorchés. Il l’amena ainsi à Ajaccio où il fut jugé et condamné aux galères. Mais après la justice des juges, ce fut le tour de celle du bandit. Il s’échappa donc le soir même et alla coucher au maquis ; le dimanche suivant, au sortir de la messe, il se trouva sur la place, tout le monde l’entourait et le brigadier aussi, à qui Théodore cria du plus loin et tout en le mirant : « Compère, tu ne m’échapperas pas ». Il ne lui échappa pas non plus, et tomba percé d’une balle au cœur, première vengeance. Le bandit regagna le maquis d’où il ne descendait plus que pour continuer ses meurtres sur la famille de son ennemi et sur les gendarmes, dont il tua bien une quarantaine. Le coup de fusil parti il disparaissait le soir et retournait dans un autre canton. Il vécut ainsi douze hivers et douze étés, et toujours généreux, réparant les torts, défendant ceux qui s’adressaient à lui, délicat à l’extrême sur le point d’honneur, menant joyeuse vie, recherché des femmes pour son bon cœur et sa belle mine, aimé de trois maîtresses à la fois. L’une d’elles, qui était enceinte lorsqu’il fut tué, chanta sur le corps de son amant une ballata que mon guide m’a redite. Elle commence par ces mots : « Si je n’étais pas chargée de ton fils et qui doit naître pour te venger, je t’irais rejoindre, ô mon Théodore ! »
Nous avons quitté la mer au port de Sagone, vieille ville dont on ne voit même pas les ruines, pour continuer notre route vers Vico, où nous sommes enfin arrivés le soir après dix heures de cheval. Nous avons logé chez un cousin de M. Multedo, grand homme blond et doux, parlant peu et se contentant de répéter souvent le même geste de main. Il s’est vaillamment battu contre les Anglais lorsque ceux-ci ont voulu faire une descente à Sagone ; il se sent tout prêt à recommencer. Il y a en effet dans la Corse une haine profonde pour l’Angleterre et un grand désir de le prouver. Sur la route que nous avons faite pour aller à Vico, des paysans nous arrêtaient.
— Va-t-on se battre, demandaient-ils ?
— C’est possible.
— Tant mieux.
— Et contre qui ?
— Contre les Anglais.
À ce mot ils bondissaient de joie et nous montraient en ricanant un poignard ou un pistolet, car un Corse ne voyage jamais sans être armé, soit par prudence ou par habitude. On porte le poignard soit attaché dans le pantalon, mis dans la poche de la veste, ou glissé dans la manche ; jamais on ne s’en sépare, pas même à la ville, pas même à table. Dans un grand dîner à la préfecture et où se trouvait réuni presque tout le conseil général, on m’a assuré que pas un des convives n’était sans son stylet. Le cocher qui nous a conduits à Bogogna tenait un grand pistolet chargé sous le coussin de sa voiture. Tous les bergers de la Corse manquent plutôt de chemise blanche que de lame affilée.
À Vico on commence à connaître ce que c’est qu’un village de la Corse. Situé sur un monticule, dans une grande vallée, il est dominé de tous les côtés par des montagnes qui l’entourent en entonnoir. Le système montagneux de la Corse à proprement parler, n’est point un système ; imaginez une orange coupée par le milieu, c’est là la Corse. Au fond de chaque vallée, de temps en temps un village, et pour aller au hameau voisin il faut une demi-journée de marche et passer quelquefois trois ou quatre montagnes. La campagne est partout déserte ; où elle n’est pas couverte de maquis, ce sont des plaines, mais on n’y rencontre pas plus d’habitations, car le paysan cultive encore son champ comme l’Arabe : au printemps il descend pour l’ensemencer, à l’automne il revient pour faire la moisson ; hors de là il se tient chez lui sans sortir deux fors par an de son rocher où il vit sans rien faire, paresseux, sobre et chaste. Vico est la patrie du fameux Théodore dont le nom retentit encore dans toute la Corse avec un éclat héroïque ; il a tenu douze ans le maquis, et n’a été tué qu’en trahison. C’était un simple paysan du pays, que tous aimaient et que tous aiment encore. Ce bandit-là était un noble cœur, un héros. Il venait d’être pris par la conscription et il restait chez lui attendant qu’on l’appelât ; le brigadier du lieu, son compère, lui avait promis de l’avertir à temps, quand un matin la force armée tombe chez lui et l’arrache de sa cabane au nom du roi. C’était le compère qui dirigeait sa petite compagnie et qui, pour se faire bien voir sans doute, voulut le mener rondement et prouver son zèle pour l’État en faisant le lâche et le traître. Dans la crainte qu’il ne lui échappât il lui mit les menottes aux mains en lui disant : « Compère, tu ne m’échapperas pas », et tout le monde vous dira encore que les poignets de Théodore en étaient écorchés. Il l’amena ainsi à Ajaccio où il fut jugé et condamné aux galères. Mais après la justice des juges, ce fut le tour de celle du bandit. Il s’échappa donc le soir même et alla coucher au maquis ; le dimanche suivant, au sortir de la messe, il se trouva sur la place, tout le monde l’entourait et le brigadier aussi, à qui Théodore cria du plus loin et tout en le mirant : « Compère, tu ne m’échapperas pas ». Il ne lui échappa pas non plus, et tomba percé d’une balle au cœur, première vengeance. Le bandit regagna le maquis d’où il ne descendait plus que pour continuer ses meurtres sur la famille de son ennemi et sur les gendarmes, dont il tua bien une quarantaine. Le coup de fusil parti il disparaissait le soir et retournait dans un autre canton. Il vécut ainsi douze hivers et douze étés, et toujours généreux, réparant les torts, défendant ceux qui s’adressaient à lui, délicat à l’extrême sur le point d’honneur, menant joyeuse vie, recherché des femmes pour son bon cœur et sa belle mine, aimé de trois maîtresses à la fois. L’une d’elles, qui était enceinte lorsqu’il fut tué, chanta sur le corps de son amant une ballata que mon guide m’a redite. Elle commence par ces mots : « Si je n’étais pas chargée de ton fils et qui doit naître pour te venger, je t’irais rejoindre, ô mon Théodore ! »
Le passager se composait de trois ecclésiastiques, d’un ingénieur des ponts et chaussées, d’un jeune médecin corse et d’un receveur des finances et de sa jeune femme qui a eu une agonie de vingt-quatre heures. La nuit vint, on alluma la lampe suspendue aux écoutilles et que le roulis fit remuer et danser toute la nuit ; on dressa la table pour les survivants, après nous avoir fait l’ironique demande de nous y asseoir. Les trois curés et M. Cloquet seuls se mirent à manger. Cela avait quelque chose de triste, et je commençai à m’apitoyer sur mon sort ; humilié déjà de ma position, je l’étais encore plus de voir trois curés boire et manger comme des laïques. J’aurais pris tant de plaisir à me voir à leur place et eux à la mienne ! Les rôles me semblaient intervertis, d’autant plus que l’un d’eux voyageait pour sa santé — c’était bien plutôt à lui d’être malade — ; le second s’occupait de botanique — et qu’est-ce qu’un botaniste a à faire sur les flots ? — le troisième avait l’air d’un gros paysan décrassé, indigne de regarder la mer et de rêver, tandis que moi j’aurais eu si bonne grâce à table ! La nuit venue je l’aurais passée à contempler les étoiles, le vent dans les cheveux, la tempête dans le cœur. Le bonheur est toujours réservé à des imbéciles qui ne savent pas en jouir.
Je m’endormis enfin, et mon sommeil dura à peu près quatre heures. Il était minuit quand je me réveillai, j’entendais les trois prêtres ronfler, les autres voyageurs se taisaient ou soupiraient, un grand bruit d’eaux qui venaient et se retiraient se faisait sur les parois du navire, la mer était rude et la mâture craquait ; une faible lueur de lune qui se reflétait sur les flots venait d’en face et disparaissait de temps en temps, et celle de la lampe jetait sur les cabines des ondulations qui passaient et repassaient avec le mouvement du roulis. Alors je me mis à me rappeler Panurge en pareille occurence, lorsque « la mer remuait du bas abysme » et que tristement assis au pied du grand mât il enviait le sort dès pourceaux ; je m’amusai à continuer le parallèle, tâchant de me faire rire sur le compte de Panurge afin de ne pas trop m’attrister sur moi-même. L’immobilité à laquelle j’étais condamné me fatiguait horriblement et le matelas de crin m’entrait dans les côtes ; au moindre mouvement que je tâchais de faire la nausée me prenait aussitôt, il fallait bien se résigner, la douleur me rendormait.
Nous longions alors les côtes de la Corse, et le temps, de plus en plus rude, me réveilla avec des angoisses épouvantables et une sueur d’agonisant. Je comparais les cabines à autant de bières superposées les unes au-dessus des autres ; c’était en effet une traversée d’enfer, et la barque de Caron n’a jamais contenu de gens qui aient eu le cœur plus malade. D’autres fois j’essayais de m’étourdir, de me tourner en ridicule, de m’amuser à mes dépens ; je me dédoublais et je me figurais être à terre, en plein jour, assis sur l’herbe, fumant à l’ombre et pensant à un autre moi couché sur le dos et vomissant dans une cuvette de fer-blanc ; ou bien je me transportais à Rouen, dans mon lit : l’hiver, je me réveillais à cette heure-là, j’allumais mon feu, et je me mettais à ma table. Alors je me rappelais tout et je pressurais ma mémoire pour qu’elle me rendît tous les détails de ma vie de là-bas, je revoyais ma cheminée, ma pendule, mon lit, mon tapis, le papier taché, le pavé blanchi à certaines places ; je m’approchais de la fenêtre et je regardais les barres du jour qui saillissaient entre les branches de l’acacia ; tout le monde dort tranquille au-dessous de moi, le feu pétille et mon flambeau fait un cercle blanc au plafond. Ou bien c’était à Déville, l’été ; j’entrais dans le bosquet, j’ouvrais la barrière, j’entendais le bruit du loquet en fer qui retentissait sur le bois. Une vague plus forte me réveillait de tout cela et me rendait à ma situation présente, à ma cuvette aux trois quarts remplie.
D’autres fois je prenais des distractions stupides, comme de regarder toujours le même coin de la chambre, ou de faire couler quelques gouttes de citron sur ma lèvre inférieure que je m’amusais ensuite à souffler sur ma moustache, toutes les misères de la philosophie pour adoucir les maux. Le moment le plus récréatif pour moi a été celui où le roulis devenant plus fort a renversé la table et les chaises qui ont roulé avec un fracas épouvantable et ont éveillé tous les malades hurlant : le vieux curé, qui avait les pieds embarrassés dans les rideaux, a manqué d’être écrasé, et le financier, qui sortait du cabinet, est tombé sur le dos de M. Cloquet de la manière la plus immorale du monde. J’ai ri très haut, d’abord parce que j’en avais envie, et, en second lieu, pour faire un peu plus de bruit et me divertir. Le mouvement que je m’étais donné occasionna encore une purgation, qui fut bien la plus cruelle, et de nouvelles douleurs qui ne me quittèrent réellement qu’à Ajaccio sur le terrain des vaches. Quelques heures après être débarqué, le sol remuait encore et je voyais tous les meubles s’incliner et se redresser.
Nous avons eu un avant-goût de l’hospitalité corse dans le cordial et franc accueil du préfet, qui nous a fait quitter notre hôtel et nous a pris chez lui comme des amis déjà connus. M. Jourdan est un homme encore jeune, plein d’énergie et de vivacité. Ancien carbonaro, un des chefs de l’association, sa jeunesse a été agitée par les passions politiques et sa tête a été mise à prix. Il administre la Corse depuis dix ans, ne rencontrant plus maintenant d’opposition que dans quelques membres du conseil général qu’il mène assez rudement. Sa maison est pleine de ce bon ton qui part du cœur ; ses filles, qui ne sont pas jolies, sont charmantes. M. Jourdan connaît son département mieux qu’aucun Corse et il nous a donné sur ce beau pays d’excellents renseignements. Je me rappelle un certain soir qu’il a déblatéré contre l’archéologie et je l’ai contredit ; un autre jour il a parlé avec feu des études historiques et particulièrement de la philosophie de l’histoire ; je l’ai laissé dire, me demandant en moi-même ce que les gens qui ont passé leur vie à l’étudier entendaient aujourd’hui par ce mot-là, et s’ils le comprenaient bien eux-mêmes. Ce que les plus fervents y voient de plus clair, c’est que c’est une science dans l’horizon, et les autres sceptiques pensent que ce sont deux mots bien lourds à entasser l’un sur l’autre, et que la philosophie est assez obscure sans y adjoindre l’histoire, et que l’histoire en elle-même est assez pitoyable sans l’atteler à la philosophie. Nous sommes partis d’Ajaccio pour Vico le 7 octobre, à 6 heures du matin. Le fils de M. Jourdan nous a accompagnés jusqu’à une lieue hors la ville. Nous avons quitté la vue d’Ajaccio et nous nous sommes enfoncés dans la montagne. La route en suit toutes les ondulations et fait souvent des coudes sur les flancs du maquis, de sorte que la vue change sans cesse et que le même tableau montre graduellement toutes ses parties et se déploie avec toutes ses couleurs, ses nuances de ton et tous les caprices de son terrain accidenté. Après avoir passé deux vallées, nous arrivâmes sur une hauteur d’où nous aperçûmes la vallée de Cinarca, couverte de petits monticules blancs qui se détachaient dans la verdure du maquis. Au bas s’étendent les trois golfes de Chopra, de Liamone et de Sagone ; dans l’horizon et au bout du promontoire, la petite colonie de Cargèse. Toute la route était déserte, et l’œil ne découvrait pas un seul pan de mur. Tantôt à l’ombre et tantôt au soleil, suivant que la silhouette des montagnes que nous longions s’avançait ou se retirait, nous allions au petit trot, baissant la tête, éblouis que nous étions par la lumière qui inondait l’air et donnait aux contours des rochers quelque chose de si vaporeux et de si ardent à la fois qu’il était impossible à l’œil de les saisir nettement. Nous sommes descendus à travers les broussailles et les granits éboulés, traînant nos chevaux par la bride jusqu’à une cabane de planches où nous avons déjeuné sous une treille de fougères sèches, en vue de la mer. Une pauvre femme s’y tenait couchée et poussait des gémissements aigus que lui arrachait la douleur d’un abcès au bras ; les autres habitants n’étaient guère plus riants ; un jeune garçon tout jaune de la fièvre nous regardait manger avec de grands yeux noirs hébétés. Nos chevaux broutaient dans le maquis, toute la nature rayonnait de soleil, la mer au fond scintillait sur le sable et ressemblait avec ses trois golfes à un tapis de velours bleu découpé en trois festons. Nous sommes repartis au bout d’une heure et nous avons marché longtemps dans des sentiers couverts qui serpentent dans le maquis et descendent jusqu’au rivage. Au revers d’un coteau nous avons vu sortir du bois et allant en sens inverse un jeune Corse, à pied, accompagné d’une femme montée sur un petit cheval noir. Elle se tenait à califourchon, accoudée sur une botte de maïs que portait sa monture ; un grand chapeau de paille, plat, lui couvrait la tête, et ses jupes relevées en arrière par la croupe du cheval laissaient voir ses pieds nus. Ils se sont arrêtés pour nous laisser passer, nous ont salués gravement. C’était alors en plein midi, et nous longions le bord de la mer que le chemin suit jusqu’à l’ancienne ville de Sagom. Elle était calme, le soleil, donnant dessus, éclairait son azur qui paraissait plus limpide encore ; ses rayons faisaient tout autour des rochers à fleur comme des couronnes de diamant qui les auraient entourés ; elles brillaient plus vives et plus scintillantes que les étoiles. La mer a un parfum plus suave que les roses, nous le humions avec délices ; nous aspirions en nous le soleil, la brise marine, la vue de l’horizon, l’odeur des myrtes, car il est des jours heureux où l’âme aussi est ouverte au soleil comme la campagne et, comme elle, embaume de fleurs cachées que la suprême beauté y fait éclore.
Je m’endormis enfin, et mon sommeil dura à peu près quatre heures. Il était minuit quand je me réveillai, j’entendais les trois prêtres ronfler, les autres voyageurs se taisaient ou soupiraient, un grand bruit d’eaux qui venaient et se retiraient se faisait sur les parois du navire, la mer était rude et la mâture craquait ; une faible lueur de lune qui se reflétait sur les flots venait d’en face et disparaissait de temps en temps, et celle de la lampe jetait sur les cabines des ondulations qui passaient et repassaient avec le mouvement du roulis. Alors je me mis à me rappeler Panurge en pareille occurence, lorsque « la mer remuait du bas abysme » et que tristement assis au pied du grand mât il enviait le sort dès pourceaux ; je m’amusai à continuer le parallèle, tâchant de me faire rire sur le compte de Panurge afin de ne pas trop m’attrister sur moi-même. L’immobilité à laquelle j’étais condamné me fatiguait horriblement et le matelas de crin m’entrait dans les côtes ; au moindre mouvement que je tâchais de faire la nausée me prenait aussitôt, il fallait bien se résigner, la douleur me rendormait.
Nous longions alors les côtes de la Corse, et le temps, de plus en plus rude, me réveilla avec des angoisses épouvantables et une sueur d’agonisant. Je comparais les cabines à autant de bières superposées les unes au-dessus des autres ; c’était en effet une traversée d’enfer, et la barque de Caron n’a jamais contenu de gens qui aient eu le cœur plus malade. D’autres fois j’essayais de m’étourdir, de me tourner en ridicule, de m’amuser à mes dépens ; je me dédoublais et je me figurais être à terre, en plein jour, assis sur l’herbe, fumant à l’ombre et pensant à un autre moi couché sur le dos et vomissant dans une cuvette de fer-blanc ; ou bien je me transportais à Rouen, dans mon lit : l’hiver, je me réveillais à cette heure-là, j’allumais mon feu, et je me mettais à ma table. Alors je me rappelais tout et je pressurais ma mémoire pour qu’elle me rendît tous les détails de ma vie de là-bas, je revoyais ma cheminée, ma pendule, mon lit, mon tapis, le papier taché, le pavé blanchi à certaines places ; je m’approchais de la fenêtre et je regardais les barres du jour qui saillissaient entre les branches de l’acacia ; tout le monde dort tranquille au-dessous de moi, le feu pétille et mon flambeau fait un cercle blanc au plafond. Ou bien c’était à Déville, l’été ; j’entrais dans le bosquet, j’ouvrais la barrière, j’entendais le bruit du loquet en fer qui retentissait sur le bois. Une vague plus forte me réveillait de tout cela et me rendait à ma situation présente, à ma cuvette aux trois quarts remplie.
D’autres fois je prenais des distractions stupides, comme de regarder toujours le même coin de la chambre, ou de faire couler quelques gouttes de citron sur ma lèvre inférieure que je m’amusais ensuite à souffler sur ma moustache, toutes les misères de la philosophie pour adoucir les maux. Le moment le plus récréatif pour moi a été celui où le roulis devenant plus fort a renversé la table et les chaises qui ont roulé avec un fracas épouvantable et ont éveillé tous les malades hurlant : le vieux curé, qui avait les pieds embarrassés dans les rideaux, a manqué d’être écrasé, et le financier, qui sortait du cabinet, est tombé sur le dos de M. Cloquet de la manière la plus immorale du monde. J’ai ri très haut, d’abord parce que j’en avais envie, et, en second lieu, pour faire un peu plus de bruit et me divertir. Le mouvement que je m’étais donné occasionna encore une purgation, qui fut bien la plus cruelle, et de nouvelles douleurs qui ne me quittèrent réellement qu’à Ajaccio sur le terrain des vaches. Quelques heures après être débarqué, le sol remuait encore et je voyais tous les meubles s’incliner et se redresser.
Nous avons eu un avant-goût de l’hospitalité corse dans le cordial et franc accueil du préfet, qui nous a fait quitter notre hôtel et nous a pris chez lui comme des amis déjà connus. M. Jourdan est un homme encore jeune, plein d’énergie et de vivacité. Ancien carbonaro, un des chefs de l’association, sa jeunesse a été agitée par les passions politiques et sa tête a été mise à prix. Il administre la Corse depuis dix ans, ne rencontrant plus maintenant d’opposition que dans quelques membres du conseil général qu’il mène assez rudement. Sa maison est pleine de ce bon ton qui part du cœur ; ses filles, qui ne sont pas jolies, sont charmantes. M. Jourdan connaît son département mieux qu’aucun Corse et il nous a donné sur ce beau pays d’excellents renseignements. Je me rappelle un certain soir qu’il a déblatéré contre l’archéologie et je l’ai contredit ; un autre jour il a parlé avec feu des études historiques et particulièrement de la philosophie de l’histoire ; je l’ai laissé dire, me demandant en moi-même ce que les gens qui ont passé leur vie à l’étudier entendaient aujourd’hui par ce mot-là, et s’ils le comprenaient bien eux-mêmes. Ce que les plus fervents y voient de plus clair, c’est que c’est une science dans l’horizon, et les autres sceptiques pensent que ce sont deux mots bien lourds à entasser l’un sur l’autre, et que la philosophie est assez obscure sans y adjoindre l’histoire, et que l’histoire en elle-même est assez pitoyable sans l’atteler à la philosophie. Nous sommes partis d’Ajaccio pour Vico le 7 octobre, à 6 heures du matin. Le fils de M. Jourdan nous a accompagnés jusqu’à une lieue hors la ville. Nous avons quitté la vue d’Ajaccio et nous nous sommes enfoncés dans la montagne. La route en suit toutes les ondulations et fait souvent des coudes sur les flancs du maquis, de sorte que la vue change sans cesse et que le même tableau montre graduellement toutes ses parties et se déploie avec toutes ses couleurs, ses nuances de ton et tous les caprices de son terrain accidenté. Après avoir passé deux vallées, nous arrivâmes sur une hauteur d’où nous aperçûmes la vallée de Cinarca, couverte de petits monticules blancs qui se détachaient dans la verdure du maquis. Au bas s’étendent les trois golfes de Chopra, de Liamone et de Sagone ; dans l’horizon et au bout du promontoire, la petite colonie de Cargèse. Toute la route était déserte, et l’œil ne découvrait pas un seul pan de mur. Tantôt à l’ombre et tantôt au soleil, suivant que la silhouette des montagnes que nous longions s’avançait ou se retirait, nous allions au petit trot, baissant la tête, éblouis que nous étions par la lumière qui inondait l’air et donnait aux contours des rochers quelque chose de si vaporeux et de si ardent à la fois qu’il était impossible à l’œil de les saisir nettement. Nous sommes descendus à travers les broussailles et les granits éboulés, traînant nos chevaux par la bride jusqu’à une cabane de planches où nous avons déjeuné sous une treille de fougères sèches, en vue de la mer. Une pauvre femme s’y tenait couchée et poussait des gémissements aigus que lui arrachait la douleur d’un abcès au bras ; les autres habitants n’étaient guère plus riants ; un jeune garçon tout jaune de la fièvre nous regardait manger avec de grands yeux noirs hébétés. Nos chevaux broutaient dans le maquis, toute la nature rayonnait de soleil, la mer au fond scintillait sur le sable et ressemblait avec ses trois golfes à un tapis de velours bleu découpé en trois festons. Nous sommes repartis au bout d’une heure et nous avons marché longtemps dans des sentiers couverts qui serpentent dans le maquis et descendent jusqu’au rivage. Au revers d’un coteau nous avons vu sortir du bois et allant en sens inverse un jeune Corse, à pied, accompagné d’une femme montée sur un petit cheval noir. Elle se tenait à califourchon, accoudée sur une botte de maïs que portait sa monture ; un grand chapeau de paille, plat, lui couvrait la tête, et ses jupes relevées en arrière par la croupe du cheval laissaient voir ses pieds nus. Ils se sont arrêtés pour nous laisser passer, nous ont salués gravement. C’était alors en plein midi, et nous longions le bord de la mer que le chemin suit jusqu’à l’ancienne ville de Sagom. Elle était calme, le soleil, donnant dessus, éclairait son azur qui paraissait plus limpide encore ; ses rayons faisaient tout autour des rochers à fleur comme des couronnes de diamant qui les auraient entourés ; elles brillaient plus vives et plus scintillantes que les étoiles. La mer a un parfum plus suave que les roses, nous le humions avec délices ; nous aspirions en nous le soleil, la brise marine, la vue de l’horizon, l’odeur des myrtes, car il est des jours heureux où l’âme aussi est ouverte au soleil comme la campagne et, comme elle, embaume de fleurs cachées que la suprême beauté y fait éclore.
Quand on lit Rabelais et qu’on s’y aventure, on finit par perdre le fil et par avancer dans un dédale dont vous ne savez bientôt ni les issues ni les entrées ; ce sont des arabesques à n’en plus finir, des poussées de rire qui étourdissent, des fusées de folle gaieté qui retombent en gerbes, illuminant et obscurcissant à la fois à la manière des grands feux ; rien de général ne se saisit, on pressent et on prévoit bien quelque chose, mais quant à un sens clair, à une idée nette, c’est ce qu’il n’y faut point chercher. Dans Montaigne tout est libre, facile ; on y nage en pleine intelligence humaine, chaque flot de pensée emplit et colore la longue phrase causeuse qui finit tantôt par un saut tantôt par un arrêt. La pensée de la Renaissance, d’abord vague et confuse, pleine de rire et de joie géante dans Rabelais, est devenue plus humaine, dégagée d’idéal et de fantastique ; elle a quitté le roman et est devenue philosophie. Ce que je voudrais nettement exprimer, c’est la marche ascendante du style, le muscle dans la phrase qui devient chaque jour plus dessiné et plus raide. Ainsi passez de Retz à Pascal, de Corneille à Molière, l’idée se précise et la phrase se resserre, s’éclaire ; elle laisse rayonner en elle l’idée qu’elle contient comme une lampe dans un globe de cristal, mais la lumière est si pure et si éclatante qu’on ne voit pas ce qui la couvre. C’est là, si je ne me trompe, l’essence de la prose française du xviie siècle : le dégagement de la forme pour rendre la pensée, la métaphysique dans l’art, et, pour employer un mot qui sent trop l’école, la substance en tant qu’être. Je doute que l’architecture ait fait quelque chose de semblable. Elle se dépouille bien, en effet, comme le style, de tous les contours qui entravaient sa marche, et comme dans le style aussi elle a passé un rabot qui fait sauter mille choses gracieuses de la Renaissance ou du moyen âge qui disparaissent pour toujours avec les derniers vestiges de grâce naïve ; la bonne pensée gauloise, échauffée au souvenir latin, ne s’en ira pas moins ; l’arabesque meurt avec Rabelais, la Renaissance, quelque belle qu’elle ait été, n’a vécu qu’un jour. Ce qui a été pour la pierre tout un jour de vie est une aurore, une ère nouvelle pour les lettres. C’est que la pierre n’exprime ni la philosophie ni la critique ; elle ne fait ni le roman, ni le conte, ni le drame ; elle est l’hymne. Il ne lui est plus resté après Luther, après la satire Ménippée, qu’à s’aligner dans les quais, à paver les routes, à bâtir des palais, et Louis XIV qui voulait s’en faire des temples pour y vivre n’a pu lui donner la vie ; le sang en était parti avec la foi, c’était chose usée, outil cassé dont l’ouvrier était mort. Tout ce que la pierre n’avait pas dit, la prose se chargea de le dire et elle le dit bien. Maintenant que nous croyons tout expirant, que trois siècles de littérature ont raffiné sur chaque nuance du cœur de l’homme, usant toutes les formes, parlant tous les mots, faisant vingt langues dans un siècle et renfermant dans une immense synthèse Pascal contre Montaigne, Voltaire contre Bossuet, Lafontaine et Marot, Chateaubriand et Rousseau, le doute et la foi, l’art et la poésie, la monarchie et la démocratie, tous les cris les plus doux et les plus forts, à cette heure, dis-je, où les poètes se rencontrent inquiets et où chacun demande à l’autre s’il a retrouvé la Muse envolée, quelle sera la lyre sur laquelle les hommes chanteront ? reprendront-ils le ciseau pour bâtir la Babel de leurs idées ? dans quelle eau de Jouvence se retrempera leur plume ? C’est ce que je me disais dans Saint-Sernin à Toulouse, me promenant sous sa belle nef romane ; catacombe de pierre où sont ensevelies de vieilles idées, nous n’avons pour elle qu’une vénération de curiosité et nous faisons craquer nos bottes vernies sur les dalles où dorment les saints. Eh ! pourquoi pas ? Que nous font les saints, à nous autres ? Nous étudions l’histoire du christianisme comme celle de l’islamisme et nous nous ennuyons de l’un et de l’autre. Nous sentons bien qu’il nous faut quelque chose que nous ne savons pas, mais ce n’est rien de ce qu’on nous offre. J’étais fatigué de l’église, quelque beau que soit son roman, j’étais assommé d’église et je le suis encore ; le curé nous dit qu’il y avait des reliques, je l’ai cru en homme bien élevé, et un mouvement de joie inconcevable m’a fait bondir le cœur quand il m’a dit que le vélin des missels avait fait des cartouches. Je rencontrais là au moins quelque chose de notre vie, de ma vie, de la colère brutale ; une passion au moins que nous comprenons, qu’un rien peut rallumer, tandis que pour la foi la niche même en est cassée en pièces dans notre cœur.
J’aime bien la Méditerranée, elle a quelque chose de grave et de tendre qui fait penser à la Grèce, quelque chose d’immense et de voluptueux qui fait penser à l’Orient. A la baie aux Oursins, où j’ai été pour voir pêcher le thon, je me serais cru volontiers sur un rivage d’Asie Mineure. II faisait si beau soleil, toute la nature en fête vous entrait si bien dans la peau et dans le cœur ! C’est la fille du patron Scard qui nous a reçus ; elle nous a fait monter dans sa maison, des filets étaient étendus par terre, et le jour qui entrait par la fenêtre faisait éclater de blancheur la peinture à la colle qui décorait la muraille. Mlle Scard n’est pas jolie, mais elle avait des mouvements de tête et de taille les plus gracieux du monde ; tout en causant, elle se tenait sur sa chaise d’une façon mignarde et naïve. J’ai pensé aux belles demoiselles de ville qui se lissent, qui se sanglent, qui jeûnent et qui, après tout, ne valent pas en esprit et en beauté le sans-façon cordial de la fille du bord de la mer. Elle est venue avec nous dans la barque et elle a causé tout le temps avec nous comme une bonne créature. Ses jeux sont du même azur que la mer. Pas un souffle d’air ne ridait les flots, et nous avancions à la rame doucement et tout en suivant la direction du filet ; l’eau est si transparente que je m’amusais à regarder la madrague qui filait sous notre barque et les petits poissons se jouer dans les mailles avec toutes les couleurs chatoyantes que leur donnait le soleil qui, passant à travers les flots, les colorait de mille nuances d’azur, d’or et d’émeraude ; ils frétillaient, passaient et revenaient avec mille petits mouvements les plus gentils du monde. A mesure qu’on s’avance, le filet se resserre et s’étrangle de plus en plus vers les trois barques placées au large, qui forment comme un cul-de-sac où doit se rendre tout le poisson pris dans le filet antérieur. Les nattes de jonc accrochées aux barques, plongées dans l’eau et sur les bords se relevant en coquille, avaient l’air du berceau d’une Naïade. Un dimanche soir j’ai vu le peuple se réjouir. Ce qui chagrine le plus les gens vertueux c’est de voir le peuple s’amuser. Il y a de quoi les chagriner fort à Marseille, car il s’y amuse tout à son aise, et boit le plaisir par tous les pores, sous toutes les formes, tant qu’il peut. J’en suis rentré le soir tout édifié et plein d’estime pour ces bonnes gens qui dînent sans causer politique et qui s’enivrent sans philosophie. La rue de la Darse était pleine de marins de toutes les nations, juifs, arméniens, grecs, tous en costume national, encombrant les cabarets, riant avec des filles, renversant des pots de vin, chantant, dansant, faisant l’amour à leur aise. Aux portes des guinguettes, c’était une foule mouvante, chaude et gaie, qui se dressait sur la pointe des pieds pour voir ceux qui étaient attablés, qui jouaient et qui fumaient. Nous nous y sommes mêlés et à travers les vitres obscurcies nous avons vu, tout au fond d’une grande pièce, la représentation d’un mystère provençal. Sur une estrade au fond se tenaient quatre à cinq personnages richement vêtus ; il y avait le roi avec sa couronne, la reine, le paysan à qui on avait enlevé sa fille et qui se disputait avec le ravisseur pendant que la mère désolée et s’arrachant les cheveux chantait une espèce de complainte avec des exclamations nombreuses, comme dans les tragédies d’Eschyle. Le dialogue était vif et animé, improvisé sans doute, plein de saillies à coup sûr à en juger par les éclats de rire et les applaudissements qui survenaient de temps à autre dans l’auditoire. Tous ces braves gens écoutaient et goûtaient l’air avec respect et recueillement d’une manière à réjouir un poète s’il fût passé là. J’ai remarqué que les tables étaient presque toutes vides ou à peu près, on se pressait pour entrer, et la foule s’introduisait flot à flot comme elle pouvait, mais sans troubler le spectacle. Des joueurs de mandoline ou des chanteurs étaient aussi dans la rue, il y avait des cercles autour d’eux. On n’entendait aucun chant d’ivrogne ; les tavernes du rez-de-chaussée, toutes ouvertes, fermaient la vue de ce qui se passait au dedans par un grand rideau blanc qui tombait depuis le haut jusqu’en bas ; lorsque quelqu’un allait ou venait, on I’entr’ouvrait, on voyait assis, sur des tabourets séparés, trois ou quatre hommes du peuple, les bras nus, tenant des femmes sur leurs genoux.
ÉCRIT AU RETOUR.
J’en étais resté à Marseille de mon voyage, je le reprends à quinze jours de distance. Me voilà réinstallé dans mon fauteuil vert, auprès de mon feu qui brûle, voilà que je recommence ma vie des ans passés. Qu’ont donc les voyages de si attrayant pour qu’on les regrette à peine finis ? Oh ! je rêverai encore longtemps des forêts de pins où je me promenais il y a trois semaines, et de la Méditerranée qui était si bleue, si limpide, si éclairée de soleil il y a quinze jours ; je sens bien que cet hiver, quand la neige couvrira les toits et que le vent sifflera dans les serrures, je me surprendrai à errer dans les maquis de myrtes, le long du golfe de Liamone, ou à regarder la lune dans la baie d’Ajaccio.
Maintenant, les arbres ici n’ont plus de feuilles, et la boue est dans les chemins. J’entends encore le chant de nos guides et le bruit du vent dans les châtaigniers ; c’est pour cela que je reprendrai souvent ces notes interrompues et reprises à des places différentes, avec des encres si diverses qu’elles semblent une mosaïque. Je les allongerai, je les détaillerai de plus en plus, ce sera comme un homme qui a un peu de vin dans son verre et qui y met de l’eau pour délayer son plaisir et boire plus longtemps. Quand on marche on veut l’avenir, on désire avancer, on court, on s’élance, regardant toujours en avant et, la route à peine finie, on détourne la tête et l’on regrette les chemins parcourus si vite, de sorte que l’homme, quoi qu’on en dise, aspire sans cesse au passé et à l’avenir, à tout ce qui n’est pas de sa vie actuelle en un mot, puisqu’il se reporte toujours vers le matin qui n’est plus, vers la nuit qui n’est pas encore (réflexion neuve).
J’en étais resté à Marseille de mon voyage, je le reprends à quinze jours de distance. Me voilà réinstallé dans mon fauteuil vert, auprès de mon feu qui brûle, voilà que je recommence ma vie des ans passés. Qu’ont donc les voyages de si attrayant pour qu’on les regrette à peine finis ? Oh ! je rêverai encore longtemps des forêts de pins où je me promenais il y a trois semaines, et de la Méditerranée qui était si bleue, si limpide, si éclairée de soleil il y a quinze jours ; je sens bien que cet hiver, quand la neige couvrira les toits et que le vent sifflera dans les serrures, je me surprendrai à errer dans les maquis de myrtes, le long du golfe de Liamone, ou à regarder la lune dans la baie d’Ajaccio.
Maintenant, les arbres ici n’ont plus de feuilles, et la boue est dans les chemins. J’entends encore le chant de nos guides et le bruit du vent dans les châtaigniers ; c’est pour cela que je reprendrai souvent ces notes interrompues et reprises à des places différentes, avec des encres si diverses qu’elles semblent une mosaïque. Je les allongerai, je les détaillerai de plus en plus, ce sera comme un homme qui a un peu de vin dans son verre et qui y met de l’eau pour délayer son plaisir et boire plus longtemps. Quand on marche on veut l’avenir, on désire avancer, on court, on s’élance, regardant toujours en avant et, la route à peine finie, on détourne la tête et l’on regrette les chemins parcourus si vite, de sorte que l’homme, quoi qu’on en dise, aspire sans cesse au passé et à l’avenir, à tout ce qui n’est pas de sa vie actuelle en un mot, puisqu’il se reporte toujours vers le matin qui n’est plus, vers la nuit qui n’est pas encore (réflexion neuve).
Videos de Gustave Flaubert (132)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : récit de voyageVoir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gustave Flaubert (142)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Éducation Sentimentale
Fumichon, concernant la propriété, évoque les arguments d'un homme politique dont Flaubert parle en ces terme dans une lettre à George Sand: "Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croûtard plus abject, un plus étroniforme bourgeois! Non! Rien ne peut donner l'idée du vomissement que m'inspire ce vieux melon diplomatique, arrondissant sa bêtise sur le fumier de la Bourgeoisie!". De qui s'agit-il?
Benjamin Constant
Adolphe Thiers
Proudhon
Frédéric Bastiat
Turgot
8 questions
174 lecteurs ont répondu
Thème : L'Education sentimentale de
Gustave FlaubertCréer un quiz sur ce livre174 lecteurs ont répondu