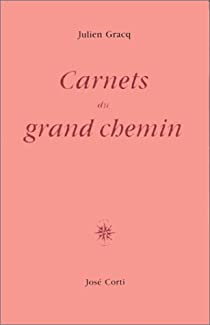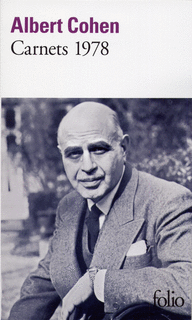Julien Gracq/5
71 notes
Résumé :
Inlassable marcheur autant que fin observateur de la vie secrète du monde, des paysages et de la littérature, Julien Gracq, dans ses "Carnets du grand chemin", distille pour le plus grand bonheur de ses admirateurs des notes de voyages et de lectures empreintes de poésie, d'humour et surtout de nostalgie.
Celle d'un homme qui a connu plusieurs mondes, qui en a vu disparaître certains, et qui s'efforce, par la magie de la création littéraire, d'en prolonger l... >Voir plus
Celle d'un homme qui a connu plusieurs mondes, qui en a vu disparaître certains, et qui s'efforce, par la magie de la création littéraire, d'en prolonger l... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Carnets du grand cheminVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (9)
Voir plus
Ajouter une critique
Je me suis d'abord étonnée qu'il n'y ait pas plus de lecteurs Babelio pour ces Carnets du grand chemin, puis je me suis dit que c'était le genre d'ouvrages qui plaisent surtout à des personnes qui écrivent elles-mêmes. Des récits et des réflexions pour auteurs. D'ailleurs, c'est grâce à Marie Hélène Lafon que je m'y suis intéressée après qu'elle m'en ait fait lecture d'un passage sur notre Cantal commun, et un autre ami auteur, Christophe Masson, m'y incitait à son tour par un "lorsqu'on lit Julien Gracq, c'est tout de suite avec l'impression d'être en haut du panier..." En effet, il y a une fascination à suivre la maîtrise avec laquelle le grand homme retransmet ses ressentis de voyage, comme des notes superbes, avec ce qui faut de précisions et de sentiments pour que cela sonne juste, sans excès de style et même de poésie : simplement incroyablement bien écrit. Et il y a aussi toutes ses méditations sur l'acte d'écrire qui émaillent la dernière partie de l'ouvrage, entre des digressions sur l'histoire, l'art et les artistes qu'il a côtoyés. Assez passionnant, tout ça ! Enfin, j'espère que d'autres lecteurs me feront mentir et me diront qu'il existe aussi le plaisir désintéressé de parcourir la France en suivant avec bonheur la plume de Julien Gracq...
Je ne suis pas spécialement un contemplatif, ça semble parfois me gonfler au bout de cinq minutes, mais peut-être est-ce parce que je m'éloigne de la chose inspirante à cause d'une contrariété quelconque ou que sais-je à vrai dire ..
Mais la chose que j'ai aimée (secrètement), j'aime bien la voir aborder par les artistes qui me surprennent et rivalisent de talent et d'authenticité pour nous la faire partager.
Ainsi c'est Anatole France qui aimait bien les rives de la Somme, les bateaux qui remontaient le chenal pour acheminer le sel, les quais n'avaient pas encore vu le jour, la brume qui envahissait la baie, les canards qui nageaient sur le bord du chenal .."l'eau n'a pas de sourires et le vent n'a pas de caresses .."
Et là je revisite la Baie de Somme avec Julien Gracq :
"Estuaire de la Somme, pays du miroitement et de la brume, où les linéaments de la terre à vau-l'eau se réduisent dans le paysage à quelques pures et minces lignes horizontales, mangées par les reflets de lumière, et dont la légèreté irréelle fait songer à un lavis chinois. Près de la mer, longues nappes de vase réfléchissantes, courant se fondre dans le gris et la nacre d'huître de la Manche, où la Somme essore paresseusement sa traînée liquide comme la pellicule d'eau qui draine le fond de la baignoire mouillée. Dans la platitude humide pointent seulement quelques huttes de chasseurs de canards. Et le paysage lui-même est semblable au cri du canard : solitude trempée des eaux plates, ouate grise, odeur de sauvagine, froid cru et stagnant du matin mal réveillé.
A Crotoy, en avant du rempart des villas serrées s'étend non pas une plage, mais plutôt un immense terrain vague de sable granuleux dont la croûte cède sous le pas comme aux abords d'un chott d'Algérie, seulement, si on s'y étend, le froid qui monte de sa profondeur vous en chasse. Je retournerai un jour vers ces sables décolorés - le Crotoy, Berck, Malo, Wimereux, Wissant, - ces plages livides des mers grises que visite à de longs intervalles , exsangue et flottant comme un ectoplasme de lumière, un fantôme de soleil blanc."
Mais la chose que j'ai aimée (secrètement), j'aime bien la voir aborder par les artistes qui me surprennent et rivalisent de talent et d'authenticité pour nous la faire partager.
Ainsi c'est Anatole France qui aimait bien les rives de la Somme, les bateaux qui remontaient le chenal pour acheminer le sel, les quais n'avaient pas encore vu le jour, la brume qui envahissait la baie, les canards qui nageaient sur le bord du chenal .."l'eau n'a pas de sourires et le vent n'a pas de caresses .."
Et là je revisite la Baie de Somme avec Julien Gracq :
"Estuaire de la Somme, pays du miroitement et de la brume, où les linéaments de la terre à vau-l'eau se réduisent dans le paysage à quelques pures et minces lignes horizontales, mangées par les reflets de lumière, et dont la légèreté irréelle fait songer à un lavis chinois. Près de la mer, longues nappes de vase réfléchissantes, courant se fondre dans le gris et la nacre d'huître de la Manche, où la Somme essore paresseusement sa traînée liquide comme la pellicule d'eau qui draine le fond de la baignoire mouillée. Dans la platitude humide pointent seulement quelques huttes de chasseurs de canards. Et le paysage lui-même est semblable au cri du canard : solitude trempée des eaux plates, ouate grise, odeur de sauvagine, froid cru et stagnant du matin mal réveillé.
A Crotoy, en avant du rempart des villas serrées s'étend non pas une plage, mais plutôt un immense terrain vague de sable granuleux dont la croûte cède sous le pas comme aux abords d'un chott d'Algérie, seulement, si on s'y étend, le froid qui monte de sa profondeur vous en chasse. Je retournerai un jour vers ces sables décolorés - le Crotoy, Berck, Malo, Wimereux, Wissant, - ces plages livides des mers grises que visite à de longs intervalles , exsangue et flottant comme un ectoplasme de lumière, un fantôme de soleil blanc."
Bien sûr que Julien Gracq reste immense lorsqu'il décrit ce qu'il ressent lors ses voyages : ses descriptions remarquable de la nature, ses réflexions au fil de l'eau ou de la route, ses connexions culturelles ou historiques. Bref, une magnifique boîte de "chocolats éternels" à (re)consommer, à sucer, à mâchouiller avec lenteur et bonheur. On peut le laisser au bord de la route, puis le reprendre, ce livre ne vous en voudra jamais : cela pétille dans le coeur et l'esprit !
Recueil hétéroclite où Gracq se dévoile, avec son acuité coutumière, pot-pourri où l'on trouve pêle-mêle, ds un premier tps, des carnets de route, paysages, régions, et par la suite des analyses originales, littéraires bien sûr, mais aussi des souvenirs de guerre et d'enseignement, des réflexions sur les échecs, l'opéra, la géographie, etc.
A lire que l'on connaisse son oeuvre ou non.
A lire que l'on connaisse son oeuvre ou non.
Un chemin parsemé d'impressions d'images poétiques de réflexions, le tout dans un style pur. On prend plaisir à voyager avec Gracq, à travers ses mots, ses phrases toujours ciselées avec ce qu'il faut de précision et d'élégance pour faire de ces récits et réflexions un moment savoureux de littérature.
Citations et extraits (52)
Voir plus
Ajouter une citation
Presque aucune des routes où j'ai aimé m'engager, et qu'aujourd'hui encore j'aime reprendre, qui ne m'ait été, qui ne me demeure, comme une ouverture musicale, qui n'ait remué devant moi au bout de sa perspective, les plis et les lumières d'un rideau tout prêt à se lever. Pour quelques-unes, leur coloration à jamais joyeuse ou sombre est liée à l'attente, à l'anticipation de tristesse ou de bonheur sur laquelle elles s'ouvraient la première fois que je les ai prises -...-
Un calcul, même très approximatif, du nombre d’heures dont nous avons disposé au cours de notre vie pour la lecture, nous prouve que nous avons en réalité lu sensiblement moins de livres que nous ne le croyons. Nous n’avons pas eu le temps matériel de lire tous les livres que nous pensons avoir lus.
Mais les livres que nous avons lus sont bien loin d’être les seuls éléments de notre culture livresque. Comptent aussi, parfois presque autant, ceux dont nous avons entendu parler, d’une manière qui nous a fait dresser l’oreille (l’oreille interne), ceux dont un passage cité ailleurs isolément a éveillé en nous des échos précis, ou dont la mitoyenneté avec des ouvrages déjà connus de nous a permis au moins l’étiquetage. Ceux dont nous ne connaissons guère que le titre et le sens général, mais qui, dessinés en creux par les frontières des livres connexes, figurent pourtant, dans notre répertoire livresque, comme références utilisables.
Cette culture accrue par enjambements, par recoupements et par contamination, est peut-être la vraie culture livresque. Le livre est contagieux. La masse des livres déjà connus confère une demi-réalité maniable aux livres non lus encore qu’elle cerne et fait pressentir. Ainsi, à partir d’un certain acquis, la culture livresque, alors que la lecture ne suit qu’une progression arithmétique, peut se développer de manière presque exponentielle par une méthode qui n’est pas sans analogie avec la solution d’un puzzle, et que les polyglottes expérimentent tous pratiquement pour l’acquisition de nouvelles langues. Pour s’enrichir pleinement par la lecture, il ne suffit pas de lire, il faut savoir s’introduire dans la société des livres, qui nous font alors profiter de toutes leurs relations, et nous présentent à elles de proche en proche à l’infini. Une preuve a contrario en est fournie par l’autodidacte de La Nausée.
Mais les livres que nous avons lus sont bien loin d’être les seuls éléments de notre culture livresque. Comptent aussi, parfois presque autant, ceux dont nous avons entendu parler, d’une manière qui nous a fait dresser l’oreille (l’oreille interne), ceux dont un passage cité ailleurs isolément a éveillé en nous des échos précis, ou dont la mitoyenneté avec des ouvrages déjà connus de nous a permis au moins l’étiquetage. Ceux dont nous ne connaissons guère que le titre et le sens général, mais qui, dessinés en creux par les frontières des livres connexes, figurent pourtant, dans notre répertoire livresque, comme références utilisables.
Cette culture accrue par enjambements, par recoupements et par contamination, est peut-être la vraie culture livresque. Le livre est contagieux. La masse des livres déjà connus confère une demi-réalité maniable aux livres non lus encore qu’elle cerne et fait pressentir. Ainsi, à partir d’un certain acquis, la culture livresque, alors que la lecture ne suit qu’une progression arithmétique, peut se développer de manière presque exponentielle par une méthode qui n’est pas sans analogie avec la solution d’un puzzle, et que les polyglottes expérimentent tous pratiquement pour l’acquisition de nouvelles langues. Pour s’enrichir pleinement par la lecture, il ne suffit pas de lire, il faut savoir s’introduire dans la société des livres, qui nous font alors profiter de toutes leurs relations, et nous présentent à elles de proche en proche à l’infini. Une preuve a contrario en est fournie par l’autodidacte de La Nausée.
Lorsque nous partîmes en mai 1940 pour la Hollande — une des pièces maîtresses dans la stratégie du général Gamelin — nous débarquâmes du train le 13 dans le soir avancé à proximité de St-Nicolas d’Anvers et nous passâmes le reste de la nuit sur l’herbe du bas-côté de la route. Le matin fut radieux. Nous marchions par une petite route de terre vers le bourg de Sinai ; la luxuriance de la campagne flamande m’éblouissait : après les resserres à fumier de la Lorraine, les tourbières de la Canche et de l’Authie, on allait enfin cantonner dans le pays de Cocagne. Le bourg était si récuré, si net, qu’il paraissait vernissé; il m’échut une chambre fraîchement lessivée, à carreau et édredon rouge: j’étais si fatigué que je me coulai séance tenante entre les draps. Mais je n’y trouvai pas le sommeil. Par intervalles espacés, maintenant que le remue-ménage de l’installation s’était tu, le bruit du canon, tellement inattendu pour nous si loin de la frontière, éveillait le silence de cette chambre de béguinage. La joue collée voluptueusement à l’oreiller, aussi frais qu’un oreiller proustien, je tentai un moment de croire à quelque combat naval en mer du Nord, mais un planton me tira incontinent du lit. On partait, en catastrophe, abandonnant dans le village à la garde d’un sergent nos cantines et tout notre convoi de voitures. En quelques minutes, I’atmosphère avait changé: l’urgence, l’incohérence de cette fête en avant, le décombre de nos bagages sur les bas-côtés, où déjà s’attroupaient des Flamands goguenards, tout avait soudain une odeur de désastre. C’était le moment tout juste où les Allemands passaient la Meuse à Sedan.
St-Nicolas d’Anvers, tous feux éteints, grouillait de troupes emmêlées, silencieuses dans le noir; la rue principale n’était qu’un long embarras de voitures. Nous apprîmes qu’Anvers était déjà sous les obus, et qu’on minait en hâte le tunnel routier de l’Escaut. Mais, au lieu de suivre le chemin de la grande ville vers laquelle le feu aurait dû nous aspirer, nous prîmes droit au nord, et bientôt nous fîmes route dans le désert d’une campagne qui semblait inhabitée, tant elle était sourde et muette. A droite, nous longions des bois de pins très sombres qui devaient être les dernières avancées de la Campine. A gauche, la route, qui bientôt devint digue, dominait un pays bas où l’œil ne saisissait aucune ligne, aucun objet discernable, mais d’où montait une faible haleine mouillée qui parlait de la mer. La solitude brusque, le silence sans fond faisaient penser aux changements à vue du rêve, où une prote qu’on pousse se change en tapis volant, donne instantanément sur un autre climat, une autre contrée, une autre époque. La troupe déjà harassée (c’était notre première marche depuis des mois) cheminait sans souffler mot ; aux haltes, les hommes tombaient sur le dos, entraînés par le poids du sac. La fatigue, I’insomnie rendaient irréelle la contrée inconnue où nous pénétrions: ni villages, ni maisons au long de notre route, rien que ce goût de mouillure d’une étendue liquide invisible, ce silence qui semblait émerger d’un en deçà des temps. Un moment, nous marchâmes vers un point de l’étendue noire où, à intervalles espacés, s’allumait une lueur masquée; le sillage d’un fracas théâtral enjambait la voûte de la nuit pendant de longues secondes, s’éteignait, puis un point rouge à peine perceptible se rallumait sans aucun bruit à l’horizon: cette balistique alanguie et abstraite fonctionnant au cœur des ténèbres ne s’accordait guère pour mon inexpérience avec l’idée d’un tir d’artillerie lourde. Nous passâmes à l’aplomb de la voûte de vacarme. Puis nous laissâmes dériver peu à peu la source lumineuse intermittente sur notre arrière comme un bateau-feu, et de nouveau ce fut le silence noir: la nuit ressemblait à une traversée de la mer. Comme se levait à peine le petit matin gris, nous arrivâmes à un bourg, presque une villette même, avec sa grand’ place pavée, mais une villette naine aux maisons de poupée, aux portes qui semblaient ne livrer passage que de profil : Kieldrecht. On s’attendait presque à en voir sortir les magots naïfs et mécaniques, à sabots vernis et pipes de porcelaine, qui peuplent un des contes d’Edgar Poe : c’était le bourg de Vondervotteimitis — mais il était trop tôt encore pour les santons indigènes ; il n’y avait âme qui vive dans les rues. Là-dessus le bataillon se disloqua et les sections voguèrent chacune vers leur emplacement de combat, au travers d’une sorte d’Eden pastoral dont le souvenir enchanté peuple encore les pages de La Sieste en Flandre hollandaise. Nous fîmes encore sept à huit kilomètres, en file indienne sur la crête des digues gazonnées; enfin mon guide (nous n’avions pas de cartes des Pays-Bas) me désigna le polder dont j’avais à assurer la défense avec mes vingt-cinq hommes contre des "engins mécaniques amphibies susceptibles de traverser l’Escaut": une immense pelouse d’un bon kilomètre carré, cernée de ses peupliers comme la cuve d’un stade de sa haie d’oriflammes, et paisiblement habitée de ruminants déjà à l’ouvrage. On n’entendait pas d’autre bruit, dans ce séduisant bout-du-monde, que le meuglement des vaches laitières et le froissement de la petite brise de mer dans les peupliers: désorienté par ce champ de bataille bucolique, mais un peu dépeuplé, car je n’avais de voisins qu’à un bon kilomètre, j’adressai quelques mots d’encouragement à mes hommes et je les assurai que sur la crête des digues nous n’avions rien à craindre des chars (sic). Mais ils ne semblaient guère en souci des chars, ou plutôt ils dormaient déjà debout: trois minutes plus tard, toute la section ronflait vautrée dans l’herbe juteuse: des chars amphibies fantômes, nul ne vit jamais trace. Ce déraillement onirique, qui nous rejetait d’un seul déclic hors du sentier de la guerre au moment même du "baptême du feu", cette marche fourvoyée à travers des champs d’asphodèles dont l’Histoire n’était plus que le songe insignifiant sont restés dans mon esprit comme un trip virgilien dont je demeurai longtemps drogué : "perque domos ditis vacuas et inania regna" (*)
(*) "A travers les demeures vides et le royaume désert de Pluton".
[Julien GRACQ, "Carnets du grand chemin", José Corti éditeur (Paris), 310 pages, 1992 — pages 139 à 143]
St-Nicolas d’Anvers, tous feux éteints, grouillait de troupes emmêlées, silencieuses dans le noir; la rue principale n’était qu’un long embarras de voitures. Nous apprîmes qu’Anvers était déjà sous les obus, et qu’on minait en hâte le tunnel routier de l’Escaut. Mais, au lieu de suivre le chemin de la grande ville vers laquelle le feu aurait dû nous aspirer, nous prîmes droit au nord, et bientôt nous fîmes route dans le désert d’une campagne qui semblait inhabitée, tant elle était sourde et muette. A droite, nous longions des bois de pins très sombres qui devaient être les dernières avancées de la Campine. A gauche, la route, qui bientôt devint digue, dominait un pays bas où l’œil ne saisissait aucune ligne, aucun objet discernable, mais d’où montait une faible haleine mouillée qui parlait de la mer. La solitude brusque, le silence sans fond faisaient penser aux changements à vue du rêve, où une prote qu’on pousse se change en tapis volant, donne instantanément sur un autre climat, une autre contrée, une autre époque. La troupe déjà harassée (c’était notre première marche depuis des mois) cheminait sans souffler mot ; aux haltes, les hommes tombaient sur le dos, entraînés par le poids du sac. La fatigue, I’insomnie rendaient irréelle la contrée inconnue où nous pénétrions: ni villages, ni maisons au long de notre route, rien que ce goût de mouillure d’une étendue liquide invisible, ce silence qui semblait émerger d’un en deçà des temps. Un moment, nous marchâmes vers un point de l’étendue noire où, à intervalles espacés, s’allumait une lueur masquée; le sillage d’un fracas théâtral enjambait la voûte de la nuit pendant de longues secondes, s’éteignait, puis un point rouge à peine perceptible se rallumait sans aucun bruit à l’horizon: cette balistique alanguie et abstraite fonctionnant au cœur des ténèbres ne s’accordait guère pour mon inexpérience avec l’idée d’un tir d’artillerie lourde. Nous passâmes à l’aplomb de la voûte de vacarme. Puis nous laissâmes dériver peu à peu la source lumineuse intermittente sur notre arrière comme un bateau-feu, et de nouveau ce fut le silence noir: la nuit ressemblait à une traversée de la mer. Comme se levait à peine le petit matin gris, nous arrivâmes à un bourg, presque une villette même, avec sa grand’ place pavée, mais une villette naine aux maisons de poupée, aux portes qui semblaient ne livrer passage que de profil : Kieldrecht. On s’attendait presque à en voir sortir les magots naïfs et mécaniques, à sabots vernis et pipes de porcelaine, qui peuplent un des contes d’Edgar Poe : c’était le bourg de Vondervotteimitis — mais il était trop tôt encore pour les santons indigènes ; il n’y avait âme qui vive dans les rues. Là-dessus le bataillon se disloqua et les sections voguèrent chacune vers leur emplacement de combat, au travers d’une sorte d’Eden pastoral dont le souvenir enchanté peuple encore les pages de La Sieste en Flandre hollandaise. Nous fîmes encore sept à huit kilomètres, en file indienne sur la crête des digues gazonnées; enfin mon guide (nous n’avions pas de cartes des Pays-Bas) me désigna le polder dont j’avais à assurer la défense avec mes vingt-cinq hommes contre des "engins mécaniques amphibies susceptibles de traverser l’Escaut": une immense pelouse d’un bon kilomètre carré, cernée de ses peupliers comme la cuve d’un stade de sa haie d’oriflammes, et paisiblement habitée de ruminants déjà à l’ouvrage. On n’entendait pas d’autre bruit, dans ce séduisant bout-du-monde, que le meuglement des vaches laitières et le froissement de la petite brise de mer dans les peupliers: désorienté par ce champ de bataille bucolique, mais un peu dépeuplé, car je n’avais de voisins qu’à un bon kilomètre, j’adressai quelques mots d’encouragement à mes hommes et je les assurai que sur la crête des digues nous n’avions rien à craindre des chars (sic). Mais ils ne semblaient guère en souci des chars, ou plutôt ils dormaient déjà debout: trois minutes plus tard, toute la section ronflait vautrée dans l’herbe juteuse: des chars amphibies fantômes, nul ne vit jamais trace. Ce déraillement onirique, qui nous rejetait d’un seul déclic hors du sentier de la guerre au moment même du "baptême du feu", cette marche fourvoyée à travers des champs d’asphodèles dont l’Histoire n’était plus que le songe insignifiant sont restés dans mon esprit comme un trip virgilien dont je demeurai longtemps drogué : "perque domos ditis vacuas et inania regna" (*)
(*) "A travers les demeures vides et le royaume désert de Pluton".
[Julien GRACQ, "Carnets du grand chemin", José Corti éditeur (Paris), 310 pages, 1992 — pages 139 à 143]
« […] L’arbre… Il n’apparaissait d’abord qu’au fond des vallées, dans les files de peupliers qui pacageaient leurs prairies molles, ou bien par intervalles, dans le lointain du plateau, un bouquet de noyers appuyant leurs branches basses sur les clôtures de pierres sèches d’une cour de métairie. Maintenant — comme une foule sortie on ne sait d’où qui s’agglomère en grappes — d’abord posté de loin en loin en sentinelle, il accourt de partout vers la route que vient reborder peu à peu de chaque côté une fourrure luxuriante d’herbe verte. Non plus le noyer grêle aux feuilles claires, mais le châtaignier vert sombre, piqué de rosettes d’un vert plus jaune, dont l’ombrage est si lourd, et le massif de feuillage si compact. Et, de toutes parts, gardés par ces hautes tours vertes, s’étalent non plus les chaumes secs et les éteules roussies du Poitou, mais de profonds étangs d’herbe, enclos entre les berges des haies, chambres de verdure secrètes qui s’imbriquent et s’entr’rouvrent indéfiniment l’une sur l’autre, pelucheuses, moelleuses, encourtinées, et d’où l’haleine des plantes confinées déferle sur la route aussi intime et entêtante que la touffeur d’une alcôve. Ce n’est pas la forêt, clairement délimitée, avec l’aplomb de sa muraille nette et l’avalement brutal, en coup de vent, de la route par sa haute tranchée noire — ce n’est pas le bocage aux haies de ronciers plus épaisses et plus maigres — c’est un enfièvrement congestif du monde des plantes, qui monte, gonfle et s’amasse peu à peu des deux côtés de la route comme un orage vert. Les branches s’avancent au-dessus de la chaussée et y dégorgent lentement, goutte à goutte, l’eau lourde de la dernière averse : au-dessous d’elles, le long des bas-côtés où s’épaissit l’herbe vorace, les paravents des haies ferment toute issue au regard ; le bourrelet tremblant des fougères vient onduler jusqu’à l’asphalte. On se laisse couler comme au cœur d’une eau verte et lustrale dans l’énorme respiration calme : nulle forêt noire, dans sa plantation ligneuse, son odeur de cave et de fagot, ne se referme sur le promeneur aussi voluptueusement que ce bain de plantes fermé comme une voûte, duveteux comme une mousse, qui comble et étanche en nous quelque chose de plus ancien que la soif. Très loin au-delà de cette déflagration de verdure qui monte sur la terre et gonfle ses ombrelles vertes, il y a une grande ville, mais son existence même s’embrume, et ce n’est pas vers elle qu’on marche : on monte, on voudrait continuer à monter interminablement vers ce haut pays de la verdure arborescente, à travers laquelle filtrent maintenant les barreaux horizontaux du soleil, où rien ne frappe plus l’oreille que le craquement solennel des branches chauffées, et où on croit entendre quelquefois l’arbre respirer. […] » [pp.67-69]
Le beige très clair, décoloré, des brisées de fougères sèches, quand elles s'exposent à la cuisson du soleil sur les brandes nues, fait penser à une jonchée de très fins squelettes végétaux. Ce qui craque ici sous le pied, comme un bris de verre filé, ce n'est plus la "dépouille de l'hiver" des allées spongieuses de novembre, mais une sorte d'ossuaire végétal, friable et délicat, blanchi de soleil, et dont la siccité cassante semble démentir nos hivers pluvieux.
Il y a là comme un refus qui surprend, tant il nous paraît isolé, de l'humidité de la mort végétale, si docile d'habitude à se laisser résorber dans l'humus. Ainsi font, paraît-il, les chardons des steppes du Baragan, dont la sécheresse de l'été brise la tige au ras du sol, et dont le vent chasse longuement sur le sol le troupeau flou des boules épineuses, comme des Lémures végétaux en peine de sépulture et de repos.
Il y a là comme un refus qui surprend, tant il nous paraît isolé, de l'humidité de la mort végétale, si docile d'habitude à se laisser résorber dans l'humus. Ainsi font, paraît-il, les chardons des steppes du Baragan, dont la sécheresse de l'été brise la tige au ras du sol, et dont le vent chasse longuement sur le sol le troupeau flou des boules épineuses, comme des Lémures végétaux en peine de sépulture et de repos.
Videos de Julien Gracq (34)
Voir plusAjouter une vidéo
À travers les différents ouvrages que l'auteur a écrit pendant et après ses voyages à travers le monde, la poésie a pris une place importante. Mais pas que ! Sylvain Tesson est venu sur le plateau de la grande librairie avec les livres ont fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui, au-delàs de ses voyages. "Ce sont les livres que je consulte tout le temps. Je les lis, je les relis et je les annote" raconte-il à François Busnel. Parmi eux, "Entretiens" de Julien Gracq, un professeur de géographie, "Sur les falaises de marbres" d'Ernst Jünger ou encore, "La Ferme africaine" de Karen Blixen.
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Julien Gracq (36)
Voir plus
Quiz
Voir plus
900ème : Spécial Julien Gracq
Julien était bel homme, on le qualifiait parfois de beau ...?...
spécimen
ténébreux
gosse
Brummel
11 questions
26 lecteurs ont répondu
Thème :
Julien GracqCréer un quiz sur ce livre26 lecteurs ont répondu