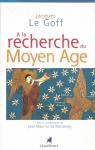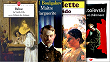Critiques de Jacques Le Goff (106)
Passionnée par les romans historiques et plus particulièrement par le Moyen-âge, j'ai ressenti le besoin de lire des livres d'Histoire et non plus des histoires sur cette période. Je me suis donc tournée vers l'une des oeuvres de Jacques Le Goff, l'un des plus célèbre médieviste.
J'ai choisit "A la recherche du Moyen-Âge" car ce livre permet une rencontre en "douceur" avec cette époque. On y retrouve beaucoup d'informations, les grandes lignes et les grandes idées principales qui font le Moyen-âge, expliquées de façon à être comprises par le grand public.
Très bon livre "d'introduction" qui me conduira naturellement vers des ouvrages plus poussés sur le sujet. Jacques Le Goff réussit à nous transmettre sa passion pour cette époque qui n'a rien de médiocre ou d'ennuyeuse comme le sous-entends le terme pejoratif de "moyen".
J'ai choisit "A la recherche du Moyen-Âge" car ce livre permet une rencontre en "douceur" avec cette époque. On y retrouve beaucoup d'informations, les grandes lignes et les grandes idées principales qui font le Moyen-âge, expliquées de façon à être comprises par le grand public.
Très bon livre "d'introduction" qui me conduira naturellement vers des ouvrages plus poussés sur le sujet. Jacques Le Goff réussit à nous transmettre sa passion pour cette époque qui n'a rien de médiocre ou d'ennuyeuse comme le sous-entends le terme pejoratif de "moyen".
J'ai beaucoup aimé ce livre écrit par l'historien médiéviste Jacques le Goff au crépuscule de sa vie en 2003. Il y présente de manière très abordable pour un non spécialiste une synthèse des travaux qu'il a consacrés au Moyen-Age pendant toute sa carrière.
Il commence par un éclairage intéressant sur les questions de méthode propres à la discipline historique. L'histoire est présentée comme la science des sources. Cela lui donne l'occasion de retracer l'histoire du support écrit et de l'écriture depuis les rouleaux de l'antiquité jusqu'au livre imprimé de la Renaissance. Il montre aussi comment les sources utilisées par l'historien sont aujourd'hui beaucoup plus variées que celles utilisées il y a cent ans, provenant alors principalement des archives juridiques (les chartes).
Après avoir défini ce qu'on appelle Moyen Age et insisté sur la continuité à l'oeuvre dans l'histoire, beaucoup plus importante que les ruptures, le Goff revient ensuite les thèmes de ses travaux. C'est en particulier le sujet des marchands-banquiers et des intellectuels, groupes sociaux qui émergent au XIIème siècle environ en parallèle du développement du commerce, des villes et des universités. Il tente aussi de définir ce qu'est la civilisation médiévale, centrée sur la religion chrétienne, qui structure toute la vie des hommes du Moyen-Age. En particulier, il s'étend longuement sur la façon dont le temps et l'espace sont pensés au Moyen-Age. La nouveauté et le progrès n'ont pas de valeur mais le déroulement du temps est considéré comme menant à une fin, qui sera une renaissance dans un monde éternel. de manière plus terre à terre, le Goff décrit comment le temps médiéval s'est peu à peu structuré avec la mise en place de calendriers, laïque et chrétien, l'organisation de la semaine et des journées (avec par exemple l'usage des cloches). Dans le domaine de l'espace, le Goff raconte de manière toujours aussi passionnante le développement des cartes, le maillage du territoire à la fois par un réseau de sanctuaires dotés de reliques et par un réseau fondé sur le commerce. Il donne également un éclairage sur la féodalité, sur le droit médiéval, sur la spiritualité en s'appuyant sur quelques figures auxquelles il a consacré ses travaux comme le roi Saint Louis ou saint François d'Assise.
En résume, un excellent livre de vulgarisation, dans le bon sens du terme, très facile d'accès tout en n'étant pas simpliste. Un livre après lequel on se sent plus intelligent.
Il commence par un éclairage intéressant sur les questions de méthode propres à la discipline historique. L'histoire est présentée comme la science des sources. Cela lui donne l'occasion de retracer l'histoire du support écrit et de l'écriture depuis les rouleaux de l'antiquité jusqu'au livre imprimé de la Renaissance. Il montre aussi comment les sources utilisées par l'historien sont aujourd'hui beaucoup plus variées que celles utilisées il y a cent ans, provenant alors principalement des archives juridiques (les chartes).
Après avoir défini ce qu'on appelle Moyen Age et insisté sur la continuité à l'oeuvre dans l'histoire, beaucoup plus importante que les ruptures, le Goff revient ensuite les thèmes de ses travaux. C'est en particulier le sujet des marchands-banquiers et des intellectuels, groupes sociaux qui émergent au XIIème siècle environ en parallèle du développement du commerce, des villes et des universités. Il tente aussi de définir ce qu'est la civilisation médiévale, centrée sur la religion chrétienne, qui structure toute la vie des hommes du Moyen-Age. En particulier, il s'étend longuement sur la façon dont le temps et l'espace sont pensés au Moyen-Age. La nouveauté et le progrès n'ont pas de valeur mais le déroulement du temps est considéré comme menant à une fin, qui sera une renaissance dans un monde éternel. de manière plus terre à terre, le Goff décrit comment le temps médiéval s'est peu à peu structuré avec la mise en place de calendriers, laïque et chrétien, l'organisation de la semaine et des journées (avec par exemple l'usage des cloches). Dans le domaine de l'espace, le Goff raconte de manière toujours aussi passionnante le développement des cartes, le maillage du territoire à la fois par un réseau de sanctuaires dotés de reliques et par un réseau fondé sur le commerce. Il donne également un éclairage sur la féodalité, sur le droit médiéval, sur la spiritualité en s'appuyant sur quelques figures auxquelles il a consacré ses travaux comme le roi Saint Louis ou saint François d'Assise.
En résume, un excellent livre de vulgarisation, dans le bon sens du terme, très facile d'accès tout en n'étant pas simpliste. Un livre après lequel on se sent plus intelligent.
A force de visiter les abbayes bourguignonnes et les Maîtres de la Renaissance comme Fra Angelico, je ne pouvais pas ne pas m’intéresser à la Légende Dorée, ce recueil fameux des vies de saints écrit au XIIIème siècle, et souvent présenté comme un catalogue hagiographique fourre-tout. Et voilà que cet essai savant, dense et court, mais écrit dans un langage limpide et surtout accessible à toute personne dénuée de culture religieuse approfondie, nous replonge avec sagesse dans l’esprit de ce temps qui fut un siècle de stabilité et de forte croissance économique.
Un mot sur l’auteur : Jacques Le Goff (né en 1924) est l’un des spécialistes les plus éminents du Moyen-Âge. Assistant de Fernand Braudel, il dirigea, avec Emmanuel Le Roy Ladurie et Marc Ferro « Les Annales ». Tout est dit ! Il s’intéresse à l’histoire des mentalités, qui « mue par des mouvements profonds et continus, elle ne connaît pas de rupture brusque ». Du XIIIème siècle on retiendra l’attitude à l’égard de la femme, l’appréciation de la positivité du travail et l’omniprésence de la religion.
Qu’est-ce que la Légende Dorée ? D’abord le « best-seller » d’une époque où chaque livre est recopié à la main. De cet ouvrage, on recense encore aujourd’hui plus de mille copies ! Il fut écrit en 1262-1264 et comporte, à travers 178 chapitres, les notices de 153 saints, classés selon l’ordre chronologique de leur célébration dans le temps liturgique, de l’Avent (4 semaines avant Noël) à la fin novembre. Pourquoi 153 ? Parce que, lors de la pêche miraculeuse, Pierre sortit de l’eau 153 gros poissons…La Légende Dorée fut compilée par Iacopo da Varazze, que nous appelons Jacques de Voragine, moine dominicain (ordre prêcheur), devenu évêque de Gènes, comme un ouvrage servant à la préparation des sermons par les prédicateurs.
L’essai de Jacques Le Goff est une merveilleuse explication de texte. C’est d’abord une défense et illustration de la compilation qui sait aussi devenir véritablement création. Jacques de Voragine cite ses multiples sources, choisit celle qui lui semble la plus pertinente, même parmi les ouvrages non reconnus officiellement par l’Eglise – les évangiles apocryphes par exemple, considérés comme pourvoyeurs d’informations historiques.
La clé de l’immense succès de ce livre dès sa parution : un engouement comparé par Jacques Le Goff à celui des films d’aventure par l’efficacité des récits et de « faits divers » merveilleux qui entourent la destinée des saints. La personne du saint est propre à la religion chrétienne. Sa caractéristique est d’avoir été choisi par Dieu pour se manifester sur terre à sa place comme instrument ou intermédiaire, par des miracles, des vertus ou un comportement exceptionnellement religieux dans son existence terrestre. Je comprends aujourd’hui aussi l’immense succès des reliques, découvertes, morcelées, réparties, achetées, vendues, volées, et du pouvoir qui leur était attaché au point de déclencher la construction de sanctuaires magnifiques et de provoquer des pèlerinages d’une amplitude énorme.
L’ouvrage de Jacques Le Goff est entièrement centré sur la place du temps : le temps tout entier doit être, à toute heure, consacré à la louange de Dieu. La Légende Dorée explique la finalité de la succession des manifestations et des fêtes de l’année et décrit à cette occasion la vie des saints. Elle a joué à ce titre un rôle déterminant dans l’élaboration de la culture européenne. Une des vertus du temps est de pouvoir effacer un mauvais moment du passé en y superposant un bon moment pour l’avenir. Ce pourquoi on célèbre les saints non pas au jour de leur naissance – le plus souvent ignoré au Moyen-Âge – mais à celui de leur mort ou encore à celui de l’invention de leur corps ou de leurs reliques. Et c’est un jour de fête et non de tristesse. On souligne aussi la nécessité de célébrer la Toussaint, créée récemment pour ne pas risquer d’oublier un seul des saints.
Voici donc un ouvrage savant mais facile à lire et relativement court, permettant d’appréhender la structuration du temps religieux à l’poque de la construction des cathédrales, et souvent aussi de comprendre les grandes œuvres des peintres qui s’en sont directement inspirés…J’ai ici en mémoire les extraordinaires fresques de la Chapelle Brancacci à Florence racontant la vie de Saint Pierre, par Masaccio et Masolino. Et un très bon antidote au livre d’Eric Stemmelin, La Religion des seigneurs.
Lien : http://www.bigmammy.fr
Un mot sur l’auteur : Jacques Le Goff (né en 1924) est l’un des spécialistes les plus éminents du Moyen-Âge. Assistant de Fernand Braudel, il dirigea, avec Emmanuel Le Roy Ladurie et Marc Ferro « Les Annales ». Tout est dit ! Il s’intéresse à l’histoire des mentalités, qui « mue par des mouvements profonds et continus, elle ne connaît pas de rupture brusque ». Du XIIIème siècle on retiendra l’attitude à l’égard de la femme, l’appréciation de la positivité du travail et l’omniprésence de la religion.
Qu’est-ce que la Légende Dorée ? D’abord le « best-seller » d’une époque où chaque livre est recopié à la main. De cet ouvrage, on recense encore aujourd’hui plus de mille copies ! Il fut écrit en 1262-1264 et comporte, à travers 178 chapitres, les notices de 153 saints, classés selon l’ordre chronologique de leur célébration dans le temps liturgique, de l’Avent (4 semaines avant Noël) à la fin novembre. Pourquoi 153 ? Parce que, lors de la pêche miraculeuse, Pierre sortit de l’eau 153 gros poissons…La Légende Dorée fut compilée par Iacopo da Varazze, que nous appelons Jacques de Voragine, moine dominicain (ordre prêcheur), devenu évêque de Gènes, comme un ouvrage servant à la préparation des sermons par les prédicateurs.
L’essai de Jacques Le Goff est une merveilleuse explication de texte. C’est d’abord une défense et illustration de la compilation qui sait aussi devenir véritablement création. Jacques de Voragine cite ses multiples sources, choisit celle qui lui semble la plus pertinente, même parmi les ouvrages non reconnus officiellement par l’Eglise – les évangiles apocryphes par exemple, considérés comme pourvoyeurs d’informations historiques.
La clé de l’immense succès de ce livre dès sa parution : un engouement comparé par Jacques Le Goff à celui des films d’aventure par l’efficacité des récits et de « faits divers » merveilleux qui entourent la destinée des saints. La personne du saint est propre à la religion chrétienne. Sa caractéristique est d’avoir été choisi par Dieu pour se manifester sur terre à sa place comme instrument ou intermédiaire, par des miracles, des vertus ou un comportement exceptionnellement religieux dans son existence terrestre. Je comprends aujourd’hui aussi l’immense succès des reliques, découvertes, morcelées, réparties, achetées, vendues, volées, et du pouvoir qui leur était attaché au point de déclencher la construction de sanctuaires magnifiques et de provoquer des pèlerinages d’une amplitude énorme.
L’ouvrage de Jacques Le Goff est entièrement centré sur la place du temps : le temps tout entier doit être, à toute heure, consacré à la louange de Dieu. La Légende Dorée explique la finalité de la succession des manifestations et des fêtes de l’année et décrit à cette occasion la vie des saints. Elle a joué à ce titre un rôle déterminant dans l’élaboration de la culture européenne. Une des vertus du temps est de pouvoir effacer un mauvais moment du passé en y superposant un bon moment pour l’avenir. Ce pourquoi on célèbre les saints non pas au jour de leur naissance – le plus souvent ignoré au Moyen-Âge – mais à celui de leur mort ou encore à celui de l’invention de leur corps ou de leurs reliques. Et c’est un jour de fête et non de tristesse. On souligne aussi la nécessité de célébrer la Toussaint, créée récemment pour ne pas risquer d’oublier un seul des saints.
Voici donc un ouvrage savant mais facile à lire et relativement court, permettant d’appréhender la structuration du temps religieux à l’poque de la construction des cathédrales, et souvent aussi de comprendre les grandes œuvres des peintres qui s’en sont directement inspirés…J’ai ici en mémoire les extraordinaires fresques de la Chapelle Brancacci à Florence racontant la vie de Saint Pierre, par Masaccio et Masolino. Et un très bon antidote au livre d’Eric Stemmelin, La Religion des seigneurs.
Lien : http://www.bigmammy.fr
lu avec passion longtemps après la légende dorée de Voragine
L'édition scientifique italienne de «la Légende dorée» en 2005 a servi de déclic. [Jacques Le Goff ] s'est replongé dans le texte et en a tiré bien plus qu'une évocation des saints: une compréhension du temps, des temps pour être précis, au Moyen Age:
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Très joli livre, tout en subtilité, qui touche par la grâce et la délicatesse de l'auteur. C'est aussi une joie de découvrir la vie d'un chercheur, ses rencontres, ses amis, ses voyages.
La notion de Cocagne est largement passée dans le langage courant : on parle d'un "pays de Cocagne" pour un lieu idéal ou encore d'un "mât de cocagne", jeu qui permet de remporter profusion de cadeaux. Mais qu'en est-il de l'origine de ce terme ?
L'utopie ou mythe de Cocagne naît quelque part autour du XIIe siècle, et apparaît de manière structurée dans le Fabliau de Cocagne, poème du XIIIè siècle d'origine picarde. En parallèle, d'autres textes concurrent, exploitant la même thématique, avec des différences culturelles tenant au lieu de création, apparaîssent, tel The Land of Cockaygne, poème irlando-anglais du XIVe.
L'auteur de cet ouvrage, après nous avoir proposé la version la plus courante de ces deux poèmes, analyse en profondeur leur contexte (le monde médiéval gros créateur d'utopies), le public cible (dans un premier temps probablement la petite "bourgeoisie" et le bas clergé, avant de traduire de plus en plus l'idéal populaire), le lien avec l'Eglise et la transgression (liberté alimentaire et sexuelle dans un monde où le carême et les jours de jeûne limitent les plaisirs), l'abondance sans effort portée par ces poèmes face aux disettes et au labeur du quotidien...
Un monde inversé, où qui dort dîne, où le travail est inutile et se fait pour le plaisir, où nourriture et vêtements se préparent seuls.
L'auteur compare aussi les versions françaises et anglaises, la deuxième étant encore plus "légère" que la première, plus abondante et plus colorée, tel un paradis du quotidien.
L'ouvrage est dense, contient énormément d'informations sur l'esprit médiéval, ses aspirations et interdits. Il est touffu et se lit avec concentration, mais ne demande pas de grandes connaissances historiques. Il bénéficie aussi du style bien travaillé d'Hilario Franco Junior.
Je le recommande aux curieux du passé !
L'utopie ou mythe de Cocagne naît quelque part autour du XIIe siècle, et apparaît de manière structurée dans le Fabliau de Cocagne, poème du XIIIè siècle d'origine picarde. En parallèle, d'autres textes concurrent, exploitant la même thématique, avec des différences culturelles tenant au lieu de création, apparaîssent, tel The Land of Cockaygne, poème irlando-anglais du XIVe.
L'auteur de cet ouvrage, après nous avoir proposé la version la plus courante de ces deux poèmes, analyse en profondeur leur contexte (le monde médiéval gros créateur d'utopies), le public cible (dans un premier temps probablement la petite "bourgeoisie" et le bas clergé, avant de traduire de plus en plus l'idéal populaire), le lien avec l'Eglise et la transgression (liberté alimentaire et sexuelle dans un monde où le carême et les jours de jeûne limitent les plaisirs), l'abondance sans effort portée par ces poèmes face aux disettes et au labeur du quotidien...
Un monde inversé, où qui dort dîne, où le travail est inutile et se fait pour le plaisir, où nourriture et vêtements se préparent seuls.
L'auteur compare aussi les versions françaises et anglaises, la deuxième étant encore plus "légère" que la première, plus abondante et plus colorée, tel un paradis du quotidien.
L'ouvrage est dense, contient énormément d'informations sur l'esprit médiéval, ses aspirations et interdits. Il est touffu et se lit avec concentration, mais ne demande pas de grandes connaissances historiques. Il bénéficie aussi du style bien travaillé d'Hilario Franco Junior.
Je le recommande aux curieux du passé !
Du silence à la parole : Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours
Jacques Le Goff
Jacques Le Goff
Au moment où l'on assiste à une évidente redéfinition du contrat de travail et à une évolution du monde du travail - qualifiée souvent d'« uberisation » ou « amazonisation » -, Jacques Le Goff nous offre un survol historique des grands combats pour la naissance d'un droit du travail : la création des sociétés de secours mutuel, l'apparition des syndicats, du contrat de travail, du Code du Travail, des congés payés... Avec un esprit de synthèse remarquable, soucieux d'expliquer les enjeux, le contexte et les aspirations de chaque époque, l'auteur produit une contribution majeure à la compréhension de ce sujet. Une fresque historique unique en son genre, essentielle pour comprendre les normes juridiques en vigueur et l'évolution des rapports sociaux.
Lien : https://www.mediathequeouest..
Lien : https://www.mediathequeouest..
Du silence à la parole : Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours
Jacques Le Goff
Jacques Le Goff
Début XIXème , l’industrialisation s’invite dans le monde du travail et va générer des bouleversements importants tant dans les rapports sociaux que dans l’espace privé de chaque travailleur. Dans les régions où l’industrialisation est massive, les manufactures se multiplient : tous y travaillent, hommes, femmes et enfants. Les conditions, les contraintes, le rendement sont les mêmes quel que soit le sexe ou l’âge. Les revenus issus du travail sont si maigres que toute la famille doit s’y coller si l’on veut subsister. Le patron régit le quotidien des ouvriers et de leurs familles, en construisant des cités aux abords de l’usine, en créant des commerces, en salariant un médecin : un monde clos voit le jour. Le patron, figure patriarcale, seul législateur, instaure une « neo-féodalité despotique ». Il impose un temps précis, celui de l’horloge. Le travail n’est plus alors rythmé par les saisons, le lever du soleil. Le temps devient une unité de compte économique, le temps du travail devient un temps social.
Le passage du contrat de louage au contrat de travail marque une première étape dans la reconnaissance par l’Etat de la nécessité de protéger les travailleurs, le rapport de force est par trop inégal. Entre 1880 et 1936, le travail – ses conditions et les relations contractuelles qui lui sont inhérentes – devient un objet qu’il s’agit de règlementer sous peine de débordements et d’émeutes. De nombreuses lois viennent garantir le cadre de son exercice, la santé, la protection, la prévoyance. En 1904, par exemple, la loi Millerand introduit une durée légale de travail quotidien : ce sera, pour tous, 10 heures. C’est, à l’époque, une véritable avancée pour les travailleurs…
L’auteur déroule donc cette histoire jusque dans les années 2000. On connait davantage les évolutions qui suivent la période de 36 et du Front Populaire, les congés payés notamment. J’ai donc été davantage intéressée par le récit des décennies précédentes. Il est important, me semble-t-il, de se remémorer les grands combats menés de concert par le prolétariat et les courants politiques réformateurs, catholiques et socialistes qui ont permis que soient reconnus des droits à tous les travailleurs. Du silence à la parole ou comment l’ouvrier, le salarié accède à un statut, obtient le droit de s’exprimer, d’être représenté par des instances collectives, de voir ses conditions de travail améliorées. Très intéressant, très bien écrit, dans un style inhabituel pour ce type d’ouvrage.
Le passage du contrat de louage au contrat de travail marque une première étape dans la reconnaissance par l’Etat de la nécessité de protéger les travailleurs, le rapport de force est par trop inégal. Entre 1880 et 1936, le travail – ses conditions et les relations contractuelles qui lui sont inhérentes – devient un objet qu’il s’agit de règlementer sous peine de débordements et d’émeutes. De nombreuses lois viennent garantir le cadre de son exercice, la santé, la protection, la prévoyance. En 1904, par exemple, la loi Millerand introduit une durée légale de travail quotidien : ce sera, pour tous, 10 heures. C’est, à l’époque, une véritable avancée pour les travailleurs…
L’auteur déroule donc cette histoire jusque dans les années 2000. On connait davantage les évolutions qui suivent la période de 36 et du Front Populaire, les congés payés notamment. J’ai donc été davantage intéressée par le récit des décennies précédentes. Il est important, me semble-t-il, de se remémorer les grands combats menés de concert par le prolétariat et les courants politiques réformateurs, catholiques et socialistes qui ont permis que soient reconnus des droits à tous les travailleurs. Du silence à la parole ou comment l’ouvrier, le salarié accède à un statut, obtient le droit de s’exprimer, d’être représenté par des instances collectives, de voir ses conditions de travail améliorées. Très intéressant, très bien écrit, dans un style inhabituel pour ce type d’ouvrage.
Un livre qui donne assurément un autre regard sur notre façon d’envisager les divisions de l’histoire.
Lien : http://www.ledevoir.com/cult..
Lien : http://www.ledevoir.com/cult..
Les questions de périodisation, en histoire, semblent réglées depuis belle lurette : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance… Ce petit livre remet en cause ce découpage en montrant pour commencer qu'il est beaucoup plus récent qu'on ne se l'imagine, puis en essayant de prouver que la Renaissance n'est que la dernière partie du Moyen Âge, qui, selon Jacques Le Goff, se termine au dix-huitième siècle, avec les Lumières, l'Encyclopédie et la Révolution. Le retour à l'Antiquité, auquel on a donné tant d'importance, est une constante au Moyen Âge, qui a connu en fait plusieurs renaissances. L'humanisme? Déjà en route depuis longtemps. Les grandes découvertes? la boussole, au Moyen Âge. Bref, la Renaissance fait partie du Moyen Âge. Convaincant? A méditer en tout cas…
Double volonté du Médiéviste Jacques le Goff dans cet essai du début 2014. Démontrer, d'une part, que la Renaissance, exemple parfait d'un découpage de l'histoire, présentée comme une rupture avec l'époque antérieure, est seulement le dernier avatar d'un long Moyen Age qui débute au VIe-VIIe siècle (Antiquité tardive) et ne prend fin qu'au XVIIIe siècle. Affirmer, d'autre part, que la "périodisation" reste néanmoins l'outil indispensable de la mémoire pour l'historien qui doit l'utiliser avec plus de souplesse que par le passé. Nécessité dans un contexte de mondialisation des savoirs, qui ne se confond pas avec une uniformisation des savoirs.
En analysant les rapports étroits existant entre le Moyen Age et la Renaissance, Jacques le Goff, s'appuyant sur ses propres travaux et ceux de nombreux historiens, permet à son assertion de départ de développer toute sa pertinence. Ce "livre-parcours" est l'aboutissement d'une réflexion sur l'histoire qu'il fait débuter en 1950. Synthèse passionnante s'il en fut et des plus convaincante. Une lecture incontournable pour les amoureux ou les passionnés d'histoire ou plus simplement les curieux de tout poil.
Avant que l'histoire ne se constitue en savoirs organisés, n'acquiert sa spécificité et ne devienne matière d'enseignement, une lente maturation a été nécessaire où diverses conceptions du temps ont durablement coexisté, en s'opposant parfois, et a permis finalement à la notion de périodisation de s'imposer, au XIVe et au XVe siècle, pour offrir "une image continue et globale du passé". D'un simple genre littéraire, de chroniques initiales passées, éparses et rassemblées, l'histoire est devenue peu à peu une discipline à part entière dans le courant du XIXe siècle.
La vision De La Renaissance qui s'est largement diffusée en France entre 1840 et 1860 est le fruit d'une création léguée par Jules Michelet (1798-1874) dans son Histoire de France, opposant cette période de changement florissant au Moyen Age et imputant le rôle d'incubateur de ce mouvement à l'Italie (c'est Michelet qui met un "r" majuscule à Renaissance). A la fin du XIXe siècle, l'historien de l'art Burckhardt renforce par ses études la prééminence de l'Italie dans ce mouvement. Il faut remonter plus avant, en revanche, pour rencontrer une définition de la période antérieure à la Renaissance qu'on doit à Pétrarque (1304-1374) qui le premier emploie l'expression "media aetas", destinée à définir une période "intermédiaire entre une Antiquité imaginaire et une modernité imaginée". "Dark ages" en Angleterre, "féodalité" ailleurs jusqu'au XVIIe siècle, "Moyen Age" finit par se répandre dans l'usage courant quand Marc Bloch (1886-1944) et l'école des Annales achèvent de le réhabiliter, après un bref retour en grâce au XIXe siècle.
"L'invention de la Renaissance", selon un célèbre article de Lucien Febvre en 1950, impacte profondément la perception d'une période singulière de l'histoire ainsi que la période qui l'a précédée mais consacre surtout une volonté de périodisation des historiens, héritière de temps très anciens et jamais neutre. Jacques le Goff, à la suite de Fernand Braudel et de quelques illustres prédécesseurs, dont l'abondante bibliographie est fournie, choisit, lui, d'appréhender l'histoire par les passages et les transitions inscrits dans la longue durée et qui forment une même continuité.
C'est en effet à la tradition religieuse judéo-chrétienne, puisant elle-même aux sources de l'Antiquité, qu'il faut se référer en Occident pour retrouver les traces de ce qui a fondé les toutes premières réflexions sur la maîtrise et l'organisation du temps, calées d'abord sur le fonctionnement des cycles naturels (la vie ou les saisons). Temps cyclique ou chronologies plus élaborées qui permettent de penser le temps plus long, le modèle en quatre périodes de l'Ancien Testament (Daniel) ou celui plus pessimiste calqué sur les six âges de la vie proposé par Saint Augustin (La Cité de Dieu), perdureront tout au long du Moyen Age et bien au-delà. Denys le Petit installe quant à lui une rupture décisive au VIe siècle en imposant de répertorier les événements en référence à la date supposée de la naissance de Jésus Christ.
Dans cette continuité que Jacques le Goff explore entre Moyen Age et Renaissance, il rétablit la chaîne des transmissions médiévales, de traditions intellectuelles escamotées ou oubliées par les laudateurs De La Renaissance. de Varron (premier siècle avant notre ère), à Cassiodore (VIe siècle) et Alcuin (VIIIe-IXe siècle), en passant par Saint-Anselme, précurseur d'un humanisme conforté, et non apparu, à la Renaissance, réinterprété au XIIe siècle par Bernard de Chartres et Honorius d'Autun, ou encore l'école des Victorins en Ile-de-France. Contrairement à une idée répandue, il n'y a pas de recul de la pensée rationnelle au Moyen Age, mais c'est son formalisme qui a fait obstacle au développement scientifique et que la Renaissance fera reculer.
Redonnant ainsi son pluriel au mot renaissance, comme Erwin Panofsky avant lui (voir "La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident", trad. 1976), et sans sous-estimer les vraies réussites De La Renaissance (redécouverte du Grec ancien, homogénéisation de l'écriture et dans les Arts : innovations en peinture et en architecture, identification de l'artiste), l'auteur restitue du même coup des pans entiers de l'histoire, occultés par l'exclusivité d'une utilisation trop étroite du concept de périodisation. Car si la découverte de l'imprimerie est souvent citée pour la Renaissance, la substitution lente du volumen par le codex entre le IVe et le Ve siècle est une transition majeure du Moyen Age tout à fait décisive par l'extension inexorable du domaine de la lecture qu'elle entraîne dans la durée.
1492 : mettre la date de côté. La découverte de l'Amérique est replacée dans l'histoire plus générale de la navigation hauturière et du commerce européen (première liaison maritime régulière entre Gênes et Bruges en 1297) et de la mise au point, au XIIIe siècle, des instruments de précision comme la boussole, le gouvernail d'étambot ou la voile carrée, sans lesquels Christophe Colomb n'aurait jamais pu appareiller vers le nouveau monde. Par ailleurs, les répercussions principales - hors le coup de fouet monétaire - de cette immense découverte ne se font sentir qu'au milieu du XVIIIe siècle, moment de la fondation des Etats-Unis.
En matière économique, nulle modification profonde entre Moyen Age et Renaissance, ce que consacre "Civilisation matérielle et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles" de Fernand Braudel en 1967. C'est sur le plan politique que cette continuité entre les deux périodes apparaît de la manière la plus éclatante : les régimes monarchiques européens résistent à toutes les tentatives de ruptures, à l'exception de la première république formée par les Provinces-Unies (Hollande) en 1579 par le traité d'Utrecht, et ce, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Une partie de l'intérêt de la démonstration relève bien entendu de l'érudition de son auteur. Son analyse dévoile les arcanes d'une connaissance généreuse poussée aux confins de l'histoire événementielle et ouverte à la philosophie, à l'économie, la géographie, la sociologie, les arts visuels, la littérature, l'histoire de l'art. Elle apporte un éclairage panoramique nouveau sur le passé dont les images se figent très vite dans des clichés des lors que l'on s'en tient aux seuls événements circonscrits dans leurs périodes.
Surtout, Jacques le Goff en pensant la continuité d'un long Moyen Age dont la Renaissance ne serait qu'une étape sur le chemin d'une modernité engagée au XVIIIe siècle, introduit judicieusement la possibilité d'une grande variabilité, d'une nouvelle plasticité des mouvements historiques qui se juxtaposent autant qu'ils se succèdent, en accordant à la question des transitions lentes le même dynamisme que celui porté au crédit des révolutions. Nul ennui dans une telle analyse, c'est le changement qui apparaît comme artifice quand la périodisation se fait trop appuyée.
Un historien hors pair, une synthèse étonnante, une somme de références. Troisième de la collection La librairie du XXIe siècle dont je m'empare. Je recommande chaleureusement.
En analysant les rapports étroits existant entre le Moyen Age et la Renaissance, Jacques le Goff, s'appuyant sur ses propres travaux et ceux de nombreux historiens, permet à son assertion de départ de développer toute sa pertinence. Ce "livre-parcours" est l'aboutissement d'une réflexion sur l'histoire qu'il fait débuter en 1950. Synthèse passionnante s'il en fut et des plus convaincante. Une lecture incontournable pour les amoureux ou les passionnés d'histoire ou plus simplement les curieux de tout poil.
Avant que l'histoire ne se constitue en savoirs organisés, n'acquiert sa spécificité et ne devienne matière d'enseignement, une lente maturation a été nécessaire où diverses conceptions du temps ont durablement coexisté, en s'opposant parfois, et a permis finalement à la notion de périodisation de s'imposer, au XIVe et au XVe siècle, pour offrir "une image continue et globale du passé". D'un simple genre littéraire, de chroniques initiales passées, éparses et rassemblées, l'histoire est devenue peu à peu une discipline à part entière dans le courant du XIXe siècle.
La vision De La Renaissance qui s'est largement diffusée en France entre 1840 et 1860 est le fruit d'une création léguée par Jules Michelet (1798-1874) dans son Histoire de France, opposant cette période de changement florissant au Moyen Age et imputant le rôle d'incubateur de ce mouvement à l'Italie (c'est Michelet qui met un "r" majuscule à Renaissance). A la fin du XIXe siècle, l'historien de l'art Burckhardt renforce par ses études la prééminence de l'Italie dans ce mouvement. Il faut remonter plus avant, en revanche, pour rencontrer une définition de la période antérieure à la Renaissance qu'on doit à Pétrarque (1304-1374) qui le premier emploie l'expression "media aetas", destinée à définir une période "intermédiaire entre une Antiquité imaginaire et une modernité imaginée". "Dark ages" en Angleterre, "féodalité" ailleurs jusqu'au XVIIe siècle, "Moyen Age" finit par se répandre dans l'usage courant quand Marc Bloch (1886-1944) et l'école des Annales achèvent de le réhabiliter, après un bref retour en grâce au XIXe siècle.
"L'invention de la Renaissance", selon un célèbre article de Lucien Febvre en 1950, impacte profondément la perception d'une période singulière de l'histoire ainsi que la période qui l'a précédée mais consacre surtout une volonté de périodisation des historiens, héritière de temps très anciens et jamais neutre. Jacques le Goff, à la suite de Fernand Braudel et de quelques illustres prédécesseurs, dont l'abondante bibliographie est fournie, choisit, lui, d'appréhender l'histoire par les passages et les transitions inscrits dans la longue durée et qui forment une même continuité.
C'est en effet à la tradition religieuse judéo-chrétienne, puisant elle-même aux sources de l'Antiquité, qu'il faut se référer en Occident pour retrouver les traces de ce qui a fondé les toutes premières réflexions sur la maîtrise et l'organisation du temps, calées d'abord sur le fonctionnement des cycles naturels (la vie ou les saisons). Temps cyclique ou chronologies plus élaborées qui permettent de penser le temps plus long, le modèle en quatre périodes de l'Ancien Testament (Daniel) ou celui plus pessimiste calqué sur les six âges de la vie proposé par Saint Augustin (La Cité de Dieu), perdureront tout au long du Moyen Age et bien au-delà. Denys le Petit installe quant à lui une rupture décisive au VIe siècle en imposant de répertorier les événements en référence à la date supposée de la naissance de Jésus Christ.
Dans cette continuité que Jacques le Goff explore entre Moyen Age et Renaissance, il rétablit la chaîne des transmissions médiévales, de traditions intellectuelles escamotées ou oubliées par les laudateurs De La Renaissance. de Varron (premier siècle avant notre ère), à Cassiodore (VIe siècle) et Alcuin (VIIIe-IXe siècle), en passant par Saint-Anselme, précurseur d'un humanisme conforté, et non apparu, à la Renaissance, réinterprété au XIIe siècle par Bernard de Chartres et Honorius d'Autun, ou encore l'école des Victorins en Ile-de-France. Contrairement à une idée répandue, il n'y a pas de recul de la pensée rationnelle au Moyen Age, mais c'est son formalisme qui a fait obstacle au développement scientifique et que la Renaissance fera reculer.
Redonnant ainsi son pluriel au mot renaissance, comme Erwin Panofsky avant lui (voir "La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident", trad. 1976), et sans sous-estimer les vraies réussites De La Renaissance (redécouverte du Grec ancien, homogénéisation de l'écriture et dans les Arts : innovations en peinture et en architecture, identification de l'artiste), l'auteur restitue du même coup des pans entiers de l'histoire, occultés par l'exclusivité d'une utilisation trop étroite du concept de périodisation. Car si la découverte de l'imprimerie est souvent citée pour la Renaissance, la substitution lente du volumen par le codex entre le IVe et le Ve siècle est une transition majeure du Moyen Age tout à fait décisive par l'extension inexorable du domaine de la lecture qu'elle entraîne dans la durée.
1492 : mettre la date de côté. La découverte de l'Amérique est replacée dans l'histoire plus générale de la navigation hauturière et du commerce européen (première liaison maritime régulière entre Gênes et Bruges en 1297) et de la mise au point, au XIIIe siècle, des instruments de précision comme la boussole, le gouvernail d'étambot ou la voile carrée, sans lesquels Christophe Colomb n'aurait jamais pu appareiller vers le nouveau monde. Par ailleurs, les répercussions principales - hors le coup de fouet monétaire - de cette immense découverte ne se font sentir qu'au milieu du XVIIIe siècle, moment de la fondation des Etats-Unis.
En matière économique, nulle modification profonde entre Moyen Age et Renaissance, ce que consacre "Civilisation matérielle et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles" de Fernand Braudel en 1967. C'est sur le plan politique que cette continuité entre les deux périodes apparaît de la manière la plus éclatante : les régimes monarchiques européens résistent à toutes les tentatives de ruptures, à l'exception de la première république formée par les Provinces-Unies (Hollande) en 1579 par le traité d'Utrecht, et ce, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Une partie de l'intérêt de la démonstration relève bien entendu de l'érudition de son auteur. Son analyse dévoile les arcanes d'une connaissance généreuse poussée aux confins de l'histoire événementielle et ouverte à la philosophie, à l'économie, la géographie, la sociologie, les arts visuels, la littérature, l'histoire de l'art. Elle apporte un éclairage panoramique nouveau sur le passé dont les images se figent très vite dans des clichés des lors que l'on s'en tient aux seuls événements circonscrits dans leurs périodes.
Surtout, Jacques le Goff en pensant la continuité d'un long Moyen Age dont la Renaissance ne serait qu'une étape sur le chemin d'une modernité engagée au XVIIIe siècle, introduit judicieusement la possibilité d'une grande variabilité, d'une nouvelle plasticité des mouvements historiques qui se juxtaposent autant qu'ils se succèdent, en accordant à la question des transitions lentes le même dynamisme que celui porté au crédit des révolutions. Nul ennui dans une telle analyse, c'est le changement qui apparaît comme artifice quand la périodisation se fait trop appuyée.
Un historien hors pair, une synthèse étonnante, une somme de références. Troisième de la collection La librairie du XXIe siècle dont je m'empare. Je recommande chaleureusement.
Faut-il que les historiens du Moyen Âge annexent la Renaissance, comme semblait avoir tendance à le faire Jacques Le Goff dans cet essai - ou ensemble de réflexions - intitulé : Faut-il vraiment découper l'Histoire en tranches ?
Si les questions que se pose Jacques Le Goff (1924 - 2014) sont utiles et bienvenues, et si nous sommes très nombreux à partager certaines de ses pertinentes et brillantes analyses, il me semble toutefois que les réponses apportées vont peut-être un peu loin.
Autant il est utile de rappeler que les bornes chronologiques posées par commodité et confort intellectuel - plus que par vrai et pur rationalisme - ont un côté quelque peu artificiel, puisque forcément les changements viennent de loin et se préparent dans la longue durée avant d'éclater au grand jour comme une évidence, autant il me paraîtrait exagéré et imprudent de systématiser l'emploi des mots "long Moyen Âge", comme si cette période qui ne s'arrêterait pas en 1453, 1492 ou 1499-1500, mais au XVIIIème siècle pouvait tout englober de ce qui s'est présenté entre le XVIème siècle et le XVIIIème siècle. Il faudrait reprendre, détail dans le détail, chaque exemple choisi pour s'assurer que les assertions de l'auteur se vérifient bien historiquement de manière précise, sinon totalement objective - ce qui est impossible dans la mesure où l'Histoire est et demeure une science humaine, par définition mouvante dans les classifications, délimitations et le sens qu'elle donne aux choses et dans la lecture qu'elle fait des événements selon les époques d'où l'on se place et les points de vue d'où l'on part pour en parler. Tout peut changer sans cesse si l'on doit tout réinterpréter à l'aune des options idéologiques qui sont celles de l'historien qui s'exprime et qui est immergé dans une société qui influence son état d'esprit.
Est-ce que l'Histoire, à partir du moment où elle est devenue matière d'enseignement et de recherche, a pris cette forme avec découpage de périodes bien délimitées par esprit de simplification ou parce qu'il existait des critères objectifs de présenter les choses ainsi et que cela resterait malgré tout valable ?
Je crains qu'il ne plaise pas vraiment aux spécialistes de la Renaissance et à ceux de l'Âge classique qu'on les fasse passer par un exercice pratique dans lequel on chercherait à vérifier que ce que Jacques Le Goff nous a laissé entendre est une chose absolument démontrable.
On peut se livrer librement à ce genre de réflexions comme l'a fait Jacques Le Goff sans remettre totalement en cause nos grilles de lecture, et sans tout relativiser.
Si les questions que se pose Jacques Le Goff (1924 - 2014) sont utiles et bienvenues, et si nous sommes très nombreux à partager certaines de ses pertinentes et brillantes analyses, il me semble toutefois que les réponses apportées vont peut-être un peu loin.
Autant il est utile de rappeler que les bornes chronologiques posées par commodité et confort intellectuel - plus que par vrai et pur rationalisme - ont un côté quelque peu artificiel, puisque forcément les changements viennent de loin et se préparent dans la longue durée avant d'éclater au grand jour comme une évidence, autant il me paraîtrait exagéré et imprudent de systématiser l'emploi des mots "long Moyen Âge", comme si cette période qui ne s'arrêterait pas en 1453, 1492 ou 1499-1500, mais au XVIIIème siècle pouvait tout englober de ce qui s'est présenté entre le XVIème siècle et le XVIIIème siècle. Il faudrait reprendre, détail dans le détail, chaque exemple choisi pour s'assurer que les assertions de l'auteur se vérifient bien historiquement de manière précise, sinon totalement objective - ce qui est impossible dans la mesure où l'Histoire est et demeure une science humaine, par définition mouvante dans les classifications, délimitations et le sens qu'elle donne aux choses et dans la lecture qu'elle fait des événements selon les époques d'où l'on se place et les points de vue d'où l'on part pour en parler. Tout peut changer sans cesse si l'on doit tout réinterpréter à l'aune des options idéologiques qui sont celles de l'historien qui s'exprime et qui est immergé dans une société qui influence son état d'esprit.
Est-ce que l'Histoire, à partir du moment où elle est devenue matière d'enseignement et de recherche, a pris cette forme avec découpage de périodes bien délimitées par esprit de simplification ou parce qu'il existait des critères objectifs de présenter les choses ainsi et que cela resterait malgré tout valable ?
Je crains qu'il ne plaise pas vraiment aux spécialistes de la Renaissance et à ceux de l'Âge classique qu'on les fasse passer par un exercice pratique dans lequel on chercherait à vérifier que ce que Jacques Le Goff nous a laissé entendre est une chose absolument démontrable.
On peut se livrer librement à ce genre de réflexions comme l'a fait Jacques Le Goff sans remettre totalement en cause nos grilles de lecture, et sans tout relativiser.
Jacques Le Goff livre surtout une réflexion magnifiquement stimulante sur la nécessité de combiner « continuité et discontinuité » dans nos façons de concevoir le temps historique.
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Pour intéressant qu'il soit, ce livre ne tient pas les promesses de son titre.
Il traite uniquement de la charnière Moyen Âge-Renaissance, et d'ailleurs de la pertinence même de la notion de Renaissance.
En bon médiéviste, il défend son pré carré, et en profite pour faire une nouvelle fois l'éloge de son époque de prédilection.
Ceux qui demeurent attachés à une vision plus sombre du Moyen-Age, voire à la notion de" Dark ages" qui n'est pas nécessairement dépourvue de pertinence, ne le suivront par sur ce terrain, malgré la finesse de son argumentation et la belle érudition du livre.
En tout cas, il est dommage que Le Goff n'ait pas traité le problème tout aussi intéressant de la césure Antiquité-Moyen-Age, fixée traditionnellement à 476, mais que l'on place de plus en plus beaucoup plus tard, à la charnière du neuvième et du dixième siècle.
Il traite uniquement de la charnière Moyen Âge-Renaissance, et d'ailleurs de la pertinence même de la notion de Renaissance.
En bon médiéviste, il défend son pré carré, et en profite pour faire une nouvelle fois l'éloge de son époque de prédilection.
Ceux qui demeurent attachés à une vision plus sombre du Moyen-Age, voire à la notion de" Dark ages" qui n'est pas nécessairement dépourvue de pertinence, ne le suivront par sur ce terrain, malgré la finesse de son argumentation et la belle érudition du livre.
En tout cas, il est dommage que Le Goff n'ait pas traité le problème tout aussi intéressant de la césure Antiquité-Moyen-Age, fixée traditionnellement à 476, mais que l'on place de plus en plus beaucoup plus tard, à la charnière du neuvième et du dixième siècle.
Jacques Le Goff a écrit « Faut-il découper l’histoire en tranches ? » en 2013, peu avant son décès à l’âge de 90 ans. Cet historien était un immense médiéviste mais pas seulement, oserais je dire, tant il a œuvré pour la réflexion épistémologique de l’histoire (notamment sur la mémoire de l’histoire). Ce livre n’est clairement pas son meilleur (il faut dire qu’à ce titre le choix est rude tant la qualité est la norme dans son œuvre). J’ose ici un petit sacrilège qu’il me pardonnera, moi qui suis un grand lecteur de cet historien génial qui a tant bouleversé la vision que nous pouvons avoir du « Moyen Age. » L’ouvrage est intéressant. Il voit Jacques Le Goff s’interroger sur « la prétendue nouveauté de la « Renaissance », sa « centralité » et son rapport au Moyen Âge. La thèse de celui-ci, est que l’on peut parler d’un « long Moyen Age occidental » qui pourrait aller de l’Antiquité tardive (IIIème au VIIème siècle) jusqu’au milieu du XVIIIème siècle. Il insiste sur l’intérêt d’une histoire périodisée avec ces continuités, ces ruptures.. Faut-il une histoire « une et continue ou sectionnée en compartiments ? » La bibliographie peut piquer aussi à notre curiosité. Maintenant, voici pourquoi je minore quelque peu mes compliments sur cet ouvrage. En effet, si vous ne deviez lire qu’un seul livre de Jacques Le Goff, je vous recommanderais son « Saint Louis » qui est un authentique travail d’orfèvre et son chef d’œuvre absolu !
Lien : https://thedude524.com/2017/..
Lien : https://thedude524.com/2017/..
Jacques Le Goff, éminent spécialiste de ce passionnant Moyen Âge, que les Anglais appellent "Dark ages", nous livre ici un ouvrage "testament" paru en 2013, soit un an avant le décès du célèbre historien.
Pas de doute, l'histoire est une science humaine, et de ce fait, tributaire de l'état des connaissances et du regard porté sur la discipline par ceux-là mêmes qui l'étudient. Avec le recul, pourrait-on dire que notre vision prend de la hauteur et permet donc de considérer avec plus de discernement non pas les ruptures mais les évolutions lentes? Ainsi, en serait-il de la Renaissance, que Le Goff nous incite à replacer au coeur du Moyen Âge, période où l'Antiquité fut toujours à l'honneur. Il prône ainsi pour une vision élargie du Moyen Âge, allant de l'Antiquité tardive (III au VIIème siècle) jusqu'au milieu du XVIII ème siècle. Une démonstration bien étayée par les travaux de collègues européens, passionnante et éclairante.
Alors, faut-il découper l'histoire en tranches fines, plus épaisses, en dés ou en lamelles? La réponse, est au bout de la lecture.
Un ouvrage qui passionnera les amoureux de l'histoire de tout poil!
Pas de doute, l'histoire est une science humaine, et de ce fait, tributaire de l'état des connaissances et du regard porté sur la discipline par ceux-là mêmes qui l'étudient. Avec le recul, pourrait-on dire que notre vision prend de la hauteur et permet donc de considérer avec plus de discernement non pas les ruptures mais les évolutions lentes? Ainsi, en serait-il de la Renaissance, que Le Goff nous incite à replacer au coeur du Moyen Âge, période où l'Antiquité fut toujours à l'honneur. Il prône ainsi pour une vision élargie du Moyen Âge, allant de l'Antiquité tardive (III au VIIème siècle) jusqu'au milieu du XVIII ème siècle. Une démonstration bien étayée par les travaux de collègues européens, passionnante et éclairante.
Alors, faut-il découper l'histoire en tranches fines, plus épaisses, en dés ou en lamelles? La réponse, est au bout de la lecture.
Un ouvrage qui passionnera les amoureux de l'histoire de tout poil!
Le pendant dans cette belle collection de Duby
Là aussi l' érudition est au top,les sujets bien analysés. présentées. Si (à mon avis!) l'écriture est moins flamboyante sentant plus "son intellectuel à concepts", avec un parti pris plus sociologique (toujours à mon avis! ) elle capte en permanence notre attention sans jamais nous lasser.
L'avantage, (comme pour l'ouvrage équivalent de Duby) si on a le courage de le lire au moins en partie "dans la foulée" quelques sujets de nous révéler un peu les interrogations mais aussi les "marottes" de leur auteur.
Là aussi l' érudition est au top,les sujets bien analysés. présentées. Si (à mon avis!) l'écriture est moins flamboyante sentant plus "son intellectuel à concepts", avec un parti pris plus sociologique (toujours à mon avis! ) elle capte en permanence notre attention sans jamais nous lasser.
L'avantage, (comme pour l'ouvrage équivalent de Duby) si on a le courage de le lire au moins en partie "dans la foulée" quelques sujets de nous révéler un peu les interrogations mais aussi les "marottes" de leur auteur.
n ne présente plus le grand historien médiéviste Jacques Le Goff récemment disparu. « Héros et merveilles du Moyen Age » est un travail passionnant sur l’origine de ces derniers et leur évolution au cours des siècles. L’ensemble peut se lire comme un grand roman au style, comme à chaque fois chez lui, très agréable. On est tantôt ému, rieur, et nous de mesurer à quel point certains récits ont pu influencer notre imaginaire aujourd’hui encore. Une jolie façon de redécouvrir avec délice l’histoire des mentalités au Moyen Age.
Lien : https://thedude524.com/2015/..
Lien : https://thedude524.com/2015/..
Spécialiste universitaire de l’histoire médiévale européenne, Jacques Le Goff fait ici dans la forme courte et synthétique. Quelques instruments de compréhension globale de l’aspect merveilleux du Moyen Age sont fournis dans une introduction qui constitue également la partie la plus dense de cet ouvrage. En partant de la spécificité médiévale, Jacques Le Goff étend ses hypothèses et grilles de lecture à la compréhension de la plupart des paradigmes qui trouvent leur point d’ancrage dans une source faite de légendes, de mythes et d’imagination. Dans le cadre médiéval, le paradigme est au confluent de l’héritage antique, de l’interprétation chrétienne et de l’horizon chevaleresque qui diffuse ses valeurs de courage et de courtoisie. Le merveilleux serait-il alors le symbole qui fait sens et qui traduit l’étonnement de l’homme médiéval devant ce croisement inédit de nouvelles influences ?
« Les héros et les merveilles du Moyen Âge sont les lumières, les prouesses de cette installation des chrétiens sur une terre qu’ils décorent de ce qui faisait la gloire et le charme du monde surnaturel. »
A la suite de cette introduction savoureuse, Jacques Le Goff partage son livre en plusieurs chapitres consacrés à l’analyse d’un symbole merveilleux médiéval. A la liste des légendes mises à l’honneur, nous retrouverons les personnages bien connus d’Arthur, de Charlemagne, du Cid ou de Merlin, mais également des animaux comme la Licorne ou le fameux Renart, les lieux du cloître, de la cathédrale et du château-fort et le type du chevalier ou du troubadour. Les spécialistes de ces figures ne trouveront pas de quoi rassasier leur soif de connaissances car Jacques Le Goff s’adresse à des lecteurs amateurs qui souhaitent s’initier aux merveilles du Moyen Age. Apparition contextuelle, développement de la signification de la légende au Moyen Age puis dans la société moderne jusqu’à ses avatars les plus récents dans le domaine culturel : la chronologie de chaque figure médiévale tient en une dizaine de pages qui fournissent les éléments nécessaires pour une bonne compréhension, mais jamais davantage.
Si les spécialistes n’y trouveront sans doute pas une nourriture qui tient au ventre, les autres apprécieront ce petit ouvrage clair et accessible qui ouvre des pistes de connaissances culturelles et historiques.
« Les héros et les merveilles du Moyen Âge sont les lumières, les prouesses de cette installation des chrétiens sur une terre qu’ils décorent de ce qui faisait la gloire et le charme du monde surnaturel. »
A la suite de cette introduction savoureuse, Jacques Le Goff partage son livre en plusieurs chapitres consacrés à l’analyse d’un symbole merveilleux médiéval. A la liste des légendes mises à l’honneur, nous retrouverons les personnages bien connus d’Arthur, de Charlemagne, du Cid ou de Merlin, mais également des animaux comme la Licorne ou le fameux Renart, les lieux du cloître, de la cathédrale et du château-fort et le type du chevalier ou du troubadour. Les spécialistes de ces figures ne trouveront pas de quoi rassasier leur soif de connaissances car Jacques Le Goff s’adresse à des lecteurs amateurs qui souhaitent s’initier aux merveilles du Moyen Age. Apparition contextuelle, développement de la signification de la légende au Moyen Age puis dans la société moderne jusqu’à ses avatars les plus récents dans le domaine culturel : la chronologie de chaque figure médiévale tient en une dizaine de pages qui fournissent les éléments nécessaires pour une bonne compréhension, mais jamais davantage.
Si les spécialistes n’y trouveront sans doute pas une nourriture qui tient au ventre, les autres apprécieront ce petit ouvrage clair et accessible qui ouvre des pistes de connaissances culturelles et historiques.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jacques Le Goff
Quiz
Voir plus
Les créatures imaginaires
Créature de la nuit, je suce le sang de mes victimes pour me nourrir. Je peux me métamorphoser en chauve-souris, en loup, en chat ou en chien quand je ne me dissipe pas en une traînée de brouillard. Les miroirs ne reflètent pas mon image et je ne projette aucune ombre. Je crains la lumière du jour et le meilleur moyen de m'anéantir est de m'enfoncer un pieux dans le cœur ou de me décapiter. Un de mes représentants le plus célèbre est le Comte Dracula.
Le zombie
Le vampire
Le poltergeist
Le golem
10 questions
598 lecteurs ont répondu
Thèmes :
imaginaire
, fantastique
, fantasy
, créatures fantastiques
, créature imaginaire
, littératureCréer un quiz sur cet auteur598 lecteurs ont répondu