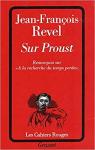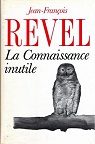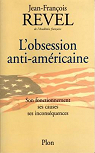Critiques de Jean-François Revel (70)
Très abordable sans avoir des connaissances philosophiques, scientifiques ou religieuses particulières. Le texte est la retranscription d'un dialogue qui n'évite pas les digressions ni les répétitions, mais à ces réserves près, cette confrontation entre un philosophe occidental athée et son moine de fils est très instructive, voire passionnante. Excellente introduction au bouddhisme.
Montée des pouvoirs, confrontations des puissances.
Opposition des contraires Est / Ouest ou plus encore les valeurs s'affrontent et se bousculent.
Entrez dans la danse, pages après pages, sans faux pas et raison.
Opposition des contraires Est / Ouest ou plus encore les valeurs s'affrontent et se bousculent.
Entrez dans la danse, pages après pages, sans faux pas et raison.
On a déjà lu des livres où un philosophe et un religieux s'affrontent. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est un dialogue entre un père et son fils - qui ont pris des directions diamétralement opposées dans le domaine de la vie et de la pensée. Jean-François Revel (mort en 2006) fut un philosophe et un chroniqueur assez connu, rationaliste et athée. Matthieu Ricard, qui avait une vocation scientifique, a tout lâché pour s'installer en Asie et y recevoir l'enseignement de grands maitres du bouddhisme tibétain. Il est devenu le porte-parole du Dalaï Lama et c'est l'une des personnalités les plus connues du bouddhisme en France.
Dans cet ouvrage, les deux penseurs s'affrontent courtoisement sur tous les thèmes qui gouvernent la vie des hommes. Leurs discours sont très différents, au point qu'on a parfois l'impression d'un dialogue de sourds. Pour ma part, l'intellectualisme du philosophe - desséchant - m'a un peu assommé. Son fils n'est pas rebelle à la pensée rationnelle, mais il ne lui attribue pas autant d'importance que J.-F. Revel. le bouddhisme met en avant des valeurs éthiques compatibles avec l'humanisme occidental, mais éloignées des valeurs philosophiques athées. Le livre m'a semblé stimulant sur le plan intellectuel. Mais l'échange entre les deux protagonistes ne font pas vraiment avancer le schmilblick, pour les personnes soucieuses de spiritualité. C'est du moins l'impression que je garde de ce livre.
Dans cet ouvrage, les deux penseurs s'affrontent courtoisement sur tous les thèmes qui gouvernent la vie des hommes. Leurs discours sont très différents, au point qu'on a parfois l'impression d'un dialogue de sourds. Pour ma part, l'intellectualisme du philosophe - desséchant - m'a un peu assommé. Son fils n'est pas rebelle à la pensée rationnelle, mais il ne lui attribue pas autant d'importance que J.-F. Revel. le bouddhisme met en avant des valeurs éthiques compatibles avec l'humanisme occidental, mais éloignées des valeurs philosophiques athées. Le livre m'a semblé stimulant sur le plan intellectuel. Mais l'échange entre les deux protagonistes ne font pas vraiment avancer le schmilblick, pour les personnes soucieuses de spiritualité. C'est du moins l'impression que je garde de ce livre.
Matthieu Ricard, qui est devenu moine bouddhiste après avoir suivi des études scientifiques, dialogue avec son père Jean-François Revel, philosophe agnostique, à qui il expose ce qu'est le bouddhisme. Ils n'avaient jamais jusque-là éprouvé le besoin de confronter leurs points de vue. Ils abordent des thèmes tels que la métaphysique bouddhiste, la spiritualité, la psychanalyse ou l'attitude devant la mort, en suivant un modèle socratique.
Contexte[modifier | modifier le code]
Quand son fils est parti au Tibet en 1972, Jean-François Revel (« Revel » est un pseudonyme) a cru qu'il entrait « dans une secte »2, puis il a compris que le bouddhisme était sérieux. Dans ces retrouvailles, le moine semble faire plus de pas vers le point de vue du philosophe que l'inverse, mais chacun reste sur ses positions3.
Contexte[modifier | modifier le code]
Quand son fils est parti au Tibet en 1972, Jean-François Revel (« Revel » est un pseudonyme) a cru qu'il entrait « dans une secte »2, puis il a compris que le bouddhisme était sérieux. Dans ces retrouvailles, le moine semble faire plus de pas vers le point de vue du philosophe que l'inverse, mais chacun reste sur ses positions3.
Intéressant de lire deux points de vue différents sur une panoplie de thèmes avec des modes de vie et des convictions propres à chacun. Une vision occidentale face à l'orientale. Certains passages ne sont pas toujours convaincants mais ce livre offre une belle réflexion et permet de se positionner par rapport à ses propres convictions.
Liberalism is peace, ignorance is strength, socialism is slavery
Assister à un affrontement entre « libéraux » et « socialistes » est une véritable rigolbochade. L’ouvrage La Grande Parade de l’intellectuel français Jean-François Revel illustre assez bien ce sempiternel (et stérile) débat. En effet, il est truculent de constater que chacun des deux camps semble s’accuser … des mêmes maux ! D’un côté comme de l’autre, on se voit comme plus blanc que blanc et pointe l’autre comme étant plus noir que noir. Finalement, les malheurs du monde viennent de l’Autre. Un vrai combat du Bien contre le Mal aux positions interchangeables selon le point de vue.
L’ouvrage du libéral français Revel s’inscrit dans cette optique de diabolisation réciproque. On sent que l’ancien philosophe abhorre plus que tout ce que représente Marx et ses nombreux (pseudo ?) épigones, qu’il est littéralement révulsé au plus haut point par leur doctrine, leur pensée. Et comme tout homme semblant être fanatisé on tombe régulièrement dans la caricature, la simplification, la vision systémique. Revel ne fait pas pour moi exception.
En ce sens, Revel mérite très clairement le trophée du plus gros point Godwin de l’année 2000 en insistant (lourdement) sur le parallèle entre nazisme et communisme (amusant quand on sait que certains font le parallèle entre libéralisme et nazisme), qui seraient finalement les deux faces d’une même pièce ! Des frères presque jumeaux finalement, où la seule véritable distinction acceptable serait une dichotomie entre une politique appliquée clairement annoncée et une autre cachée, qui ferait le contraire de ce qu’elle proclamait. Jean-François Revel, nouvel historien majeur du « totalitarisme » ?
Par la même Revel fait en quelque sorte sentir de manière plus ou moins cachée que le nazisme serait moins « négatif » car fondamentalement plus honnête que le communisme.
Bien entendu, notre cher libéral ne s’arrête pas là, et applique le néologisme de négationnisme aux « pro communistes » aveugles (plus ou moins volontairement) envers les crimes perpétrés par des régimes qui se disent ou sont qualifiés de communistes. Pas de raison qu’on réserve ça aux « nazis » et aux autres pardi !
Notre cher libéral se permet même une tirade assez culottée, dont j’ai peine à trouver à l’intérieur du seconde degré : "Avoir été communiste, c'était avoir été soit coauteur soit complice d'un colossal crime contre l’humanité ».
Bien entendu, et c’est de bonne guerre, Revel expose sous un jour plus que laudatif le « mouvement libéral », et en cela semble clairement trier dans l’Histoire les exemples qui illustrent sa thèse. Les socialistes disent se battre pour les droits sociaux et diabolisent les libéraux ? Mais, enfin ! Il ne faut surtout pas oublier que Bastiat ou Guizot ont pris des mesures ou des tenus des prises de position dans ce sens ! Oui, d’accord d’accord, je veux bien, ces exemples sont sans doute véridiques, mais quid de la recontextualisation historique et des autres libéraux ou même de leurs autres actes ? Ont-ils été toujours aussi attentionné que Revel semble le laisser entendre ? Les libéraux, parangons de la défense des opprimés et pourfendeurs des injustices ? (j’ai une phrase sympathique de Constant sous le coude pour qui veut). Bizarrement, ce n’est pas exactement l’image qu’on peut en avoir (sans doute encore et toujours à cause de la propagande marxiste). Trier dans l’Histoire est une chose aisée, même un communiste pourrait surement faire de même pour illustrer tel ou tel point de sa thèse. Une hirondelle ne fait pas le printemps sait-on d’ailleurs.
JFR s’arrête pendant quelques instants sur des déclarations de Marx, Engels et d’autres pour montrer qu’ils ne sont pas aussi blanc que certains peuvent le penser. Par exemple, il met en exergue des propos antisémites (hum dans un livre où on essaye de mettre sur le même plan nazisme et communisme, vous la sentez la finesse ?). Certes, ils ont tenu de tels propos (déplorables), mais, pourquoi ne parle-t-il pas aussi de certaines prises de position de libéraux sur des sujets, dira-t-on, quelque peu brulants. Heureuse coïncidence, je parcoure actuellement l’ouvrage Contre Histoire du libéralisme du philosophe Domenico Losurdo, qualifié de manière fleurie de « stalinien » par notre camarade gio, qui apprécie particulièrement éplucher les ouvrages écrits par de nombreux libéraux pour mettre en lien ce qui se dit du libéralisme et ce qu’ont dit certains libéraux. Partant de là, que pense Revel de Ludwig Von Mises, un des grands personnages de la sphère libérale, sans doute effrayé par le bruissement social en cours, aurait loué le coup d’état de Mussolini, « sauveur de la civilisation », « le mérite acquis de cette façon par le fascisme vivra éternellement dans l’histoire ».
Que pense aussi Revel du rapport ambiguë entre l’esclavage et le libéralisme, quand tant de personnalités se réclamant de cette pensée furent d’ardents défenseurs de l’esclavagisme, le grand philosophe Locke notamment, à une époque où pourtant, nombreuses furent les oppositions à une telle pratique.
Revel est aussi prompt à balancer des épithètes discriminants gratuits envers plusieurs personnalités sans chercher à critiquer (au sens neutre) leurs travaux. Deux exemples précis peuvent être mis en avant. En premier lieu, l’anathème de « stalinien » (il sort souvent celui-ci) est, il me semble accolé à la personne de l’historien Hobsbawm, qui a surement eu des paroles ou des prises de positions contestables, mais Revel ne rentre à aucun moment, même succinctement dans l’analyse des ouvrages mentionnés. J’appelle cela disqualifier un travail par une attaque ad hominem. Qu’il me dise quels points il réfute dans l’ouvrage, par exemple, de l’âge des empires, ça, c’est quelque chose qui m’intéresse. De même, il évoque le papier de Moshe Lewin sur (entre autre) l’ouvrage ô combien loué par Revel de François Furet « Le passé d’une illusion » dans le (satanique) Monde Diplomatique. Même son de cloche ici, aucun regard critique sur le dit article pourtant assez fourni et intéressant, dont je conseille la lecture à tous et qui mérite (au moins) discussion. Je veux bien que dans un « brulot », un « pamphlet », on soit plus léger, moins « universitaire », mais nous sommes en droit tout de même d’attendre un minimum de sérieux, surtout de la part d’un homme qui vient juger du haut de son trône et condamner de manière aussi tranchée « l’idée socialiste ». Peut-être n’avait-il pas sous le coude d’arguments suffisamment solide à mettre en face de ces deux auteurs …
Dans l’article précédemment mentionné, l’historien Moshe Lewin arguait que :
« Nul doute : la question qui préoccupe tant de gens - pourquoi le socialisme (ou le communisme) s’est-il effondré en Russie ? - apparaît comme un leurre. Pour parvenir à comprendre cette histoire, il faut admettre cette évidence : le socialisme et, a fortiori, le communisme ne sont pas des concepts adéquats. Aussi faudrait-il reformuler la question : qu’est-ce donc qui s’est effondré en Russie ? Voilà de quoi méditer. »
Evidemment, vous vous en doutez bien, notre cher omniscient Revel balaye un tel propos comme Fabius congédiant les dires de son interlocuteur d’un mouvement de main suffisant. Ce n’est que ritournelle sophistique que de mettre en avant une telle idée ! Le responsable, c’est l’idée socialiste, point final, pas la peine d’ergoter pendant des heures et des pages sur une telle question. Tout est plus simple avec JFR. Néanmoins, en étant quelque peu extérieur à ces chamailleries, il s’agit d’un point central. Les régimes désignés (ou auto désignés) comme communistes ou socialistes le furent-ils véritablement ? Peut-on condamner à la damnation éternelle une doctrine que l’on pourrait qualifier de « mal appliquée » ? La socialisme est-il finalement Un, indivisible, monolithique ? Les libéraux se drapent des oripeaux de la vertu d’une soi disante « non idéologie » (ah ah) et d’une grande pluralité mais refusent visiblement ce dont ils se parent à d’autres. Pourtant je n’ai pas l’impression que le Socialisme soi aussi univoque et semblable partout et de tout temps …
Et au contraire, bien entendu, ce qui était attendu arrive, il n’y a pas d’ « idéologie » (ou remplacez par le terme qui vous convient) libérale. Vous pouvez vous échiner à critiquer certaines prises de position de libéraux, mais jamais, ô non jamais vous n’atteindrez le plumage étincelant de l’idée libérale ! On vous l’a dit, le Mal, il est en face.
Beaucoup de bla bla pour ne pas dire grand chose, je sais bien, mais au boulot, dans un bureau, on trouve toujours quelque chose à faire pour échapper à son dur labeur.
J’ai posé quelques mots sur ce qui m’est spontanément venu en tête du souvenir de cette lecture rapide, mais Revel aborde bien d’autres points, plus ou moins en détail. Son ouvrage ne se résume pas à mes quelques phrases. Si je devais mettre en avant le point sur lequel je rejoins le plus JFR c’est bien, il me semble sur les premiers chapitres où il évoque l’attachement et l’aveuglement de nombreux individus envers certains régimes "socialistes" et le fanatisme des militants communistes. C’est assez vrai, plutôt intéressant par moment et avec quelques passages croustillants.
Dois-je maintenant préciser que je ne porte pas la doctrine Marxiste dans mon coeur, pour ne pas être qualifié par les thuriféraires de la Vérité de … stalinien ?
Assister à un affrontement entre « libéraux » et « socialistes » est une véritable rigolbochade. L’ouvrage La Grande Parade de l’intellectuel français Jean-François Revel illustre assez bien ce sempiternel (et stérile) débat. En effet, il est truculent de constater que chacun des deux camps semble s’accuser … des mêmes maux ! D’un côté comme de l’autre, on se voit comme plus blanc que blanc et pointe l’autre comme étant plus noir que noir. Finalement, les malheurs du monde viennent de l’Autre. Un vrai combat du Bien contre le Mal aux positions interchangeables selon le point de vue.
L’ouvrage du libéral français Revel s’inscrit dans cette optique de diabolisation réciproque. On sent que l’ancien philosophe abhorre plus que tout ce que représente Marx et ses nombreux (pseudo ?) épigones, qu’il est littéralement révulsé au plus haut point par leur doctrine, leur pensée. Et comme tout homme semblant être fanatisé on tombe régulièrement dans la caricature, la simplification, la vision systémique. Revel ne fait pas pour moi exception.
En ce sens, Revel mérite très clairement le trophée du plus gros point Godwin de l’année 2000 en insistant (lourdement) sur le parallèle entre nazisme et communisme (amusant quand on sait que certains font le parallèle entre libéralisme et nazisme), qui seraient finalement les deux faces d’une même pièce ! Des frères presque jumeaux finalement, où la seule véritable distinction acceptable serait une dichotomie entre une politique appliquée clairement annoncée et une autre cachée, qui ferait le contraire de ce qu’elle proclamait. Jean-François Revel, nouvel historien majeur du « totalitarisme » ?
Par la même Revel fait en quelque sorte sentir de manière plus ou moins cachée que le nazisme serait moins « négatif » car fondamentalement plus honnête que le communisme.
Bien entendu, notre cher libéral ne s’arrête pas là, et applique le néologisme de négationnisme aux « pro communistes » aveugles (plus ou moins volontairement) envers les crimes perpétrés par des régimes qui se disent ou sont qualifiés de communistes. Pas de raison qu’on réserve ça aux « nazis » et aux autres pardi !
Notre cher libéral se permet même une tirade assez culottée, dont j’ai peine à trouver à l’intérieur du seconde degré : "Avoir été communiste, c'était avoir été soit coauteur soit complice d'un colossal crime contre l’humanité ».
Bien entendu, et c’est de bonne guerre, Revel expose sous un jour plus que laudatif le « mouvement libéral », et en cela semble clairement trier dans l’Histoire les exemples qui illustrent sa thèse. Les socialistes disent se battre pour les droits sociaux et diabolisent les libéraux ? Mais, enfin ! Il ne faut surtout pas oublier que Bastiat ou Guizot ont pris des mesures ou des tenus des prises de position dans ce sens ! Oui, d’accord d’accord, je veux bien, ces exemples sont sans doute véridiques, mais quid de la recontextualisation historique et des autres libéraux ou même de leurs autres actes ? Ont-ils été toujours aussi attentionné que Revel semble le laisser entendre ? Les libéraux, parangons de la défense des opprimés et pourfendeurs des injustices ? (j’ai une phrase sympathique de Constant sous le coude pour qui veut). Bizarrement, ce n’est pas exactement l’image qu’on peut en avoir (sans doute encore et toujours à cause de la propagande marxiste). Trier dans l’Histoire est une chose aisée, même un communiste pourrait surement faire de même pour illustrer tel ou tel point de sa thèse. Une hirondelle ne fait pas le printemps sait-on d’ailleurs.
JFR s’arrête pendant quelques instants sur des déclarations de Marx, Engels et d’autres pour montrer qu’ils ne sont pas aussi blanc que certains peuvent le penser. Par exemple, il met en exergue des propos antisémites (hum dans un livre où on essaye de mettre sur le même plan nazisme et communisme, vous la sentez la finesse ?). Certes, ils ont tenu de tels propos (déplorables), mais, pourquoi ne parle-t-il pas aussi de certaines prises de position de libéraux sur des sujets, dira-t-on, quelque peu brulants. Heureuse coïncidence, je parcoure actuellement l’ouvrage Contre Histoire du libéralisme du philosophe Domenico Losurdo, qualifié de manière fleurie de « stalinien » par notre camarade gio, qui apprécie particulièrement éplucher les ouvrages écrits par de nombreux libéraux pour mettre en lien ce qui se dit du libéralisme et ce qu’ont dit certains libéraux. Partant de là, que pense Revel de Ludwig Von Mises, un des grands personnages de la sphère libérale, sans doute effrayé par le bruissement social en cours, aurait loué le coup d’état de Mussolini, « sauveur de la civilisation », « le mérite acquis de cette façon par le fascisme vivra éternellement dans l’histoire ».
Que pense aussi Revel du rapport ambiguë entre l’esclavage et le libéralisme, quand tant de personnalités se réclamant de cette pensée furent d’ardents défenseurs de l’esclavagisme, le grand philosophe Locke notamment, à une époque où pourtant, nombreuses furent les oppositions à une telle pratique.
Revel est aussi prompt à balancer des épithètes discriminants gratuits envers plusieurs personnalités sans chercher à critiquer (au sens neutre) leurs travaux. Deux exemples précis peuvent être mis en avant. En premier lieu, l’anathème de « stalinien » (il sort souvent celui-ci) est, il me semble accolé à la personne de l’historien Hobsbawm, qui a surement eu des paroles ou des prises de positions contestables, mais Revel ne rentre à aucun moment, même succinctement dans l’analyse des ouvrages mentionnés. J’appelle cela disqualifier un travail par une attaque ad hominem. Qu’il me dise quels points il réfute dans l’ouvrage, par exemple, de l’âge des empires, ça, c’est quelque chose qui m’intéresse. De même, il évoque le papier de Moshe Lewin sur (entre autre) l’ouvrage ô combien loué par Revel de François Furet « Le passé d’une illusion » dans le (satanique) Monde Diplomatique. Même son de cloche ici, aucun regard critique sur le dit article pourtant assez fourni et intéressant, dont je conseille la lecture à tous et qui mérite (au moins) discussion. Je veux bien que dans un « brulot », un « pamphlet », on soit plus léger, moins « universitaire », mais nous sommes en droit tout de même d’attendre un minimum de sérieux, surtout de la part d’un homme qui vient juger du haut de son trône et condamner de manière aussi tranchée « l’idée socialiste ». Peut-être n’avait-il pas sous le coude d’arguments suffisamment solide à mettre en face de ces deux auteurs …
Dans l’article précédemment mentionné, l’historien Moshe Lewin arguait que :
« Nul doute : la question qui préoccupe tant de gens - pourquoi le socialisme (ou le communisme) s’est-il effondré en Russie ? - apparaît comme un leurre. Pour parvenir à comprendre cette histoire, il faut admettre cette évidence : le socialisme et, a fortiori, le communisme ne sont pas des concepts adéquats. Aussi faudrait-il reformuler la question : qu’est-ce donc qui s’est effondré en Russie ? Voilà de quoi méditer. »
Evidemment, vous vous en doutez bien, notre cher omniscient Revel balaye un tel propos comme Fabius congédiant les dires de son interlocuteur d’un mouvement de main suffisant. Ce n’est que ritournelle sophistique que de mettre en avant une telle idée ! Le responsable, c’est l’idée socialiste, point final, pas la peine d’ergoter pendant des heures et des pages sur une telle question. Tout est plus simple avec JFR. Néanmoins, en étant quelque peu extérieur à ces chamailleries, il s’agit d’un point central. Les régimes désignés (ou auto désignés) comme communistes ou socialistes le furent-ils véritablement ? Peut-on condamner à la damnation éternelle une doctrine que l’on pourrait qualifier de « mal appliquée » ? La socialisme est-il finalement Un, indivisible, monolithique ? Les libéraux se drapent des oripeaux de la vertu d’une soi disante « non idéologie » (ah ah) et d’une grande pluralité mais refusent visiblement ce dont ils se parent à d’autres. Pourtant je n’ai pas l’impression que le Socialisme soi aussi univoque et semblable partout et de tout temps …
Et au contraire, bien entendu, ce qui était attendu arrive, il n’y a pas d’ « idéologie » (ou remplacez par le terme qui vous convient) libérale. Vous pouvez vous échiner à critiquer certaines prises de position de libéraux, mais jamais, ô non jamais vous n’atteindrez le plumage étincelant de l’idée libérale ! On vous l’a dit, le Mal, il est en face.
Beaucoup de bla bla pour ne pas dire grand chose, je sais bien, mais au boulot, dans un bureau, on trouve toujours quelque chose à faire pour échapper à son dur labeur.
J’ai posé quelques mots sur ce qui m’est spontanément venu en tête du souvenir de cette lecture rapide, mais Revel aborde bien d’autres points, plus ou moins en détail. Son ouvrage ne se résume pas à mes quelques phrases. Si je devais mettre en avant le point sur lequel je rejoins le plus JFR c’est bien, il me semble sur les premiers chapitres où il évoque l’attachement et l’aveuglement de nombreux individus envers certains régimes "socialistes" et le fanatisme des militants communistes. C’est assez vrai, plutôt intéressant par moment et avec quelques passages croustillants.
Dois-je maintenant préciser que je ne porte pas la doctrine Marxiste dans mon coeur, pour ne pas être qualifié par les thuriféraires de la Vérité de … stalinien ?
Cet ouvrage fit un énorme buzz à sa sortie, époque où je l'ai lu. Mais je ne me souviens pas de grand-chose sur le fond, hormis un ton certes percutant. Il est vrai que l'auteur fut classé très à droite. Par ailleurs, déjà à son époque, les facteurs essentiellement d'ordre économique, qui entraîneront à leur tour des clivages d'ordre communautariste, étaient ceux à l'oeuvre qui se révéleront les plus susceptibles de mettre en danger la démocratie, par la substitution d'une nouvelle aristocratie d'ordre financier se moquant de la démocratie issue du suffrage universel. Or je ne me souviens pas que cet auteur ait mis cette problématique particulièrement en évidence. Je peux évidemment me tromper à ce sujet mais le fait que je n'aie rien retenu de ce bouquin ne m'amènerait pas à en conseiller la lecture aujourd'hui
Déjà dans son "Histoire de la philosophie occidentale" publié en 1994, JF Revel exprimait le peu de considération qu'il a pour l'œuvre de Descartes .
J'ai d'abord pensé que "Descartes inutile et incertain" -le compliment est extrait des Pensées de Pascal- , publié en 1998 était une occasion d'enfoncer le clou en troquant le marteau initial pour la masse que méritait le sujet . Vérification faite, il s'agit exactement du même texte que le chapitre sixième de l'Historie susnommée, auquel ont été ajoutées huit pages d'une conclusion qui n'apporte pas grand chose. Malice d'édition et/ou période de vache très maigre pour l'auteur.
Cela n'enlève rien à l'intérêt de l'essai qui démonte, d'une façon que j'ai trouvée très convaincante, que Descartes n'a pas apporté grand-chose de nouveau à part un système métaphysique dont la clé de voûte est l'existence "démontrée" de Dieu, duquel dérive un ensemble de théories en physique, biologie, psychologie ,...qui se sont à peu près toutes révélées fausses.
"La connaissance de Dieu conduit à la connaissance détaillée de l'univers, tout le cartésianisme est dans cette conviction".
Revel parcourt notamment quelques unes des hypothèses intuitives, erreurs de raisonnement, fautes de logique, approximations qui émaillent les écrits du philosophe qui, modestement, se pensait le seul capable depuis l'antiquité de venir à bout de ces difficiles problèmes.
Mais: "il ne s'agit pas tant ici de dresser le catalogues des erreurs scientifiques nombreuses commises par Descartes que de cerner l'erreur d'orientation globale qui découlait nécessairement de la façon même dont il posait le problème de la connaissance en la rattachant à la véracité divine, et dont il expliquait le monde en le soumettant à sa théorie de la nature de Dieu."
Il dénie à Descartes, adepte d'une philosophie au sens antique,incluant toutes les autres disciplines y compris la science, tout caractère novateur, faisant de lui un homme du passé, finalement dogmatique, proche par la démarche de l'école scolastique avec laquelle il entendait rompre.
"Or précisément, toute la critique de la scolastique consistait à séparer enfin complètement la philosophie première et les sciences d'observation. Descartes ne semble pas l'avoir compris."
Revel souligne l'incompréhension fondamentale de Descartes pour la vraie révolution scientifique du temps, illustrée par Galilée puis Newton notamment, celle de l'induction qui consiste à partir des faits de l'expérimentation pour concevoir les théories devant rendre compte des premiers, quand lui Descartes privilégie de façon inconditionnelle l'intuition-formulation d'hypothèses relevant, pour lui, de l'évidence- et la déduction à partir de celles-ci : "il ne se propose pas d'expérimenter au sens où Galilée le faisait. A l'inverse, comme Platon, il a confiance dans la validité absolue de ses principes a priori, aperçus par la seule lumière du raisonnement, et donc, par avance, il est sûr de leur efficacité dans la pratique".
Revel décrit aussi un Descartes, peu curieux de s'enrichir des découvertes scientifiques de son époque mais principalement préoccupé de s'enquérir si celles-ci rentrent dans l'ordre de son système, sinon de les tordre pour les y faire rentrer ou les rejeter quand c'est impossible.
Polémique bien sûr, en ce pays. Il n'est que de lire l'article consacré à Descartes dans Wikipédia pour s'en convaincre!
J'ai d'abord pensé que "Descartes inutile et incertain" -le compliment est extrait des Pensées de Pascal- , publié en 1998 était une occasion d'enfoncer le clou en troquant le marteau initial pour la masse que méritait le sujet . Vérification faite, il s'agit exactement du même texte que le chapitre sixième de l'Historie susnommée, auquel ont été ajoutées huit pages d'une conclusion qui n'apporte pas grand chose. Malice d'édition et/ou période de vache très maigre pour l'auteur.
Cela n'enlève rien à l'intérêt de l'essai qui démonte, d'une façon que j'ai trouvée très convaincante, que Descartes n'a pas apporté grand-chose de nouveau à part un système métaphysique dont la clé de voûte est l'existence "démontrée" de Dieu, duquel dérive un ensemble de théories en physique, biologie, psychologie ,...qui se sont à peu près toutes révélées fausses.
"La connaissance de Dieu conduit à la connaissance détaillée de l'univers, tout le cartésianisme est dans cette conviction".
Revel parcourt notamment quelques unes des hypothèses intuitives, erreurs de raisonnement, fautes de logique, approximations qui émaillent les écrits du philosophe qui, modestement, se pensait le seul capable depuis l'antiquité de venir à bout de ces difficiles problèmes.
Mais: "il ne s'agit pas tant ici de dresser le catalogues des erreurs scientifiques nombreuses commises par Descartes que de cerner l'erreur d'orientation globale qui découlait nécessairement de la façon même dont il posait le problème de la connaissance en la rattachant à la véracité divine, et dont il expliquait le monde en le soumettant à sa théorie de la nature de Dieu."
Il dénie à Descartes, adepte d'une philosophie au sens antique,incluant toutes les autres disciplines y compris la science, tout caractère novateur, faisant de lui un homme du passé, finalement dogmatique, proche par la démarche de l'école scolastique avec laquelle il entendait rompre.
"Or précisément, toute la critique de la scolastique consistait à séparer enfin complètement la philosophie première et les sciences d'observation. Descartes ne semble pas l'avoir compris."
Revel souligne l'incompréhension fondamentale de Descartes pour la vraie révolution scientifique du temps, illustrée par Galilée puis Newton notamment, celle de l'induction qui consiste à partir des faits de l'expérimentation pour concevoir les théories devant rendre compte des premiers, quand lui Descartes privilégie de façon inconditionnelle l'intuition-formulation d'hypothèses relevant, pour lui, de l'évidence- et la déduction à partir de celles-ci : "il ne se propose pas d'expérimenter au sens où Galilée le faisait. A l'inverse, comme Platon, il a confiance dans la validité absolue de ses principes a priori, aperçus par la seule lumière du raisonnement, et donc, par avance, il est sûr de leur efficacité dans la pratique".
Revel décrit aussi un Descartes, peu curieux de s'enrichir des découvertes scientifiques de son époque mais principalement préoccupé de s'enquérir si celles-ci rentrent dans l'ordre de son système, sinon de les tordre pour les y faire rentrer ou les rejeter quand c'est impossible.
Polémique bien sûr, en ce pays. Il n'est que de lire l'article consacré à Descartes dans Wikipédia pour s'en convaincre!
« Le Moine et le Philosophe » rassemble les échanges entre Jean François Revel, philosophe athée, et Matthieu Ricard, son fils, moine bouddhiste, proche du Dalaï Lama. Classé par thèmes, le livre tente par une série de questions d’interroger deux modes de pensée, de démarches intellectuelles et spirituelles. En abordant ce genre d’ouvrage, ces questions sont celles que le lecteur se pose plus ou moins explicitement. Comment expliquer le parcours de Mattieu Ricard promis à un brillant avenir scientifique et qui abandonne tout pour revêtir les habits d’un moine bouddhiste. Comment comprendre l’intérêt de l’Occident pour le Bouddhisme ? J. F. Revel replace certains éléments du Bouddhisme dans l’histoire de la philosophie occidentale. Mathieu Ricard développe les fondements de la philosophie (ou religion ?) bouddhiste, explique la situation du Tibet sous l’autorité chinoise, les tentatives politiques du Dalaï Lama. Certains chapitres restent plus ardus : les conceptions spirituelles du Bouddhisme… Mais l’ensemble est intéressant car le livre interroge l’Occident sur les limites de ses succès scientifiques…sur ses désastreuses idéologies des XIX ème et XX ème siècles. Reste les explications de Mathieu Ricard sur la philosophie ou la religion bouddhiste qui attire les européens et qui sont laissées à l’appréciation de lecteur.
C'est un livre qui m'a donné beaucoup de forces dans ma vie professionnelle et personnelle avant que je n'applique mes propres valeurs mûries et réfléchies et parfois moins douces que le boudhisme.
Sur Proust, on peut lire cet essai, pas mal du tout, réédité en 2013. Ces « Remarques » de Jean-François Revel font suite à une relecture de sa part afin, dit-il, de « se reposer des théories […] fuir leur dogmatisme étouffant et les oublier au contact des textes originaux ». L'approche me convient. Le livre a été écrit en 1955, quelques chapitres ajoutés en 1959 et une parution en 1960. Lecture stimulante pour qui aime Proust compte tenu du caractère d’extrême proximité entretenue avec le texte, toujours abondamment cité, et qui tord le cou à certaines idées reçues sur Proust et La Recherche. L’essai montre par la même occasion que le commentaire théorique, aussi érudit soit-il, ne peut à lui seul rendre compte de ce qu'est l’œuvre littéraire. Style élégant et percutant.
La Recherche, une œuvre coupée du réel ? Reprenant à son compte la formule de Painter, d’une « autobiographie créatrice », Revel analyse et illustre une géologie proustienne (p.34) où l’imagination, loin d’être la négation de la réalité, en est plutôt le révélateur. C’est ainsi que Proust, à partir du vécu et de la « vérité » des détails, atteint le plus haut comique ou le plus profond sérieux. Contrairement au reproche qui lui est adressé d'une oeuvre déconnectée du réel, elle est au contraire pétrie à son contact et reconfigurée par l'expérience personnelle de l'auteur. Et c’est là que Revel nous dit rencontrer en Proust le créateur magistral.
Complaisant ou snob Proust ? S'il s'est penché sur l'oisiveté d’une classe sociale particulière, c’est qu’elle est SON sujet. Il débusque le snobisme et l'examine ainsi qu’un anthropologue. La constellation des Guermantes est en effet peuplée de gens snobs qui passent leur temps à s’inviter ou à s’éviter. Mais Proust ne s’est pas contenté de la seule classe aristocratique pour décrire des snobs : on en rencontre également chez les grands et des petits bourgeois (les Verdurin et leurs fidèles notamment). La chronique ordinaire de la société ne se limite pas à celle des mondains, elle s’élargit aussi à celle des employés (Aimé) et des gens de maisons (Françoise), des artistes (Elstir, Vinteuil), des intellectuels (Bergotte). Proust y excelle, bien plus selon Revel, que dans « les morceaux » habituellement cités (la madeleine, le buisson d’aubépine etc.), et que dans la poésie des noms et des lieux.
Un essai de Thorstein Veblen : "La théorie de la classe oisive" (1899, traduit de l'anglais en 1970), entre en "coïncidence involontaire" avec La Recherche. Sa description d'une classe "en consommation improductive de temps", permet à Revel d’appréhender l’attitude de Proust face à la politique. Il relève que cette dernière (la politique) est partout présente dans La Recherche, illustrée par l'affaire Dreyfus mentionnée très tôt. Mais également par la description de la médiocrité de certains personnels de la haute administration (Norpois, parfait exemple du carriérisme véreux), de l'incompétence de l'Etat-Major ou de certains hommes politiques, par la bêtise du nationalisme, tout comme du bellicisme ambiant, de l'aveuglement ou de l'hypocrisie qui sont omniprésents.
Sur l’amour, Proust sceptique et superficiel ? Le narrateur de la Recherche est persuadé que l’amour, ne peut être partagé, ni même ne peut exister. L’amour est « L’annonce d’une solitude irrémédiable ». L’être aimé n’est pas aimé pour lui-même, c’est un absolu qui est recherché à travers lui. Vision platonicienne, selon Revel, et non psychologique. Comme en art où l’objet éveille à quelque chose de plus durable et plus précieux. Mais Proust, lui, ne croit à aucune transcendance, à la différence de Platon. L’amour n’est donc que souffrance et la vie est tragique. Sa conception de l’amour/maladie n’a rien de superficiel et plonge ses racines jusque dans l’antiquité (Lucrèce, Théocrite, Catulle). Revel renvoie à deux textes de Freud (Sur le narcissisme, paru en 1914 et Deuil et Mélancolie écrit en 1917 que La Fugitive illustre parfaitement), qui trouvent un écho puissant dans La Recherche (p. 143). Rien à voir donc avec une conception de l’amour superficielle qui ne serait que représentative d’une certaine classe à la Belle Epoque comme beaucoup ont pu dire.
La « vérité » est toujours fluctuante et rien n’est jamais sûr ni acquis chez Proust. Infidélité et mensonge semblent régner dans toute relation entre individus et rendent donc l’amour ou l'amitié impossible. Odette a-t-elle couché avec Forcheville le soir où Swann la cherchait ? Personne n’en saura jamais rien... L’amitié que le narrateur porte à Saint-Loup est alors d’autant plus exceptionnelle. Mais Revel note qu’elle le détourne cependant de sa vraie vocation littéraire. On peut aussi s’interroger sur ce qui nourrit les relations dans La Recherche ? Plaisir de la rencontre ou des mondanités ? Médisance et méchanceté sont pratiquées comme des sports. Cette société qui ne s'amuse pas plus qu'elle ne travaille est le terreau d’un pessimisme nécessaire à Proust pour écrire selon Revel.
Enfin, il établit un parallèle entre Montaigne et Proust, deux écrivains proches par leur œuvre taxés tous les deux de superficiels, mondains et complaisants. Ce sont des observateurs et non des théoriciens : "Ils remplissent leurs filets d'autant plus abondamment qu'ils ne se demandent pas au préalable selon quels principes ils vont trier le matériel qu'ils amènent à la surface". Ils ont une sensibilité qui leur permet de capter ce que les autres ressentent. "Avec des journées de psychopathes ils ont édifié des vies de sages". A propos des deux Revel ajoute que "Les injections de substance neuve sont plus rares dans l'histoire de la pensée que les remaniements doctrinaux" et qu’à ce titre ils sont exemplaires.
L’essai se termine par une réflexion sur l’œuvre d’art. Proust pense qu’elle procède d’un moi profond qu’il distingue du moi social et quotidien - sujet de « Contre Sainte-Beuve » -, chaque artiste ayant son monde d'images préalable à son expérience, "son pays". Revel montre à quel point la limite stricte décrite par Proust est dans son cas plutôt poreuse. Que serait en effet son œuvre sans les innombrables remontées fournies par son moi quotidien et dans lesquelles il n'a cessé de puiser pour nourrir la Recherche ? Quant à sa théorie de la mémoire, elle est le fruit de la mode de l'époque (c'est à dire Bergson et la réaction anti-intellectualiste à l'oeuvre dans toute l'Europe au début du XX° siècle). Et si on a les images de son temps, cela peut aussi conduire à des bévues de jugement ajoute Revel (Proust admire Anna de Noailles et Maeterlinck, Léon Daudet, ignore Apollinaire, Max Jacob ou Jarry). C’est sur ces deux derniers terrains qu’il le trouve plus « faible ».
Conclusion de Revel Proust infiniment plus convaincant, car créateur, dans l’exercice d’anthropologie littéraire et celui de l’observation maniaque de la progression des désastres de la passion ; beaucoup moins sur la théorie construite autour de la mémoire et de la création artistique. A méditer chacun se fera une idée. Un essai passionnant et très riche qui offre des angles de réfléxions multiples sur la Recherche et de nombreuses autres pistes de lectures ou relectures.
La Recherche, une œuvre coupée du réel ? Reprenant à son compte la formule de Painter, d’une « autobiographie créatrice », Revel analyse et illustre une géologie proustienne (p.34) où l’imagination, loin d’être la négation de la réalité, en est plutôt le révélateur. C’est ainsi que Proust, à partir du vécu et de la « vérité » des détails, atteint le plus haut comique ou le plus profond sérieux. Contrairement au reproche qui lui est adressé d'une oeuvre déconnectée du réel, elle est au contraire pétrie à son contact et reconfigurée par l'expérience personnelle de l'auteur. Et c’est là que Revel nous dit rencontrer en Proust le créateur magistral.
Complaisant ou snob Proust ? S'il s'est penché sur l'oisiveté d’une classe sociale particulière, c’est qu’elle est SON sujet. Il débusque le snobisme et l'examine ainsi qu’un anthropologue. La constellation des Guermantes est en effet peuplée de gens snobs qui passent leur temps à s’inviter ou à s’éviter. Mais Proust ne s’est pas contenté de la seule classe aristocratique pour décrire des snobs : on en rencontre également chez les grands et des petits bourgeois (les Verdurin et leurs fidèles notamment). La chronique ordinaire de la société ne se limite pas à celle des mondains, elle s’élargit aussi à celle des employés (Aimé) et des gens de maisons (Françoise), des artistes (Elstir, Vinteuil), des intellectuels (Bergotte). Proust y excelle, bien plus selon Revel, que dans « les morceaux » habituellement cités (la madeleine, le buisson d’aubépine etc.), et que dans la poésie des noms et des lieux.
Un essai de Thorstein Veblen : "La théorie de la classe oisive" (1899, traduit de l'anglais en 1970), entre en "coïncidence involontaire" avec La Recherche. Sa description d'une classe "en consommation improductive de temps", permet à Revel d’appréhender l’attitude de Proust face à la politique. Il relève que cette dernière (la politique) est partout présente dans La Recherche, illustrée par l'affaire Dreyfus mentionnée très tôt. Mais également par la description de la médiocrité de certains personnels de la haute administration (Norpois, parfait exemple du carriérisme véreux), de l'incompétence de l'Etat-Major ou de certains hommes politiques, par la bêtise du nationalisme, tout comme du bellicisme ambiant, de l'aveuglement ou de l'hypocrisie qui sont omniprésents.
Sur l’amour, Proust sceptique et superficiel ? Le narrateur de la Recherche est persuadé que l’amour, ne peut être partagé, ni même ne peut exister. L’amour est « L’annonce d’une solitude irrémédiable ». L’être aimé n’est pas aimé pour lui-même, c’est un absolu qui est recherché à travers lui. Vision platonicienne, selon Revel, et non psychologique. Comme en art où l’objet éveille à quelque chose de plus durable et plus précieux. Mais Proust, lui, ne croit à aucune transcendance, à la différence de Platon. L’amour n’est donc que souffrance et la vie est tragique. Sa conception de l’amour/maladie n’a rien de superficiel et plonge ses racines jusque dans l’antiquité (Lucrèce, Théocrite, Catulle). Revel renvoie à deux textes de Freud (Sur le narcissisme, paru en 1914 et Deuil et Mélancolie écrit en 1917 que La Fugitive illustre parfaitement), qui trouvent un écho puissant dans La Recherche (p. 143). Rien à voir donc avec une conception de l’amour superficielle qui ne serait que représentative d’une certaine classe à la Belle Epoque comme beaucoup ont pu dire.
La « vérité » est toujours fluctuante et rien n’est jamais sûr ni acquis chez Proust. Infidélité et mensonge semblent régner dans toute relation entre individus et rendent donc l’amour ou l'amitié impossible. Odette a-t-elle couché avec Forcheville le soir où Swann la cherchait ? Personne n’en saura jamais rien... L’amitié que le narrateur porte à Saint-Loup est alors d’autant plus exceptionnelle. Mais Revel note qu’elle le détourne cependant de sa vraie vocation littéraire. On peut aussi s’interroger sur ce qui nourrit les relations dans La Recherche ? Plaisir de la rencontre ou des mondanités ? Médisance et méchanceté sont pratiquées comme des sports. Cette société qui ne s'amuse pas plus qu'elle ne travaille est le terreau d’un pessimisme nécessaire à Proust pour écrire selon Revel.
Enfin, il établit un parallèle entre Montaigne et Proust, deux écrivains proches par leur œuvre taxés tous les deux de superficiels, mondains et complaisants. Ce sont des observateurs et non des théoriciens : "Ils remplissent leurs filets d'autant plus abondamment qu'ils ne se demandent pas au préalable selon quels principes ils vont trier le matériel qu'ils amènent à la surface". Ils ont une sensibilité qui leur permet de capter ce que les autres ressentent. "Avec des journées de psychopathes ils ont édifié des vies de sages". A propos des deux Revel ajoute que "Les injections de substance neuve sont plus rares dans l'histoire de la pensée que les remaniements doctrinaux" et qu’à ce titre ils sont exemplaires.
L’essai se termine par une réflexion sur l’œuvre d’art. Proust pense qu’elle procède d’un moi profond qu’il distingue du moi social et quotidien - sujet de « Contre Sainte-Beuve » -, chaque artiste ayant son monde d'images préalable à son expérience, "son pays". Revel montre à quel point la limite stricte décrite par Proust est dans son cas plutôt poreuse. Que serait en effet son œuvre sans les innombrables remontées fournies par son moi quotidien et dans lesquelles il n'a cessé de puiser pour nourrir la Recherche ? Quant à sa théorie de la mémoire, elle est le fruit de la mode de l'époque (c'est à dire Bergson et la réaction anti-intellectualiste à l'oeuvre dans toute l'Europe au début du XX° siècle). Et si on a les images de son temps, cela peut aussi conduire à des bévues de jugement ajoute Revel (Proust admire Anna de Noailles et Maeterlinck, Léon Daudet, ignore Apollinaire, Max Jacob ou Jarry). C’est sur ces deux derniers terrains qu’il le trouve plus « faible ».
Conclusion de Revel Proust infiniment plus convaincant, car créateur, dans l’exercice d’anthropologie littéraire et celui de l’observation maniaque de la progression des désastres de la passion ; beaucoup moins sur la théorie construite autour de la mémoire et de la création artistique. A méditer chacun se fera une idée. Un essai passionnant et très riche qui offre des angles de réfléxions multiples sur la Recherche et de nombreuses autres pistes de lectures ou relectures.
Le fils parle de son engagement bouddhiste, pendant que le père se fait observateur passif de l'histoire de la philosophie occidentale.
Du point de vue du père, l'échec de l'utopie marxiste serait le point culminant des philosophies occidentales trop occupées à chercher le bonheur à travers une meilleure organisation en société. Donc le bouddhisme éveillerait l'attention d'un occident dépité, mais pas au point de remplacer une utopie politique par une métaphysique alambiquée. En effet la réincarnation en tant que continuation du flux de conscience ne remporte clairement pas l'adhésion du père. le fils voudrait prouver par ses expériences vécues mais il obtient le résultat inverse.
Puis vient la question brulante pour le père : comment accepter que son fils ait abandonné une brillante carrière scientifique pour devenir moine ! S'engage alors le débat sur la perception de la contribution de la science au bonheur. Et là c'est le fils qui se montre le plus sceptique.
A chacun donc de prendre les arguments du père et du fils et d'en faire ce qu'il en veut. C'est le chemin qui compte. Au fil des lectures partagées sur Babelio, j'ai retenu ceci :
-Les mystiques nationalistes ou religieuses, la dictature du prolétariat ou celle de l'argent ont causé des ravages. Pour cette raison le débat démocratique doit être vif et ouvert. Chacun doit participer d'une manière ou d'une autre à la société civile. Les pouvoirs économiques et politiques de chaque individu doivent toujours être limités.
-Toutes les idéologies chantent la même chanson monotone "Je ne suis pas un animal" (cit. Wilhelm Reich). L'animal humain s'égare à cause de ses propres capacités cognitives. Ainsi notre espèce, par son énorme impact sur l'environnement, démontre une capacité d'adaptation limitée.
- Sans l'apport qu'une quelconque révélation, la vie après la mort existe réellement dans la mémoire vive des êtres proches survivants. Et donc cette mémoire doit être animée par l'exemple de la sagesse du défunt.
Du point de vue du père, l'échec de l'utopie marxiste serait le point culminant des philosophies occidentales trop occupées à chercher le bonheur à travers une meilleure organisation en société. Donc le bouddhisme éveillerait l'attention d'un occident dépité, mais pas au point de remplacer une utopie politique par une métaphysique alambiquée. En effet la réincarnation en tant que continuation du flux de conscience ne remporte clairement pas l'adhésion du père. le fils voudrait prouver par ses expériences vécues mais il obtient le résultat inverse.
Puis vient la question brulante pour le père : comment accepter que son fils ait abandonné une brillante carrière scientifique pour devenir moine ! S'engage alors le débat sur la perception de la contribution de la science au bonheur. Et là c'est le fils qui se montre le plus sceptique.
A chacun donc de prendre les arguments du père et du fils et d'en faire ce qu'il en veut. C'est le chemin qui compte. Au fil des lectures partagées sur Babelio, j'ai retenu ceci :
-Les mystiques nationalistes ou religieuses, la dictature du prolétariat ou celle de l'argent ont causé des ravages. Pour cette raison le débat démocratique doit être vif et ouvert. Chacun doit participer d'une manière ou d'une autre à la société civile. Les pouvoirs économiques et politiques de chaque individu doivent toujours être limités.
-Toutes les idéologies chantent la même chanson monotone "Je ne suis pas un animal" (cit. Wilhelm Reich). L'animal humain s'égare à cause de ses propres capacités cognitives. Ainsi notre espèce, par son énorme impact sur l'environnement, démontre une capacité d'adaptation limitée.
- Sans l'apport qu'une quelconque révélation, la vie après la mort existe réellement dans la mémoire vive des êtres proches survivants. Et donc cette mémoire doit être animée par l'exemple de la sagesse du défunt.
C'est un dialogue entre le père, J. F. Revel philosophe, et le fils, M. Ricard moine bouddhiste; deux hommes extrêmement intelligents qui reflechissent ensemble sur le thème: " le bouddhisme et l'Occident ". La question est née du fait que le bouddhisme, doctrine qui date de plusieurs siècles avant notre ère, a pris de plus en plus d'importance et fait de plus en plus d'adeptes, en particulier depuis le prix Nobel de la paix que le Dalaï-lama a reçu en 1989. Tous les grands problèmes sont abordés: qu'est-ce que le bouddhisme ? Religion ou Philosophie ? Pourquoi tant de curiosité à son sujet en Occident ? Après avoir parlé de son parcours, Matthieu Ricard, interrogé par son père, aborde le thème de la transformation intérieure, dont la motivation initiale est d'échapper à la souffrance - état d'insatisfaction profonde - , qui est elle-même le résultat de l'ignorance; le moi n'a aucune existence propre, il est la source de tous nos maux, et le bouddhisme offre les moyens d'atteindre la paix intérieure en relâchant cet attachement au moi; grâce à la connaissance du fonctionnement de l'esprit, on peut se libérer des émotions perturbatrices. Le bouddhisme parle d'états successifs d'existence, notre vie ne se limitant pas à l'existence présente, il y a eu d'autres états d'existence avant, il y en aura d'autres après. Le cheminement vers l'état de Bouddha, vers la perfection, est un voeu altruiste et non pas égocentrique; si j'atteins la connaissance, je serai capable d'aider les autres à se libérer des causes de leur souffrance. L'altruisme n'est pas le fait d'accomplir de temps en temps de bonnes actions, mais d'avoir un souci constant de l'autre et de son bien-être. Sont abordés également les problèmes de protection de l'environnement, des réponses à apporter à la violence, en particulier à la volonté chinoise d'annihiler les tibétains ... Le monde n'est pas mauvais en soi; pour un être éveillé, un bouddha, il est pureté infinie; le bouddhisme ne prône pas l'apathie: notre action sur le monde est souhaitable, mais pour cela notre transformation intérieure est indispensable ! Tout au long du livre, interventions passionnantes de J. F. Revel qui émet des hypothèses quant à l'expansion spirituelle du bouddhisme.
Lien : http://www.les2bouquineuses...
Lien : http://www.les2bouquineuses...
Les démocraties ne sont-elles pas que de simples parenthèses de l'histoire ? Ton mordant, mais clair et très facile d'accès pour cet ouvrage qui fait réfléchir.
Déjà il y a vingt-cinq ans, Jean-François Revel dénonçait par cette réflexion philosophique et sociologique le trop plein d'informations fournies à tout un chacun suite à la révolution des médias, qui n'a abouti qu'à un appauvrissement de l'analyse et donc ne consiste qu'à une connaissance inutile. Le propos est toujours actualité et je ne peux donc qu'en recommander la lecture.
Brillant pamphlétaire, Jean-François Revel est à peine moins polémique dans les trois titres qu’on trouve aujourd’hui compilés dans l’excellente collection "Bouquins". Mais il y traite beaucoup plus largement de philosophie.
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Je me suis vraiment forcée à finir ce livre. Il est très bien documenté et fait part de beaucoup de faits intéressants mais est beaucoup trop partisan. Il est dur de supporter les 317 pages de propos totalement orientés.
Si on apprécie JF Revel et qu'on souhaite acquérir une connaissance d'"honnête homme" de la philosophie classique, comme ce fut mon cas, alors la lecture de cet ouvrage compact est un vrai plaisir.
Outre la somme de connaissances sur le sujet, on y retrouve, je dirais presque à chaque ligne, l'intelligence aiguë, la vivacité et l'esprit critique de Revel face à l'establishment philosophique et aux "vérités" de l'enseignement académique.
La liberté d'esprit de cet homme qu'il a manifestée de multiples façons est une merveille.
Outre la somme de connaissances sur le sujet, on y retrouve, je dirais presque à chaque ligne, l'intelligence aiguë, la vivacité et l'esprit critique de Revel face à l'establishment philosophique et aux "vérités" de l'enseignement académique.
La liberté d'esprit de cet homme qu'il a manifestée de multiples façons est une merveille.
http://boivino.wordpress.com/2012/07/09/le-moine-et-le-philosophe-un-pere-et-son-fils-debattent-du-sens-de-la-vie/
Lien : http://boivino.wordpress.com..
Lien : http://boivino.wordpress.com..
C'est au-delà de la rencontre d'un religieux et d'un philosophe, les retrouvailles d'un père et d'un fils. Il n'y a donc pas de véritable confrontation mais une discussion gentille entre personnes bien éduquées. Le côté érudit de la conversation rend le livre parfois ennuyeux.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jean-François Revel
Lecteurs de Jean-François Revel (929)Voir plus
Quiz
Voir plus
On entend les noms d'écrivaines et d'écrivains
Elle correspondit sans discontinuer avec Madame Bovary à partir de 1863.
George
Louise
Mathilde
Pauline
12 questions
166 lecteurs ont répondu
Thèmes :
Écrivains français
, 19ème siècle
, 20ème siècle
, 21ème siècleCréer un quiz sur cet auteur166 lecteurs ont répondu