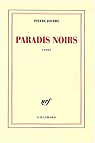Critiques de Pierre Jourde (255)
Critique de Alexis Brocas pour le Magazine Littéraire
Il tient sa garde haute, de l'allonge dans ses analyses, attaque à droite et à gauche, vise juste et parfois en dessous de la ceinture. Pierre Jourde pratique ce qu'il appelle la « critique de combat », et La Littérature sans estomac n'était que d'aimables prolégomènes à la Littérature monstre. Avec cet essai, il se dote d'un ring à sa mesure, où Christine Angot, Virginie Despentes et quelques autres font office de punching-balls, et la critique journalistique joue le rôle du sac de sable. Une critique accusée de plaider la subjectivité pour masquer son incompétence, de dévaluer le commentaire par sa complaisance, de réduire le livre à quelques propositions grossières et d'abdiquer son jugement en estimant tout objet culturel estimable a priori. La critique fait l'objet d'un méticuleux massacre. Cela donne envie de la défendre : sa crise, avérée, ne découle-t-elle pas de celle, plus globale, de la presse ? Puisque le chapitre le plus offensif de cette Littérature monstre s'intitule « Polémiques », il n'est pas interdit de discuter ses thèses... Tout en reconnaissant l'honnêteté de leur auteur. Contrairement à nombre de ses adversaires, Pierre Jourde ne prétend pas décerner des brevets de grands écrivains ; juste souligner ce qui rend, dans un texte, la réalité féconde, et, par une extrême singularité, touche à l'universel. Selon lui, tout découle de la fin du xixe siècle, quand le livre, s'affranchissant des règles, se met à viser l'unicité, l'extraordinaire, le monstrueux. L'essayiste révèle la singularité extrême de certains contemporains de Joris-Karl Huysmans, comme l'inventeur de l'opérette, Louis-Auguste Florimond Ronger, alias Hervé. C'est lui, si doué pour la tautologie ou pour prêter à ses personnages des dialogues insensés, qui étrenne dans l'allégresse une première partie de cette somme « jourdienne » baptisée « Loufoqueries ». On y croise les faunes d'Alexandre Vialatte, Alphonse Allais contant l'écorchement d'une bayadère avec d'innocentes afféteries, ou l'oublié Jean Lorrain et son emploi plus grandiloquent de ce même thème de l'épiderme... Car, pour Jourde, la réussite d'une oeuvre se révèle à la lumière des ratages des autres, consubstantiels à la création. Aussi met-il le même soin à disséquer Poictevin, émule allumé des Goncourt, qu'à évoquer la représentation de l'irreprésentable chez Nerval ou l'hermétisme du « Sonnet en X » de Mallarmé. Si la littérature moderne a accouché de bien des monstres, tous ne sont pas viables. Mais, en bon tératologue, Jourde ne néglige aucune bizarrerie.
Il tient sa garde haute, de l'allonge dans ses analyses, attaque à droite et à gauche, vise juste et parfois en dessous de la ceinture. Pierre Jourde pratique ce qu'il appelle la « critique de combat », et La Littérature sans estomac n'était que d'aimables prolégomènes à la Littérature monstre. Avec cet essai, il se dote d'un ring à sa mesure, où Christine Angot, Virginie Despentes et quelques autres font office de punching-balls, et la critique journalistique joue le rôle du sac de sable. Une critique accusée de plaider la subjectivité pour masquer son incompétence, de dévaluer le commentaire par sa complaisance, de réduire le livre à quelques propositions grossières et d'abdiquer son jugement en estimant tout objet culturel estimable a priori. La critique fait l'objet d'un méticuleux massacre. Cela donne envie de la défendre : sa crise, avérée, ne découle-t-elle pas de celle, plus globale, de la presse ? Puisque le chapitre le plus offensif de cette Littérature monstre s'intitule « Polémiques », il n'est pas interdit de discuter ses thèses... Tout en reconnaissant l'honnêteté de leur auteur. Contrairement à nombre de ses adversaires, Pierre Jourde ne prétend pas décerner des brevets de grands écrivains ; juste souligner ce qui rend, dans un texte, la réalité féconde, et, par une extrême singularité, touche à l'universel. Selon lui, tout découle de la fin du xixe siècle, quand le livre, s'affranchissant des règles, se met à viser l'unicité, l'extraordinaire, le monstrueux. L'essayiste révèle la singularité extrême de certains contemporains de Joris-Karl Huysmans, comme l'inventeur de l'opérette, Louis-Auguste Florimond Ronger, alias Hervé. C'est lui, si doué pour la tautologie ou pour prêter à ses personnages des dialogues insensés, qui étrenne dans l'allégresse une première partie de cette somme « jourdienne » baptisée « Loufoqueries ». On y croise les faunes d'Alexandre Vialatte, Alphonse Allais contant l'écorchement d'une bayadère avec d'innocentes afféteries, ou l'oublié Jean Lorrain et son emploi plus grandiloquent de ce même thème de l'épiderme... Car, pour Jourde, la réussite d'une oeuvre se révèle à la lumière des ratages des autres, consubstantiels à la création. Aussi met-il le même soin à disséquer Poictevin, émule allumé des Goncourt, qu'à évoquer la représentation de l'irreprésentable chez Nerval ou l'hermétisme du « Sonnet en X » de Mallarmé. Si la littérature moderne a accouché de bien des monstres, tous ne sont pas viables. Mais, en bon tératologue, Jourde ne néglige aucune bizarrerie.
Propos théorique exigeant et ambitieux, saine visée polémique, formidable envie de lire. Du bonheur.
Publié en 2008, cet épais volume (700 pages) représente largement un captivant aboutissement à date de la recherche critique menée par Pierre Jourde parallèlement à son activité de romancier, dans la continuité de son « Empailler le toréador : l’incongru dans la littérature française » (1999) et de « La littérature sans estomac » (2002).
Sous-titré « Etudes sur la modernité littéraire », l’ouvrage, lui-même proprement monstrueux, est pourtant d’une surprenante et implacable unité cherchant, dans ses quatre parties thématiques, à dégager et démontrer le lieu littéraire de l’intelligence, de l’expérience de langage et du récit, clairement contre les fossoyeurs trop nombreux voulant perpétuellement discréditer l’idée même de littérature, réputée devoir se dissoudre toujours davantage dans une instantanéité aussi « moderne, forcément moderne » que vide de sens. L’avant-propos de Pierre Jourde, précisant l’étendue du projet, est lumineux, et justifie quasiment à lui seul l’ensemble de l’ouvrage.
Les 200 pages de « Loufoqueries » examinent un certain nombre d’auteurs emblématiques, souvent peu ou mal connus, autour de la Belle Epoque, traquant les ressorts et les limites de certains traits caractéristiques du roman moderne ou contemporain dans les livrets de Hervé, l’inventeur de l’opérette, dans les écrits « non musicaux » d’Erik Satie, dans le traitement du corps (et de sa peau, au premier chef) chez Jean Lorrain, chez Alphonse Allais, chez Georges Fourest, chez Eugène Mouton ou encore chez Félicien Champsaur, mais aussi dans les textes de Vialatte, dans la poésie de Georges Fourest, de Henry Jean-Marie Levet, d’Alphonse Allais, d’André Frédérique, de Léon-Paul Fargue, dans les travaux du photographe contemporain Jean-Luc Dorchies, ou encore dans les bandes dessinées de Goossens.
Les 100 pages de « Monstruosités » poursuivent directement ce premier propos en pointant un certain nombre d’occurrences et d’émergences du « monstrueux » à l’orée du XXème siècle, mettant en évidence le caractère profondément significatif de ce retour et de cette envolée, grâce à un parcours dans les écrits scientifiques et para-scientifiques en tératologie, à une lecture attentive des textes de Jean Richepin, de J.K. Huysmans, de Catulle Mendès, de Princesse Sapho ou de Léon Bloy, à l’analyse de l’hystérie et de l’autoscopie dans la littérature médicale de l’époque comme dans les textes de Gustav Meyrink, mais aussi grâce à une lecture millimétrique du « Rivage des Syrtes » de Gracq, et plus particulièrement à la lecture du portrait de Piero Aldobrandi, ou encore à la définition du statut des îles et des labyrinthes et de leurs imaginaires secrets respectifs dans la littérature du XXème siècle !
Les 150 pages de « Polémiques », utilisant subtilement le matériau dégagé par les deux premières parties de l’ouvrage, poursuit le travail de défense d’une « véritable » critique, à visée à la fois constructive et non complaisante, amorcé dans « La littérature sans estomac », et fournit une brillante démonstration de la légitimité et de la nécessité de ce « rendre compte » qui ne cherche pas à occulter les faiblesses ou les erreurs – perçues et si possible démontrées - des écrivains, fussent-ils « amis ». Une lecture infiniment salutaire pour quiconque se pique d’écrire SUR des livres, fût-ce au travers de modestes notes de lecture… L’arrogante complaisance d’une bonne partie du « système littéraire » de cooptation et d’auto-congratulation, allant de Philippe Sollers au Monde des Livres, qui domine le monde français des lettres depuis trop d’années, en prend au passage pour son grade, tandis que l’auteur nous gratifie de pages captivantes sur Houellebecq, sur Gracq, sur Littell, sur Michon, sur Echenoz ou sur Chevillard, avec une lucidité et une intelligence qui forcent l’admiration, et l’envie de lire encore et encore…
Les 150 pages de « L’objet singulier », enfin, tentent de conclure provisoirement la démarche entreprise, en esquissant une définition dynamique et vivante du roman contemporain, saisi par ses bizarreries revendiquées comme par ses filiations apparentes ou non, en parcourant à nouveau un étonnant matériau allant des romans dont le titre se limite à un nom ou un prénom, ou bien comporte « Monsieur » ou « Madame », aux œuvres consacrées comme « mineures » par la critique postérieure (et à ce que cela signifie), aux curieux destins littéraires de Nerval ou de Mallarmé, de ce point de vue-là (« mineur vs. majeur »), au complexe jeu de J.K. Huysmans avec ces notions même, ou enfin à la figure de Marcel Schwob, comme un archétype ultime de cette impossible synthèse.
L’un des miracles de cet ouvrage, et c’est tout le talent critique de Pierre Jourde qui est là à l’œuvre (comme on a pu en avoir un saisissant aperçu en direct, le 25 avril dernier à la librairie Charybde, où il officiait en « libraire invité »), c’est bien de réussir simultanément à tenir un propos théorique exigeant et ambitieux, à diriger cette recherche dans une visée nettement et sainement polémique, et à donner envie de lire ou relire des dizaines d’auteurs parmi ceux mentionnés. Un immense bonheur de lecture, donc.
Publié en 2008, cet épais volume (700 pages) représente largement un captivant aboutissement à date de la recherche critique menée par Pierre Jourde parallèlement à son activité de romancier, dans la continuité de son « Empailler le toréador : l’incongru dans la littérature française » (1999) et de « La littérature sans estomac » (2002).
Sous-titré « Etudes sur la modernité littéraire », l’ouvrage, lui-même proprement monstrueux, est pourtant d’une surprenante et implacable unité cherchant, dans ses quatre parties thématiques, à dégager et démontrer le lieu littéraire de l’intelligence, de l’expérience de langage et du récit, clairement contre les fossoyeurs trop nombreux voulant perpétuellement discréditer l’idée même de littérature, réputée devoir se dissoudre toujours davantage dans une instantanéité aussi « moderne, forcément moderne » que vide de sens. L’avant-propos de Pierre Jourde, précisant l’étendue du projet, est lumineux, et justifie quasiment à lui seul l’ensemble de l’ouvrage.
Les 200 pages de « Loufoqueries » examinent un certain nombre d’auteurs emblématiques, souvent peu ou mal connus, autour de la Belle Epoque, traquant les ressorts et les limites de certains traits caractéristiques du roman moderne ou contemporain dans les livrets de Hervé, l’inventeur de l’opérette, dans les écrits « non musicaux » d’Erik Satie, dans le traitement du corps (et de sa peau, au premier chef) chez Jean Lorrain, chez Alphonse Allais, chez Georges Fourest, chez Eugène Mouton ou encore chez Félicien Champsaur, mais aussi dans les textes de Vialatte, dans la poésie de Georges Fourest, de Henry Jean-Marie Levet, d’Alphonse Allais, d’André Frédérique, de Léon-Paul Fargue, dans les travaux du photographe contemporain Jean-Luc Dorchies, ou encore dans les bandes dessinées de Goossens.
Les 100 pages de « Monstruosités » poursuivent directement ce premier propos en pointant un certain nombre d’occurrences et d’émergences du « monstrueux » à l’orée du XXème siècle, mettant en évidence le caractère profondément significatif de ce retour et de cette envolée, grâce à un parcours dans les écrits scientifiques et para-scientifiques en tératologie, à une lecture attentive des textes de Jean Richepin, de J.K. Huysmans, de Catulle Mendès, de Princesse Sapho ou de Léon Bloy, à l’analyse de l’hystérie et de l’autoscopie dans la littérature médicale de l’époque comme dans les textes de Gustav Meyrink, mais aussi grâce à une lecture millimétrique du « Rivage des Syrtes » de Gracq, et plus particulièrement à la lecture du portrait de Piero Aldobrandi, ou encore à la définition du statut des îles et des labyrinthes et de leurs imaginaires secrets respectifs dans la littérature du XXème siècle !
Les 150 pages de « Polémiques », utilisant subtilement le matériau dégagé par les deux premières parties de l’ouvrage, poursuit le travail de défense d’une « véritable » critique, à visée à la fois constructive et non complaisante, amorcé dans « La littérature sans estomac », et fournit une brillante démonstration de la légitimité et de la nécessité de ce « rendre compte » qui ne cherche pas à occulter les faiblesses ou les erreurs – perçues et si possible démontrées - des écrivains, fussent-ils « amis ». Une lecture infiniment salutaire pour quiconque se pique d’écrire SUR des livres, fût-ce au travers de modestes notes de lecture… L’arrogante complaisance d’une bonne partie du « système littéraire » de cooptation et d’auto-congratulation, allant de Philippe Sollers au Monde des Livres, qui domine le monde français des lettres depuis trop d’années, en prend au passage pour son grade, tandis que l’auteur nous gratifie de pages captivantes sur Houellebecq, sur Gracq, sur Littell, sur Michon, sur Echenoz ou sur Chevillard, avec une lucidité et une intelligence qui forcent l’admiration, et l’envie de lire encore et encore…
Les 150 pages de « L’objet singulier », enfin, tentent de conclure provisoirement la démarche entreprise, en esquissant une définition dynamique et vivante du roman contemporain, saisi par ses bizarreries revendiquées comme par ses filiations apparentes ou non, en parcourant à nouveau un étonnant matériau allant des romans dont le titre se limite à un nom ou un prénom, ou bien comporte « Monsieur » ou « Madame », aux œuvres consacrées comme « mineures » par la critique postérieure (et à ce que cela signifie), aux curieux destins littéraires de Nerval ou de Mallarmé, de ce point de vue-là (« mineur vs. majeur »), au complexe jeu de J.K. Huysmans avec ces notions même, ou enfin à la figure de Marcel Schwob, comme un archétype ultime de cette impossible synthèse.
L’un des miracles de cet ouvrage, et c’est tout le talent critique de Pierre Jourde qui est là à l’œuvre (comme on a pu en avoir un saisissant aperçu en direct, le 25 avril dernier à la librairie Charybde, où il officiait en « libraire invité »), c’est bien de réussir simultanément à tenir un propos théorique exigeant et ambitieux, à diriger cette recherche dans une visée nettement et sainement polémique, et à donner envie de lire ou relire des dizaines d’auteurs parmi ceux mentionnés. Un immense bonheur de lecture, donc.
Dans cet essai captivant, Pierre Jourde s'interroge sur l'aspiration à la singularité de la littérature, en particulier à la Belle Epoque, et des "formes excessives" (monstrueuses donc) qui en résultent. L'exégèse des "loufoqueries" sert une réflexion sur la modernité littéraire, aussi les écrivains contemporains ne sont-ils pas publiés (ni épargnés). Brillant et passionnant.
Parler des coups de cœur est un exercice toujours difficile. Particulièrement pour ce livre tant il y a dire. Une lecture riche, intense, profonde et desservie par une écriture qui aiguise l’esprit.
Il aura suffi d'une silhouette aperçue sur le quai d'une gare pour le narrateur replonge dans ses souvenirs d'adolescence puis d'enfance. Lui qui croyait enterré toutes ces images, ces années de collège passées dans internat dirigé par des frères refont surface. Devenu un écrivain reconnu, il rend visite à Boris un de ses amis de l'internat. Boris marié, père de famille, l'image respectable tout comme lui, loin de ce qu'ils faisaient subir à Serge avec François le dernier membre du trio disparu depuis.
Se cachant derrière l'insouciance, la naïveté de l'enfance, les jeux n'en étaient pas pour autant cruels, honteux. L'humiliation était un trophée, Serge la victime qui ne bronchait pas. Le narrateur cherche à donner une nouvelle lumière sur ces années comme pour les laver. Mais un détail ou une situation resurgissent "et la sensation d’écœurement me prend, un dégoût qui ne vient pas de la nature peu glorieuse de cet épisode, mais de ce je ne peux empêcher qu'il serve à me rendre intéressant". On découvre François le chef de la bande élevé par des vieilles femmes, les plans conçus avec exaltation où le simple fait de savoir que Serge serait rabaissé une fois de plus engendrait un plaisir pervers. Pourquoi Serge acceptait-il son sort? Et cette silhouette est-ce vraiment François?
Pierre Jourde nous conduit sur les chemins de la mémoire fidèle et infidèle, ce qu'on embellit avec les années ou que l'on oublie par commodité. Mémoire qui nous trompe, nous leurre, nous permet de nous blanchir mais qui quand elle s'éveille révèle des actes et des pensées qu'on a préféré mettre dans un recoin comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais le passé est bien réel et François, Serge le martyr apparaissent différemment.
Juxtaposant réalité et l'imaginatif développé par le poids des souvenirs et de la culpabilité, la question lancinante de l'innocence et des jeux cruels portent ce récit où la noirceur et la tristesse côtoient le sublime. Trois vers de Baudelaire La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs qui martèlent le récit trouvent tout leur sens dans les dernières pages.
Le paradis noirs de l'enfance où le duo souffrance/joie mettent l'âme humaine à nue. Un livré coup de cœur électrochoc par l'histoire et par cette écriture dont je suis tombée amoureuse !
http://fibromaman.blogspot.fr/2013/07/pierre-jourde-paradis-noirs.html
Lien : http://fibromaman.blogspot.f..
Il aura suffi d'une silhouette aperçue sur le quai d'une gare pour le narrateur replonge dans ses souvenirs d'adolescence puis d'enfance. Lui qui croyait enterré toutes ces images, ces années de collège passées dans internat dirigé par des frères refont surface. Devenu un écrivain reconnu, il rend visite à Boris un de ses amis de l'internat. Boris marié, père de famille, l'image respectable tout comme lui, loin de ce qu'ils faisaient subir à Serge avec François le dernier membre du trio disparu depuis.
Se cachant derrière l'insouciance, la naïveté de l'enfance, les jeux n'en étaient pas pour autant cruels, honteux. L'humiliation était un trophée, Serge la victime qui ne bronchait pas. Le narrateur cherche à donner une nouvelle lumière sur ces années comme pour les laver. Mais un détail ou une situation resurgissent "et la sensation d’écœurement me prend, un dégoût qui ne vient pas de la nature peu glorieuse de cet épisode, mais de ce je ne peux empêcher qu'il serve à me rendre intéressant". On découvre François le chef de la bande élevé par des vieilles femmes, les plans conçus avec exaltation où le simple fait de savoir que Serge serait rabaissé une fois de plus engendrait un plaisir pervers. Pourquoi Serge acceptait-il son sort? Et cette silhouette est-ce vraiment François?
Pierre Jourde nous conduit sur les chemins de la mémoire fidèle et infidèle, ce qu'on embellit avec les années ou que l'on oublie par commodité. Mémoire qui nous trompe, nous leurre, nous permet de nous blanchir mais qui quand elle s'éveille révèle des actes et des pensées qu'on a préféré mettre dans un recoin comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais le passé est bien réel et François, Serge le martyr apparaissent différemment.
Juxtaposant réalité et l'imaginatif développé par le poids des souvenirs et de la culpabilité, la question lancinante de l'innocence et des jeux cruels portent ce récit où la noirceur et la tristesse côtoient le sublime. Trois vers de Baudelaire La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs qui martèlent le récit trouvent tout leur sens dans les dernières pages.
Le paradis noirs de l'enfance où le duo souffrance/joie mettent l'âme humaine à nue. Un livré coup de cœur électrochoc par l'histoire et par cette écriture dont je suis tombée amoureuse !
http://fibromaman.blogspot.fr/2013/07/pierre-jourde-paradis-noirs.html
Lien : http://fibromaman.blogspot.f..
« Je m’apprête à publier du vécu (Le Voyage du canapé-lit, en janvier) mais je suis travaillé par l’envie de revenir à la veine du roman légèrement bizarre que j’ai longtemps creusée : Festins secrets, Paradis noirs, Le Maréchal absolu ou L’Heure et l’ombre. »
Trois des quatre romans évoqués par Pierre Jourde dans cette citation m’ont toujours fait l’effet d’appartenir à une même famille très particulière de l’étrange. Ce sont trois livres où les frontières entre réel et rêve, souvenir et réalité, réalisme et fantastique se brouillent, trois romans qui cultivent une impression d’irréalité et une atmosphère d’ombre et d’illusion qui les rapproche à mes yeux d’un certain symbolisme belge. Comme les tableaux de Spilliaert ou Degouve de Nuncques, Paradis noirs, Festins secrets et L’Heure et l’ombre plongent le lecteur dans une torpeur cotonneuse où les ombres et la brume semblent cacher des arrière-mondes. Ces ouvrages composent à mes yeux une fratrie spectrale, unie par des ressemblances et des obsessions communes, liée par des jeux de miroirs et un entrelacs de mots et d’images. [...]
Lien : http://cdilpantoine.blogspot..
Trois des quatre romans évoqués par Pierre Jourde dans cette citation m’ont toujours fait l’effet d’appartenir à une même famille très particulière de l’étrange. Ce sont trois livres où les frontières entre réel et rêve, souvenir et réalité, réalisme et fantastique se brouillent, trois romans qui cultivent une impression d’irréalité et une atmosphère d’ombre et d’illusion qui les rapproche à mes yeux d’un certain symbolisme belge. Comme les tableaux de Spilliaert ou Degouve de Nuncques, Paradis noirs, Festins secrets et L’Heure et l’ombre plongent le lecteur dans une torpeur cotonneuse où les ombres et la brume semblent cacher des arrière-mondes. Ces ouvrages composent à mes yeux une fratrie spectrale, unie par des ressemblances et des obsessions communes, liée par des jeux de miroirs et un entrelacs de mots et d’images. [...]
Lien : http://cdilpantoine.blogspot..
Paradis noir (pas radis noirs...)
Rien ne peut empêcher ici qu’on trouve la forme trop dominante du fond.
Sans réels chapitres, ce texte brillant et noueux s’articule autour de la répétition de trois vers de Baudelaire tirés des fleurs du mal (« la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse , Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs » en superpositions d’anacoluthes et de tropes compliqués chers au poète halluciné).
Il narre les rencontres réelles ou imaginaires, à étapes de vingt ans, avec François un ami de collège qui partage avec lui un secret qui semble très lourd même s’il s’avère être celui d’une très mauvaise plaisanterie. On n’en saura pas plus sur ce sujet qui se termine en ellipse.
François a été élevé et a vécu au milieu de vieilles femmes ; abandonné par sa mère il passe sa jeunesse dans la noble pauvreté (pas la misère) de l’Auvergne profonde, parmi les fragrances et les odeurs du terroir.
Le narrateur lui, très soucieux de lui et de sa conscience culpabilisante, s’abandonne volontiers aux plaisirs sulfureux de trouver à tout une explication rassurante et poétique. Un intellectuel dans toute sa « vérité » affectée.
Les positions radicales et disons fascisantes prises par François trouvent, elles aussi une justification dans l’ambition qu’aurait François a n’envisager sa vie que sous la forme d’ « une » éternité. Ce sophisme est glissant, même si l’argumentaire peut sembler convaincant.
Lorsque le souvenir de François s’efface, ne restent que les vers de Baudelaire que Pierre Jourde met dans sa poche avec son mouchoir plein de larmes amères, par-dessus.
Est-ce tout que ce regard amoureux dont on ne pressent que le souvenir d’un battement de cœur ?
Un peu d'humour aiderait.
Rien ne peut empêcher ici qu’on trouve la forme trop dominante du fond.
Sans réels chapitres, ce texte brillant et noueux s’articule autour de la répétition de trois vers de Baudelaire tirés des fleurs du mal (« la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse , Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs » en superpositions d’anacoluthes et de tropes compliqués chers au poète halluciné).
Il narre les rencontres réelles ou imaginaires, à étapes de vingt ans, avec François un ami de collège qui partage avec lui un secret qui semble très lourd même s’il s’avère être celui d’une très mauvaise plaisanterie. On n’en saura pas plus sur ce sujet qui se termine en ellipse.
François a été élevé et a vécu au milieu de vieilles femmes ; abandonné par sa mère il passe sa jeunesse dans la noble pauvreté (pas la misère) de l’Auvergne profonde, parmi les fragrances et les odeurs du terroir.
Le narrateur lui, très soucieux de lui et de sa conscience culpabilisante, s’abandonne volontiers aux plaisirs sulfureux de trouver à tout une explication rassurante et poétique. Un intellectuel dans toute sa « vérité » affectée.
Les positions radicales et disons fascisantes prises par François trouvent, elles aussi une justification dans l’ambition qu’aurait François a n’envisager sa vie que sous la forme d’ « une » éternité. Ce sophisme est glissant, même si l’argumentaire peut sembler convaincant.
Lorsque le souvenir de François s’efface, ne restent que les vers de Baudelaire que Pierre Jourde met dans sa poche avec son mouchoir plein de larmes amères, par-dessus.
Est-ce tout que ce regard amoureux dont on ne pressent que le souvenir d’un battement de cœur ?
Un peu d'humour aiderait.
Noirs, en effet, ces paradis- mais sont-ce encore des paradis ?
En tout cas, ce n'est pas le sens que j'accorde à ce substantif. Les paradis de Pierre Jourde sont peuplés de souvenjirs torturés, de culpabilités inguérissables...
Tout est noir dans ce roman, mais d'une noirceur magnifiquement écrite...
ISBN : 9782070459575
Si vous n'avez jamais entendu parler de Pierre Jourde, si, plus encore, vous n'avez jamais lu aucun de ses textes, "Paradis Noirs" risque de vous poser problème. Bien qu'il n'atteigne pas, en format poche, les trois-cents pages, bien qu'il fasse intervenir un nombre relativement réduit de personnages, bien qu'une identique sobriété s'observe quant à la toile de fond - l'Auvergne, entre le Passé et le Présent, et en particulier Clermont-Ferrand - ce livre est d'une complexité rare. J'irai même plus loin : à côté de "Paradis Noirs", "Festins Secrets", à la construction pourtant si particulière, littéralement hanté par la nuit et les brumes, fait presque figure de roman clair et ensoleillé qui pose d'emblée et sans aucun complexe les questions que l'auteur voulait aborder.
Dans "Paradis Noirs" au contraire, le lecteur met un peu (beaucoup ? trop ?) de temps à définir les thèmes centraux. La cruauté bien sûr, tout spécialement la cruauté enfantine, se détache sans trop difficultés au premier plan mais n'est-ce pas l'arbre destiné à nous cacher une forêt bien plus profonde, bien plus ambiguë ? ... Le héros - ou l'anti-héros - du roman, François, qui obsède le narrateur au point que celui-ci finit par le voir apparaître régulièrement à ses côtés (mort ? vivant ? est-il si intéressant de le savoir, au fond ?) et à se lancer avec lui dans de longues conversations, va au-delà de la cruauté. En fait, sauf erreur de ma part (c'est un livre difficile, je le répète et une relecture s'imposera un jour ou l'autre ), la cruauté qu'il sème autour de lui lui permet à François de ne plus souffrir. Cela va bien au-delà d'un Bien et d'un Mal qu'il relativise avec autant de facilité qu'il laisse monter en lui la rage, et n'est pas sans évoquer, dans cette atmosphère dominée par l'enfance catho à mort des protagonistes, la très polémique question du nirvana oriental : atteindre le nirvana, cet état où il nous devient impossible de ressentir la moindre souffrance parce que nous avons réussi à nous détacher de tout ce qui faisait notre vie, y compris et avant tout nos plaisirs. Pas forcément les grandes jouissances mais aussi les petits riens sur lesquels nous nous bâtissons et qui nous permettent d'avancer. Seul problème : atteindre le nirvana implique de ne plus percevoir la souffrance d'autrui. La légende de la déesse Kuan Yin qui, sur le point d'ccéder au nirvana, le refusa pour continuer à percevoir les souffrances de ses frères humains et les soutenir sur leur dur chemin terrestre, résume l'ambiguïté terrible de cet adieu sans retour à la souffrance au prix de la compassion.
L'enfance de François est comme la nôtre, remplie de petits riens. Des petits riens qu'il aimait et même qu'il vénérait, en dépit de leurs imperfections. Plus ou moins abandonné par sa mère, il est élevé par l'aïeule (c'est cette femme, servante toute sa vie, qui permet à Jourde de ponctuer son texte de la répétition lancinante de trois des vers les plus fameux de Baudelaire) qui l'aime comme son enfant. Le samedi et le dimanche - disait-on le "week-end" en ces temps si lointains ? - il allait chez ses deux grands tantes, l'une complètement sourde, l'autre toujours en train de rire, de chantonner, de faire gâteaux et crêpes pour les enfants du quartier. C'était modeste, le confort que nous avons appris à appeler moderne, manquait çà et là - surtout chez l'aïeule - mais il faisait bon, il faisait chaud : François était un enfant quasi normal, faisant face pour la première fois à la cruauté lorsque, sans raison, il tue un jour le vieux crapaud qui rendait de si grands services à l'aïeule.
Mais la cruauté fait partie de nous. Nous le savons tous. Et nous apprenons à la domestiquer, à la maîtriser, à la refouler.
Ou nous n'apprenons pas. Surtout si la cruauté nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir plus, et puis de ne plus nous sentir du tout.
Mais il en va de la cruauté comme de toutes les drogues : elle détruit celui ou celle qui se livre à elle. Elle a, sans aucun doute possible, détruit François, adolescent brillant et même étincelant. Pire, elle a peuplé sa vie et son univers mental de regrets éternels. Celles, ceux qu'il a trahis - l'aïeule la toute première - sont devenus les compagnons, muets et pleins de reproches, de cette route qu'il s'est choisie parce que, au début, il pensait n'y trouver que ce qu'on pourrait nommer son "confort", une route dont, dans la seconde moitié du récit, le narrateur nous donne l'impression qu'elle n'est qu'une boucle enténébrée, qui répète sans cesse ses méandres et ses spirales comme, jadis, se déroulaient sans répit pour l'imagination des élèves, les couloirs, les angles perdus, toute cette architecture occulte du collège Saint-Barthélémy. Le collège où ils ont "tué" Serge, qui voulait tant être de leurs amis - Serge, dont on saura à la fin du livre que François avait une raison secrète de le haïr, ce qui le fait, en somme trahir aussi la cruauté puisque, dans ce cas-là au moins, elle cesse d'être gratuite - le collège où leur trio - Boris, François, le narrateur - est né, le collège qui porte le nom d'un martyre qui fut écorché vif.
Sous la plume de son "narrateur" - dont j'ai parfois eu l'impression troublante qu'il était un peu le "double" de François, comme un Dr Jekyll qui aurait finalement vaincu Mr Hyde, ou alors qu'il parlait carrément à une hallucination peut-être née des exigences de son métier puisqu'il est ... écrivain - "Paradis Noirs" oscille, avec une détermination redoutable, entre le passé, les grandes interrogations majeures mais ici traitées à la Jourde, si l'on veut bien me permettre cette expression, sur le Bien et le Mal dont nous sommes tous constitués, un présent qui ne fait vraiment que de très brèves (et très cartésiennes) apparitions, et à nouveau, le passé, le tout barbotant avec des difficultés sans nom dans une cruauté sourde ou calculée, une noirceur systématique, quelques éclairs fulgurants de bonté et de compassion pures, parmi des silhouettes plus fantomatiques les unes que les autres et les brumes qui les escamotent (la dernière fois que le rencontre le narrateur, dans une forêt vide, sur une route vide, François est là et puis, d'un seul coup, il n'est plus là : on ne le voit pas disparaître, il n'est plus là, c'est tout ), bref, dans une ambiance pesante, obsessionnelle, avec, pour faire bonne mesure, les remarques d'un narrateur qui, avançant en âge, se demande parfois non sans naïveté s'il se rappelle bien ...
"Paradis Noirs" est un livre auquel on s'accroche comme à un wagon fou, lui-même traîné par une locomotive monstrueuse, vers une direction dont on ne sait rien. On ne sait même plus comment diable on a pu prendre ce foutu train ... Et quand on débarque au terminus, il n'y a personne pour vous attendre. Et le plus étrange, c'est que vous voyez la locomotive et ses wagons déments trembloter dans l'air souterrain et puis, d'un seul coup, il n'y a plus rien.
Enfin si, il vous reste vos questions. Selon votre nature, acquise ou innée, d'omnilecteur ou de lecteur, disons, plus classique, vous en ressentirez de l'excitation ou de la frustration. Cela si vous ne décrochez pas en route. Il y en aura certainement pour le faire : ils ne s'apercevront pas que, en fait, c'est le wagon déjanté lui-même qui les a éjectés dans un tournant bien dangereux. Et cela vaut mieux : car ce wagon l'aura fait avec cette cruauté tout à la fois froide et pleine de rage qui est la marque du personnage principal.
Si vous n'avez jamais entendu parler de Pierre Jourde, si, plus encore, vous n'avez jamais lu aucun de ses textes, "Paradis Noirs" risque de vous poser problème. Bien qu'il n'atteigne pas, en format poche, les trois-cents pages, bien qu'il fasse intervenir un nombre relativement réduit de personnages, bien qu'une identique sobriété s'observe quant à la toile de fond - l'Auvergne, entre le Passé et le Présent, et en particulier Clermont-Ferrand - ce livre est d'une complexité rare. J'irai même plus loin : à côté de "Paradis Noirs", "Festins Secrets", à la construction pourtant si particulière, littéralement hanté par la nuit et les brumes, fait presque figure de roman clair et ensoleillé qui pose d'emblée et sans aucun complexe les questions que l'auteur voulait aborder.
Dans "Paradis Noirs" au contraire, le lecteur met un peu (beaucoup ? trop ?) de temps à définir les thèmes centraux. La cruauté bien sûr, tout spécialement la cruauté enfantine, se détache sans trop difficultés au premier plan mais n'est-ce pas l'arbre destiné à nous cacher une forêt bien plus profonde, bien plus ambiguë ? ... Le héros - ou l'anti-héros - du roman, François, qui obsède le narrateur au point que celui-ci finit par le voir apparaître régulièrement à ses côtés (mort ? vivant ? est-il si intéressant de le savoir, au fond ?) et à se lancer avec lui dans de longues conversations, va au-delà de la cruauté. En fait, sauf erreur de ma part (c'est un livre difficile, je le répète et une relecture s'imposera un jour ou l'autre ), la cruauté qu'il sème autour de lui lui permet à François de ne plus souffrir. Cela va bien au-delà d'un Bien et d'un Mal qu'il relativise avec autant de facilité qu'il laisse monter en lui la rage, et n'est pas sans évoquer, dans cette atmosphère dominée par l'enfance catho à mort des protagonistes, la très polémique question du nirvana oriental : atteindre le nirvana, cet état où il nous devient impossible de ressentir la moindre souffrance parce que nous avons réussi à nous détacher de tout ce qui faisait notre vie, y compris et avant tout nos plaisirs. Pas forcément les grandes jouissances mais aussi les petits riens sur lesquels nous nous bâtissons et qui nous permettent d'avancer. Seul problème : atteindre le nirvana implique de ne plus percevoir la souffrance d'autrui. La légende de la déesse Kuan Yin qui, sur le point d'ccéder au nirvana, le refusa pour continuer à percevoir les souffrances de ses frères humains et les soutenir sur leur dur chemin terrestre, résume l'ambiguïté terrible de cet adieu sans retour à la souffrance au prix de la compassion.
L'enfance de François est comme la nôtre, remplie de petits riens. Des petits riens qu'il aimait et même qu'il vénérait, en dépit de leurs imperfections. Plus ou moins abandonné par sa mère, il est élevé par l'aïeule (c'est cette femme, servante toute sa vie, qui permet à Jourde de ponctuer son texte de la répétition lancinante de trois des vers les plus fameux de Baudelaire) qui l'aime comme son enfant. Le samedi et le dimanche - disait-on le "week-end" en ces temps si lointains ? - il allait chez ses deux grands tantes, l'une complètement sourde, l'autre toujours en train de rire, de chantonner, de faire gâteaux et crêpes pour les enfants du quartier. C'était modeste, le confort que nous avons appris à appeler moderne, manquait çà et là - surtout chez l'aïeule - mais il faisait bon, il faisait chaud : François était un enfant quasi normal, faisant face pour la première fois à la cruauté lorsque, sans raison, il tue un jour le vieux crapaud qui rendait de si grands services à l'aïeule.
Mais la cruauté fait partie de nous. Nous le savons tous. Et nous apprenons à la domestiquer, à la maîtriser, à la refouler.
Ou nous n'apprenons pas. Surtout si la cruauté nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir plus, et puis de ne plus nous sentir du tout.
Mais il en va de la cruauté comme de toutes les drogues : elle détruit celui ou celle qui se livre à elle. Elle a, sans aucun doute possible, détruit François, adolescent brillant et même étincelant. Pire, elle a peuplé sa vie et son univers mental de regrets éternels. Celles, ceux qu'il a trahis - l'aïeule la toute première - sont devenus les compagnons, muets et pleins de reproches, de cette route qu'il s'est choisie parce que, au début, il pensait n'y trouver que ce qu'on pourrait nommer son "confort", une route dont, dans la seconde moitié du récit, le narrateur nous donne l'impression qu'elle n'est qu'une boucle enténébrée, qui répète sans cesse ses méandres et ses spirales comme, jadis, se déroulaient sans répit pour l'imagination des élèves, les couloirs, les angles perdus, toute cette architecture occulte du collège Saint-Barthélémy. Le collège où ils ont "tué" Serge, qui voulait tant être de leurs amis - Serge, dont on saura à la fin du livre que François avait une raison secrète de le haïr, ce qui le fait, en somme trahir aussi la cruauté puisque, dans ce cas-là au moins, elle cesse d'être gratuite - le collège où leur trio - Boris, François, le narrateur - est né, le collège qui porte le nom d'un martyre qui fut écorché vif.
Sous la plume de son "narrateur" - dont j'ai parfois eu l'impression troublante qu'il était un peu le "double" de François, comme un Dr Jekyll qui aurait finalement vaincu Mr Hyde, ou alors qu'il parlait carrément à une hallucination peut-être née des exigences de son métier puisqu'il est ... écrivain - "Paradis Noirs" oscille, avec une détermination redoutable, entre le passé, les grandes interrogations majeures mais ici traitées à la Jourde, si l'on veut bien me permettre cette expression, sur le Bien et le Mal dont nous sommes tous constitués, un présent qui ne fait vraiment que de très brèves (et très cartésiennes) apparitions, et à nouveau, le passé, le tout barbotant avec des difficultés sans nom dans une cruauté sourde ou calculée, une noirceur systématique, quelques éclairs fulgurants de bonté et de compassion pures, parmi des silhouettes plus fantomatiques les unes que les autres et les brumes qui les escamotent (la dernière fois que le rencontre le narrateur, dans une forêt vide, sur une route vide, François est là et puis, d'un seul coup, il n'est plus là : on ne le voit pas disparaître, il n'est plus là, c'est tout ), bref, dans une ambiance pesante, obsessionnelle, avec, pour faire bonne mesure, les remarques d'un narrateur qui, avançant en âge, se demande parfois non sans naïveté s'il se rappelle bien ...
"Paradis Noirs" est un livre auquel on s'accroche comme à un wagon fou, lui-même traîné par une locomotive monstrueuse, vers une direction dont on ne sait rien. On ne sait même plus comment diable on a pu prendre ce foutu train ... Et quand on débarque au terminus, il n'y a personne pour vous attendre. Et le plus étrange, c'est que vous voyez la locomotive et ses wagons déments trembloter dans l'air souterrain et puis, d'un seul coup, il n'y a plus rien.
Enfin si, il vous reste vos questions. Selon votre nature, acquise ou innée, d'omnilecteur ou de lecteur, disons, plus classique, vous en ressentirez de l'excitation ou de la frustration. Cela si vous ne décrochez pas en route. Il y en aura certainement pour le faire : ils ne s'apercevront pas que, en fait, c'est le wagon déjanté lui-même qui les a éjectés dans un tournant bien dangereux. Et cela vaut mieux : car ce wagon l'aura fait avec cette cruauté tout à la fois froide et pleine de rage qui est la marque du personnage principal.
Bernard et son fils sont en route pour aller assister aux obsèques d'une très jeune fille décédée dans son village natal, loin, au bout du bout du bout d'une route étroite et sinueuse dans le Cantal, dont on ne repart qu'en faisant demi-tour. Plus de la moitié du livre est consacré au trajet en voiture et aux souvenirs que le paysage convoque chez l'auteur. C'est dense, touffus, foisonnant et peu compréhensible pour le lecteur. On dirait presque une posture, un parti pris mais pourquoi ? Pourquoi ce langage hermétique ? Pour avoir l'air de dire quelque chose là où il n'y a rien à dire ?
Vient ensuite une courte partie consacrée aux retrouvailles avec la famille de là-haut, entre silences et pudeurs puis les obsèques qui sont narrés de l'extérieur, en quelques lignes à peine. Vient ensuite le départ, le retour vers la ville où l'auteur a fait sa vie.
J'avais eu du mal à lire Pays perdu de Pierre Jourde, lui aussi peu compréhensible, bouillonnant de mots et de gestes dont le sens m'avait échappé et auquel ce Pays éperdu répond, plus soft, plus mesuré, encore plus soporifique. Sans doute ne suis-je pas réceptive à la manière dont toute cette nostalgie est transmise ?
Quel dommage que l'action se situe dans le Cantal, un chouette département qui mérite mieux !
Vient ensuite une courte partie consacrée aux retrouvailles avec la famille de là-haut, entre silences et pudeurs puis les obsèques qui sont narrés de l'extérieur, en quelques lignes à peine. Vient ensuite le départ, le retour vers la ville où l'auteur a fait sa vie.
J'avais eu du mal à lire Pays perdu de Pierre Jourde, lui aussi peu compréhensible, bouillonnant de mots et de gestes dont le sens m'avait échappé et auquel ce Pays éperdu répond, plus soft, plus mesuré, encore plus soporifique. Sans doute ne suis-je pas réceptive à la manière dont toute cette nostalgie est transmise ?
Quel dommage que l'action se situe dans le Cantal, un chouette département qui mérite mieux !
On découvre un univers qu'on croyait perdu à jamais à travers des descriptions effrayantes et d'une grande poésie.L'écriture est magnifique , et le livre se lit d'un trait .Le narrateur a pour la région de ses origines un grand amour mêlé de dégoût et de nostalgie . Le livre édité en 2003 et a valu à son auteur bien des déboires et on a envie de lire " la suite " , " La première pierre " qui vient de paraitre pour la rentrée littéraire 2013!
Récemment, j'ai adopté une nouvelle règle de lecture : lorsque j'arrive à la moitié d'un bouquin, si je n'ai toujours pas accroché, j'abandonne. Il y a trop de livres à lire et pas assez de temps dans une vie pour perdre du temps à lire des livre qu'on n'aime pas. Et puis, un auteur qui ne sait pas accrocher le lecteur avant la moitié du livre, ne vaut pas la peine d'être lu.
Et bien une fois arrivé à la moitié de Pays Perdu, je ne pouvais plus supporter une seule description d'un habitant de ce village. Vu que j'ai cessé ma lecture au milieu de cet ouvrage, je fais appel à vous, qui avez lu ce livre : pouvez-vous me spoiler ? Pouvez-vous me confirmer que la deuxième moitié du livre est aussi barbante que la première ? S'agit-il, jusqu'au bout, d'une trainée incessante de descriptions aussi vides de sens les unes que les autres, et qui n'ont absolument aucun lien entre elles ?
En tout cas, certains auteurs ne se foulent pas à trouver une intrigue digne de ce nom. Ils se contentent de belles figures de style et hop, ils trouvent un éditeur ! J'en ai presque envie de pleurer pour les écrivains talentueux qui désespèrent.
Et bien une fois arrivé à la moitié de Pays Perdu, je ne pouvais plus supporter une seule description d'un habitant de ce village. Vu que j'ai cessé ma lecture au milieu de cet ouvrage, je fais appel à vous, qui avez lu ce livre : pouvez-vous me spoiler ? Pouvez-vous me confirmer que la deuxième moitié du livre est aussi barbante que la première ? S'agit-il, jusqu'au bout, d'une trainée incessante de descriptions aussi vides de sens les unes que les autres, et qui n'ont absolument aucun lien entre elles ?
En tout cas, certains auteurs ne se foulent pas à trouver une intrigue digne de ce nom. Ils se contentent de belles figures de style et hop, ils trouvent un éditeur ! J'en ai presque envie de pleurer pour les écrivains talentueux qui désespèrent.
Ce livre avait provoqué l'ire des habitants s'étant reconnus dans les portraits féroces de villageois alcoolisés sculptés par l'auteur à coup de serpe vitriolée. Ces autochtones offensés avaient attaqué l'écrivain et sa famille alors qu'il venait passer des vacances dans le village, dans sa maison familiale.
Ce fait divers consternant avait d'ailleurs fait l'objet de commentaires dans la presse nationale et locale lors du procès des agresseurs au tribunal d'Aurillac
Le texte (s'agit-il vraiment d'un roman ?) est vraiment très bien écrit. Il est vrai que l'écrivain ne ménage pas ses modèles, ne voyant chez les êtres qu'il évoque, que les mutilations causées par les outils de travail, la boisson, les animaux. Ce côté glauque, impitoyable, est d'ailleurs un peu trop systématique chez cet auteur, que ce soit dans sa fiction (voir Festin secrets), ou dans son oeuvre critique (la littérature sans estomac) Mais en même temps, comment ne pas voir, au-delà de ces portraits cruels de personnages dévastés par la vie, l'humanité, certes frêle et chancelante, qui émane de ces portraits. J'y vois pour ma part sourdre, au coeur même de l'écriture impitoyable, une profonde empathie envers ce pays (le plateau du Cezalier), abandonné en marge de l'autoroute pas si lointaine, envers les gens qui persistent à vivre et à exister aux marges d'un monde en pleine mutation.
Il est curieux que ce livre rejoigne, dans ses thèmes et son écriture, sa vision d'un monde rural en train de sombrer (ayant déjà largement disparu dans les trente glorieuses), trois autres écrivains du centre de la France : Millet, Michon et Bergougnoux.
Cela me parait confirmer qu'une littérature puisant son inspiration dans le terroir du massif central (ou d'autres terroirs d'ailleurs) - qui n'est pas "régionaliste" et qui est bien plus intéressante que celle de l'école dite "de Brive" - est possible, existe bel et bien.
Tant mieux si de nouveaux Giono peuvent renouveler le genre et sortir un peu la littérature française de l'ornière introspective parisienne dans laquelle elle a parfois tendance à s'enliser.
La France existe aussi au-delà du périphérique, et la littérature doit en rendre compte, à sa manière.
Lien : http://jcfvc.over-blog.com
Ce fait divers consternant avait d'ailleurs fait l'objet de commentaires dans la presse nationale et locale lors du procès des agresseurs au tribunal d'Aurillac
Le texte (s'agit-il vraiment d'un roman ?) est vraiment très bien écrit. Il est vrai que l'écrivain ne ménage pas ses modèles, ne voyant chez les êtres qu'il évoque, que les mutilations causées par les outils de travail, la boisson, les animaux. Ce côté glauque, impitoyable, est d'ailleurs un peu trop systématique chez cet auteur, que ce soit dans sa fiction (voir Festin secrets), ou dans son oeuvre critique (la littérature sans estomac) Mais en même temps, comment ne pas voir, au-delà de ces portraits cruels de personnages dévastés par la vie, l'humanité, certes frêle et chancelante, qui émane de ces portraits. J'y vois pour ma part sourdre, au coeur même de l'écriture impitoyable, une profonde empathie envers ce pays (le plateau du Cezalier), abandonné en marge de l'autoroute pas si lointaine, envers les gens qui persistent à vivre et à exister aux marges d'un monde en pleine mutation.
Il est curieux que ce livre rejoigne, dans ses thèmes et son écriture, sa vision d'un monde rural en train de sombrer (ayant déjà largement disparu dans les trente glorieuses), trois autres écrivains du centre de la France : Millet, Michon et Bergougnoux.
Cela me parait confirmer qu'une littérature puisant son inspiration dans le terroir du massif central (ou d'autres terroirs d'ailleurs) - qui n'est pas "régionaliste" et qui est bien plus intéressante que celle de l'école dite "de Brive" - est possible, existe bel et bien.
Tant mieux si de nouveaux Giono peuvent renouveler le genre et sortir un peu la littérature française de l'ornière introspective parisienne dans laquelle elle a parfois tendance à s'enliser.
La France existe aussi au-delà du périphérique, et la littérature doit en rendre compte, à sa manière.
Lien : http://jcfvc.over-blog.com
Je connais Pierre Jourde par son blog sur le site de l'Obs (http://pierre-jourde.blogs.nouvelobs.com/), et je sais par ailleurs qu'il est (ou fut) associé à Eric Naulleau, qui n'est (ou ne fut) pas que le complice de talk-show d’Éric Zemmour, mais aussi le premier éditeur (à peu de choses près) d'Olivier Maulin, ce qui est plus reluisant. Cet écheveau de circonstances fit que j'avais envie de le lire (Pierre Jourde). Je truffai donc ma liste de souhaits de toutes les références disponibles en français dans le réseau Bookcrossing, et quelqu'un m'envoya fort aimablement ce livre, lu dans la foulée.
Au début ça ne m'a pas plu, pas du tout. De la prose de professionnel urbain de l'intellect essayant de donner un sens à des circonstances de retour dans le village reculé d'origine de son père et de ses vacances d'enfant. Outre cette posture déjà un peu éculée, des phrases aussi longues que vides, du pur cérébral, aucun ressenti, aucune sincérité. J'étais sur le point d'abandonner cette lecture (chose bien rare chez moi), et simultanément, quelque chose bascula, tout doucement mais sans véritable retour en arrière. Comme si le narrateur, comme le voyageur, avait eu besoin d'un temps pour se familiariser à nouveau avec cette terre (ce matériau littéraire) revêche, raidi, dont l'intérêt ne se montre pas en un tournemain. Mais peu à peu, on y arriva, à cette impression que Pierre Jourde avait trouvé le chemin vers ce qu'il voulait dire, et probablement vers ses souvenirs et ses sensations, ce qu'il en conservait, ce que cela pouvait susciter dans son imaginaire volontiers baigné de fantastique. L'intérêt du livre remonte en flèche alors, et s'il reste parfois inégal, ce n'est peut-être qu'au gré du paysage, tant physique que mental, qu'il parcourt avec nous : les reliefs et leurs trous d'ombres plus ou moins ragoûtantes, alcoolisme, mutilations, merde, mort, et dans le meilleur des cas, folie.
Ce livre valut certains ennuis à son auteur : les habitants de sa région d'origine crurent s'y reconnaître un peu trop précisément, et finirent par l'accueillir, un jour qu'il arrivait là en vacances, à coups de pierres jetées vers lui et sa famille. A la lecture du livre, on comprend leur colère (les pierres, par contre, étaient de trop. Une saine discussion aurait mieux fait l'affaire). Pour moi, je ne peux que reconnaître ce que Pierre Jourde peint de cette campagne reculée et familiale : faussement belle, cruelle, possessive, profondément aliénante, et qu'on ne peut pourtant que désirer et retrouver toujours.
Au début ça ne m'a pas plu, pas du tout. De la prose de professionnel urbain de l'intellect essayant de donner un sens à des circonstances de retour dans le village reculé d'origine de son père et de ses vacances d'enfant. Outre cette posture déjà un peu éculée, des phrases aussi longues que vides, du pur cérébral, aucun ressenti, aucune sincérité. J'étais sur le point d'abandonner cette lecture (chose bien rare chez moi), et simultanément, quelque chose bascula, tout doucement mais sans véritable retour en arrière. Comme si le narrateur, comme le voyageur, avait eu besoin d'un temps pour se familiariser à nouveau avec cette terre (ce matériau littéraire) revêche, raidi, dont l'intérêt ne se montre pas en un tournemain. Mais peu à peu, on y arriva, à cette impression que Pierre Jourde avait trouvé le chemin vers ce qu'il voulait dire, et probablement vers ses souvenirs et ses sensations, ce qu'il en conservait, ce que cela pouvait susciter dans son imaginaire volontiers baigné de fantastique. L'intérêt du livre remonte en flèche alors, et s'il reste parfois inégal, ce n'est peut-être qu'au gré du paysage, tant physique que mental, qu'il parcourt avec nous : les reliefs et leurs trous d'ombres plus ou moins ragoûtantes, alcoolisme, mutilations, merde, mort, et dans le meilleur des cas, folie.
Ce livre valut certains ennuis à son auteur : les habitants de sa région d'origine crurent s'y reconnaître un peu trop précisément, et finirent par l'accueillir, un jour qu'il arrivait là en vacances, à coups de pierres jetées vers lui et sa famille. A la lecture du livre, on comprend leur colère (les pierres, par contre, étaient de trop. Une saine discussion aurait mieux fait l'affaire). Pour moi, je ne peux que reconnaître ce que Pierre Jourde peint de cette campagne reculée et familiale : faussement belle, cruelle, possessive, profondément aliénante, et qu'on ne peut pourtant que désirer et retrouver toujours.
Arriver à L., petit village du nord Cantal, ça se mérite. Et encore quand il n'y a pas trop de neige. Préférer la belle saison, quoi.
Mais la neige, quand même...
"Je me souviens du bonheur de ces reliefs effacés, enveloppés dans une substance égale, éblouissante, engourdissant les sensations, avalant même les sons. Plus de prés, de bosquets, de haies, de murs ,de chemins, d'herbe, de taupinières, une continuité douce, des ondulations moelleuses laissant seulement la trace des choses qu'on s'étonnait presque d'avoir connues sous une forme moins parfaite. Moins encore que des traces, une allusion, une esquisse de courbe, rien. D'invraisemblables vagues soulevées par le vent, au bord de l'effondrement, et demeurant comme des rouleaux mécaniques figés dans un temps suspendu. Des éclats de paillettes que la lumière allume, éteint, ranime ailleurs.Et parfois, sous la couche régulière, par une déchirure, comme un rappel , le souvenir d'un monde ancien aboli, un aperçu sur des profondeurs noires et pleines de formes enchevêtrées. Si la neige, à nouveau, pouvait tout envelopper, effacer les reliefs et les chagrins, taire les mots."
Pour régler une affaire de famille, le narrateur (Jourde) et son frère se rendent dans le petit village d'où est originaire leur père, apprenant à leur arrivée le décès d'une jeune fille du village. Les obsèques auront lieu le lendemain. Défilé des voisins et de la famille, des habitants des villages environnants dans la maison des parents, occasion de portraiturer ces figures hautes en couleur ou exemplaires. Jourde ne fait pas dans la dentelle, et quelques pages d'anthologie sont consacrées aux bouses de vache...(j'adore, car en plus c'est du vécu et je confirme la ténacité et l'ambivalence de la chose. En revanche j'ai eu du mal avec les descriptions de crasse chez certains...)
Je ne suis pas originaire de ce coin là, mais ma foi, le monde paysan à l'ancienne, que de souvenirs...
"Le vieux célibataire a l'hospitalité cordiale et généreuse. Il sait ce qu'il doit au monde. La simplicité de ses manières, simplicité dont il se réclame en vous forçant à boire un autre plein verre et à accepter un fromage ou une douzaine d'oeufs, n'est que l'apparence conventionnelle d'un attachement intégriste aux rituels complexes de la civilité paysanne. La conversation se tient assis sur des bancs, de part et d'autre de la table. Le verre rempli à ras bords doit durer. Son contenu marque le développement de la première phase, son remplissage permettra une relance. La conversation avec le vieux cousin n'implique pas nécessairement un langage verbal. Son fonds principal se constitue de grommellements dispersés, d'onomatopées entre lesquels on laisse s'installer un silence de bon aloi.
Là-dessus, quelques remarques à propos du temps, des récoltes, de la famille viennent se détacher en guise de fioritures décoratives. Un attrape-mouche doré pend dans le creux profond de la fenêtre, tortillé comme un ornement baroque dans une église. La lumière avaricieuse ne se dépense qu'à l'éclairer, le prenant pour un luxe, et nos laisse dans la pénombre. Sur la spirale glorieuse s'achèvent de minuscules agonies. D'autres mouches profitent du calme ambiant pour avancer avec soin leur exploration de la toile cirée."
Une unité d'espace (les villages proches) et de temps (deux jours) pour une plongée dans ce monde rural incroyable. L'auteur évoquera aussi son père et le secret de ses origines. Mais là n'est point le sujet, on ne s'attarde pas.
Ce récit/roman n'a pas eu l'heur de plaire aux villageois, qui ont agressé l'auteur lors d'un de ses passages en 2005, des noms d'oiseaux ont fusé, un procès s'en est ensuivi, et le dernier opus de Pierre Jourde, La première pierre, revient sur cette histoire. Il me tarde de le lire!
Lien : http://enlisantenvoyageant.b..
Mais la neige, quand même...
"Je me souviens du bonheur de ces reliefs effacés, enveloppés dans une substance égale, éblouissante, engourdissant les sensations, avalant même les sons. Plus de prés, de bosquets, de haies, de murs ,de chemins, d'herbe, de taupinières, une continuité douce, des ondulations moelleuses laissant seulement la trace des choses qu'on s'étonnait presque d'avoir connues sous une forme moins parfaite. Moins encore que des traces, une allusion, une esquisse de courbe, rien. D'invraisemblables vagues soulevées par le vent, au bord de l'effondrement, et demeurant comme des rouleaux mécaniques figés dans un temps suspendu. Des éclats de paillettes que la lumière allume, éteint, ranime ailleurs.Et parfois, sous la couche régulière, par une déchirure, comme un rappel , le souvenir d'un monde ancien aboli, un aperçu sur des profondeurs noires et pleines de formes enchevêtrées. Si la neige, à nouveau, pouvait tout envelopper, effacer les reliefs et les chagrins, taire les mots."
Pour régler une affaire de famille, le narrateur (Jourde) et son frère se rendent dans le petit village d'où est originaire leur père, apprenant à leur arrivée le décès d'une jeune fille du village. Les obsèques auront lieu le lendemain. Défilé des voisins et de la famille, des habitants des villages environnants dans la maison des parents, occasion de portraiturer ces figures hautes en couleur ou exemplaires. Jourde ne fait pas dans la dentelle, et quelques pages d'anthologie sont consacrées aux bouses de vache...(j'adore, car en plus c'est du vécu et je confirme la ténacité et l'ambivalence de la chose. En revanche j'ai eu du mal avec les descriptions de crasse chez certains...)
Je ne suis pas originaire de ce coin là, mais ma foi, le monde paysan à l'ancienne, que de souvenirs...
"Le vieux célibataire a l'hospitalité cordiale et généreuse. Il sait ce qu'il doit au monde. La simplicité de ses manières, simplicité dont il se réclame en vous forçant à boire un autre plein verre et à accepter un fromage ou une douzaine d'oeufs, n'est que l'apparence conventionnelle d'un attachement intégriste aux rituels complexes de la civilité paysanne. La conversation se tient assis sur des bancs, de part et d'autre de la table. Le verre rempli à ras bords doit durer. Son contenu marque le développement de la première phase, son remplissage permettra une relance. La conversation avec le vieux cousin n'implique pas nécessairement un langage verbal. Son fonds principal se constitue de grommellements dispersés, d'onomatopées entre lesquels on laisse s'installer un silence de bon aloi.
Là-dessus, quelques remarques à propos du temps, des récoltes, de la famille viennent se détacher en guise de fioritures décoratives. Un attrape-mouche doré pend dans le creux profond de la fenêtre, tortillé comme un ornement baroque dans une église. La lumière avaricieuse ne se dépense qu'à l'éclairer, le prenant pour un luxe, et nos laisse dans la pénombre. Sur la spirale glorieuse s'achèvent de minuscules agonies. D'autres mouches profitent du calme ambiant pour avancer avec soin leur exploration de la toile cirée."
Une unité d'espace (les villages proches) et de temps (deux jours) pour une plongée dans ce monde rural incroyable. L'auteur évoquera aussi son père et le secret de ses origines. Mais là n'est point le sujet, on ne s'attarde pas.
Ce récit/roman n'a pas eu l'heur de plaire aux villageois, qui ont agressé l'auteur lors d'un de ses passages en 2005, des noms d'oiseaux ont fusé, un procès s'en est ensuivi, et le dernier opus de Pierre Jourde, La première pierre, revient sur cette histoire. Il me tarde de le lire!
Lien : http://enlisantenvoyageant.b..
Un petit parisien venait en vacances dans le Cantal. Il y a vu des choses, des gens.
Quand, 20 bonnes années plus tard, devenu un magnifique spécimen de parigot, il décide d’écrire ce qui lui reste de souvenirs de cette époque, cela donne ce ramassis d’âneries, diffamatoires pour la plupart, que son grand ami qui ne peut rien lui refuser éditera.
Ces âneries lui vaudront des déboires justifiés sur le fond mais condamnables, d’ailleurs condamnés, sur la forme.
Si vous voulez lire une description fidèle de la vie dans cette contrée, je vous recommande Les derniers indiens de Marie Hélène-Lafon. En plus, elle, elle écrit très bien.
Quand, 20 bonnes années plus tard, devenu un magnifique spécimen de parigot, il décide d’écrire ce qui lui reste de souvenirs de cette époque, cela donne ce ramassis d’âneries, diffamatoires pour la plupart, que son grand ami qui ne peut rien lui refuser éditera.
Ces âneries lui vaudront des déboires justifiés sur le fond mais condamnables, d’ailleurs condamnés, sur la forme.
Si vous voulez lire une description fidèle de la vie dans cette contrée, je vous recommande Les derniers indiens de Marie Hélène-Lafon. En plus, elle, elle écrit très bien.
Je pense que pour la première fois j'ai du mettre 5/5 à un livre. Pour une petite partie par attachement à des situations connues (je suis Cantalou de descendance), mais surtout par le sujet et la langue. Quelle belle écriture...Fluide, idéalement construite, pas lourde et pourtant si riche en vocabulaire. Et puis le sujet....ces paysans perdus dans ces recoins du Cantal, s'accrochant encore à une terre ingrate. Raymond Depardon en a d'ailleurs fait des images qui pourraient idéalement illustrer cet ouvrage au cas où l'imagination du lecteur ne serait pas à la hauteur ou tout simplement pour le cas où il n'aurait pas la joie d'avoir connu ces "derniers Indiens" comme dirait une autre grande écrivaine du cru: Marie-Hélène Laffon.
C'est le premier ouvrage de Pierre Jourde que je lis, avec fascination. Comment ne pas être happé par l'écriture jourdienne, qui épouse si bien les reliefs de la Montagne cantalienne, et les visages ravinés de ses autochtones? Quiconque connaît ce terroir du Centre de la France, cette terre d'oubli entre forêts sombres et villages de basalte noir, ceinturée par l'autoroute, sera sidéré par le travail littéraire, le tableau si expressif de cette solitude du fond des âges, qui échappe cependant au double piège du réalisme et du symbolisme, par un savant et infinitésimal dosage des deux, alchimie particulière réussie grâce au précipité de l'émotion et de l'âme.
Le titre sans doute m'a attirée, dans sa mélancolie et sa brutalité mêlées.
La référence proustienne, cependant inscrite dans le rapport de Jourde à la littérature, est ici balayée d'un revers de main. Ici toute recherche s'arrête, ici commence la rencontre avec un pays perdu depuis toujours, au sens du bled paumé comme à celui de la séparation subjective. Jourde ne risque pas même le mot de retour, puisque cet écrit qui parle tant d'humus, de racines végétales, mais aussi de cloaque et de destruction lente ou accidentelle des corps, résonne quelque peu comme un adieu. Il y a dans ce livre une triple référence à la mort d'un individu: celle du père de l'auteur, à qui semble dédié ce livre, la mort du lointain cousin, qui fait signe aux vivants en lèguant son maigre bien au seul des apparentés qui venait , de loin en loin, lui rendre visite, et celle, cruellement absurde, d'une fillette dont le sourire et la beauté enfantine marquent les souvenirs de l'auteur.
Le livre est construit autour d'un bref voyage afin de règler une improbable succession, et les obsèques d'une enfant, Lucie (lumière…), décédée de leucémie. Ce rituel funèbre, ainsi que la coutume des visites à la défunte sont le champ dans lequel entrent et sortent vivants et morts, ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas rendre ce dernier hommage. La caméra subjective, le regard de Pierre Jourde, nous fait découvrir en plan serré ou en champ-contrechamp toute une humanité isolée du reste de l'humanité, sculptée par le travail, à peine déviée de son cheminement sourd et aveugle au reste du monde par les unions dont certaines sont brèves, et les autres génératrices de coupures familiales définitives.
C'est là que la littérature devient réalité, et c'est là que prit naissance le ressort de la haine et du rejet, manifestée par une forme de lynchage des personnages de Jourde contre lui et contre sa famille, après la parution de Pays perdu..
Sans prendre position sur le fond, sûrement complexe, de l'affaire, sans revenir au débat sur l'auto fiction et ses conséquences, et sans remettre aucunement en cause la qualité littéraire de l'oeuvre ni l'intention de l'auteur,
je partage quelques réflexions, qui resteront sûrement superficielles.
La force et le pouvoir de l'écriture, est aussi, comme le disait magnifiquement Levi- Strauss, ce qui permet l'existence et le maintien d'une forme de domination. Face à ce qu'ils ont reçu comme une intrusion et une insulte, les personnages ripostent, non avec l'usage des mots dont ils n'ont pas la maîtrise, mais avec la violence qu'ils pensent leur être faite. Et ils chassent le traître du pays, obéissant à la même logique que celle qui anime Jourde, en n'en conservant que la versant du rejet. Car la fascination-répulsion de l'auteur pour ses origines a pu être traitée par l'écriture. Mais il n'en va pas de même pour ses personnages, qui n'ont pas sur eux-mêmes un regard transcendé par la littérature et la poésie, pour eux un mot est un mot, et une pierre est une pierre.
Le titre sans doute m'a attirée, dans sa mélancolie et sa brutalité mêlées.
La référence proustienne, cependant inscrite dans le rapport de Jourde à la littérature, est ici balayée d'un revers de main. Ici toute recherche s'arrête, ici commence la rencontre avec un pays perdu depuis toujours, au sens du bled paumé comme à celui de la séparation subjective. Jourde ne risque pas même le mot de retour, puisque cet écrit qui parle tant d'humus, de racines végétales, mais aussi de cloaque et de destruction lente ou accidentelle des corps, résonne quelque peu comme un adieu. Il y a dans ce livre une triple référence à la mort d'un individu: celle du père de l'auteur, à qui semble dédié ce livre, la mort du lointain cousin, qui fait signe aux vivants en lèguant son maigre bien au seul des apparentés qui venait , de loin en loin, lui rendre visite, et celle, cruellement absurde, d'une fillette dont le sourire et la beauté enfantine marquent les souvenirs de l'auteur.
Le livre est construit autour d'un bref voyage afin de règler une improbable succession, et les obsèques d'une enfant, Lucie (lumière…), décédée de leucémie. Ce rituel funèbre, ainsi que la coutume des visites à la défunte sont le champ dans lequel entrent et sortent vivants et morts, ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas rendre ce dernier hommage. La caméra subjective, le regard de Pierre Jourde, nous fait découvrir en plan serré ou en champ-contrechamp toute une humanité isolée du reste de l'humanité, sculptée par le travail, à peine déviée de son cheminement sourd et aveugle au reste du monde par les unions dont certaines sont brèves, et les autres génératrices de coupures familiales définitives.
C'est là que la littérature devient réalité, et c'est là que prit naissance le ressort de la haine et du rejet, manifestée par une forme de lynchage des personnages de Jourde contre lui et contre sa famille, après la parution de Pays perdu..
Sans prendre position sur le fond, sûrement complexe, de l'affaire, sans revenir au débat sur l'auto fiction et ses conséquences, et sans remettre aucunement en cause la qualité littéraire de l'oeuvre ni l'intention de l'auteur,
je partage quelques réflexions, qui resteront sûrement superficielles.
La force et le pouvoir de l'écriture, est aussi, comme le disait magnifiquement Levi- Strauss, ce qui permet l'existence et le maintien d'une forme de domination. Face à ce qu'ils ont reçu comme une intrusion et une insulte, les personnages ripostent, non avec l'usage des mots dont ils n'ont pas la maîtrise, mais avec la violence qu'ils pensent leur être faite. Et ils chassent le traître du pays, obéissant à la même logique que celle qui anime Jourde, en n'en conservant que la versant du rejet. Car la fascination-répulsion de l'auteur pour ses origines a pu être traitée par l'écriture. Mais il n'en va pas de même pour ses personnages, qui n'ont pas sur eux-mêmes un regard transcendé par la littérature et la poésie, pour eux un mot est un mot, et une pierre est une pierre.
Invité chez Busnel, Pierre Jourde a présenté son livre ‘La première pierre’ où il expliquait qu’il était retourné dans le village décrit dans ce roman. Lui, sa femme et ses enfants en ont été chassés à coups de pierre. J’ai donc voulu savoir ce qu’il y avait dedans.
Eh bien pas grand-chose : il n’y a pas vraiment d’histoire, seulement des descriptions à n’en plus finir sur la crasse des campagnards et leur alcoolisme. L’impression d’assister à du commérage. Je lirai quand même La première pierre, puisqu’il a eu le prix Jean Giono.
Eh bien pas grand-chose : il n’y a pas vraiment d’histoire, seulement des descriptions à n’en plus finir sur la crasse des campagnards et leur alcoolisme. L’impression d’assister à du commérage. Je lirai quand même La première pierre, puisqu’il a eu le prix Jean Giono.
Description d'un monde de paysans arriérés aux confins de l'Auvergne.
Même dans des circonstances très défavorables à ma concentration et à une lecture hachée, je ressens beaucoup de choses pour ce livre. Tant le contenu campagnard, d'exilés du monde, prisonniers d'un autre monde, un monde que j'ai un peu connu par bribes, qui est dur, assez implacable, quelque part.
Tant la forme, une très belle écriture, sans effets, sans procédés, juste juste, juste très juste.
Tant la forme, une très belle écriture, sans effets, sans procédés, juste juste, juste très juste.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre Jourde
Lecteurs de Pierre Jourde (999)Voir plus
Quiz
Voir plus
Petite charade littéraire 2
Mon premier est un aliment apprécié par les Asiatiques
riz
sorgho
mil
5 questions
26 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur26 lecteurs ont répondu