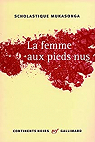Critiques de Scholastique Mukasonga (326)
Sur une des mille collines rwandaises, la nuit où les conteuses à la lueur des braises rougeoyantes rappellent les croyances ancestrales, les héros de légende et les généalogies mythiques, s’oppose au jour des Padri qui annoncent d’autres héros, christianisent et baptisent à tour de bras. A commencer par le nouveau mwami Mutara III placé sur le trône par l’autorité de tutelle parce que le précédent Musinga refusait le baptème.
Les villageois syncrétisent Yézu et Kibogo, tous deux montés au ciel, et ne savent pas trop qui de Maria ou de Mukamwezi, prêtresse de Kibogo, a mis fin à une grave sécheresse. Akayézu (petit Jésus)) un ancien séminariste, tente la soudure entouré de quelques femmes à sa dévotion, parmi lesquelles une « femme libre » d’Astrida (actuellement Butare) Sur la montagne sacrée, interdite d’ascension, Ajayézu s’unira mystiquement à Mukamwezi, et tous deux disparaîtront dans un nuage à moins qu’ils n’aient été précipités d’une roche pointue. Pour reconquérir ce morceau de terre où subsiste un paganisme intégral et donc péché mortel, les Padri y élèveront une chapelle à Maria.
Quelques années plus tard, arrive un professeur ethnologue belge – et franc-maçon, horresco referens – il a eu vent des traditions de la colline, et vient recueillir les témoignages des survivants, fort âgés et à la mémoire défaillante. Qu’importe : ils compensent par des ajouts et des embellissements, et les jeunes, qui avaient transgressé l’interdit, en remettent une couche, tous attirés par le matabiche et la perspective d’avoir leur nom dans un livre des Blancs, promesse du professeur. Promesse non tenue : le professeur décède dans un accident d’avion. Vengeance de Kibogo, assurément. Lui aussi peut agiter le ciel et déclencher la foudre, le conte de Kibogo ne vaut-il pas celui de Yézu ? Et dans le secret profond de la nuit, les conteuses tissent et retissent encore le conte de Kibogo. (p. 153-154).
Une écriture simple, quotidienne, avec un petit aspect ethnologique nullement dérangeant, les mots de kinyarwanda sont nombreux, mais toujours traduits, ils nous introduisent à une autre connaissance du Rwanda. L’attachement au pays est prégnant chez les protagonistes et chez l’auteure. L’espérance est sous-jacente de la restauration de la grandeur passée.
Délectable et truculent : une perle de justesse dans l’observation, d’humour léger et d’ironie acide sur la destructuration des sociétés traditionnelles et le choc des croyances, une des faces du choc des cultures. Nourrie dans le sérail, Scholastique Mukasonga sait de quoi elle parle.
Les villageois syncrétisent Yézu et Kibogo, tous deux montés au ciel, et ne savent pas trop qui de Maria ou de Mukamwezi, prêtresse de Kibogo, a mis fin à une grave sécheresse. Akayézu (petit Jésus)) un ancien séminariste, tente la soudure entouré de quelques femmes à sa dévotion, parmi lesquelles une « femme libre » d’Astrida (actuellement Butare) Sur la montagne sacrée, interdite d’ascension, Ajayézu s’unira mystiquement à Mukamwezi, et tous deux disparaîtront dans un nuage à moins qu’ils n’aient été précipités d’une roche pointue. Pour reconquérir ce morceau de terre où subsiste un paganisme intégral et donc péché mortel, les Padri y élèveront une chapelle à Maria.
Quelques années plus tard, arrive un professeur ethnologue belge – et franc-maçon, horresco referens – il a eu vent des traditions de la colline, et vient recueillir les témoignages des survivants, fort âgés et à la mémoire défaillante. Qu’importe : ils compensent par des ajouts et des embellissements, et les jeunes, qui avaient transgressé l’interdit, en remettent une couche, tous attirés par le matabiche et la perspective d’avoir leur nom dans un livre des Blancs, promesse du professeur. Promesse non tenue : le professeur décède dans un accident d’avion. Vengeance de Kibogo, assurément. Lui aussi peut agiter le ciel et déclencher la foudre, le conte de Kibogo ne vaut-il pas celui de Yézu ? Et dans le secret profond de la nuit, les conteuses tissent et retissent encore le conte de Kibogo. (p. 153-154).
Une écriture simple, quotidienne, avec un petit aspect ethnologique nullement dérangeant, les mots de kinyarwanda sont nombreux, mais toujours traduits, ils nous introduisent à une autre connaissance du Rwanda. L’attachement au pays est prégnant chez les protagonistes et chez l’auteure. L’espérance est sous-jacente de la restauration de la grandeur passée.
Délectable et truculent : une perle de justesse dans l’observation, d’humour léger et d’ironie acide sur la destructuration des sociétés traditionnelles et le choc des croyances, une des faces du choc des cultures. Nourrie dans le sérail, Scholastique Mukasonga sait de quoi elle parle.
Je vous emmène au pays des mille collines, et plus particulièrement auprès de l’une d’entre elles, le mont Runani, au pied duquel se situe ce roman. En quatre tableaux d’époques différentes, de la Seconde guerre mondiale aux années 60, Scholastique Mukasonga nous fait vivre l’évolution de l’évangélisation au Rwanda, et de sa cohabitation avec les cultes et coutumes plus ancestraux.
Le fil rouge ? Kibogo, fils du roi Ndahiro, qui, en des temps lointains et selon ce qu’on raconte, monta au sommet du mont Runani pour sauver son peuple de la famine, y fut foudroyé et emporté au ciel, ce qui lui permit de faire tomber la pluie et arrêter la sécheresse qui sévissait alors. Les tableaux ? Ruzagayura (nom de la grande famine de 1943), Akayezu, Mukamwezi et Kibogo. Les protagonistes ? Les padri, qui, du haut de leur supériorité, incitent cette population païenne à prier Yezu et Maria ; les anciens, qui connaissent les histoires qui se transmettent de génération en génération et sont plus enclins à invoquer l’aide de Kibogo ; Akayezu, séminariste dont les croyances font se rejoindre Bible et tradition ; Mukamwezi, vierge prêtresse consacrée à Kibogo ; un ethnologue passionné par les sacrifices humains… puis ces vieillards et enfants qui sont la voix des villageois…
Scholastique Mukasonga nous offre ici un beau conte, fait lui-même d’autres contes, comme ceux que l’on raconte lors des veillées. Si le début est assez dur (exploitation par les colons, sécheresse et famine), elle nous donne également, avec beaucoup d’humour et de tendresse pour ses personnages, un regard intéressant sur ce travail missionnaire de l’époque, et du recours à la religion chrétienne ou aux pratiques et coutumes locales au gré des intempéries et des besoins, et sur ce processus d’acculturation qu’Akayezu représente. Et de la grande famine aux récits au coin du feu, nous ne sommes pas plus avancés en refermant notre livre : finalement, qui, de Kibogo ou de Yezu et Maria, fait tomber la pluie ?
En résumé, un roman intéressant qui appréhende avec humour l’évangélisation du Rwanda.
Le fil rouge ? Kibogo, fils du roi Ndahiro, qui, en des temps lointains et selon ce qu’on raconte, monta au sommet du mont Runani pour sauver son peuple de la famine, y fut foudroyé et emporté au ciel, ce qui lui permit de faire tomber la pluie et arrêter la sécheresse qui sévissait alors. Les tableaux ? Ruzagayura (nom de la grande famine de 1943), Akayezu, Mukamwezi et Kibogo. Les protagonistes ? Les padri, qui, du haut de leur supériorité, incitent cette population païenne à prier Yezu et Maria ; les anciens, qui connaissent les histoires qui se transmettent de génération en génération et sont plus enclins à invoquer l’aide de Kibogo ; Akayezu, séminariste dont les croyances font se rejoindre Bible et tradition ; Mukamwezi, vierge prêtresse consacrée à Kibogo ; un ethnologue passionné par les sacrifices humains… puis ces vieillards et enfants qui sont la voix des villageois…
Scholastique Mukasonga nous offre ici un beau conte, fait lui-même d’autres contes, comme ceux que l’on raconte lors des veillées. Si le début est assez dur (exploitation par les colons, sécheresse et famine), elle nous donne également, avec beaucoup d’humour et de tendresse pour ses personnages, un regard intéressant sur ce travail missionnaire de l’époque, et du recours à la religion chrétienne ou aux pratiques et coutumes locales au gré des intempéries et des besoins, et sur ce processus d’acculturation qu’Akayezu représente. Et de la grande famine aux récits au coin du feu, nous ne sommes pas plus avancés en refermant notre livre : finalement, qui, de Kibogo ou de Yezu et Maria, fait tomber la pluie ?
En résumé, un roman intéressant qui appréhende avec humour l’évangélisation du Rwanda.
Scholastique Mukasonga nous livre un récit très intéressant, un peu comme un conte, sur l'évangélisation du Rwanda par les colons.
Lors des veillées, on raconte l'histoire de Kibogo, fils du roi Ndahiro. Alors qu'une grande sécheresse sévissait sur le Rwanda, Kibogo est allé sur la montagne proche de son village, le mont Runani, pour invoquer la pluie. Sous les yeux de trois enfants, Kibogo a été foudroyé, c'est ainsi que selon la légende, il est monté au ciel.
A leur arrivée, les prêtres blancs interdisent cette montagne, symbole des rites païens.
Akayézu, choisi par les missionnaires, entre au séminaire où il apprend la bible.
Revenu dans son village, il prêche en se ré appropriant celle-ci, persuadé qu'il y est raconté l'histoire des rwandais et non celle de Jésus.
Puis arrive un professeur, ethnologue blanc, qui s'intéresse aux traditions rwandaises et qui se fait raconter les témoignages des survivants de l'époque de Kibogo. Ces derniers apportent des ajouts et des embellissements à leurs récits qu'ils livrent contre la promesse d'avoir leur nom inscrit dans un livre.
Avec humour, l'auteure nous montre les conséquences de la colonisation et de l'évangélisation sur la culture d'un pays.
A travers l'histoire de quelques personnages, Scholastique Mukasonga nous parle du mélange des deux cultures où fort heureusement l'influence des blancs n'a pas anéanti toutes les croyances qui font ce pays.
Un roman très agréable à lire pour une belle découverte du Rwanda !
Lors des veillées, on raconte l'histoire de Kibogo, fils du roi Ndahiro. Alors qu'une grande sécheresse sévissait sur le Rwanda, Kibogo est allé sur la montagne proche de son village, le mont Runani, pour invoquer la pluie. Sous les yeux de trois enfants, Kibogo a été foudroyé, c'est ainsi que selon la légende, il est monté au ciel.
A leur arrivée, les prêtres blancs interdisent cette montagne, symbole des rites païens.
Akayézu, choisi par les missionnaires, entre au séminaire où il apprend la bible.
Revenu dans son village, il prêche en se ré appropriant celle-ci, persuadé qu'il y est raconté l'histoire des rwandais et non celle de Jésus.
Puis arrive un professeur, ethnologue blanc, qui s'intéresse aux traditions rwandaises et qui se fait raconter les témoignages des survivants de l'époque de Kibogo. Ces derniers apportent des ajouts et des embellissements à leurs récits qu'ils livrent contre la promesse d'avoir leur nom inscrit dans un livre.
Avec humour, l'auteure nous montre les conséquences de la colonisation et de l'évangélisation sur la culture d'un pays.
A travers l'histoire de quelques personnages, Scholastique Mukasonga nous parle du mélange des deux cultures où fort heureusement l'influence des blancs n'a pas anéanti toutes les croyances qui font ce pays.
Un roman très agréable à lire pour une belle découverte du Rwanda !
La dédicace / citation de Michel Leiris, à la première page de l’Iguifou de Scolastique Mukasonga, peut nous donner une piste :
L’Afrique - qui fit – refit - et qui fera.
Avec lyrisme, et en plusieurs nouvelles du même sujet, l’auteure parle de ce cruel magicien dont les Tutsis ont été frappés au cours du génocide. Ce qui fit l’Afrique, malgré ses magnificences, et en particulier Nyamata, ou l’Iguifou ricane au fond des ventres. Avec sa famille, ce sont des déplacés à Nyamata, où rien ne pousse, dans de misérables cases.
“Mon père espérait obtenir un peu de riz à la mission, ce
qui n’arrivait pas souvent, ou gagner quelques pièces pour
acheter du sel en rédigeant la lettre ou le formulaire administratif d’un gendarme ou d’un notable illettré”
Le faim, c’est toujours plus que la faim, et pour Scolastique et sa petite sœur, cherchant dans le fonds d’une casserole en terre des débris de nourriture, eh bien, mieux vaut dormir si on peut, car l’iguifou déchire leurs ventres de toutes ses griffes.
L’iguifou, c’est la faim.
Ce que l’Afrique fit, et refit, ce sont les rêves, comme ceux qui assaillent la petite Colomba.
Un monde si beau !
Entre rêves d’un monde qui n’existe plus, puisque l’héroïne meurt de faim, les croyances et les interdits de manger tel ou tel mets, même si cela conduit à la mort, par exemple (honteux)boire du lait de chèvre au lieu du lait de vache.
Il n’y a plus de vaches, tuées par les militaires, plus de lait, plus de vie.
La peur s’installe, qui poursuit l’auteure jusque dans des boulevards européens. Va-t-il me tuer ? se demande-t-elle, comme elle devait se le demander devant un militaire, un milicien, un inconnu.
Car la mort est partout, en embuscade. En contraste, la « belle Hélène » dont la beauté a fait le malheur, deuxième bureau d’un homme pas clair, et je ne parle pas de la couleur de peau, puis d’autres, dont Mobutu Sese Seko, aux assauts duquel elle doit être livrée puisqu’aucune Zaïroise, aucune Burundaise, n’accepterait.
La mort des Tutsis, précédée par la mort des vaches, leur principale fortune, la faim la peur le génocide, et la visite à tous ces morts, leurs morts.
Dire tout de même que le régime rwandais est Tutsi depuis 1994.
L’Afrique, qui fera.
L’Afrique - qui fit – refit - et qui fera.
Avec lyrisme, et en plusieurs nouvelles du même sujet, l’auteure parle de ce cruel magicien dont les Tutsis ont été frappés au cours du génocide. Ce qui fit l’Afrique, malgré ses magnificences, et en particulier Nyamata, ou l’Iguifou ricane au fond des ventres. Avec sa famille, ce sont des déplacés à Nyamata, où rien ne pousse, dans de misérables cases.
“Mon père espérait obtenir un peu de riz à la mission, ce
qui n’arrivait pas souvent, ou gagner quelques pièces pour
acheter du sel en rédigeant la lettre ou le formulaire administratif d’un gendarme ou d’un notable illettré”
Le faim, c’est toujours plus que la faim, et pour Scolastique et sa petite sœur, cherchant dans le fonds d’une casserole en terre des débris de nourriture, eh bien, mieux vaut dormir si on peut, car l’iguifou déchire leurs ventres de toutes ses griffes.
L’iguifou, c’est la faim.
Ce que l’Afrique fit, et refit, ce sont les rêves, comme ceux qui assaillent la petite Colomba.
Un monde si beau !
Entre rêves d’un monde qui n’existe plus, puisque l’héroïne meurt de faim, les croyances et les interdits de manger tel ou tel mets, même si cela conduit à la mort, par exemple (honteux)boire du lait de chèvre au lieu du lait de vache.
Il n’y a plus de vaches, tuées par les militaires, plus de lait, plus de vie.
La peur s’installe, qui poursuit l’auteure jusque dans des boulevards européens. Va-t-il me tuer ? se demande-t-elle, comme elle devait se le demander devant un militaire, un milicien, un inconnu.
Car la mort est partout, en embuscade. En contraste, la « belle Hélène » dont la beauté a fait le malheur, deuxième bureau d’un homme pas clair, et je ne parle pas de la couleur de peau, puis d’autres, dont Mobutu Sese Seko, aux assauts duquel elle doit être livrée puisqu’aucune Zaïroise, aucune Burundaise, n’accepterait.
La mort des Tutsis, précédée par la mort des vaches, leur principale fortune, la faim la peur le génocide, et la visite à tous ces morts, leurs morts.
Dire tout de même que le régime rwandais est Tutsi depuis 1994.
L’Afrique, qui fera.
L’inguifu. Ce n’est assurément pas un livre facile à digérer, ce n’est pas un ouvrage que l’on avale goulument sans que le palais n’en sente le goût. Ce livre s’avale comme un sirop pour la toux, ou une aspirine effervescente. On anticipe le goût amer, on serre les maxillaires, on se renfrogne à l’odeur qui se rapproche des narines car on sent que ça ne va pas être bon.
Au fond de nous, nous savons qu’il faut se méfier de ce 4ème de couverture qui annonce "Rwanda", "faim" et qui nous penser "génocide". Nous entamons sur cette lecture à reculons, nous butons sur les premiers mots remplis de Kinyarwanda et de nom Hutus et Tutsi imprononçables.
Nous nous disons, "punaise, je me disais bien que ce livre serait abominablement chiant à lire", mais nous insistons, nous continuons à avancer dans la lecture peut-être parce que la voix de cette enfant qui invective sa faim personnifiée nous a déjà hypnotisée.
Peut-être parce que, petit à petit, les mots nous pénètrent, font tomber nos à priori et nous révèlent cette âme jeune qui ne se plaint pas de l’horrible manque de nourriture qui l’amène au bord du tombeau. Pas de complainte, pas d’injures au sort, pas de mots larmoyants. Rien que le dialogue d’une enfant avec la faim qui est devenue sa compagne. Une ombre permanente dont elle essai de protéger sa jeune sœur sous le regard impuissant de parents que l’on devine au bord du désespoir.
Cette "entrée" n’est que le départ d’un voyage qui nous emmène au cœur du Rwanda. Non pas au cœur de la guerre, mais autour, tout autour, avec, toujours, le génocide que l’on devine en toile de fond.
Dans ces vécus qui nous montrent le quasi-culte des Tutsi pour l’élevage de la vache, science transmise de génération en génération et qui fait la marque de ce peuple,
ces destins qui incombent à celles qui naissent avec la beauté faite vie et qui n’ont d’issues que la misère et la mort, sous le règne de régimes fous et d’un monde aux valeurs corrompues,
Cette peur qui laissent ses relents fétides dans les vies de ceux qui ont vécu l’indicible, qui vivent un présent de frayeurs permanentes. L’horreur anticipée dans l’âme d’une enfant que l’on voudrait entourée que de rires et de désir futiles.
Scholastique MUKASONGA est une auteure d’origine rwandaise qui a, dans sa façon de conter la vie un pragmatisme dans l’écriture et un rendu de l’intenable qui est magnifique.
Dans un style, parfois, quasi journalistique, très descriptive, elle nous apprend à connaitre le Rwanda, l’histoire de ces peuples autrement que par les spéculaires pétarades des canons dont sont friands les apôtres des dieux "Médias". Et si les premières bouchées peuvent sembler difficiles à ingurgiter, ce livre se déguste néanmoins avec le bonheur et la gravité de celui qui sait qu’il sortira de ce festin un peu plus humain qu’il ne l’était.
Lien : http://www.loumeto.com/spip...
Au fond de nous, nous savons qu’il faut se méfier de ce 4ème de couverture qui annonce "Rwanda", "faim" et qui nous penser "génocide". Nous entamons sur cette lecture à reculons, nous butons sur les premiers mots remplis de Kinyarwanda et de nom Hutus et Tutsi imprononçables.
Nous nous disons, "punaise, je me disais bien que ce livre serait abominablement chiant à lire", mais nous insistons, nous continuons à avancer dans la lecture peut-être parce que la voix de cette enfant qui invective sa faim personnifiée nous a déjà hypnotisée.
Peut-être parce que, petit à petit, les mots nous pénètrent, font tomber nos à priori et nous révèlent cette âme jeune qui ne se plaint pas de l’horrible manque de nourriture qui l’amène au bord du tombeau. Pas de complainte, pas d’injures au sort, pas de mots larmoyants. Rien que le dialogue d’une enfant avec la faim qui est devenue sa compagne. Une ombre permanente dont elle essai de protéger sa jeune sœur sous le regard impuissant de parents que l’on devine au bord du désespoir.
Cette "entrée" n’est que le départ d’un voyage qui nous emmène au cœur du Rwanda. Non pas au cœur de la guerre, mais autour, tout autour, avec, toujours, le génocide que l’on devine en toile de fond.
Dans ces vécus qui nous montrent le quasi-culte des Tutsi pour l’élevage de la vache, science transmise de génération en génération et qui fait la marque de ce peuple,
ces destins qui incombent à celles qui naissent avec la beauté faite vie et qui n’ont d’issues que la misère et la mort, sous le règne de régimes fous et d’un monde aux valeurs corrompues,
Cette peur qui laissent ses relents fétides dans les vies de ceux qui ont vécu l’indicible, qui vivent un présent de frayeurs permanentes. L’horreur anticipée dans l’âme d’une enfant que l’on voudrait entourée que de rires et de désir futiles.
Scholastique MUKASONGA est une auteure d’origine rwandaise qui a, dans sa façon de conter la vie un pragmatisme dans l’écriture et un rendu de l’intenable qui est magnifique.
Dans un style, parfois, quasi journalistique, très descriptive, elle nous apprend à connaitre le Rwanda, l’histoire de ces peuples autrement que par les spéculaires pétarades des canons dont sont friands les apôtres des dieux "Médias". Et si les premières bouchées peuvent sembler difficiles à ingurgiter, ce livre se déguste néanmoins avec le bonheur et la gravité de celui qui sait qu’il sortira de ce festin un peu plus humain qu’il ne l’était.
Lien : http://www.loumeto.com/spip...
Dans ses nouvelles, Scholastique Mukasonga donne la parole aux enfants de l’avant-génocide, quand la peur s’échafaudait lentement, pas à pas, semant ses grains insidieusement. Elle décrit un monde qui décline dans un quotidien grevée par la faim, la peur, l’appât du gain, l’exil à Nyamata...
Elle aborde le sujet de façon très pudique, par touches subtiles, en peignant la vie de ces enfants, hommes et femmes qui subissent une lutte qui n’a aucun sens pour eux. Elle suggère le massacre, mais jamais elle ne l’aborde de front, permettant ainsi au lecteur d’apprécier cette lecture pure et solaire qui cache une réalité sombre et sanguinaire.
- Seule la dernière nouvelle « Le deuil » parle - mais toujours très délicatement - des années des génocides au travers le vécu d’une jeune exilée qui apprend à vivre avec la mort de tous ses proches :
« Ce n’est pas sur les tombes ou près des ossements ou dans la fosse des latrines que tu retrouveras tes Morts. Ce n’est pas là qu’ils t’attendent, ils sont en toi. Ils ne survivent qu’en toi, tu ne survis que par eux. Mais c’est en eux désormais que tu puiseras ta force, tu n’as plus d’autre choix, et cette force-là, personne ne pourra te l’enlever, elle te rendra capable de faire ce que peut-être aujourd’hui il t’est impossible de prévoir. La mort des nôtres, et nous n’y pouvons rien, nous a nourris, non pas de rancœur, non pas de haine, mais d’une énergie que rien ne pourra briser. » (p. 120)
Cette jeune fille, c’est sans doute l’auteur elle-même qui a perdu les siens lors du génocide de 1994. Elle est l’une des rares rescapées de sa famille et par ces récits discrets, elle offre une digne sépulture à ses proches. Grâce à elle, nous n’oublions pas l’horreur afin de mieux lutter contre son retour…
Lien : http://lecturissime.over-blo..
Elle aborde le sujet de façon très pudique, par touches subtiles, en peignant la vie de ces enfants, hommes et femmes qui subissent une lutte qui n’a aucun sens pour eux. Elle suggère le massacre, mais jamais elle ne l’aborde de front, permettant ainsi au lecteur d’apprécier cette lecture pure et solaire qui cache une réalité sombre et sanguinaire.
- Seule la dernière nouvelle « Le deuil » parle - mais toujours très délicatement - des années des génocides au travers le vécu d’une jeune exilée qui apprend à vivre avec la mort de tous ses proches :
« Ce n’est pas sur les tombes ou près des ossements ou dans la fosse des latrines que tu retrouveras tes Morts. Ce n’est pas là qu’ils t’attendent, ils sont en toi. Ils ne survivent qu’en toi, tu ne survis que par eux. Mais c’est en eux désormais que tu puiseras ta force, tu n’as plus d’autre choix, et cette force-là, personne ne pourra te l’enlever, elle te rendra capable de faire ce que peut-être aujourd’hui il t’est impossible de prévoir. La mort des nôtres, et nous n’y pouvons rien, nous a nourris, non pas de rancœur, non pas de haine, mais d’une énergie que rien ne pourra briser. » (p. 120)
Cette jeune fille, c’est sans doute l’auteur elle-même qui a perdu les siens lors du génocide de 1994. Elle est l’une des rares rescapées de sa famille et par ces récits discrets, elle offre une digne sépulture à ses proches. Grâce à elle, nous n’oublions pas l’horreur afin de mieux lutter contre son retour…
Lien : http://lecturissime.over-blo..
Chaque phrase, chaque mot composant les cinq nouvelles de ce recueil, L’Iguifou, nouvelles rwandaises, empoigne notre cœur qui s'emplit d’angoisse, amène un trop plein de sang qui fait bourdonner nos oreilles et grésiller devant nos yeux le contexte du génocide qui plane au dessus de chaque nouvelle sans jamais véritablement être là. La poésie de l'écriture et de la narration fait que tous les personnages de ces nouvelles sont les rescapés, les réfugiés tutsi, ceux qui ne sont pas mort et qui doivent vivre avec la faim, la peur, le deuil mais aussi avec la nostalgie de leur pays et de leurs vaches. Ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas nommer le génocide avant la dernière nouvelle.
L'Iguifou est un recueil de nouvelles sur le Rwanda. Quand on parle de ce pays, tout le monde pense au génocide de 1994 qui a fait environ 800.000 victimes. Ce que nous apprend ce livre, c'est que l'histoire du pays est pavée de massacres, et les enfants tutsis exilés au Bugesera car chassés de leurs terres quelques années auparavant, vivent dans le souvenir des tueries de 1959 ou 1963 et dans la hantise de la prochaine folie qui fera d'eux des victimes d'un conflit fratricide. Ils ont peur des Hutus, peur des militaires qui peut les tabasser ou leur tirer dessus juste pour s'amuser. Tout le monde, que ce soit à la maison ou à l'école, est prêt à fuir et se cacher dans la brousse lorsqu'on viendra les massacrer. Ça se produira à coup sûr, seule la date est inconnue.
L'auteure raconte une blague entendue dans la cour de récréation :
"Elle se rappelait l’histoire que lui racontaient en riant au lycée de Kigali ses camarades hutu : Un jour, un enfant demanderait à sa mère :
— Dis-moi, maman, qui étaient ces Tutsi dont j’ai entendu parler ? À quoi pouvaient-ils bien ressembler ?
— Ce n’était rien, mon fils, répondrait la mère, ce n’était qu’une légende.”
Les nouvelles intitulées La faim (l'iguifou), la peur, le deuil, font toutes référence à l'exil intérieur imposé aux Tutsis et aux massacres. J'ai beaucoup aimé celle qui s'intitule "La gloire de la vache", qui montre l'importance de cet animal dans la culture des Tutsis. Leur bétail a été massacré lorsqu'ils ont été chassés de leur terre, et pour eux ce n'était pas seulement une perte économique, c'était une humiliation qui fut vécue presque comme une perte d'identité pour ce peuple d'éleveurs. L'auteure décrit des actions telles que mener les vaches au pâturage ou les traire comme un cérémonial, et elle raconte l'espèce de désespoir qui a envahi son père suite à la perte de son cheptel.
Le tout est écrit dans un style très plaisant, sans jamais tomber dans l'horreur malgré le caractère abominable des évènements passés. Beaucoup ont écrit suite au génocide rwandais, peu l'ont fait avec autant de délicatesse.
L'auteure raconte une blague entendue dans la cour de récréation :
"Elle se rappelait l’histoire que lui racontaient en riant au lycée de Kigali ses camarades hutu : Un jour, un enfant demanderait à sa mère :
— Dis-moi, maman, qui étaient ces Tutsi dont j’ai entendu parler ? À quoi pouvaient-ils bien ressembler ?
— Ce n’était rien, mon fils, répondrait la mère, ce n’était qu’une légende.”
Les nouvelles intitulées La faim (l'iguifou), la peur, le deuil, font toutes référence à l'exil intérieur imposé aux Tutsis et aux massacres. J'ai beaucoup aimé celle qui s'intitule "La gloire de la vache", qui montre l'importance de cet animal dans la culture des Tutsis. Leur bétail a été massacré lorsqu'ils ont été chassés de leur terre, et pour eux ce n'était pas seulement une perte économique, c'était une humiliation qui fut vécue presque comme une perte d'identité pour ce peuple d'éleveurs. L'auteure décrit des actions telles que mener les vaches au pâturage ou les traire comme un cérémonial, et elle raconte l'espèce de désespoir qui a envahi son père suite à la perte de son cheptel.
Le tout est écrit dans un style très plaisant, sans jamais tomber dans l'horreur malgré le caractère abominable des évènements passés. Beaucoup ont écrit suite au génocide rwandais, peu l'ont fait avec autant de délicatesse.
L'Iguifou, c'est la faim qui ronge le ventre des petites Tutsi exilées à un tel point qu'il leur rend si belles et lumineuses les portes de la mort. Alors on se souvient de la vache, du lait, sacré, que l'on buvait assis par terre le dos bien droit et les jambes allongées.
La peur par contre n'a pas de nom mais c'est leur ange gardien, toujours être prêt à se jeter dans les fossés épineux quand un camion de militaire s'amuse à lancer une grenade ou à tirer dans les jambes des écoliers.
Il y a aussi la triste histoire d'Helena, la plus jolie fille de la région, et ce deuil, si difficile à accomplir en exil avec juste devant soi la liste des membres de la famille victimes du génocide.
L'écriture de Scholastique Mukasonga est très belle et reste légère et sereine malgré la gravité du sujet.
La peur par contre n'a pas de nom mais c'est leur ange gardien, toujours être prêt à se jeter dans les fossés épineux quand un camion de militaire s'amuse à lancer une grenade ou à tirer dans les jambes des écoliers.
Il y a aussi la triste histoire d'Helena, la plus jolie fille de la région, et ce deuil, si difficile à accomplir en exil avec juste devant soi la liste des membres de la famille victimes du génocide.
L'écriture de Scholastique Mukasonga est très belle et reste légère et sereine malgré la gravité du sujet.
Scholastique Mukasonga est rwandaise. Elle a eu la chance de quitter son pays avant le génocide des années 90, qui a conduit au massacre de 800 000 rwandais, hutus ou tutsis. Mais ce ne fut pas le cas de sa famille, dont presque tous les membres ont été tués. Alors il n'est pas surprenant de retrouver en filigrane, dans les nouvelles de ce recueil, l'évocation de ce massacre. Mais l'art de Scholastique Mukasonga est de mêler à ce thème funeste une écriture splendide qui plonge le lecteur dans l'histoire de cette région d'Afrique.
Cinq nouvelles composent ce recueil. La première donne son nom au recueil : L'iguifou. Pour la petite Colomba, l'iguifou est la faim qui la tenaille lorsqu'elle n'a même plus quelques grains de riz pour la nourrir. L'attente de sa mère qui est sensée apporter quelques fruits ou racines occupe toute entière la petite fille, qui ne parvient pas à oublier sa faim, jusqu'à être éblouie par une lumière étincelante.
Lien : http://livres-et-cin.over-bl..
Cinq nouvelles composent ce recueil. La première donne son nom au recueil : L'iguifou. Pour la petite Colomba, l'iguifou est la faim qui la tenaille lorsqu'elle n'a même plus quelques grains de riz pour la nourrir. L'attente de sa mère qui est sensée apporter quelques fruits ou racines occupe toute entière la petite fille, qui ne parvient pas à oublier sa faim, jusqu'à être éblouie par une lumière étincelante.
Lien : http://livres-et-cin.over-bl..
****
Dans ce recueil de 5 nouvelles, Scholastique Mukasonga nous fait partager la dure vie et les terribles souvenirs des Tutsis au prémices du génocide.
Avec douceur et poésie, elle arrive à poser de jolis mots sur cette période sombre.
Il est toujours compliqué de parler de nouvelles, mais ce recueil là est à savourer... En souvenir... Et pour ne pas oublier...
Dans ce recueil de 5 nouvelles, Scholastique Mukasonga nous fait partager la dure vie et les terribles souvenirs des Tutsis au prémices du génocide.
Avec douceur et poésie, elle arrive à poser de jolis mots sur cette période sombre.
Il est toujours compliqué de parler de nouvelles, mais ce recueil là est à savourer... En souvenir... Et pour ne pas oublier...
Très bien ecrit. C'est une écriture un peu poétique facile et agréable à lire.
« L’Iguifou », c’est la faim. Celle qui vous tenaille, vous fait mal au ventre, celle qui vous réveille avant le lever du jour. C’est celle qui rend vos yeux plus grands lorsque vous guettez la rondeur pleine de promesses du balluchon de votre mère. Ce méchant Iguifou, c’est celui qui vous emmène aux portes de la mort et c’est celui qu’a connu l’auteur, Scolastique Mukasonga, alors qu’elle était exilée dans la région insalubre du Bugesera, au Rwanda. Parce qu’elle était Tutsi.
Dans ce recueil de nouvelles, l’auteur nous fait partager ses souvenirs rwandais. Que ce soit à travers les personnages de Colomba, Kalisa ou Asumpta, l’auteur dévoile son ancienne vie, celle d’avant le génocide. Un temps où déjà les signes avant-coureur annonçaient le pire…
« La gloire de la vache » nous rappelle que les Tutsis étaient au tout début des éleveurs pour qui les vaches revêtaient une extrême importance. Source de prospérité, la vache apportait chance et nourriture à celui qui en possédait une. Retirer ces bêtes aux Tutsis, c'était leur ôter de quoi survivre mais aussi de quoi rester dignes.
« La peur », c’est celle qui n’a jamais quitté les Tutsis lorsque les persécutions ont commencé. On la guette et, au premier signe - un nuage de poussière au loin, des buissons qui bruissent – on s’enfuit et on se cache.
« Le malheur d’être belle », c’est l’histoire d’Héléna. Jeune femme très belle… mais tutsi. Son avantage physique va décider de son destin. De maîtresse adorée, elle devient prostituée, répudiée et contrainte à l’exil.
Enfin « Le deuil » est la seule nouvelle qui aborde directement le génocide et le thème des survivants. Comment continuer à vivre alors que tous nos proches ont été tués ? Comment « faire son deuil », leur dire au revoir, alors qu’il n’y a pas de corps à pleurer, alors que l’on est exilé dans un autre pays ?
Dans ce livre, Scholastique Mukasonga, tout en sobriété et poésie, nous conte son malheur et celui des siens.
Dans ce recueil de nouvelles, l’auteur nous fait partager ses souvenirs rwandais. Que ce soit à travers les personnages de Colomba, Kalisa ou Asumpta, l’auteur dévoile son ancienne vie, celle d’avant le génocide. Un temps où déjà les signes avant-coureur annonçaient le pire…
« La gloire de la vache » nous rappelle que les Tutsis étaient au tout début des éleveurs pour qui les vaches revêtaient une extrême importance. Source de prospérité, la vache apportait chance et nourriture à celui qui en possédait une. Retirer ces bêtes aux Tutsis, c'était leur ôter de quoi survivre mais aussi de quoi rester dignes.
« La peur », c’est celle qui n’a jamais quitté les Tutsis lorsque les persécutions ont commencé. On la guette et, au premier signe - un nuage de poussière au loin, des buissons qui bruissent – on s’enfuit et on se cache.
« Le malheur d’être belle », c’est l’histoire d’Héléna. Jeune femme très belle… mais tutsi. Son avantage physique va décider de son destin. De maîtresse adorée, elle devient prostituée, répudiée et contrainte à l’exil.
Enfin « Le deuil » est la seule nouvelle qui aborde directement le génocide et le thème des survivants. Comment continuer à vivre alors que tous nos proches ont été tués ? Comment « faire son deuil », leur dire au revoir, alors qu’il n’y a pas de corps à pleurer, alors que l’on est exilé dans un autre pays ?
Dans ce livre, Scholastique Mukasonga, tout en sobriété et poésie, nous conte son malheur et celui des siens.
" Maman, je n’étais pas là pour recouvrir ton
corps et je n’ai plus que des mots — des mots
d’une langue que tu ne comprenais pas — pour
accomplir ce que tu avais demandé. Et je suis
seule avec mes pauvres mots et mes phrases, sur
la page du cahier, tissent et retissent le linceul de
ton corps absent."
Ces mots sont pour Stefania, la mère de Scholastique Mukasonga disparue avec toute sa famille lors du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Scholastique vivait en France depuis peu après avoir fui au Burundi. Il lui aura fallu attendre 2004 pour avoir le courage de revenir au Rwanda , pour retourner dans le Bugesera cette région inhospitalière où les Tutsi avaient été "déplacés"....
Sonnée, je suis sonnée. Des pages inoubliables où l'amour d'une fille pour sa Mère, la Mère nourricière, la femme aux pieds nus , transcende chaque mot en cri d'amour. Ce roman inoubliable a été récompensé en 2008 par le Prix Seligmann contre le racisme et l'intolérance.
corps et je n’ai plus que des mots — des mots
d’une langue que tu ne comprenais pas — pour
accomplir ce que tu avais demandé. Et je suis
seule avec mes pauvres mots et mes phrases, sur
la page du cahier, tissent et retissent le linceul de
ton corps absent."
Ces mots sont pour Stefania, la mère de Scholastique Mukasonga disparue avec toute sa famille lors du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Scholastique vivait en France depuis peu après avoir fui au Burundi. Il lui aura fallu attendre 2004 pour avoir le courage de revenir au Rwanda , pour retourner dans le Bugesera cette région inhospitalière où les Tutsi avaient été "déplacés"....
Sonnée, je suis sonnée. Des pages inoubliables où l'amour d'une fille pour sa Mère, la Mère nourricière, la femme aux pieds nus , transcende chaque mot en cri d'amour. Ce roman inoubliable a été récompensé en 2008 par le Prix Seligmann contre le racisme et l'intolérance.
Un roman féministe
Publié en 2008 j'ai découvert ce roman récemment au hasard d'un échange avec l'autrice elle-même à l'occasion du prix Simone de Beauvoir qu'elle a reçu en 2021. C'est peu de dire que ce récit m'a touchée. C'est peut-être de tous les livres que j'ai lus de Scholatique Mukasonga, celui que je préfère. Livre "linceul", livre tombeau consacré à la mère, il est aussi le livre des femmes : mères, sœurs, tantes, voisines, amies. Hommage à la mère, Stefania, femme forte, mère protectrice, nourricière, curatrice, libre dans sa condition de déportée. Mais au delà de ça, c'est un livre de la féminité qui s'interroge sur l'image de la femme et sur sa représentation. C'est aussi un récit qui brise les tabous de la sexualité féminine, évoquant coutumes et mariages (réussis et manqués). Récit aussi de la terrible condition des femmes par temps de guerre, récit du viol, arme de destruction massive parce qu'il broie l'individu et démembre la structure sociale, met à mal la collectivité. Comment ne pas penser aux prix Nobel Denis Mukwege
dans ces pages qui évoquent le viol ? "les viols. Personne ne voulait en parler. Personne ne pouvait en parler. Il n'y avait rien dans la coutume qui permettait de faire face à cette catastrophe qui bouleversait les familles" . Pour lire des extraits cliquez sur mon adresse web.
Lien : https://twitter.com/claire_t..
Publié en 2008 j'ai découvert ce roman récemment au hasard d'un échange avec l'autrice elle-même à l'occasion du prix Simone de Beauvoir qu'elle a reçu en 2021. C'est peu de dire que ce récit m'a touchée. C'est peut-être de tous les livres que j'ai lus de Scholatique Mukasonga, celui que je préfère. Livre "linceul", livre tombeau consacré à la mère, il est aussi le livre des femmes : mères, sœurs, tantes, voisines, amies. Hommage à la mère, Stefania, femme forte, mère protectrice, nourricière, curatrice, libre dans sa condition de déportée. Mais au delà de ça, c'est un livre de la féminité qui s'interroge sur l'image de la femme et sur sa représentation. C'est aussi un récit qui brise les tabous de la sexualité féminine, évoquant coutumes et mariages (réussis et manqués). Récit aussi de la terrible condition des femmes par temps de guerre, récit du viol, arme de destruction massive parce qu'il broie l'individu et démembre la structure sociale, met à mal la collectivité. Comment ne pas penser aux prix Nobel Denis Mukwege
dans ces pages qui évoquent le viol ? "les viols. Personne ne voulait en parler. Personne ne pouvait en parler. Il n'y avait rien dans la coutume qui permettait de faire face à cette catastrophe qui bouleversait les familles" . Pour lire des extraits cliquez sur mon adresse web.
Lien : https://twitter.com/claire_t..
Cela commence par une bienveillante injonction :"Personne ne doit voir mon corps"; puis une mise en garde : "Personne ne doit voir le cadavre d'une mère sinon cela vous poursuivra"; et enfin un conseil : "Il vous faudra aussi quelqu'un pour recouvrir votre corps".
Mais comment faire dans un Rwanda en proie aux maladies, à la famine et aux massacres ? Quelle place pour la filiation, quelles mécanismes de transmission au sein d'une famille, dans les établissements scolaires ou même au quotidien quand le danger rôde ?
Ce récit qui aurait pu être sombre se révèle riche de vie à travers des anecdotes et souvenirs narrés par des femmes déterminées.
Mais comment faire dans un Rwanda en proie aux maladies, à la famine et aux massacres ? Quelle place pour la filiation, quelles mécanismes de transmission au sein d'une famille, dans les établissements scolaires ou même au quotidien quand le danger rôde ?
Ce récit qui aurait pu être sombre se révèle riche de vie à travers des anecdotes et souvenirs narrés par des femmes déterminées.
Vingt-sept membres de la famille de l'écrivaine ont été massacrés pendant le génocide rwandais. Stefania, sa mère tutsie, était des victimes et ce livre rend un hommage magnifique à cette femme africaine contrainte à l'exil avec sa famille à Nyamata, sous la perpétuelle menace des soldats hutus du camp Gako. Nous sommes dans la région inhospitalière du Bugesera, là où sont déportés les tutsis du nord depuis les massacres ethniques qui les ravagèrent en vagues successives depuis 1959.
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu’il avait droit au premier des droits de l’homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
"Ma mère n'avait qu'une idée en tête, le même projet pour chaque jour, qu'une seule raison de survivre : sauver ses enfants. Pour cela elle élaborait toutes les stratégies, expérimentait toutes les tactiques."
Le livre raconte comment Stefania préserva et éleva ses enfants, cultiva la terre, fit des projets pour eux comme le font les mères rwandaises, selon leurs coutumes, selon leur pauvreté, attentives aux présages du ciel, des corbeaux, des plantes et des eaux du lac. La description du mode de vie et des codes de cette famille est une source d'information sociologique et ethnographique étonnante. Malgré l'épée de Damoclès — un piétinement de bottes sur la piste, une fusillade dans la nuit, l'arrestation d'un voisin —, subsiste une volonté de vivre dignement comme elle l'a fait autrefois sur les pentes des collines, sous le couvert des bananiers. L'époque racontée doit remonter aux années septante, un peu plus tôt peut-être, alors que Scholastique était adolescente (l'auteure est née en 1956).
Stefania n'aime pas l'habitation de torchis et de tôle, "vide d'Esprits", où logent les déportés. Elle veut sa case, l'inzu, la maison de paille, roseau et papyrus, tressée comme une vannerie. L'eau pour le poisson, l'air pour les hommes, l'inzu à Stefania, une maison où elle pourra vivre une vraie vie de famille, où on entend moudre les grains de sorgho sur la pierre, le clapotis des cruches où fermente la bière, le rire des enfants et le bavardage insouciant des jeunes filles. Elle connut le grand bonheur de voir son fils fonder une famille de neuf enfants, dont sept garçons. La famille se perpétuerait donc si quelques-uns survivaient. Elle se trompait.
"Ma raison de vivre est de représenter ce peuple massacré comme des "cafards", de redonner une identité à ces personnes, de faire admettre qu’il avait droit au premier des droits de l’homme, le droit de vivre." Voilà comment s'exprime Scholastique dans une interview à La Libre Belgique.
Le génocide n'est pas l'objet du livre mais il est partout présent. Dès les premières pages, des responsables sont désignés, à savoir les autorités hutu, placées par les Belges et l'Église à la tête du Rwanda nouvellement indépendant.
Plus loin, il est question d'histoires qu'on racontait qui n'étaient pas celles des tutsis: "Les Blancs avaient déchaîné sur les Tutsis les monstres insatiables de leurs mauvais rêves. [...]. Ils prétendaient mieux savoir que nous qui nous étions, d'où nous venions." L'auteur veut parler du mythe hamitique construit par l'explorateur John Hanning Speke : le peuple tutsi serait une minorité raciale supérieure aux Hutus car il n'est pas originaire du Rwanda mais d'Éthiopie. Ce mythe a été utilisé par les extrémistes hutus pour mobiliser les citoyens ordinaires contre les tutsis «envahisseurs» lors du génocide de 1994.
Le journaliste Jean Hatzfeld dans Une saison de machettes (2003) a interrogé des génocidaires de la région rwandaise. Il explique dans un entretien (Afrik.com) pourquoi il a voulu s'adresser aux tueurs et ce qu'il en a retenu.
On constate que derrière ce livre simple, authentique, d'une grande sobriété, subsistent des blessures irréparables et l'immense question des responsabilités, à laquelle ce modeste billet ne saurait répondre.
La femme aux pieds nus a obtenu le Prix Seligmann.
Lien : http://www.christianwery.be/..
Un livre d'amour né dans la violence.
La femme aux pieds nus n'est autre que Stéfania, la mère de l'auteur, massacrée comme tant d'autres lors du génocide rwandais de 1994. Le génocide n'est pas le thème central de ce livre, mais il est sous-jacent à chaque page, la présence des militaires et des jeunes hutus est menaçante et fait vivre la famille dans une tension constante.
Stéfania et les siens avaient déjà été chassés de leurs terres et déplacés dans la région du Bugasera, terre aride et inhospitalière où les mères s'efforcent de maintenir les traditions avec dignité et courage. C'est ce que décrit l'auteur en évoquant son enfance parmi ses nombreux frères et soeurs. En une dizaine de chapitres, elle dresse un portrait de la vie quotidienne, saison après saison, la récolte du sorgho, la construction d'une case traditionnelle "l'inzu". De nombreuses traditions régissent la conduite à tenir, que ce soit sur la beauté des femmes, la manière de se soigner et de lire les présages, ou les codes à respecter entre voisines.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
Stéfania et les siens avaient déjà été chassés de leurs terres et déplacés dans la région du Bugasera, terre aride et inhospitalière où les mères s'efforcent de maintenir les traditions avec dignité et courage. C'est ce que décrit l'auteur en évoquant son enfance parmi ses nombreux frères et soeurs. En une dizaine de chapitres, elle dresse un portrait de la vie quotidienne, saison après saison, la récolte du sorgho, la construction d'une case traditionnelle "l'inzu". De nombreuses traditions régissent la conduite à tenir, que ce soit sur la beauté des femmes, la manière de se soigner et de lire les présages, ou les codes à respecter entre voisines.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
A l'occasion d'une rencontre littéraire à Caen, Scholastique a dédicacé ce livre à mon épouse et à moi-même. Je l'ai lu bien sûr ; l'on percevait déjà les tout premiers signes de la catastrophe qui submergerait plus tard le Rwanda, à travers le récit de son enfance, et l'hommage qu'elle rend à sa mère.
Je retrouve ce livre perdu dans mes rayonnages consacrés aux écrits du monde Noir à l'occasion d'une mise en ordre générale de ma bibliothèque. C'est un beau livre. Les livres qui rendent hommage aux Mères sont toujours beaux... Pat
Je retrouve ce livre perdu dans mes rayonnages consacrés aux écrits du monde Noir à l'occasion d'une mise en ordre générale de ma bibliothèque. C'est un beau livre. Les livres qui rendent hommage aux Mères sont toujours beaux... Pat
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Scholastique Mukasonga
Lecteurs de Scholastique Mukasonga (1439)Voir plus
Quiz
Voir plus
La bonne adresse
Rue des boutiques... (Patrick Modiano)
occultes
inconnues
obscures
8 questions
181 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur181 lecteurs ont répondu