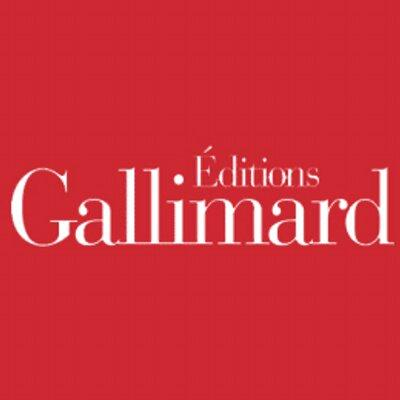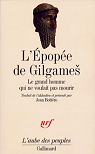Critiques de Éditions Gallimard (121)
Gilgamesh est un récit épique de la Mésopotamie antique, en 2650 avant Jésus Christ. Il a été écrit de façon simplifiée par Pierre-Marie Beaude, pour les jeunes.
Le héros s’appelle Gilgamesh ; c’est le roi d’Ourouk en Mésopotamie. Il est brutal, autoritaire et violent avec son peuple. Celui-ci est mécontent et prie les dieux pour qu’ils lui donnent une leçon. Ils décident donc de créer un rival pour Gilgamesh. Il s’appelle Enkidou et c’est un homme sauvage.
Les deux se battent. Enkidou gagne mais, ils deviennent amis. Ensemble, ils partent à l’aventure. Gilgamesh propose à son ami d’aller défier Houmbaba, le gardien de la forêt des Cèdres qu’ils vont vaincre.
Ils abattent alors de beaux cèdres, construisent un radeau pour les emmener dans la ville de Nippour, en naviguant sur l’Euphrate. La déesse de l’amour Ishtar est amoureuse de Gilgamesh et veut l’épouser. Il refuse car elle a déjà tué des maris. Pour se venger, elle demande au dieu Anu de lui donner son taureau du ciel pour tuer Gilgamesh. Le taureau sème la terreur dans la ville mais Gilgamesh et Enkidou arrivent à le tuer. Ishtar se fâche et Anu provoque la mort de Enkidou.
Gilgamesh part alors à la recherche de l’immortalité que peut lui donner Outanapishtî, le seul immortel. Après avoir franchi beaucoup d’obstacles, il rencontre ce personnage mais il ne pourra pas devenir immortel car il ne réussit pas l’épreuve. Par contre, Outanapishtî lui livre le secret de la fleur qui rajeunit mais, un serpent lui vole la fleur pendant qu’il se baigne. Il retourne à Ourouk et gouverne son pays avec sagesse et gentillesse.
Gilgamesh a beaucoup de défauts, arrogant, insolent (je suis le roi, je fais le roi). Il abuse de sa force avec les femmes et même avec les hommes très forts. Il est dédaigneux, bagarreur. Ce comportement change lorsqu’il est vaincu par Enkidou. Il devient même heureux.
La mort de son ami le rend très malheureux et triste. Lorsqu’il part à la recherche de l’immortalité, il commence à ressentir la peur. Il pleure même. Outanapishtî le trouve courageux et persévérant lorsqu’il traverse la mer dangereuse pour le rejoindre. Il n’est pas sympathique au début, mais le devient peu à peu, en partie grâce à son ami. Son changement total vis-à-vis de son peuple le rend attachant et j’en arrive à l’admirer pour son courage et sa gentillesse.
Thomas S. - 5ème2
Le héros s’appelle Gilgamesh ; c’est le roi d’Ourouk en Mésopotamie. Il est brutal, autoritaire et violent avec son peuple. Celui-ci est mécontent et prie les dieux pour qu’ils lui donnent une leçon. Ils décident donc de créer un rival pour Gilgamesh. Il s’appelle Enkidou et c’est un homme sauvage.
Les deux se battent. Enkidou gagne mais, ils deviennent amis. Ensemble, ils partent à l’aventure. Gilgamesh propose à son ami d’aller défier Houmbaba, le gardien de la forêt des Cèdres qu’ils vont vaincre.
Ils abattent alors de beaux cèdres, construisent un radeau pour les emmener dans la ville de Nippour, en naviguant sur l’Euphrate. La déesse de l’amour Ishtar est amoureuse de Gilgamesh et veut l’épouser. Il refuse car elle a déjà tué des maris. Pour se venger, elle demande au dieu Anu de lui donner son taureau du ciel pour tuer Gilgamesh. Le taureau sème la terreur dans la ville mais Gilgamesh et Enkidou arrivent à le tuer. Ishtar se fâche et Anu provoque la mort de Enkidou.
Gilgamesh part alors à la recherche de l’immortalité que peut lui donner Outanapishtî, le seul immortel. Après avoir franchi beaucoup d’obstacles, il rencontre ce personnage mais il ne pourra pas devenir immortel car il ne réussit pas l’épreuve. Par contre, Outanapishtî lui livre le secret de la fleur qui rajeunit mais, un serpent lui vole la fleur pendant qu’il se baigne. Il retourne à Ourouk et gouverne son pays avec sagesse et gentillesse.
Gilgamesh a beaucoup de défauts, arrogant, insolent (je suis le roi, je fais le roi). Il abuse de sa force avec les femmes et même avec les hommes très forts. Il est dédaigneux, bagarreur. Ce comportement change lorsqu’il est vaincu par Enkidou. Il devient même heureux.
La mort de son ami le rend très malheureux et triste. Lorsqu’il part à la recherche de l’immortalité, il commence à ressentir la peur. Il pleure même. Outanapishtî le trouve courageux et persévérant lorsqu’il traverse la mer dangereuse pour le rejoindre. Il n’est pas sympathique au début, mais le devient peu à peu, en partie grâce à son ami. Son changement total vis-à-vis de son peuple le rend attachant et j’en arrive à l’admirer pour son courage et sa gentillesse.
Thomas S. - 5ème2
Je me suis procuré cette version française du texte et je l'ai trouvée bien écrite et belle à lire. L'assyriologie, étude des anciennes langues et littératures de Mésopotamie, est si majoritairement anglophone qu'on ne pense pas tout de suite à chercher dans le peu d'ouvrages français disponibles. Les textes de cet ensemble consacrés à Gilgamesh peuvent s'étudier avec de bonnes grammaires, de bonnes versions aident à corriger les erreurs du lecteur, de bonnes études l'éclairent, mais tout est en anglais !
Est-il légitime de parler d'épopée ici ? Ce mot, postérieur au cycle de Gilgamesh, est-il pertinent pour le désigner ? Même s'il n'y a pas de guerre à proprement parler, Enkidu et Gilgamesh accomplissent des exploits surhumains, dans la forêt des Cèdres ou contre le Taureau Céleste : on peut donc qualifier l'ouvrage d'épopée, sans les effets de masse, ni les tensions entre individu et société auxquels Homère nous a habitués. La quête d'immortalité de Gilgamesh privé de son ami est épique dans la mesure où là encore, il accomplit de grands exploits, non guerriers et martiaux, mais dans sa lutte contre la nature et les obstacles matériels (les Hommes-Scorpions, les Montagnes des Ténèbres, la Mer Périlleuse). Sa quête métaphysique, en revanche, nous éloigne de la tradition épique postérieure, puisque Achille, Hector ou Ulysse ne se rebellent jamais contre le destin mortel des hommes mais s'y soumettent sans discussion. La motivation du héros, la vie éternelle, a tout pour nous dépayser et nous éloigner de nos cadres occidentaux.
Enfin, autre différence notable, le style. Il est difficile d'imaginer la scansion et les sonorités des vers akkadiens, et c'est totalement impossible pour la poésie sumérienne. La phrase, cependant, est simple, répétitive souvent, manifestement écrite pour la déclamation orale, mais sans aucun des ornements rhétoriques et sans le souci raffiné du style de l'épopée grecque : Eric Auerbach, dans son livre Mimesis, soulignait la rudesse des récits bibliques, qui choquait les amateurs gréco-latins de littérature. Il en va un peu de même ici : le parti-pris de simplicité pourrait faire penser, dans une certaine mesure, au roman médiéval en vers, où la plus grande clarté d'expression est au service du récit.
Est-il légitime de parler d'épopée ici ? Ce mot, postérieur au cycle de Gilgamesh, est-il pertinent pour le désigner ? Même s'il n'y a pas de guerre à proprement parler, Enkidu et Gilgamesh accomplissent des exploits surhumains, dans la forêt des Cèdres ou contre le Taureau Céleste : on peut donc qualifier l'ouvrage d'épopée, sans les effets de masse, ni les tensions entre individu et société auxquels Homère nous a habitués. La quête d'immortalité de Gilgamesh privé de son ami est épique dans la mesure où là encore, il accomplit de grands exploits, non guerriers et martiaux, mais dans sa lutte contre la nature et les obstacles matériels (les Hommes-Scorpions, les Montagnes des Ténèbres, la Mer Périlleuse). Sa quête métaphysique, en revanche, nous éloigne de la tradition épique postérieure, puisque Achille, Hector ou Ulysse ne se rebellent jamais contre le destin mortel des hommes mais s'y soumettent sans discussion. La motivation du héros, la vie éternelle, a tout pour nous dépayser et nous éloigner de nos cadres occidentaux.
Enfin, autre différence notable, le style. Il est difficile d'imaginer la scansion et les sonorités des vers akkadiens, et c'est totalement impossible pour la poésie sumérienne. La phrase, cependant, est simple, répétitive souvent, manifestement écrite pour la déclamation orale, mais sans aucun des ornements rhétoriques et sans le souci raffiné du style de l'épopée grecque : Eric Auerbach, dans son livre Mimesis, soulignait la rudesse des récits bibliques, qui choquait les amateurs gréco-latins de littérature. Il en va un peu de même ici : le parti-pris de simplicité pourrait faire penser, dans une certaine mesure, au roman médiéval en vers, où la plus grande clarté d'expression est au service du récit.
Monument littéraire parmi les plus anciens, très antérieur à la Bible (mais avec déjà du Déluge dedans), the mother of all!
Bottéro la présente de façon plus académique que moi. Normal, il était universitaire, très sérieux, tout ça tout ça. Cette version, il l’a voulue rigoureuse – d’où une certaine aridité du texte – et adressée aux non-spécialistes – d’où une grande pédagogie.
Le bouquin s’ouvre sur une soixantaine de pages d’intro. Prononciation, carte, chronologie, cosmologie babylonienne, contexte historique, état des sources, présentation de l’œuvre et de son héros… Balayage concis, pointu et clair qui permettra aux néophytes en histoire mésopotamienne de ne pas s’aventurer dans le texte les mains vides.
Les 230 pages restantes sont consacrées à l’épopée et à la quête d’immortalité de Gilgamesh. Aucune idée de que vaut la traduction en elle-même, mes connaissances en clous sont de l’ordre du zéro, autant en bricolage qu’en cunéiforme. M’enfin Bottéro n’a pas une réputation de bras cassé, on peut lui faire confiance. Sa version s’agrémente de nombreuses notes expliquant les difficultés et choix de traduction. Les trous dans le texte, mots manquants slash illisibles slash effacés, sont restitués. En soi, c’est une bonne chose, puisqu’il s’agit d’un travail scientifique. Le texte, rien que le texte. Cela dit, on touche quand même aux limites de l’ouvrage adressé aux non-spécialistes : on ne parle quand même pas d’un bouquin grand public. Si tu veux lire une bonne histoire de fantasy sans trous dans le texte, tourne-toi vers une version romancée. Par exemple Gilgamesh, roi d’Ourouk de Robert Silverberg.
Quelle que soit la version retenue, je conseille aux amateurs de fantasy d’y jeter un œil. Une quête, des épreuves, des combats, des monstres, un compagnon d’aventure… L’épopée de Gilgamesh, c’est le super ancêtre de l’heroic fantasy (Conan, Fafhrd et le Souricier Gris, Elric et Tristelune…).
Lien : https://unkapart.fr/l-epopee..
Bottéro la présente de façon plus académique que moi. Normal, il était universitaire, très sérieux, tout ça tout ça. Cette version, il l’a voulue rigoureuse – d’où une certaine aridité du texte – et adressée aux non-spécialistes – d’où une grande pédagogie.
Le bouquin s’ouvre sur une soixantaine de pages d’intro. Prononciation, carte, chronologie, cosmologie babylonienne, contexte historique, état des sources, présentation de l’œuvre et de son héros… Balayage concis, pointu et clair qui permettra aux néophytes en histoire mésopotamienne de ne pas s’aventurer dans le texte les mains vides.
Les 230 pages restantes sont consacrées à l’épopée et à la quête d’immortalité de Gilgamesh. Aucune idée de que vaut la traduction en elle-même, mes connaissances en clous sont de l’ordre du zéro, autant en bricolage qu’en cunéiforme. M’enfin Bottéro n’a pas une réputation de bras cassé, on peut lui faire confiance. Sa version s’agrémente de nombreuses notes expliquant les difficultés et choix de traduction. Les trous dans le texte, mots manquants slash illisibles slash effacés, sont restitués. En soi, c’est une bonne chose, puisqu’il s’agit d’un travail scientifique. Le texte, rien que le texte. Cela dit, on touche quand même aux limites de l’ouvrage adressé aux non-spécialistes : on ne parle quand même pas d’un bouquin grand public. Si tu veux lire une bonne histoire de fantasy sans trous dans le texte, tourne-toi vers une version romancée. Par exemple Gilgamesh, roi d’Ourouk de Robert Silverberg.
Quelle que soit la version retenue, je conseille aux amateurs de fantasy d’y jeter un œil. Une quête, des épreuves, des combats, des monstres, un compagnon d’aventure… L’épopée de Gilgamesh, c’est le super ancêtre de l’heroic fantasy (Conan, Fafhrd et le Souricier Gris, Elric et Tristelune…).
Lien : https://unkapart.fr/l-epopee..
Un livre particulier puisqu’il s’agit des traductions des tablettes cunéiformes retraçant cette première épopée.
L’épopée de Gilgamesh (ou Gilgames) est la première épopée écrite et remonte au temps de la Mésopotamie. Transmises par de nombreuses tablettes d’argile, de culture et de peuple, nous la connaissons grâce à ses supports découverts dans divers sites archéologiques.
Jean Bottero, spécialiste de la Mésopotamie, nous propose donc ici des traductions des tablettes évoquant cette épopée. Plusieurs versions sont présentées, plus ou moins complètes, plus ou moins anciennes, issues de diverses populations.
L’introduction de cette épopée est vraiment très bien faite. Elle permettra au néophyte de comprendre la grande culture de la Mésopotamie ancienne ; l’auteur fait ici preuve d’un très bon travail de vulgarisation : pointu, mais tout en restant accessible. Il nous présente donc le contexte d’écriture de cette épopée, ces différentes versions avec ses variantes, ainsi que les thèmes aborder par ces histoires (la conception du monde mésopotamien n’est pas tout le même que le nôtre).
Pour ce qui est des textes (traductions) en eux-mêmes, difficile de m’exprimer. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en face d’un texte littéraire classique puis que ce sont des traductions de tablettes d’argiles : certains vers sont manquants (ce qui ampute parfois le récit), des mots ne sont pas déchiffrables (car abimés et illisibles). Nous nous retrouvons devant des textes versifiés très lacunaires.
D’une certaine façon, ça se lit bien : les vers sont courts et ne présente pas trop de complexité. Ceci dit, si la lecture est assez rapide, elle n’en demeure pas moins très évasive et parfois compliquée dans la compréhension du « fond » du récit. En effet, malgré les très nombreuses annotations, il est parfois compliqué de saisir les subtilités de ce texte.
Mais que narre cette épopée ? Elle raconte les aventures de Gilgames, un roi d’essence divine (si l’on peut s’exprimer ainsi, les Mésopotamiens n’ont pas de terme pour désigner des demi-dieux, les héros), qui avec son ami Enkidu (un être sauvage) affronte plusieurs épreuves, avant de partir à la découverte de la-vie-sans-fin après le décès de son ami.
C’est très résumé, mais c’est les grandes trames de ce récit. On y trouve d’ailleurs la première allusion au Déluge.
Personnellement, j’ai apprécié la lecture de ce livre, car je me suis retrouvé au plus près des textes anciens et cela m’a permis de découvrir les bases mêmes de cette épopée. Mais je ne pense pas que cet ouvrage convienne pour quelqu’un qui souhaiterait un texte plus « littéraire ». Même moi, je pense maintenant me tourner vers un livre plus « romancer » afin de peut-être mieux saisir l’essence même de ce récit.
Il est donc difficile pour moi d’en dire plus. Le livre est vraiment très bien fait avec une très bonne introduction, de très nombreuses annotations et remarques. Ceci dit, ce n’est pas un « roman ».
Il ne convient donc pas à tous les publics.
L’épopée de Gilgamesh (ou Gilgames) est la première épopée écrite et remonte au temps de la Mésopotamie. Transmises par de nombreuses tablettes d’argile, de culture et de peuple, nous la connaissons grâce à ses supports découverts dans divers sites archéologiques.
Jean Bottero, spécialiste de la Mésopotamie, nous propose donc ici des traductions des tablettes évoquant cette épopée. Plusieurs versions sont présentées, plus ou moins complètes, plus ou moins anciennes, issues de diverses populations.
L’introduction de cette épopée est vraiment très bien faite. Elle permettra au néophyte de comprendre la grande culture de la Mésopotamie ancienne ; l’auteur fait ici preuve d’un très bon travail de vulgarisation : pointu, mais tout en restant accessible. Il nous présente donc le contexte d’écriture de cette épopée, ces différentes versions avec ses variantes, ainsi que les thèmes aborder par ces histoires (la conception du monde mésopotamien n’est pas tout le même que le nôtre).
Pour ce qui est des textes (traductions) en eux-mêmes, difficile de m’exprimer. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en face d’un texte littéraire classique puis que ce sont des traductions de tablettes d’argiles : certains vers sont manquants (ce qui ampute parfois le récit), des mots ne sont pas déchiffrables (car abimés et illisibles). Nous nous retrouvons devant des textes versifiés très lacunaires.
D’une certaine façon, ça se lit bien : les vers sont courts et ne présente pas trop de complexité. Ceci dit, si la lecture est assez rapide, elle n’en demeure pas moins très évasive et parfois compliquée dans la compréhension du « fond » du récit. En effet, malgré les très nombreuses annotations, il est parfois compliqué de saisir les subtilités de ce texte.
Mais que narre cette épopée ? Elle raconte les aventures de Gilgames, un roi d’essence divine (si l’on peut s’exprimer ainsi, les Mésopotamiens n’ont pas de terme pour désigner des demi-dieux, les héros), qui avec son ami Enkidu (un être sauvage) affronte plusieurs épreuves, avant de partir à la découverte de la-vie-sans-fin après le décès de son ami.
C’est très résumé, mais c’est les grandes trames de ce récit. On y trouve d’ailleurs la première allusion au Déluge.
Personnellement, j’ai apprécié la lecture de ce livre, car je me suis retrouvé au plus près des textes anciens et cela m’a permis de découvrir les bases mêmes de cette épopée. Mais je ne pense pas que cet ouvrage convienne pour quelqu’un qui souhaiterait un texte plus « littéraire ». Même moi, je pense maintenant me tourner vers un livre plus « romancer » afin de peut-être mieux saisir l’essence même de ce récit.
Il est donc difficile pour moi d’en dire plus. Le livre est vraiment très bien fait avec une très bonne introduction, de très nombreuses annotations et remarques. Ceci dit, ce n’est pas un « roman ».
Il ne convient donc pas à tous les publics.
Par ce texte partiel et multiple dans ses versions, près de trente cinq siècles nous contemplent. Ecrite en sumérien et surtout en akkadien, l'épopée nous présente les aventures de Gilgames et d'Enkidu , entre récits mythiques et questions philosophiques ; toutes les principales questions que peut se poser l'être humain sont présentes : la quête d'identité et d'immortalité, la force de l'amitié, le rapport nature / civilisation, la transmission.
Nous sommes accompagnés dans cette lecture par une introduction brillantes et des notes précises de Jean Bottero.
Un indispensable de la littérature qui nous permet de relativiser beaucoup de choses et aborder avec sérénité la création littéraire actuelle...
Nous sommes accompagnés dans cette lecture par une introduction brillantes et des notes précises de Jean Bottero.
Un indispensable de la littérature qui nous permet de relativiser beaucoup de choses et aborder avec sérénité la création littéraire actuelle...
Une grande rencontre que ce récit mis par écrit au 3ème millénaire, très antérieur à l'Iliade, rencontre conseillée par Henri l’Oiseleur, qui pratique l’akkadien et que je remercie.
Le narrateur commence par la fin : l’éloge d’un héros « Surdoué de sagesse », « Retour de son lointain voyage, Exténué mais apaisé ». De là il développe la légende selon le fil du temps. Gilgames, roi d'Uruk, se conduit comme un « buffle arrogant », parade sur les murailles de la ville, fait trembler les gaillards et déflore leurs promises. Les gaillards se plaignent à Anu, chef des dieux, qui commande à Aruru-la-grande de créer un rival à Gilgames : « S’étant lavé les mains, Elle prit un lopin d’argile Et le déposa en la steppe : Et c’est là dans la steppe, Qu’elle forma Enkidu-le-preux […] Abondamment velu Par tout le corps » (p 69). Enkidu, l'homme sauvage, détruit les pièges du chasseur, l'émissaire de la civilisation. Le chasseur n’ose affronter le géant et, sur le conseil de son père, recrute en ville la courtisane Lajoyeuse. « En compagnie de sa harde, [Enkidu] s’abreuvait à l’aiguade, Et se régalait d’eau En compagnie des bêtes. Lajoyeuse le vit, cet être-humain sauvage, Ce redoutable gaillard D’en pleine steppe : Le voilà lui dit le chasseur. Dénude-toi, Lajoyeuse, Découvre-toi le sexe Pour qu’il y prenne ta volupté ! […] Une fois soûlé Du plaisir qu’elle lui avait donné, Il se disposa À rejoindre sa harde. Mais, à la vue d’Enkidu, Gazelles de s’enfuir, Et les bêtes sauvages De s’écarter de lui » (p 74-5). Alors Enkidu change de monde : « Il avait mûri : il était devenu intelligent ! Aussi revint-il s’asseoir Aux pieds de la courtisane. Les yeux rivés sur son visage, Il comprenait tout ce qu’elle lui disait. La courtisane S’adressa donc à lui, Enkidu : Tu es beau, Enkidu ! Tu ressembles à un dieu ! Pourquoi galoper en la steppe Avec les bêtes ? » (p 76). Dans ce mythe généreux, antérieur à la Bible, la tentatrice initie l’homme au plaisir, mais aussi au savoir. La courtisane civilise Enkidu, partage avec lui ses vêtements et l’emmène à Uruk.
Enkidu et Gilgames se rencontrent et se battent, mais aucun ne domine. Se reconnaissant égaux, ils deviennent inséparables. Ils font ensemble des voyages et des travaux fabuleux : abattre Humbaba le Gardien de la Forêt des Cèdres, tuer le Taureau-Céleste. Leur succès, leur complicité, leur insolence vis à vis d’Istar-la-princesse déplaît au conseil des dieux. Alors Enkidu agonise pendant douze jours. Se croyant trahi par les hommes, il maudit le chasseur, la courtisane Lajoyeuse et la porte colossale qu’il a offerte à la ville. Puis il revient sur la malédiction de Lajoyeuse et meurt. Gilgames le tient sur ses genoux « jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez » et lui fait une longue déploration : « Pleurez-le, ours, hyènes, panthères, Tigres, cerfs et guépards, Lions, buffles, daims, bouquetins, Grosses et petites bêtes sauvages ! […] Pleurez le, ô gaillards d’Uruk-les-clos, Qui nous avez vu combattre Et tuer le Taureau-géant » (p 149). « Lorsque brilla Le point du jour, Gilgames fit publier Un appel dans tout le pays : Fondeurs de métaux ! Lapidaires ! Travailleurs du métal ! Orfèvres ! Joaillers ! Faites à mon ami sa statue ! » (p 152) « Lorsque brilla le point du jour, Gilgames ouvrit la porte du Palais, Produisit un grand plateau En bois d’elammaku, Remplit de miel une jatte rouge, Remplit de beurre une jatte bleu, Et le tout dûment apprêté, Le présenta à Samas » (le Dieu du soleil) (p 154).
Les funérailles achevées, Gilgames comprend que la finitude d'Enkidu, c’est la sienne. Il se révolte et part solitaire à la recherche de la vie-sans-fin, dans une nouvelle séquence d'aventures et de personnages héroïques : la Tavernière, les hommes-scorpions, le Nocher, enfin Utanapisti, l'homme qui a fait survivre l’humanité au déluge, ce désastre qui a épouvanté jusqu’aux dieux : « Prenant la fuite, Ils grimpèrent jusqu’au plus haut du ciel, Où, tels des chiens, ils demeuraient pelotonnés Et accroupis au sol. La Déesse criait Comme une parturiente » (p 191).
La vie-sans-fin lui est interdite et Gilgames se lamente : « Si l’on pouvait Fermer la porte à l’angoisse ! Si l’on pouvait l’obturer Au bitume, à l’asphalte ! Mais le Destin ne m’a pas laissé m’amuser : Il m’a déchiré, Malheureux que je suis ! ». Utanapisti le tance : « Pourquoi donc, Gilgames, Exagérer ton désespoir ? Toi que les dieux ont fait De substance divino-humaine, Qu’ils ont traité comme ton père et ta mère, Serais-tu, Gilgames, Comparable à un fou ? A un fou, l’on peut faire passer de la lie Pour du beurre. […] Penses-y, Gilgames » (p 179-80). Alors Gilgames retourne à Uruk : « Les Sept Sages en personne N’en ont-ils pas jeté les fondations ? ».
J’ai lu la version ninivite par les yeux de Bottero : « Une mise en français, suffisamment à jour, mais adressée premièrement aux autres, aux non-professionnels, auxquels les spécialistes farouches, enfermés dans leur impénétrable casemate, ne rendent pas souvent visite » (p 7). Sur la forme, Bottero prévient de l’amputation du « manuscrit » (c'est vrai, les cunéiformes sont manuscrits sur des tablettes), des difficultés de la transcription, de l’arbitraire de choix souvent nécessaires. Son style est rugueux dans le commentaire comme dans la traduction, ce qui convient à la puissance et à la franchise du mythe. En « lecteur ingénu », je vois dans ce temps et ce texte archaïques le temps et le texte des découvertes. L’homme y découvre la joie du corps, la peine de la mort, le respect des autres mortels, la sagesse et l’irrespect pour les dieux.
Le narrateur commence par la fin : l’éloge d’un héros « Surdoué de sagesse », « Retour de son lointain voyage, Exténué mais apaisé ». De là il développe la légende selon le fil du temps. Gilgames, roi d'Uruk, se conduit comme un « buffle arrogant », parade sur les murailles de la ville, fait trembler les gaillards et déflore leurs promises. Les gaillards se plaignent à Anu, chef des dieux, qui commande à Aruru-la-grande de créer un rival à Gilgames : « S’étant lavé les mains, Elle prit un lopin d’argile Et le déposa en la steppe : Et c’est là dans la steppe, Qu’elle forma Enkidu-le-preux […] Abondamment velu Par tout le corps » (p 69). Enkidu, l'homme sauvage, détruit les pièges du chasseur, l'émissaire de la civilisation. Le chasseur n’ose affronter le géant et, sur le conseil de son père, recrute en ville la courtisane Lajoyeuse. « En compagnie de sa harde, [Enkidu] s’abreuvait à l’aiguade, Et se régalait d’eau En compagnie des bêtes. Lajoyeuse le vit, cet être-humain sauvage, Ce redoutable gaillard D’en pleine steppe : Le voilà lui dit le chasseur. Dénude-toi, Lajoyeuse, Découvre-toi le sexe Pour qu’il y prenne ta volupté ! […] Une fois soûlé Du plaisir qu’elle lui avait donné, Il se disposa À rejoindre sa harde. Mais, à la vue d’Enkidu, Gazelles de s’enfuir, Et les bêtes sauvages De s’écarter de lui » (p 74-5). Alors Enkidu change de monde : « Il avait mûri : il était devenu intelligent ! Aussi revint-il s’asseoir Aux pieds de la courtisane. Les yeux rivés sur son visage, Il comprenait tout ce qu’elle lui disait. La courtisane S’adressa donc à lui, Enkidu : Tu es beau, Enkidu ! Tu ressembles à un dieu ! Pourquoi galoper en la steppe Avec les bêtes ? » (p 76). Dans ce mythe généreux, antérieur à la Bible, la tentatrice initie l’homme au plaisir, mais aussi au savoir. La courtisane civilise Enkidu, partage avec lui ses vêtements et l’emmène à Uruk.
Enkidu et Gilgames se rencontrent et se battent, mais aucun ne domine. Se reconnaissant égaux, ils deviennent inséparables. Ils font ensemble des voyages et des travaux fabuleux : abattre Humbaba le Gardien de la Forêt des Cèdres, tuer le Taureau-Céleste. Leur succès, leur complicité, leur insolence vis à vis d’Istar-la-princesse déplaît au conseil des dieux. Alors Enkidu agonise pendant douze jours. Se croyant trahi par les hommes, il maudit le chasseur, la courtisane Lajoyeuse et la porte colossale qu’il a offerte à la ville. Puis il revient sur la malédiction de Lajoyeuse et meurt. Gilgames le tient sur ses genoux « jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez » et lui fait une longue déploration : « Pleurez-le, ours, hyènes, panthères, Tigres, cerfs et guépards, Lions, buffles, daims, bouquetins, Grosses et petites bêtes sauvages ! […] Pleurez le, ô gaillards d’Uruk-les-clos, Qui nous avez vu combattre Et tuer le Taureau-géant » (p 149). « Lorsque brilla Le point du jour, Gilgames fit publier Un appel dans tout le pays : Fondeurs de métaux ! Lapidaires ! Travailleurs du métal ! Orfèvres ! Joaillers ! Faites à mon ami sa statue ! » (p 152) « Lorsque brilla le point du jour, Gilgames ouvrit la porte du Palais, Produisit un grand plateau En bois d’elammaku, Remplit de miel une jatte rouge, Remplit de beurre une jatte bleu, Et le tout dûment apprêté, Le présenta à Samas » (le Dieu du soleil) (p 154).
Les funérailles achevées, Gilgames comprend que la finitude d'Enkidu, c’est la sienne. Il se révolte et part solitaire à la recherche de la vie-sans-fin, dans une nouvelle séquence d'aventures et de personnages héroïques : la Tavernière, les hommes-scorpions, le Nocher, enfin Utanapisti, l'homme qui a fait survivre l’humanité au déluge, ce désastre qui a épouvanté jusqu’aux dieux : « Prenant la fuite, Ils grimpèrent jusqu’au plus haut du ciel, Où, tels des chiens, ils demeuraient pelotonnés Et accroupis au sol. La Déesse criait Comme une parturiente » (p 191).
La vie-sans-fin lui est interdite et Gilgames se lamente : « Si l’on pouvait Fermer la porte à l’angoisse ! Si l’on pouvait l’obturer Au bitume, à l’asphalte ! Mais le Destin ne m’a pas laissé m’amuser : Il m’a déchiré, Malheureux que je suis ! ». Utanapisti le tance : « Pourquoi donc, Gilgames, Exagérer ton désespoir ? Toi que les dieux ont fait De substance divino-humaine, Qu’ils ont traité comme ton père et ta mère, Serais-tu, Gilgames, Comparable à un fou ? A un fou, l’on peut faire passer de la lie Pour du beurre. […] Penses-y, Gilgames » (p 179-80). Alors Gilgames retourne à Uruk : « Les Sept Sages en personne N’en ont-ils pas jeté les fondations ? ».
J’ai lu la version ninivite par les yeux de Bottero : « Une mise en français, suffisamment à jour, mais adressée premièrement aux autres, aux non-professionnels, auxquels les spécialistes farouches, enfermés dans leur impénétrable casemate, ne rendent pas souvent visite » (p 7). Sur la forme, Bottero prévient de l’amputation du « manuscrit » (c'est vrai, les cunéiformes sont manuscrits sur des tablettes), des difficultés de la transcription, de l’arbitraire de choix souvent nécessaires. Son style est rugueux dans le commentaire comme dans la traduction, ce qui convient à la puissance et à la franchise du mythe. En « lecteur ingénu », je vois dans ce temps et ce texte archaïques le temps et le texte des découvertes. L’homme y découvre la joie du corps, la peine de la mort, le respect des autres mortels, la sagesse et l’irrespect pour les dieux.
Gilgamesh est la plus vieille oeuvre littéraire de l'histoire de l'humanité (35 siècles !) ; elle est donc à la base de notre culture et de notre histoire, et il reste important et passionnant de découvrir ces textes fondateurs.
L'épopée de Gilgamesh est loin d'être dépassée : en plus de son intérêt d'un point de vue historique, elle raconte une histoire qui parle à tous et qui reste actuelle. Au-delà de l'aspect un peu "folklorique" et surnaturel, c'est une histoire sur l'amitié, le pouvoir, la relation à la mort... Quant à la mythologie mésopotamienne, elle est tout aussi riche que les mythologies grecque ou égyptienne ; ses valeurs, ses conflits et ses récits sont tout aussi universels (on retrouve notamment un épisode de déluge très proche de celui de la Bible...).
Cette édition est très intéressante car, au lieu d'essayer de rédiger de manière moderne le récit, elle restitue telles qu'elles ont été trouvées les différentes tablettes, respectant la versification, signalant les lettres manquantes ou les vers perdus... Il y a également de nombreuses notes qui apportent beaucoup à la lecture.
L'épopée de Gilgamesh est loin d'être dépassée : en plus de son intérêt d'un point de vue historique, elle raconte une histoire qui parle à tous et qui reste actuelle. Au-delà de l'aspect un peu "folklorique" et surnaturel, c'est une histoire sur l'amitié, le pouvoir, la relation à la mort... Quant à la mythologie mésopotamienne, elle est tout aussi riche que les mythologies grecque ou égyptienne ; ses valeurs, ses conflits et ses récits sont tout aussi universels (on retrouve notamment un épisode de déluge très proche de celui de la Bible...).
Cette édition est très intéressante car, au lieu d'essayer de rédiger de manière moderne le récit, elle restitue telles qu'elles ont été trouvées les différentes tablettes, respectant la versification, signalant les lettres manquantes ou les vers perdus... Il y a également de nombreuses notes qui apportent beaucoup à la lecture.
Remarquable ! D'une actualité brûlante. Et Jean Botéro a commis un travail superbe pour retracer les 100 vers des plaquettes d'argile retraçant la vie et "la grande amitié, source de surhumaine réussites, mais qui, tragiquement amputé par la mort, jette le survivant ... dans une recherche désespérée...".
La vie de Gilgames m'a donné envie d'écrire celle de Gilles Gamèche, son avatar moderne.
La vie de Gilgames m'a donné envie d'écrire celle de Gilles Gamèche, son avatar moderne.
Paradoxe :sur le funeste champs de la « Mère des batailles » , d’humbles tablettes d’argile nous ont transmis le « Père des romans » ! Restitué par le patient travail de chercheurs obstinés ce texte du fond des temps nous montre la constante de l’esprit humain avide d’histoires pour exorciser ses peurs . Car dans ce texte tous les archétypes sont là (amour , amitié , pouvoir, apocalypse, la mort surtout , la peur de la mort toujours recommencée…) , tout ce que vous retrouverez au fil de l’histoire littéraire de la culture savante à la culture populaire . Bravo à Jean Bottero qui nous rend accessible ce chef d’œuvre primordial..
La plus vieille épopée écrite du monde retrouvée a ce jour, (en irak).
Surement vers -2000 avant JC
Un demi-dieu, qui trouve un équivalent, ensemble ils affrontent des dangers
Dans certaine versions le texte finit par une quete de l'immortalitée
Un profond respect pour nos ancetres je met 5 étoiles
Surement vers -2000 avant JC
Un demi-dieu, qui trouve un équivalent, ensemble ils affrontent des dangers
Dans certaine versions le texte finit par une quete de l'immortalitée
Un profond respect pour nos ancetres je met 5 étoiles
Ce texte, que j'aime tout particulièrement, est tout simplement de la plus vielle épopée du monde et sans doute aussi le plus vieux texte à proprement parlé littéraire de l'humanité.
Compte tenu de son extrême ancienneté, nous ne disposons sans doute pas du texte dans son intégralité, ce qui nous en reste provient d'ailleurs de différentes versions, pas toutes identiques ni même écrites dans exactement la même langue. Mais peu importe, ce qui nous reste suffit à montrer que dès que l'homme a su écrire il a pleinement été homme et qu'il s'est posé les mêmes questions, éprouvé les mêmes angoisses, ressenti les mêmes joies, et qu'il a eu le besoin de l'art et de la magie du verbe pour le dire.
Cette Épopée de Gilagameš nous parle d'un roi légendaire d'Uruk, ville sumérienne de Mésopotamie, actuellement en Irak, un roi d'avant le Déluge, dont quelques mentions dans des listes royales font penser qu'il a pu exister vers -2700,-2500 av J.-C. Mais comme pour le Charlemagne de nos vieilles chansons de geste, le personnage réel n'a rien à voir sans doute avec le personnage de littérature qu'il est devenu, magnifié et héroïsé par les scribes.
Les premiers textes qui évoquent Gilagameš ont été composés vers la fin du III millénaire en sumérien, il s'agit d'épisodes isolés consacrés à certaines de ses aventures et qui reprennent sans doute des traditions orales.
La première version de l'Épopée en tant que telle semble avoir été composée par un seul auteur dans la Babylonie du XVIII ou XVII siècle av. J.-C. en akkadien. Ce sont des tablettes du VII siècle avant notre ère conservées dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive découvertes au XIXème siècle qui nous ont en grande partie permis de redécouvrir ce texte extraordinaire, complété par d'autres versions plus ou moins partielles, car ce texte fût fameux pendant des siècles et des siècles, et il a été souvent reproduit.
Il s'agit donc de nous conter l'histoire de Gilagameš, roi d'Uruk « Pour deux tiers, il est dieux, pour un tiers, il est homme », un tyran plus qu'un roi, tellement dur pour ses sujets que ces derniers vont se plaindre au dieu Anu. Les dieux pour le contraindre à plus de modération, vont créer Enkidu, mi-homme mi-bête, qui va être capable de tenir tête à Gilagameš, qui ne pourra pas le battre en duel. Ils vont devenir amis, plus proches que des frères, et ensemble accomplir des exploits sans nombre.
Mais ils vont dépasser les bornes de ce qui est permis à des hommes et offenser les dieux qui vont faire mourir Enkidu. Cette mort terrorise Gilagameš , qui refuse qu'il lui arrive la même chose, il part donc à la recherche de l'immortalité, et pour cela se lance dans la quête de Uta-napisti, l'homme qui a survécu au Déluge et qui est devenu immortel. Gilagameš affronte de grands dangers pour le retrouver mais Uta-napisti ne peut lui donner l'immortalité, pour l'en convaincre, il lui fait le récit du Déluge. Gilagameš finira par accepter le sort commun des hommes et reviendra à Uruk pour y finir sa vie.
Ce n'est bien sûr qu'un très bref résumé de ce texte riche et complexe, qui a été pendant longtemps lu et raconté. Une partie au moins a été intégré dans notre culture, le récit biblique de la Bible reprend en effet une bonne partie du récit du Déluge mésopotamien, ce qui choqua terriblement au XIXem siècle: la Bible ne serait pas le plus vieux texte de l'humanité, et en plus une partie aurait été copié sur un texte païen (et non pas inspiré par la parole divine !).
Quelques mots aussi sur la traduction, personnellement je possède la très belle version de Jean Bottero, dont j'ai peur qu'elle ne soit plus disponible, elle est très littéraire, ce qui est un choix assumé de Bottéro, qui explique qu'il souhaitait s'adresser à des non spécialistes. Je suis personnellement une grande admiratrice des travaux de ce grand assyriologue, qui joint à une immense érudition une écriture magnifique, élégante et raffiné, et qui arrive à mon sens à faire passer une grande passion pour cette vielle culture de la Mésopotamie ancienne si mal connue et si mal aimée.
Compte tenu de son extrême ancienneté, nous ne disposons sans doute pas du texte dans son intégralité, ce qui nous en reste provient d'ailleurs de différentes versions, pas toutes identiques ni même écrites dans exactement la même langue. Mais peu importe, ce qui nous reste suffit à montrer que dès que l'homme a su écrire il a pleinement été homme et qu'il s'est posé les mêmes questions, éprouvé les mêmes angoisses, ressenti les mêmes joies, et qu'il a eu le besoin de l'art et de la magie du verbe pour le dire.
Cette Épopée de Gilagameš nous parle d'un roi légendaire d'Uruk, ville sumérienne de Mésopotamie, actuellement en Irak, un roi d'avant le Déluge, dont quelques mentions dans des listes royales font penser qu'il a pu exister vers -2700,-2500 av J.-C. Mais comme pour le Charlemagne de nos vieilles chansons de geste, le personnage réel n'a rien à voir sans doute avec le personnage de littérature qu'il est devenu, magnifié et héroïsé par les scribes.
Les premiers textes qui évoquent Gilagameš ont été composés vers la fin du III millénaire en sumérien, il s'agit d'épisodes isolés consacrés à certaines de ses aventures et qui reprennent sans doute des traditions orales.
La première version de l'Épopée en tant que telle semble avoir été composée par un seul auteur dans la Babylonie du XVIII ou XVII siècle av. J.-C. en akkadien. Ce sont des tablettes du VII siècle avant notre ère conservées dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive découvertes au XIXème siècle qui nous ont en grande partie permis de redécouvrir ce texte extraordinaire, complété par d'autres versions plus ou moins partielles, car ce texte fût fameux pendant des siècles et des siècles, et il a été souvent reproduit.
Il s'agit donc de nous conter l'histoire de Gilagameš, roi d'Uruk « Pour deux tiers, il est dieux, pour un tiers, il est homme », un tyran plus qu'un roi, tellement dur pour ses sujets que ces derniers vont se plaindre au dieu Anu. Les dieux pour le contraindre à plus de modération, vont créer Enkidu, mi-homme mi-bête, qui va être capable de tenir tête à Gilagameš, qui ne pourra pas le battre en duel. Ils vont devenir amis, plus proches que des frères, et ensemble accomplir des exploits sans nombre.
Mais ils vont dépasser les bornes de ce qui est permis à des hommes et offenser les dieux qui vont faire mourir Enkidu. Cette mort terrorise Gilagameš , qui refuse qu'il lui arrive la même chose, il part donc à la recherche de l'immortalité, et pour cela se lance dans la quête de Uta-napisti, l'homme qui a survécu au Déluge et qui est devenu immortel. Gilagameš affronte de grands dangers pour le retrouver mais Uta-napisti ne peut lui donner l'immortalité, pour l'en convaincre, il lui fait le récit du Déluge. Gilagameš finira par accepter le sort commun des hommes et reviendra à Uruk pour y finir sa vie.
Ce n'est bien sûr qu'un très bref résumé de ce texte riche et complexe, qui a été pendant longtemps lu et raconté. Une partie au moins a été intégré dans notre culture, le récit biblique de la Bible reprend en effet une bonne partie du récit du Déluge mésopotamien, ce qui choqua terriblement au XIXem siècle: la Bible ne serait pas le plus vieux texte de l'humanité, et en plus une partie aurait été copié sur un texte païen (et non pas inspiré par la parole divine !).
Quelques mots aussi sur la traduction, personnellement je possède la très belle version de Jean Bottero, dont j'ai peur qu'elle ne soit plus disponible, elle est très littéraire, ce qui est un choix assumé de Bottéro, qui explique qu'il souhaitait s'adresser à des non spécialistes. Je suis personnellement une grande admiratrice des travaux de ce grand assyriologue, qui joint à une immense érudition une écriture magnifique, élégante et raffiné, et qui arrive à mon sens à faire passer une grande passion pour cette vielle culture de la Mésopotamie ancienne si mal connue et si mal aimée.
Le plus ancien texte en écriture cunéiforme, retrouvé en 1000 vers sur des tablettes d'argile. Le titre complet est "L'Epopée de Gilgames, Le grand homme homme qui ne voulait pas mourir.
Ce texte est époustouflant de modernité, c'est "la première oeuvre littéraire connue qui par son ampleur, sa force, son souffle, sa hauteur de vision et de ton, l'éminent et l'universel de son propos aient valu, dans tout le Proche-Orient ancien, une célébrité millénaire..."
Tout homme qui réfléchit au sens de sa vie devrait lire cet ouvrage poétique !
Ce texte est époustouflant de modernité, c'est "la première oeuvre littéraire connue qui par son ampleur, sa force, son souffle, sa hauteur de vision et de ton, l'éminent et l'universel de son propos aient valu, dans tout le Proche-Orient ancien, une célébrité millénaire..."
Tout homme qui réfléchit au sens de sa vie devrait lire cet ouvrage poétique !
L'idée n'est pas ici de trouver une réflexion unilatérale, mais des déclinaisons en nouvelles et en non-fiction autour de l'errance et du rire dans la littérature, et les sociétés antillaises. Si l'importance de ces deux concepts trouve sa source dans l'Histoire et la Géographie, l'errance et le rire ont contribué à créer une identité évolutive, un appel d'air à la liberté dans un terreau qui lui semblait infertile.
Attirée en premier lieu par les noms hautement chéris de Louis-Philippe Dalembert et surtout, surtout, Lyonel Trouillot (oui encore lui et tant sa nouvelle que la partie essai sont magistrales !), je me suis empressée de cocher ce titre lors de la dernière masse critique de Babelio.
Une belle découverte, délicieusement protéiforme qui m'a faite passer par plusieurs émotions à l'image du rire, contenu ou éclatant, souvent bouclier au malheur, masque de la douleur, parade à la mélancolie. Un rire errant, lui aussi, qui nous convie à voyager avec lui au gré de ses mutations.
J'ai adoré la diversité de tons. Découvrir les aventures de Compère Lapin grâce aux talents de conteur de Frankito, assister à la rencontre fortuite des âmes de Josephine Baker et Aimé Césaire sous la plume de Mérine Céco (dont j'ai également dévoré le texte sur les femmes et l'errance d'ailleurs) , suivre les sinueux chemins-chiens de Gloria grâce à Gisèle Pineau, et que dire de l'empowerment offert gracieusement par Gaël Octavia dans son rire-ladja (si seulement j'avais connu le "Gwopwel" plus tôt !),... Je ne les cite pas tous mais il y a tant d'auteurs et d'autrices que j'ai envie désormais de connaître en format plus longs!
Si, par mon incapacité à les comprendre, j'ai fait l'impasse sur les versions créoles proposées pour la nouvelle d'Hector Poullet et les deux textes de Mélissa Béralus, j'en salue tellement l'initiative ! Les quelques phrases survolées, la musicalité particulière qui s'en dégage, me font toucher du bout des yeux ce qu'elles peuvent apporter au lectorat qui en détient les clés.
Comme une réponse à l'errance, cette langue créole se fait point d'ancrage à de multiples trajectoires issues de déracinement divers, choisis ou, plus souvent, contraints, et créé de ce lointain bigarré, un pont vers un ici commun.
La partie "essais" est des plus enrichissante elle questionne les fonctions, pointe du doigt les inégalités avec clarté et intelligence.
Merci pour ce voyage sans avion, cette errance de l'esprit qui se poursuit même après lecture.
Attirée en premier lieu par les noms hautement chéris de Louis-Philippe Dalembert et surtout, surtout, Lyonel Trouillot (oui encore lui et tant sa nouvelle que la partie essai sont magistrales !), je me suis empressée de cocher ce titre lors de la dernière masse critique de Babelio.
Une belle découverte, délicieusement protéiforme qui m'a faite passer par plusieurs émotions à l'image du rire, contenu ou éclatant, souvent bouclier au malheur, masque de la douleur, parade à la mélancolie. Un rire errant, lui aussi, qui nous convie à voyager avec lui au gré de ses mutations.
J'ai adoré la diversité de tons. Découvrir les aventures de Compère Lapin grâce aux talents de conteur de Frankito, assister à la rencontre fortuite des âmes de Josephine Baker et Aimé Césaire sous la plume de Mérine Céco (dont j'ai également dévoré le texte sur les femmes et l'errance d'ailleurs) , suivre les sinueux chemins-chiens de Gloria grâce à Gisèle Pineau, et que dire de l'empowerment offert gracieusement par Gaël Octavia dans son rire-ladja (si seulement j'avais connu le "Gwopwel" plus tôt !),... Je ne les cite pas tous mais il y a tant d'auteurs et d'autrices que j'ai envie désormais de connaître en format plus longs!
Si, par mon incapacité à les comprendre, j'ai fait l'impasse sur les versions créoles proposées pour la nouvelle d'Hector Poullet et les deux textes de Mélissa Béralus, j'en salue tellement l'initiative ! Les quelques phrases survolées, la musicalité particulière qui s'en dégage, me font toucher du bout des yeux ce qu'elles peuvent apporter au lectorat qui en détient les clés.
Comme une réponse à l'errance, cette langue créole se fait point d'ancrage à de multiples trajectoires issues de déracinement divers, choisis ou, plus souvent, contraints, et créé de ce lointain bigarré, un pont vers un ici commun.
La partie "essais" est des plus enrichissante elle questionne les fonctions, pointe du doigt les inégalités avec clarté et intelligence.
Merci pour ce voyage sans avion, cette errance de l'esprit qui se poursuit même après lecture.
Comme on parle parfois de la "Saudade" du Portugal, ou du "Zapoi" russe, l'Errance et le Rire (qui prennent ici un sens précis) peuvent être vus comme caractéristiques du peuple créole. Issus de l'histoire de l'esclavage et de ce que ce dernier a laissé comme cicatrices pour toute une population, les écrivains d'aujourd'hui s'emparent de ces concepts pour mieux faire toucher au lecteur leur spécificité.
L'introduction très didactique de Ralf Ludwig pose simplement les bases nécessaires pour déambuler à travers un univers qui peut être déroutant pour qui n'a pas fréquenté la culture créole et antillaise, et laisse ensuite la place aux récits littéraires dans un premier temps, puis de l'aspect théoriques de ceux-ci. Si le plaisir est évidemment inégal d'une nouvelle à l'autre, on trouve dans ce recueil des textes vraiment passionnants, mettant clairement en valeur ces déambulations anarchiques, souvent empruntes d'interdit et de recherche de sexualité. J'ai particulièrement apprécié les récits Melissa Belarus, Louis Philippe Dalembert, Gael Octavia et Néhémy Pierre-Dahomey, mais l'ensemble forme un tout vraiment cohérent.
En ce qui concerne la partie plus théorique de l'ouvrage, elle est moins accessible et paradoxalement, ne m'a pas plus permis de comprendre mieux la culture créole que les textes de fiction poisseux, lumineux, étranges mais qui nous mettent en prise directe avec la réalité de ces cultures.
Merci aux Editions Gallimard et à Babelio pour cette découverte
Masse Critique Février 2022
L'introduction très didactique de Ralf Ludwig pose simplement les bases nécessaires pour déambuler à travers un univers qui peut être déroutant pour qui n'a pas fréquenté la culture créole et antillaise, et laisse ensuite la place aux récits littéraires dans un premier temps, puis de l'aspect théoriques de ceux-ci. Si le plaisir est évidemment inégal d'une nouvelle à l'autre, on trouve dans ce recueil des textes vraiment passionnants, mettant clairement en valeur ces déambulations anarchiques, souvent empruntes d'interdit et de recherche de sexualité. J'ai particulièrement apprécié les récits Melissa Belarus, Louis Philippe Dalembert, Gael Octavia et Néhémy Pierre-Dahomey, mais l'ensemble forme un tout vraiment cohérent.
En ce qui concerne la partie plus théorique de l'ouvrage, elle est moins accessible et paradoxalement, ne m'a pas plus permis de comprendre mieux la culture créole que les textes de fiction poisseux, lumineux, étranges mais qui nous mettent en prise directe avec la réalité de ces cultures.
Merci aux Editions Gallimard et à Babelio pour cette découverte
Masse Critique Février 2022
J'ai été particulièrement intéressée par ce livre quand il a été annoncé lors de la Masse Critique Non Fiction et j'ai été d'autant plus heureuse de découvrir quelques jours après la sélection que j'allais le recevoir. Je remercie donc infiniment la maison d'édition et Babelio pour l'envoi et leur confiance. Pour moi, c'est un honneur car étant moi-même descendante d'Antillais et de créole, c'est comme si cet ouvrage s'adressait directement à ma personne.
Comment ce collectif d'auteurs a-t-il réussi à résumer la situation des créoles des Antilles ? Une errance, un désintérêt des gens pour une autre culture qui n'est pas la leur. Une errance concernant leur peuple, où doivent-ils aller, seront-ils acceptés ?
Le rire. Ils usent du rire pour communiquer leur mal-être, pour expliquer ce qu'ils ressentent, pour faire entendre leur voix trop longtemps étouffée par ceux qui "dominaient", ceux qui avaient plus de pouvoir.
Chaque nouvelle aide à sensibiliser à sa manière, le lecteur peut être décontenancé mais il n'en reste pas moins que pour ma part j'en suis ressortie instruite, dans l'attente même de découvrir d'autres oeuvres du genre. Cet ouvrage s'adresse à tous, aux descendants d'esclaves, à ceux qui font partie des minorités mais aussi à ceux qui ont besoin ou envie d'être éveillés, d'être bousculés...
Comment ce collectif d'auteurs a-t-il réussi à résumer la situation des créoles des Antilles ? Une errance, un désintérêt des gens pour une autre culture qui n'est pas la leur. Une errance concernant leur peuple, où doivent-ils aller, seront-ils acceptés ?
Le rire. Ils usent du rire pour communiquer leur mal-être, pour expliquer ce qu'ils ressentent, pour faire entendre leur voix trop longtemps étouffée par ceux qui "dominaient", ceux qui avaient plus de pouvoir.
Chaque nouvelle aide à sensibiliser à sa manière, le lecteur peut être décontenancé mais il n'en reste pas moins que pour ma part j'en suis ressortie instruite, dans l'attente même de découvrir d'autres oeuvres du genre. Cet ouvrage s'adresse à tous, aux descendants d'esclaves, à ceux qui font partie des minorités mais aussi à ceux qui ont besoin ou envie d'être éveillés, d'être bousculés...
Un recueil de nouvelles c'est très dense, plus qu'un roman, et il est difficile, une fois lu, de tout en retenir. Alors ce qui est intéressant, quand on en reprend un lu il y a un moment, qu'on le feuillette juste, c'est de voir ce que ça nous rappelle. J'avoue que dans celui-là pas grand-chose n'a laissé de traces, à l'exception notable du texte de Thomas Day, dont je me souviens comme d'une histoire intrigante autour de l'éthologie des tigres. Et surtout du "Constructeur" de Philip K. Dick : seize pages sobres mais haletantes, étranges, banales, inquiètes, qui se dénouent à la dernière phrase, et pas avant. Une des cinq meilleures nouvelles que j'ai lues.
Une odyssée qui a été pour moi une traversée du désert. Je n’ai pas apprécié ces nouvelles, hormis celle des tigres (mais qui se termine sans queue ni tête sans mauvais jeu de mots).
Le recueil de nouvelles est un art compliqué mais très intéressant. Ici il est pour moi complètement raté.
Le recueil de nouvelles est un art compliqué mais très intéressant. Ici il est pour moi complètement raté.
Il s'agit d'une histoire d'amour du XIII°s : deux amoureux, le chevalier Agolane et la Châtelaine de Vergy, nièce du Duc de Bourgogne s’aiment en secret. Le petit chien de la Châtelaine leur sert de signal: lorsqu'il vient dans le verger, ceci indique au chevalier qu'il peut aller à la rencontre de sa Belle. Cependant leur idylle est menacée par une autre femme, la Duchesse de Bourgogne, qui, repoussée par le jeune homme, accuse faussement celui-ci de vouloir la séduire...
Il faut lire ce texte sur un arrière-plan courtois. C'est dans le milieu culturel de la Cour, avec tous ses raffinements de mœurs, de manières et avec les charmes de ses habitations qu'évolue le roman. Il est décrit une vie agréable et douce dans ce texte. Il n'y a pas de grande aventure, hormis cette histoire d'amour. Mais quelle histoire !!!
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Il faut lire ce texte sur un arrière-plan courtois. C'est dans le milieu culturel de la Cour, avec tous ses raffinements de mœurs, de manières et avec les charmes de ses habitations qu'évolue le roman. Il est décrit une vie agréable et douce dans ce texte. Il n'y a pas de grande aventure, hormis cette histoire d'amour. Mais quelle histoire !!!
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
A l'instar de Tristant et yseult ou de Roméo et Juliette, La châtelaine de Vergy et son chevalier connaissent un amour à l'issu tragique.
L'amour courtois impose un certain nombre de codes à respecter, parmi lesquels le secret: personne ne doit connaître la passion que se vouent les amoureux car "il en résulte un tel malheur que leur amour nécessairement sombre dans le désespoir".
Aussi, lorsque la duchesse de Bourgogne apprend que le chevalier dont elle est tombée amoureuse aime la nièce de son époux (elle a percé leur secret à force de perfidie), elle s'arrange pour faire savoir à la jeune châtelaine qu'elle est au courant.
A l'époque, les gens avaient une faculté inouïe pour littéralement mourir de désespoir aussi la jeune femme pousse -t-elle son dernier soupir en se lamentant sur son sort, brusquement.
Le chevalier, découvrant le corps sans vie de son aimée, se transperce le cœur avec une épée.
Le duc, comprenant que c'est sa femme qui est à l'origine de tout cela, prend l'épée et va la tuer en plein bal.
N'est-ce pas tragique comme situation?
Je ne peux, par ailleurs, m'empêcher de souligner la violence d'une telle histoire: la châtelaine meurt de désespoir sur un lit, mais une petite fille se trouve dans la pièce et assiste à la scène. Elle est toujours là lorsque le chevalier se transperce le cœur avec l'épée; enfin, le duc assassine sa femme en pleine cérémonie devant donc un grand nombre de personnes!
Ce livre est un formidable témoignage de ce qu'était la littérature courtoise Au Moyen Age, une littérature riche et si particulière!
L'amour courtois impose un certain nombre de codes à respecter, parmi lesquels le secret: personne ne doit connaître la passion que se vouent les amoureux car "il en résulte un tel malheur que leur amour nécessairement sombre dans le désespoir".
Aussi, lorsque la duchesse de Bourgogne apprend que le chevalier dont elle est tombée amoureuse aime la nièce de son époux (elle a percé leur secret à force de perfidie), elle s'arrange pour faire savoir à la jeune châtelaine qu'elle est au courant.
A l'époque, les gens avaient une faculté inouïe pour littéralement mourir de désespoir aussi la jeune femme pousse -t-elle son dernier soupir en se lamentant sur son sort, brusquement.
Le chevalier, découvrant le corps sans vie de son aimée, se transperce le cœur avec une épée.
Le duc, comprenant que c'est sa femme qui est à l'origine de tout cela, prend l'épée et va la tuer en plein bal.
N'est-ce pas tragique comme situation?
Je ne peux, par ailleurs, m'empêcher de souligner la violence d'une telle histoire: la châtelaine meurt de désespoir sur un lit, mais une petite fille se trouve dans la pièce et assiste à la scène. Elle est toujours là lorsque le chevalier se transperce le cœur avec l'épée; enfin, le duc assassine sa femme en pleine cérémonie devant donc un grand nombre de personnes!
Ce livre est un formidable témoignage de ce qu'était la littérature courtoise Au Moyen Age, une littérature riche et si particulière!
Une histoire d'amour médiévale dans laquelle un lecteur du XXIe siècle peut s'identifier, se sentir concerner, être embarqué? C'est le pari gagné d'un récit du Moyen Âge ayant traversé les âges et qui, aujourd'hui encore, peut parler au lecteur. Petit plus: la langue est belle!
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le Japon en ses oeuvres
steka
144 livres

Champ romantique
steka
67 livres
Auteurs proches de Éditions Gallimard
Lecteurs de Éditions Gallimard (1131)Voir plus
Quiz
Voir plus
Petite charade littéraire 1
Mon premier est un article défini
le
la
les
5 questions
30 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur30 lecteurs ont répondu