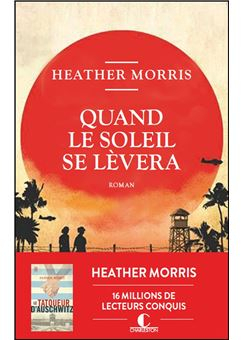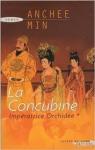Anchee Min/5
7 notes
Résumé :
La Révolution culturelle bat son plein, la Chine plie sous le joug d'une idéologie qui méprise les individus, dédaigne les sentiments et interdit l'amour. A dix-sept ans, comme des millions d'adolescents de son âge, Anchee Min est envoyée dans une ferme d'Etat... pour le bien de la patrie. Sur une terre qui dessèche les âmes et les cœurs, Anchee survit à grand-peine. Son lot quotidien et son avenir ? La faim, la solitude. ET c'est pourtant là, dans ce désert, qu'ell... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'Azalée rougeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Un roman autobiographique qui nous plonge dans la Chine communiste. Anchee Min nous raconte son parcours, ses amours, et évoque les détails terrifiants du quotidien.
A noter, de nombreux passages sur Madame Mao, notamment en fin de livre, qui prefigurent sans doute un roman ultérieur, non traduit en français, sur la dernière épouse du dirigeant communiste.
A noter, de nombreux passages sur Madame Mao, notamment en fin de livre, qui prefigurent sans doute un roman ultérieur, non traduit en français, sur la dernière épouse du dirigeant communiste.
Citations et extraits (41)
Voir plus
Ajouter une citation
Quand j’ai eu dix-sept ans, ma vie a pris un autre tour. Après s’être entretenu avec beaucoup d’autres, le sous-directeur de l’école a eu une conversation avec moi.
— Je tiens à te rappeler que tu es un chef, un modèle pour les étudiants. Il existe une ligne de conduite, aussi rigoureuse qu’une équation mathématique. Tu appartiens à une seule catégorie. Tu seras ouvrier agricole. Il s’agit là d’une décision irrévocable. Le plan conçu par Pékin est une directive sacrée. Il est universellement accepté. Il est de ton devoir d’obéir. J’ai moi-même envoyé quatre de mes enfants travailler dans les campagnes. Je suis très fier d’eux.
Il a employé beaucoup d’autres mots. Des mots abstraits. Des mots qui chantaient. Par exemple, il a dit :
— Quand on défie le ciel, on en tire du plaisir ; quand on défie la terre, on en tire du plaisir ; quand on défie les siens, on en tire le plus grand plaisir.
C’était un poème de Mao.
Il a ajouté :
— Une vraie communiste aime les défis. Elle les relève avec dignité.
J’avais dix-sept ans. J’étais exaltée. Je brûlais de me consacrer. J’attendais l’épreuve avec impatience.
Entre-temps, j’écoutais les ragots du voisinage. Mon voisin d’à côté avait écrit depuis son village pour raconter qu’il s’était volontairement tapé sur le doigt avec un marteau pendant son travail afin de pouvoir demander qu’on le renvoie chez lui à cause de sa blessure. La grande sœur de Petit-Cercueil était à la frontière nord ; elle a écrit qu’on avait tiré à la frontière sur sa camarade de chambre, car c’était une traîtresse qui avait tenté de s’échapper en URSS. Mon cousin, envoyé en Mongolie-Intérieure, a raconté dans une lettre que son meilleur ami était mort en luttant contre un feu de montagne. Il a reçu les honneurs dus à un héros, car il avait sauvé les réserves de grain du village au prix de sa vie. Mon cousin a ajouté que le héros lui avait fait comprendre le vrai sens de la vie, aussi avait-il décidé de passer le reste de sa vie à cheval en Mongolie pour devenir un héros.
Parmi les on-dit, j’ai entendu que la fille de la famille Li avait été violée par un chef de village dans la province du sud-ouest ; le fils de la famille Yang avait été honoré pour avoir tué un ours qui avait mangé son compagnon de travail dans une ferme du nord. Ces familles étaient inquiètes. Elles allaient porter ces histoires horribles aux administrateurs du parti local. Les lettres passaient de main en main. Mais on demandait aux familles de ne pas croire ces mensonges éhontés. Ils émanaient d’ennemis qui craignaient les progrès de la révolution. Les autorités du Parti montraient aux familles des photographies de l’endroit où étaient partis leurs enfants. C’étaient des photographies de prospérité. Les familles étaient convaincues et rassurées. Les gens du dessus ont envoyé leurs deuxième et troisième enfants dans les campagnes. Les parents de Petit-Cercueil ont eu l’honneur de recevoir des certificats et des fleurs de papier rouges, comme pour toute famille ayant expédié trois enfants à la campagne. Les portes et les murs de chez eux étaient couverts de lettres de félicitations grandes comme des affiches.
— Je tiens à te rappeler que tu es un chef, un modèle pour les étudiants. Il existe une ligne de conduite, aussi rigoureuse qu’une équation mathématique. Tu appartiens à une seule catégorie. Tu seras ouvrier agricole. Il s’agit là d’une décision irrévocable. Le plan conçu par Pékin est une directive sacrée. Il est universellement accepté. Il est de ton devoir d’obéir. J’ai moi-même envoyé quatre de mes enfants travailler dans les campagnes. Je suis très fier d’eux.
Il a employé beaucoup d’autres mots. Des mots abstraits. Des mots qui chantaient. Par exemple, il a dit :
— Quand on défie le ciel, on en tire du plaisir ; quand on défie la terre, on en tire du plaisir ; quand on défie les siens, on en tire le plus grand plaisir.
C’était un poème de Mao.
Il a ajouté :
— Une vraie communiste aime les défis. Elle les relève avec dignité.
J’avais dix-sept ans. J’étais exaltée. Je brûlais de me consacrer. J’attendais l’épreuve avec impatience.
Entre-temps, j’écoutais les ragots du voisinage. Mon voisin d’à côté avait écrit depuis son village pour raconter qu’il s’était volontairement tapé sur le doigt avec un marteau pendant son travail afin de pouvoir demander qu’on le renvoie chez lui à cause de sa blessure. La grande sœur de Petit-Cercueil était à la frontière nord ; elle a écrit qu’on avait tiré à la frontière sur sa camarade de chambre, car c’était une traîtresse qui avait tenté de s’échapper en URSS. Mon cousin, envoyé en Mongolie-Intérieure, a raconté dans une lettre que son meilleur ami était mort en luttant contre un feu de montagne. Il a reçu les honneurs dus à un héros, car il avait sauvé les réserves de grain du village au prix de sa vie. Mon cousin a ajouté que le héros lui avait fait comprendre le vrai sens de la vie, aussi avait-il décidé de passer le reste de sa vie à cheval en Mongolie pour devenir un héros.
Parmi les on-dit, j’ai entendu que la fille de la famille Li avait été violée par un chef de village dans la province du sud-ouest ; le fils de la famille Yang avait été honoré pour avoir tué un ours qui avait mangé son compagnon de travail dans une ferme du nord. Ces familles étaient inquiètes. Elles allaient porter ces histoires horribles aux administrateurs du parti local. Les lettres passaient de main en main. Mais on demandait aux familles de ne pas croire ces mensonges éhontés. Ils émanaient d’ennemis qui craignaient les progrès de la révolution. Les autorités du Parti montraient aux familles des photographies de l’endroit où étaient partis leurs enfants. C’étaient des photographies de prospérité. Les familles étaient convaincues et rassurées. Les gens du dessus ont envoyé leurs deuxième et troisième enfants dans les campagnes. Les parents de Petit-Cercueil ont eu l’honneur de recevoir des certificats et des fleurs de papier rouges, comme pour toute famille ayant expédié trois enfants à la campagne. Les portes et les murs de chez eux étaient couverts de lettres de félicitations grandes comme des affiches.
Petite-Verdure avait dix-huit ans. Elle dormait dans le lit à côté du mien. Elle était si pâle que, malgré l’exposition quotidienne au soleil, sa peau ne changeait pas de couleur. Ses doigts étaient longs et fins. Elle épandait du fumier de cochon comme si elle arrangeait des bijoux. Elle marchait avec grâce. On aurait dit un saule sous la brise. Ses longues nattes ondulaient dans son dos. Quand elle parlait, elle baissait les yeux. Elle était timide. Mais elle adorait chanter. Elle m’a raconté qu’elle avait été élevée par sa grand-mère, cantatrice d’opéra avant la Révolution culturelle. Elle avait hérité de sa voix. Ses parents avaient été expédiés au diable travailler dans des champs de colza parce que c’étaient des intellectuels. Ils revenaient chez eux la veille du jour de l’an. Elle ne connaissait presque pas ses parents, mais elle savait par cœur tous les vieux opéras, même si elle ne les chantait jamais en public. En public, elle chantait Ma mère patrie, chant populaire depuis la Libération. Sa voix faisait la fierté de la section. Elle nous aidait à venir à bout de nos durs travaux, à bout des jours. Car nous nous levions à cinq heures pour travailler aux champs jusqu’à neuf heures du soir.
Elle avait de l’audace. Elle osait orner sa beauté. Elle nouait ses nattes avec des ficelles de couleur tandis que nous utilisions des élastiques marron. Sa féminité se gaussait de nous. Je la regardais et percevais le danger qu’elle courait à cause de sa hardiesse. Avant, j’étais à la tête des gardes rouges. Je connaissais les règles. Je savais le fil ténu entre le bien et le mal. J’observais Petite-Verdure. Sa beauté. Je voulais nouer mes nattes avec des ficelles de couleur tous les jours. Mais je n’avais pas le cran d’afficher mon mépris des règles. J’avais toujours agi comme il faut.
Je dois admettre qu’elle était belle. Mais les autres femmes soldats et moi disions que non. Nous utilisions des élastiques marron. Couleur de boue, de fumier de cochon, couleur de notre moral. Parce que nous croyions qu’une vraie communiste ne devait jamais s’occuper de son apparence. Seule devait nous concerner la beauté de l’âme. Petite-Verdure ne discutait jamais. Peu importe ce qu’on disait. Elle souriait pour elle-même. Elle baissait les yeux. Son sourire, qui venait du cœur, était pour elle, pour ses nœuds de couleur, et elle était satisfaite. Peu importait sa fatigue, Petite-Verdure marchait trois quarts d’heure jusqu’au point d’eau chaude et rapportait de quoi se laver. Elle ôtait la boue de ses ongles avec patience et gaieté. Chaque soir, elle se lavait sous sa moustiquaire, tandis qu’étendue sous la mienne je la regardais, mes pattes crasseuses sur mes cuisses.
Petite-Verdure me montrait fièrement comment elle utilisait les bouts de tissu pour se faire de jolis sous-vêtements, finement brodés de fleurs, d’oiseaux et de feuilles. Elle tendait une ficelle près de la petite fenêtre entre nos lits afin de les y suspendre à sécher. Dans notre chambre dénudée, la ficelle était une galerie d’art.
Petite-Verdure me troublait. Elle troublait la chambre, la section et la compagnie. Elle attirait le regard. C’était plus fort que nous. Les bons à rien ne quittaient pas des yeux cette créature à l’allure bourgeoise. Je méprisais le désir que j’avais de dévoiler ma jeunesse. Un désir moche, et sale, me répétai-je des centaines de fois. J’avais dix-sept ans et demi. J’admirais le cran de Petite-Verdure. Le cran de redessiner les habits qu’on nous fournissait. Elle resserrait ses jupes à la taille ; elle retaillait ses pantalons pour que ses jambes aient l’air plus longues. Elle n’avait pas honte de sa poitrine épanouie. Quand le soir tombait, elle portait deux seaux d’eau chaude, dos bien droit, poitrine fière. Elle pénétrait dans notre chambre en chantant. Derrière elle, le ciel était d’un bleu de velours. Les soldats, mi-hommes, mi-singes, la dévoraient des yeux quand elle passait. Elle était la Vénus du soir à la ferme. Je l’enviais et je l’adorais. En juin, elle a osé ne pas porter de soutien-gorge. J’ai détesté le mien quand je l’ai vue s’avancer vers moi avec ses seins bondissants. Je me sentais flétrie sans m’être jamais épanouie.
Elle avait de l’audace. Elle osait orner sa beauté. Elle nouait ses nattes avec des ficelles de couleur tandis que nous utilisions des élastiques marron. Sa féminité se gaussait de nous. Je la regardais et percevais le danger qu’elle courait à cause de sa hardiesse. Avant, j’étais à la tête des gardes rouges. Je connaissais les règles. Je savais le fil ténu entre le bien et le mal. J’observais Petite-Verdure. Sa beauté. Je voulais nouer mes nattes avec des ficelles de couleur tous les jours. Mais je n’avais pas le cran d’afficher mon mépris des règles. J’avais toujours agi comme il faut.
Je dois admettre qu’elle était belle. Mais les autres femmes soldats et moi disions que non. Nous utilisions des élastiques marron. Couleur de boue, de fumier de cochon, couleur de notre moral. Parce que nous croyions qu’une vraie communiste ne devait jamais s’occuper de son apparence. Seule devait nous concerner la beauté de l’âme. Petite-Verdure ne discutait jamais. Peu importe ce qu’on disait. Elle souriait pour elle-même. Elle baissait les yeux. Son sourire, qui venait du cœur, était pour elle, pour ses nœuds de couleur, et elle était satisfaite. Peu importait sa fatigue, Petite-Verdure marchait trois quarts d’heure jusqu’au point d’eau chaude et rapportait de quoi se laver. Elle ôtait la boue de ses ongles avec patience et gaieté. Chaque soir, elle se lavait sous sa moustiquaire, tandis qu’étendue sous la mienne je la regardais, mes pattes crasseuses sur mes cuisses.
Petite-Verdure me montrait fièrement comment elle utilisait les bouts de tissu pour se faire de jolis sous-vêtements, finement brodés de fleurs, d’oiseaux et de feuilles. Elle tendait une ficelle près de la petite fenêtre entre nos lits afin de les y suspendre à sécher. Dans notre chambre dénudée, la ficelle était une galerie d’art.
Petite-Verdure me troublait. Elle troublait la chambre, la section et la compagnie. Elle attirait le regard. C’était plus fort que nous. Les bons à rien ne quittaient pas des yeux cette créature à l’allure bourgeoise. Je méprisais le désir que j’avais de dévoiler ma jeunesse. Un désir moche, et sale, me répétai-je des centaines de fois. J’avais dix-sept ans et demi. J’admirais le cran de Petite-Verdure. Le cran de redessiner les habits qu’on nous fournissait. Elle resserrait ses jupes à la taille ; elle retaillait ses pantalons pour que ses jambes aient l’air plus longues. Elle n’avait pas honte de sa poitrine épanouie. Quand le soir tombait, elle portait deux seaux d’eau chaude, dos bien droit, poitrine fière. Elle pénétrait dans notre chambre en chantant. Derrière elle, le ciel était d’un bleu de velours. Les soldats, mi-hommes, mi-singes, la dévoraient des yeux quand elle passait. Elle était la Vénus du soir à la ferme. Je l’enviais et je l’adorais. En juin, elle a osé ne pas porter de soutien-gorge. J’ai détesté le mien quand je l’ai vue s’avancer vers moi avec ses seins bondissants. Je me sentais flétrie sans m’être jamais épanouie.
J’ai emménagé avec Yan et six autres chefs de section. Yan et moi partagions un lit superposé. J’occupais celui du dessus. Yan avait décoré sa moustiquaire avec des badges de Mao épinglés sur un carré rouge. Il y en avait bien mille, représentant les différentes étapes historiques. J’étais impressionnée. Yan les accrochait le jour et les décrochait la nuit. La pièce était de la même taille que celle où je logeais auparavant. Elle servait de chambre, de salle de conférences et de salle à manger improvisée. C’était aussi un champ de bataille. Si Yan était officiellement responsable et Lu son adjointe, Lu avait de l’ambition. Elle voulait la place de Yan et ne pensait qu’à ça. Elle convoquait des réunions sans prévenir. Nous devions obtempérer. Fatiguées comme nous l’étions, il nous fallait assister à ces assemblées jusqu’au bout. Elle adorait voir qu’on lui obéissait. Le pouvoir était sa drogue. Ce n’est qu’au cours des réunions qu’elle pouvait contrôler la vie des autres au même titre que la sienne. Ces réunions n’étaient qu’avertissements et menaces. Elle prisait notre peur.
Elle recherchait nos erreurs possibles. Elle guettait le moment de repérer une faute et de réduire la coupable à sa soumission. Elle essayait de surprendre le moindre faux pas chez Yan. Je peux affirmer que, si elle en avait eu l’occasion, elle l’aurait précipitée au pied d’une falaise.
Le nom entier de Lu était Lu-Glace. C’était la fille d’un martyr de la révolution. Son père avait été tué à Taïwan par les nationalistes, assassiné en pleine mission secrète. Sa mère en avait souffert jusqu’à sa mort, trois jours après la naissance de Lu. C’était un hiver terrible. Le vent froid, coupant comme des ciseaux, vous sciait la peau. Elle a prénommé son bébé Glace. Glace a été confiée aux soins attentifs du Parti. Elle a grandi dans un orphelinat financé par les chefs du Parti. À l’instar de Yan, elle était fondatrice des gardes rouges. Elle était allée visiter la maison de Mao dans le Hunan et avait mangé des feuilles du même arbre que celles qu’il avait mangées lorsque, trente ans auparavant, il avait été assiégé et cloué dans la vallée par les nationalistes.
Lu m’a montré un crâne qu’elle avait découvert dans l’arrière-cour d’une maison du Hunan.
— C’est le crâne d’un martyr appartenant à l’Armée rouge. Le trou que tu vois au front a été fait par une balle.
Elle caressait le crâne de ses doigts, les passant et les repassant par les orbites, effleurant la mâchoire. Son visage arborait une expression si étrange que j’en avais le souffle coupé.
— Une vieille dame du village a enterré le martyr en secret. Vingt ans plus tard, le crâne a émergé du sol. En apprenant que mon père avait lui aussi été un martyr, la vieille dame l’a extirpé pour me le donner. Je pense souvent que ce crâne aurait pu être celui de mon père.
J’observais attentivement le crâne, essayant de percevoir ce qui attirait Lu à ce point. La menace qui en émanait ? La froideur que seule porte en elle la mort ?
Lu portait bien son nom, surtout quand on songe à son regard. Il était réfrigérant. Son enthousiasme manquait de chaleur. Elle parlait lentement, détachant chaque syllabe. Elle avait un long visage décidé en forme de cacahuète. Elle avait toujours l’air de vous juger. Elle avait des traits réguliers. Des yeux en amande, froids comme sur le portrait peint d’une beauté d’un autre temps. Mais sa rigueur inébranlable tuait sa beauté. Ses yeux en demi-lune avaient perdu toute chaleur et toute douceur vis-à -vis des soldats. Nous éprouvions pour elle le respect d’une souris pour un chat.
Lu prisait l’action. Elle ignorait l’hésitation. Elle prenait d’assaut et envahissait. Attraper, réduire en miettes, tel était son style. « Guette, vise et tire », aimait-elle à répéter. Mais cela ne m’impressionnait pas. Au contraire, je prenais mes distances. Elle était monomaniaque. Elle avait l’esprit morbide. Elle m’observait. Froidement. Son sourire était porteur d’avertissements. Elle m’a donné un exemplaire de ses réflexions sur Mao. La calligraphie en était extrêmement régulière. J’aurais voulu écrire aussi bien, mais en même temps ses propos m’ennuyaient profondément. Elle raisonnait comme une machine à propagande. Sans moteur propre. Quand elle m’a demandé mon avis, je le lui ai dit. Bien sûr, je ne lui ai pas dit que son esprit n’était qu’une machine à propagande, mais je lui ai suggéré d’en huiler les rouages.
— J’apprécie ta franchise. On m’a toujours menti. J’ai côtoyé une bande d’hypocrites. Je hais l’hypocrisie. Le pays est rempli d’hypocrites. Sous bien des aspects, ce sont eux qui dirigent le Parti. Mon devoir est de lutter contre les hypocrites. Je vais consacrer ma vie à redresser les incorrections. Bats-toi avec moi.
Je ne comprenais pas vraiment de quoi elle parlait, mais je n’en ai rien dit.
— Oui, bien sûr, ai-je répondu. De toute façon, les hypocrites sont une sale race.
— Tu en flaires, dans la chambre ? m’a-t-elle demandé.
Nos compagnes sont revenues après le dîner. Elles riaient. Elles plaisantaient sur la façon dont elles avaient puni ces tas de fainéants qui refusaient d’apprécier la vie de paysan. Quand Lu s’est mise à parler des hypocrites, elles se sont calmées. Elles se sont glissées sous leur moustiquaire l’une après l’autre, comme des poissons. Il y a eu des bruits de tâtonnements. Cela me faisait penser à des vampires mangeant des corps humains dans leurs tombes.
Lu continuait de parler. On se serait cru au théâtre.
— En tant que fille de martyr révolutionnaire, je n’oublierai jamais que mes ancêtres ont versé leur sang et donné leur vie pour la révolution. Jamais je ne manquerai d’être à la hauteur de leurs espérances. J’espère que vous toutes, mes camarades de combat, surveillerez mon comportement. À l’avenir, j’accueillerai volontiers toute critique que vous pourrez formuler à mon endroit. Le Parti est ma mère, vous êtes ma seule famille.
Elle essayait d’être une héroïne d’opéra incarnée, mais je me sentais incapable de la voir ainsi.
J’avais bien du mal à imaginer comment Lu pouvait dormir toutes les nuits nez à nez avec ce crâne. Après m’être aperçue que le crâne était juste à côté de moi, puisque le lit de Lu et le mien étaient reliés, je me suis mise à avoir des cauchemars. Je n’osais pas me plaindre. Mon instinct m’en empêchait : Lu l’aurait sûrement pris comme une insulte. Pouvais-je me permettre d’être citée comme quelqu’un qui a peur du crâne d’un martyr ?
Lu observait tout le monde, notant ses remarques sur un carnet de plastique rouge. Chaque mois, elle faisait son rapport à l’état-major.
— Je dois mes compétences politiques à ma famille, répétait-elle souvent.
Un jour, elle nous en a parlé.
— Mes parents étaient secrétaires du Parti dans l’armée. Ma sœur adoptive et mes deux frères étaient secrétaires du Parti à l’université et à l’usine. Tous les membres de ma famille ont eu l’honneur de séjourner en hôpital privé quand ils étaient malades. Leur chambre jouxtait celle du Premier ministre.
Lu fabriquait des bonnets d’âne politiques. Au cours des réunions, elle désignait toujours une personne qui devait le porter jusqu’au bout. Il fallait toujours en passer par où elle voulait. Des extraits du Drapeau rouge et du Quotidien du peuple jaillissaient de sa bouche comme un torrent. Avec elle, je pensais irrésistiblement à ce que ce serait si les agneaux vivaient avec un loup.
— Un miroir est le symbole du narcissisme, m’a-t-elle dit un jour. C’est un luxe bourgeois.
— Bien sûr, ai-je dit.
Puis j’ai caché mon petit miroir dans ma taie d’oreiller. Je savais que, si elle le voulait, Lu pouvait me taxer de réactionnaire. Elle avait déjà fait subir pareil sort à pas mal de monde. Elle les avait envoyés faire sauter des montagnes à la dynamite pour créer des rizières, ou creuser le sol pour fabriquer un souterrain. Elle s’arrangeait pour qu’ils paient de leur vie. Ceux qui s’en sortaient ressemblaient à Petite-Verdure. Nul n’échappait au prix à payer pour avoir osé répondre à Lu. Elle me faisait si peur.
Curieusement, et parallèlement à cela, elle se donnait un mal fou pour impressionner les soldats, lavant nos vêtements, ou affûtant nos faucilles et nos houes. Chaque soir, elle faisait la tournée des chambrées, nous bordait, s’assurait que nous étions emmitouflées et ne risquerions pas d’attraper froid. Elle envoyait souvent la totalité de son salaire anonymement aux parents malades d’une camarade. Elle recevait beaucoup d’éloges.
— Peu m’importe d’être le chiffon utilisé par le Parti communiste pour nettoyer le coin le plus gras de sa cuisine, aimait-elle dire.
Elle avait le don de ce genre de formules. Nous prétendions aimer le soin qu’elle prenait de nous. Il le fallait bien. Nous écrivions des phrases louangeuses sur le rapport mensuel expédié au quartier général. C’est ce que Lu attendait de nous. Les soldats le savaient par cœur.
Elle notifiait l’incorrection de Yan chaque fois que possible.
— Yan n’est pas assez sévère concernant la réforme de l’esprit, trop laxiste sur le budget de la compagnie, trop impatiente quand elle dirige une session d’étude de la pensée de Mao.
Yan se défendait avec colère. Elle n’était pas douée pour la polémique. Elle n’arrivait pas à la cheville de Lu. Elle tenait des propos incohérents. De désespoir, elle finissait par jurer. Des tas de gros mots de toute sorte qu’elle alignait.
— Plant de riz pourri, cul de cochon, ver de terre fornicateur...
Lu se réjouissait de voir Yan en position fâcheuse. Elle aimait l’acculer sur le terrain de la rhétorique et la battre à plate couture. Ses attaques étaient féroces. Elle montr
Elle recherchait nos erreurs possibles. Elle guettait le moment de repérer une faute et de réduire la coupable à sa soumission. Elle essayait de surprendre le moindre faux pas chez Yan. Je peux affirmer que, si elle en avait eu l’occasion, elle l’aurait précipitée au pied d’une falaise.
Le nom entier de Lu était Lu-Glace. C’était la fille d’un martyr de la révolution. Son père avait été tué à Taïwan par les nationalistes, assassiné en pleine mission secrète. Sa mère en avait souffert jusqu’à sa mort, trois jours après la naissance de Lu. C’était un hiver terrible. Le vent froid, coupant comme des ciseaux, vous sciait la peau. Elle a prénommé son bébé Glace. Glace a été confiée aux soins attentifs du Parti. Elle a grandi dans un orphelinat financé par les chefs du Parti. À l’instar de Yan, elle était fondatrice des gardes rouges. Elle était allée visiter la maison de Mao dans le Hunan et avait mangé des feuilles du même arbre que celles qu’il avait mangées lorsque, trente ans auparavant, il avait été assiégé et cloué dans la vallée par les nationalistes.
Lu m’a montré un crâne qu’elle avait découvert dans l’arrière-cour d’une maison du Hunan.
— C’est le crâne d’un martyr appartenant à l’Armée rouge. Le trou que tu vois au front a été fait par une balle.
Elle caressait le crâne de ses doigts, les passant et les repassant par les orbites, effleurant la mâchoire. Son visage arborait une expression si étrange que j’en avais le souffle coupé.
— Une vieille dame du village a enterré le martyr en secret. Vingt ans plus tard, le crâne a émergé du sol. En apprenant que mon père avait lui aussi été un martyr, la vieille dame l’a extirpé pour me le donner. Je pense souvent que ce crâne aurait pu être celui de mon père.
J’observais attentivement le crâne, essayant de percevoir ce qui attirait Lu à ce point. La menace qui en émanait ? La froideur que seule porte en elle la mort ?
Lu portait bien son nom, surtout quand on songe à son regard. Il était réfrigérant. Son enthousiasme manquait de chaleur. Elle parlait lentement, détachant chaque syllabe. Elle avait un long visage décidé en forme de cacahuète. Elle avait toujours l’air de vous juger. Elle avait des traits réguliers. Des yeux en amande, froids comme sur le portrait peint d’une beauté d’un autre temps. Mais sa rigueur inébranlable tuait sa beauté. Ses yeux en demi-lune avaient perdu toute chaleur et toute douceur vis-à -vis des soldats. Nous éprouvions pour elle le respect d’une souris pour un chat.
Lu prisait l’action. Elle ignorait l’hésitation. Elle prenait d’assaut et envahissait. Attraper, réduire en miettes, tel était son style. « Guette, vise et tire », aimait-elle à répéter. Mais cela ne m’impressionnait pas. Au contraire, je prenais mes distances. Elle était monomaniaque. Elle avait l’esprit morbide. Elle m’observait. Froidement. Son sourire était porteur d’avertissements. Elle m’a donné un exemplaire de ses réflexions sur Mao. La calligraphie en était extrêmement régulière. J’aurais voulu écrire aussi bien, mais en même temps ses propos m’ennuyaient profondément. Elle raisonnait comme une machine à propagande. Sans moteur propre. Quand elle m’a demandé mon avis, je le lui ai dit. Bien sûr, je ne lui ai pas dit que son esprit n’était qu’une machine à propagande, mais je lui ai suggéré d’en huiler les rouages.
— J’apprécie ta franchise. On m’a toujours menti. J’ai côtoyé une bande d’hypocrites. Je hais l’hypocrisie. Le pays est rempli d’hypocrites. Sous bien des aspects, ce sont eux qui dirigent le Parti. Mon devoir est de lutter contre les hypocrites. Je vais consacrer ma vie à redresser les incorrections. Bats-toi avec moi.
Je ne comprenais pas vraiment de quoi elle parlait, mais je n’en ai rien dit.
— Oui, bien sûr, ai-je répondu. De toute façon, les hypocrites sont une sale race.
— Tu en flaires, dans la chambre ? m’a-t-elle demandé.
Nos compagnes sont revenues après le dîner. Elles riaient. Elles plaisantaient sur la façon dont elles avaient puni ces tas de fainéants qui refusaient d’apprécier la vie de paysan. Quand Lu s’est mise à parler des hypocrites, elles se sont calmées. Elles se sont glissées sous leur moustiquaire l’une après l’autre, comme des poissons. Il y a eu des bruits de tâtonnements. Cela me faisait penser à des vampires mangeant des corps humains dans leurs tombes.
Lu continuait de parler. On se serait cru au théâtre.
— En tant que fille de martyr révolutionnaire, je n’oublierai jamais que mes ancêtres ont versé leur sang et donné leur vie pour la révolution. Jamais je ne manquerai d’être à la hauteur de leurs espérances. J’espère que vous toutes, mes camarades de combat, surveillerez mon comportement. À l’avenir, j’accueillerai volontiers toute critique que vous pourrez formuler à mon endroit. Le Parti est ma mère, vous êtes ma seule famille.
Elle essayait d’être une héroïne d’opéra incarnée, mais je me sentais incapable de la voir ainsi.
J’avais bien du mal à imaginer comment Lu pouvait dormir toutes les nuits nez à nez avec ce crâne. Après m’être aperçue que le crâne était juste à côté de moi, puisque le lit de Lu et le mien étaient reliés, je me suis mise à avoir des cauchemars. Je n’osais pas me plaindre. Mon instinct m’en empêchait : Lu l’aurait sûrement pris comme une insulte. Pouvais-je me permettre d’être citée comme quelqu’un qui a peur du crâne d’un martyr ?
Lu observait tout le monde, notant ses remarques sur un carnet de plastique rouge. Chaque mois, elle faisait son rapport à l’état-major.
— Je dois mes compétences politiques à ma famille, répétait-elle souvent.
Un jour, elle nous en a parlé.
— Mes parents étaient secrétaires du Parti dans l’armée. Ma sœur adoptive et mes deux frères étaient secrétaires du Parti à l’université et à l’usine. Tous les membres de ma famille ont eu l’honneur de séjourner en hôpital privé quand ils étaient malades. Leur chambre jouxtait celle du Premier ministre.
Lu fabriquait des bonnets d’âne politiques. Au cours des réunions, elle désignait toujours une personne qui devait le porter jusqu’au bout. Il fallait toujours en passer par où elle voulait. Des extraits du Drapeau rouge et du Quotidien du peuple jaillissaient de sa bouche comme un torrent. Avec elle, je pensais irrésistiblement à ce que ce serait si les agneaux vivaient avec un loup.
— Un miroir est le symbole du narcissisme, m’a-t-elle dit un jour. C’est un luxe bourgeois.
— Bien sûr, ai-je dit.
Puis j’ai caché mon petit miroir dans ma taie d’oreiller. Je savais que, si elle le voulait, Lu pouvait me taxer de réactionnaire. Elle avait déjà fait subir pareil sort à pas mal de monde. Elle les avait envoyés faire sauter des montagnes à la dynamite pour créer des rizières, ou creuser le sol pour fabriquer un souterrain. Elle s’arrangeait pour qu’ils paient de leur vie. Ceux qui s’en sortaient ressemblaient à Petite-Verdure. Nul n’échappait au prix à payer pour avoir osé répondre à Lu. Elle me faisait si peur.
Curieusement, et parallèlement à cela, elle se donnait un mal fou pour impressionner les soldats, lavant nos vêtements, ou affûtant nos faucilles et nos houes. Chaque soir, elle faisait la tournée des chambrées, nous bordait, s’assurait que nous étions emmitouflées et ne risquerions pas d’attraper froid. Elle envoyait souvent la totalité de son salaire anonymement aux parents malades d’une camarade. Elle recevait beaucoup d’éloges.
— Peu m’importe d’être le chiffon utilisé par le Parti communiste pour nettoyer le coin le plus gras de sa cuisine, aimait-elle dire.
Elle avait le don de ce genre de formules. Nous prétendions aimer le soin qu’elle prenait de nous. Il le fallait bien. Nous écrivions des phrases louangeuses sur le rapport mensuel expédié au quartier général. C’est ce que Lu attendait de nous. Les soldats le savaient par cœur.
Elle notifiait l’incorrection de Yan chaque fois que possible.
— Yan n’est pas assez sévère concernant la réforme de l’esprit, trop laxiste sur le budget de la compagnie, trop impatiente quand elle dirige une session d’étude de la pensée de Mao.
Yan se défendait avec colère. Elle n’était pas douée pour la polémique. Elle n’arrivait pas à la cheville de Lu. Elle tenait des propos incohérents. De désespoir, elle finissait par jurer. Des tas de gros mots de toute sorte qu’elle alignait.
— Plant de riz pourri, cul de cochon, ver de terre fornicateur...
Lu se réjouissait de voir Yan en position fâcheuse. Elle aimait l’acculer sur le terrain de la rhétorique et la battre à plate couture. Ses attaques étaient féroces. Elle montr
J’ai passé la soirée de mes dix-huit ans sous ma moustiquaire. Une anxiété indicible s’était emparée de moi. On se serait cru un chaud après-midi d’été. La moiteur était irritante. L’air était crémeux. Le corps était mûr. Il brûlait. Il criait intérieurement. Il voulait briser ses liens. Il était nerveux et agité.
Les roseaux poussaient sous mon lit. J’ai dû les couper parce qu’ils traversaient ma natte de bambou et m’avaient écorché la joue la nuit précédente. Je devais les arrêter, sans quoi ils me blesseraient. C’était déjà arrivé. Et j’avais extirpé leurs racines. Mais les roseaux étaient indestructibles. Ils étaient déchaînés et résistaient au sel. Quand je les croyais disparus, ils revenaient. Ils jaillissaient de nulle part. Ce devait être le sel. Le sel leur donnait des forces, me disais-je. Ils travaillaient comme les deux doigts de la main. C’étaient eux les vrais fermiers de la Grande-Flamme-Rouge.
Je suis descendue du lit pour me mettre à quatre pattes. J’ai arraché les roseaux et les ai tous cassés en deux. Je suis retournée sous ma moustiquaire, j’ai bien fermé les rideaux et tué trois moustiques. Je les ai écrasés et j’ai observé les taches de sang sur la moustiquaire.
L’agitation me submergeait comme les roseaux, de nulle part. C’était le corps. Ce devait être ça. La jeunesse, le sel. Le corps et l’agitation travaillaient comme les deux doigts de la main. Ils criaient en moi, me cassant en deux.
Je me suis emparée d’un petit miroir pour examiner mon corps, dans ce qu’il a de plus intime. J’ai écouté mon corps. Attentivement. J’ai entendu son trouble, son tourment. Il tentait de saisir quelque chose, un effleurement étranger, il voulait calmer son angoisse, mais en vain. Le corps exigeait une trêve, une rupture d’avec l’esprit, son maître. Il était en colère. Il me menait là où je ne voulais pas aller : je commençais à penser aux hommes. Je rêvais d’être touchée par des mains, plein de mains. Je me dégoûtais.
C’était violent. Mon corps avait faim. Je n’arrivais pas à le faire collaborer avec moi. Je me suis retournée dans mon lit toute la nuit, la solitude m’enveloppait, l’anxiété m’affligeait. Je gisais sur le dos comme si j’étais étendue sur les barreaux d’une grille. Mes mains sur tout mon corps, je ne savais comment retrouver la paix. Je sentais un monstre grandir en moi, un monstre de désir. Chaque jour il prenait plus de place, repoussant mes organes. J’étais sans défense. Je ne voyais aucune issue. La moustiquaire était une tombe avec juste un peu d’air vicié. Je me sentais blessée, mais je ne pouvais pas pleurer. Je devais me retenir parce que personne d’autre ne pleurait dans la chambre. Mes compagnes n’avaient-elles rien en commun avec moi ? Les moustiques me piquaient. Je les cherchais. Ils se rassemblaient dans les coins. Gorgés de sang, ils étaient gros et maladroits. Je visais, tapais. Le moustique s’envolait. J’attendais, donnais la chasse, attendais, visais à nouveau et attaquais. J’en ai eu un. Il était sur ma main, collant, sanguinolent. Le sang du moustique. Mon sang. Tous les soirs je faisais la chasse aux moustiques. Je les ai tous écrabouillés. Les traces de sang sur la moustiquaire affichaient mes succès. Je jouais avec les moustiques aux jambes longues comme des cousins. J’admirais leur élégance. J’en laissais un se poser sur mon genou et je le regardais me piquer. Je le regardais insérer sous ma peau sa petite bouche en forme de paille, je sentais la piqûre. Je le laissais me sucer jusqu’à sa satisfaction. Puis je le pinçais fermement et regardais couler le sang brunâtre.
Tuer les moustiques ne m’apaisait pas. Je ne me reconnaissais plus. Mon esprit n’était plus une perfection d’acier trempé. Je commençais à penser à ces filles en disgrâce rencontrées à l’école. En tant que chef de classe, je devais m’asseoir à côté d’elles pour les aider à retrouver le droit chemin. J’étais supposée les corriger et les influencer. On ne m’a jamais expliqué ce qui n’allait pas chez elles, mais chacun savait qu’on les appelait « La-Sai » – mot d’argot indiquant qu’elles avaient fait des choses honteuses avec des hommes et qu’elles avaient été condamnées par des représentants de la moralité. Ces filles n’avaient aucune pudeur. On les surnommait « porcelaine fêlée ». Personne n’en voulait. Elles n’avaient pas d’avenir. Elles étaient bonnes à jeter à la poubelle. Leur donner une place à mon côté montrait la générosité du Parti communiste. Le Parti n’abandonnait aucun pécheur. Il les sauvait. Je représentais le Parti.
Je les ai côtoyées pendant sept ans : j’ai eu le temps de comprendre que leur cœur était rongé par la honte. J’ai appris à ne jamais me mettre dans leur position, à garder mes distances avec les hommes. J’ai pris exemple sur les femmes modèles célébrées par la société. Les héroïnes des opéras révolutionnaires n’avaient ni mari ni amant. Yan, l’héroïne de ma vie, semblait, elle non plus, n’avoir aucun contact avec les hommes. Se sentait-elle agitée, elle aussi ? Que pensait-elle de son corps ? Ces derniers temps, elle paraissait plus préoccupée. Elle ne discourait plus aux réunions. Elle était boudeuse et ombrageuse. Je l’ai vue essayer de parler à Petite-Verdure. Cette dernière réagissait étrangement. L’air ailleurs, elle jouait avec des roseaux ou avec les boutons d’uniforme de Yan. Elle partait d’un rire hystérique. Yan avait l’air malheureuse et perplexe. Elle secouait les épaules de Petite-Verdure. Elle la suppliait de l’écouter. Mais elle parlait à un légume.
Tard le soir, une fois ma faucille aiguisée, je retournais dans ma chambre m’asseoir près de Petite-Verdure. Mes compagnes étaient affairées. Comparables à des vers à soie au travail, elles tricotaient des chandails, des sacs et des écharpes. Personne ne parlait.
J’allais ensuite sous ma moustiquaire et fermais les rideaux. Je regardais au plafond. La solitude m’envahissait. Je n’étais en rien différente de la vache avec laquelle je travaillais. Je m’incitais à supporter l’existence. Jour après jour, nous cuisions au soleil, à genoux sur le sol dur, plantant des graines de coton et coupant les roseaux. Je m’ennuyais à périr. Mon esprit se rouillait. Quand je transpirais, il ne produisait plus aucune pensée, se contentant de flotter dans la blancheur. Le cerveau se ratatinait dans le sel et séchait au soleil.
Les graines de coton que nous plantions grimpaient à l’air libre comme des êtres prématurés avec des roseaux sauvages tout autour. Les nouvelles pousses ressemblaient à de petits hommes à casquette marron. Dans le soleil du matin, elles étaient mignonnes, mais, quand arrivait midi, elles souffraient du soleil nu et dévastateur. Beaucoup mouraient le soir avant que le brouillard n’ait pu leur offrir son humidité. Quand elles périssaient ou s’étiolaient, leurs casquettes brunes tombaient par terre et les petits hommes se courbaient tristement.
Ceux qui survivaient grandissaient et devenaient plus costauds. Ils luttaient pour gagner encore un jour. En une semaine, les casquettes sautaient et les têtes des petits hommes s’ouvraient en deux. C’étaient les deux premières feuilles des plants. À la ferme de la Grande-Flamme-Rouge, ils ne donnaient jamais comme prévu parce que ces satanées brutes de roseaux suçaient leur eau et leur engrais. Ils étendaient leurs bras et prenaient tout le soleil. Les plants de coton s’inclinaient sur le côté, vivant à l’ombre des roseaux. Les pauvres fleurs faisaient pitié. On aurait dit des veuves au visage rosâtre. Les capsules de coton étaient autant de noix raides, maigres, tordues, dévorées par les insectes cachés au cœur des plants. C’était du coton de la plus mauvaise qualité. Hors norme tant il était piètre. Si parfois il obtenait une qualification, c’était du calibre quatre. Nous ramassions les capsules et les mettions dans des sacs avant de les expédier à une usine de papier. Pas question de les envoyer dans une usine textile.
Moi aussi j’étais une noix toute raide. Je me ratatinais au lieu de m’épanouir. Mais je résistais, je ne voulais pas m’étioler. Je me suis tournée vers Orchidée. J’avais soif. Orchidée avait très envie que nous soyons amies. Elle m’invitait à m’asseoir sur son lit. Elle parlait de points de tricot. Son bavardage était incessant. Elle m’a raconté qu’elle tricotait le même chandail pour la quatrième fois. Elle m’a expliqué les dessins en détail, et m’a dit qu’une fois achevé elle le détricoterait pour recommencer. Le tricot était son plus grand plaisir dans la vie. Elle ne pouvait s’empêcher de tricoter. Rien d’autre ne l’intéressait. Elle fixait les yeux sur ses aiguilles. C’était son horizon. Ses doigts en mouvement me faisaient penser à un criquet en train de mastiquer de l’herbe. Je regardais la pelote se faire dévorer, maille après maille. Je lui suggérais de parler d’autre chose, de l’opéra, par exemple. Elle refusait de m’entendre, continuant de parler tandis que ses mains s’agitaient. Le criquet mastiquait, centimètre après centimètre, heure après heure, jour après jour. J’ai commencé à parler d’opéra. J’ai chanté Écoutons l’enseignement du grand pin vert en haut de la montagne Taï. Orchidée s’est assoupie. Elle s’est glissée sous sa moustiquaire. Bientôt, elle ronflait bruyamment. Je l’aurais tuée. Imaginer ce que serait le reste de ma vie m’enfonçait dans la folie.
Les roseaux poussaient sous mon lit. J’ai dû les couper parce qu’ils traversaient ma natte de bambou et m’avaient écorché la joue la nuit précédente. Je devais les arrêter, sans quoi ils me blesseraient. C’était déjà arrivé. Et j’avais extirpé leurs racines. Mais les roseaux étaient indestructibles. Ils étaient déchaînés et résistaient au sel. Quand je les croyais disparus, ils revenaient. Ils jaillissaient de nulle part. Ce devait être le sel. Le sel leur donnait des forces, me disais-je. Ils travaillaient comme les deux doigts de la main. C’étaient eux les vrais fermiers de la Grande-Flamme-Rouge.
Je suis descendue du lit pour me mettre à quatre pattes. J’ai arraché les roseaux et les ai tous cassés en deux. Je suis retournée sous ma moustiquaire, j’ai bien fermé les rideaux et tué trois moustiques. Je les ai écrasés et j’ai observé les taches de sang sur la moustiquaire.
L’agitation me submergeait comme les roseaux, de nulle part. C’était le corps. Ce devait être ça. La jeunesse, le sel. Le corps et l’agitation travaillaient comme les deux doigts de la main. Ils criaient en moi, me cassant en deux.
Je me suis emparée d’un petit miroir pour examiner mon corps, dans ce qu’il a de plus intime. J’ai écouté mon corps. Attentivement. J’ai entendu son trouble, son tourment. Il tentait de saisir quelque chose, un effleurement étranger, il voulait calmer son angoisse, mais en vain. Le corps exigeait une trêve, une rupture d’avec l’esprit, son maître. Il était en colère. Il me menait là où je ne voulais pas aller : je commençais à penser aux hommes. Je rêvais d’être touchée par des mains, plein de mains. Je me dégoûtais.
C’était violent. Mon corps avait faim. Je n’arrivais pas à le faire collaborer avec moi. Je me suis retournée dans mon lit toute la nuit, la solitude m’enveloppait, l’anxiété m’affligeait. Je gisais sur le dos comme si j’étais étendue sur les barreaux d’une grille. Mes mains sur tout mon corps, je ne savais comment retrouver la paix. Je sentais un monstre grandir en moi, un monstre de désir. Chaque jour il prenait plus de place, repoussant mes organes. J’étais sans défense. Je ne voyais aucune issue. La moustiquaire était une tombe avec juste un peu d’air vicié. Je me sentais blessée, mais je ne pouvais pas pleurer. Je devais me retenir parce que personne d’autre ne pleurait dans la chambre. Mes compagnes n’avaient-elles rien en commun avec moi ? Les moustiques me piquaient. Je les cherchais. Ils se rassemblaient dans les coins. Gorgés de sang, ils étaient gros et maladroits. Je visais, tapais. Le moustique s’envolait. J’attendais, donnais la chasse, attendais, visais à nouveau et attaquais. J’en ai eu un. Il était sur ma main, collant, sanguinolent. Le sang du moustique. Mon sang. Tous les soirs je faisais la chasse aux moustiques. Je les ai tous écrabouillés. Les traces de sang sur la moustiquaire affichaient mes succès. Je jouais avec les moustiques aux jambes longues comme des cousins. J’admirais leur élégance. J’en laissais un se poser sur mon genou et je le regardais me piquer. Je le regardais insérer sous ma peau sa petite bouche en forme de paille, je sentais la piqûre. Je le laissais me sucer jusqu’à sa satisfaction. Puis je le pinçais fermement et regardais couler le sang brunâtre.
Tuer les moustiques ne m’apaisait pas. Je ne me reconnaissais plus. Mon esprit n’était plus une perfection d’acier trempé. Je commençais à penser à ces filles en disgrâce rencontrées à l’école. En tant que chef de classe, je devais m’asseoir à côté d’elles pour les aider à retrouver le droit chemin. J’étais supposée les corriger et les influencer. On ne m’a jamais expliqué ce qui n’allait pas chez elles, mais chacun savait qu’on les appelait « La-Sai » – mot d’argot indiquant qu’elles avaient fait des choses honteuses avec des hommes et qu’elles avaient été condamnées par des représentants de la moralité. Ces filles n’avaient aucune pudeur. On les surnommait « porcelaine fêlée ». Personne n’en voulait. Elles n’avaient pas d’avenir. Elles étaient bonnes à jeter à la poubelle. Leur donner une place à mon côté montrait la générosité du Parti communiste. Le Parti n’abandonnait aucun pécheur. Il les sauvait. Je représentais le Parti.
Je les ai côtoyées pendant sept ans : j’ai eu le temps de comprendre que leur cœur était rongé par la honte. J’ai appris à ne jamais me mettre dans leur position, à garder mes distances avec les hommes. J’ai pris exemple sur les femmes modèles célébrées par la société. Les héroïnes des opéras révolutionnaires n’avaient ni mari ni amant. Yan, l’héroïne de ma vie, semblait, elle non plus, n’avoir aucun contact avec les hommes. Se sentait-elle agitée, elle aussi ? Que pensait-elle de son corps ? Ces derniers temps, elle paraissait plus préoccupée. Elle ne discourait plus aux réunions. Elle était boudeuse et ombrageuse. Je l’ai vue essayer de parler à Petite-Verdure. Cette dernière réagissait étrangement. L’air ailleurs, elle jouait avec des roseaux ou avec les boutons d’uniforme de Yan. Elle partait d’un rire hystérique. Yan avait l’air malheureuse et perplexe. Elle secouait les épaules de Petite-Verdure. Elle la suppliait de l’écouter. Mais elle parlait à un légume.
Tard le soir, une fois ma faucille aiguisée, je retournais dans ma chambre m’asseoir près de Petite-Verdure. Mes compagnes étaient affairées. Comparables à des vers à soie au travail, elles tricotaient des chandails, des sacs et des écharpes. Personne ne parlait.
J’allais ensuite sous ma moustiquaire et fermais les rideaux. Je regardais au plafond. La solitude m’envahissait. Je n’étais en rien différente de la vache avec laquelle je travaillais. Je m’incitais à supporter l’existence. Jour après jour, nous cuisions au soleil, à genoux sur le sol dur, plantant des graines de coton et coupant les roseaux. Je m’ennuyais à périr. Mon esprit se rouillait. Quand je transpirais, il ne produisait plus aucune pensée, se contentant de flotter dans la blancheur. Le cerveau se ratatinait dans le sel et séchait au soleil.
Les graines de coton que nous plantions grimpaient à l’air libre comme des êtres prématurés avec des roseaux sauvages tout autour. Les nouvelles pousses ressemblaient à de petits hommes à casquette marron. Dans le soleil du matin, elles étaient mignonnes, mais, quand arrivait midi, elles souffraient du soleil nu et dévastateur. Beaucoup mouraient le soir avant que le brouillard n’ait pu leur offrir son humidité. Quand elles périssaient ou s’étiolaient, leurs casquettes brunes tombaient par terre et les petits hommes se courbaient tristement.
Ceux qui survivaient grandissaient et devenaient plus costauds. Ils luttaient pour gagner encore un jour. En une semaine, les casquettes sautaient et les têtes des petits hommes s’ouvraient en deux. C’étaient les deux premières feuilles des plants. À la ferme de la Grande-Flamme-Rouge, ils ne donnaient jamais comme prévu parce que ces satanées brutes de roseaux suçaient leur eau et leur engrais. Ils étendaient leurs bras et prenaient tout le soleil. Les plants de coton s’inclinaient sur le côté, vivant à l’ombre des roseaux. Les pauvres fleurs faisaient pitié. On aurait dit des veuves au visage rosâtre. Les capsules de coton étaient autant de noix raides, maigres, tordues, dévorées par les insectes cachés au cœur des plants. C’était du coton de la plus mauvaise qualité. Hors norme tant il était piètre. Si parfois il obtenait une qualification, c’était du calibre quatre. Nous ramassions les capsules et les mettions dans des sacs avant de les expédier à une usine de papier. Pas question de les envoyer dans une usine textile.
Moi aussi j’étais une noix toute raide. Je me ratatinais au lieu de m’épanouir. Mais je résistais, je ne voulais pas m’étioler. Je me suis tournée vers Orchidée. J’avais soif. Orchidée avait très envie que nous soyons amies. Elle m’invitait à m’asseoir sur son lit. Elle parlait de points de tricot. Son bavardage était incessant. Elle m’a raconté qu’elle tricotait le même chandail pour la quatrième fois. Elle m’a expliqué les dessins en détail, et m’a dit qu’une fois achevé elle le détricoterait pour recommencer. Le tricot était son plus grand plaisir dans la vie. Elle ne pouvait s’empêcher de tricoter. Rien d’autre ne l’intéressait. Elle fixait les yeux sur ses aiguilles. C’était son horizon. Ses doigts en mouvement me faisaient penser à un criquet en train de mastiquer de l’herbe. Je regardais la pelote se faire dévorer, maille après maille. Je lui suggérais de parler d’autre chose, de l’opéra, par exemple. Elle refusait de m’entendre, continuant de parler tandis que ses mains s’agitaient. Le criquet mastiquait, centimètre après centimètre, heure après heure, jour après jour. J’ai commencé à parler d’opéra. J’ai chanté Écoutons l’enseignement du grand pin vert en haut de la montagne Taï. Orchidée s’est assoupie. Elle s’est glissée sous sa moustiquaire. Bientôt, elle ronflait bruyamment. Je l’aurais tuée. Imaginer ce que serait le reste de ma vie m’enfonçait dans la folie.
Il s’est interrompu et m’a regardée longtemps, longtemps.
— Tu es si jeune, et tu es belle. Il est heureux que tu ne saches pas grand-chose.
— Quelles étaient tes relations avec la camarade Jiang-Ching ? Il faut que je sache.
— Au contraire. Si tu ne sais rien, on ne te fera aucun mal. N’oublie pas les ténèbres de la nuit, n’oublie pas de marcher dans le sens de l’Histoire, d’observer comme elle a changé, de voir comment on a réveillé les morts pour les faire parler, comment jamais ils ne se sont plaints de ce qu’on a mis dans leur bouche fétide. La puissance de l’Histoire m’a ensorcelé. Admire l’Histoire.
Sa voix s’infiltrait dans tout mon être :
— Azalée-Rouge naîtra en un autre temps, en un autre lieu, j’en suis sûr, a-t-il murmuré. J’aime Azalée-Rouge. Et toi ?
» Les opéras émanent des désirs inassouvis de Jiang-Ching. C’est par ce même désir que les tragédies anciennes font frémir les âmes, et les civilisations qui suivent. C’est de ce même désir qu’a jailli la flamme de la Grande Révolution culturelle.
Il s’est interrompu, a regardé autour de lui et a repris :
— Je ne vois guère d’amoureux sous les buissons ni de masturbateurs, ce soir ; dommage. Le vent chante si joliment dans les feuilles d’érable que cela mériterait beaucoup d’auditeurs. Imagine les collines vertes et les pivoines roses de mon jardin à Pékin. Imagine-nous assis dans la vallée entre les seins de la mère nature. Ferme les yeux, respire le parfum des fleurs. Garde-le toute ta vie. Ouvre le chemin caché de ton esprit, sois en parfaite communion avec lui. Dis-moi comment le vent souffle sur les nuages.
Je me suis laissée dériver dans sa chaleur :
— Tes mains sont le vent. Dans tes mains, mon corps se fait nuage.
— Je suis ardent, et ma passion a la force de la mort.
» J’ai toujours aimé regarder la fumée s’échapper en volutes de la cheminée du crématorium de la Vue-du-Dragon. Je ne crains pas la mort. Je n’ai jamais fait confiance aux livres d’histoire chinois parce qu’ils ont été écrits par des hommes incapables de désirs. Des gens payés par les générations d’empereurs. Des eunuques dont on avait castré les désirs.
» Je veux que tu vives. Que tu vives ma vie. Tu connais mon désir secret. Garde-le, nourris-le pour moi.
Toute frissonnante, j’ai dit en sanglotant :
— C’est promis.
— Serrons-nous fort. Ne parlons pas.
Nous nous sommes étreints. Je sentais la présence de Yan – nous quittions l’obscurité.
— Tu es si jeune, et tu es belle. Il est heureux que tu ne saches pas grand-chose.
— Quelles étaient tes relations avec la camarade Jiang-Ching ? Il faut que je sache.
— Au contraire. Si tu ne sais rien, on ne te fera aucun mal. N’oublie pas les ténèbres de la nuit, n’oublie pas de marcher dans le sens de l’Histoire, d’observer comme elle a changé, de voir comment on a réveillé les morts pour les faire parler, comment jamais ils ne se sont plaints de ce qu’on a mis dans leur bouche fétide. La puissance de l’Histoire m’a ensorcelé. Admire l’Histoire.
Sa voix s’infiltrait dans tout mon être :
— Azalée-Rouge naîtra en un autre temps, en un autre lieu, j’en suis sûr, a-t-il murmuré. J’aime Azalée-Rouge. Et toi ?
» Les opéras émanent des désirs inassouvis de Jiang-Ching. C’est par ce même désir que les tragédies anciennes font frémir les âmes, et les civilisations qui suivent. C’est de ce même désir qu’a jailli la flamme de la Grande Révolution culturelle.
Il s’est interrompu, a regardé autour de lui et a repris :
— Je ne vois guère d’amoureux sous les buissons ni de masturbateurs, ce soir ; dommage. Le vent chante si joliment dans les feuilles d’érable que cela mériterait beaucoup d’auditeurs. Imagine les collines vertes et les pivoines roses de mon jardin à Pékin. Imagine-nous assis dans la vallée entre les seins de la mère nature. Ferme les yeux, respire le parfum des fleurs. Garde-le toute ta vie. Ouvre le chemin caché de ton esprit, sois en parfaite communion avec lui. Dis-moi comment le vent souffle sur les nuages.
Je me suis laissée dériver dans sa chaleur :
— Tes mains sont le vent. Dans tes mains, mon corps se fait nuage.
— Je suis ardent, et ma passion a la force de la mort.
» J’ai toujours aimé regarder la fumée s’échapper en volutes de la cheminée du crématorium de la Vue-du-Dragon. Je ne crains pas la mort. Je n’ai jamais fait confiance aux livres d’histoire chinois parce qu’ils ont été écrits par des hommes incapables de désirs. Des gens payés par les générations d’empereurs. Des eunuques dont on avait castré les désirs.
» Je veux que tu vives. Que tu vives ma vie. Tu connais mon désir secret. Garde-le, nourris-le pour moi.
Toute frissonnante, j’ai dit en sanglotant :
— C’est promis.
— Serrons-nous fort. Ne parlons pas.
Nous nous sommes étreints. Je sentais la présence de Yan – nous quittions l’obscurité.
Lire un extrait
Videos de Anchee Min (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez votre livre dans notre librairie en ligne ! :
Perle de Chine de Anchee Min aux éditions J'ai Lu https://www.lagriffenoire.com/79386-poche-perle-de-chine.html
La culture décontractée !!!!! ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAINE YOUTUBE ! http://www.youtube.com/user/griffenoiretv/featured (merci) La boutique officielle : http://www.lagriffenoire.com
#soutenezpartagezcommentezlgn Merci pour votre soutien et votre amitié qui nous sont inestimables. @Gérard Collard @Jean-Edgar Casel
Perle de Chine de Anchee Min aux éditions J'ai Lu https://www.lagriffenoire.com/79386-poche-perle-de-chine.html
La culture décontractée !!!!! ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAINE YOUTUBE ! http://www.youtube.com/user/griffenoiretv/featured (merci) La boutique officielle : http://www.lagriffenoire.com
#soutenezpartagezcommentezlgn Merci pour votre soutien et votre amitié qui nous sont inestimables. @Gérard Collard @Jean-Edgar Casel
autres livres classés : revolution culturelleVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Anchee Min (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
129 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre129 lecteurs ont répondu