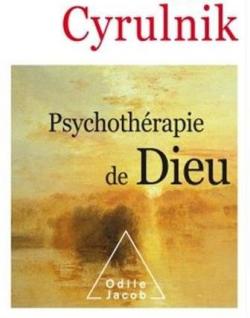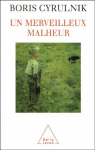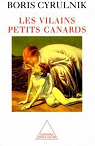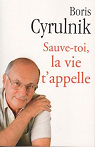Citations sur Psychothérapie de Dieu (122)
Ils étaient apaisés, heureux d’obéir à un imam de pacotille, un gourou religieux qui profitait de leur besoin de soumission pour transformer en gogos de l’islam ces jeunes qui se croyaient rebelles alors qu’ils n’étaient que désorientés, soumis à des mouvements pulsionnels. La plupart des imams sont fréquentables, mais un jeune errant, largué de toute culture, même religieuse, ne sait pas faire la différence.
La spiritualité n'est pas tombée du ciel. Elle a émergé de la rencontre entre un cerveau capable de se représenter un monde totalement absent et un contexte culturel qui donnait forme à cette dimension de l'esprit.
Ces enfants enrôlés dans la guerre de Sécession, dans la Commune de Paris, le nazisme ou le djihadisme sont euphorisés par le projet grandiose proposé par les adultes
Notre système nerveux, en se développant au contact des autres, nous invite à quitter l'immédiateté des stimulations pour habiter un cosmos encore vide.
VIVRE ET AIMER
L'extension discrète de l'athéisme sur la planète contraste avec l'affirmation voyante de toutes les religions. Pourquoi les sans-dieu ne se rendent-ils pas visibles, alors que les croyants consacrent beaucoup de temps à réaliser de magnifiques mises en scène ? Dans d'immenses œuvres d'art que l'on appelle « mosquées », « cathédrales » ou « temples », les fidèles sculptent des statues, peignent des tableaux, disposent des chandeliers, des tapis, des moulures, des tentures, des vitraux, de la vaisselle d'argent, des orgues, des instruments de musique, des cloches, des appels à la prière, des parfums, des postures ou encore des mouvements de foule qui créent de splendides événements de transcendance esthétique. Après de telles représentations, les croyants ont vécu ensemble de fortes expériences, au-dessus de la réalité quotidienne. Ils ont éprouvé des émotions sublimes, ils ont côtoyé Dieu, ils sont apaisés, émerveillés, comme après un acte d'amour. Quand ils redescendent sur terre, ils voient que les sans-dieu ont continué leur insipide train-train. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas condescendants envers ces pauvres humains qui végètent dans l'immanence, alors que les “croyants” viennent de connaître un événement extraordinaire ? Ils méprisent les “non-croyants” plus que ceux qui adorent de faux dieux. Ces croyants-là, pensent-ils, sont dans l'erreur, mais au moins, avec eux, on peut comparer les dieux. On sait de quoi on parle, chacun pense que les dieux et les églises élèvent l'âme et aident à vivre dans un monde meilleur.
Avec les “non-croyants” on ne peut même pas parler, ils rampent sur terre tandis que nous montons vers les cieux. Ne parvenant pas à argumenter, chacun ne peut qu'imaginer le monde mental de l'autre. « Ils gobent des contes de fées », pensent les athées. « Les libres-penseurs sont des individus sans morale et sans rêves puisqu'ils refusent d'appartenir au groupe des croyants solidaires et moraux », affirment les religieux convaincus que seule la foi fonde la morale, l'altruisme et la charité.
p. 192
L'extension discrète de l'athéisme sur la planète contraste avec l'affirmation voyante de toutes les religions. Pourquoi les sans-dieu ne se rendent-ils pas visibles, alors que les croyants consacrent beaucoup de temps à réaliser de magnifiques mises en scène ? Dans d'immenses œuvres d'art que l'on appelle « mosquées », « cathédrales » ou « temples », les fidèles sculptent des statues, peignent des tableaux, disposent des chandeliers, des tapis, des moulures, des tentures, des vitraux, de la vaisselle d'argent, des orgues, des instruments de musique, des cloches, des appels à la prière, des parfums, des postures ou encore des mouvements de foule qui créent de splendides événements de transcendance esthétique. Après de telles représentations, les croyants ont vécu ensemble de fortes expériences, au-dessus de la réalité quotidienne. Ils ont éprouvé des émotions sublimes, ils ont côtoyé Dieu, ils sont apaisés, émerveillés, comme après un acte d'amour. Quand ils redescendent sur terre, ils voient que les sans-dieu ont continué leur insipide train-train. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas condescendants envers ces pauvres humains qui végètent dans l'immanence, alors que les “croyants” viennent de connaître un événement extraordinaire ? Ils méprisent les “non-croyants” plus que ceux qui adorent de faux dieux. Ces croyants-là, pensent-ils, sont dans l'erreur, mais au moins, avec eux, on peut comparer les dieux. On sait de quoi on parle, chacun pense que les dieux et les églises élèvent l'âme et aident à vivre dans un monde meilleur.
Avec les “non-croyants” on ne peut même pas parler, ils rampent sur terre tandis que nous montons vers les cieux. Ne parvenant pas à argumenter, chacun ne peut qu'imaginer le monde mental de l'autre. « Ils gobent des contes de fées », pensent les athées. « Les libres-penseurs sont des individus sans morale et sans rêves puisqu'ils refusent d'appartenir au groupe des croyants solidaires et moraux », affirment les religieux convaincus que seule la foi fonde la morale, l'altruisme et la charité.
p. 192
Entre celui qui croit en Dieu et celui qui n'y croit pas, nous pouvons situer celui qui croit aux super-penseurs, comme Marx, Staline, Freud et bien d'autres. Ces hommes jouiraient d'une intelligence surhumaine qui nous permettrait de comprendre la condition humaine, à condition de bien apprendre leurs idées.
Ces maîtres-penseurs possèdent, eux aussi, une fonction sécurisante et socialisante. Pendant des millénaires ce pouvoir était attribué à papa quand il partait à la chasse ou descendait à la mine pour rapporter à la maison de quoi vivre. Nous avions intérêt à lui obéir, notre bien-être en dépendait. Aujourd'hui Maman part à la chasse, elle aussi. L'image dominatrice et sécurisante est répartie entre les parents, les éducateurs, les philosophes, les écrivains, les comédiens et les chanteurs qu'on voit à la télé. la fonction surhumaine est moins écrasante et plus démocratique, est-elle plus sécurisante ? Ceux qui croient en Mao Zedong, en Socrate ou en Descartes se crispent quand on critique leur rôle intellectuel parce que la référence à ces penseurs surhumains possède un effet socialisant et sécurisant, comme la croyance en Dieu. Partager leurs pensées donne cohérence au groupe. Quand on lit les mêmes livres, les mêmes journaux, quand on va voir les mêmes films et qu'on se réunit pour en parler, on réalise un réseau, en amont d'Internet. Il est plus lent à tisser, mais plus émotionnel. On s'harmonise et on s'affecte en partageant les mêmes idées.
P171-172.
Ces maîtres-penseurs possèdent, eux aussi, une fonction sécurisante et socialisante. Pendant des millénaires ce pouvoir était attribué à papa quand il partait à la chasse ou descendait à la mine pour rapporter à la maison de quoi vivre. Nous avions intérêt à lui obéir, notre bien-être en dépendait. Aujourd'hui Maman part à la chasse, elle aussi. L'image dominatrice et sécurisante est répartie entre les parents, les éducateurs, les philosophes, les écrivains, les comédiens et les chanteurs qu'on voit à la télé. la fonction surhumaine est moins écrasante et plus démocratique, est-elle plus sécurisante ? Ceux qui croient en Mao Zedong, en Socrate ou en Descartes se crispent quand on critique leur rôle intellectuel parce que la référence à ces penseurs surhumains possède un effet socialisant et sécurisant, comme la croyance en Dieu. Partager leurs pensées donne cohérence au groupe. Quand on lit les mêmes livres, les mêmes journaux, quand on va voir les mêmes films et qu'on se réunit pour en parler, on réalise un réseau, en amont d'Internet. Il est plus lent à tisser, mais plus émotionnel. On s'harmonise et on s'affecte en partageant les mêmes idées.
P171-172.
Le totalitarisme qui impose une seule vérité fabrique un monde stable ou règne l'ordre… qui est celui des cimetières.
C'est sur terre qu'il faut travailler à être heureux et non pas après la mort.
« La tentation du Bien est beaucoup plus dangereuse que celle du Mal »
Chaque groupe religieux se caractérise par une manière de voir le monde, de le penser et de s'y comporter. Mais quand la société se dilue, les processus archaïques de socialisation resurgissent et la loi du plus fort gouverne à nouveau. Alors les croyants se replient dans le groupe où ils se sentent protégés. C'est ainsi que se met en place une morale perverse. Les religieux sont solidaires de ceux qui partagent les mêmes croyances, mais ignorent le monde mental des autres et en viennent parfois à se réjouir des malheurs qui frappent ceux qui ne croient pas comme eux, ce qui peut être considéré comme une perversion collective.
En ce sens, le communautarisme est une adaptation à la défaillance culturelle. Quand on ne peut plus fabriquer de structures sociales, quand on se sent mal au sein d'un trop grand nombre d'individus, alors on se réfugie auprès des familiers. C'est une légitime défense, mais dans ce cas l'empathie s'arrête. La capacité à se soucier de la souffrance des autres n'est plus possible dans un grand nombre, on ne peut pas se mettre à la place de tous les humains de la planète ; alors on les laisse mourir.
La culpabilité qui freine nos pulsions aurait donc un effet moral. Quand on découvre que notre désir peut faire du mal à l'Autre, l'empathie freine le passage à l'acte : on ne peut plus tout se permettre. Le tout-petit met plusieurs années pour découvrir que les autres ont un monde mental différent du sien. Ce processus d'orientation vers l'autre ne s'effectue que si l'enfant sécurisé éprouve le plaisir d'explorer un monde différent du sien. Quand la niche affective fonctionne mal, le petit reste autocentré, ignorant que d'autres mondes existent. Il ne parvient pas à comprendre que l'expression sans frein de son désir peut faire du mal à l'autre. Après avoir été pervers jusqu'à l'âge de 4 ans, nous redevenons pervers dans une culture du grand nombre. Le moment de moralité que produit l'empathie se situe entre le faible développement de soi qui rend inaccessible l'altérité et un contexte de surpopulation qui provoque une anomie. Pourrait-on dire que nous sommes des êtres moraux coincés entre deux moments pervers ? Cela expliquerait pourquoi les religions, tout en étant morales, commettent leur part de crime... en toute innocence, et comment toute personne épanouie peut un jour redevenir perverse*.
On a besoin de bordures culturelles pour caractériser le groupe d'appartenance où l'on se sent sécurisé. On a besoin d'un cadre verbal pour énoncer la loi qui définit ce qui est faisable et nous dit à partir de quel comportement on devient transgresseur. À l'inhibition affective acquise au cours de notre développement s'ajoute l'interdit énoncé par la loi. La religion assume ces deux fonctions : le groupe d'appartenance est dessiné par les vêtements, les coupes de cheveux, les lieux où l'on se rencontre, la famille, la société et Dieu. Quant à l'énoncé de la loi, on peut le critiquer quand il est humain, mais l'énoncé divin, lui, n'est pas discutable.
-----
* Cyrulnik B., Todorov T., « La tentation du Bien est beaucoup plus dangereuse que celle du Mal », Le Monde, 30 décembre 2016.
p. 140-41
Chaque groupe religieux se caractérise par une manière de voir le monde, de le penser et de s'y comporter. Mais quand la société se dilue, les processus archaïques de socialisation resurgissent et la loi du plus fort gouverne à nouveau. Alors les croyants se replient dans le groupe où ils se sentent protégés. C'est ainsi que se met en place une morale perverse. Les religieux sont solidaires de ceux qui partagent les mêmes croyances, mais ignorent le monde mental des autres et en viennent parfois à se réjouir des malheurs qui frappent ceux qui ne croient pas comme eux, ce qui peut être considéré comme une perversion collective.
En ce sens, le communautarisme est une adaptation à la défaillance culturelle. Quand on ne peut plus fabriquer de structures sociales, quand on se sent mal au sein d'un trop grand nombre d'individus, alors on se réfugie auprès des familiers. C'est une légitime défense, mais dans ce cas l'empathie s'arrête. La capacité à se soucier de la souffrance des autres n'est plus possible dans un grand nombre, on ne peut pas se mettre à la place de tous les humains de la planète ; alors on les laisse mourir.
La culpabilité qui freine nos pulsions aurait donc un effet moral. Quand on découvre que notre désir peut faire du mal à l'Autre, l'empathie freine le passage à l'acte : on ne peut plus tout se permettre. Le tout-petit met plusieurs années pour découvrir que les autres ont un monde mental différent du sien. Ce processus d'orientation vers l'autre ne s'effectue que si l'enfant sécurisé éprouve le plaisir d'explorer un monde différent du sien. Quand la niche affective fonctionne mal, le petit reste autocentré, ignorant que d'autres mondes existent. Il ne parvient pas à comprendre que l'expression sans frein de son désir peut faire du mal à l'autre. Après avoir été pervers jusqu'à l'âge de 4 ans, nous redevenons pervers dans une culture du grand nombre. Le moment de moralité que produit l'empathie se situe entre le faible développement de soi qui rend inaccessible l'altérité et un contexte de surpopulation qui provoque une anomie. Pourrait-on dire que nous sommes des êtres moraux coincés entre deux moments pervers ? Cela expliquerait pourquoi les religions, tout en étant morales, commettent leur part de crime... en toute innocence, et comment toute personne épanouie peut un jour redevenir perverse*.
On a besoin de bordures culturelles pour caractériser le groupe d'appartenance où l'on se sent sécurisé. On a besoin d'un cadre verbal pour énoncer la loi qui définit ce qui est faisable et nous dit à partir de quel comportement on devient transgresseur. À l'inhibition affective acquise au cours de notre développement s'ajoute l'interdit énoncé par la loi. La religion assume ces deux fonctions : le groupe d'appartenance est dessiné par les vêtements, les coupes de cheveux, les lieux où l'on se rencontre, la famille, la société et Dieu. Quant à l'énoncé de la loi, on peut le critiquer quand il est humain, mais l'énoncé divin, lui, n'est pas discutable.
-----
* Cyrulnik B., Todorov T., « La tentation du Bien est beaucoup plus dangereuse que celle du Mal », Le Monde, 30 décembre 2016.
p. 140-41
La religion est un phénomène humain majeur qui structure la vision du monde, sauve un grand nombre d’individus, organise presque toutes les cultures… et provoque d’immenses malheurs !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Boris Cyrulnik (73)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres de Cyrulnik
Un merveilleux...
jour
malheur
problème
sentiment
10 questions
46 lecteurs ont répondu
Thème :
Boris CyrulnikCréer un quiz sur ce livre46 lecteurs ont répondu