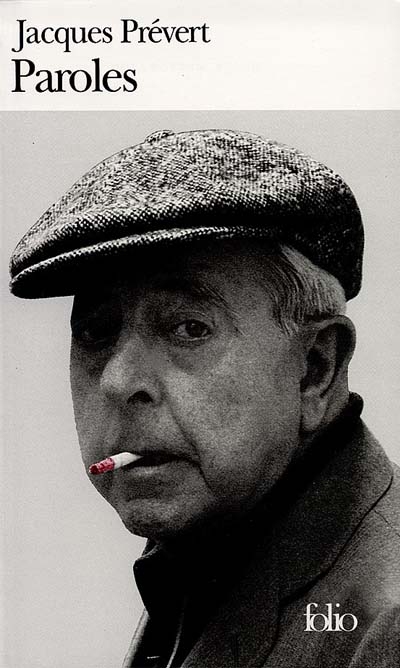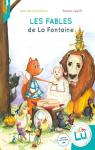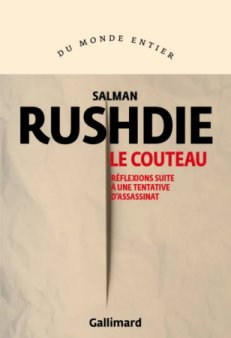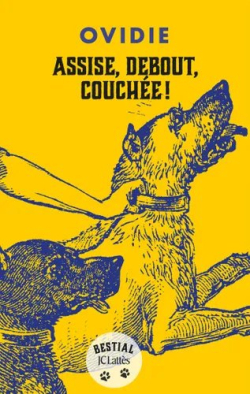Michèle Duclos
L’œuvre de Kenneth White, par son ampleur, son audace intellectuelle et sa force poétique, sort des normes habituelles et reste difficile à appréhender dans son intégralité. Ce livre se donne pour tâche d’en saisir la vivacité, d’en sonder la densité, d’en cartographier la cohérence et d’en dessiner les perspectives. Pour ce faire, il plonge d’abord dans les origines écossaises de l’auteur, évoquant toute une lignée qui va des moines celtes, ermites ou voyag... >Voir plus
EAN : 9782843100710
302 pages
Editions littéraires et linguistique de l'université de Grenoble (01/07/2006)
/5
1 notes
302 pages
Editions littéraires et linguistique de l'université de Grenoble (01/07/2006)
Résumé :
L’œuvre de Kenneth White, par son ampleur, son audace intellectuelle et sa force poétique, sort des normes habituelles et reste difficile à appréhender dans son intégralité. Ce livre se donne pour tâche d’en saisir la vivacité, d’en sonder la densité, d’en cartographier la cohérence et d’en dessiner les perspectives. Pour ce faire, il plonge d’abord dans les origines écossaises de l’auteur, évoquant toute une lignée qui va des moines celtes, ermites ou voyag... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Kenneth White : Nomade intellectuel, poète du mondeVoir plus
Citations et extraits (110)
Voir plus
Ajouter une citation
La ville, reflétée par le poète, révèle, à partir de fondements identiques, des images
qui se transforment radicalement au fil des ans en même temps que se manifestent des
apports culturels nouveaux. Ce n'est point tant le jugement qui change que le degré
d'implication, entre le jeune étudiant prisonnier de son présent individuel, de son « ego
psycho-social », et le penseur ouvert sur le monde. On passe des imprécations bibliques de
Wild Coal, des rougeoiements sataniques de En toute candeur, de la ville dantesque de
Dérives, à la notion de « monde flottant » que White, amoureux des estampes japonaises (il
a écrit un livre sur Hokusaï) reprend à la culture nippone. Il présente sa ville sous cet aspect
dans un essai, « Le Monde flottant de Glasgow », l’année (1989) où Glasgow (l’attitude de
White devant de tels « programmes culturels » est celle d’une distance ironique) était Cité
culturelle européenne :
Passer des pires taudis de l'Europe à une citadelle de la culture en l'espace de
quelques années, cela peut surprendre : que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut connaître un peu l'histoire intime de la
ville, il faut pénétrer derrière les images horripilantes qu'on a voulu donner d'elle
dans la presse à sensation, dans toute une série de mauvais romans, pour retrouver
le contact avec ses énergies primordiales, son espace premier. C'est qu'il y a toujours eu, non seulement « de la culture », à Glasgow, mais une culture qui a été seulement
un peu enfouie sous la crasse, un peu perdue dans les fumées des usines. Cette
culture se promenait sous la pluie en vieille gabardine (ou plutôt en vieux
mackintosh), vivait en ermite dans un deux pièces-cuisine, elle murmurait un poème,
chantonnait une chanson, quelquefois ce n'était qu'un sourire sur les lèvres, une
lueur dans les yeux. Elle fuyait à la fois la culture provinciale insipide (importée
d'Angleterre) et l'horrible Kitsch tartanisé du music-hall que l'on faisait passer pour
authentiquement « scotch » et joyeusement « populaire ».
Quand j'étais étudiant à Glasgow, à la fin des années cinquante, c’étaient ces
traces là que je cherchais. J'aimais le soir, en sortant de la bibliothèque universitaire
et avant d'errer dans les rues, me tenir sur les hauteurs de Gilmorehill à contempler
la ville étalée à mes pieds: le fleuve, les docks, les fumées, les grues... et, le jour,
j'interrompais souvent mes études pour aller faire une petite visite au musée de
Kelvingrove, dont le premier étage était consacré aux maquettes de bateaux et aux
machines, alors que les étages supérieurs abritaient une belle collection de peinture,
notamment de peinture française, rassemblée par un magnat de la marine
marchande, William Burrell, au cours des années qui suivirent la Première Guerre
mondiale. J'aimais aussi flâner dans le vieux centre de la ville, du côté du Trongate,
ou bien je traversais le fleuve par un pont ou sur un bac, et j'allais dans le quartier
sud, du côté des Gorbals. Logé chez un Polonais près des docks, je me prenais
parfois, les soirs d'hiver, pour Dostoïevski à Saint-Pétersbourg. Parfois, les jours de
pluie, pour Nagaï Kafu à Tokyo. Tout en emmagasinant des impressions de la vie
immédiate : la lumière du matin sur Great Western Road, un crépuscule violet sur le
Broomielaw, des mouettes un peu paf piaillant au-dessus de barils de whisky alignés
le long des quais, la fumée grise et rose d'un train quittant la gare de Saint-Enoch. Je
lisais tout ce que je pouvais trouver sur l'histoire de la ville dans les bibliothèques
(notamment la fameuse Mitchell, la plus grande bibliothèque municipale du monde)
ou sur les brouettes des bouquinistes de Renfield Street. Car, tout en cherchant à
savoir où l'on peut aller, il est bon de savoir aussi d'où l'on vient (...) (Atlas-Air
France, mars 1989)
P 44
qui se transforment radicalement au fil des ans en même temps que se manifestent des
apports culturels nouveaux. Ce n'est point tant le jugement qui change que le degré
d'implication, entre le jeune étudiant prisonnier de son présent individuel, de son « ego
psycho-social », et le penseur ouvert sur le monde. On passe des imprécations bibliques de
Wild Coal, des rougeoiements sataniques de En toute candeur, de la ville dantesque de
Dérives, à la notion de « monde flottant » que White, amoureux des estampes japonaises (il
a écrit un livre sur Hokusaï) reprend à la culture nippone. Il présente sa ville sous cet aspect
dans un essai, « Le Monde flottant de Glasgow », l’année (1989) où Glasgow (l’attitude de
White devant de tels « programmes culturels » est celle d’une distance ironique) était Cité
culturelle européenne :
Passer des pires taudis de l'Europe à une citadelle de la culture en l'espace de
quelques années, cela peut surprendre : que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut connaître un peu l'histoire intime de la
ville, il faut pénétrer derrière les images horripilantes qu'on a voulu donner d'elle
dans la presse à sensation, dans toute une série de mauvais romans, pour retrouver
le contact avec ses énergies primordiales, son espace premier. C'est qu'il y a toujours eu, non seulement « de la culture », à Glasgow, mais une culture qui a été seulement
un peu enfouie sous la crasse, un peu perdue dans les fumées des usines. Cette
culture se promenait sous la pluie en vieille gabardine (ou plutôt en vieux
mackintosh), vivait en ermite dans un deux pièces-cuisine, elle murmurait un poème,
chantonnait une chanson, quelquefois ce n'était qu'un sourire sur les lèvres, une
lueur dans les yeux. Elle fuyait à la fois la culture provinciale insipide (importée
d'Angleterre) et l'horrible Kitsch tartanisé du music-hall que l'on faisait passer pour
authentiquement « scotch » et joyeusement « populaire ».
Quand j'étais étudiant à Glasgow, à la fin des années cinquante, c’étaient ces
traces là que je cherchais. J'aimais le soir, en sortant de la bibliothèque universitaire
et avant d'errer dans les rues, me tenir sur les hauteurs de Gilmorehill à contempler
la ville étalée à mes pieds: le fleuve, les docks, les fumées, les grues... et, le jour,
j'interrompais souvent mes études pour aller faire une petite visite au musée de
Kelvingrove, dont le premier étage était consacré aux maquettes de bateaux et aux
machines, alors que les étages supérieurs abritaient une belle collection de peinture,
notamment de peinture française, rassemblée par un magnat de la marine
marchande, William Burrell, au cours des années qui suivirent la Première Guerre
mondiale. J'aimais aussi flâner dans le vieux centre de la ville, du côté du Trongate,
ou bien je traversais le fleuve par un pont ou sur un bac, et j'allais dans le quartier
sud, du côté des Gorbals. Logé chez un Polonais près des docks, je me prenais
parfois, les soirs d'hiver, pour Dostoïevski à Saint-Pétersbourg. Parfois, les jours de
pluie, pour Nagaï Kafu à Tokyo. Tout en emmagasinant des impressions de la vie
immédiate : la lumière du matin sur Great Western Road, un crépuscule violet sur le
Broomielaw, des mouettes un peu paf piaillant au-dessus de barils de whisky alignés
le long des quais, la fumée grise et rose d'un train quittant la gare de Saint-Enoch. Je
lisais tout ce que je pouvais trouver sur l'histoire de la ville dans les bibliothèques
(notamment la fameuse Mitchell, la plus grande bibliothèque municipale du monde)
ou sur les brouettes des bouquinistes de Renfield Street. Car, tout en cherchant à
savoir où l'on peut aller, il est bon de savoir aussi d'où l'on vient (...) (Atlas-Air
France, mars 1989)
P 44
A commencer par le « poète
national » de l'Ecosse, Robert Burns :
C'est au moment où Edimbourg allait vers sa Gloire rationaliste, critique et
scientifique, qu'arriva dans la ville, par la porte de l'Ouest, un génie sorti de la glèbe
et qui allait devenir le « poète national »: Robert Burns. Si Burns est devenu une
référence symbolique en Ecosse, même pour des gens qui connaissent à peine son
œuvre, c'est qu'il incarne des énergies physiques et mentales que l'embourgeoisement
et l’« anglification » progressifs de la culture écossaise allaient petit à petit étouffer.
Burns [...] est loin d'être tout d'une pièce. L'Ecosse n'a pas le monopole de ce que
Baudelaire appelait Homo Duplex (l'homme double), mais nous avons déjà noté la
présence fréquente de ce thème dans la littérature du pays. Burns est non seulement
prisonnier de tendances intérieures contraires, mais il se tient en quelque sorte à la
ligne de partage des eaux de deux cultures : d'un côté une culture indigène forte,
mais de plus en plus réduite ; de l'autre une culture raffinée, mais tendant à
l'artificiel et à la fausse élégance, qui lui venait de ses lectures d'auteurs anglais néoclassiques (...) Il écrit aussi trois langues: un écossais du terroir, un anglais biblique,
et un anglais du Sud et des salons. Toute une problématique culturelle écossaise se
concentre dans la personne de ce « paysan inspiré » (Ec, p.34).
Exubérance, donc, esprit satirique féroce, don de la caricature, goût de la
grotesquerie. Et pourtant quelle tendresse aussi chez Burns ! Une tendresse qui frise
quelquefois la sentimentalité la plus banale, mais qui sait aussi toucher la note la
plus juste, la plus rare (...)
« Quel esprit antithétique ! », s'exclame Lord Byron (lui-même « à moitié
Ecossais par la naissance, entièrement Ecossais par l'éducation », comme il disait),
tendresse, rudesse, délicatesse, brutalité, sentiment, sensualité, pureté et paillardise,
vision et vulgarité – tout cela à l'état de mélange dans une seule motte de glaise
inspirée!
Antithétique, c'est-à-dire Ecossais. Je crois avoir assez insisté là-dessus tout
au long de ce livre.(EKW, p.165-166).
Mais si White lui-même dresse un portrait sympathique du « barde national », d’autres
figures l’intéressent davantage, et il évolue lui-même dans un plus large espace :
Le Celte, tel que je le vois, est un être des lointains. Il ne s'enferme pas dans
un état de choses, il suit son élan. Pour trouver sa véritable identité, il faut aller à
l'autre bout de soi, à l'autre bout du monde, se risquer au-dehors. (PC, p.77).
Il revient à plusieurs reprises sur cette originalité et cette puissance de la vision celte :
« Studieux philologues », « hardis philosophes », « maîtres en grammaire et
en littérature pour tout l'Occident », dit Renan (La Poésie des races celtiques) – qui
allaient sillonner toute l'Europe pendant tout le Moyen Age. On les trouvait dans les
universités, dans les monastères et sur les routes. Si l'on a pu parler, malgré tout
l'obscurantisme, de la « grande clarté » du Moyen Age, il faut reconnaître que cette
clarté fut en grande partie due à des Scot Erigène, à des Richard de Saint Victor et
autres intelligences de la même envergure, au même rayonnement, sorties de la
tradition celte ». (3ème mill, 3, p.29)
P 49
national » de l'Ecosse, Robert Burns :
C'est au moment où Edimbourg allait vers sa Gloire rationaliste, critique et
scientifique, qu'arriva dans la ville, par la porte de l'Ouest, un génie sorti de la glèbe
et qui allait devenir le « poète national »: Robert Burns. Si Burns est devenu une
référence symbolique en Ecosse, même pour des gens qui connaissent à peine son
œuvre, c'est qu'il incarne des énergies physiques et mentales que l'embourgeoisement
et l’« anglification » progressifs de la culture écossaise allaient petit à petit étouffer.
Burns [...] est loin d'être tout d'une pièce. L'Ecosse n'a pas le monopole de ce que
Baudelaire appelait Homo Duplex (l'homme double), mais nous avons déjà noté la
présence fréquente de ce thème dans la littérature du pays. Burns est non seulement
prisonnier de tendances intérieures contraires, mais il se tient en quelque sorte à la
ligne de partage des eaux de deux cultures : d'un côté une culture indigène forte,
mais de plus en plus réduite ; de l'autre une culture raffinée, mais tendant à
l'artificiel et à la fausse élégance, qui lui venait de ses lectures d'auteurs anglais néoclassiques (...) Il écrit aussi trois langues: un écossais du terroir, un anglais biblique,
et un anglais du Sud et des salons. Toute une problématique culturelle écossaise se
concentre dans la personne de ce « paysan inspiré » (Ec, p.34).
Exubérance, donc, esprit satirique féroce, don de la caricature, goût de la
grotesquerie. Et pourtant quelle tendresse aussi chez Burns ! Une tendresse qui frise
quelquefois la sentimentalité la plus banale, mais qui sait aussi toucher la note la
plus juste, la plus rare (...)
« Quel esprit antithétique ! », s'exclame Lord Byron (lui-même « à moitié
Ecossais par la naissance, entièrement Ecossais par l'éducation », comme il disait),
tendresse, rudesse, délicatesse, brutalité, sentiment, sensualité, pureté et paillardise,
vision et vulgarité – tout cela à l'état de mélange dans une seule motte de glaise
inspirée!
Antithétique, c'est-à-dire Ecossais. Je crois avoir assez insisté là-dessus tout
au long de ce livre.(EKW, p.165-166).
Mais si White lui-même dresse un portrait sympathique du « barde national », d’autres
figures l’intéressent davantage, et il évolue lui-même dans un plus large espace :
Le Celte, tel que je le vois, est un être des lointains. Il ne s'enferme pas dans
un état de choses, il suit son élan. Pour trouver sa véritable identité, il faut aller à
l'autre bout de soi, à l'autre bout du monde, se risquer au-dehors. (PC, p.77).
Il revient à plusieurs reprises sur cette originalité et cette puissance de la vision celte :
« Studieux philologues », « hardis philosophes », « maîtres en grammaire et
en littérature pour tout l'Occident », dit Renan (La Poésie des races celtiques) – qui
allaient sillonner toute l'Europe pendant tout le Moyen Age. On les trouvait dans les
universités, dans les monastères et sur les routes. Si l'on a pu parler, malgré tout
l'obscurantisme, de la « grande clarté » du Moyen Age, il faut reconnaître que cette
clarté fut en grande partie due à des Scot Erigène, à des Richard de Saint Victor et
autres intelligences de la même envergure, au même rayonnement, sorties de la
tradition celte ». (3ème mill, 3, p.29)
P 49
Tous les éléments constitutifs de la topographie whitienne (océan, rivage, île,
oiseaux, nord, blancheur), sont liés et appellent la même finalité ontologique, le « vide » que
traduit la prégnance de la lumière. Cette topographie réconcilie nature et culture, jouissance
sensorielle et intensité de la contemplation spirituelle.
Voyons de près les divers espaces de cette topographie, de cette topologie.
L'Océan, tel que le poète l'a vécu tout enfant, est une présence perpétuelle. Mais , à
part la partie de pêche dans « Fishing off Jura » (ETC), on voit peu le poète sur l'eau. Il
pratique plus volontiers la marche le long du rivage et sur l’estran. Depuis le rivage de sable
blond lavé par le vent et la pluie, le poète contemple les îles, abondamment peuplées
d’oiseaux de mer, plus chichement d’habitants humains frustes et taciturnes, et vues comme
des concentrations intenses d'énergie. A travers l'histoire, des moines celtes y ont fondé des
monastères, conservatoires de la culture écrite :
Rodel
Where the young men
Built the beautiful ship
That the sea coveted
And the « great cleric» lived
Who founded the grammar school in Paris
Rodel this evening
Is an empty harbour
A rusty iron wing
And a heap of red seaweed (M, p.54)
Rodel
Où les jeunes hommes
Bâtirent le beau navire
Que la mer convoita
Et où vivait le « grand clerc »
Qui fonda le Collège à Paris
Rodel ce soir
Est une jetée vide
Un anneau de fer rouillé
Un amas d’algues roses (M, p.55)
P 24
oiseaux, nord, blancheur), sont liés et appellent la même finalité ontologique, le « vide » que
traduit la prégnance de la lumière. Cette topographie réconcilie nature et culture, jouissance
sensorielle et intensité de la contemplation spirituelle.
Voyons de près les divers espaces de cette topographie, de cette topologie.
L'Océan, tel que le poète l'a vécu tout enfant, est une présence perpétuelle. Mais , à
part la partie de pêche dans « Fishing off Jura » (ETC), on voit peu le poète sur l'eau. Il
pratique plus volontiers la marche le long du rivage et sur l’estran. Depuis le rivage de sable
blond lavé par le vent et la pluie, le poète contemple les îles, abondamment peuplées
d’oiseaux de mer, plus chichement d’habitants humains frustes et taciturnes, et vues comme
des concentrations intenses d'énergie. A travers l'histoire, des moines celtes y ont fondé des
monastères, conservatoires de la culture écrite :
Rodel
Where the young men
Built the beautiful ship
That the sea coveted
And the « great cleric» lived
Who founded the grammar school in Paris
Rodel this evening
Is an empty harbour
A rusty iron wing
And a heap of red seaweed (M, p.54)
Rodel
Où les jeunes hommes
Bâtirent le beau navire
Que la mer convoita
Et où vivait le « grand clerc »
Qui fonda le Collège à Paris
Rodel ce soir
Est une jetée vide
Un anneau de fer rouillé
Un amas d’algues roses (M, p.55)
P 24
Non seulement la pensée
mais l'écriture de White se fait une, sur l'estran, avec celle de son mentor tout en conservant
son identité et son originalité propres:
J'ai dit comment je voyais Nietzsche lorsque j'étais étudiant et un jeune
écrivain. Comment m'apparaît-il aujourd'hui, trente-sept ans plus tard, depuis mon
«monastère » breton? Eh bien, à la fin d'une journée enchanteresse, en cet aprèsmidi d’ ‘apeiron’ printanier après avoir longtemps marché sur le chemin des
douaniers que bordent d'un côté des boqueteaux de pins d'un vert luisant et de l'autre
l'assaut bleu embrumé de la marée, je le vois qui avance sur une haute crête entre
deux mers.
Cette ‘haute crête’ est celle qu'il évoque dans Naissance de la Philosophie, une
'ligne de crête' qui doit être maintenue pour éviter que la culture ne sombre dans une
confusion et une platitude totales, pour qu'un contact fertile et brillant soit maintenu
entre le passé et le futur. Quant aux deux mers, les interprétations différeront selon
les divers points du chemin. En un endroit, on peut les voir comme la mer de la
création artistique d'un côté et la mer du savoir de l'autre. Nietzsche était à fond
pour le savoir, les sciences humaines et les sciences naturelles qui ont permis de
dépasser la croyance et la foi du Moyen Age et sont encore utiles contre les
obscurantismes récurrents. Mais en soi le savoir n'est pas suffisant - il peut se faire
lourd et encombrant (pensez au chameau de Zarathoustra). Aussi, contre le savoir,
Nietzsche insiste sur la nécessité de l'art et d'un sens esthétique de la vie. Sur la crête
quelque chose se passe qui est au-delà de l'art et du savoir, sans ressembler en quoi
que ce soit à une synthèse hégélienne. En un autre point du chemin, les deux mers
peuvent se voir comme la poésie et la philosophie. Nietzsche n'épargne pas la poésie,
et à juste titre, pour la débarrasser de ses habitudes et de ses ornements. Il hait le
sentiment lyrique, dit que les Chants du Gai Savoir sont d' un poète qui se moque des
poètes’, déclare que les poètes mentent trop et que pour écrire de la bonne prose il
faut être un poète capable de se battre contre la poésie - et en même temps il se
proclame 'poète, à la limite du mot’. Quant à la philosophie, dont il salue la
naissance en lui souhaitant une autre naissance, rares sont les philosophes qui
trouvent grâce à ses yeux à l'exception d' Héraclite - tous les autres, pour lui,
souffrent de blocages ou de maladie. De manière plus abstraite, il répète que le la
tâche du philosophe, telle qu'il l'envisage, est de 'faire résonner au-dedans de lui
l'universelle symphonie et de la projeter hors de lui sous la forme de concepts’. Mais
ailleurs il prétend qu'il y a, parfois, une 'évidence immédiate' qu'il est difficile
d'atteindre au moyen de concepts et de la raison. A nouveau, sur cette crête, quelque
chose se passe qui est au-delà de la poésie et de la philosophie telles qu'on les
comprend habituellement. En un autre point, aussi, il est possible de voir les deux
mers comme l'Orient et l'Occident. Nous savons que toute rencontre avec la pensée
orientale intéressait Nietzsche. Il parle des 'hauteurs de l'atmosphère hindouiste' et
en épigraphe à Aurore il cite le RigVeda: ‘Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui’. Les références à l'Orient abondent dans son oeuvre. En même temps il critiquait
le bouddhisme qu'il jugeait trop négatif, concerné seulement par la cessation de la
souffrance, pas par le ‘gai savoir’, la danse de l'existence, la poétique de la vie. La
raison en est que le bouddhisme était venu à lui dans sa version schopenhauerienne -
il ignorait tout des sphères élevées du Mahayana. Leur connaissance l'aurait
enchanté. Si bien que, dans sa marche sur la crête, je le vois rencontrer de temps à
autre Dogen, ou Hakuin, ou le taoïste Tchouang-tseu... Plus loin à nouveau, je vois
les deux mers comme non-sédentarité (errance incertaine) d'un côté, et de l'autre,
une nouvelle situation, un fondement et une créativité nouveaux. Et finalement, les
deux mers sont celles de la sérénité et de la folie.
J’ai parlé de quelque chose qui 'advient’ sur cette haute crête, quelque chose
qui ne se coule pas aisément dans nos catégories, quelque chose qui advient audessus de toutes les dialectiques querelleuses, les chamailleries localistes, et les
fantaisies d'esprits sous-développés. Cet 'advenir’ n'est pas simplement un ensemble
d'ouvrages, les marques d'une carrière. Il s'agit d'un chemin de vie, de voyages avec
des projections et des conceptions aussi bien que des artefacts. Philosophiquement, il
s'agit de quelque chose qui ne se contente pas de poser des problèmes (philosopherie
universitaire) ou de poser des questions (philosophisme socratique), mais passe par
une ascèse, par une exposition existentielle en forme de psychodrame. Poétiquement,
on s'écarte d'un acte d'écrire qui, avec toute son énergie, son agilité et sa
perspicacité, laisse la littérature loin derrière. 'Que chaque corps se fasse danseur, et
chaque esprit oiseau’, s'écrie-t-il . Disons que l'écriture de Nietzsche est un
battement d'aile de plus en plus rapide à travers des espaces de plus en plus vastes...
Une dernière remarque. Nul, pour moi, ne comprend complètement Nietzsche qui ne
sait pas voir pourquoi, un jour dans une rue de Turin, il a jeté ses bras autour d'un
pauvre vieux cheval de fiacre fatigué.
mais l'écriture de White se fait une, sur l'estran, avec celle de son mentor tout en conservant
son identité et son originalité propres:
J'ai dit comment je voyais Nietzsche lorsque j'étais étudiant et un jeune
écrivain. Comment m'apparaît-il aujourd'hui, trente-sept ans plus tard, depuis mon
«monastère » breton? Eh bien, à la fin d'une journée enchanteresse, en cet aprèsmidi d’ ‘apeiron’ printanier après avoir longtemps marché sur le chemin des
douaniers que bordent d'un côté des boqueteaux de pins d'un vert luisant et de l'autre
l'assaut bleu embrumé de la marée, je le vois qui avance sur une haute crête entre
deux mers.
Cette ‘haute crête’ est celle qu'il évoque dans Naissance de la Philosophie, une
'ligne de crête' qui doit être maintenue pour éviter que la culture ne sombre dans une
confusion et une platitude totales, pour qu'un contact fertile et brillant soit maintenu
entre le passé et le futur. Quant aux deux mers, les interprétations différeront selon
les divers points du chemin. En un endroit, on peut les voir comme la mer de la
création artistique d'un côté et la mer du savoir de l'autre. Nietzsche était à fond
pour le savoir, les sciences humaines et les sciences naturelles qui ont permis de
dépasser la croyance et la foi du Moyen Age et sont encore utiles contre les
obscurantismes récurrents. Mais en soi le savoir n'est pas suffisant - il peut se faire
lourd et encombrant (pensez au chameau de Zarathoustra). Aussi, contre le savoir,
Nietzsche insiste sur la nécessité de l'art et d'un sens esthétique de la vie. Sur la crête
quelque chose se passe qui est au-delà de l'art et du savoir, sans ressembler en quoi
que ce soit à une synthèse hégélienne. En un autre point du chemin, les deux mers
peuvent se voir comme la poésie et la philosophie. Nietzsche n'épargne pas la poésie,
et à juste titre, pour la débarrasser de ses habitudes et de ses ornements. Il hait le
sentiment lyrique, dit que les Chants du Gai Savoir sont d' un poète qui se moque des
poètes’, déclare que les poètes mentent trop et que pour écrire de la bonne prose il
faut être un poète capable de se battre contre la poésie - et en même temps il se
proclame 'poète, à la limite du mot’. Quant à la philosophie, dont il salue la
naissance en lui souhaitant une autre naissance, rares sont les philosophes qui
trouvent grâce à ses yeux à l'exception d' Héraclite - tous les autres, pour lui,
souffrent de blocages ou de maladie. De manière plus abstraite, il répète que le la
tâche du philosophe, telle qu'il l'envisage, est de 'faire résonner au-dedans de lui
l'universelle symphonie et de la projeter hors de lui sous la forme de concepts’. Mais
ailleurs il prétend qu'il y a, parfois, une 'évidence immédiate' qu'il est difficile
d'atteindre au moyen de concepts et de la raison. A nouveau, sur cette crête, quelque
chose se passe qui est au-delà de la poésie et de la philosophie telles qu'on les
comprend habituellement. En un autre point, aussi, il est possible de voir les deux
mers comme l'Orient et l'Occident. Nous savons que toute rencontre avec la pensée
orientale intéressait Nietzsche. Il parle des 'hauteurs de l'atmosphère hindouiste' et
en épigraphe à Aurore il cite le RigVeda: ‘Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui’. Les références à l'Orient abondent dans son oeuvre. En même temps il critiquait
le bouddhisme qu'il jugeait trop négatif, concerné seulement par la cessation de la
souffrance, pas par le ‘gai savoir’, la danse de l'existence, la poétique de la vie. La
raison en est que le bouddhisme était venu à lui dans sa version schopenhauerienne -
il ignorait tout des sphères élevées du Mahayana. Leur connaissance l'aurait
enchanté. Si bien que, dans sa marche sur la crête, je le vois rencontrer de temps à
autre Dogen, ou Hakuin, ou le taoïste Tchouang-tseu... Plus loin à nouveau, je vois
les deux mers comme non-sédentarité (errance incertaine) d'un côté, et de l'autre,
une nouvelle situation, un fondement et une créativité nouveaux. Et finalement, les
deux mers sont celles de la sérénité et de la folie.
J’ai parlé de quelque chose qui 'advient’ sur cette haute crête, quelque chose
qui ne se coule pas aisément dans nos catégories, quelque chose qui advient audessus de toutes les dialectiques querelleuses, les chamailleries localistes, et les
fantaisies d'esprits sous-développés. Cet 'advenir’ n'est pas simplement un ensemble
d'ouvrages, les marques d'une carrière. Il s'agit d'un chemin de vie, de voyages avec
des projections et des conceptions aussi bien que des artefacts. Philosophiquement, il
s'agit de quelque chose qui ne se contente pas de poser des problèmes (philosopherie
universitaire) ou de poser des questions (philosophisme socratique), mais passe par
une ascèse, par une exposition existentielle en forme de psychodrame. Poétiquement,
on s'écarte d'un acte d'écrire qui, avec toute son énergie, son agilité et sa
perspicacité, laisse la littérature loin derrière. 'Que chaque corps se fasse danseur, et
chaque esprit oiseau’, s'écrie-t-il . Disons que l'écriture de Nietzsche est un
battement d'aile de plus en plus rapide à travers des espaces de plus en plus vastes...
Une dernière remarque. Nul, pour moi, ne comprend complètement Nietzsche qui ne
sait pas voir pourquoi, un jour dans une rue de Turin, il a jeté ses bras autour d'un
pauvre vieux cheval de fiacre fatigué.
Le «celtisme » désigne pour White une mentalité, une culture, une attitude
anthropologique combattues, étouffées mais non détruites ni par les conquérants romains ni
par la métaphysique dualiste d’une civilisation « continentale » qui a dominé depuis deux
millénaires notre mode de vie occidental et notre vision du monde ; à cette vision
« continentale » massive, figée, il oppose un mode de vie et pensée « archipélagique »,
« océanique », non coupée du monde naturel.
Non seulement l'art mais aussi la pensée médiévale du Continent fut fécondée par la
vision ardente et claire du réel immédiat, entre autres par les moines celtes ermites ou
errants souvent des lettrés :
Et si la poésie européenne a su garder, malgré tout, de la vigueur et de la
vivacité, c'est grâce à la composante celte de la population et au fond celtique de la
culture.(AT, p.133).
P 69
anthropologique combattues, étouffées mais non détruites ni par les conquérants romains ni
par la métaphysique dualiste d’une civilisation « continentale » qui a dominé depuis deux
millénaires notre mode de vie occidental et notre vision du monde ; à cette vision
« continentale » massive, figée, il oppose un mode de vie et pensée « archipélagique »,
« océanique », non coupée du monde naturel.
Non seulement l'art mais aussi la pensée médiévale du Continent fut fécondée par la
vision ardente et claire du réel immédiat, entre autres par les moines celtes ermites ou
errants souvent des lettrés :
Et si la poésie européenne a su garder, malgré tout, de la vigueur et de la
vivacité, c'est grâce à la composante celte de la population et au fond celtique de la
culture.(AT, p.133).
P 69
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Michèle Duclos (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1231 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1231 lecteurs ont répondu