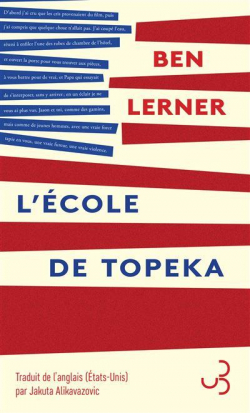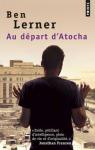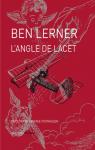Ce roman dense, complexe, semble condenser la société américaine et ses maux, des errements adolescents à l'éveil de la révolte féminine face aux violences, des tromperies maritales à la stigmatisation de "l'autre". Ben Lerner réfléchit aussi, à travers ses quatre protagonistes, à l'Homme comme à la fois unique et partie d'un tout, être de sensations et de langage partageant ses traits singuliers avec le reste de l'espèce humaine (plus de détails : https://pamolico.wordpress.com/2022/09/05/lecole-de-topeka-ben-lerner/)
Lien : https://pamolico.wordpress.c..
Lien : https://pamolico.wordpress.c..
Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Cy9G1VxD7pQ
Tout d'abord, je dois dire que c'est compliqué pour moi de parler de ce roman. Il y a des oeuvres, comme celle-ci, où l'on est totalement dans la réception, dans le plaisir esthétique, ce qui fait qu'on est moins dans l'analyse. Et par ailleurs, c'est compliqué aussi parce que je pense que ce serait peut-être une erreur d'essayer de l'expliquer — de dénouer tous les fils — ce roman n'est pas une énigme à résoudre, c'est bien plus que ça. Bref, il va falloir partir du principe que plus le livre est bon, moins bien je vais en parler. Un roman qui m'avait fait cette impression un peu de gueule de bois béate, gorgée de gratitude, c'était La plus secrète mémoire des hommes, donc attention, grand livre !
De quoi ça parle ? On va y suivre le destin croisé de quatre personnes : Adam, qu'on pourrait qualifier de personnage principal puisqu'il sert de jonction entre tous les autres, un jeune homme en lice pour un championnat de débat, ses parents, Jane, autrice féministe à succès et Jonathan, les deux étant aussi psychologues et Darren, un camarade qui souffre de handicap. Une traversée de l'Amérique des années 50, puisqu'on retourne jusque dans l'enfance et l'adolescence des parents à de celle de Trump, qui permet donc en même temps de parcourir son évolution et ses obessions.
Mon avis
C'est un très bon livre, qui n'est pas loin, assez souvent du Flux de conscience déjà discuté dans Mrs Dalloway, Ulysse ou le bruit et la fureur. D'ailleurs, ce dernier exemple me semble être une source d'inspiration non négligeable, tant dans les thématiques brossées que dans la manière dont elles sont appréhendées.
Tout d'abord, le personnage de Darren, ressemble énormément à celui de Benjamin/Maury dans le livre de Faulkner : deux handicapés, dépersonnalisés, des êtres de sensations plus que de pensées, ce qui permet à Lerner d'expérimenter sa plume, de passer de la matière à l'abstraction, du dehors au-dedans et inversement. C'est lors de ces passages qu'on est dans ce que la pensée peut avoir de plus animal, de plus réactif et pulsionnel — que contrairement aux autres personnages, je pense surtout aux parents — où l'on rationnalise, et où l'on tente de trouver du sens, des explications de l'individu, là, on est dans l'explosion, la dislocation de l'individu. Comme dans le Bruit, les passages de Darren, et dans une moindre mesure d'Adam, ce sont actions, des pensées qui s'enchainent, des changements de temporalité, comme si on était aussi confus que ces deux personnages. Ce qui m'a vraiment mis sur cette route, c'est que Darren, tout comme Benjamin, se raccroche à ses sens, et surtout, à l'odorat — les parties sur Darren évoquent le chèvrefeuille, l'herbe coupée, deux odeurs qu'on retrouve, me semble-t-il, dans la description de Caddy.
On peut aussi comparer ces deux oeuvres dans le sens ou l'inceste est fondateur dans cette famille, comme il l'était dans celle du Bruit et de la fureur — inceste commis ou non, c'est et cela reste une marche branlante, une zone d'ombre, une manière d'incarner une Amérique troublée — précisons par exemple que Topeka est l'une des villes des États libres fondées par les hommes de l'est contre l'esclavagisme, cependant, seulement après une décennie de combats sanglants entre pro- et anti-esclavagistes, ou que la ségrégation raciale n'était pas appliquée … sauf dans les écoles. L'inceste, c'est un peu le fantôme de la famille, tu et refoulé pendant des années par Jane, la mère d'Adam, et ce n'est pas anodin qu'il éclate au moment de la construction d'Adam en tant qu'homme.
« Ils sont là pour évaluer mon fils (pas un homme, évidemment, mais un garçon, un éternel garçon, Peter Pan, un homme-enfant, vu que l'Amérique est une adolescence sans fin).
C'est le sujet du livre. Devenir homme, dans le sens viril, grandir dans l'ombre d'une femme brillante, ce qui aurait pu être vécu comme une émasculation. Devenir homme, c'est passer par plein de petits rites de passages, on pense à l'herbe frottée contre les mains à l'enfance, aux jeux d'alcool de l'adolescence — mais cela peut aussi passer par la face sombre de la masculinité, larvée en chacun d'eux. Plaisir de domination pour Adam, infidélité pour Jonathan, pour Darren, la violence faite à une femme. (ça monte crescendo, mais ça peut s'arrêter, sauf la balle de billard envoyée, comme une manière d'illustrer que la violence ne permet pas de retour en arrière — un enfoncement du personnage de Darren dans cette sobre virilité, lui que l'on retrouve à la fin du livre avec une casquette rouge Make America great again !). Pour Adam, devenir homme, c'est s'affranchir de l'héritage masculin, de ces voix d'hommes qu'il entend enfant au passage de sa mère, « le visage collectif », et que s'affranchir totalement, c'est quasiment impossible (comme cette dernière scène où il souhaite qu'un père de famille, au parc, surveille le comportement tyrannique de son enfant, et que perdant son sang-froid, il lui fait tomber son portable des mains — violence primale et en latence, attendant toujours de ressurgir). « La voix continua en Adam, puis s'effaça, mais il savait qu'elle était quelque part en lui, depuis longtemps et pour longtemps. Comment se débarrasse-t-on d'une voix, comment l'empêche-t-on de faire partie de la sienne ? »
Devenir homme pour Adam, cela passe aussi par le prisme du langage. En effet, comme je l'ai déjà dit, il participe à des concours de débat, et il apprend à dominer son concurrent avec la technique de l'étalement — qui consiste à dire le plus de choses en très peu de temps, une sorte d'empilement des données, difficile à traiter par un cerveau humain. A parler comme un politicien. « un gamin qui imite le langage de la politique et des politiciens, le langage des hommes ». Et grandir, devenir un homme pour lui, passera par la prise de distance avec son modèle dans ce domaine (ou en tout cas, aux yeux de sa mère, car chaque vérité dans ce roman est parcellaire parce que subjective). Retrouver un langage vrai ; dépouillé de toute technique d'ensevelissement de l'autre.
C'est un livre que je vous recommande, il est très subtil, pas forcément simple à appréhender, surtout au début, quand j'ai lu le résumé, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais je suis très contente de l'avoir lu, j'ai passé un très bon moment.
Lien : https://www.youtube.com/watc..
Tout d'abord, je dois dire que c'est compliqué pour moi de parler de ce roman. Il y a des oeuvres, comme celle-ci, où l'on est totalement dans la réception, dans le plaisir esthétique, ce qui fait qu'on est moins dans l'analyse. Et par ailleurs, c'est compliqué aussi parce que je pense que ce serait peut-être une erreur d'essayer de l'expliquer — de dénouer tous les fils — ce roman n'est pas une énigme à résoudre, c'est bien plus que ça. Bref, il va falloir partir du principe que plus le livre est bon, moins bien je vais en parler. Un roman qui m'avait fait cette impression un peu de gueule de bois béate, gorgée de gratitude, c'était La plus secrète mémoire des hommes, donc attention, grand livre !
De quoi ça parle ? On va y suivre le destin croisé de quatre personnes : Adam, qu'on pourrait qualifier de personnage principal puisqu'il sert de jonction entre tous les autres, un jeune homme en lice pour un championnat de débat, ses parents, Jane, autrice féministe à succès et Jonathan, les deux étant aussi psychologues et Darren, un camarade qui souffre de handicap. Une traversée de l'Amérique des années 50, puisqu'on retourne jusque dans l'enfance et l'adolescence des parents à de celle de Trump, qui permet donc en même temps de parcourir son évolution et ses obessions.
Mon avis
C'est un très bon livre, qui n'est pas loin, assez souvent du Flux de conscience déjà discuté dans Mrs Dalloway, Ulysse ou le bruit et la fureur. D'ailleurs, ce dernier exemple me semble être une source d'inspiration non négligeable, tant dans les thématiques brossées que dans la manière dont elles sont appréhendées.
Tout d'abord, le personnage de Darren, ressemble énormément à celui de Benjamin/Maury dans le livre de Faulkner : deux handicapés, dépersonnalisés, des êtres de sensations plus que de pensées, ce qui permet à Lerner d'expérimenter sa plume, de passer de la matière à l'abstraction, du dehors au-dedans et inversement. C'est lors de ces passages qu'on est dans ce que la pensée peut avoir de plus animal, de plus réactif et pulsionnel — que contrairement aux autres personnages, je pense surtout aux parents — où l'on rationnalise, et où l'on tente de trouver du sens, des explications de l'individu, là, on est dans l'explosion, la dislocation de l'individu. Comme dans le Bruit, les passages de Darren, et dans une moindre mesure d'Adam, ce sont actions, des pensées qui s'enchainent, des changements de temporalité, comme si on était aussi confus que ces deux personnages. Ce qui m'a vraiment mis sur cette route, c'est que Darren, tout comme Benjamin, se raccroche à ses sens, et surtout, à l'odorat — les parties sur Darren évoquent le chèvrefeuille, l'herbe coupée, deux odeurs qu'on retrouve, me semble-t-il, dans la description de Caddy.
On peut aussi comparer ces deux oeuvres dans le sens ou l'inceste est fondateur dans cette famille, comme il l'était dans celle du Bruit et de la fureur — inceste commis ou non, c'est et cela reste une marche branlante, une zone d'ombre, une manière d'incarner une Amérique troublée — précisons par exemple que Topeka est l'une des villes des États libres fondées par les hommes de l'est contre l'esclavagisme, cependant, seulement après une décennie de combats sanglants entre pro- et anti-esclavagistes, ou que la ségrégation raciale n'était pas appliquée … sauf dans les écoles. L'inceste, c'est un peu le fantôme de la famille, tu et refoulé pendant des années par Jane, la mère d'Adam, et ce n'est pas anodin qu'il éclate au moment de la construction d'Adam en tant qu'homme.
« Ils sont là pour évaluer mon fils (pas un homme, évidemment, mais un garçon, un éternel garçon, Peter Pan, un homme-enfant, vu que l'Amérique est une adolescence sans fin).
C'est le sujet du livre. Devenir homme, dans le sens viril, grandir dans l'ombre d'une femme brillante, ce qui aurait pu être vécu comme une émasculation. Devenir homme, c'est passer par plein de petits rites de passages, on pense à l'herbe frottée contre les mains à l'enfance, aux jeux d'alcool de l'adolescence — mais cela peut aussi passer par la face sombre de la masculinité, larvée en chacun d'eux. Plaisir de domination pour Adam, infidélité pour Jonathan, pour Darren, la violence faite à une femme. (ça monte crescendo, mais ça peut s'arrêter, sauf la balle de billard envoyée, comme une manière d'illustrer que la violence ne permet pas de retour en arrière — un enfoncement du personnage de Darren dans cette sobre virilité, lui que l'on retrouve à la fin du livre avec une casquette rouge Make America great again !). Pour Adam, devenir homme, c'est s'affranchir de l'héritage masculin, de ces voix d'hommes qu'il entend enfant au passage de sa mère, « le visage collectif », et que s'affranchir totalement, c'est quasiment impossible (comme cette dernière scène où il souhaite qu'un père de famille, au parc, surveille le comportement tyrannique de son enfant, et que perdant son sang-froid, il lui fait tomber son portable des mains — violence primale et en latence, attendant toujours de ressurgir). « La voix continua en Adam, puis s'effaça, mais il savait qu'elle était quelque part en lui, depuis longtemps et pour longtemps. Comment se débarrasse-t-on d'une voix, comment l'empêche-t-on de faire partie de la sienne ? »
Devenir homme pour Adam, cela passe aussi par le prisme du langage. En effet, comme je l'ai déjà dit, il participe à des concours de débat, et il apprend à dominer son concurrent avec la technique de l'étalement — qui consiste à dire le plus de choses en très peu de temps, une sorte d'empilement des données, difficile à traiter par un cerveau humain. A parler comme un politicien. « un gamin qui imite le langage de la politique et des politiciens, le langage des hommes ». Et grandir, devenir un homme pour lui, passera par la prise de distance avec son modèle dans ce domaine (ou en tout cas, aux yeux de sa mère, car chaque vérité dans ce roman est parcellaire parce que subjective). Retrouver un langage vrai ; dépouillé de toute technique d'ensevelissement de l'autre.
C'est un livre que je vous recommande, il est très subtil, pas forcément simple à appréhender, surtout au début, quand j'ai lu le résumé, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais je suis très contente de l'avoir lu, j'ai passé un très bon moment.
Lien : https://www.youtube.com/watc..
J'ai abandonné très vite ce roman sans doute écrit sous une substance quelconque auquel je suis restée totalement hermétique en raison de sa superficialité. le style de l'auteur, quelconque, ne m'a pas retenue plus que ça non plus. Ça s'arrange peut-être ensuite, je ne veux pas décourager les bonnes volontés !
Les critiques semblaient alléchantes...
Malheureusement, au bout de 80 pages j'arrête la lecture.
Impossible de rentrer dans cet univers.
L'histoire ne commence pas, et je ne vois pas où cette suite de pages va mener.
Je préfère passer à autre chose et ne plus perdre de temps à essayer de déchiffrer le message de cet ouvrage qui m'échappe totalement.
Malheureusement, au bout de 80 pages j'arrête la lecture.
Impossible de rentrer dans cet univers.
L'histoire ne commence pas, et je ne vois pas où cette suite de pages va mener.
Je préfère passer à autre chose et ne plus perdre de temps à essayer de déchiffrer le message de cet ouvrage qui m'échappe totalement.
Le livre a traîné longtemps dans ma chambre, doublé par beaucoup d'autres dans la pile. J'ai fini par me lancer. Après une centaine de pages, je ne savais toujours pas où j'allais et si les personnages étaient suffisamment intéressants pour m'embarquer avec eux.
On suit trois (voire quatre) d'entre eux. Les parents et le fils, lycéen pendant la majeure partie du roman, puis père de famille à son tour à la fin.
A mes yeux, le point fort réside dans quelques fulgurances, des remarques très intéressantes, mais pas vraiment dans le récit de cette famille de psys à laquelle on ne s'attache pas et qu'on suit de loin. le sujet est davantage le rapport au langage, la langue, la communication, mais est-ce suffisant ?
On suit trois (voire quatre) d'entre eux. Les parents et le fils, lycéen pendant la majeure partie du roman, puis père de famille à son tour à la fin.
A mes yeux, le point fort réside dans quelques fulgurances, des remarques très intéressantes, mais pas vraiment dans le récit de cette famille de psys à laquelle on ne s'attache pas et qu'on suit de loin. le sujet est davantage le rapport au langage, la langue, la communication, mais est-ce suffisant ?
Ses deux premiers romans nous avaient habitué à un personnage central jouant avec beaucoup d'humour de nombreuses variations sur son rôle d'imposteur. Certains lecteurs pourraient ici être déçus de ne pas y retrouver leurs marques. D'autres pourraient apprécier cette nouvelle ambition donnée par l'auteur à son oeuvre. On remarquera ici une approche plus large, plus complexe et une réflexion plus sociétale. Mais étrangement ce surplus d'ambition lui fait perdre aussi en singularité. A savoir qu'on le voit se ranger dans une filiation de plus en plus nette avec ses pairs, Joyce Carole Oates, Paul Auster ou, de façon plus évidente encore, Philip Roth.
L'École de Topeka : un cas d'école.
L'École de Topeka : un cas d'école.
« L'Ecole de Topeka » est le troisième roman de l'américain Ben Lerner, traduit par par Jakuta Alikavazovic (2022, Christian Bourgois, 416 p.).
Où l'on retrouve la famille Gordon, celle du fils Adam, parti en bourse d'études Fullbright à Madrid, et protagoniste principal de « Au Départ d'Atocha » (2011) également traduit par Jakuta Alikavazovic. (2014, Editions De l'Olivier, 205 p.), la famille Gordon a quitté New York pour Topeka, dans le Kansas. le père Jonathan travaille dans une prestigieuse clinique psychiatrique « La Fondation » où il s'occupe d'adolescents en difficulté. La mère Jane, est également psychologue, écrivain, auteur féministe, déjà célèbre, quoique aussi vivement critiquée. Un fils, Adam, celui qui partira à Madrid, est encore au collège où il rêve de devenir poète. Il est devenu champion de débats oratoires. Ben Lerner narre avec humour les hauts et les bas de la famille Gordon, avec les coups de canifs dans le contrat de mariage des époux. Et surtout, les problèmes d'élever un enfant lorsque l'on travaille en pédopsychiatrie. Avec en parallèle, l'évolution du jeune Darren Eberheart. Un jeune inadapté social qui accumule les expulsions, suite à des brimades et qui réagit par la violence. En toile de fond, les dégâts des réseaux sociaux, le discours machiste et ségrégationniste de « l'homme blanc en colère », dans un Kansas animé sous l'influence de la droite américaine
Le Kansas est un état qui a abolit le décret de l'abolition de l'esclave de 1854. Les élections de 1855 furent l'objet d'un conflit violent, connu sous le nom de « Bleeding Kansas » (Kansas sanglant). Depuis, les colons anti-esclavagistes se sont organisés en tant que parti politique de l'État libre, devenu depuis le Parti Républicain du Kansas, un sous-groupe du « Great Old Party » (GOP) Républicain, l'Eléphant Rouge. L'état es sous influence républicaine déclinante de Bush (62 %) à Trump (57 %). le gouverneur est passé Démocrate en 2022 (49.5 %), avec 3 sénateurs sur 4 Républicains. C'était l'un des états clés des dernières élections.
Le roman contient une bonne partie d'éléments autobiographiques. On peut parler d'autofiction. le jeune Ben Lerner y a grandi, il y a remporté un championnat national de débat oratoire au collège. Comme la mère d'Adam, la mère de Lerner, Harriet Goldhor-Lerner, est une psychologue qui a publié des livres à succès destinés à un public non académique, dont certains traduits. « La Danse de la Colère » (1990, First, 277 p.), « La Valse des Emotions » (1990, First, 219 p.) ), « le Pouvoir Créateur de la Colère » (1994, Editions du Jour, 203 p.). Postulant que « la colère est un signal et mérite d'être écoutée », elle suggère aux femmes « d'identifier les véritables sources de leur colère et à ensuite l'utiliser comme un puissant moyen pour créer un changement durable ».
La fin du livre se déroule à New York, où Adam a déménagé, après s‘être marié et devenu père de deux filles. Ils reviennent à Topeka, pour assister à une conférence d'Adam. Et au retour à New York, ils assistent à une manifestation contre la politique de séparation des familles de l'administration Trump.
Cet aller-retour entre Topeka et New York se veut une description de la « violente crise d'identité parmi les hommes blancs » des années 1990 qui préfigure la montée du populisme et l'élection de Donald Trump. le tout est accompagné, pour ne pas dire attisé par les manifestations de la « Westboro Baptist Church », basée à Topeka. Cette petite organisation religieuse, fondée par Fred Phelps et principalement composée de membres de sa famille, est connu pour ses piquets de grève homophobes et anti-américains, ainsi que pour ses discours de haine contre les athées, les juifs, les musulmans, et plus généralement les personnes transgenres.
Cette crise se rajoute à celle du machisme toxique, illustré par le jeune Darren. Ainsi que l'effondrement du langage en tant que moyen de communication, incarné par la technique du débat. C'est la « diffusion » oratoire où un orateur tente de vaincre son adversaire avec autant d'arguments que possible, quel que soit leur mérite. Elle est illustrée par les joutes oratoires de Adam au collège, épisode qui sera repris dans « Au Départ d'Atocha ». Les techniques des joutes oratoires sont décrites en détail, techniques proposées par le père Jonathan. Cela inclue l'improvisation : « le style libre des nerds », comme ces personnes solitaires, obnubilées par des sujets intellectuels abscons. Ainsi que par « L'étalement » (The Spread) une effusion verbale à grande vitesse. « Pendant quelques secondes, cela ressemble plus ou moins à un discours oratoire, mais bientôt elle accélère à une vitesse presque inintelligible, la hauteur et le volume augmentent. Elle halète comme un nageur qui fait surface, ou qui se noie peut-être ; elle tente de « répartir » leurs adversaires, car ses adversaires tenteront de les répartir à leur tour, c'est-à-dire de présenter plus d'arguments, de rassembler plus de preuves que l'autre équipe ne peut répondre dans le délai imparti ». Cette théorie, développée par Jonathan, se retrouve tout au long du roman, presque comme un fil conducteur, ainsi justifié par son auteur. « Dans des conditions de surcharge d'informations, les mécanismes de la parole s'effondrent ».
Son entraîneur, Evanson, deviendra par la suite un promoteur d'un programme de droite approuvé par l'administration Trump. On pense à Brian K Evenson, qui dans « The Wavering Knife » (2004, Fiction Collective 2, 205 p.) appelle à « spread the word about a unique, genre-busting writer » (répandre les mots pour faire connaitre un écrivain unique, qui casse les genres). Toutefois, j'ignore si BK Evenson est le même que celui qui a écrit « La Conférence des Mutilés » (2008, le Cherche Midi, Lot 49, 228 p.) ou « Baby Leg » (2012, le Cherche Midi, Lot 49, 108 p.). Les sujets et le style étant très différents. J'y reviendrai plus loin.
Pour en revenir à « L'Ecole de Topeka », les premières éditions du livre ont été approuvées et louées et par Sally Rooney, dont les compétences en matière de débat international étaient remarquables - avant qu'elle ne soit véritablement connue. Ce que j'en pensais après avoir lu son second roman « Normal People » traduit par Stéphane Roques (2021, Editions de l'Olivier, 320 p). « En résumé. C'est un livre que je qualifierais de surfait. C'est une prose simpliste, c'est le moins que l'on puisse dire ». Avec des phrases simplistes. « Les cerises pendent aux branches des arbres vert foncé comme autant de boucles d'oreilles ». Trumpisme et populisme.
On constate que le livre de Ben Lerner aborde beaucoup de thèmes, sans doute trop à la fois. Mais l'idée était de faire passer ces idées de crise des « Rednecks », pauvres en milieu rural. Thèmes que l'on trouve déjà dans les romans d'Erskine Caldwell (1903-1987) et ses deux romans des années 30 traduits par Maurice Edgar Coindreau « La Route au Tabac » (2017, Belfond, 220 p.) et « le Petit Arpent du Bon Dieu » (1973, Gallimard, 269 p.).
Globalement, le livre comporte trois perspectives qui recouvrent la famille Gordon. La mère, Jane réfléchit à la vie de sa famille, à ses sombres secrets et surtout aux changements imprévus dus à la célébrité d'un livre à succès. le père, Jonathan est, réfléchit aussi à la vie de famille, mais en s'embarquent dans des relations extérieures. Enfin, Adam le fils cherche des réponses et des explications à des questions qu'il ne maitrise pas. Se rajoutent des sortes de digressions, soit l'entourage immédiat familial, la seconde sur l'extérieur. Donc, au trio familial, Ben Lerner rajoute Darren Eberheart, patient du père, surtout inadapté social soufrant d'un trouble d'apprentissage. Il blesse gravement une fille lors d'une fête qui a repoussé ses avances soi-disant romantiques après des années d'humiliation par ses camarades. Exclusion et de brimades qui conduisent tout naturellement à la violence. Bel exemple de prise en charge par les psychologues de l'établissement. « La parodie d'inclusion qu'ils jouaient avec Darren - leur stagiaire - était aussi une citation et une critique des méthodes de la Fondation »
Parmi les personnages annexes qui contrôlent l'ambiance, il y a là le révérend Fred Phelps de la secte baptiste « « Westboro Baptist Church », homophobe et raciste, qui jette de l'huile sur le feu. Un autre est Klaus, « sûrement le seul homme de Topeka vêtu de lin blanc », sans mentionner la probité. C'est le mentor et père de substitution de Jonathan. Un psychanalyste déjà âgé qui a survécu à la Shoah alors que ses parents et ses trois soeurs étaient assassinés à Auschwitz. C'est un peu aussi le clin d'oeil de Ben Lerner à la communauté, fort active et acheteuse de livres. Klaus pourrait faire partie de la communauté LGBT, autre clin d'oeil marketing. Pour un psychologue, il reste étrangement déconnecté de « La Fondation », du moins des autres professionnels. « le charme de Klaus, du moins pour moi, était que sa voix ressemblait déjà à une imitation d'elle-même ; Klaus était un acteur perplexe de jouer Klaus. Et pourtant, l'effet de ce dédoublement était généreux, autodérision ». Adam le suit et l'écoute jusqu'à sur son lit de mort où il expose les théories fumeuses de Hans Hörbiger (1860-1931) sur la « Welteislehre », ou Théorie de la Glace Eternelle. Théorie qui prétend que tout est glace et retournera en glace, et que tous les corps de l'univers sont constitués de glace. Théorie qui sera reprise par les nazis, puis par la suite par Louis Pauwels et Jacques Bergier dans « le Matin des Magiciens" » (1965, Gallimard, 514 p.).
Comme si les digressions sur les personnes ne suffisaient pas, on a aussi celle dans l'espace-temps. « L'Amérique est une adolescence sans fin ». Je vais finir par le croire. Et c'est à propos d'Adam. « Son problème, c'est que nous lui avons donné une enfance parfaite » disent de lui ses parents, surtout sa mère. Quand Adam et sa petite amie s'embrassent, ils deviennent des véritables figures de style littéraires « Il a goûté le brillant sucré et le tabac, les notes de menthe et de métal qui lui ont fait penser au sang quand il l'a embrassée ». On croirait presque de la publicité pour un rouge à lèvres.
Ce sera aussi l'occasion pour Ben Lerner de présenter ses références à l'art. Dans « Au Départ d'Atocha », il y avait ces scènes quasi extatiques devant « La Descente de Croix » (1435) de van der Weyden. Dans « 10:04 », c'était « Jeanne d'Arc » (1879) de Bastien-Lepage. Là, c'est la « Vierge à l'Enfant » (vers 1300) de Duccio. Eclectisme, mais sujets toujours axés sur la religion.
On en arrive au côté « politique » du roman. Ouf.
A 17 ans, Adam Gordon, est félicité par le sénateur Bob Dole après avoir remporté un tournoi de débat. La scène est censée se passer en 1996 et Dole « était à moins d'un mois d'être écrasé » (49.2 %) par Bill Clinton. Victoire qui confirme la défaite du conservatisme culturel, du moins pour le Kansas, d'où Dole était originaire. Scrutin sans appel de 379 contre 159 grands électeurs. L'histoire de l'ex-sénateur était terminée. Mais en 2019, Adam Gordon, devenu père et vivant à New York sait que l'échec de la candidature présidentielle de Dole ne met pas fin à l'histoire. Il sait, vingt ans après, que le président élu sera une star de télé-réalité raciste qui parle de lui-même à la troisième personne. Ben Lerner repart donc pur un tour, en remettant une pièce dans la machine.
A Topeka, Evanson enseigne à Adam comment compenser son intellectualisme progressiste. Il lui suffit d'afficher ses racines du Midwest, son style « redneck » et son aisance des joutes oratoires. « Cessez votre aisance intellectuelle avec des extraits sonores fades de la décence régionale. Livrez de petites tautologies comme si c'étaient des proverbes ». Toute la panoplie du populisme.
Pour faire, tout de même bonne figure, Adam le plaint parce qu'il est « du mauvais côté de l'histoire qui s'est terminée avec Dole » et est mort quand « les républicains meurent en tant que parti national ». Au lieu de cela, Evanson devient un « architecte clé du poste de gouverneur le plus à droite que le Kansas ait jamais connu. Un modèle important pour l'administration Trump ». Evanson est maître de la propagande, rebaptisée « étalement ».
En résumé, et si l'on peut dire en guise de conclusion. 400 et quelques pages dans lesquelles sont exprimés des tas de choses, de thèmes, le tout sur une petite dizaine de personnages, dont 3 ou 4 principaux. Tout le reste est digression. L'écriture est facile, mais on s'y perd vite à rechercher un fil conducteur global. On a un peu l'impression d'un roman « attrape tout », qui jongle sur des thèmes très variés, sans vraiment aller chaque fois au fond des choses. Un peu la même impression au final que dans « Au Départ d'Atocha », où Adam Gordon reste très passif vis-à-vis de l'attentat terroriste. Passivité voulue, dénoncée certes dans « L'Ecole de Topeka », mais dont le message véritable est enfoui sous d'autres thèmes, qui finissent par brouiller le tout. « Surcharge d'informations » qui fait que « les mécanismes de la parole s'effondrent ». Est-ce une assertion de la théorie de « l'étalement » ou une illustration. Inexorablement, on pense à l'adage de l'étalement à propos de la confiture (ou de la culture).
Où l'on retrouve la famille Gordon, celle du fils Adam, parti en bourse d'études Fullbright à Madrid, et protagoniste principal de « Au Départ d'Atocha » (2011) également traduit par Jakuta Alikavazovic. (2014, Editions De l'Olivier, 205 p.), la famille Gordon a quitté New York pour Topeka, dans le Kansas. le père Jonathan travaille dans une prestigieuse clinique psychiatrique « La Fondation » où il s'occupe d'adolescents en difficulté. La mère Jane, est également psychologue, écrivain, auteur féministe, déjà célèbre, quoique aussi vivement critiquée. Un fils, Adam, celui qui partira à Madrid, est encore au collège où il rêve de devenir poète. Il est devenu champion de débats oratoires. Ben Lerner narre avec humour les hauts et les bas de la famille Gordon, avec les coups de canifs dans le contrat de mariage des époux. Et surtout, les problèmes d'élever un enfant lorsque l'on travaille en pédopsychiatrie. Avec en parallèle, l'évolution du jeune Darren Eberheart. Un jeune inadapté social qui accumule les expulsions, suite à des brimades et qui réagit par la violence. En toile de fond, les dégâts des réseaux sociaux, le discours machiste et ségrégationniste de « l'homme blanc en colère », dans un Kansas animé sous l'influence de la droite américaine
Le Kansas est un état qui a abolit le décret de l'abolition de l'esclave de 1854. Les élections de 1855 furent l'objet d'un conflit violent, connu sous le nom de « Bleeding Kansas » (Kansas sanglant). Depuis, les colons anti-esclavagistes se sont organisés en tant que parti politique de l'État libre, devenu depuis le Parti Républicain du Kansas, un sous-groupe du « Great Old Party » (GOP) Républicain, l'Eléphant Rouge. L'état es sous influence républicaine déclinante de Bush (62 %) à Trump (57 %). le gouverneur est passé Démocrate en 2022 (49.5 %), avec 3 sénateurs sur 4 Républicains. C'était l'un des états clés des dernières élections.
Le roman contient une bonne partie d'éléments autobiographiques. On peut parler d'autofiction. le jeune Ben Lerner y a grandi, il y a remporté un championnat national de débat oratoire au collège. Comme la mère d'Adam, la mère de Lerner, Harriet Goldhor-Lerner, est une psychologue qui a publié des livres à succès destinés à un public non académique, dont certains traduits. « La Danse de la Colère » (1990, First, 277 p.), « La Valse des Emotions » (1990, First, 219 p.) ), « le Pouvoir Créateur de la Colère » (1994, Editions du Jour, 203 p.). Postulant que « la colère est un signal et mérite d'être écoutée », elle suggère aux femmes « d'identifier les véritables sources de leur colère et à ensuite l'utiliser comme un puissant moyen pour créer un changement durable ».
La fin du livre se déroule à New York, où Adam a déménagé, après s‘être marié et devenu père de deux filles. Ils reviennent à Topeka, pour assister à une conférence d'Adam. Et au retour à New York, ils assistent à une manifestation contre la politique de séparation des familles de l'administration Trump.
Cet aller-retour entre Topeka et New York se veut une description de la « violente crise d'identité parmi les hommes blancs » des années 1990 qui préfigure la montée du populisme et l'élection de Donald Trump. le tout est accompagné, pour ne pas dire attisé par les manifestations de la « Westboro Baptist Church », basée à Topeka. Cette petite organisation religieuse, fondée par Fred Phelps et principalement composée de membres de sa famille, est connu pour ses piquets de grève homophobes et anti-américains, ainsi que pour ses discours de haine contre les athées, les juifs, les musulmans, et plus généralement les personnes transgenres.
Cette crise se rajoute à celle du machisme toxique, illustré par le jeune Darren. Ainsi que l'effondrement du langage en tant que moyen de communication, incarné par la technique du débat. C'est la « diffusion » oratoire où un orateur tente de vaincre son adversaire avec autant d'arguments que possible, quel que soit leur mérite. Elle est illustrée par les joutes oratoires de Adam au collège, épisode qui sera repris dans « Au Départ d'Atocha ». Les techniques des joutes oratoires sont décrites en détail, techniques proposées par le père Jonathan. Cela inclue l'improvisation : « le style libre des nerds », comme ces personnes solitaires, obnubilées par des sujets intellectuels abscons. Ainsi que par « L'étalement » (The Spread) une effusion verbale à grande vitesse. « Pendant quelques secondes, cela ressemble plus ou moins à un discours oratoire, mais bientôt elle accélère à une vitesse presque inintelligible, la hauteur et le volume augmentent. Elle halète comme un nageur qui fait surface, ou qui se noie peut-être ; elle tente de « répartir » leurs adversaires, car ses adversaires tenteront de les répartir à leur tour, c'est-à-dire de présenter plus d'arguments, de rassembler plus de preuves que l'autre équipe ne peut répondre dans le délai imparti ». Cette théorie, développée par Jonathan, se retrouve tout au long du roman, presque comme un fil conducteur, ainsi justifié par son auteur. « Dans des conditions de surcharge d'informations, les mécanismes de la parole s'effondrent ».
Son entraîneur, Evanson, deviendra par la suite un promoteur d'un programme de droite approuvé par l'administration Trump. On pense à Brian K Evenson, qui dans « The Wavering Knife » (2004, Fiction Collective 2, 205 p.) appelle à « spread the word about a unique, genre-busting writer » (répandre les mots pour faire connaitre un écrivain unique, qui casse les genres). Toutefois, j'ignore si BK Evenson est le même que celui qui a écrit « La Conférence des Mutilés » (2008, le Cherche Midi, Lot 49, 228 p.) ou « Baby Leg » (2012, le Cherche Midi, Lot 49, 108 p.). Les sujets et le style étant très différents. J'y reviendrai plus loin.
Pour en revenir à « L'Ecole de Topeka », les premières éditions du livre ont été approuvées et louées et par Sally Rooney, dont les compétences en matière de débat international étaient remarquables - avant qu'elle ne soit véritablement connue. Ce que j'en pensais après avoir lu son second roman « Normal People » traduit par Stéphane Roques (2021, Editions de l'Olivier, 320 p). « En résumé. C'est un livre que je qualifierais de surfait. C'est une prose simpliste, c'est le moins que l'on puisse dire ». Avec des phrases simplistes. « Les cerises pendent aux branches des arbres vert foncé comme autant de boucles d'oreilles ». Trumpisme et populisme.
On constate que le livre de Ben Lerner aborde beaucoup de thèmes, sans doute trop à la fois. Mais l'idée était de faire passer ces idées de crise des « Rednecks », pauvres en milieu rural. Thèmes que l'on trouve déjà dans les romans d'Erskine Caldwell (1903-1987) et ses deux romans des années 30 traduits par Maurice Edgar Coindreau « La Route au Tabac » (2017, Belfond, 220 p.) et « le Petit Arpent du Bon Dieu » (1973, Gallimard, 269 p.).
Globalement, le livre comporte trois perspectives qui recouvrent la famille Gordon. La mère, Jane réfléchit à la vie de sa famille, à ses sombres secrets et surtout aux changements imprévus dus à la célébrité d'un livre à succès. le père, Jonathan est, réfléchit aussi à la vie de famille, mais en s'embarquent dans des relations extérieures. Enfin, Adam le fils cherche des réponses et des explications à des questions qu'il ne maitrise pas. Se rajoutent des sortes de digressions, soit l'entourage immédiat familial, la seconde sur l'extérieur. Donc, au trio familial, Ben Lerner rajoute Darren Eberheart, patient du père, surtout inadapté social soufrant d'un trouble d'apprentissage. Il blesse gravement une fille lors d'une fête qui a repoussé ses avances soi-disant romantiques après des années d'humiliation par ses camarades. Exclusion et de brimades qui conduisent tout naturellement à la violence. Bel exemple de prise en charge par les psychologues de l'établissement. « La parodie d'inclusion qu'ils jouaient avec Darren - leur stagiaire - était aussi une citation et une critique des méthodes de la Fondation »
Parmi les personnages annexes qui contrôlent l'ambiance, il y a là le révérend Fred Phelps de la secte baptiste « « Westboro Baptist Church », homophobe et raciste, qui jette de l'huile sur le feu. Un autre est Klaus, « sûrement le seul homme de Topeka vêtu de lin blanc », sans mentionner la probité. C'est le mentor et père de substitution de Jonathan. Un psychanalyste déjà âgé qui a survécu à la Shoah alors que ses parents et ses trois soeurs étaient assassinés à Auschwitz. C'est un peu aussi le clin d'oeil de Ben Lerner à la communauté, fort active et acheteuse de livres. Klaus pourrait faire partie de la communauté LGBT, autre clin d'oeil marketing. Pour un psychologue, il reste étrangement déconnecté de « La Fondation », du moins des autres professionnels. « le charme de Klaus, du moins pour moi, était que sa voix ressemblait déjà à une imitation d'elle-même ; Klaus était un acteur perplexe de jouer Klaus. Et pourtant, l'effet de ce dédoublement était généreux, autodérision ». Adam le suit et l'écoute jusqu'à sur son lit de mort où il expose les théories fumeuses de Hans Hörbiger (1860-1931) sur la « Welteislehre », ou Théorie de la Glace Eternelle. Théorie qui prétend que tout est glace et retournera en glace, et que tous les corps de l'univers sont constitués de glace. Théorie qui sera reprise par les nazis, puis par la suite par Louis Pauwels et Jacques Bergier dans « le Matin des Magiciens" » (1965, Gallimard, 514 p.).
Comme si les digressions sur les personnes ne suffisaient pas, on a aussi celle dans l'espace-temps. « L'Amérique est une adolescence sans fin ». Je vais finir par le croire. Et c'est à propos d'Adam. « Son problème, c'est que nous lui avons donné une enfance parfaite » disent de lui ses parents, surtout sa mère. Quand Adam et sa petite amie s'embrassent, ils deviennent des véritables figures de style littéraires « Il a goûté le brillant sucré et le tabac, les notes de menthe et de métal qui lui ont fait penser au sang quand il l'a embrassée ». On croirait presque de la publicité pour un rouge à lèvres.
Ce sera aussi l'occasion pour Ben Lerner de présenter ses références à l'art. Dans « Au Départ d'Atocha », il y avait ces scènes quasi extatiques devant « La Descente de Croix » (1435) de van der Weyden. Dans « 10:04 », c'était « Jeanne d'Arc » (1879) de Bastien-Lepage. Là, c'est la « Vierge à l'Enfant » (vers 1300) de Duccio. Eclectisme, mais sujets toujours axés sur la religion.
On en arrive au côté « politique » du roman. Ouf.
A 17 ans, Adam Gordon, est félicité par le sénateur Bob Dole après avoir remporté un tournoi de débat. La scène est censée se passer en 1996 et Dole « était à moins d'un mois d'être écrasé » (49.2 %) par Bill Clinton. Victoire qui confirme la défaite du conservatisme culturel, du moins pour le Kansas, d'où Dole était originaire. Scrutin sans appel de 379 contre 159 grands électeurs. L'histoire de l'ex-sénateur était terminée. Mais en 2019, Adam Gordon, devenu père et vivant à New York sait que l'échec de la candidature présidentielle de Dole ne met pas fin à l'histoire. Il sait, vingt ans après, que le président élu sera une star de télé-réalité raciste qui parle de lui-même à la troisième personne. Ben Lerner repart donc pur un tour, en remettant une pièce dans la machine.
A Topeka, Evanson enseigne à Adam comment compenser son intellectualisme progressiste. Il lui suffit d'afficher ses racines du Midwest, son style « redneck » et son aisance des joutes oratoires. « Cessez votre aisance intellectuelle avec des extraits sonores fades de la décence régionale. Livrez de petites tautologies comme si c'étaient des proverbes ». Toute la panoplie du populisme.
Pour faire, tout de même bonne figure, Adam le plaint parce qu'il est « du mauvais côté de l'histoire qui s'est terminée avec Dole » et est mort quand « les républicains meurent en tant que parti national ». Au lieu de cela, Evanson devient un « architecte clé du poste de gouverneur le plus à droite que le Kansas ait jamais connu. Un modèle important pour l'administration Trump ». Evanson est maître de la propagande, rebaptisée « étalement ».
En résumé, et si l'on peut dire en guise de conclusion. 400 et quelques pages dans lesquelles sont exprimés des tas de choses, de thèmes, le tout sur une petite dizaine de personnages, dont 3 ou 4 principaux. Tout le reste est digression. L'écriture est facile, mais on s'y perd vite à rechercher un fil conducteur global. On a un peu l'impression d'un roman « attrape tout », qui jongle sur des thèmes très variés, sans vraiment aller chaque fois au fond des choses. Un peu la même impression au final que dans « Au Départ d'Atocha », où Adam Gordon reste très passif vis-à-vis de l'attentat terroriste. Passivité voulue, dénoncée certes dans « L'Ecole de Topeka », mais dont le message véritable est enfoui sous d'autres thèmes, qui finissent par brouiller le tout. « Surcharge d'informations » qui fait que « les mécanismes de la parole s'effondrent ». Est-ce une assertion de la théorie de « l'étalement » ou une illustration. Inexorablement, on pense à l'adage de l'étalement à propos de la confiture (ou de la culture).
Particulièrement peu aisé à résumer, ce roman très remarqué lors du dernier festival America de Vincennes et finaliste Pulitzer 2020, raconte l'histoire d'une famille dont Jonathan, le père est psychologue au sein la prestigieuse
Fondation de Topeka au Kansas, Jane, la mère est une écrivaine féministe ayant rencontré le succès grâce à un livre sur le couple et Adam, leur fils, est quant à lui champion de débat et d'éloquence et se rêve poète.
En parallèle et en pointillés de cette histoire, on découvre également le destin de Darren, jeune garçon naïf, dont l'exclusion dont il sera victime engendrera un cycle de violence.
À travers ses trois voix singulières et disonnantes , Ben Lerner dresse un portrait de l'Amérique de la fin des années 1990 avec ses failles et ses dérives dans une dissection au scalpel d'une Amérique à la dérive ...
Ce roman dense, complexe, fouillé, brillant, semble condenser la société américaine et ses maux, ses pouvoirs d'influence, ses errements adolescents à l'éveil de la révolte féminine face aux violences, ses tromperies maritales , ses haines de l'étranger..
.L'Amérique de la fin des années 90 dans une niche intellectuelle pour dire l'Amérique d'aujourd'hui.
Histoire familiale aussi bien que sociale, « L'école de Topeka » avec un petit côté David Lodge 2.0 marque durablement les esprits.
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Fondation de Topeka au Kansas, Jane, la mère est une écrivaine féministe ayant rencontré le succès grâce à un livre sur le couple et Adam, leur fils, est quant à lui champion de débat et d'éloquence et se rêve poète.
En parallèle et en pointillés de cette histoire, on découvre également le destin de Darren, jeune garçon naïf, dont l'exclusion dont il sera victime engendrera un cycle de violence.
À travers ses trois voix singulières et disonnantes , Ben Lerner dresse un portrait de l'Amérique de la fin des années 1990 avec ses failles et ses dérives dans une dissection au scalpel d'une Amérique à la dérive ...
Ce roman dense, complexe, fouillé, brillant, semble condenser la société américaine et ses maux, ses pouvoirs d'influence, ses errements adolescents à l'éveil de la révolte féminine face aux violences, ses tromperies maritales , ses haines de l'étranger..
.L'Amérique de la fin des années 90 dans une niche intellectuelle pour dire l'Amérique d'aujourd'hui.
Histoire familiale aussi bien que sociale, « L'école de Topeka » avec un petit côté David Lodge 2.0 marque durablement les esprits.
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Ben Lerner est un nom à retenir. Ayant souvent été second couteau des sorties d'auteurs américains jusqu'à ce jour – quelques fulgurances dans ses poésies et ses précédents romans – n'auront pas permis de faire reconnaître son talent à sa juste valeur. Un talent indéniable qui prend tout son envol dans ce magistral nouveau roman publié par les éditions Bourgois, avec la traduction virtuose de Jakuta Alikavazovic. Mais de quoi « Ben Lerner » est-il le nom ?
Ce fils de psychiatres, enseignant de littérature au Brooklyn college, n'en est pas à son coup d'essai, et n'est pas inconnu des lecteurs français les plus assidus. Ainsi, nous avions pu le découvrir avec « Au départ d'Atocha » ( l'Olivier, 2014), puis 10 :04 ( l'Olivier, 2016), ainsi qu'un recueil de poésie, à savoir « Angle de lacet » ( éditons Joca Seria, 2019). Un auteur quasi-confidentiel, comme un Stephen Markley, ou encore John Wray, impressionnant par sa virtuosité, mais ne rencontrant jamais le succès d'un Jonathan Franzen ou Philip Roth, car oui, son talent impose la comparaison.
« Lécole de Topeka » raconte la vie et les atermoiements de la famille Gordon, dignes citoyens américains issus de la classe moyenne. Nous suivons Adam le fils, champion de joutes oratoires, le père Jonathan et la mère Jane, tous les deux psychiatres travaillant à la Fondation, dans la ville de Topeka dans le Kansas. Cette famille en apparence soudée, mais au parcours aussi singulier que tout à chacun, se retrouvant confrontée à une époque changeante, à un entourage inconstant et aux questionnements existentielles qui peuvent s'imposer au cours du cheminement de vie. Enfin, nous suivons Darren, son témoignage, par petite bribe, venant compléter ainsi un tableau d'un milieu et d'une époque.
Ben Lerner, ne propose pas moins que d'ausculter avec minutie, et maniérisme, l'Amérique des années 90, mais plus globalement les sociétés occidentales capitalistes de cette époque à l'heure des dérèglements. Qu'il s'agit-ce de la confrontation d'idéaux, de changement de dogme sociétal, notamment les confrontations entre patriarcat et émancipation de la femme, mais aussi l'aliénation du succès ou encore le délitement du couple face à une routine consumériste, et la perte de sens dans un monde de plus en plus rapide et superficiel. Chacun incarnant à tour de rôle, symboliquement une problématique et son questionnement inhérent, tout en construisant un lien, même ténu avec les autres membres de la famille, donnant ainsi une cohérence d'ensemble vertigineuse.
“puis nous sommes arrivés devant La Vierge À L'Enfant de Duccio, y sommes restés plusieurs minutes; mes mâchoires se serraient et se desserraient involontairement tandis que nous le regardions. Les vieux tableaux m'ennuyaient habituellement, mais celui-ci me stupéfia. L'expression de la femme, comme si elle savait les choses d'avance, comme si elle était à même d'anticiper une récurrence distante. le parapet étrange sous les silhouettes, sa façon de lier le monde sacré et celui des spectateurs. Un instant, le fond doré me semblait plat; le suivant, il n'était que profondeur. Mais ce qui m'a réellement fasciné, ce qui m'a réellement ému, n'était pas dans le tableau : c'était le fait que le bord inférieur du cadre portait des brûlures de bougie. Des traces d'un vieux procédé d'éclairage, l'ombre de la dévotion. le cartel affirmait que le tableau avait contribué à inaugurer la Renaissance parce que Duccio avait réimaginé la Madone et le Christ en des termes issus du quotidien. En ce sens, c'était une façon de se détourner du sacré, les tableaux devenant progressivement des objets de contemplation esthétique, détachés de la religion, détachés des autels, libres ou condamnés à circuler dans l'espace du musée et celui du marché. Mais les brûlures étaient comme l'empreinte digitale d'une époque révolue – avant que Ziegler et ses camarades ne décrètent que les sources traditionnelles de valeur n'étaient que superstition. Ces ” milliers de générations de progrès technique” ont oblitéré tout rituel, vidé les choses de tout sens, une glossolalie sans divinité. J' ai décidé, moi, que c'est cela qu'elle voyait, cette mère peinte, qu'elle faisait ses adieux aux chandelles, qu'elle se savait prisonnière d'un tableau adressé à l'avenir, où il ne pourrait être, en dépit de sa grandeur, qu'une instance de savoir-faire, de maîtrise technique. de nouvelles fissures apparaissaient à la surface, sous mes yeux. Dans mon souvenir, les larmes me sont montés.“
Mais le plus impressionnant, à la lecture de « Lécole de Topeka », c'est le style de l'auteur, nous sommes face à un écrivain possédant une écriture, un style, un regard propre à lui-même une signature donnant une grandeur au tout. Les pensées et les digressions des personnages se font d'une intensité rare. On en vient presque à ressentir une mélancolie et une urgence du constat. Et cette stylistique fonctionne à chaque fois. Que l'on parle d'un tableau, de la perception de la célébrité, du rapport à ses confrères, ou encore de la perte d'une amitié, tout devient à la fois métaphysique et intime, comme une collision entre le sublime et le banal.
On pourra relever les similitudes entre Adam et sa famille avec l'auteur et ses parents, il y a une base commune, mais ceci ne justifie nullement le talent derrière cet oeuvre. « L'école de Topeka » est un grand roman, pas un grand roman américain, il est au-delà, s'inscrivant comme témoin d'une névrose universelle, dans une vérité du sublime et du crasseux, il est ce grand roman que l'on aime ouvrir et se prendre en pleine face page après page. Une sacrée claque !
Lien : https://www.undernierlivre.n..
Ce fils de psychiatres, enseignant de littérature au Brooklyn college, n'en est pas à son coup d'essai, et n'est pas inconnu des lecteurs français les plus assidus. Ainsi, nous avions pu le découvrir avec « Au départ d'Atocha » ( l'Olivier, 2014), puis 10 :04 ( l'Olivier, 2016), ainsi qu'un recueil de poésie, à savoir « Angle de lacet » ( éditons Joca Seria, 2019). Un auteur quasi-confidentiel, comme un Stephen Markley, ou encore John Wray, impressionnant par sa virtuosité, mais ne rencontrant jamais le succès d'un Jonathan Franzen ou Philip Roth, car oui, son talent impose la comparaison.
« Lécole de Topeka » raconte la vie et les atermoiements de la famille Gordon, dignes citoyens américains issus de la classe moyenne. Nous suivons Adam le fils, champion de joutes oratoires, le père Jonathan et la mère Jane, tous les deux psychiatres travaillant à la Fondation, dans la ville de Topeka dans le Kansas. Cette famille en apparence soudée, mais au parcours aussi singulier que tout à chacun, se retrouvant confrontée à une époque changeante, à un entourage inconstant et aux questionnements existentielles qui peuvent s'imposer au cours du cheminement de vie. Enfin, nous suivons Darren, son témoignage, par petite bribe, venant compléter ainsi un tableau d'un milieu et d'une époque.
Ben Lerner, ne propose pas moins que d'ausculter avec minutie, et maniérisme, l'Amérique des années 90, mais plus globalement les sociétés occidentales capitalistes de cette époque à l'heure des dérèglements. Qu'il s'agit-ce de la confrontation d'idéaux, de changement de dogme sociétal, notamment les confrontations entre patriarcat et émancipation de la femme, mais aussi l'aliénation du succès ou encore le délitement du couple face à une routine consumériste, et la perte de sens dans un monde de plus en plus rapide et superficiel. Chacun incarnant à tour de rôle, symboliquement une problématique et son questionnement inhérent, tout en construisant un lien, même ténu avec les autres membres de la famille, donnant ainsi une cohérence d'ensemble vertigineuse.
“puis nous sommes arrivés devant La Vierge À L'Enfant de Duccio, y sommes restés plusieurs minutes; mes mâchoires se serraient et se desserraient involontairement tandis que nous le regardions. Les vieux tableaux m'ennuyaient habituellement, mais celui-ci me stupéfia. L'expression de la femme, comme si elle savait les choses d'avance, comme si elle était à même d'anticiper une récurrence distante. le parapet étrange sous les silhouettes, sa façon de lier le monde sacré et celui des spectateurs. Un instant, le fond doré me semblait plat; le suivant, il n'était que profondeur. Mais ce qui m'a réellement fasciné, ce qui m'a réellement ému, n'était pas dans le tableau : c'était le fait que le bord inférieur du cadre portait des brûlures de bougie. Des traces d'un vieux procédé d'éclairage, l'ombre de la dévotion. le cartel affirmait que le tableau avait contribué à inaugurer la Renaissance parce que Duccio avait réimaginé la Madone et le Christ en des termes issus du quotidien. En ce sens, c'était une façon de se détourner du sacré, les tableaux devenant progressivement des objets de contemplation esthétique, détachés de la religion, détachés des autels, libres ou condamnés à circuler dans l'espace du musée et celui du marché. Mais les brûlures étaient comme l'empreinte digitale d'une époque révolue – avant que Ziegler et ses camarades ne décrètent que les sources traditionnelles de valeur n'étaient que superstition. Ces ” milliers de générations de progrès technique” ont oblitéré tout rituel, vidé les choses de tout sens, une glossolalie sans divinité. J' ai décidé, moi, que c'est cela qu'elle voyait, cette mère peinte, qu'elle faisait ses adieux aux chandelles, qu'elle se savait prisonnière d'un tableau adressé à l'avenir, où il ne pourrait être, en dépit de sa grandeur, qu'une instance de savoir-faire, de maîtrise technique. de nouvelles fissures apparaissaient à la surface, sous mes yeux. Dans mon souvenir, les larmes me sont montés.“
Mais le plus impressionnant, à la lecture de « Lécole de Topeka », c'est le style de l'auteur, nous sommes face à un écrivain possédant une écriture, un style, un regard propre à lui-même une signature donnant une grandeur au tout. Les pensées et les digressions des personnages se font d'une intensité rare. On en vient presque à ressentir une mélancolie et une urgence du constat. Et cette stylistique fonctionne à chaque fois. Que l'on parle d'un tableau, de la perception de la célébrité, du rapport à ses confrères, ou encore de la perte d'une amitié, tout devient à la fois métaphysique et intime, comme une collision entre le sublime et le banal.
On pourra relever les similitudes entre Adam et sa famille avec l'auteur et ses parents, il y a une base commune, mais ceci ne justifie nullement le talent derrière cet oeuvre. « L'école de Topeka » est un grand roman, pas un grand roman américain, il est au-delà, s'inscrivant comme témoin d'une névrose universelle, dans une vérité du sublime et du crasseux, il est ce grand roman que l'on aime ouvrir et se prendre en pleine face page après page. Une sacrée claque !
Lien : https://www.undernierlivre.n..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ben Lerner (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3247 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3247 lecteurs ont répondu