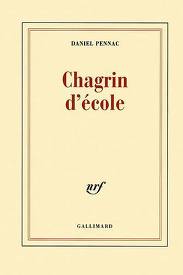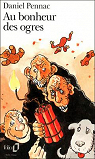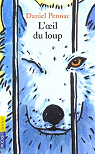Entre essai et roman autobiographique, Chagrin d'école nous fait découvrir l'enfance du Pennac mauvais élève, les cours du Pennac professeur de français et la vision qu'il porte sur les cancres qu'il a fréquentés et plus généralement sur ce qu'on appelle de nos jours, non sans un certain mépris, "la jeunesse d'aujourd'hui".
Les histoires de cancres ont toujours fait sourire, et ce livre ne fait pas exception. Mais au bout de quelques dizaines de pages, ça devient lassant. Manifestement Daniel Pennac a fait du remplissage, et l'intérêt baisse au fur et à mesure de la lecture. On retrouve ensuite des remarques pertinentes sur la manière d'enseigner, même si certaines auront du mal à convaincre…
On peut toujours commencer le livre, et l'abandonner au milieu, sans vraiment perdre grand chose.
Les histoires de cancres ont toujours fait sourire, et ce livre ne fait pas exception. Mais au bout de quelques dizaines de pages, ça devient lassant. Manifestement Daniel Pennac a fait du remplissage, et l'intérêt baisse au fur et à mesure de la lecture. On retrouve ensuite des remarques pertinentes sur la manière d'enseigner, même si certaines auront du mal à convaincre…
On peut toujours commencer le livre, et l'abandonner au milieu, sans vraiment perdre grand chose.
Daniel Pennac - «Chagrin d'école» - Gallimard 2007
Daniel Pennac est surtout connu en tant qu'auteur de nombreux et excellents romans policiers. Né en 1945, sa scolarité couvre les années 1950-1968, après quoi il exerça comme professeur dans des collèges. Il trace ici un parallèle entre son expérience et la scolarité des gosses d'aujourd'hui.
J'hésitai à acquérir ce qui apparaissait comme «un bouquin de plus sur l'école» parmi tant et tant d'autres, et puis je me suis décidé avec la publication en livre de poche. C'est plutôt réussi, car l'auteur reste constamment au ras des pâquerettes, et ne tombe ni dans les grandes théories absurdes des pédagogisants (de type IUFM de gôôôche) ni dans les anathèmes si fréquemment lancés sur l'école en général.
Certes, il provient d'un milieu plutôt favorisé (p. 23): « père polytechnicien, mère au foyer, pas de divorce, pas d'alcoolique etc » et put donc redresser la barre dès qu'il décida de travailler un peu, ce qui n'est pas le cas des gamins de banlieue d'aujourd'hui... Il n'en reste pas moins que son texte est parsemé d'observations d'une justesse confondante.
Ainsi page 141 (troisième partie, début du chapitre 9) : «En aura-t-elle proféré, des sottises, ma génération, sur les rituels considérés comme marque de soumission aveugle, la notation estimée avilissante, la dictée réactionnaire, le calcul mental abrutissant, la mémorisation des textes infantilisante, ce genre de proclamation...». Eh, oui ! En avons-nous reçu de ces proclamations depuis mai 1968 ! En avons-nous répété de ces sottises, dans les années 1970 !
Et ça continue !
Pour ma part, il m'arrive de penser nos profs quadragénaires, qui étaient nés vers 1930 et qui avaient, elles et eux, bénéficié de l'enseignement «classique» (elles et ils étaient largement issu-e-s des classes favorisées ou du milieu des instit), nous ont tout à fait sciemment refusé l'accès à ce savoir qu'ils avaient ingurgité, avec lequel ils gagnaient leur vie, qu'ils jugeaient inutile pour nous, enfants «de basse extrace» qu'au fond, elles et ils méprisaient.
Il est difficile d'effectuer un choix de citations (j'en mets tout de même quelques-unes) : il faudrait recopier le livre entier !
Relevons par exemple, pages 226 à 229, la mention de la dictature impitoyable et délibérément organisée des marques publicitaires parmi les jeunes : remarquable description ! La «mère-grand marketing» omniprésente, décrite p. 277 par exemple. le règne de l'enfant client (pp. 281-284), avec un remarquable passage sur «l'enfant désiré», question « saugrenue » aux yeux de la génération précédente des mères... (p. 283).
Bref, un livre sans doute à lire et relire pour comprendre «comment on en est arrivé là», à produire de larges couches de gamines et gamins (largement issus des milieux populaires) sortant du système scolaire sans aucune conscience de la chronologie historique, sans aucune culture littéraire solidement assise, sans connaissance de la langue française etc., pendant que les gosses de riches ou d'intellectuels se voient pourvus de tout ça dans le cercle familial, de façon à leur garantir plusieurs longueurs d'avance pour entrer dans les circuits «nobles» de l'enseignement supérieur.
Malheureusement, ce témoignage n'aura bien évidemment aucun effet, précisément parce que le système éducatif français est délibérément organisé pour que l'accès aux « bons » et « nobles » cursus soit réservé aux enfants issus des classes aisées : aucun gouvernement (quelle que soit sa couleur politique) ne remet ce mécanisme en cause, bien au contraire ! On le sait depuis Patrick le Lay, le but est de générer « du temps de cerveau humain disponible pour Coca-Cola » et surtout rien d'autre.
A lire, à relire, et surtout à offrir à tous les parents débutants dont les enfants entrent dans la moulinette de notre « éducation nationale »…
Daniel Pennac est surtout connu en tant qu'auteur de nombreux et excellents romans policiers. Né en 1945, sa scolarité couvre les années 1950-1968, après quoi il exerça comme professeur dans des collèges. Il trace ici un parallèle entre son expérience et la scolarité des gosses d'aujourd'hui.
J'hésitai à acquérir ce qui apparaissait comme «un bouquin de plus sur l'école» parmi tant et tant d'autres, et puis je me suis décidé avec la publication en livre de poche. C'est plutôt réussi, car l'auteur reste constamment au ras des pâquerettes, et ne tombe ni dans les grandes théories absurdes des pédagogisants (de type IUFM de gôôôche) ni dans les anathèmes si fréquemment lancés sur l'école en général.
Certes, il provient d'un milieu plutôt favorisé (p. 23): « père polytechnicien, mère au foyer, pas de divorce, pas d'alcoolique etc » et put donc redresser la barre dès qu'il décida de travailler un peu, ce qui n'est pas le cas des gamins de banlieue d'aujourd'hui... Il n'en reste pas moins que son texte est parsemé d'observations d'une justesse confondante.
Ainsi page 141 (troisième partie, début du chapitre 9) : «En aura-t-elle proféré, des sottises, ma génération, sur les rituels considérés comme marque de soumission aveugle, la notation estimée avilissante, la dictée réactionnaire, le calcul mental abrutissant, la mémorisation des textes infantilisante, ce genre de proclamation...». Eh, oui ! En avons-nous reçu de ces proclamations depuis mai 1968 ! En avons-nous répété de ces sottises, dans les années 1970 !
Et ça continue !
Pour ma part, il m'arrive de penser nos profs quadragénaires, qui étaient nés vers 1930 et qui avaient, elles et eux, bénéficié de l'enseignement «classique» (elles et ils étaient largement issu-e-s des classes favorisées ou du milieu des instit), nous ont tout à fait sciemment refusé l'accès à ce savoir qu'ils avaient ingurgité, avec lequel ils gagnaient leur vie, qu'ils jugeaient inutile pour nous, enfants «de basse extrace» qu'au fond, elles et ils méprisaient.
Il est difficile d'effectuer un choix de citations (j'en mets tout de même quelques-unes) : il faudrait recopier le livre entier !
Relevons par exemple, pages 226 à 229, la mention de la dictature impitoyable et délibérément organisée des marques publicitaires parmi les jeunes : remarquable description ! La «mère-grand marketing» omniprésente, décrite p. 277 par exemple. le règne de l'enfant client (pp. 281-284), avec un remarquable passage sur «l'enfant désiré», question « saugrenue » aux yeux de la génération précédente des mères... (p. 283).
Bref, un livre sans doute à lire et relire pour comprendre «comment on en est arrivé là», à produire de larges couches de gamines et gamins (largement issus des milieux populaires) sortant du système scolaire sans aucune conscience de la chronologie historique, sans aucune culture littéraire solidement assise, sans connaissance de la langue française etc., pendant que les gosses de riches ou d'intellectuels se voient pourvus de tout ça dans le cercle familial, de façon à leur garantir plusieurs longueurs d'avance pour entrer dans les circuits «nobles» de l'enseignement supérieur.
Malheureusement, ce témoignage n'aura bien évidemment aucun effet, précisément parce que le système éducatif français est délibérément organisé pour que l'accès aux « bons » et « nobles » cursus soit réservé aux enfants issus des classes aisées : aucun gouvernement (quelle que soit sa couleur politique) ne remet ce mécanisme en cause, bien au contraire ! On le sait depuis Patrick le Lay, le but est de générer « du temps de cerveau humain disponible pour Coca-Cola » et surtout rien d'autre.
A lire, à relire, et surtout à offrir à tous les parents débutants dont les enfants entrent dans la moulinette de notre « éducation nationale »…
Livre intéressant mais un peu décousu : les chapitres s'enchaînent sans logique apparente.
Pennac revient à la fois sur sa pratique de prof et sur ses années d'élève-cancre : comment le fait d'être un cancre a influé sur sa pédagogie et sur sa façon d'appréhender la relation avec ces élèves en échec scolaire, de chercher les clés pour les « déverrouiller » et leur faire aimer l'école.
Une succession d'exemples, d'anecdotes et de flashbacks… un portrait à multiples facettes du cancre.
Quelques réflexions intéressantes mais pas de « magie » à la lecture de ce roman-essai : je préfère la fantaisie des autres romans de Pennac.
Pennac revient à la fois sur sa pratique de prof et sur ses années d'élève-cancre : comment le fait d'être un cancre a influé sur sa pédagogie et sur sa façon d'appréhender la relation avec ces élèves en échec scolaire, de chercher les clés pour les « déverrouiller » et leur faire aimer l'école.
Une succession d'exemples, d'anecdotes et de flashbacks… un portrait à multiples facettes du cancre.
Quelques réflexions intéressantes mais pas de « magie » à la lecture de ce roman-essai : je préfère la fantaisie des autres romans de Pennac.
Je suis passé à coté de ce livre à sa sortie, pensant qu'il faisait l'apologie de la cancrerie, mal m'en a pris, ce n'était pas le cas. Ce livre traite d'éducation, de cancres oui, mais de comment les récupérer, les comprendre et essayer de leur donner une chance, sans les prendre en pitié mais en essayant d'analyser leurs blocages et leurs peurs.
Ce n'est ni un essai, ni un roman, mais un hybride, un essai romancé, facile d'approche, agréable à lire, drôle, touchant et intéressant.
J'avais beaucoup aimé comme un roman, ce livre est de la même veine, plus autobiographique car il retrace l'histoire de l'élève Pennacchioni, du professeur qu'il devint et de l'écrivain Pennac, de ses relations avec ses professeurs, ses élèves et ses parents. le livre d'une vie, d'une passion, à recommander aux élèves ou anciens élèves aux professeurs et à tous ceux qui veulent croire en la jeunesse de demain.
Ce n'est ni un essai, ni un roman, mais un hybride, un essai romancé, facile d'approche, agréable à lire, drôle, touchant et intéressant.
J'avais beaucoup aimé comme un roman, ce livre est de la même veine, plus autobiographique car il retrace l'histoire de l'élève Pennacchioni, du professeur qu'il devint et de l'écrivain Pennac, de ses relations avec ses professeurs, ses élèves et ses parents. le livre d'une vie, d'une passion, à recommander aux élèves ou anciens élèves aux professeurs et à tous ceux qui veulent croire en la jeunesse de demain.
Très déçue !
Déjà le titre : "Chagrin" sans "s". A l'école, il me semble que chacun connait bien des malheurs et donc, on a tous vécu des chagrins.
J'ai lu un amalgame de vécu mais qui m'ont laissé indifférente tellement c'est banal. Une écriture parlée, une espèce de dialogue avec le lecteur sauf que le lecteur ne peut pas en placer une. Je m'attendais effectivement à un témoignage mais je reste sur ma faim. de plus, rien n'est croustillant même les mots sont basiques.
Lirais-je un autre Pennac?
Déjà le titre : "Chagrin" sans "s". A l'école, il me semble que chacun connait bien des malheurs et donc, on a tous vécu des chagrins.
J'ai lu un amalgame de vécu mais qui m'ont laissé indifférente tellement c'est banal. Une écriture parlée, une espèce de dialogue avec le lecteur sauf que le lecteur ne peut pas en placer une. Je m'attendais effectivement à un témoignage mais je reste sur ma faim. de plus, rien n'est croustillant même les mots sont basiques.
Lirais-je un autre Pennac?
Ce livre démontre un grand sens pédagogique de son auteur, qui nous brosse avec un humour de "vieux sage" son passé de cancre. Il fait transparaître à travers son expérience de professeur, une volonté incommensurable de transmettre le savoir, de se donner corps et âme à ses élèves, de donner une seconde, une troisième voir plus de chances à ces élèves abandonnés à eux mêmes parce que personne ne fait plus cas d' eux.
Il porte à la fois un regard attendri et pourtant si distant du cancre qu' il a lui même été, à tel point qu' apparaît en filigrane un dialogue avec son jumeau, l' opposition entre la mauvaise foi et la raison...
Il est clair que ce livre se veut certainement être un message d' espoir, sur un sujet maintes fois débattu : que faire de l' école, cette institution qui ne produit pas seulement de bons élèves, docteurs en puissance, mais qui connaît aussi ses propres échecs; des élèves qui n' ont que faire de ce qu' elle a à leur transmettre.
Un message d' espoir donc. Mais pas seulement. Avec son humour, je l' ai senti pourtant très moralisateur, trop axé sur son expérience personnelle, j' attendais peut- être une réfléxion plus objective. Il part dans tous les sens, comme si finalement le livre été plus une discussion au coin du feu, où des souvenirs lui reviennent tout à coup en mémoire, pas quelque chose de vraiment structuré. Pourtant j' aime bien sa façon d' écrire, très suave. Je sors de cette lecture sans avoir bien compris les raisons de sa cancrerie, même si il dénonce une part de responsabilité des professeurs qui ne sont pas prêts à gérer le savoir et l' ignorance. Comme il le dit, rien ne le prédisposait à être un cancre, alors pourquoi ? D' ailleurs, je ne le trouve pas si cancre comme il le prétend. Il ne faisait rien à l' école certes, mais il nous dit que la lecture l' a sauvé, dès son jeune âge il fût un grand consommateur de lectures en tous genres! Si je puis me permettre, un "véritable" cancre ne se serait pas adonné à cette passion! Lire? Même les bons élèves sont parfois récalcitrants!
Les stéréotypes, les clichés sur les cancres actuels qui viennent des cités, des banlieues, de l' immigration etc... sont stigmatisés à tout bout de champ, je me demande s' il n' en fait pas lui- même un cliché à trop en parler. Oui, certes il y a ces clichés, mais c' est aussi oublier à côté de ces banlieues, près de 36 000 communes en France.
Finalement je suis un peu déçue par ce livre, la trame était bien de parler de cancrerie, mais en fin de compte j' ai plus eu l' impression que c' est un règlement de compte avec son passé et ceux qui n' ont pas cru en lui. C' est mon avis, qui n' engage que moi.
Il porte à la fois un regard attendri et pourtant si distant du cancre qu' il a lui même été, à tel point qu' apparaît en filigrane un dialogue avec son jumeau, l' opposition entre la mauvaise foi et la raison...
Il est clair que ce livre se veut certainement être un message d' espoir, sur un sujet maintes fois débattu : que faire de l' école, cette institution qui ne produit pas seulement de bons élèves, docteurs en puissance, mais qui connaît aussi ses propres échecs; des élèves qui n' ont que faire de ce qu' elle a à leur transmettre.
Un message d' espoir donc. Mais pas seulement. Avec son humour, je l' ai senti pourtant très moralisateur, trop axé sur son expérience personnelle, j' attendais peut- être une réfléxion plus objective. Il part dans tous les sens, comme si finalement le livre été plus une discussion au coin du feu, où des souvenirs lui reviennent tout à coup en mémoire, pas quelque chose de vraiment structuré. Pourtant j' aime bien sa façon d' écrire, très suave. Je sors de cette lecture sans avoir bien compris les raisons de sa cancrerie, même si il dénonce une part de responsabilité des professeurs qui ne sont pas prêts à gérer le savoir et l' ignorance. Comme il le dit, rien ne le prédisposait à être un cancre, alors pourquoi ? D' ailleurs, je ne le trouve pas si cancre comme il le prétend. Il ne faisait rien à l' école certes, mais il nous dit que la lecture l' a sauvé, dès son jeune âge il fût un grand consommateur de lectures en tous genres! Si je puis me permettre, un "véritable" cancre ne se serait pas adonné à cette passion! Lire? Même les bons élèves sont parfois récalcitrants!
Les stéréotypes, les clichés sur les cancres actuels qui viennent des cités, des banlieues, de l' immigration etc... sont stigmatisés à tout bout de champ, je me demande s' il n' en fait pas lui- même un cliché à trop en parler. Oui, certes il y a ces clichés, mais c' est aussi oublier à côté de ces banlieues, près de 36 000 communes en France.
Finalement je suis un peu déçue par ce livre, la trame était bien de parler de cancrerie, mais en fin de compte j' ai plus eu l' impression que c' est un règlement de compte avec son passé et ceux qui n' ont pas cru en lui. C' est mon avis, qui n' engage que moi.
Le thème : Daniel Pennac, ancien cancre devenu professeur de lettres puis écrivain met tout ça en perspective...
Mon avis : le livre est particulièrement bien écrit, même si on n'y retrouve pas la pétillance habituelle à Pennac. le sujet est intéressant, voire très intéressant. Alors pourquoi je n'accroche pas et ne le termine pas alors que je suis dedans depuis un mois (un mois !!!) ? Eh bien je ne sais pas trop ! Bon, déjà, le sujet, pour être intéressant, ne me passionne pas non plus. Ensuite, et surtout, je crois que je suis un brin agacée par le manque de "creusage" et de remise en cause (du système, de l'entourage, de lui-même), un petit côté déification et adoration aveugle de l'Education Nationale qui me rase. Il critique l'enfant qu'il était, il relativise l'importance de l'adulte professeur qu'il est, il prend l'école telle que pratiquée comme un fait posé sans même, semble-t-il, se poser la question d'une autre école, d'une autre relation à l'école, etc., il voit la réussite scolaire comme la clé de l'épanouissement global, donne une importance centrale et essentielle à la réussite académique et scolaire, et de fait place manifestement l'élève avant l'humain (même s'il semble donner une grande place à l'humain, ne nous y trompons pas : c'est au service de l'élève). Moi qui ait lâché l'école pour manque d'humanité, réduction de l'existence entière à l'élève et pratique de l'humiliation comme une méthode pédagogique, alors que j'étais une excellente élève sans effort, je sais à quel point cette vision idéalisée est fausse.
En bref : rien que du bien ordinaire là-dedans au final, consensuel, un peu creux, typiquement "prof EN se voulant humaniste"... décevant. Stop page 164 sur 305.
Lien : http://ploufetreplouf.over-b..
Mon avis : le livre est particulièrement bien écrit, même si on n'y retrouve pas la pétillance habituelle à Pennac. le sujet est intéressant, voire très intéressant. Alors pourquoi je n'accroche pas et ne le termine pas alors que je suis dedans depuis un mois (un mois !!!) ? Eh bien je ne sais pas trop ! Bon, déjà, le sujet, pour être intéressant, ne me passionne pas non plus. Ensuite, et surtout, je crois que je suis un brin agacée par le manque de "creusage" et de remise en cause (du système, de l'entourage, de lui-même), un petit côté déification et adoration aveugle de l'Education Nationale qui me rase. Il critique l'enfant qu'il était, il relativise l'importance de l'adulte professeur qu'il est, il prend l'école telle que pratiquée comme un fait posé sans même, semble-t-il, se poser la question d'une autre école, d'une autre relation à l'école, etc., il voit la réussite scolaire comme la clé de l'épanouissement global, donne une importance centrale et essentielle à la réussite académique et scolaire, et de fait place manifestement l'élève avant l'humain (même s'il semble donner une grande place à l'humain, ne nous y trompons pas : c'est au service de l'élève). Moi qui ait lâché l'école pour manque d'humanité, réduction de l'existence entière à l'élève et pratique de l'humiliation comme une méthode pédagogique, alors que j'étais une excellente élève sans effort, je sais à quel point cette vision idéalisée est fausse.
En bref : rien que du bien ordinaire là-dedans au final, consensuel, un peu creux, typiquement "prof EN se voulant humaniste"... décevant. Stop page 164 sur 305.
Lien : http://ploufetreplouf.over-b..
très bon bouquin, moi qui ne suis pas très fan des livres qui tournent autour de la vie de l'école, là je dirai que c'est un livre pour les enseignants certes, véritable profession de foi, à relire dès qu'on a en face de nous un "valignien", un bachibouzouc d'élève qui ne comprend rien, mais aussi un livre pour les parents. le style est fluide et pourtant d'une richesse d'esprit géniale, il faut vraiment être doué (ou avoir beaucoup travaillé) pour arriver à faire passer tant d'idées (idées qui sont poussées jusqu'au bout d'elles mêmes) dans des phrases syntaxiquement si simples et qu'il ne faut pas relire deux fois pour comprendre. Pennac, parlant du cancre qu'il fut durant sa jeunesse, parle de la place du cancre dans l'école -et plus généralement dans la société. Ses deux points de vue (celui de l'ancien cancre et celui du professeur qui a des cancres en face de lui) servent à loisir son analyse, qu'elle se penche sur le milieu familial, le rôle de la société moderne et de la communication, ou encore sur l'aspect psychologique de l'enfermement, du serpent qui se mord la queue, du "miroir ourobore" comme dirait Pessoa. Je ferais bien une analyse plus approfondie du bouquin juste pour mon petit plaisir personnel car je me doute que ça n'intéresse pas grand monde, mais voyez-vous on est le 31, j'ai préparé quelques mets onctueux que j'ai inventé moi-même et vu l'heure il va falloir s'occuper de l'apéro (même si je n'y ai pas droit, snifffff...), donc de façon très simple je vous conseille la lecture de ce livre, et de façon plus générale la lecture de tous les Pennac car c'est un auteur génial!
Pennac est triste, il voudrait (et moi aussi) que tous les élèves aient leur chance.
Redonner le goût de l'effort, de la littérature. Apprendre, apprendre, faire des dictées, savoir des textes par coeur pour exercer sa mémoire.
Prof pour enfants en difficulté, il nous raconte par bribes un peu de son enfance et surtout comment lui enfant cancre, a retrouvé le plaisir d'apprendre, de connaître la beauté de la langue française, sa richesse.
Intéressante lecture, pleine d'anecdotes rigolotes. Et surtout livre qui donne envie de se replonger dans les auteurs classiques. Et d'exercer sa mémoire en apprenant des bouts de texte...
Redonner le goût de l'effort, de la littérature. Apprendre, apprendre, faire des dictées, savoir des textes par coeur pour exercer sa mémoire.
Prof pour enfants en difficulté, il nous raconte par bribes un peu de son enfance et surtout comment lui enfant cancre, a retrouvé le plaisir d'apprendre, de connaître la beauté de la langue française, sa richesse.
Intéressante lecture, pleine d'anecdotes rigolotes. Et surtout livre qui donne envie de se replonger dans les auteurs classiques. Et d'exercer sa mémoire en apprenant des bouts de texte...
Daniel Pennac raconte son passé de cancre, lui qui était promu à un destin brillant eu égard à la réussite de ses frères aînés. Il en garde un souvenir douloureux dont il témoigne notamment dans les premiers chapitres. Il fait part également de son devenir de professeur de français et de ses réflexions tant sur le métier d'enseignant que sur le système éducatif français (école mais aussi famille).
Un roman et essai très bien écrit, au style poétique, dense également, à la fois dans l'écriture, et dans la réflexion sur l'éducation. de grands thèmes sont abordés : la dépréciation, le manque de confiance en soi, la violence, l'échec scolaire, les tentatives de l'enseignant pour y remédier, les inventions pédagogiques, … En somme, une autobiographie doublée d'un essai sur l'éducation, passée (années 50) et actuelle.
Un roman et essai très bien écrit, au style poétique, dense également, à la fois dans l'écriture, et dans la réflexion sur l'éducation. de grands thèmes sont abordés : la dépréciation, le manque de confiance en soi, la violence, l'échec scolaire, les tentatives de l'enseignant pour y remédier, les inventions pédagogiques, … En somme, une autobiographie doublée d'un essai sur l'éducation, passée (années 50) et actuelle.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Daniel Pennac (70)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Ernest et Célestine
Où vivent les Ours ?
Dans le monde d'en haut
Dans le monde d'en bas
Dans la Terre du Milieu
10 questions
57 lecteurs ont répondu
Thème : Le roman d'Ernest et Célestine de
Daniel PennacCréer un quiz sur ce livre57 lecteurs ont répondu