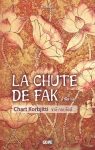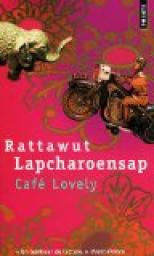Saneh Sangsuk
Marcel Barang (Traducteur)/5 43 notes
Marcel Barang (Traducteur)/5 43 notes
Résumé :
Un enfant thaï de dix ans garde ses vaches dans le jour finissant. Un enfant estropié, rêveur, sûr de sa gloire à venir... Tandis qu'il se donne en spectacle pour amuser quelques amis, il ne voit pas le cobra géant qui s'approche de lui : une femelle de quatre mètres de long ! Ralliant toutes ses forces pour un combat mortel, l'enfant tient en respect de son seul bras valide le serpent qui lui broie le corps. Pour combien de temps? Autour de lui, ses proches se défi... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après VeninVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (18)
Voir plus
Ajouter une critique
La nouvelle venimeuse, à la fois âpre et onirique, du romancier thaïlandais Saneh Sangsuk.
L'auteur plante le décor dans un petit village paysan au confins de l'ancien Royaume du Siam pour nous faire vivre le récit cauchemardesque du combat entre un enfant de dix ans et un sSSssSsserpent.
D'emblée la nouvelle nous captive par sa fluidité à la fois dans le style mais aussi la narration de Sangsuk. Nous savons depuis la quatrième de couverture que tôt ou tard l'enfant croisera la route du serpent.
“Et c'est alors que, d'un antre secret au sein de la terre sous le tamarinier géant pourrissant qui gisait là, un cobra femelle pointa la tête au comble de la colère. Son corps était gros comme la cuisse d'un homme mûr. Son dos était d'un noir d'encre, son ventre blanc strié de gris.”
Lorsque arrive enfin la rencontre, une tension attrape le lecteur pour ne plus le lâcher … un peu comme une Sangsuk (pardon).
L'auteur enroule ses mots autour de son lecteur comme le serpent enroule son corps autour de la taille du frêle gamin thaï. le souffle manque, la peur écrase le coeur, un brouillard d'angoisse et de suspense s'installe. Tout s'entremêle, pendant que le corps lutte, l'esprit s'évade, les souvenirs défilent, dans ce moment de bascule, de lutte pour la vie, le lecteur n'a plus aucune idée de là où l'auteur veut l'emmener — forcé de vivre au rythme de l'étreinte plus ou moins pressante de la bête.
A travers son combat contre le serpent, le “mental” comme on dit dans le sport avec un bon accent tolousaing, se révèle crucial, à l'image des épreuves de la vie, cette épreuve d'une nuit voit le jeune garçon passer par toute sorte de phases émotionnelles, dictées ou non par la douleur physique.
Certes il y a le cobra mais la vipère du village c'est Songwât, sorte de chamane auto-proclamé, abusant de la crédulité superstitieuse des habitants, aveuglé par sa haine du petit garçon estropié dont les parents osent lui tenir tête. le fait qu'on décrive ce persifleur comme “efféminé” donne peut-être une clé pour le comprendre : une homosexualité indicible, que l'on ne peut pas vivre, peut pousser à chercher un rôle à l'abri des représailles, et quoi de mieux que de devenir le prêtre mystique du village… je n'irai pas plus loin dans les comparaisons et la sociologie des vocations ecclésiastiques de toute obédience… ni dans la culture thaïlandaise, qui nous donne d'étonnantes leçons de tolérance avec ses “ladysboys”.
Venin est une lecture ouverte à de multiples interprétations, tellement immersive qu'elle nous hante encore et moi-même qui vous parle j'ai dû en découdre en rêve avec un Cobra, il est fort Sangsuk !
Qu'en pensez-vous ?
L'auteur plante le décor dans un petit village paysan au confins de l'ancien Royaume du Siam pour nous faire vivre le récit cauchemardesque du combat entre un enfant de dix ans et un sSSssSsserpent.
D'emblée la nouvelle nous captive par sa fluidité à la fois dans le style mais aussi la narration de Sangsuk. Nous savons depuis la quatrième de couverture que tôt ou tard l'enfant croisera la route du serpent.
“Et c'est alors que, d'un antre secret au sein de la terre sous le tamarinier géant pourrissant qui gisait là, un cobra femelle pointa la tête au comble de la colère. Son corps était gros comme la cuisse d'un homme mûr. Son dos était d'un noir d'encre, son ventre blanc strié de gris.”
Lorsque arrive enfin la rencontre, une tension attrape le lecteur pour ne plus le lâcher … un peu comme une Sangsuk (pardon).
L'auteur enroule ses mots autour de son lecteur comme le serpent enroule son corps autour de la taille du frêle gamin thaï. le souffle manque, la peur écrase le coeur, un brouillard d'angoisse et de suspense s'installe. Tout s'entremêle, pendant que le corps lutte, l'esprit s'évade, les souvenirs défilent, dans ce moment de bascule, de lutte pour la vie, le lecteur n'a plus aucune idée de là où l'auteur veut l'emmener — forcé de vivre au rythme de l'étreinte plus ou moins pressante de la bête.
A travers son combat contre le serpent, le “mental” comme on dit dans le sport avec un bon accent tolousaing, se révèle crucial, à l'image des épreuves de la vie, cette épreuve d'une nuit voit le jeune garçon passer par toute sorte de phases émotionnelles, dictées ou non par la douleur physique.
Certes il y a le cobra mais la vipère du village c'est Songwât, sorte de chamane auto-proclamé, abusant de la crédulité superstitieuse des habitants, aveuglé par sa haine du petit garçon estropié dont les parents osent lui tenir tête. le fait qu'on décrive ce persifleur comme “efféminé” donne peut-être une clé pour le comprendre : une homosexualité indicible, que l'on ne peut pas vivre, peut pousser à chercher un rôle à l'abri des représailles, et quoi de mieux que de devenir le prêtre mystique du village… je n'irai pas plus loin dans les comparaisons et la sociologie des vocations ecclésiastiques de toute obédience… ni dans la culture thaïlandaise, qui nous donne d'étonnantes leçons de tolérance avec ses “ladysboys”.
Venin est une lecture ouverte à de multiples interprétations, tellement immersive qu'elle nous hante encore et moi-même qui vous parle j'ai dû en découdre en rêve avec un Cobra, il est fort Sangsuk !
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu ce livre avant de l'offrir, parce que le titre et la quatrième de couverture annonçaient un récit angoissant.
Et c'est un récit angoissant. D'abord parce qu'un cobra est un animal angoissant. Ensuite parce que de malheur en malheur un enfant est accablé. Finalement, parce que la lutte contre l'obscurantisme est décidément difficile.
Mais c'est un livre bien fait, une longue nouvelle qui nous fait pénétrer dans un village thaïlandais et dans la littérature du pays, ce qui était le but de cette lecture. Un sujet dur transformé en une lecture prenante, il me semble que cela témoigne du talent de l'auteur.
Je me suis demandé si ce récit était une fable et quelle en serait la morale. On peut dire que le pouvoir politique est monopolisé en Thaïlande par une classe éduquée et riche, non-musulmane. Ceux qui ont tenté par deux fois, après une élection démocratique, de changer cet état de fait ont été accusés de populisme et de corruption, renversés par la violence et finalement avec l'aide de l'armée. Saneh Sangsuk montre dans le récit comment une famille arrive à usurper une propriété, puis le pouvoir local par la médisance, le népotisme et en prétendant représenter les volontés d'une divinité locale. le rapprochement est-il évident pour un lecteur thaïlandais (on doit au roi un respect quasi-divin), le livre ayant été écrit en 2000, bien avant l'élection de Thaskin Shinawatra ? Est-ce qu'il a un sens pour un français aujourd'hui (je ne dis pas que les chemises rouges et les gilets jaunes représentent le même mouvement)?
Petite note personnelle : je témoigne que, comme dans ce village, les enfants thaï sont élevés bien naturellement dans la crainte des serpents, mais aussi dans celle des moustiques. Ce livre contient quelques exemples des relations entre hommes et cobras, dont le rappel pourrait être utile.
Et c'est un récit angoissant. D'abord parce qu'un cobra est un animal angoissant. Ensuite parce que de malheur en malheur un enfant est accablé. Finalement, parce que la lutte contre l'obscurantisme est décidément difficile.
Mais c'est un livre bien fait, une longue nouvelle qui nous fait pénétrer dans un village thaïlandais et dans la littérature du pays, ce qui était le but de cette lecture. Un sujet dur transformé en une lecture prenante, il me semble que cela témoigne du talent de l'auteur.
Je me suis demandé si ce récit était une fable et quelle en serait la morale. On peut dire que le pouvoir politique est monopolisé en Thaïlande par une classe éduquée et riche, non-musulmane. Ceux qui ont tenté par deux fois, après une élection démocratique, de changer cet état de fait ont été accusés de populisme et de corruption, renversés par la violence et finalement avec l'aide de l'armée. Saneh Sangsuk montre dans le récit comment une famille arrive à usurper une propriété, puis le pouvoir local par la médisance, le népotisme et en prétendant représenter les volontés d'une divinité locale. le rapprochement est-il évident pour un lecteur thaïlandais (on doit au roi un respect quasi-divin), le livre ayant été écrit en 2000, bien avant l'élection de Thaskin Shinawatra ? Est-ce qu'il a un sens pour un français aujourd'hui (je ne dis pas que les chemises rouges et les gilets jaunes représentent le même mouvement)?
Petite note personnelle : je témoigne que, comme dans ce village, les enfants thaï sont élevés bien naturellement dans la crainte des serpents, mais aussi dans celle des moustiques. Ce livre contient quelques exemples des relations entre hommes et cobras, dont le rappel pourrait être utile.
Saneh Sangsuk est considéré comme l'un des plus grands écrivains thaïlandais de sa génération.
Un enfant de dix ans dit Patte Folle garde ses vaches . L'envie lui prend d'aller vers le bosquet de bambous au bord du réservoir,près de l'autel de la Mère Sacrée.Malgré son bras droit paralysé suite à une chute, il est assez habile avec son bras gauche et ce soir il a décidé de jouer avec ses marionnettes, tous ses copains sont là autour de lui mais le spectacle est brutalement interrompu par un cobra femelle qu'il a dérangé . L'attaque du serpent est fulgurante , l'enfant essaye de se défendre....
Court texte mais d'une intensité à la hauteur du combat entre le cobra et l'enfant. Un décor ,un mode de vie que je connais peu ou pas , une lecture donc en demi teinte mais merci à babelio et à tous ces challenges qui me poussent à m'immerger dans des lectures différentes ...
Un enfant de dix ans dit Patte Folle garde ses vaches . L'envie lui prend d'aller vers le bosquet de bambous au bord du réservoir,près de l'autel de la Mère Sacrée.Malgré son bras droit paralysé suite à une chute, il est assez habile avec son bras gauche et ce soir il a décidé de jouer avec ses marionnettes, tous ses copains sont là autour de lui mais le spectacle est brutalement interrompu par un cobra femelle qu'il a dérangé . L'attaque du serpent est fulgurante , l'enfant essaye de se défendre....
Court texte mais d'une intensité à la hauteur du combat entre le cobra et l'enfant. Un décor ,un mode de vie que je connais peu ou pas , une lecture donc en demi teinte mais merci à babelio et à tous ces challenges qui me poussent à m'immerger dans des lectures différentes ...
Ce court roman, oscillant entre le récit d'apprentissage, le conte, la nouvelle et la philosophie, est très fort et très prenant. L'histoire se passe en Thaïlande, avant, dans un temps indéterminé. Il y a la radio, mais pas d'internet... le personnage principal est un enfant différent, qui suite à une chute d'un palmier est estropié d'un bras. Cela fait jaser dans le village. Aidée par une famille aimante et une grand-mère au caractère bien trempé, il progresse, apprend à écrire de la main gauche, continue à garder les vaches, puis se prend de passion pour le théâtre d'ombre. Alors que la nuit tombe, il commence à donner une représentation pour ses copains et soudain, un immense cobra l'attaque. S'ensuit une lutte incroyable, invraisemblable et pourtant très précise, dans laquelle les deux créatures (l'enfant et le serpent) sont à force égale. Comprenant qu'il n'y parviendra pas seul, il va au monastère, ses parents sont effrayés, il arrive au village et le medium donne sa sentence... La fin est très forte, prenante, dérangeante et cependant d'une justesse implacable. Les cadres sociétaux qui nous enserrent sont d'une violence extrême.
Cette histoire, je devrais dire ce conte ,mais un conte dur ,se passe en Thaïlande.
Un petit gamin de dix ans dont on ne connait pas le prénom, mais surnommé patte folle ,suite à une chute qui lui estropie le bras gauche,va être confronté a un cobra de 4 mètres. On va assister à cette lutte à mort,entre le cobra et l'enfant.Roman très court (75 pages)mais hypnotique tant l'angoisse et le suspense sont présents au fur et à mesure de la lecture.Au travers ce conte ,on y voit la couardise des villageois,les peurs ancestrales qui ressurgissent attisées par Songwât,le médium de la Mère Sacrée du village ,qui est très redouté des villageois .C'est vrai que c'est un récit fascinant tant en peu de pages l'auteur nous angoisse jusqu'au point culminant.Un conte d'une extrême cruauté, révélateur de certains côtés négatifs de l'être humain.Je ne connaissais pas cet écrivain Thaî,une belle rencontre.
P.S: un grand merci au traducteur :Marcel Barang.⭐⭐⭐⭐
Un petit gamin de dix ans dont on ne connait pas le prénom, mais surnommé patte folle ,suite à une chute qui lui estropie le bras gauche,va être confronté a un cobra de 4 mètres. On va assister à cette lutte à mort,entre le cobra et l'enfant.Roman très court (75 pages)mais hypnotique tant l'angoisse et le suspense sont présents au fur et à mesure de la lecture.Au travers ce conte ,on y voit la couardise des villageois,les peurs ancestrales qui ressurgissent attisées par Songwât,le médium de la Mère Sacrée du village ,qui est très redouté des villageois .C'est vrai que c'est un récit fascinant tant en peu de pages l'auteur nous angoisse jusqu'au point culminant.Un conte d'une extrême cruauté, révélateur de certains côtés négatifs de l'être humain.Je ne connaissais pas cet écrivain Thaî,une belle rencontre.
P.S: un grand merci au traducteur :Marcel Barang.⭐⭐⭐⭐
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
“Et c’est alors que, d’un antre secret au sein de la terre sous le tamarinier géant pourrissant qui gisait là, un cobra femelle pointa la tête au comble de la colère. Son corps était gros comme la cuisse d’un homme mûr. Son dos était d’un noir d’encre, son ventre blanc strié de gris.”
Quand on s'entraida pour dénouer ses anneaux et dégager l'enfant,cela se fit sans problème .Tout le monde était encore horrifié et sidéré par la taille colossale du serpent,et les commentaires allaient bon train.Mais l'enfant estropié ne s'intéressait à personne ni à quoi que ce soit.Ses yeux étaient vitreux .Parfois il souriait .Parfois il éclatait de rire .Parfois il pleurait.Parfois il marmonnait pour lui tout seul des choses incompréhensibles. Il avait totalement perdu la raison à partir du moment où Il avait décidé d'accepter sa défaite. ( Page75).
Le serpent géant était tout contre lui. Il n'avait jamais imaginé une telle promiscuité. Il n'en avait pas eu la moindre prémonition, ni en rêve ni dans la réalité. Où se trouvait son cœur ? Comment se faisait-il qu'il ne pouvait pas sentir les battements de son cœur ? Et son venin, il était de quelle couleur ? Blanc comme du lait ou jaune comme une topaze ? Combien de kilos pesait-il ? Cinquante ? Soixante ? Soixante-dix kilos ? Il n'en avait aucune idée. Mais il était certain qu'il pesait davantage que lui.
À la distance d'un bras seulement,l'enfant au bras invalide ne vit que quelque chose qui fondait sur son visage.Il eut seulement conscience que le serpent allait le mordre.Il ferma les yeux ,se rejetant en arrière. C'etait une conscience
aiguë, totale.Il pensa ensuite ,Douleur,mort,Douleur,mort ,peur ,et puis c'est fini.Tout ça, ce n'étaient que des mots.( Page 36/37).
aiguë, totale.Il pensa ensuite ,Douleur,mort,Douleur,mort ,peur ,et puis c'est fini.Tout ça, ce n'étaient que des mots.( Page 36/37).
Le soir tombait.Le crépuscule était bien avancé.Le rouge foncé du soleil peu à peu s'estompait.Le ciel était limpide comme un dôme de cristal.Au - dessus de l'horizon au couchant ,sous le jeu des rayons ,des fins lambeaux de nuages prenaient une beauté irréelle. Leurs formes variées titillaient l'imagination.(Page 9).
autres livres classés : littérature thaïlandaiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

En Thaïlande
anneAFB
30 livres

THAÏLANDE
ComptoirdelaMousson
13 livres
Autres livres de Saneh Sangsuk (3)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1726 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1726 lecteurs ont répondu