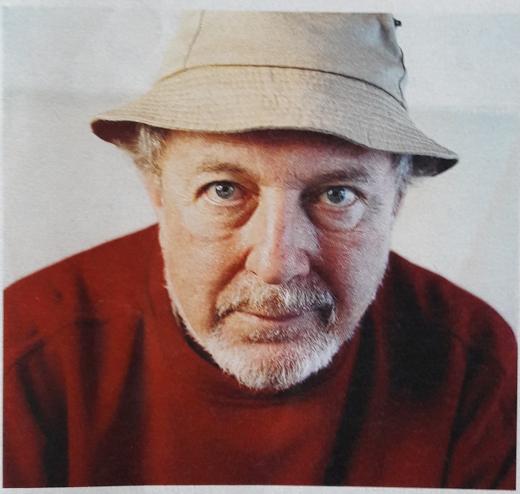Citations de Clément Rosset (215)
Toute joie parfaite consiste en la joie de vivre, et en elle seule.
Le bonheur lié au sentiment d'être aimé a pour consistance majeure le fait de se trouver soudain nanti, par l'entremise de l'amour obtenu, d'un soi propre, d'une identité personnelle.
Sur l’album de Tintin « L’oreille cassée »
Le fétiche que l’on poursuit en Amérique est en Europe, dans une malle, à portée de la main. De même, dans d’autres albums du même Hergé (Le secret de la Licorne, Le trésor de Rackham le Rouge), le trésor convoité n’est pas situé dans l’océan Atlantique, où on va le chercher, mais chez soi, dans sa propre cave : il suffit d’y mettre le doigt pour le trouver, comme il suffisait d’ouvrir la malle de Balthazar pour y trouver le fétiche. C’est là également, on le sait, le sort de cette Lettre volée, d’Edgar Poe, qui échappe à toutes les investigations policières pour être placée bien en évidence sur la table. Le regard du désir est un regard distrait : il glisse sur le présent, l’ici, le trop immédiatement visible, et ne réussit à être attentif qu’à la condition de porter son regard ailleurs. Et puisqu’il est ici question de fétiches, on remarquera que ce « sort » attaché au regard du désir – de toujours regarder ailleurs, de tout voir hormis ce que l’on cherche à voir – définit le sort de ceux que la psychiatrie appelle, précisément, des fétichistes. Le fétichiste reste froid devant la chose elle-même, laquelle lui apparaît comme muette, incolore et sans saveur ; il est ému non par la chose mais par quelque autre chose qui la signale. D’où un refus du présent et de l’ici, c’est-à-dire un refus du réel en général, puisque le présent et l’ici en sont les deux coordonnées fondamentales. On ne peut s’intéresser à la fois au fétiche (c’est-à-dire au réel) et à ce que le fétiche est censé représenter (c’est-à-dire au « vrai », par opposition au double, au faux). Qui cherche le fétiche trouvera le fétiche ; mais qui cherche ce que le fétiche représente ne trouvera rien, et en tout cas pas le fétiche.
Bref : ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant, car il est ici et maintenant, seulement ici et maintenant. Mais, si l’on ne veut pas du réel, il est préférable, en effet, de regarder ailleurs : d’aller voir ce qui se passe sous le tapis, ou en Amérique du Sud, ou dans la mer des Caraïbes, n’importe où pourvu qu’on soit assuré de n’y jamais rien trouver. Car on n’y trouvera jamais rien d’autre que ce qu’on y cherchait réellement : c’est-à-dire, précisément, rien.
Le fétiche que l’on poursuit en Amérique est en Europe, dans une malle, à portée de la main. De même, dans d’autres albums du même Hergé (Le secret de la Licorne, Le trésor de Rackham le Rouge), le trésor convoité n’est pas situé dans l’océan Atlantique, où on va le chercher, mais chez soi, dans sa propre cave : il suffit d’y mettre le doigt pour le trouver, comme il suffisait d’ouvrir la malle de Balthazar pour y trouver le fétiche. C’est là également, on le sait, le sort de cette Lettre volée, d’Edgar Poe, qui échappe à toutes les investigations policières pour être placée bien en évidence sur la table. Le regard du désir est un regard distrait : il glisse sur le présent, l’ici, le trop immédiatement visible, et ne réussit à être attentif qu’à la condition de porter son regard ailleurs. Et puisqu’il est ici question de fétiches, on remarquera que ce « sort » attaché au regard du désir – de toujours regarder ailleurs, de tout voir hormis ce que l’on cherche à voir – définit le sort de ceux que la psychiatrie appelle, précisément, des fétichistes. Le fétichiste reste froid devant la chose elle-même, laquelle lui apparaît comme muette, incolore et sans saveur ; il est ému non par la chose mais par quelque autre chose qui la signale. D’où un refus du présent et de l’ici, c’est-à-dire un refus du réel en général, puisque le présent et l’ici en sont les deux coordonnées fondamentales. On ne peut s’intéresser à la fois au fétiche (c’est-à-dire au réel) et à ce que le fétiche est censé représenter (c’est-à-dire au « vrai », par opposition au double, au faux). Qui cherche le fétiche trouvera le fétiche ; mais qui cherche ce que le fétiche représente ne trouvera rien, et en tout cas pas le fétiche.
Bref : ne cherchez pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant, car il est ici et maintenant, seulement ici et maintenant. Mais, si l’on ne veut pas du réel, il est préférable, en effet, de regarder ailleurs : d’aller voir ce qui se passe sous le tapis, ou en Amérique du Sud, ou dans la mer des Caraïbes, n’importe où pourvu qu’on soit assuré de n’y jamais rien trouver. Car on n’y trouvera jamais rien d’autre que ce qu’on y cherchait réellement : c’est-à-dire, précisément, rien.
Précisons ici la suite des idées qui résume (…) ce qui tenait le plus au cœur de Proust, du moins en matière de philosophie : Je suis heureux quand j’éprouve quelque chose qui, étant en rapport à la fois avec le temps passé et le temps présent, n’est pas en rapport avec le présent qui passe – qui est donc sans rapport avec le présent et sa pauvreté (Baudelaire ici renchérirait : avec le réel et sa banalité).
L’erreur de Proust n’est ici pas tant de privilégier l’imagination aux dépens de la parution du réel – privilégiation dont il convient d’ailleurs lui-même de façon explicite : « Tant de fois, au cours de ma vie, la réalité m’avait déçu parce qu’au moment où je la percevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s’appliquer à elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu’on ne puisse imaginer que ce qui est absent » – que de prendre pour souvenir la simple apparition du réel, son « épiphanie », de prendre pour représentation seconde ce qui est en fait présentation première.
La « réminiscence » proustienne n’est pas un souvenir pour cette simple raison qu’elle ne reproduit aucune image. Un souvenir répète une présentation ; c’est en quoi d’ailleurs elle peut constituer, à la rigueur, une « re-présentation ».
Mais rien de tel dans les réminiscences évoquées par Proust. La réminiscence proustienne ne remémore rien parce qu’elle est précisément – et c’est là tout son intérêt – la première « représentation » du réel, c’est-à-dire sa présentation inaugurale, qui signale l’émergence d’un certain réel à la surface de la conscience. Lorsque Swann – pour s’en tenir à cet unique exemple – réentend le thème de la sonate de Vinteuil qui lui évoque le temps de ses premières amours avec Odette, il ne se rappelle pas, à proprement parler, l’intensité du sentiment qui l’a lié, et le lie encore, à Odette : il en prend simplement conscience. Il y a ici non pas souvenir mais saisie, aperception, découverte.
Le réel n’est pas revenu, il est arrivé. Il est dommage que Proust, si attentif à cette éclosion du réel à la surface de la conscience, ait cru devoir le congédier sitôt né, et ait fait reposer l’intimité de son bonheur sur sa faculté à l’évacuer.
L’erreur de Proust n’est ici pas tant de privilégier l’imagination aux dépens de la parution du réel – privilégiation dont il convient d’ailleurs lui-même de façon explicite : « Tant de fois, au cours de ma vie, la réalité m’avait déçu parce qu’au moment où je la percevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s’appliquer à elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu’on ne puisse imaginer que ce qui est absent » – que de prendre pour souvenir la simple apparition du réel, son « épiphanie », de prendre pour représentation seconde ce qui est en fait présentation première.
La « réminiscence » proustienne n’est pas un souvenir pour cette simple raison qu’elle ne reproduit aucune image. Un souvenir répète une présentation ; c’est en quoi d’ailleurs elle peut constituer, à la rigueur, une « re-présentation ».
Mais rien de tel dans les réminiscences évoquées par Proust. La réminiscence proustienne ne remémore rien parce qu’elle est précisément – et c’est là tout son intérêt – la première « représentation » du réel, c’est-à-dire sa présentation inaugurale, qui signale l’émergence d’un certain réel à la surface de la conscience. Lorsque Swann – pour s’en tenir à cet unique exemple – réentend le thème de la sonate de Vinteuil qui lui évoque le temps de ses premières amours avec Odette, il ne se rappelle pas, à proprement parler, l’intensité du sentiment qui l’a lié, et le lie encore, à Odette : il en prend simplement conscience. Il y a ici non pas souvenir mais saisie, aperception, découverte.
Le réel n’est pas revenu, il est arrivé. Il est dommage que Proust, si attentif à cette éclosion du réel à la surface de la conscience, ait cru devoir le congédier sitôt né, et ait fait reposer l’intimité de son bonheur sur sa faculté à l’évacuer.
Sans le mot qui seul compte dans l'expression d'une pensée, la pensée en question n'est qu'un pur fantôme en attente de corps. Là où les mots manquent pour le dire, manque aussi la pensée.
Ce serait un moindre mal de mourir si l'on pouvait tenir pour assuré qu'on a du moins vécu.
Cette imitation de l’autre peut aussi – et c’est le cas le plus courant – persister jusqu’à l’âge adulte. L’autre qui m’a formé est comme le Dieu de Descartes qui doit sans cesse continuer à créer le monde, si l’on en croit la théorie cartésienne de la « création continue » : s’il cesse d’agir, le monde cesse d’exister. De même l’autre dont je m’inspire doit continuer à m’influencer à tout instant : si son influence cesse, je cesse d’être moi. A moins naturellement – et c’est encore une fois le cas le plus fréquent – que son influence ne cesse au profit d’un autre : auquel cas mon moi ne cesse pas d’être, mais se trouve plus ou moins considérablement modifié. Mais qu’il change ou non, mon moi ou ce que je prends pour tel ne cessera pas d’être un moi d’emprunt. Incapable d’exister par moi-même, j’emprunte son identité à un autre dont j’adopte le moi et en quelque sorte me « paye la tête », encore que dans un sens très différent, et même diamétralement opposé, de celui de l’expression usuelle.
Quand on vous jette une pierre dessus, ce n'est pas une idéée de pierre qui s'écrase sur votre figure.
Premier entretien. Le réel finit toujours par prendre sa revanche, p. 28-29
Premier entretien. Le réel finit toujours par prendre sa revanche, p. 28-29
Une des marques les plus assurées de la joie est, pour user d’un qualificatif aux résonances fâcheuses à bien des égards, son caractère totalitaire. Le régime de la joie est celui du tout ou rien : il n’est de joie que totale ou nulle (et j’ajouterai, anticipant sur la suite de mon propos, qu’il n’est de joie qu’à la fois totale et de certaine façon nulle). L’homme joyeux se réjouit certes de ceci ou de cela en particulier ; mais à l’interroger davantage on découvre vite qu’il se réjouit aussi de tel autre ceci et de tel autre cela, et encore de telle et telle autre chose, et ainsi de suite à l’infini. Sa réjouissance n’est pas particulière mais générale : il est « joyeux de toutes les joies », omnibus laetitiis laetum, comme le dit un amoureux comblé dans une pièce du dramaturge latin Trabéa, partiellement citée par Cicéron. Parole pénétrante, encore qu’on ignore tout du contexte dans lequel elle se situait. Ce que suggère une telle parole peut à peu près s’énoncer ainsi : il y a dans la joie un mécanisme approbateur qui tend à déborder l’objet particulier qui l’a suscitée pour affecter indifféremment tout objet et aboutir à une affirmation du caractère jubilatoire de l’existence en général. La joie apparaît ainsi comme une sorte de quitus aveugle accordé à tout et à n’importe quoi, comme une approbation inconditionnelle de toute forme d’existence présente, passée ou à venir.
La force majeure, p. 7-8
La force majeure, p. 7-8
On ne s'en avise pas toujours, s'imaginant volontiers qu'on a perdu de vue une idée alors qu'on a simplement oublié les mots qui seuls pourraient la constituer ou plutôt la reconstituer. C'est pourquoi nous avons souvent l'illusion d'être à la recherche d'une idée, alors que nous sommes en réalité à la recherche d'un mot.
Ma quête de ce que j’appelle le réel est très voisine de l’enquête sur l’être qui occupe les philosophes depuis les aurores de la philosophie. A cette différence près que presque tous les philosophes s’obstinent à marquer, tel naguère Heidegger, la différence entre l’être et la réalité commune, alors que je m’efforce pour ma part d’affirmer leur identité.
P. 55 Je terminerai par une remarque qui concerne l'amour (au sens usuel) mais n'a rien à voir avec la thèse générale du livre. L'amour est sans doute l'expérience la plus gratifiante qui soit ; il n'est cependant jamais, et ce contrairement à un préjugé tenace, l'occasion d'une véritable "découverte". Je veux dire qu'on y expérimente quelque chose dont ont on possédait toujours et déjà la notion, - ce qui explique le fait apparemment paradoxal que tant de penseurs aient pu parler aussi profondément de l'amour (tels Schopenhauer, Kierkegaard ou Nietzsche) sans en avoir connu l'expérience réelle. Il en va de l'amour comme des cent thalers évoqués par Kant dans la Critique de la raison pure : ceux qui sont dans ma poche ont l'inestimable avantage d'exister et d'être à moi, mais ne diffèrent aucunement de l'idée que je me faisais au préalable de ces même cent thalers. C'est aussi un peu ce qu'exprime Freud lorsqu'il remarque que la prétendue découverte de l'amour adulte et l'amour infantile de la mère, n'est jamais que l'occasion d'une retrouvaille.
P. 46 : L'adoration d'une vérité se double ainsi toujours d'un indifférence à l'égard du contenu de cette vérité même. Il arrive même parfois à de tels fanatiques, lorsqu'ils en viennent à douter de leur idole ou de leurs idoles successives, de ne trouver d'apaisement que dans une dévotion envers une cause humble mais indiscutable, par exemple la vérité arithmétique. Celui qui a cru en tout mais aussi douté de tout peut très bien faire, en fin de carrière, un excellent expert-comptable : l'établissement d'additions justes et de comptes exacts lui offrant enfin l'occasion d'une indubitable et interminable jouissance du vrai. Ainsi Bouvard et Pécuchet, après avoir tâté de tout, devaient-ils en revenir, selon le projet de Flaubert, à leur projet initial de copistes scrupuleux et irréprochables.
L’original doit se passer de toute image : si je ne me trouve pas en moi-même, je me retrouverai encore bien moins dans mon écho.
Le chichi se caractérise d’abord, bien entendu, par un goût de la complication, qui traduit lui-même un dégoût du simple. Mais il faut comprendre le double sens de ce refus du simple, dût-il sembler qu’on tombe ainsi soi-même dans le travers qu’on prétend étudier de l’extérieur. En un premier sens, le dégoût du simple exprime seulement un goût de la complication […]. Mais en un second sens, qui n’élimine pas le premier mais au contraire l’approfondit et l’élucide, le dégoût du simple désigne un effroi face à l’unique, un éloignement face à la chose même : le goût de la complication exprimant d’abord un besoin de la duplication, nécessaire à l’assomption en dérobade d’un réel dont l’unicité crue est instinctivement pressentie comme indigeste.
Sans l’obscurité, il n’y aurait pas de lumière. Si tout est rose, rien n’est rose (comme le disait Jankélévitch). J’ai tendance à penser que l’allégresse est l’état premier, le plus profond chez n’importe quel être vivant ; en tout cas, il en va ainsi chez moi. Cependant, il arrive que l’allégresse soit le résultat d’une mélancolie surmontée. Le point de départ de ma philosophie est la conscience du tragique de l’existence : tout est promis à disparaître, la mort nous entoure et nous sommes menacés par notre propre inconsistance. Or la tentation est forte de refuser en bloc ces considérations déplaisantes. Ce refus du tragique, donc de la réalité, se paie très cher. À l’inverse, la capacité d’admettre la part tragique du réel est pour moi la pierre de touche de la santé morale et de l’allégresse. Il faut apprendre à vivre avec le tragique. C’est pourquoi je distingue deux axes dans l’histoire de la philosophie : les philosophes qui accordent une place au tragique – Pascal, Nietzsche… –, et ceux qui s’échinent à l’évacuer par la rationalisation excessive du monde – Platon, Kant, Hegel…
Contester ce qui est au nom de ce qui a été , ou de ce qui aurait pu être, à remonter d'un cran le cours du temps, relève d'une hallucination commune et instinctive que rend encore une fois très poignante la dose de désarroi et de détresse qu'elle implique.
L'invisible dont il est question ici ne concerne pas le domaine des objets qu'une impossibilité matérielle interdit de voir (tel un visage plongé dans l'obscurité), mais celui des objets qu'on croit voir alors qu'ils ne sont aucunement perceptibles parce qu'ils n'existent pas et/ou ne sont pas présents (tel un visage absent d'une pièce éclairée). Cette sorte d’« existence » d’objets non existants, ou de visibilité de ce qui est invisible, si on la conçoit indépendamment de toute pathologie hallucinatoire, semble évidemment une contradiction dans les termes.
Cependant de tels objets existent, et ils sont légion. Car ce que j’ai appelé ailleurs la « faculté anti-perceptive » est double et complémentaire. Faculté, d’abord, de ne pas percevoir ce qu’on a sous les yeux ; mais aussi faculté de percevoir ce qui n’existe pas et échappe ainsi nécessairement à toute perception : de voir (ou de croire voir) ce qu’elle ne peut voir, de penser ce qu’elle ne pense pas, d’imaginer ce qu’en réalité elle n’imagine pas. Car l’homme possède la faculté de croire souvent appréhender des objets éminemment équivoques, dont on peut dire à la fois qu’ils existent et qu’ils n’existent pas. Ce sont sans doute là moins des perceptions illusoires que des illusions de perception. Les objets paradoxaux suggérés par ces illusions sont naturellement très différents des mirages qu’on peut voir en mer ou dans le désert (d’abord parce que le mirage consiste en une image que chacun peut percevoir réellement ; ensuite parce qu’ils reflètent un corps réel situé au-dessous de l’horizon, alors que l’illusion de perception allie l’invisibilité à l’inconsistance). Pour le dire en mot : si, dans l’illusion de perception, l’objet de la vision n’existe pas, la « vision » de l’objet, ou son imagination, n’en existe pas moins. Mais que voit-on, quand on ne voit rien ? Et de même, pour reprendre une question de Jean Paulhan : que pense-t-on, quand on ne pense à rien ?
Cependant de tels objets existent, et ils sont légion. Car ce que j’ai appelé ailleurs la « faculté anti-perceptive » est double et complémentaire. Faculté, d’abord, de ne pas percevoir ce qu’on a sous les yeux ; mais aussi faculté de percevoir ce qui n’existe pas et échappe ainsi nécessairement à toute perception : de voir (ou de croire voir) ce qu’elle ne peut voir, de penser ce qu’elle ne pense pas, d’imaginer ce qu’en réalité elle n’imagine pas. Car l’homme possède la faculté de croire souvent appréhender des objets éminemment équivoques, dont on peut dire à la fois qu’ils existent et qu’ils n’existent pas. Ce sont sans doute là moins des perceptions illusoires que des illusions de perception. Les objets paradoxaux suggérés par ces illusions sont naturellement très différents des mirages qu’on peut voir en mer ou dans le désert (d’abord parce que le mirage consiste en une image que chacun peut percevoir réellement ; ensuite parce qu’ils reflètent un corps réel situé au-dessous de l’horizon, alors que l’illusion de perception allie l’invisibilité à l’inconsistance). Pour le dire en mot : si, dans l’illusion de perception, l’objet de la vision n’existe pas, la « vision » de l’objet, ou son imagination, n’en existe pas moins. Mais que voit-on, quand on ne voit rien ? Et de même, pour reprendre une question de Jean Paulhan : que pense-t-on, quand on ne pense à rien ?
outefois, ces formes radicales de refus du réel restent marginales et relativement exceptionnelles. L’attitude la plus commune, face à la réalité déplaisante, est assez différente. Si le réel me gêne et si je désire m’en affranchir, je m’en débarrasserai d’une manière généralement plus souple, grâce à un mode de réception du regard qui se situe à mi-chemin entre l’admission et l’expulsion pure et simple : qui ne dit ni oui ni non à la chose perçue, ou plutôt lui dit à la fois oui et non. Oui à la chose perçue, non aux conséquences qui devraient normalement s’ensuivre. Cette autre manière d’en finir avec le réel ressemble à un raisonnement juste que viendrait couronner une conclusion aberrante : c’est une perception juste qui s’avère impuissante à faire
embrayer sur un comportement adapté à la perception. Je ne refuse pas de voir, et ne nie en rien le réel qui m’est montré. Mais ma complaisance s’arrête là. J’ai vu, j’ai admis, mais qu’on ne m’en demande pas davantage. Pour le reste, je maintiens mon point de vue, persiste dans mon comportement, tout comme si je n’avais rien vu. Coexistent paradoxalement ma perception présente et mon point de vue antérieur. Il s’agit là moins d’une perception erronée que d’une perception inutile.
embrayer sur un comportement adapté à la perception. Je ne refuse pas de voir, et ne nie en rien le réel qui m’est montré. Mais ma complaisance s’arrête là. J’ai vu, j’ai admis, mais qu’on ne m’en demande pas davantage. Pour le reste, je maintiens mon point de vue, persiste dans mon comportement, tout comme si je n’avais rien vu. Coexistent paradoxalement ma perception présente et mon point de vue antérieur. Il s’agit là moins d’une perception erronée que d’une perception inutile.
Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserves l'impérieuse prérogative du réelle. Cette faculté se trouve si souvent prise en défaut qu’il semble raisonnable d’imaginer qu’elle n’implique pas la reconnaissance d’un droit imprescriptible – celui du réel à être perçu – mais figure plutôt une sorte de tolérance, conditionnelle et provisoire. Tolérance que chacun peut suspendre à son gré, sitôt que les circonstances l’exigent : un peu comme les douanes qui peuvent décider du jour au lendemain que la bouteille d’alcool ou les dix paquets de cigarettes – « tolérés » jusqu’alors – ne passeront plus. Si les voyageurs abusent de la complaisance des douanes, celles-ci font montre de fermeté et annulent tout droit de passage. De même, le réel n’est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu’à un certain point : s’il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l’abri de tout spectacle indésirable. Quant au réel, s’il insiste et tient absolument à être perçu, il pourra toujours aller se faire voir ailleurs.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

" Mal de vivre !..."
fanfanouche24
33 livres

Eloge de l'ombre
Alzie
65 livres
Auteurs proches de Clément Rosset
Quiz
Voir plus
Le bourgeois gentilhomme
Quel est le vrai nom de l'auteur ?
Jean-Baptiste Poquelin
John-Baptiste Poquelain
Jean-Baptiste Molière
John-Baptiste Molière
30 questions
346 lecteurs ont répondu
Thème : Le Bourgeois Gentilhomme de
MolièreCréer un quiz sur cet auteur346 lecteurs ont répondu