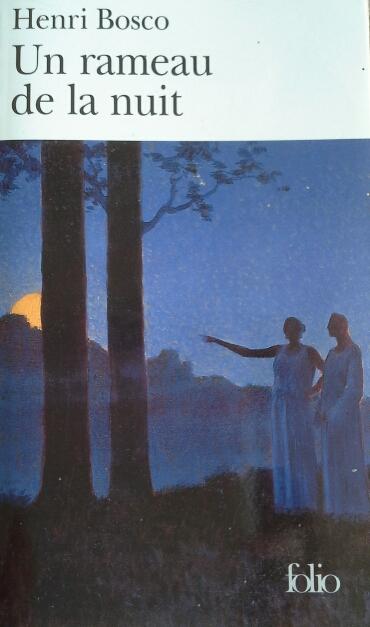Henri Bosco/5
37 notes
C'est le récit d'une saison de vertige et de drame dans une grande maison solitaire, pas tout à fait hantée, mais imprégnée de souvenirs, parmi les arbres d'un parc redevenu sauvage, plein de fontaines d'eau vive et de volières d'oiseaux ; là, quelques personnages mystérieux se dissimulent et passent comme des fantômes. C'est le récit de la possession d'un vivant par un mort, une plongée au cœur ... >Voir plus
Résumé :
C'est le récit d'une saison de vertige et de drame dans une grande maison solitaire, pas tout à fait hantée, mais imprégnée de souvenirs, parmi les arbres d'un parc redevenu sauvage, plein de fontaines d'eau vive et de volières d'oiseaux ; là, quelques personnages mystérieux se dissimulent et passent comme des fantômes. C'est le récit de la possession d'un vivant par un mort, une plongée au cœur ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Un rameau de la nuitVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (10)
Voir plus
Ajouter une critique
« le Roman du Rêve » d'une profondeur gigantesque mais qui aurait dû, à mon sens, se contenter de 200 pages sur les 500 qui m'en ont fait un assommoir, une grande bavante, un étouffoir !
Mais une belle bavante ; un peu comme le Mont-Blanc (les montagnards comprendront)
On ne se relève pas indemne d'un tel roman. Henri Bosco écrit avec maestria. Outre l'immense beauté de sa syntaxe aux mots terriblement évocateurs, la puissance qu'il sait donner à l'insignifiant, il joue avec une relative pauvreté voulue de vocabulaire et une lancinante répétitivité dont le but, à n'en pas douter, est de mimer les effets d'un mantra ou d'une prière répétitive, ou des tambours africains, ou d'un balancement d'endormissement, etc…nous plongeant dans un état cataleptique et envoutant qui pourrait presque provoquer un lâcher-prise nous entraînant dans le rêve.
Mais si cela serait déjà un exploit remarquable de l'auteur que de nous plonger de façon si réelle dans le monde irréel du rêve, à mon sens, l'état de lâcher-prise que provoquent les mots, les phrases, le style d'Henri Bosco va au-delà, atteignant notre âme en l'entrainant dans une fusion avec la Nature, avec l'âme de la Nature.
Pour moi, Bosco est le poète de la non-dualité, le chantre de la méditation. J'avais déjà été envouté par ces thèmes chers à l'auteur dans des textes comme « Malicroix », le « Jardin de Hyacinthe » et même dans des textes considérés comme plus légers comme « l'enfant et la rivière » ou « l'âne culotte ».
C'est un peu comme si l'auteur, dans la progression de son oeuvre, plongeait de plus en plus dans les profondeurs, là ou l'onde est calme, là où l'âme se voit.
Mais peut-être, arrive-t-il, dans cette progression, que l'auteur, finisse par dépasser ce que son lecteur est capable de supporter à un moment de sa propre évolution.
Je crois que, pour moi, cette étape était franchie avec ce roman.
De sorte que les phrases d'une longueur à laquelle je n'étais pas habitué chez l'auteur, quoique belles, me devenaient irritantes, étouffantes.
La composition elle-même du roman m'a donné le sentiment que ce volume hétérogène était une sorte de fourre-tout, un recueil de nouvelles qui n'en sont pas vraiment, comme si Bosco avait voulu nous transmettre certaine des idées qui le hantent comme le vide de l'être enfoui sous le moi, l'âme pouvant habiter les objets, la terre, les animaux ou les rêves, mais que faute de les développer suffisamment il les regroupe dans ce volume sans homogénéité.
Car enfin, à moins que je n'ai rien compris, ce qui est possible après tout, quel lien uni le jeune Marcellin, sa tante rose, Alléluia, Marie-Josépha-de-Jésus, le narrateur Meyrel, Clotilde et Bernard Dumontel ? Franchement je ne vois pas !
Il est vrai que souvent dans les rêves la logique n'a pas cours.
Il n'empêche que l'on se trouve donc immergés au fil des nouvelles dans cet univers chargé de présences immatérielles attirantes mais fuyantes, jamais terrifiantes. Pas des fantômes mais plutôt des âmes guidantes.
Et Il faut attendre la page 357 pour qu'enfin se profile une très courte « intrigue » qui met une sorte de point final à ce roman bancal qui m'a, somme toute, envouté mais déçu.
Je ressens néanmoins que cette lecture n'est pas arrivée au moment le plus opportun pour moi et, de ce fait, si j'en ai mal joui, j'en ai suffisamment tiré de plaisir pour conserver Henri Bosco dans le tabernacle de mes auteurs préférés.
J'invite les lecteurs intrigués par Henri Bosco à se reporter à ce magnifique texte de Paul Jullien sur
http://salon-litteraire.com/fr/essai/content/1806359-henri-bosco-cette-ame-ecrivant-les-reveries-d-un-rameau-de-la-nuit
Petit résumé si ça vous tente :
Une simple halte
Frédéric Meyrel, le narrateur voyage seul à pied dans les collines de Provence, il suit les chemins qui l'attirent ; généralement les moins empruntés.
L'un d'entre eux le conduit dans le village de Géneval
Là il va plus ou moins s'intégrer à la famille de l'aubergiste, Rose Manet, qui l'accueille, essayant d'éveiller son petit neveu, Marcellin, à la vie.
Le village se meure, à l'écart des grandes villes ; encore dix ans et il sera en ruine.
Frédéric sentant son coeur s'éprendre et de la Tante et du neveu va fuir à l'aube ce si doux village.
L'Altaïr
(En arabe Altaïr veut dire l'aigle en vol et désigne donc cette étoile très vive dans la constellation de l'aigle)
Nous sautons du coq à l'âne, Meyrel se retrouve chez lui à Marseille ou il vit une curieuse expérience mystique faisant naître, des phrases écrites durant l'antiquité et qu'il traduit, l'esprit de celui qui les composa.
Il nous présente longuement les personnages constituants son groupe de relation et plus particulièrement Labartelade, important personnage du port de marchandise.
Puis, nouvel évènement, Labartelade et le narrateur partent à la recherche d'un personnage mystérieux qui s'est embarqué sur un Paquebot abandonné dans une partie sinistre du port. Meyrel va vivre une nouvelle expérience mystique sur ce navire ruiné, « hanté » par ceux qui y séjournèrent. Mais toutes ses présences ne sont que fugaces et incertaines. Ils retrouvent le personnage mystérieux, en fait leur ami Alléluia, en contact avec l'esprit de Marie-Josépha-de-Jésus. le navire va couler emmenant avec lui Alléluia et son ami ; Meyrel, lui en réchappera de justesse. Durant sa convalescence, nous devinons qu'un lien unissait Alléluia et Meyrel sans doute par le spectre vénéré.
Losélée
Pour parfaire sa convalescence, Meyrel loue le manoir de Losélée qui se trouve dans le village de Géneval ; mais Rose et Marcellin ont quitté le village. Sans doute Rose éprouvait-elle des sentiments pour Meyrel qui s'était enfuit comme un voleur.
Très vite le manoir envoute Meyrel ; il ressent les présences obscures de deux êtres qui vécurent ici ; il ressent leur amour.
Des personnages bien réels rôdent aux confins de la maison ; la servante sourde et le vieux jardinier qui se cache.
Meyrel, parfait médium, va de plus en plus sentir un esprit prendre possession de son corps, cohabitant avec le sien propre.
Apparaît alors la belle Clotilde qui fut amoureuse de Bernard qui hante le corps de Meyrel et qui le reconnaît.
L'amour impossible et confus naît alors et détruira tout.
Mais une belle bavante ; un peu comme le Mont-Blanc (les montagnards comprendront)
On ne se relève pas indemne d'un tel roman. Henri Bosco écrit avec maestria. Outre l'immense beauté de sa syntaxe aux mots terriblement évocateurs, la puissance qu'il sait donner à l'insignifiant, il joue avec une relative pauvreté voulue de vocabulaire et une lancinante répétitivité dont le but, à n'en pas douter, est de mimer les effets d'un mantra ou d'une prière répétitive, ou des tambours africains, ou d'un balancement d'endormissement, etc…nous plongeant dans un état cataleptique et envoutant qui pourrait presque provoquer un lâcher-prise nous entraînant dans le rêve.
Mais si cela serait déjà un exploit remarquable de l'auteur que de nous plonger de façon si réelle dans le monde irréel du rêve, à mon sens, l'état de lâcher-prise que provoquent les mots, les phrases, le style d'Henri Bosco va au-delà, atteignant notre âme en l'entrainant dans une fusion avec la Nature, avec l'âme de la Nature.
Pour moi, Bosco est le poète de la non-dualité, le chantre de la méditation. J'avais déjà été envouté par ces thèmes chers à l'auteur dans des textes comme « Malicroix », le « Jardin de Hyacinthe » et même dans des textes considérés comme plus légers comme « l'enfant et la rivière » ou « l'âne culotte ».
C'est un peu comme si l'auteur, dans la progression de son oeuvre, plongeait de plus en plus dans les profondeurs, là ou l'onde est calme, là où l'âme se voit.
Mais peut-être, arrive-t-il, dans cette progression, que l'auteur, finisse par dépasser ce que son lecteur est capable de supporter à un moment de sa propre évolution.
Je crois que, pour moi, cette étape était franchie avec ce roman.
De sorte que les phrases d'une longueur à laquelle je n'étais pas habitué chez l'auteur, quoique belles, me devenaient irritantes, étouffantes.
La composition elle-même du roman m'a donné le sentiment que ce volume hétérogène était une sorte de fourre-tout, un recueil de nouvelles qui n'en sont pas vraiment, comme si Bosco avait voulu nous transmettre certaine des idées qui le hantent comme le vide de l'être enfoui sous le moi, l'âme pouvant habiter les objets, la terre, les animaux ou les rêves, mais que faute de les développer suffisamment il les regroupe dans ce volume sans homogénéité.
Car enfin, à moins que je n'ai rien compris, ce qui est possible après tout, quel lien uni le jeune Marcellin, sa tante rose, Alléluia, Marie-Josépha-de-Jésus, le narrateur Meyrel, Clotilde et Bernard Dumontel ? Franchement je ne vois pas !
Il est vrai que souvent dans les rêves la logique n'a pas cours.
Il n'empêche que l'on se trouve donc immergés au fil des nouvelles dans cet univers chargé de présences immatérielles attirantes mais fuyantes, jamais terrifiantes. Pas des fantômes mais plutôt des âmes guidantes.
Et Il faut attendre la page 357 pour qu'enfin se profile une très courte « intrigue » qui met une sorte de point final à ce roman bancal qui m'a, somme toute, envouté mais déçu.
Je ressens néanmoins que cette lecture n'est pas arrivée au moment le plus opportun pour moi et, de ce fait, si j'en ai mal joui, j'en ai suffisamment tiré de plaisir pour conserver Henri Bosco dans le tabernacle de mes auteurs préférés.
J'invite les lecteurs intrigués par Henri Bosco à se reporter à ce magnifique texte de Paul Jullien sur
http://salon-litteraire.com/fr/essai/content/1806359-henri-bosco-cette-ame-ecrivant-les-reveries-d-un-rameau-de-la-nuit
Petit résumé si ça vous tente :
Une simple halte
Frédéric Meyrel, le narrateur voyage seul à pied dans les collines de Provence, il suit les chemins qui l'attirent ; généralement les moins empruntés.
L'un d'entre eux le conduit dans le village de Géneval
Là il va plus ou moins s'intégrer à la famille de l'aubergiste, Rose Manet, qui l'accueille, essayant d'éveiller son petit neveu, Marcellin, à la vie.
Le village se meure, à l'écart des grandes villes ; encore dix ans et il sera en ruine.
Frédéric sentant son coeur s'éprendre et de la Tante et du neveu va fuir à l'aube ce si doux village.
L'Altaïr
(En arabe Altaïr veut dire l'aigle en vol et désigne donc cette étoile très vive dans la constellation de l'aigle)
Nous sautons du coq à l'âne, Meyrel se retrouve chez lui à Marseille ou il vit une curieuse expérience mystique faisant naître, des phrases écrites durant l'antiquité et qu'il traduit, l'esprit de celui qui les composa.
Il nous présente longuement les personnages constituants son groupe de relation et plus particulièrement Labartelade, important personnage du port de marchandise.
Puis, nouvel évènement, Labartelade et le narrateur partent à la recherche d'un personnage mystérieux qui s'est embarqué sur un Paquebot abandonné dans une partie sinistre du port. Meyrel va vivre une nouvelle expérience mystique sur ce navire ruiné, « hanté » par ceux qui y séjournèrent. Mais toutes ses présences ne sont que fugaces et incertaines. Ils retrouvent le personnage mystérieux, en fait leur ami Alléluia, en contact avec l'esprit de Marie-Josépha-de-Jésus. le navire va couler emmenant avec lui Alléluia et son ami ; Meyrel, lui en réchappera de justesse. Durant sa convalescence, nous devinons qu'un lien unissait Alléluia et Meyrel sans doute par le spectre vénéré.
Losélée
Pour parfaire sa convalescence, Meyrel loue le manoir de Losélée qui se trouve dans le village de Géneval ; mais Rose et Marcellin ont quitté le village. Sans doute Rose éprouvait-elle des sentiments pour Meyrel qui s'était enfuit comme un voleur.
Très vite le manoir envoute Meyrel ; il ressent les présences obscures de deux êtres qui vécurent ici ; il ressent leur amour.
Des personnages bien réels rôdent aux confins de la maison ; la servante sourde et le vieux jardinier qui se cache.
Meyrel, parfait médium, va de plus en plus sentir un esprit prendre possession de son corps, cohabitant avec le sien propre.
Apparaît alors la belle Clotilde qui fut amoureuse de Bernard qui hante le corps de Meyrel et qui le reconnaît.
L'amour impossible et confus naît alors et détruira tout.
Les rêveries d'un Rameau de la nuit.
Bosco, cette âme écrivant ?
La lecture est avant tout un cheminement hasardeux, où il faut se laisser aller à la beauté d'un titre, à l'oreille aussi, sa résonance dans notre imaginaire, tout autant qu'au bras attrapant au hasard un ouvrage sur l'étalage de la librairie. Aller vers le livre tout autant qu'il vient à nous, comme s'il recelait des pouvoirs magiques. le fait de lire réellement si l'on peut dire, ne se trouve pas tant dans l'action de l'oeil et de la main, du corps donc, sur une page contrainte, que dans le vecteur sensoriel ondoyant, cette sorte de vide invisible qui tournoie et fait vaciller l'oeil, la main et la page, le monde, tout à la fois.
Ma découverte du nom de Bosco est à la fois un hasard et une résurgence de l'inconscient. Je lus une première fois son nom dans l'ouvrage Poétique de l'espace de Bachelard : tout de suite, les extraits divulgués m'happèrent, m'époustouflant de style, cette puissance de l'insignifiant. Deux jours après, mon père, avec qui je ne parle que très rarement de lecture me dit : « J'ai parlé à un ami, il m'a dit que tu devais lire Henri Bosco. » Et c'est tout. Une simple phrase. Pourtant j'en étais désormais sûr, cet auteur deviendrait sans doute l'une de mes figures majeures. Une conviction inébranlable. J'achetai aussitôt cinq ouvrages de cet auteur, au hasard là-aussi : Un rameau de la nuit, Malicroix, Pierre Lampédouze, le Mas Théotime, Hyacinthe. (Je n'ai lu pour l'instant que les deux premiers, et une bonne part du troisième, livre tellement différent qu'il m'a amené à écrire cette note.) Bien que refusant systématiquement de lire la biographie d'un auteur pour ne pas être tenter par la psychanalyse, voire pire, le psychologisme de comptoir, systématique et tellement absurde tel qu'il est effectué à notre époque, je découvre malgré tout que ce cher Bosco est né en Avignon ; je suis vauclusien. Il est né en Avignon, 3 rue de la Carreterie, au sein ocre et protecteur des remparts papaux. 3 rue de la Carreterie ! Rue habitée par mon grand frère de nombreuses années pour ses études, rue empruntée par n'importe quel villageois débarquant dans la cité pour aller faire des courses ou boire un coup. Donc par moi, aussi. Et c'est bien sûr ! La plaque qui marque le lieu de naissance de l'auteur, je la vois, je l'ai lue de nombreuses fois, comme on lirait un prospectus, prospectus tellement habile qu'il graverait ses lettres au plus profond du cortex. C'est alors que tout revient ! Je suis pris d'un doute. Un sanglot me fait tressaillir. Je m'en vais vite fouiller les tréfonds de la bibliothèque familiale : je déniche un livre tout mâché par le temps et raturé, par le petit frère c'est certain, un livre que je n'avais pas ouvert depuis longtemps, vingt ans, et que j'avais complètement oublié : l'enfant et la rivière, d'Henri Bosco. Ce livre, pour sûr, je l'ai lu, mais impossible de me souvenir de quoique ce soit. Il touche à l'enfance, à des désirs et des émotions réprimés par l'adulte. Je n'ose l'ouvrir, je ne le lirai plus. Il y a sans doute dans ce livre que je n'ouvrirai pas, tout ce que compose l'oeuvre de cet auteur : l'enfouissement, l'inconscient, le hasard, l'enfance des sens, la rêverie.
Quelques jours plus tard, après un long temps de patience, je reçois les cinq livres par la poste. Pour commencer, ou plutôt recommencer, je choisis un titre : « Un rameau de la nuit » Quel titre ! Magnifique. Aussitôt je suis pris. Je le lis, étrangement très vite, alors qu'habituellement, j'ai une tendance tenace à l'extrême lenteur. Voilà. Ici, je n'en raconterai pas l'histoire en détail. Ce n'est pas lieu ni le but.
Cette succession de coïncidences, ces oublis, autant que ces résurgences du hasard et des profondeurs de l'inconscient me semblent choquants. Non pas sous un trait chamanique, non pas dans l'ordre de la destinée, mais choquants dans le sens qu'ils traduisent, décrivent, entourent parfaitement ce qu'est ce roman : une rêverie d'enfant, un voyage dans les fonds anciens des bibliothèques abandonnées, dans l'insignifiance des signes et des idées, des toutes minuscules choses tenus aux boucles du temps et à l'espace, aux pierres perdues et qui meurent, toutes ces choses de l'impalpable, de ce rapport du corps et de l'esprit à l'âme. Toute ma vie semblait avoir été dévolue à la lecture future de ce livre que j'allais dévorer en un instant. Mais n'est-ce pas là, le trait du temps, de toute la vie que de préparer l'instant d'après, qu'il soit futile ou magistral ?
Ce texte (provisoire) n'est pas à considérer comme une analyse factuelle. Il est lui-même issu d'une rêverie au sortir de la lecture d'un des ouvrages d'Henri Bosco. Ici nulle prétention de détenir la vérité, mais la seule nécessité d'écrire ce qui semble juste. Ici, il faudrait analyser de manière plus précise les cadres englobant les rêveries, les différentes phases qui font parvenir jusqu'au rêve. Peut-être y viendrai-je, plus tard.
Nul ne peut longtemps, je le crois, lire les rêveries d'Henri Bosco de manière purement consciente. Toujours, quand nous lisons d'autres livres, une pensée futile s'arraisonne ; à notre grand désarroi, nous décrochons et continuant à lire, nous perdons le fil en songeant à la liturgie des courses du lendemain et des tracas de la veille. Il en est de même des pages de Bosco, à la différence subtile, que lorsque l'on se réveille de celles-ci, à la faveur d'une fin d'un paragraphe ou d'un chapitre, il est impossible de se rappeler cette pensée futile, de se remémorer quelques raisons à ce décrochage : il n'y en a pas, d'extérieures à la lecture en tout cas. le fil, lui, n'est pas perdu. Ici nulle frustration, mais un bonheur enveloppant, une somnolence ouatée, un réveil doux et molletonné. Henri Bosco, de par la magie de son écriture (dont je me garderai l'analyse) dételle la lecture à la raison, pour l'arrimer à l'inconscient. Dans une mise en abîme magnifique, le lecteur devient alors le rêveur songeant le rêve dépeint par le narrateur-rêveur, rêve sans doute aussi "halluciné" par l'auteur lui-même. L'oeuvre de Bosco, c'est un monde entier et insécable qui nous pénètre - nulle possibilité de sortie ! - : l'univers fluctuant, étrange mais tranquille du premier sommeil, cette phase paradoxale, où s'endorment les facultés, où somnole la compréhension, mais durant laquelle le cerveau est plus que jamais à vif. Chez Bosco, c'est un sommeil dans lequel les yeux roulent les paupières grandes ouvertes. Un sommeil contemplatif. Ce ne sont pas les hommes qui rêvent, mais comme pourrait l'écrire l'auteur lui-même, ce sont leurs âmes.
Nous pourrions sans doute appuyer sur le thème de l'oubli dans sa littérature. Car comme après tout sommeil, le réel apparaît et au levé, les rêves s'effacent (la distinction entre réel et rêve est, je le crois, de toutes les manières, factice, illusoire, c'est une des grandes facultés de l'art de Bosco que d'en abolir la frontière). Comme le sommeil qui est un monde absolu et clos dans lequel nous pénétrons et aussitôt que nous en sortons, oublions, ou du moins en interprétons, témoignons, égratignons les rares indices qui nous l'ont fait percevoir (ces indices : le rêve, un rêve auquel le conscient applique des visages là où il n'y avait qu'ombre floutée, auquel le réel brosse des couleurs là où il n'y avait que contours noirs et blanches étendues.) le monde de Bosco s'oublie un peu dans les temps où nous ne le lisons pas – Voilà une nouvelle raison, autrement plus vivifiante que celle simpliste de la mémoire perdue, de mon oubli de l'enfant et la rivière. – Difficile de parler d'action, de retranscrire les rêveries, grande frustration de ne pas pouvoir les communiquer, les partager. C'est un monde solitaire. Il faut replonger, réengager l'inconscient, retrouver le fil de la lecture, et alors tout reprend sens, sans pour autant que l'on comprenne pourquoi. Quelle magie ! C'est simplement là. Nous y sommes. Nous lisons. Les rêveries reprennent. Nous redevenons des somnambules.
Cela a sans doute été un problème conséquent pour Henri Bosco. La peur a du être grande de perdre le lecteur au milieu de ces songes toujours étranges, toujours obscurs. Il faut que le lecteur résiste un petit peu au sommeil lourd qui pourrait le surprendre. Il ne doit pas non plus perdre le fil de l'histoire. S'il ne doit pas lire avec sa raison, il ne doit pas non plus se noyer dans les labyrinthes de la perception. C'est toute l'histoire d'un Rameau de la nuit : le danger qu'il y a à détacher l'âme du corps et de l'esprit, et de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais faire synthèse. Bosco est conscient de ce danger. Ce livre en est une mise en garde : à trop pénétrer la ouate de l'imaginaire, l'homme se perd. Voilà bien une définition de la folie, mais une folie douce, tranquille, heureuse. Malgré tout Bosco veut préserver son lectorat de celle-ci, tout lui en transcrivant le goût, l'odeur, les sons. Comment s'y est-il pris ?
Un indice, un témoignage de ma conscience dans l'inconscient de cette lecture, m'a quelque peu perturbé : la répétition. Dans un Rameau de la nuit, des mots reviennent sans cesse : âme, arrière pensée, net, hallucination, etc. La langue de Bosco est pourtant superbe, riche, mais là, nous le sentons, c'est l'urgence, il faut aller vite, il faut rattraper sa mémoire qui défaille toujours, c'est un combat acharné entre l'homme et le souvenir, alors des mots reviennent, se disputent, on les écrit, on n'a pas le temps ni le choix, il faut écrire avant que la mer ait définitivement monté sur les mots. Alors la question peut se poser : pourquoi lors de la correction, de la relecture, ces mots-là n'ont-ils pas été corrigés, remplacés ? Pierre Lampédouze, pour ne citer que lui, premier roman, fait la démonstration éloquente du vocabulaire, de la qualité stylistique, de la richesse de l'auteur. Pour autant, dans ce même livre, ce sentiment de rêverie bien que parfaitement écrit, est moins puissant. On a l'impression que c'est une maîtrise naissante d'une mécanique en devenir mais pas encore pleine et aboutie comme c'est le cas dans un Rameau de la nuit.
J'avance une idée : Bosco sait parfaitement ce que va provoquer sa lecture : l'entrée dans un monde rêvé. Bosco connaît cette magie. Il construit lui-même les portes de ce monde. Il choisit la qualité de la pierre, quelle mélodie doit happer le lecteur, quelle qualité de grain doit venir éprendre l'espace : suffoquant ou au contraire voluptueux, léger... Il engage le lecteur sur la voie du rêve et décide de tout. L'idée qui est la mienne n'est pas issue d'un décompte fastidieux de ces répétitions, mais de la désagréable sensation qu'ils ont provoquée en moi. Ces mots répétés seraient des îlots de conscience auxquels le lecteur pourrait s'accrocher un peu, reprendre souffle, et replonger aussitôt, plus profondément. Cette désagréable sensation ? C'est Henri Bosco lui-même qui, avec une aiguille, « pique » le dormeur. Voilà le réel, nécessaire mais douloureux, qui secoue le rêve, un petit peu, juste un petit peu. Cette mécanique ressemble étrangement à celle qui nous surprend au moment de s'endormir : cette sensation de chute ou ce violent tressautement du corps, ce rappel du cerveau aux nerfs que ce n'est pas la mort qui nous attend, mais la vie, autre, ailleurs. Ces mots sont les fils du corps à l'âme.
Quelle immense maîtrise de Bosco si cette théorie s'avère juste ! Pour comprendre les âmes, il faut avoir cheminé longtemps le long de leurs routes, et sans doute en avoir été une soi-même, ce qui est toute l'histoire d'un Rameau de la nuit : l'âme d'un mort s'accaparant le corps et l'esprit d'un vivant. Bosco, cette âme écrivant ?
Paul Jullien
BOSCO Henri, Un rameau de la nuit, Editions Gallimard, Collection Folio, Première édition chez Flammarion, 1950, Réédition 2002, 509 pages.
Bosco, cette âme écrivant ?
La lecture est avant tout un cheminement hasardeux, où il faut se laisser aller à la beauté d'un titre, à l'oreille aussi, sa résonance dans notre imaginaire, tout autant qu'au bras attrapant au hasard un ouvrage sur l'étalage de la librairie. Aller vers le livre tout autant qu'il vient à nous, comme s'il recelait des pouvoirs magiques. le fait de lire réellement si l'on peut dire, ne se trouve pas tant dans l'action de l'oeil et de la main, du corps donc, sur une page contrainte, que dans le vecteur sensoriel ondoyant, cette sorte de vide invisible qui tournoie et fait vaciller l'oeil, la main et la page, le monde, tout à la fois.
Ma découverte du nom de Bosco est à la fois un hasard et une résurgence de l'inconscient. Je lus une première fois son nom dans l'ouvrage Poétique de l'espace de Bachelard : tout de suite, les extraits divulgués m'happèrent, m'époustouflant de style, cette puissance de l'insignifiant. Deux jours après, mon père, avec qui je ne parle que très rarement de lecture me dit : « J'ai parlé à un ami, il m'a dit que tu devais lire Henri Bosco. » Et c'est tout. Une simple phrase. Pourtant j'en étais désormais sûr, cet auteur deviendrait sans doute l'une de mes figures majeures. Une conviction inébranlable. J'achetai aussitôt cinq ouvrages de cet auteur, au hasard là-aussi : Un rameau de la nuit, Malicroix, Pierre Lampédouze, le Mas Théotime, Hyacinthe. (Je n'ai lu pour l'instant que les deux premiers, et une bonne part du troisième, livre tellement différent qu'il m'a amené à écrire cette note.) Bien que refusant systématiquement de lire la biographie d'un auteur pour ne pas être tenter par la psychanalyse, voire pire, le psychologisme de comptoir, systématique et tellement absurde tel qu'il est effectué à notre époque, je découvre malgré tout que ce cher Bosco est né en Avignon ; je suis vauclusien. Il est né en Avignon, 3 rue de la Carreterie, au sein ocre et protecteur des remparts papaux. 3 rue de la Carreterie ! Rue habitée par mon grand frère de nombreuses années pour ses études, rue empruntée par n'importe quel villageois débarquant dans la cité pour aller faire des courses ou boire un coup. Donc par moi, aussi. Et c'est bien sûr ! La plaque qui marque le lieu de naissance de l'auteur, je la vois, je l'ai lue de nombreuses fois, comme on lirait un prospectus, prospectus tellement habile qu'il graverait ses lettres au plus profond du cortex. C'est alors que tout revient ! Je suis pris d'un doute. Un sanglot me fait tressaillir. Je m'en vais vite fouiller les tréfonds de la bibliothèque familiale : je déniche un livre tout mâché par le temps et raturé, par le petit frère c'est certain, un livre que je n'avais pas ouvert depuis longtemps, vingt ans, et que j'avais complètement oublié : l'enfant et la rivière, d'Henri Bosco. Ce livre, pour sûr, je l'ai lu, mais impossible de me souvenir de quoique ce soit. Il touche à l'enfance, à des désirs et des émotions réprimés par l'adulte. Je n'ose l'ouvrir, je ne le lirai plus. Il y a sans doute dans ce livre que je n'ouvrirai pas, tout ce que compose l'oeuvre de cet auteur : l'enfouissement, l'inconscient, le hasard, l'enfance des sens, la rêverie.
Quelques jours plus tard, après un long temps de patience, je reçois les cinq livres par la poste. Pour commencer, ou plutôt recommencer, je choisis un titre : « Un rameau de la nuit » Quel titre ! Magnifique. Aussitôt je suis pris. Je le lis, étrangement très vite, alors qu'habituellement, j'ai une tendance tenace à l'extrême lenteur. Voilà. Ici, je n'en raconterai pas l'histoire en détail. Ce n'est pas lieu ni le but.
Cette succession de coïncidences, ces oublis, autant que ces résurgences du hasard et des profondeurs de l'inconscient me semblent choquants. Non pas sous un trait chamanique, non pas dans l'ordre de la destinée, mais choquants dans le sens qu'ils traduisent, décrivent, entourent parfaitement ce qu'est ce roman : une rêverie d'enfant, un voyage dans les fonds anciens des bibliothèques abandonnées, dans l'insignifiance des signes et des idées, des toutes minuscules choses tenus aux boucles du temps et à l'espace, aux pierres perdues et qui meurent, toutes ces choses de l'impalpable, de ce rapport du corps et de l'esprit à l'âme. Toute ma vie semblait avoir été dévolue à la lecture future de ce livre que j'allais dévorer en un instant. Mais n'est-ce pas là, le trait du temps, de toute la vie que de préparer l'instant d'après, qu'il soit futile ou magistral ?
Ce texte (provisoire) n'est pas à considérer comme une analyse factuelle. Il est lui-même issu d'une rêverie au sortir de la lecture d'un des ouvrages d'Henri Bosco. Ici nulle prétention de détenir la vérité, mais la seule nécessité d'écrire ce qui semble juste. Ici, il faudrait analyser de manière plus précise les cadres englobant les rêveries, les différentes phases qui font parvenir jusqu'au rêve. Peut-être y viendrai-je, plus tard.
Nul ne peut longtemps, je le crois, lire les rêveries d'Henri Bosco de manière purement consciente. Toujours, quand nous lisons d'autres livres, une pensée futile s'arraisonne ; à notre grand désarroi, nous décrochons et continuant à lire, nous perdons le fil en songeant à la liturgie des courses du lendemain et des tracas de la veille. Il en est de même des pages de Bosco, à la différence subtile, que lorsque l'on se réveille de celles-ci, à la faveur d'une fin d'un paragraphe ou d'un chapitre, il est impossible de se rappeler cette pensée futile, de se remémorer quelques raisons à ce décrochage : il n'y en a pas, d'extérieures à la lecture en tout cas. le fil, lui, n'est pas perdu. Ici nulle frustration, mais un bonheur enveloppant, une somnolence ouatée, un réveil doux et molletonné. Henri Bosco, de par la magie de son écriture (dont je me garderai l'analyse) dételle la lecture à la raison, pour l'arrimer à l'inconscient. Dans une mise en abîme magnifique, le lecteur devient alors le rêveur songeant le rêve dépeint par le narrateur-rêveur, rêve sans doute aussi "halluciné" par l'auteur lui-même. L'oeuvre de Bosco, c'est un monde entier et insécable qui nous pénètre - nulle possibilité de sortie ! - : l'univers fluctuant, étrange mais tranquille du premier sommeil, cette phase paradoxale, où s'endorment les facultés, où somnole la compréhension, mais durant laquelle le cerveau est plus que jamais à vif. Chez Bosco, c'est un sommeil dans lequel les yeux roulent les paupières grandes ouvertes. Un sommeil contemplatif. Ce ne sont pas les hommes qui rêvent, mais comme pourrait l'écrire l'auteur lui-même, ce sont leurs âmes.
Nous pourrions sans doute appuyer sur le thème de l'oubli dans sa littérature. Car comme après tout sommeil, le réel apparaît et au levé, les rêves s'effacent (la distinction entre réel et rêve est, je le crois, de toutes les manières, factice, illusoire, c'est une des grandes facultés de l'art de Bosco que d'en abolir la frontière). Comme le sommeil qui est un monde absolu et clos dans lequel nous pénétrons et aussitôt que nous en sortons, oublions, ou du moins en interprétons, témoignons, égratignons les rares indices qui nous l'ont fait percevoir (ces indices : le rêve, un rêve auquel le conscient applique des visages là où il n'y avait qu'ombre floutée, auquel le réel brosse des couleurs là où il n'y avait que contours noirs et blanches étendues.) le monde de Bosco s'oublie un peu dans les temps où nous ne le lisons pas – Voilà une nouvelle raison, autrement plus vivifiante que celle simpliste de la mémoire perdue, de mon oubli de l'enfant et la rivière. – Difficile de parler d'action, de retranscrire les rêveries, grande frustration de ne pas pouvoir les communiquer, les partager. C'est un monde solitaire. Il faut replonger, réengager l'inconscient, retrouver le fil de la lecture, et alors tout reprend sens, sans pour autant que l'on comprenne pourquoi. Quelle magie ! C'est simplement là. Nous y sommes. Nous lisons. Les rêveries reprennent. Nous redevenons des somnambules.
Cela a sans doute été un problème conséquent pour Henri Bosco. La peur a du être grande de perdre le lecteur au milieu de ces songes toujours étranges, toujours obscurs. Il faut que le lecteur résiste un petit peu au sommeil lourd qui pourrait le surprendre. Il ne doit pas non plus perdre le fil de l'histoire. S'il ne doit pas lire avec sa raison, il ne doit pas non plus se noyer dans les labyrinthes de la perception. C'est toute l'histoire d'un Rameau de la nuit : le danger qu'il y a à détacher l'âme du corps et de l'esprit, et de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais faire synthèse. Bosco est conscient de ce danger. Ce livre en est une mise en garde : à trop pénétrer la ouate de l'imaginaire, l'homme se perd. Voilà bien une définition de la folie, mais une folie douce, tranquille, heureuse. Malgré tout Bosco veut préserver son lectorat de celle-ci, tout lui en transcrivant le goût, l'odeur, les sons. Comment s'y est-il pris ?
Un indice, un témoignage de ma conscience dans l'inconscient de cette lecture, m'a quelque peu perturbé : la répétition. Dans un Rameau de la nuit, des mots reviennent sans cesse : âme, arrière pensée, net, hallucination, etc. La langue de Bosco est pourtant superbe, riche, mais là, nous le sentons, c'est l'urgence, il faut aller vite, il faut rattraper sa mémoire qui défaille toujours, c'est un combat acharné entre l'homme et le souvenir, alors des mots reviennent, se disputent, on les écrit, on n'a pas le temps ni le choix, il faut écrire avant que la mer ait définitivement monté sur les mots. Alors la question peut se poser : pourquoi lors de la correction, de la relecture, ces mots-là n'ont-ils pas été corrigés, remplacés ? Pierre Lampédouze, pour ne citer que lui, premier roman, fait la démonstration éloquente du vocabulaire, de la qualité stylistique, de la richesse de l'auteur. Pour autant, dans ce même livre, ce sentiment de rêverie bien que parfaitement écrit, est moins puissant. On a l'impression que c'est une maîtrise naissante d'une mécanique en devenir mais pas encore pleine et aboutie comme c'est le cas dans un Rameau de la nuit.
J'avance une idée : Bosco sait parfaitement ce que va provoquer sa lecture : l'entrée dans un monde rêvé. Bosco connaît cette magie. Il construit lui-même les portes de ce monde. Il choisit la qualité de la pierre, quelle mélodie doit happer le lecteur, quelle qualité de grain doit venir éprendre l'espace : suffoquant ou au contraire voluptueux, léger... Il engage le lecteur sur la voie du rêve et décide de tout. L'idée qui est la mienne n'est pas issue d'un décompte fastidieux de ces répétitions, mais de la désagréable sensation qu'ils ont provoquée en moi. Ces mots répétés seraient des îlots de conscience auxquels le lecteur pourrait s'accrocher un peu, reprendre souffle, et replonger aussitôt, plus profondément. Cette désagréable sensation ? C'est Henri Bosco lui-même qui, avec une aiguille, « pique » le dormeur. Voilà le réel, nécessaire mais douloureux, qui secoue le rêve, un petit peu, juste un petit peu. Cette mécanique ressemble étrangement à celle qui nous surprend au moment de s'endormir : cette sensation de chute ou ce violent tressautement du corps, ce rappel du cerveau aux nerfs que ce n'est pas la mort qui nous attend, mais la vie, autre, ailleurs. Ces mots sont les fils du corps à l'âme.
Quelle immense maîtrise de Bosco si cette théorie s'avère juste ! Pour comprendre les âmes, il faut avoir cheminé longtemps le long de leurs routes, et sans doute en avoir été une soi-même, ce qui est toute l'histoire d'un Rameau de la nuit : l'âme d'un mort s'accaparant le corps et l'esprit d'un vivant. Bosco, cette âme écrivant ?
Paul Jullien
BOSCO Henri, Un rameau de la nuit, Editions Gallimard, Collection Folio, Première édition chez Flammarion, 1950, Réédition 2002, 509 pages.
J'ai commencé cette lecture avec plaisir, une écriture ciselée, poétique, colorée, parfumée et puis au bout d'une quarantaine de pages, ce style lasse, car c'est long, trop long, comme cette route sans fin où chemine le narrateur, comme une nuit blanche taquinée par l'insomnie. On s'attend à ce qu'enfin il arrive quelque chose, et puis ça continue, et rien ne se passe ou si peu , ou alors je m'endors et il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vu ! Mais je me réveille , hallucinée, et ne peux me rendormir, agacée de ne pouvoir plus avancer dans cette lecture qui devient spectrale
J'arrête, dommage ! Peut-être à reprendre dans une période plus dynamique ! Mais je vais retrouver Bosco et d'autres horizons avec Malicroix.
J'arrête, dommage ! Peut-être à reprendre dans une période plus dynamique ! Mais je vais retrouver Bosco et d'autres horizons avec Malicroix.
Frédéric Meyrel consacre son temps à l'étude des textes et inscriptions anciennes. Dès que la saison l'autorise il part à travers les sentiers provençaux. Vingt ans plus tôt, vers 1900, il se souvient s'être arrêté dans un village dépeuplé, Géneval, où il avait fait connaissance de Rose Manet, une Pénélope privée d'espérance, et son neveu Marcellin en compagnie desquels il avait passé plusieurs jours puis avait quitté les lieux, tels d'autres avant lui, soudainement comme il était venu. "Une simple halte" sans clause de revoyure vécue rétrospectivement comme une fuite sur laquelle il s'interrogera au cours de son récit. Très belle introduction qu'une peinture dans le modeste café de Rose ("le café du souvenir") place sous le signe des rêveries trompeuses d'où aiment surgir les ombres. Prémisses poétiques qui se veulent "puissance d'appel" et d'attente : "[...] Attente... qui crée, peut-être, le voyageur et, peut-être, l'attire sourdement..." (p. 12) ; l'irrépressible attrait du départ remplit les premières pages et les paroles voilées d'amertume de Rose anticipant celui de Frédéric. Difficile pour le lecteur de rester insensible à l'atmosphère de mélancolie générale qu'il sent poindre à l'orée de ce livre et qui l'accompagnera jusqu'à sa fin.
Un automne marseillais triste et pluvieux succède à cet épisode pendant lequel Frédéric retrouve ses rituels de travail en ville. Seconde partie sur sept au nom évocateur : "Altaïr". le nom d'un vieux rafiot hauturier échoué dans un bassin désaffecté du port livré à la ferraille - mais désignant aussi l'une des étoiles les plus brillantes du ciel estival de l'hémisphère nord dans la constellation de l'Aigle. L'âme nocturne de Frédéric Meyrel se révèle ici a côté de quelques amis, Hautard et Jumerand, qui lui ont fait croiser des personnages hauts en couleurs unis par le sens du métier, le capitaine au long cours "Alléluia" et l'énigmatique commissaire de bord "Drot" qui ont bourlingué jadis sur l'Altaïr jusqu'en Asie, leur acolyte Labartelade rivé à ses docks ou encore le tolérant douanier Travellini. Petite société hétéroclite qui l'a accueilli comme l'un des siens et que Meyrel apprécie. Au milieu des livres et des traductions laissées en suspens durant la parenthèse pédestre qu'il dit avoir été plus longue qu'à l'accoutumée, le voilà qui relit un soir quelques mots d'une phrase en grec tracée sur une feuille oubliée. Les ombres suggérées par la silhouette d'un grumier norvégien quittant le port, aperçu au loin ce soir là, sont en tout cas de nature à le pousser hors de son antre d'érudit jusqu'au quai où flotte encore pour quelques heures la vieille coque rouillée de l'Altaïr, bientôt à la poursuite avec deux autres compères des âmes errantes de ce vaisseau fantôme.
La dimension ésotérique et presque mystique de l'épisode de l'Altaïr renvoie à la prédilection de Meyrel pour l'épigraphie et la philologie, traducteur d'auteurs oubliés ou de textes rares, hermétiques aux profanes. Sa sensibilité de médium s'y est affûtée et fait de lui un personnage complexe, une âme divisée, hésitant entre sa solitude habitée, peuplée d'ombres, dont les parties suivantes ("Loselée" ; "Ce noir feuillage" ; "Son ombre") sont l'illustration, et la réalité d'un monde qu'il aime et qu'il fuit celui dans lequel Rose et Marcellin l'invitent à demeurer. Ses cheminements méditatifs dans les livres ou sur les sentiers, son rapport fusionnel à la nature, le prédisposent au "désir de réveiller comme une mémoire des hommes effacés de ce monde" (p. 50). Mais qu'a-t'il a vu avant de frôler la mort pendant sa nuit de "démesure" sur l'Altaïr qui l'ait ébranlé au point de vouloir quitter Marseille ? Et qui fasse resurgir du même coup son départ inexpliqué de Géneval, jamais oublié, encore moins ses habitants si l'on en juge par ses retrouvailles inattendues avec l'attendrissant Marcellin devant une librairie marseillaise ("Rencontres "). Une retraite campagnarde s'impose, suggérée par son ami Drot, au domaine de Loselée dont Géneval est voisin, qui sera le lieu d'une expérience aussi envoûtante que celle dont il sort.
À Loselée, sous des éclairages lunaires dont la symbolique beauté semble avoir inspiré l'éditeur (Folio) en couverture, dans un cadre naturel magnifié par la poésie de Bosco, Meyrel ne court plus derrière l'ombre des autres : "l'être étrange, il était en moi, et c'était moi, peut être..." (p. 149). C'est l'ombre de l'ancien propriétaire des lieux que les souvenirs sibyllins de ceux qui l'ont connu projettent inexplicablement et font revivre en lui (Mme Millichel, le vieux jardinier Mus, la servante muette Valérie, Elzéar ou le curé de Géneval). le fantôme d'un autre usurperait-il son âme à travers l'emprise amoureuse qu'exerce sur lui Clotilde ? Comme il avait fui Géneval Meyrel fuit maintenat Loselée mais son retour vers Rose et Marcellin a le goût d'un remord vain... Récit des profondeurs de la conscience d'un homme en butte avec ses désirs cherchant à en éluder les secrets entre les murs d'un village déserté, au fond d'un navire abandonné ou dans l'épaisseur végétale d'un domaine perdu. Cheminement où le voyage réel, rêvé et symbolique, par ombres et livres interposés, emprunte toutes formes, tous moyens et conduit Frédéric Meyrel à des retrouvailles un peu desabusées avec lui-même. Une certaine opacité demeure en fin de lecture pour un livre dont on retient la magie dépaysante, unique, d'une écriture inspirée des visions d'une Provence rurale et secrète en voie de disparition. À redécouvrir pour qui déciderait de s'arracher quelques jours à la tyrannie du présent littéraire.
Un automne marseillais triste et pluvieux succède à cet épisode pendant lequel Frédéric retrouve ses rituels de travail en ville. Seconde partie sur sept au nom évocateur : "Altaïr". le nom d'un vieux rafiot hauturier échoué dans un bassin désaffecté du port livré à la ferraille - mais désignant aussi l'une des étoiles les plus brillantes du ciel estival de l'hémisphère nord dans la constellation de l'Aigle. L'âme nocturne de Frédéric Meyrel se révèle ici a côté de quelques amis, Hautard et Jumerand, qui lui ont fait croiser des personnages hauts en couleurs unis par le sens du métier, le capitaine au long cours "Alléluia" et l'énigmatique commissaire de bord "Drot" qui ont bourlingué jadis sur l'Altaïr jusqu'en Asie, leur acolyte Labartelade rivé à ses docks ou encore le tolérant douanier Travellini. Petite société hétéroclite qui l'a accueilli comme l'un des siens et que Meyrel apprécie. Au milieu des livres et des traductions laissées en suspens durant la parenthèse pédestre qu'il dit avoir été plus longue qu'à l'accoutumée, le voilà qui relit un soir quelques mots d'une phrase en grec tracée sur une feuille oubliée. Les ombres suggérées par la silhouette d'un grumier norvégien quittant le port, aperçu au loin ce soir là, sont en tout cas de nature à le pousser hors de son antre d'érudit jusqu'au quai où flotte encore pour quelques heures la vieille coque rouillée de l'Altaïr, bientôt à la poursuite avec deux autres compères des âmes errantes de ce vaisseau fantôme.
La dimension ésotérique et presque mystique de l'épisode de l'Altaïr renvoie à la prédilection de Meyrel pour l'épigraphie et la philologie, traducteur d'auteurs oubliés ou de textes rares, hermétiques aux profanes. Sa sensibilité de médium s'y est affûtée et fait de lui un personnage complexe, une âme divisée, hésitant entre sa solitude habitée, peuplée d'ombres, dont les parties suivantes ("Loselée" ; "Ce noir feuillage" ; "Son ombre") sont l'illustration, et la réalité d'un monde qu'il aime et qu'il fuit celui dans lequel Rose et Marcellin l'invitent à demeurer. Ses cheminements méditatifs dans les livres ou sur les sentiers, son rapport fusionnel à la nature, le prédisposent au "désir de réveiller comme une mémoire des hommes effacés de ce monde" (p. 50). Mais qu'a-t'il a vu avant de frôler la mort pendant sa nuit de "démesure" sur l'Altaïr qui l'ait ébranlé au point de vouloir quitter Marseille ? Et qui fasse resurgir du même coup son départ inexpliqué de Géneval, jamais oublié, encore moins ses habitants si l'on en juge par ses retrouvailles inattendues avec l'attendrissant Marcellin devant une librairie marseillaise ("Rencontres "). Une retraite campagnarde s'impose, suggérée par son ami Drot, au domaine de Loselée dont Géneval est voisin, qui sera le lieu d'une expérience aussi envoûtante que celle dont il sort.
À Loselée, sous des éclairages lunaires dont la symbolique beauté semble avoir inspiré l'éditeur (Folio) en couverture, dans un cadre naturel magnifié par la poésie de Bosco, Meyrel ne court plus derrière l'ombre des autres : "l'être étrange, il était en moi, et c'était moi, peut être..." (p. 149). C'est l'ombre de l'ancien propriétaire des lieux que les souvenirs sibyllins de ceux qui l'ont connu projettent inexplicablement et font revivre en lui (Mme Millichel, le vieux jardinier Mus, la servante muette Valérie, Elzéar ou le curé de Géneval). le fantôme d'un autre usurperait-il son âme à travers l'emprise amoureuse qu'exerce sur lui Clotilde ? Comme il avait fui Géneval Meyrel fuit maintenat Loselée mais son retour vers Rose et Marcellin a le goût d'un remord vain... Récit des profondeurs de la conscience d'un homme en butte avec ses désirs cherchant à en éluder les secrets entre les murs d'un village déserté, au fond d'un navire abandonné ou dans l'épaisseur végétale d'un domaine perdu. Cheminement où le voyage réel, rêvé et symbolique, par ombres et livres interposés, emprunte toutes formes, tous moyens et conduit Frédéric Meyrel à des retrouvailles un peu desabusées avec lui-même. Une certaine opacité demeure en fin de lecture pour un livre dont on retient la magie dépaysante, unique, d'une écriture inspirée des visions d'une Provence rurale et secrète en voie de disparition. À redécouvrir pour qui déciderait de s'arracher quelques jours à la tyrannie du présent littéraire.
Le personnage principal-narrateur nous raconte un moment de sa vie particulièrement important, central. C'est un homme tourné vers la vie de l'intérieur, l'étude, la concentration sur soi et sur les mots ; un paysage, une sensation, un objet, une rencontre fugitive peuvent donner lieu à une forte résonance, une sorte d'onde qui se propage, qui fait sens, qui continue à vivre et à provoquer d'autres réactions. C'est un rêveur, pour qui ses rêves ont plus de réalité que la réalité triviale de la plupart des gens.
Au début du roman nous le suivons dans un voyage à pied, dans lequel il arrive dans un village, Géneval, qui se dépeuple, il rencontre Rose qui tient le café-hôtel pour ainsi dire désert, et où il s'installe, sensible à l'atmosphère du lieu et à l'affection qui lui porte Marcellin, le jeune neveu de Rose. Mais il finit par fuir, et revenir à sa vie, celle d'un traducteur-chercheur, même s'il a l'impression que ce séjour a modifié ses perceptions. Toutefois, il n'en a pas finit avec ce village. Une étrange aventure, dans un grand navire hors d'usage, dans lequel il va rencontrer quelque chose qui ressemble à des fantômes, modifie quelque chose en lui.
En reconvalescence, il se voit proposer de louer une maison à proximité de Géneval. Tout le monde fait référence à un homme mort, celui dont il a frôlé une trace dans le navire abandonné, et de mystérieux phénomènes se produisent dans les environs ; tout une galerie de personnages sortant de l'ordinaire semblent vouloir le faire rentrer dans leur monde, et le faire disparaître en tant que tel pour faire revivre le mort à travers son corps. L'affaire devient encore plus complexe avec l'arrivée d'une femme, Clothilde, la nièce du défunt, dont il tombe amoureux, et qui essaie, encore plus que les autres, de le faire s'abandonner à la présence du disparu.
Comme souvent avec Bosco, je suis partagée en ce qui concerne cette lecture. L'écriture est magnifique, l'auteur installe un climat, trouble, incertain, vénéneux. La première partie est de toute beauté. Mais comme souvent avec cet auteur, j'ai eu au bout d'un moment, la sensation d'un enlisement, d'en rester à un climat, à une attente de quelque qui ne vient pas en fin de compte. D'être dans un couloir à la lumière diffuse, avec plusieurs portes, mais au final les seules qui s'ouvrent débouchent sur un autre couloir. Certains passages, certains moments m'ont plus captivé, plus envoûté, puis dans d'autres je me suis un peu ennuyé, avec élégance, compte tenu de la qualité du style, mais ennuyé quand même. Ce n'est pas encore avec ce livre que je vais devenir une inconditionnel de l'auteur, même si je reconnais que c'est doute un écrivain qui mérite la lecture, avec un univers et une écriture bien à lui.
Au début du roman nous le suivons dans un voyage à pied, dans lequel il arrive dans un village, Géneval, qui se dépeuple, il rencontre Rose qui tient le café-hôtel pour ainsi dire désert, et où il s'installe, sensible à l'atmosphère du lieu et à l'affection qui lui porte Marcellin, le jeune neveu de Rose. Mais il finit par fuir, et revenir à sa vie, celle d'un traducteur-chercheur, même s'il a l'impression que ce séjour a modifié ses perceptions. Toutefois, il n'en a pas finit avec ce village. Une étrange aventure, dans un grand navire hors d'usage, dans lequel il va rencontrer quelque chose qui ressemble à des fantômes, modifie quelque chose en lui.
En reconvalescence, il se voit proposer de louer une maison à proximité de Géneval. Tout le monde fait référence à un homme mort, celui dont il a frôlé une trace dans le navire abandonné, et de mystérieux phénomènes se produisent dans les environs ; tout une galerie de personnages sortant de l'ordinaire semblent vouloir le faire rentrer dans leur monde, et le faire disparaître en tant que tel pour faire revivre le mort à travers son corps. L'affaire devient encore plus complexe avec l'arrivée d'une femme, Clothilde, la nièce du défunt, dont il tombe amoureux, et qui essaie, encore plus que les autres, de le faire s'abandonner à la présence du disparu.
Comme souvent avec Bosco, je suis partagée en ce qui concerne cette lecture. L'écriture est magnifique, l'auteur installe un climat, trouble, incertain, vénéneux. La première partie est de toute beauté. Mais comme souvent avec cet auteur, j'ai eu au bout d'un moment, la sensation d'un enlisement, d'en rester à un climat, à une attente de quelque qui ne vient pas en fin de compte. D'être dans un couloir à la lumière diffuse, avec plusieurs portes, mais au final les seules qui s'ouvrent débouchent sur un autre couloir. Certains passages, certains moments m'ont plus captivé, plus envoûté, puis dans d'autres je me suis un peu ennuyé, avec élégance, compte tenu de la qualité du style, mais ennuyé quand même. Ce n'est pas encore avec ce livre que je vais devenir une inconditionnel de l'auteur, même si je reconnais que c'est doute un écrivain qui mérite la lecture, avec un univers et une écriture bien à lui.
Citations et extraits (35)
Voir plus
Ajouter une citation
Enfin, mes plus longues stations (et cela va de soi), je les faisais devant les librairies. Là j'oubliais la pluie à regarder les livres disposés en amphithéâtre sur un plan incliné. En hautes et larges majuscules les titres rouges, bleus, saumon, des ouvrages de luxe, coloraient l'ivoire glacé des couvertures, où quelquefois luisaient des ors, jouaient des entrelacs de feuillages, et veillaient des bêtes héraldiques. De ces librairies l'une, assez modeste, m'attirait plus particulièrement, surtout les jours de pluie, car elle avait l'amour des cartes, des atlas, des gravures de voyage, dont je suis grand amateur. Cette année là, elle avait enrichi sa vitrine d'un globe terrestre de verre, éclairé intérieurement et qui tournait avec lenteur de façon à montrer les couleurs différentes des cinq parties du monde. Ce globe me plaisait beaucoup. Il était assez gros et d'une douce transparence. Les mers y étaient d'un bleu vif, rayées de courants mauves, l'Europe verte, d'un vert sombre, et l'Asie rouge brique ; l'Afrique y brûlait de soleil, l'Amérique indigo s'incurvait sur les mers ; l'Océanie n'était qu'azur, immense azur...
À la nuit tombée, par un temps humide, alors que de rares passants fuyaient la bruine glaciale, rien n'était plus beau comme ce globe, où l'on voyait tourner cinq continents, tout brillants de lumière. Sur eux, immuablement clairs, pas un nuage ; le soleil qui les réchauffait vivait au centre de la terre ; et ainsi la nuit ne les touchait pas. Ils avaient l'air d'aimer la chaleur et la vie. Comme l'aube et le soir y étaient inconnus, la chaleur y était constante et la vie éternelle... (p. 179-180)
Rencontres
À la nuit tombée, par un temps humide, alors que de rares passants fuyaient la bruine glaciale, rien n'était plus beau comme ce globe, où l'on voyait tourner cinq continents, tout brillants de lumière. Sur eux, immuablement clairs, pas un nuage ; le soleil qui les réchauffait vivait au centre de la terre ; et ainsi la nuit ne les touchait pas. Ils avaient l'air d'aimer la chaleur et la vie. Comme l'aube et le soir y étaient inconnus, la chaleur y était constante et la vie éternelle... (p. 179-180)
Rencontres
J'ai vérifié les devoirs de Marcellin. Les additions sont justes. Les multiplications aussi. Mais il soustrait mal. Il a une répugnance à soustraire. Il est bien difficile de savoir pourquoi, car aux questions il ne répond qu'en prenant un air obstiné, hostile.
- Si tu as dix amandes, Marcellin, et qu'on t'en prenne sept, combien t'en reste-t-il ?
Il baisse la tête. J'insiste. Il finit par répondre :
- L'autre en a sept.
- Mais toi, Marcellin, que fais-tu alors ? Tu ne comptes pas dans ta main ce qui reste ?
- Non, monsieur Frédéric. Je vais à l'arbre. Il y en a tant que je veux...
Tante Rose écoute, en silence, et approuve de la tête.
- Ce n'est pas ce qui manque, ajoute-elle. J'ai dix amandiers, et des beaux, des coques fines... (p. 287)
Loselée
- Si tu as dix amandes, Marcellin, et qu'on t'en prenne sept, combien t'en reste-t-il ?
Il baisse la tête. J'insiste. Il finit par répondre :
- L'autre en a sept.
- Mais toi, Marcellin, que fais-tu alors ? Tu ne comptes pas dans ta main ce qui reste ?
- Non, monsieur Frédéric. Je vais à l'arbre. Il y en a tant que je veux...
Tante Rose écoute, en silence, et approuve de la tête.
- Ce n'est pas ce qui manque, ajoute-elle. J'ai dix amandiers, et des beaux, des coques fines... (p. 287)
Loselée
Pourtant le pays s'éteignait. Il semblait pris d'une pesanteur indéfinissable. Il m'en venait une impression étrange ; celle que le temps était là. Du haut en bas le village en était pétri. Le temps imprégnait les murailles et les âmes. On le voyait. Partout ailleurs, il passe. Là, il ne bougeait plus ; il s'était peu à peu accumulé dans ce creux, à l'abri. Et on en décelait, tel un mortier, dans la moindre fissure, la matière épaisse, coulée, puissante et dorée de soleil, où tout le village s'était enfoncé. C'était une très vieille chose que ce temps durci. Les hivers, les étés, l'usure des vents, des pluies, des neiges, avaient émoussé les arêtes de la vie passée. Plus rien pourtant de ce passé, lent à se fondre, ne survivait dans ce groupement d'âmes et de pierres douces, où l'on voyait encore, ça et là, une date lointaine gravée au ciseau. (p. 17-18)
Une simple halte
Une simple halte
De temps en temps, au loin, un clocher parle. Les petites églises villageoises ont souvent des cloches doucement timbrées où le bronze accorde à la brise des sons légers. L'air les emporte très facilement. Ils tintent très loin de leur cloches, jusque dans les mas isolés, perdus un peu partout dans la campagne. [...]
Celle de Géneval, plus proche, ne sonne plus que bien faiblement. Le battant ne touche le bronze que du bout d'un doigt sourd, que l'on dirait enveloppé de laine. Le bronze, lui, reste toujours sensible, mais la cloche ne parle plus qu'à un tout petit nombre d'âmes. Elle est lente, un peu lasse, et cette lassitude me trouble le coeur. (p. 281)
Loselée
Celle de Géneval, plus proche, ne sonne plus que bien faiblement. Le battant ne touche le bronze que du bout d'un doigt sourd, que l'on dirait enveloppé de laine. Le bronze, lui, reste toujours sensible, mais la cloche ne parle plus qu'à un tout petit nombre d'âmes. Elle est lente, un peu lasse, et cette lassitude me trouble le coeur. (p. 281)
Loselée
C'est à travers cet esprit et ce corps, que l'on entrevoyait la confusion des bois, que l'on entendait les évolutions souterraines de la monstrueuse vie végétale, et le mouvement furtif d'une bête et une aile soudain frémissante là-haut, dans le noir feuillage. Tout passait à travers cette opacité de la nuit. Les parfums eux-mêmes des arbres en fermentation, des herbes exaltées, de l'humus tiède, y prenaient je ne sais quel goût de soufre qui en altérait la naturelle et la nocturne douceur. Nulle clarté, pas même au ciel, où pesait une nappe épaisse de nuages qui séparait la terre des constellations. Mais partout la chaleur des feux couvait sous la croûte d'argile et les écorces craquelées des chênes. Du sol montaient des fumées magnétiques, émanations des foyers invisibles où se calcinaient les racines des arbres. La tête en était enivrée. On haletait. Le sang frémissait aux oreilles et, à chaque mouvement d'âme, répondait une pulsation de l'ombre environnante. Je vivais de la nuit ; la nuit vivait de moi.
Video de Henri Bosco (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Bosco : l'art d'être heureux
Visite à l'écrivain Henri BOSCO dans sa maison niçoise ; il évoque son enfance, sa manière de travailler, son goût pour la cuisine et pour la musique et parle surtout d'un certain art de vivre, de sa conception de la vie. Evocation d'un de ses ancêtres proches, Don Bosco avec reportage dans une école technique de la fondation Don Bosco qui forme des ouvriers qualifiés. Présentation d'un...
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Henri Bosco (40)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'enfant et la rivière
Qui est Bargabot par rapport à Pascalet ?
Son oncle
Un ami de tante Martine
Un pêcheur qui apporte du poisson à la famille
Un vagant
11 questions
248 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur ce livre248 lecteurs ont répondu