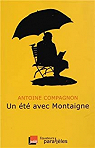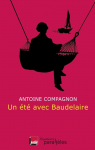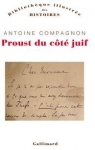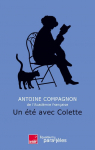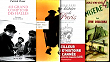Né(e) à : Bruxelles , le 20/07/1950
Antoine Compagnon est un professeur et un historien de la littérature française.
Fils du général Jean Compagnon (c.r) et de Jacqueline Terlinden, ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur d'État ès lettres, Antoine Compagnon est un critique littéraire à la fois héritier et critique du structuralisme, dont le chef de file fut Roland Barthes.
Professeur de littérature française à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et à l’Université Columbia (New York), il fait partie depuis mars 2006 du Haut Conseil de l'éducation et a été nommé en avril 2006 professeur au Collège de France.
Pendant l'été 2012, il propose une chronique quotidienne sur France Inter sous le titre "Un été avec Montaigne" accompagnée des lectures du comédien Daniel Mesguich. Cette chronique donnera lieu à la publication d'un ouvrage qui constituera un grand succès de librairie de l'été suivant. Il revient sur cette station dans le cadre de la grille d'été en 2013 ("Un été avec Proust") et en 2014 ("Un été avec Baudelaire").
Écrivain et professeur au Collège de France, Antoine Compagnon est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Montaigne et Baudelaire.
En 2018, il reçoit le Prix Guizot de l’Académie française.
Elu à l'Académie Française le 17 février 2022.
Ajouter des informations
En mai 2023, l'écrivain et critique littéraire Antoine Compagnon est reçu à l'Académie française. Spécialiste de l'oeuvre proustienne, il a édité plusieurs tomes d'À la recherche du temps perdu chez Gallimard. Son épée d'académicien, qui lui a été remise lors d'une cérémonie à la Bibliothèque nationale de France, est le fruit de sa rencontre avec la maison de joaillerie Boucheron. Dans cet entretien, il revient sur ce moment singulier et sur les éléments symboliques qui ont guidé cette démarche artistique commune. Pour en savoir plus, rdv sur le site Les Essentiels de la BnF : https://c.bnf.fr/TRC Crédits de la vidéo : Antoine Compagnon Écrivain, critique littéraire, professeur émérite et membre de l'Académie française Direction éditoriale Armelle Pasco, cheffe du service des Éditions multimédias, BnF Coordination scientifique Charline Coupeau, docteure en histoire de l'art et chercheuse à l'École des Arts Joailliers Coordination éditoriale Constance Esposito-Ferrandi, chargée d'édition multimédia, BnF Lieu de tournage Institut de France © Bibliothèque nationale de France
P. 95
NDL : sur Babelio nous nous posons souvent ce genre de questions à propos de nos lecture, trop tôt, trop vite, pas compris ? Ou tout simplement mauvaise digestion.
P. 74
(p. 46)
Le refus de la médecine fait partie de la soumission à la nature. Montaigne modifie donc le moins possible ses habitudes quand il est malade.
Vient alors la flèche du Parthe : les médecins ne vivent pas mieux ni plus longtemps que nous ; ils souffrent les mêmes maux et n'en guérissent pas davantage. (p. 124 )
Peinture : Impressionnisme (3)
Partie de gréement :
2 lecteurs ont répondu