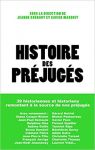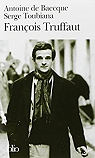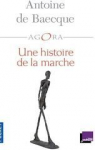Nationalité : France
Né(e) à : Neuilly-sur-Seine , le 14/05/1962
Ajouter des informations
Né(e) à : Neuilly-sur-Seine , le 14/05/1962
Biographie :
Antoine de Baecque est un historien de la littérature, un critique de cinéma et de théâtre et un éditeur français.
Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud (lettres), il est spécialiste de histoire culturelle du XVIIIe siècle. Il enseigne à l'Université de Versailles.
Mais il a aussi édité de nombreux articles et ouvrages sur le cinéma français, en particulier sur François Truffaut et l'histoire de la revue Les Cahiers du cinéma, dont il a été rédacteur en chef.
Il était aussi rédacteur en chef adjoint chargé de la culture au journal Libération qu'il a quitté fin 2006.
Il a dirigé les éditions Complexe de septembre 2007 à fin 2009.
À partir de 2007, il collabore au journal en ligne Rue89.
À partir de 2015, il collabore à la revue en ligne délibéré, où il publie Degré zéro4, une chronique consacrée à la marche et à l'exploration de la ville (Paris puis New York).
Il a publié une histoire des Cahiers du cinéma (1991), des essais sur Andréi Tarkovski (1989), Manoel de Oliveira (1996), La Nouvelle Vague (1998), ainsi qu'une biographie de François Truffaut (1996, avec Serge Toubiana). Il est également historien de la culture des Lumières et de la Révolution française.
+ Voir plusAntoine de Baecque est un historien de la littérature, un critique de cinéma et de théâtre et un éditeur français.
Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud (lettres), il est spécialiste de histoire culturelle du XVIIIe siècle. Il enseigne à l'Université de Versailles.
Mais il a aussi édité de nombreux articles et ouvrages sur le cinéma français, en particulier sur François Truffaut et l'histoire de la revue Les Cahiers du cinéma, dont il a été rédacteur en chef.
Il était aussi rédacteur en chef adjoint chargé de la culture au journal Libération qu'il a quitté fin 2006.
Il a dirigé les éditions Complexe de septembre 2007 à fin 2009.
À partir de 2007, il collabore au journal en ligne Rue89.
À partir de 2015, il collabore à la revue en ligne délibéré, où il publie Degré zéro4, une chronique consacrée à la marche et à l'exploration de la ville (Paris puis New York).
Il a publié une histoire des Cahiers du cinéma (1991), des essais sur Andréi Tarkovski (1989), Manoel de Oliveira (1996), La Nouvelle Vague (1998), ainsi qu'une biographie de François Truffaut (1996, avec Serge Toubiana). Il est également historien de la culture des Lumières et de la Révolution française.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (24)
Voir plusAjouter une vidéo
Lecture de correspondances autour de la figure de Marie-Antoinette par Isild le Besco, commentées par Antoine de Baecque, professeur à l'Ecole normale supérieure. Marie-Antoinette, dès son arrivée en France à 14 ans en 1770, suscite un flot ininterrompu de correspondances, souvent les plus contradictoires. S'esquisse ici l'avènement de la célébrité et s'affirme le lien désormais indissoluble entre espace privé, univers public et visions politiques, éléments essentiels d'une nouvelle modernité. Une rencontre explosive à laquelle la comédienne Isild le Besco, et l'historien Antoine de Baecque mêlent leurs voix. Avec le soutien de la Fondation d'entreprise La Poste.
+ Lire la suite
Podcasts (2)
Voir tous
Citations et extraits (101)
Voir plus
Ajouter une citation
" Soldats ! Du haut de ces trois semaines de tournage, soixante ans de cinéma vous contemplent ! Vous êtes mal nourris, mal payés, mal tout ! Il fait froid et on vous engueule ! Ce n'est pas fini ! Il va faire encore plus froid, vous travaillerez toujours davantage dans la boue et la pluie ! Vous serez engueulés toujours plus fort ! Mais un jour, vous défilerez sur les exclusivités des Champs-Elysées car vous aurez mené le cinéma français à la victoire !"
Citation affichée par Godard le dernier jour de tournage de " Bande à part".
Citation affichée par Godard le dernier jour de tournage de " Bande à part".
Une promenade nocturne en forêt est un excellent substitut à la cocaïne, en plus d'être tout simplement une promenade nocturne en forêt.
Jim Harrison, Passacaille du Poète perdu
Jim Harrison, Passacaille du Poète perdu
Pour autant que je m'en souvienne, je me trouvai, en débouchant dans la rue vaste et claire, d'une humeur aventureuse et romantique qui m'emplit d'aise. Le monde matinal qui s'étalait devant moi me parut si beau que j'eus le sentiment de le voir pour la première fois. Tout ce que j'apercevais me donnait une agréable impression d'amabilité, de bonté et de jeunesse. J'oubliai bien vite qu'un moment encore auparavant, dans mon bureau, là-haut, je ruminais des pensées lugubres devant une feuille de papier vide. La souffrance, la tristesse et toutes les idées pénibles avaient comme disparu, quoique je ressentisse encore vivement une certaine gravité devant et derrière moi.
Robert Walser, La promenade, 1920
Robert Walser, La promenade, 1920
La figure typiquement godardienne la plus importante "d'A bout de souffle" est cependant Parvulesco, le "grand écrivain" interviewé par Patricia sur une terrasse d'Orly. Godard pense d'abord à Louis-Ferdinand Céline, qui aurait joué son propre rôle...
Marc de Seyssel, dans ses Mémoires de randonneur, raconte d'ailleurs une excursion paradisiaque avant guerre : des villages sans constructions démesurées, le lac naturel de Tignes posé dans des prairies vierges. L'enlaidissement de la montagne es devenu depuis 50 ans une donnée objective des Alpes françaises.
Le pas humain varie suivant des conditions multiples: la profession, l'état social, le caractère, la race, le milieu où on vit.
Ainsi, le pas de l'homme du monde diffère de celui du campagnard. Le marin se reconnaît tout de suite à son balancement; ayant à marcher sur un sol constamment mobile, son centre de gravité risquant d'être à chaque instant et subitement déplacé de plusieurs degrés, il est obligé de garder les jambes fléchies et d'avancer en donnant autant d'étendue que possible à sa base de sustentation, et, conservant cette habitude même sur terre ferme, il a, dans la marche, de forts mouvements de latéralité provenant de l'écartement et de la flexion de ses jambes.
Mécanique de la Marche, Etienne-Jules Marey
Ainsi, le pas de l'homme du monde diffère de celui du campagnard. Le marin se reconnaît tout de suite à son balancement; ayant à marcher sur un sol constamment mobile, son centre de gravité risquant d'être à chaque instant et subitement déplacé de plusieurs degrés, il est obligé de garder les jambes fléchies et d'avancer en donnant autant d'étendue que possible à sa base de sustentation, et, conservant cette habitude même sur terre ferme, il a, dans la marche, de forts mouvements de latéralité provenant de l'écartement et de la flexion de ses jambes.
Mécanique de la Marche, Etienne-Jules Marey
Le gros moine, l'aristocrate, l'émigré, le roi devenu porc....Ces portraits caricaturaux, croqués dans le style allégorique ou la verve grotesque, offrent un commentaire à chaud, résolument partisan, de l'événement révolutionnaire.
Sur trois années, du printemps 1789 à l'été 1792, plus de six cent caricatures illustrent sur le vif les techniques encore incertaines du commerce du rire politique et tissent le libre discours de la Révolution sur elle-même....
(extrait du huitième numéro de la revue "Chroniques de l'Histoire" parue en février 1989)
Sur trois années, du printemps 1789 à l'été 1792, plus de six cent caricatures illustrent sur le vif les techniques encore incertaines du commerce du rire politique et tissent le libre discours de la Révolution sur elle-même....
(extrait du huitième numéro de la revue "Chroniques de l'Histoire" parue en février 1989)
Classés parmi les aliénés, traités par les aliénistes, les crétins n’ont pourtant pas intéressé Michel Foucault. Ni dans Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique (1961), ni dans le cours de l’année 1974-1975 au Collège de France « Les anormaux », le philosophe n’évoque le crétinisme. Il étudie grâce aux archives de multiples cas de « folie » et d’« anormalité », arriérés, onanistes, hermaphrodites, nécrophages, enfants idiots, « incorrigibles », monstres divers, mais jamais de crétins des Alpes proprement dits. Pourtant, ils occupent une place non négligeable dans le discours médical au XIXe siècle et un certain nombre d’individus, quelques milliers en France, quelques centaines à Paris, sont arrachés de leurs montagnes pour être placés en asiles, instituts, écoles spécialisées, souvent aux côtés d’autres formes d’aliénés. Mais il est vrai qu’ils laissaient peu de traces dans les archives judiciaires, celles qui intéressaient Foucault au premier chef, car ils ne sont ni violents ni impliqués dans des affaires de mœurs. Un crétin vit généralement dans son coin, dans un état souvent végétatif, dépourvu d’agressivité, peu porté, contrairement aux images que la fiction a reconstruites de lui, sur les obsessions sexuelles. Chez les anormaux foucaldiens, le crétin demeure le grand absent.
On ne peut que le déplorer, et ce, pour trois raisons principales. D’abord, car le crétin a posé exemplairement, en la mettant en débat, la question du « grand renfermement des corps », celle qui hante le travail de Foucault lorsqu’il se demande comment, au début des sociétés industrielles, s’est mis en place un appareil médical et punitif qui élabora le dispositif de tri entre les normaux et les anormaux. Faut-il en effet enfermer les crétins ? Non, si on les considère comme incurables, irrécupérables, « incorrigibles », disait-on à l’époque. Dès lors, beaucoup sont laissés dans leur famille, au sein des montagnes. Ce sont les idiots du village alpin, et chaque village veut ses idiots, telle une sorte de mascotte sacrée, préservant du mauvais œil en tant qu’« innocents » parlant aux étoiles et à la Providence divine. Nombreux sont ceux qui, même parmi les médecins, dénoncent l’internement des crétins, puisqu’ils seraient un ornement paradoxal de la montagne, une part certes « horriblement grotesque » mais indispensable à l’Alpe, le pendant dégénéré ou bigot de sa beauté, son versant sombre ou superstitieux.
Mais d’autres répondent par l’affirmative à la question de leur enfermement. Pour des raisons d’hygiène, de consanguinité, certains souhaitent couper les crétins de leur milieu insalubre ou séparer les couples, voire les frères des sœurs ou les enfants des parents. Mais aussi, et surtout, au nom d’une mission pédagogique : les aliénistes, qui étaient souvent des pédagogues, se sont ainsi passionnés pour l’éducation – possible, impossible ? – des crétins.
Considérés par les plus « modernes » des scientifiques comme des arriérés, ils paraissaient susceptibles d’être éduqués a minima. L’hospice de la Salpêtrière de Paris reçoit des crétines à partir de 1831. Suivant les préceptes d’Édouard Séguin, « l’instituteur des idiots », ouvrent plusieurs autres établissements éducatifs pour les crétins, souvent mêlés aux arriérés : l’Institut orthophrénique d’Issy-les-Moulineaux, le quartier des enfants idiots à Bicêtre, la Ferme de Perray-Vaucluse, près de Sainte-Geneviève-des-Bois, l’Hospice des incurables du faubourg Saint-Martin, et, sur place, l’asile de Bassens près de Chambéry. Mais l’hospice de crétins le plus célèbre est l’institution du docteur Johann Jakob Guggenbühl, qu’il fonde à Interlaken, en Suisse, en 1841. Le Centre de soins pour enfants crétins et imbéciles, dit Abendberg, est une des premières institutions à envisager une prise en charge médicale, pédagogique et thérapeutique du crétinisme. L’asile de Guggenbühl connaît d’ailleurs une certaine notoriété en Europe, quand rois, princesses, médecins et écrivains viennent le visiter. Ainsi rencontre-t-on à propos du crétin cette aporie proprement foucaldienne : si ses pathologies, repérées, étudiées, soignées, rendent nécessaire son enfermement, ce dernier le place dans un rapport coupable, et culpabilisé, à la norme, tant biologique que sociale. L’internement protège le crétin, le livre à l’état de cobaye d’expériences, tout en l’exposant à des formes de séparation, de ségrégation, de stigmatisation.
Le crétin est foucaldien pour une deuxième raison : il est une grande victime des « mécanismes de pouvoir qui, à travers la médecine et l’enfermement psychiatrique, ont investi les corps, les gestes, les comportements », ce que le philosophe propose justement d’étudier en se faisant archéologue des sciences humaines. Victime dans sa chair et son existence même. Le sacrifice des crétins est un scandale silencieux du XIXe siècle. D’une part, ils sont les cobayes de toutes sortes d’expériences, soit pédagogiques, soit chirurgicales – l’ablation du goitre –, parfois stimulantes pour l’étude de l’apprentissage ou enrichissantes pour la recherche médicale, mais souvent naïves, cruelles et généralement inutiles, du moins pour eux. D’autre part, l’échec thérapeutique de l’enfermement des crétins souligne qu’une autre politique sanitaire eût été nécessaire à l’éradication du crétinisme. Or, cette politique prophylactique a tardé, alors pourtant que l’ensemble des connaissances scientifiques et des protocoles de traitement s’est mis en place dans le premier tiers du XIXe siècle pour pouvoir guérir le crétinisme. Ainsi, au moins trois générations de crétins ont été laissées dans leur état pendant plus d’un demi-siècle par les éducateurs, les médecins et les responsables de l’hygiène publique, soit environ cinquante mille hommes, femmes et enfants qui, des années 1830 au début du XXe siècle, ont grandi débiles et difformes alors qu’une bonne part d’entre eux aurait pu être préservée de ces handicaps. L’histoire du crétinisme et de son éradication est celle d’un retard, non pas seulement le « retard » de quelques milliers d’arriérés à travers les Alpes, mais plus encore celui d’une recherche médicale qui, par ses hésitations, ses disputes, ses certitudes aveugles et ses susceptibilités mal placées, a sacrifié à sa prudence et à ses dissensions, voire à ses audaces (pédagogiques et chirurgicales notamment), plusieurs générations de crétins.
Enfin, le crétin donne une dernière leçon à Foucault, une leçon que le maître aurait pu professer lui-même au Collège de France. L’idiot des montagnes permet en effet d’aller jusqu’au terme de l’« inversion » foucaldienne, de sa poignante poétique du retournement solidaire, de cette empathie absolue qu’il parvient à construire et à formuler à l’égard des « anormaux », victimes du système d’assignation à l’anormalité et de l’enfermement asilaire. Foucault ausculte le grand effort de mise en discipline et de normalisation poursuivi par le XIXe siècle, mais il parvient aussi, et surtout, à rendre la parole à ceux qui en étaient largement dépourvus. Les crétins « font mieux », même s’ils ne savent ni parler ni écrire, et permettent d’aller radicalement plus loin : non seulement ils trouvent peu à peu un verbe et des images, poétiques et politiques, qui, en littérature, au cinéma, en musique, les incarnent, mais ils deviennent l’emblème assumé et brandi d’une forme d’authenticité alpine. La solidarité se mue en fierté crétine. Voilà sans doute la meilleure manière de conjurer ce que Foucault redoutait dès l’écriture de son Histoire de la folie : « À notre époque, l’expérience de la folie se fait dans le calme d’un savoir qui, de la trop connaître, l’oublie. » Face cette « histoire qui s’immobilise », le destin du crétin, grande victime et grande fierté, fait figure de relance dynamique.
Car, ironie et paradoxe de l’histoire – qui la mettent en mouvement –, les crétins des Alpes n’ont pas disparu. Au moment même où le crétinisme semble enfin avoir été éradiqué des Alpes, ils passent dans l’imaginaire via la fiction et la représentation. De Balzac à Hergé, des ambitions régénératrices du médecin de campagne aux jurons du capitaine Haddock – « Crétin des Alpes », lance-t-il au professeur Tournesol à partir du Trésor de Rackham le Rouge, douzième album des aventures de Tintin –, la résurgence du crétinisme sous la forme de son personnage dans la fiction révèle la façon dont travaille l’imaginaire d’une époque. Le crétin traverse le temps et s’échappe des montagnes, frayant son chemin vers tous les genres littéraires, du récit de voyage au roman, du poème à l’art dramatique, du pamphlet politique aux bulles de la bande dessinée, et s’installe dans tous les registres, du tragique au comique, du mélodramatique au pathétique, de l’ironie à la prophétie. Ces résurgences en font un être quasi mythique qui cristallise les revendications de l’authenticité alpine. Une « fierté crétine » naît, dont les manifestations, souvent burlesques et idiotes, passent par la littérature (de Flaubert au poète valaisan Maurice Chappaz), l’imagerie des Jurassiens Plonk & Replonk, le cinéma chez Fredi Murer ou Luc Moullet, « artistes alpins », le rock montagnard dans le cas du groupe haut-provençal Laids Crétins des Alpes. Personnage primitif et poétique, marginal et irrécupérable, le crétin dit naturellement ses vérités au monde moderne, celui de la vitesse, du tourisme, d’un aménagement qui, souvent, détruit la montagne. Il est aussi une manière de contrer la standardisation des apparences, des idées et des normes sociales, par la revendication, même provocatrice, d’une autre culture, d’une forme crétine d’utopie éternellement adolescente, voire potache. Cette faculté à résister par l’idiotie et cette inadaptation fondamentale au « progrès » sont les voies de la résurgence « moderne » et pamphlétaire du crétinisme, non comme pathologie réelle mais comme discours de rupture.
Introduction. Un idiot sur les bords, ou comment je suis de
On ne peut que le déplorer, et ce, pour trois raisons principales. D’abord, car le crétin a posé exemplairement, en la mettant en débat, la question du « grand renfermement des corps », celle qui hante le travail de Foucault lorsqu’il se demande comment, au début des sociétés industrielles, s’est mis en place un appareil médical et punitif qui élabora le dispositif de tri entre les normaux et les anormaux. Faut-il en effet enfermer les crétins ? Non, si on les considère comme incurables, irrécupérables, « incorrigibles », disait-on à l’époque. Dès lors, beaucoup sont laissés dans leur famille, au sein des montagnes. Ce sont les idiots du village alpin, et chaque village veut ses idiots, telle une sorte de mascotte sacrée, préservant du mauvais œil en tant qu’« innocents » parlant aux étoiles et à la Providence divine. Nombreux sont ceux qui, même parmi les médecins, dénoncent l’internement des crétins, puisqu’ils seraient un ornement paradoxal de la montagne, une part certes « horriblement grotesque » mais indispensable à l’Alpe, le pendant dégénéré ou bigot de sa beauté, son versant sombre ou superstitieux.
Mais d’autres répondent par l’affirmative à la question de leur enfermement. Pour des raisons d’hygiène, de consanguinité, certains souhaitent couper les crétins de leur milieu insalubre ou séparer les couples, voire les frères des sœurs ou les enfants des parents. Mais aussi, et surtout, au nom d’une mission pédagogique : les aliénistes, qui étaient souvent des pédagogues, se sont ainsi passionnés pour l’éducation – possible, impossible ? – des crétins.
Considérés par les plus « modernes » des scientifiques comme des arriérés, ils paraissaient susceptibles d’être éduqués a minima. L’hospice de la Salpêtrière de Paris reçoit des crétines à partir de 1831. Suivant les préceptes d’Édouard Séguin, « l’instituteur des idiots », ouvrent plusieurs autres établissements éducatifs pour les crétins, souvent mêlés aux arriérés : l’Institut orthophrénique d’Issy-les-Moulineaux, le quartier des enfants idiots à Bicêtre, la Ferme de Perray-Vaucluse, près de Sainte-Geneviève-des-Bois, l’Hospice des incurables du faubourg Saint-Martin, et, sur place, l’asile de Bassens près de Chambéry. Mais l’hospice de crétins le plus célèbre est l’institution du docteur Johann Jakob Guggenbühl, qu’il fonde à Interlaken, en Suisse, en 1841. Le Centre de soins pour enfants crétins et imbéciles, dit Abendberg, est une des premières institutions à envisager une prise en charge médicale, pédagogique et thérapeutique du crétinisme. L’asile de Guggenbühl connaît d’ailleurs une certaine notoriété en Europe, quand rois, princesses, médecins et écrivains viennent le visiter. Ainsi rencontre-t-on à propos du crétin cette aporie proprement foucaldienne : si ses pathologies, repérées, étudiées, soignées, rendent nécessaire son enfermement, ce dernier le place dans un rapport coupable, et culpabilisé, à la norme, tant biologique que sociale. L’internement protège le crétin, le livre à l’état de cobaye d’expériences, tout en l’exposant à des formes de séparation, de ségrégation, de stigmatisation.
Le crétin est foucaldien pour une deuxième raison : il est une grande victime des « mécanismes de pouvoir qui, à travers la médecine et l’enfermement psychiatrique, ont investi les corps, les gestes, les comportements », ce que le philosophe propose justement d’étudier en se faisant archéologue des sciences humaines. Victime dans sa chair et son existence même. Le sacrifice des crétins est un scandale silencieux du XIXe siècle. D’une part, ils sont les cobayes de toutes sortes d’expériences, soit pédagogiques, soit chirurgicales – l’ablation du goitre –, parfois stimulantes pour l’étude de l’apprentissage ou enrichissantes pour la recherche médicale, mais souvent naïves, cruelles et généralement inutiles, du moins pour eux. D’autre part, l’échec thérapeutique de l’enfermement des crétins souligne qu’une autre politique sanitaire eût été nécessaire à l’éradication du crétinisme. Or, cette politique prophylactique a tardé, alors pourtant que l’ensemble des connaissances scientifiques et des protocoles de traitement s’est mis en place dans le premier tiers du XIXe siècle pour pouvoir guérir le crétinisme. Ainsi, au moins trois générations de crétins ont été laissées dans leur état pendant plus d’un demi-siècle par les éducateurs, les médecins et les responsables de l’hygiène publique, soit environ cinquante mille hommes, femmes et enfants qui, des années 1830 au début du XXe siècle, ont grandi débiles et difformes alors qu’une bonne part d’entre eux aurait pu être préservée de ces handicaps. L’histoire du crétinisme et de son éradication est celle d’un retard, non pas seulement le « retard » de quelques milliers d’arriérés à travers les Alpes, mais plus encore celui d’une recherche médicale qui, par ses hésitations, ses disputes, ses certitudes aveugles et ses susceptibilités mal placées, a sacrifié à sa prudence et à ses dissensions, voire à ses audaces (pédagogiques et chirurgicales notamment), plusieurs générations de crétins.
Enfin, le crétin donne une dernière leçon à Foucault, une leçon que le maître aurait pu professer lui-même au Collège de France. L’idiot des montagnes permet en effet d’aller jusqu’au terme de l’« inversion » foucaldienne, de sa poignante poétique du retournement solidaire, de cette empathie absolue qu’il parvient à construire et à formuler à l’égard des « anormaux », victimes du système d’assignation à l’anormalité et de l’enfermement asilaire. Foucault ausculte le grand effort de mise en discipline et de normalisation poursuivi par le XIXe siècle, mais il parvient aussi, et surtout, à rendre la parole à ceux qui en étaient largement dépourvus. Les crétins « font mieux », même s’ils ne savent ni parler ni écrire, et permettent d’aller radicalement plus loin : non seulement ils trouvent peu à peu un verbe et des images, poétiques et politiques, qui, en littérature, au cinéma, en musique, les incarnent, mais ils deviennent l’emblème assumé et brandi d’une forme d’authenticité alpine. La solidarité se mue en fierté crétine. Voilà sans doute la meilleure manière de conjurer ce que Foucault redoutait dès l’écriture de son Histoire de la folie : « À notre époque, l’expérience de la folie se fait dans le calme d’un savoir qui, de la trop connaître, l’oublie. » Face cette « histoire qui s’immobilise », le destin du crétin, grande victime et grande fierté, fait figure de relance dynamique.
Car, ironie et paradoxe de l’histoire – qui la mettent en mouvement –, les crétins des Alpes n’ont pas disparu. Au moment même où le crétinisme semble enfin avoir été éradiqué des Alpes, ils passent dans l’imaginaire via la fiction et la représentation. De Balzac à Hergé, des ambitions régénératrices du médecin de campagne aux jurons du capitaine Haddock – « Crétin des Alpes », lance-t-il au professeur Tournesol à partir du Trésor de Rackham le Rouge, douzième album des aventures de Tintin –, la résurgence du crétinisme sous la forme de son personnage dans la fiction révèle la façon dont travaille l’imaginaire d’une époque. Le crétin traverse le temps et s’échappe des montagnes, frayant son chemin vers tous les genres littéraires, du récit de voyage au roman, du poème à l’art dramatique, du pamphlet politique aux bulles de la bande dessinée, et s’installe dans tous les registres, du tragique au comique, du mélodramatique au pathétique, de l’ironie à la prophétie. Ces résurgences en font un être quasi mythique qui cristallise les revendications de l’authenticité alpine. Une « fierté crétine » naît, dont les manifestations, souvent burlesques et idiotes, passent par la littérature (de Flaubert au poète valaisan Maurice Chappaz), l’imagerie des Jurassiens Plonk & Replonk, le cinéma chez Fredi Murer ou Luc Moullet, « artistes alpins », le rock montagnard dans le cas du groupe haut-provençal Laids Crétins des Alpes. Personnage primitif et poétique, marginal et irrécupérable, le crétin dit naturellement ses vérités au monde moderne, celui de la vitesse, du tourisme, d’un aménagement qui, souvent, détruit la montagne. Il est aussi une manière de contrer la standardisation des apparences, des idées et des normes sociales, par la revendication, même provocatrice, d’une autre culture, d’une forme crétine d’utopie éternellement adolescente, voire potache. Cette faculté à résister par l’idiotie et cette inadaptation fondamentale au « progrès » sont les voies de la résurgence « moderne » et pamphlétaire du crétinisme, non comme pathologie réelle mais comme discours de rupture.
Introduction. Un idiot sur les bords, ou comment je suis de
On peut savoir danser comme un dieu, aimer s'amuser la nuit entière, et avoir tout oublié le matin venu. Par contre, écrire la fête est un talent. J'ai pris goût à la nuit grâce à ceux qui l'écrivent, quand les corps qui bougent, les femmes qui brillent, les verres qui passent, les substances qui hypnotisent, les musiques qui vibrent, se réinventent en mots.
Face aux godillots, grâce aux godillots, la lutte la plus intense, au cours des années 1960, est celle du rire. Pour Le Canard enchaîné, de Gaulle est l'adversaire idéal. Militaire, il concentre les attaques de la tradition antimilitariste du journal, notamment celle de son rédacteur en chef, Robert Tréno. Ce dernier, au journal depuis 1924, d'abord comme correcteur, ensuite comme rédacteur à partir de 1932, prend les rênes de la publication en 1953, et l'oriente délibérément vers l'antigaullisme satirique. Tréno écrit en mai 1966 : "De Gaulle, c'est la république dominée, subjuguée par un militaire. La République de la caserne. La République du sabre."
La méfiance vis-à-vis du képi et des deux étoiles du Général reproduit la défiance que la gauche républicaine à toujours eue face aux aventures militaires en politique, depuis Boulanger et l'affaire Dreyfus jusqu'à Pétain. (p. 228)
La méfiance vis-à-vis du képi et des deux étoiles du Général reproduit la défiance que la gauche républicaine à toujours eue face aux aventures militaires en politique, depuis Boulanger et l'affaire Dreyfus jusqu'à Pétain. (p. 228)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Antoine de Baecque
Quiz
Voir plus
Quand les aliments portent des noms insolites ou pas...
Les cheveux d'ange se mangent-ils ?
Oui
Non
10 questions
157 lecteurs ont répondu
Thèmes :
nourriture
, fruits et légumes
, fromages
, manger
, bizarreCréer un quiz sur cet auteur157 lecteurs ont répondu