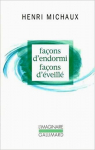Critiques de Henri Michaux (139)
Ce livre porte très bien son titre qui résume parfaitement l'intention de l'auteur « En rêvant à partir de peintures énigmatiques ».
J'aime beaucoup l'écriture d'Henri Michaux et les tableaux de René Magritte. J'aurai donc dû être totalement séduite par ce recueil de textes oniriques mais il m'a manqué quelque chose. Et ce quelque chose c'est l'image.
Michaux excelle dans cet exercice descriptif des oeuvres du peintre mais certains tableaux, bien que célèbres, ont besoin d'être vus pour apprécier toute leur poésie (et leurs détails) car l'imagination a ses limites. Personnellement, j'avais quelques tableaux en tête mais pas tous. Alors je suis allez voir sur internet et je ne les ai pas tous retrouvé, comme celui concernant la contrebasse, page 41. J'ai bien trouvé un violon et d'autres instruments de musique (ainsi qu'une pipe, un parapluie, des nuages, un oiseau, un poisson, une fenêtre, des hommes avec des chapeaux melon...) mais pas de contrebasse. Dommage.
Quand Michaux donne le titre du tableau, il est facile de le retrouver. Mais il le fait uniquement pour L'enfance d'Icare. J'ai donc testé une lecture en miroir et je dois dire que Michaux est très fort. Il a un vrai pouvoir de suggestion grâce à son écriture car il est difficile de raconter ce qui se passe dans les tableaux de René Magritte, que l'on associe aisément au mystère et au surréalisme.
J'aime beaucoup l'écriture d'Henri Michaux et les tableaux de René Magritte. J'aurai donc dû être totalement séduite par ce recueil de textes oniriques mais il m'a manqué quelque chose. Et ce quelque chose c'est l'image.
Michaux excelle dans cet exercice descriptif des oeuvres du peintre mais certains tableaux, bien que célèbres, ont besoin d'être vus pour apprécier toute leur poésie (et leurs détails) car l'imagination a ses limites. Personnellement, j'avais quelques tableaux en tête mais pas tous. Alors je suis allez voir sur internet et je ne les ai pas tous retrouvé, comme celui concernant la contrebasse, page 41. J'ai bien trouvé un violon et d'autres instruments de musique (ainsi qu'une pipe, un parapluie, des nuages, un oiseau, un poisson, une fenêtre, des hommes avec des chapeaux melon...) mais pas de contrebasse. Dommage.
Quand Michaux donne le titre du tableau, il est facile de le retrouver. Mais il le fait uniquement pour L'enfance d'Icare. J'ai donc testé une lecture en miroir et je dois dire que Michaux est très fort. Il a un vrai pouvoir de suggestion grâce à son écriture car il est difficile de raconter ce qui se passe dans les tableaux de René Magritte, que l'on associe aisément au mystère et au surréalisme.
Michaux mêle ses monstres personnels à ceux de la Seconde Guerre mondiale, à ceux d'une humanité qui s'aliène, qui crée en elle son ennemi. Les souvenirs et les idéologies mal digérées se condensent en silhouettes dures et hostiles, en statues, en sphinx. Ces masses paralysent des échafaudages ascensionnels branlants, signes des tentatives précaires de l'humanité et du poète pour se surmonter au milieu du chaos. Avec autant de lucidité que possible, Michaux tente d'observer les charniers que ces années ont laissé en lui et chez les autres et à les assimiler pour mieux les digérer, au milieu des décombres. Mais le chaos apparaît avant tout sous forme sonore, car on entend retentir l'écho des voix du siècles, celles qui poussèrent les masses à s'entretuer, à s'exterminer. La voix du poète cherche à les faire taire, ou plutôt à les assourdir par un « martèlement des mots » dont l'horreur atteint paradoxalement le calme. Une surdité par saturation.
C'est ce type d'exorcisme que défend Michaux en l'identifiant à un état qui précède l'écriture. Et précède peut-être même l'intelligence, comme le préconise le Maître de Ho (comme « haut » ?), un drôle d'individu qui pourrait symboliser l'élévation mystique de l'âme ou bien la simple faculté de s’étonner (ho !), voire un rire salutaire (ho ! ho !), exorcisme par second degré, « par ruse ». le rire se fait d'ailleurs plus franc en fin de recueil, à travers les descriptions grotesques des créatures échappées d'une partie imaginaire du cerveau, éloquemment baptisée le « Lobe à monstres ». On y retrouve les aliénations michaldiennes inspirées De Lautréamont, car c'est bien connu : l'autre est à monstres. Surtout pour qui a la nostalgie du vieil océan. En effet, chez Michaux les monstres sont des « masques du vide », comme le vide de n'avoir pas pu vivre une vie de matelot... au plus près des monstres marins ?
C'est ce type d'exorcisme que défend Michaux en l'identifiant à un état qui précède l'écriture. Et précède peut-être même l'intelligence, comme le préconise le Maître de Ho (comme « haut » ?), un drôle d'individu qui pourrait symboliser l'élévation mystique de l'âme ou bien la simple faculté de s’étonner (ho !), voire un rire salutaire (ho ! ho !), exorcisme par second degré, « par ruse ». le rire se fait d'ailleurs plus franc en fin de recueil, à travers les descriptions grotesques des créatures échappées d'une partie imaginaire du cerveau, éloquemment baptisée le « Lobe à monstres ». On y retrouve les aliénations michaldiennes inspirées De Lautréamont, car c'est bien connu : l'autre est à monstres. Surtout pour qui a la nostalgie du vieil océan. En effet, chez Michaux les monstres sont des « masques du vide », comme le vide de n'avoir pas pu vivre une vie de matelot... au plus près des monstres marins ?
‘’Pour mettre la paix entre deux personnes qui se battent, écrivez sur un billet ou sur une pomme le mot : H A O N et jetez l’objet au milieu des combattants. Ils s’arrêteront. »
(Le livre des conjurations)
« J’écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l’aventure d’être en vie » (Henri Michaux)
Vous voyez le portrait d’Henri Michaux, sur la couverture du livre ?
Qui y-a-t-il derrière ces yeux ?ce regard ? Mystère, lointain, familier.
J’ai un peu honte, j’ai honte de parler de Henri Michaux, celui du « Donc, c’est non ! »
Il fait partie des phares près desquels on rode longtemps et où on finit par habiter.
Il y a longtemps j’y suis entré et j’aurai souhaité le garder pour moi seul. Mais…bon
Mais, Je vous en prie, lisez-le
Lisez-le, je vous en prie
Vous verrez, vous rentrerez dans un territoire ami,
Ami et dangereux.
Bon ! Ces jours-là il n’allait pas bien ! Ça passe. La mer, sans doute, aide, temps permettant. !
(Le livre des conjurations)
« J’écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire: me parcourir. Là est l’aventure d’être en vie » (Henri Michaux)
Vous voyez le portrait d’Henri Michaux, sur la couverture du livre ?
Qui y-a-t-il derrière ces yeux ?ce regard ? Mystère, lointain, familier.
J’ai un peu honte, j’ai honte de parler de Henri Michaux, celui du « Donc, c’est non ! »
Il fait partie des phares près desquels on rode longtemps et où on finit par habiter.
Il y a longtemps j’y suis entré et j’aurai souhaité le garder pour moi seul. Mais…bon
Mais, Je vous en prie, lisez-le
Lisez-le, je vous en prie
Vous verrez, vous rentrerez dans un territoire ami,
Ami et dangereux.
Bon ! Ces jours-là il n’allait pas bien ! Ça passe. La mer, sans doute, aide, temps permettant. !
Le recueil de poèmes d'Henri Michaux correspondant aux années de guerre est nécessairement affecté par ces années, mais on ne doit pas s'attendre à reconnaître chez ce poète le moindre engagement du côté de "l'honneur" ou du "déshonneur des poètes". Michaux ne se soucie pas d'enthousiasmer son lecteur dans un sens ou dans l'autre, et au contraire, l'ascèse (dont l'humour et le tragique sont des visages) à laquelle il se soumet et nous soumet caractérisent sa poésie : exorciser la magie et l'enthousiasme, laisser le poète et son lecteur nus dans l'épreuve d'un chemin à frayer soi-même dans le malheur collectif. Entrer dans Michaux, c'est aussi faire un pas dans un palais de miroirs où les significations figées et les slogans se réfractent en millions de mots et de facettes, et où plus rien n'est sûr.
Publié en 1975, Face à ce qui se dérobe n'est pas un recueil de poésie à proprement parler mais un ouvrage composé de six textes dans lesquels Henri Michaux livre encore son rapport particulier à la langue, dans une écriture qui agit comme un incessant moyen de se rapprocher au plus près de lui-même, pour mieux se fondre ensuite dans toute la potentialité de l'imaginaire.
“Soudain pivotent, dirait-on, enlacés ensemble, se détachent, et de moi se libèrent mes deux pieds (je venais de glisser), cependant que mon corps, basculant de dessus la terre et soustrait à son emprise, s'engage en l'air, en arrière, quand plus soudain encore, dans mon dos, un brusque brutal se plaque contre moi, le sol, le sol évidemment, ce ne peut-être que lui, le sol revenu, sur quoi je gis maintenant, inerte [...]”
Ainsi commence Bras cassé, le premier des six textes de l'ouvrage. Avec l'évocation de cet accident personnel, Henri Michaux digresse sur la perte d'usage du bras et de la main (droite), sur la décorporalisation de son bras devenu immobile, la sollicitation maladroite du bras gauche. L'écriture lui permet ici d'objectiver sa blessure, de la rendre comme autonome, indépendante et d'en faire un objet d'observation et de description. Abordé dans un style un peu hermétique, qui semble manquer de structure, le bras cassé est pourtant un texte qui m'a plu.
Les autres titres du livre (Relations avec les apparitions, Dans l'eau changeante des résonnances, Survenue de la contemplation, Arrivée à Alicante, Moriturus) sont des textes plus courts et plus “abordables”. Henri Michaux pousse encore ici sa conscience hors d'elle-même, pour approcher un autre état de celle-ci, un état qui lui permet de souligner combien sont nombreux les éléments qui nous traversent, combien nous sommes soumis, traversés dans notre corporalité par une multitude de mouvements tous imperceptibles, insaisissables par notre conscience, de forces invisibles qui nous font pourtant sentir ce que nous sommes (ce peut-être par exemple l'air d'une pièce dans laquelle nous nous trouvons).
Dans Relations avec les apparitions, Henri Michaux interroge ce qui porte et fixe notre regard, ce qui au travers de lui retient ou éloigne notre attention. Il utilise pour son propos une statue en bois de Nouvelle-Guinée, le regard se porte sur l'objet mais derrière sa forme, son apparence se cache une histoire, une mémoire à atteindre...
Les deux textes suivants Dans l'eau changeante des résonnances et Survenue de la contemplation sont plus courts, le recours à l'anecdote plus fréquent. Dans le premier, l'écrivain évoque son rapport particulier à la musique (il ne l'aimait à vrai dire pas beaucoup) par le biais d'un instrument pour lequel il avait une affection toute particulière, le sanza *.
Dans le texte suivant, Henri Michaux livre des considérations sur la contemplation, le détachement de soi et du monde comme conditions essentielles de sa pratique... Un texte que j'ai trouvé un peu en demi-teinte, un peu convenu.
Arrivée à Alicante est un récit fait à la première personne d'un genre très étrange. Un homme arrive dans la ville d'Espagne, sort de son hôtel et va parcourir les rues alentour. Arrivé sur une place, il s'assied à la terrasse d'un café à l'ombre des palmiers. Il ne le remarque pas tout de suite mais un brusque malaise va s'emparer de lui quand son attention sera attirée sur la taille des passants... Fatigue du voyage ? Effet d'optique ? attaque cérébrale ? La conscience des choses est toujours limitée en soi, elle est portée dans ce récit à son point le plus aigü, le plus sensible. Un texte fascinant.
Plus troublant encore est Moriturus, dernier texte de Face à ce qui se dérobe. Un marcheur nommé N... avance au milieu d'un vaste et haut paysage montagneux. Lors de sa progression, N... reçoit comme un appel, une étrange injonction de la montagne, celle d'aller se précipiter dans le gouffre. Troublé, l'homme choisit d'abord de ne pas y prêter attention mais peu à peu, l'invitation se fait plus pressante. N... va choisir de faire des détours, de revenir sur ses pas, d'avancer à vue,... Mais l'inexorable se fait de plus en plus proche...
J'ai retrouvé dans Face à ce qui se dérobe toute la singularité du style d'Henri Michaux, un style introspectif mais résolument libre, jamais enfermé en lui-même mais toujours en quête d'un possible, d'un au-delà de la conscience. Une poésie subtile, essentielle.
(*) le sanza est un instrument originaire d'Afrique composé de lamelles métalliques fixées sur une planche en bois avec une caisse de résonnance.
“Soudain pivotent, dirait-on, enlacés ensemble, se détachent, et de moi se libèrent mes deux pieds (je venais de glisser), cependant que mon corps, basculant de dessus la terre et soustrait à son emprise, s'engage en l'air, en arrière, quand plus soudain encore, dans mon dos, un brusque brutal se plaque contre moi, le sol, le sol évidemment, ce ne peut-être que lui, le sol revenu, sur quoi je gis maintenant, inerte [...]”
Ainsi commence Bras cassé, le premier des six textes de l'ouvrage. Avec l'évocation de cet accident personnel, Henri Michaux digresse sur la perte d'usage du bras et de la main (droite), sur la décorporalisation de son bras devenu immobile, la sollicitation maladroite du bras gauche. L'écriture lui permet ici d'objectiver sa blessure, de la rendre comme autonome, indépendante et d'en faire un objet d'observation et de description. Abordé dans un style un peu hermétique, qui semble manquer de structure, le bras cassé est pourtant un texte qui m'a plu.
Les autres titres du livre (Relations avec les apparitions, Dans l'eau changeante des résonnances, Survenue de la contemplation, Arrivée à Alicante, Moriturus) sont des textes plus courts et plus “abordables”. Henri Michaux pousse encore ici sa conscience hors d'elle-même, pour approcher un autre état de celle-ci, un état qui lui permet de souligner combien sont nombreux les éléments qui nous traversent, combien nous sommes soumis, traversés dans notre corporalité par une multitude de mouvements tous imperceptibles, insaisissables par notre conscience, de forces invisibles qui nous font pourtant sentir ce que nous sommes (ce peut-être par exemple l'air d'une pièce dans laquelle nous nous trouvons).
Dans Relations avec les apparitions, Henri Michaux interroge ce qui porte et fixe notre regard, ce qui au travers de lui retient ou éloigne notre attention. Il utilise pour son propos une statue en bois de Nouvelle-Guinée, le regard se porte sur l'objet mais derrière sa forme, son apparence se cache une histoire, une mémoire à atteindre...
Les deux textes suivants Dans l'eau changeante des résonnances et Survenue de la contemplation sont plus courts, le recours à l'anecdote plus fréquent. Dans le premier, l'écrivain évoque son rapport particulier à la musique (il ne l'aimait à vrai dire pas beaucoup) par le biais d'un instrument pour lequel il avait une affection toute particulière, le sanza *.
Dans le texte suivant, Henri Michaux livre des considérations sur la contemplation, le détachement de soi et du monde comme conditions essentielles de sa pratique... Un texte que j'ai trouvé un peu en demi-teinte, un peu convenu.
Arrivée à Alicante est un récit fait à la première personne d'un genre très étrange. Un homme arrive dans la ville d'Espagne, sort de son hôtel et va parcourir les rues alentour. Arrivé sur une place, il s'assied à la terrasse d'un café à l'ombre des palmiers. Il ne le remarque pas tout de suite mais un brusque malaise va s'emparer de lui quand son attention sera attirée sur la taille des passants... Fatigue du voyage ? Effet d'optique ? attaque cérébrale ? La conscience des choses est toujours limitée en soi, elle est portée dans ce récit à son point le plus aigü, le plus sensible. Un texte fascinant.
Plus troublant encore est Moriturus, dernier texte de Face à ce qui se dérobe. Un marcheur nommé N... avance au milieu d'un vaste et haut paysage montagneux. Lors de sa progression, N... reçoit comme un appel, une étrange injonction de la montagne, celle d'aller se précipiter dans le gouffre. Troublé, l'homme choisit d'abord de ne pas y prêter attention mais peu à peu, l'invitation se fait plus pressante. N... va choisir de faire des détours, de revenir sur ses pas, d'avancer à vue,... Mais l'inexorable se fait de plus en plus proche...
J'ai retrouvé dans Face à ce qui se dérobe toute la singularité du style d'Henri Michaux, un style introspectif mais résolument libre, jamais enfermé en lui-même mais toujours en quête d'un possible, d'un au-delà de la conscience. Une poésie subtile, essentielle.
(*) le sanza est un instrument originaire d'Afrique composé de lamelles métalliques fixées sur une planche en bois avec une caisse de résonnance.
Une salamandre myriapode, une hydre-phasme, un nain de jardin avec une matraque, une danseuse qui se fait gratter le dos par une étoile de mer, une cage thoracique griffue et velue… Les peintures de Michaux feraient un bon test de Rorschach. Elles évoquent une aberrante « zoologie », terme utilisé par Michaux pour le réfuter et lui préférer « signes », tels des idéogrammes signifiant le mouvement dans ses variations infinies.
On peut aussi considérer ces signes comme un alphabet runique destiné à des incantations, pour invoquer les « démons effrénés accompagnateurs de nos actes et contradicteurs de notre retenue ». Et quand Michaux se met à évoquer les mouvements de la mer et de ses créatures, on croirait presque que le spectre de Maldoror va apparaître dans un nuage d'encre de poulpe, où notre poète trempe sa plume pour signer un pacte avec toutes les entités permettant d'échapper aux « mots des autres », au langage commun, et plus généralement aux systèmes de pensée qui verrouillent le corps.
Le graphisme et le texte se mêlent dans un hymen féroce, une « opération requin ». Il en résulte une poésie qui « va plus avant », comme aurait dit Paul Celan.
Dans le sillage de ce jaillissement initial apparaissent les pronoms personnels « je » et « tu ». Un échange s'installe, entre violence (« Je rame contre ta vie ») et douceur (« Je fais des nappes de paix en toi »). Happé par ce dialogue, le lecteur est secoué par des courants contraires établissant de force un mouvement en lui.
Et Michaux continue à ramer sur son frêle esquif, dans la vaine poursuite d'un contact représenté par la métaphore d'appels téléphoniques aussi intempestifs qu'insaisissables. Ses efforts achoppent sur les « pièges de la communication », où sa vie et celles des autres se font obstacle au lieu d'aller de l'avant ensemble.
L'action se fait réaction, à la limite de l'allergie. On le voit fuir la présence de personnages de cinéma rentrant dans son univers par métalepse. Hypersensibilité et misanthropie se mêlent avec humour, et si la vie des autres apparaît gênante, celle de Michaux paraît, en conséquence, invivable. Cercle vicieux.
Face à cette aporie, la recherche scientifique s'organise. le remède qu'elle propose est de manipuler l'identité. On passe à la deuxième personne du pluriel, sur un ton détaché, chirurgical (synthétisé par l'expression « tranches de savoir », qui évoque à la fois l'art de l'aphorisme et le mouvement du scalpel tranchant dans le vif). D'inquiétants savants semblent introduire un corps étranger dans les pensées d'une tierce partie, afin de manipuler ses états d'esprit. On commençait à peine à s'y retrouver que tout a déjà changé. « Même si c'est vrai, c'est faux ».
Conséquence kafkaïenne de ces métamorphoses : Michaux va vivre sa vie chez les insectes. C'est parti pour une lune de miel grotesque avec des nymphe(tte)s gluantes. Bien sûr, cela mènera aussi à rencontrer une guêpe parasitoïde, une espèce qui a inspiré le mode de reproduction de l'alien du film du même nom. Une fois introduite en soi, l'altérité peut rejaillir sous des formes peu ragoûtantes.
Qu'importe, Michaux est prêt à explorer celle-ci jusque dans un au-delà aussi intangible qu'inquiétant. Nous y écoutons parler une ombre féminine, écho du principe féminin nommé « Anhimaharua » plus tôt dans le recueil. Elle poursuit sa chute dans l'obscurité d'un sommeil toujours plus profond, qui se confond ici avec la mort. Et elle nous fait le récit au présent des phénomènes qui l'entourent, comme une sorte de retransmission en direct du Bardo Thodol sur les ondes d'une radio alien. Yama le dévoreur est remplacé par des essaims d'ombres prédatrices. Dans cet univers anxiogène fait de dépossession, le savoir ne peut être que transitoire. On ouvre alors son transistor pour capter les fréquences de la vérité du moment, juste avant son engloutissement imminent. La muse malade de Michaux fonde une démarche poétique qui marquera entre autre Philippe Jaccottet (il reprendra la citation suivante dans son Entretien des Muses) : « Savoir. Autre savoir ici. Pas savoir pour renseignements. Savoir pour devenir musicienne de la vérité. »
On peut aussi considérer ces signes comme un alphabet runique destiné à des incantations, pour invoquer les « démons effrénés accompagnateurs de nos actes et contradicteurs de notre retenue ». Et quand Michaux se met à évoquer les mouvements de la mer et de ses créatures, on croirait presque que le spectre de Maldoror va apparaître dans un nuage d'encre de poulpe, où notre poète trempe sa plume pour signer un pacte avec toutes les entités permettant d'échapper aux « mots des autres », au langage commun, et plus généralement aux systèmes de pensée qui verrouillent le corps.
Le graphisme et le texte se mêlent dans un hymen féroce, une « opération requin ». Il en résulte une poésie qui « va plus avant », comme aurait dit Paul Celan.
Dans le sillage de ce jaillissement initial apparaissent les pronoms personnels « je » et « tu ». Un échange s'installe, entre violence (« Je rame contre ta vie ») et douceur (« Je fais des nappes de paix en toi »). Happé par ce dialogue, le lecteur est secoué par des courants contraires établissant de force un mouvement en lui.
Et Michaux continue à ramer sur son frêle esquif, dans la vaine poursuite d'un contact représenté par la métaphore d'appels téléphoniques aussi intempestifs qu'insaisissables. Ses efforts achoppent sur les « pièges de la communication », où sa vie et celles des autres se font obstacle au lieu d'aller de l'avant ensemble.
L'action se fait réaction, à la limite de l'allergie. On le voit fuir la présence de personnages de cinéma rentrant dans son univers par métalepse. Hypersensibilité et misanthropie se mêlent avec humour, et si la vie des autres apparaît gênante, celle de Michaux paraît, en conséquence, invivable. Cercle vicieux.
Face à cette aporie, la recherche scientifique s'organise. le remède qu'elle propose est de manipuler l'identité. On passe à la deuxième personne du pluriel, sur un ton détaché, chirurgical (synthétisé par l'expression « tranches de savoir », qui évoque à la fois l'art de l'aphorisme et le mouvement du scalpel tranchant dans le vif). D'inquiétants savants semblent introduire un corps étranger dans les pensées d'une tierce partie, afin de manipuler ses états d'esprit. On commençait à peine à s'y retrouver que tout a déjà changé. « Même si c'est vrai, c'est faux ».
Conséquence kafkaïenne de ces métamorphoses : Michaux va vivre sa vie chez les insectes. C'est parti pour une lune de miel grotesque avec des nymphe(tte)s gluantes. Bien sûr, cela mènera aussi à rencontrer une guêpe parasitoïde, une espèce qui a inspiré le mode de reproduction de l'alien du film du même nom. Une fois introduite en soi, l'altérité peut rejaillir sous des formes peu ragoûtantes.
Qu'importe, Michaux est prêt à explorer celle-ci jusque dans un au-delà aussi intangible qu'inquiétant. Nous y écoutons parler une ombre féminine, écho du principe féminin nommé « Anhimaharua » plus tôt dans le recueil. Elle poursuit sa chute dans l'obscurité d'un sommeil toujours plus profond, qui se confond ici avec la mort. Et elle nous fait le récit au présent des phénomènes qui l'entourent, comme une sorte de retransmission en direct du Bardo Thodol sur les ondes d'une radio alien. Yama le dévoreur est remplacé par des essaims d'ombres prédatrices. Dans cet univers anxiogène fait de dépossession, le savoir ne peut être que transitoire. On ouvre alors son transistor pour capter les fréquences de la vérité du moment, juste avant son engloutissement imminent. La muse malade de Michaux fonde une démarche poétique qui marquera entre autre Philippe Jaccottet (il reprendra la citation suivante dans son Entretien des Muses) : « Savoir. Autre savoir ici. Pas savoir pour renseignements. Savoir pour devenir musicienne de la vérité. »
Admirateur de Plume et curieux de l’importance séculaire du rêve que je vois comme une signal émotif, incontrôlé, parfois fulgurant, j’ai ouvert avec appétit ce petit livre mais il m’a refroidi. Michaux examine sa production onirique dans une lente et prudente introspection, avec un détachement critique proche de l’indifférence : Je me donne des conseils. Oui. En rêve, aussi. Et tout pareillement, je prends des résolutions, bravement, en inconscient qui se croit conscient et qui, naïf, table sur du vent, sur moins que du vent. Avec ce matériau suspect, moi, sotte fourmi, me fais la leçon, prépare une suite pour ma vie à venir, à partir de la fumée de ces événements fantasmatiques, et qui vont se dissiper à l'aurore, mais que je prends pour solides et sûrs (p 20). L’écriture est belle, incomparable dans ses césures et sa syntaxe (J'affleure à la surface qui est l'éveil, lente, cotonneuse, solidifiante affaire, qui dissipe l'autre, p 29), mais dédaigneuse (grâce au subconscient très notaire et terre à terre, p 25). L’idée est la vanité du rêve : Je faisais mes dynamiques rêves de jour, rêveries que je savais rendre fascinantes, exaltantes. Après les rêveries, plus besoin de rêves. Nuits calmes, profondes (p 31). Le rêve, en général fort pour les rappels, ne l’est guère pour les solutions (p 45). Chez Michaux, le rêve cède la place à son contraire, la rêverie : Le contraire du rêve qui, n'importe où il vous mène, vous y mène attaché et sans que vous puissiez rien, la rêverie, dispose de liberté. Elle demande à en avoir. Elle en fait sa jouissance (p 135).
Cela faisait trop longtemps que j'entendais parler de cet artiste belge aux multiples facettes. Je me suis donc lancé au hasard du rayonnage de la bibliothèque. Il faut dire que je n'ai pas été conquis du tout pour cette premières approche. Découpés en plusieurs parties, le livre parle des propres rêves et l'auteur, entrecoupés de réflexions et de liens avec sa vie, son quotidien. Cela peut paraitre clair pour lui et son propre ressentis mais personnellement je n'ai pas trop compris où il voulait en venir. Bien conscient qu'un rêve par définition n'est pas logique ou cohérent, l'écrivain tente en vain d'expliquer pourquoi son esprit a bien pu arriver à de tels songes, entremêlant le réel et l'onirique. Apres avoir parlé de différentes interprétations possibles des rêves, ça se termine sur une méditation sur la rêverie.
J'ai passé plusieurs pages (de plus en plus) pour arriver heureusement vite au bout des ces 150 petites pages.
Promis ! Je vais réessayer avec d'autres de ses nombreuses parutions.
J'ai passé plusieurs pages (de plus en plus) pour arriver heureusement vite au bout des ces 150 petites pages.
Promis ! Je vais réessayer avec d'autres de ses nombreuses parutions.
Je n'ai pas compris cette poésie, ce style peut-être trop innovant pour moi. J'ai eu l'impression de lire une suite de mots aléatoire, tous tirés d'un registre plus ou moins commun et poétique. Je ne saurais donc ni le conseiller ni le déconseiller, mais juste vous inciter à vous faire votre propre avis, en espérant que vous l'apprécierez plus que moi. Je vais tenter la lecture d'une de ses autres œuvres pour voir si le ressenti est aussi faible qu'à la lecture de "Jours de silence".
Ce livre est en fait un recueil d’écrits piochés dans les différentes œuvres de Michaux, une sorte de "best of" donc (même si cet anglicisme est particulièrement moche). Il est difficile de ranger Michaux dans la poésie ou dans la prose, il serait plutôt à cheval entre les deux, ou aurait même déjà sauté plus loin, car Michaux est plus qu’un simple équilibriste, il crée son propre monde.
Il pourrait y avoir une ressemblance avec Antonin Artaud mais sans le côté excessif, le style de Michaux est au contraire assez "bonhomme". Bien que déroutante, sa faculté d’écrire une langue nouvelle paraît déconcertante de facilité, c’est là qu’est la force de Michaux, ce nouveau langage qu’il arrive à créer, pourtant inconnu de nous, reste agréable à lire, aéré, et en aucun cas hermétique. La plupart des néologismes qu’il fabrique semblent ainsi exister depuis toujours dans la langue française (lire par exemple son poème Le grand combat).
Bien que je ne sois pas expert en la matière, je considérerai peut-être Michaux comme mon poète préféré. Son inventivité, ce que l’on ressent et devine à travers ses drôles d’écrits, à la fois donc légers et percutants, lui donnent vraiment un style unique et reconnaissable dont l’originalité semble parfaitement maîtrisée.
Il pourrait y avoir une ressemblance avec Antonin Artaud mais sans le côté excessif, le style de Michaux est au contraire assez "bonhomme". Bien que déroutante, sa faculté d’écrire une langue nouvelle paraît déconcertante de facilité, c’est là qu’est la force de Michaux, ce nouveau langage qu’il arrive à créer, pourtant inconnu de nous, reste agréable à lire, aéré, et en aucun cas hermétique. La plupart des néologismes qu’il fabrique semblent ainsi exister depuis toujours dans la langue française (lire par exemple son poème Le grand combat).
Bien que je ne sois pas expert en la matière, je considérerai peut-être Michaux comme mon poète préféré. Son inventivité, ce que l’on ressent et devine à travers ses drôles d’écrits, à la fois donc légers et percutants, lui donnent vraiment un style unique et reconnaissable dont l’originalité semble parfaitement maîtrisée.
Ecce homo: l'un des grands textes de ce recueil.
« Ecce homo » sont les mots par lesquels Ponce Pilate présente au peuple le Christ couronné d'épines. Ce très long poème en prose constitue la fin du recueil Exorcismes paru en 1943. Comment s'étonner de sa noirceur, de la colère dont il témoigne, alors qu'il est écrit en plein conflit mondial, une guerre totale, monstrueuse, dont nul n'entrevoit encore l'issue. Cette vision amère de l'humain, de sa nature, de sa condition, de ses hauts faits et méfaits, malgré une fin quelque peu apaisée, sonne comme un jugement dernier.
Lien : https://www.youtube.com/watc..
« Ecce homo » sont les mots par lesquels Ponce Pilate présente au peuple le Christ couronné d'épines. Ce très long poème en prose constitue la fin du recueil Exorcismes paru en 1943. Comment s'étonner de sa noirceur, de la colère dont il témoigne, alors qu'il est écrit en plein conflit mondial, une guerre totale, monstrueuse, dont nul n'entrevoit encore l'issue. Cette vision amère de l'humain, de sa nature, de sa condition, de ses hauts faits et méfaits, malgré une fin quelque peu apaisée, sonne comme un jugement dernier.
Lien : https://www.youtube.com/watc..
Ce que j'aime bien, quand je lis de la poésie, c'est que j'ai l'impression d'être au musée. On passe à peu près autant de temps à lire un poème qu'à regarder un tableau, et surtout, on abrège ou on prolonge si ça nous plaît ou pas. Telle croûte nous agresse les yeux ; on passe au reste et on l'oublie à jamais. Telle œuvre nous touche ; on s'arrête et on essaye de comprendre pourquoi. C'est d'autant plus intéressant lorsque la croûte et l'oeuvre sont du même artiste, cela prouve que l'on a détesté la croûte en vertu d'un vrai jugement et pas sous l'impulsion misanthropique et impitoyable de la certitude que ledit artiste est par principe détestable. D'ailleurs, on s'arrête parfois moins pour envisager l'inscription de l'oeuvre dans sa mémoire que pour observer ce que ce jugement de valeur spontané dit de nous. Pour en venir au livre, je ne crois pas avoir déjà lu un recueil de poésie où cette impression s'est autant manifestée.
Autant le dire d'emblée, les trois-quarts des poèmes ne m'ont soit pas intéressé, soit carrément pas plu. On nage dans un délire absurde plus ou moins dense, dont le caractère poétique est loin d'être évident puisqu'il ne s'agit quasiment que de prose. On retient quelques thèmes récurrents : le mépris du corps, la confusion entre le réel et l'imaginé, la violence gratuite macabre, la personnification des concepts, la conceptualisation du concret. Beaucoup de têtes coupées, beaucoup de viscères qui volent, beaucoup d'assassinats cordiaux... On passe un bon moment. Il y a un travail sur la langue qui consiste à inventer des mots qui sonnent français pour traduire une idée assez floue, mais qui excellent à retranscrire leur caractère glauque. Invention également de tout un bestiaire plus ou moins fantastique qui aurait le mérite de révolutionner les collections d'un Muséum d'histoire naturelle fantasmé si le poète caractérisait lesdites espèces au lieu de les énumérer et de n'en donner que quelques traits comportementaux sous forme d'énigmes. Le poète reconnaît lui-même, à la fin d'un texte particulièrement complexe, où les incohérences succèdent aux invraisemblances, qui occasionne chez le lecteur une lutte acharnée et souvent vaine contre la passivité, que les éléments naturels sont plus à même de comprendre son écriture que l'homme ; autant vous dire qu'on n'en sort pas bouleversé par une nouvelle vision du monde. On passe son temps à essayer d'établir un diagnostic sur l'état mental du poète, traversé de passions morbides, d'obscénités grotesques et de masochisme dépressif.
Les seuls passages que j'ai apprécié sont paradoxalement les moins poétiques de l'oeuvre. Ce sont les mésaventures absurdes de Plume, assez amusantes, où une naïve victime éternelle se laisse martyriser par une société qui semble incapable d'éprouver autre chose que de la haine à son endroit ; et le voyage en grande Garabagne, où l'on se croit au milieu d'un chapitre du Livre des Merveilles de Marco Polo, qui consiste, selon un principe cher à la science-fiction, à imaginer les mœurs de peuples inconnus que le poète visite. Seule exception : le poème "Ecce homo", le tableau où j'ai dû m'arrêter, qui écrase complètement le reste du recueil pour moi et m'a bien rassuré à un moment où je commençais à me demander si je n'étais pas en train de tout détester par principe. On y trouve un regard plein de verve sur l'homme, avec un recul approprié et des images qui font mouche, et dont on saisit les références et les observations dans la société. Un bien beau poème rapide à lire, qui fait réfléchir et que j'invite à découvrir sans attendre.
Autant le dire d'emblée, les trois-quarts des poèmes ne m'ont soit pas intéressé, soit carrément pas plu. On nage dans un délire absurde plus ou moins dense, dont le caractère poétique est loin d'être évident puisqu'il ne s'agit quasiment que de prose. On retient quelques thèmes récurrents : le mépris du corps, la confusion entre le réel et l'imaginé, la violence gratuite macabre, la personnification des concepts, la conceptualisation du concret. Beaucoup de têtes coupées, beaucoup de viscères qui volent, beaucoup d'assassinats cordiaux... On passe un bon moment. Il y a un travail sur la langue qui consiste à inventer des mots qui sonnent français pour traduire une idée assez floue, mais qui excellent à retranscrire leur caractère glauque. Invention également de tout un bestiaire plus ou moins fantastique qui aurait le mérite de révolutionner les collections d'un Muséum d'histoire naturelle fantasmé si le poète caractérisait lesdites espèces au lieu de les énumérer et de n'en donner que quelques traits comportementaux sous forme d'énigmes. Le poète reconnaît lui-même, à la fin d'un texte particulièrement complexe, où les incohérences succèdent aux invraisemblances, qui occasionne chez le lecteur une lutte acharnée et souvent vaine contre la passivité, que les éléments naturels sont plus à même de comprendre son écriture que l'homme ; autant vous dire qu'on n'en sort pas bouleversé par une nouvelle vision du monde. On passe son temps à essayer d'établir un diagnostic sur l'état mental du poète, traversé de passions morbides, d'obscénités grotesques et de masochisme dépressif.
Les seuls passages que j'ai apprécié sont paradoxalement les moins poétiques de l'oeuvre. Ce sont les mésaventures absurdes de Plume, assez amusantes, où une naïve victime éternelle se laisse martyriser par une société qui semble incapable d'éprouver autre chose que de la haine à son endroit ; et le voyage en grande Garabagne, où l'on se croit au milieu d'un chapitre du Livre des Merveilles de Marco Polo, qui consiste, selon un principe cher à la science-fiction, à imaginer les mœurs de peuples inconnus que le poète visite. Seule exception : le poème "Ecce homo", le tableau où j'ai dû m'arrêter, qui écrase complètement le reste du recueil pour moi et m'a bien rassuré à un moment où je commençais à me demander si je n'étais pas en train de tout détester par principe. On y trouve un regard plein de verve sur l'homme, avec un recul approprié et des images qui font mouche, et dont on saisit les références et les observations dans la société. Un bien beau poème rapide à lire, qui fait réfléchir et que j'invite à découvrir sans attendre.
Michaux (Henri) : La vie d’Henri Michaux (Namur, 24 mai 1899 – Paris, 19 octobre 1984), poète et peintre de génie d’origine belge, bascule lorsqu’il perd son épouse. La douleur de ce décès tragique ne cicatrisera jamais, et il portera le deuil jusqu’à sa propre mort. Mais c’est sans doute grâce à ce terrible événement que sa carrière bifurque vers des travaux de tous styles, emprunts de la véritable essence de l’âme tourmenté du veuf inconsolable. Mais déjà, avant cela, ses confrontations à l’Abîme étaient fréquentes et, depuis son enfance, on peut dire que Michaux aura avalé sa part de ténèbres.
Cet homme, qui deviendra un Maître dans ses domaines de prédilection, la poésie et la peinture, a connu une adolescence difficile, entre angoisse et dépressions. A cette époque, ses premiers travaux voient le jour, influencés sans aucun doute par ses plus jeunes années durant lesquelles il a connu les pensionnats et l’éducation à la dure des jésuites, mais surtout à la fréquentation des auteurs russes Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Tout en faisant ses premiers pas dans la littérature, il s’orientera vers la médecine pour l’abandonner assez vite, prenant la mer entre 1920 et 1921. C’est peu de temps après, en découvrant Lautréamont, qu’il se décide à se lancer corps et âme dans la littérature.
Durant les Années Folles, il arrive à Paris, une ville dont il tombera éperdument amoureux. Dès lors, il n’aura de cesse de renier tout ce qui le rattache à son pays natal et se considérera parisien. Même si, par la suite, il voyagera dans le monde entier, la capitale française restera son berceau. Il sera d’ailleurs, avec la plus grande fierté, naturalisé français en 1955. Aussi rédigera-t-il ses "Carnets de Voyages", réel ou fictifs, qui feront partie intégrale de son œuvre colossale, lancé par son éditeur et ami proche, Jacques-Olivier Fourcade. En plus de l’écriture, Henri Michaux commence à s’intéresser de plus en plus à l’art pictural dont il entamera des travaux, restés longtemps secrets.
C’est en 1948 que la vie de l’auteur prendra un tournant radical, suite au décès tragique de Marie-Louise Termet, son épouse, suite à d’atroces brûlures dues à un accident domestique. Michaux en rendra compte violemment avec l’écriture de "La Vie dans les Plis" (1949), l’un des textes les plus viscéraux qu’il aura écrit.
Suite à cet évènement, il se considèrera comme un mort en sursit et comme n’ayant plus rien à perdre, commencera les expériences littéraires sous l’influence des drogues, principalement la mescaline, le LSD et la psilocybine. Ces plongeons dans l’abîme des hallucinogènes commenceront tardivement, à l’âge de 55 ans, alors qu’il n’avait jamais touché auparavant aux produits stupéfiants, mis à part l’éther qu’il consomma plus jeune. Ces expériences psychédéliques renoueront Michaux et la médecine, principalement la psychiatrie, et donneront naissance à des travaux sous l’influence des drogues, avec l’assistance d’un médecin qui calculera les dosages avec précision. Il en ressortira des textes impressionnants, mélangés avec des dessins sur des carnets spécialement utilisés pour ce que l’auteur voulait comme des approches scientifiques des effets des substance et de la créativité littéraire et picturale pouvant en découler. Les toiles qu’il a laissé derrière lui sont autant de bijoux d’art atypique qui ne peuvent pas laisser indifférent. Notons certaines œuvres picturales significatives :
Henri MICHAUX "Têtes"
Henri MICHAUX "Clown"
Henri MICHAUX "Paysages"
Henri MICHAUX "Prince de la Nuit"
Henri MICHAUX "Dragon"
Henri MICHAUX "Combats"
Henri MICHAUX "Couché"
Henri MICHAUX "Parcours"
Henri MICHAUX "Description d’un trouble"
Henri MICHAUX "Arrachements"
Henri MICHAUX "Composition"
Henri MICHAUX "Frottage"
Henri MICHAUX "Mouvements"
Henri MICHAUX "Repos ans le Malheur"
Vers la fin de sa vie, Henri Michaux vivait en reclus et était perçu comme un personnage public fuyant son lectorat et la presse. Il meurt seul à Paris, sa ville d’enracinement, le 19 octobre 1984
La bibliographie de l’auteur étant colossale – 63 ouvrages dont 6 posthumes – on retiendra surtout ses recueils de textes poétiques modernes dont voici une liste non-exhaustive :
MICHAUX Henri "Connaissance par les Gouffres"
MICHAUX Henri "La Vie dans les Plis"
MICHAUX Henri "Epreuves, Exorcismes"
MICHAUX Henri "L’Infini turbulent"
MICHAUX Henri "Poteaux d’Angles"
MICHAUX Henri "L’Espace du Dedans"
MICHAUX Henri "La Nuit remue"
MICHAUX Henri "Plume"
MICHAUX Henri "Ecuador"
MICHAUX Henri "Lointain Intérieur"
Henri MICHAUX "Misérables miracles"
Ghislain GILBERTI
"Dictionnaire de l'Académie Nada"
Cet homme, qui deviendra un Maître dans ses domaines de prédilection, la poésie et la peinture, a connu une adolescence difficile, entre angoisse et dépressions. A cette époque, ses premiers travaux voient le jour, influencés sans aucun doute par ses plus jeunes années durant lesquelles il a connu les pensionnats et l’éducation à la dure des jésuites, mais surtout à la fréquentation des auteurs russes Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Tout en faisant ses premiers pas dans la littérature, il s’orientera vers la médecine pour l’abandonner assez vite, prenant la mer entre 1920 et 1921. C’est peu de temps après, en découvrant Lautréamont, qu’il se décide à se lancer corps et âme dans la littérature.
Durant les Années Folles, il arrive à Paris, une ville dont il tombera éperdument amoureux. Dès lors, il n’aura de cesse de renier tout ce qui le rattache à son pays natal et se considérera parisien. Même si, par la suite, il voyagera dans le monde entier, la capitale française restera son berceau. Il sera d’ailleurs, avec la plus grande fierté, naturalisé français en 1955. Aussi rédigera-t-il ses "Carnets de Voyages", réel ou fictifs, qui feront partie intégrale de son œuvre colossale, lancé par son éditeur et ami proche, Jacques-Olivier Fourcade. En plus de l’écriture, Henri Michaux commence à s’intéresser de plus en plus à l’art pictural dont il entamera des travaux, restés longtemps secrets.
C’est en 1948 que la vie de l’auteur prendra un tournant radical, suite au décès tragique de Marie-Louise Termet, son épouse, suite à d’atroces brûlures dues à un accident domestique. Michaux en rendra compte violemment avec l’écriture de "La Vie dans les Plis" (1949), l’un des textes les plus viscéraux qu’il aura écrit.
Suite à cet évènement, il se considèrera comme un mort en sursit et comme n’ayant plus rien à perdre, commencera les expériences littéraires sous l’influence des drogues, principalement la mescaline, le LSD et la psilocybine. Ces plongeons dans l’abîme des hallucinogènes commenceront tardivement, à l’âge de 55 ans, alors qu’il n’avait jamais touché auparavant aux produits stupéfiants, mis à part l’éther qu’il consomma plus jeune. Ces expériences psychédéliques renoueront Michaux et la médecine, principalement la psychiatrie, et donneront naissance à des travaux sous l’influence des drogues, avec l’assistance d’un médecin qui calculera les dosages avec précision. Il en ressortira des textes impressionnants, mélangés avec des dessins sur des carnets spécialement utilisés pour ce que l’auteur voulait comme des approches scientifiques des effets des substance et de la créativité littéraire et picturale pouvant en découler. Les toiles qu’il a laissé derrière lui sont autant de bijoux d’art atypique qui ne peuvent pas laisser indifférent. Notons certaines œuvres picturales significatives :
Henri MICHAUX "Têtes"
Henri MICHAUX "Clown"
Henri MICHAUX "Paysages"
Henri MICHAUX "Prince de la Nuit"
Henri MICHAUX "Dragon"
Henri MICHAUX "Combats"
Henri MICHAUX "Couché"
Henri MICHAUX "Parcours"
Henri MICHAUX "Description d’un trouble"
Henri MICHAUX "Arrachements"
Henri MICHAUX "Composition"
Henri MICHAUX "Frottage"
Henri MICHAUX "Mouvements"
Henri MICHAUX "Repos ans le Malheur"
Vers la fin de sa vie, Henri Michaux vivait en reclus et était perçu comme un personnage public fuyant son lectorat et la presse. Il meurt seul à Paris, sa ville d’enracinement, le 19 octobre 1984
La bibliographie de l’auteur étant colossale – 63 ouvrages dont 6 posthumes – on retiendra surtout ses recueils de textes poétiques modernes dont voici une liste non-exhaustive :
MICHAUX Henri "Connaissance par les Gouffres"
MICHAUX Henri "La Vie dans les Plis"
MICHAUX Henri "Epreuves, Exorcismes"
MICHAUX Henri "L’Infini turbulent"
MICHAUX Henri "Poteaux d’Angles"
MICHAUX Henri "L’Espace du Dedans"
MICHAUX Henri "La Nuit remue"
MICHAUX Henri "Plume"
MICHAUX Henri "Ecuador"
MICHAUX Henri "Lointain Intérieur"
Henri MICHAUX "Misérables miracles"
Ghislain GILBERTI
"Dictionnaire de l'Académie Nada"
Merci pour l'envoi du livre ! Il m'avait plu par son format tout d’abord, ainsi que l’image de couverture, très originale. Et quand je l’ai reçu, l’effet de la couverture (texture, image, …) a été encore plus … waouh ! La texture donne un effet moiré sur les couleurs de l’Himalaya, c’est magnifique.
L’ouvrage consiste en la juxtaposition d’un texte des années 1930 de Henri Michaux (extrait d’un carnet de voyage intitulé « Un barbare en Asie ») et d’illustrations par Carlos Nine.
Le texte est un poème non rimé (enfin, pour moi c’est un poème). Il décrit le départ d’un train qui va gravir l’Himalaya avec wagons, sa locomotive et ses passagers.
Les illustrations ont un style bien particulier, qui m’a fait penser à des images qui illustrent souvent Alice aux Pays des merveilles … surréaliste… un style d’illustrations que la couverture, « normale », ne laisse nullement présager ! la surprise est donc totale. Les couleurs sont majoritairement chaudes (en contraste avec la montagne, plutôt froide). Les personnages humains sont particulièrement intrigants et poétiques.
Et après ma lecture, je suis revenue sur la couverture, et ai eu l’impression de découvrir dans le dessin des formes humaines et animales, que chacun pourra distinguer selon sa sensibilité… évoquant toutes ces vies qui peuplent la montagne.
Bref, un très bel ouvrage que j’aurai plaisir à offrir à un enfant !
L’ouvrage consiste en la juxtaposition d’un texte des années 1930 de Henri Michaux (extrait d’un carnet de voyage intitulé « Un barbare en Asie ») et d’illustrations par Carlos Nine.
Le texte est un poème non rimé (enfin, pour moi c’est un poème). Il décrit le départ d’un train qui va gravir l’Himalaya avec wagons, sa locomotive et ses passagers.
Les illustrations ont un style bien particulier, qui m’a fait penser à des images qui illustrent souvent Alice aux Pays des merveilles … surréaliste… un style d’illustrations que la couverture, « normale », ne laisse nullement présager ! la surprise est donc totale. Les couleurs sont majoritairement chaudes (en contraste avec la montagne, plutôt froide). Les personnages humains sont particulièrement intrigants et poétiques.
Et après ma lecture, je suis revenue sur la couverture, et ai eu l’impression de découvrir dans le dessin des formes humaines et animales, que chacun pourra distinguer selon sa sensibilité… évoquant toutes ces vies qui peuplent la montagne.
Bref, un très bel ouvrage que j’aurai plaisir à offrir à un enfant !
Tout d'abord Mille Mercis aux éditions Densité , ainsi qu'à son directeur, Hughes Massello, sans oublier Babelio
pour la découverte de ce magnifique objet- livre, fort joliment relié, pour les petits....et les grands....
L'histoire d'un petit train et d'une locomotive-poney...qui osent entreprendre la montée de l' Himalaya !?
Un extrait d' "un Barbare en Asie" du poète- peintre, Henri Michaux, illustré incroyablement par l'artiste argentin, Carlos Nine, que je découvre pour la toute première fois...
Tout est astucieusement pensé dans ce livre, au format déjà étonnant : reliure en tissu, avec l'illustration couleur de cet Himalaya rêvé, couvrant le premier plat, format oblong, tout en Hauteur, qui met en valeur les illustrations de Carlos Nine se déployant toutes en spirales montantes...Des volutes baroques et fantasmagoriques...qui habitent joyeusement le texte de Michaux ;les mots eux-mêmes,disposés de façon élégante et fantaisiste !
Intriguée par " la patte" de cet artiste...j'apprends avec regret, qu' il est décédé en 2016...Il aura eu au moins la joie de voir de son vivant cet album très réussi, paru, il y a déjà plus de 10 années( 2011)...
Je tiens à insérer un extrait, même si il n'est plus d'actualité; lignes finales présentant aux tout jeunes lecteurs ; à la fois l'auteur et l'illustrateur...
"Henri Michaux et Carlos Nine ne se sont jamais rencontrés sauf dans ces pages que tu as parcourues.
Henri était poète, mais il n'a jamais écrit pour les enfants.Il fut d'abord voyageur- poète, puis poète- poète, enfin peintre- poète. Comme Carlos.
Carlos vit en Argentine, presque de l'autre côté du monde, plus loin encore que les sommets de l'Himalaya.Quand c'est l'hiver chez nous, chez lui, c'est l'été. Il dessine et peint sans arrêt, il sait aussi inventer des histoires. "
Double petit Bonheur: la beauté de cette publication jeunesse, qui ravit aussi les yeux des Grands !... m'ayant , en plus, fait connaître ce " peintre -sculpteur-
auteur "argentin....avec l' envie de reprendre, relire le texte de Henri Michaux...
Bravo à l'éditeur pour cet album somptueux et
enchanteur !
***** lien pour en savoir plus sur l'artiste, Carlos Nine:
https://m.bedetheque.com/auteur-2223-BD-Nine-Carlos.html
pour la découverte de ce magnifique objet- livre, fort joliment relié, pour les petits....et les grands....
L'histoire d'un petit train et d'une locomotive-poney...qui osent entreprendre la montée de l' Himalaya !?
Un extrait d' "un Barbare en Asie" du poète- peintre, Henri Michaux, illustré incroyablement par l'artiste argentin, Carlos Nine, que je découvre pour la toute première fois...
Tout est astucieusement pensé dans ce livre, au format déjà étonnant : reliure en tissu, avec l'illustration couleur de cet Himalaya rêvé, couvrant le premier plat, format oblong, tout en Hauteur, qui met en valeur les illustrations de Carlos Nine se déployant toutes en spirales montantes...Des volutes baroques et fantasmagoriques...qui habitent joyeusement le texte de Michaux ;les mots eux-mêmes,disposés de façon élégante et fantaisiste !
Intriguée par " la patte" de cet artiste...j'apprends avec regret, qu' il est décédé en 2016...Il aura eu au moins la joie de voir de son vivant cet album très réussi, paru, il y a déjà plus de 10 années( 2011)...
Je tiens à insérer un extrait, même si il n'est plus d'actualité; lignes finales présentant aux tout jeunes lecteurs ; à la fois l'auteur et l'illustrateur...
"Henri Michaux et Carlos Nine ne se sont jamais rencontrés sauf dans ces pages que tu as parcourues.
Henri était poète, mais il n'a jamais écrit pour les enfants.Il fut d'abord voyageur- poète, puis poète- poète, enfin peintre- poète. Comme Carlos.
Carlos vit en Argentine, presque de l'autre côté du monde, plus loin encore que les sommets de l'Himalaya.Quand c'est l'hiver chez nous, chez lui, c'est l'été. Il dessine et peint sans arrêt, il sait aussi inventer des histoires. "
Double petit Bonheur: la beauté de cette publication jeunesse, qui ravit aussi les yeux des Grands !... m'ayant , en plus, fait connaître ce " peintre -sculpteur-
auteur "argentin....avec l' envie de reprendre, relire le texte de Henri Michaux...
Bravo à l'éditeur pour cet album somptueux et
enchanteur !
***** lien pour en savoir plus sur l'artiste, Carlos Nine:
https://m.bedetheque.com/auteur-2223-BD-Nine-Carlos.html
Merci à Babelio et aux éditions densité pour l'envoi de ce magnifique livre.
Tout est beau dans cet album jeunesse, le texte un extrait du livre «un barbare en Asie » d'Henri Michaux, les illustrations de Carlos Mine que j'adore surtout celles des femmes népalaises toutes mignonnes, et effectivement l'envie de le découvrir plus, mettant inconnu, comme Fanfanouche24 je découvre qu'il est décédé en 2016,
Cet album est somptueux et luxueux d'une part par la qualité de sa reliure, l'originalité de son format et d'autre part par son texte et ses illustrations. Un beau moment de lecture qui enchantera les petits comme les grands.
Tout est beau dans cet album jeunesse, le texte un extrait du livre «un barbare en Asie » d'Henri Michaux, les illustrations de Carlos Mine que j'adore surtout celles des femmes népalaises toutes mignonnes, et effectivement l'envie de le découvrir plus, mettant inconnu, comme Fanfanouche24 je découvre qu'il est décédé en 2016,
Cet album est somptueux et luxueux d'une part par la qualité de sa reliure, l'originalité de son format et d'autre part par son texte et ses illustrations. Un beau moment de lecture qui enchantera les petits comme les grands.
Michaux (Henri) : La vie d’Henri Michaux (Namur, 24 mai 1899 – Paris, 19 octobre 1984), poète et peintre de génie d’origine belge, bascule lorsqu’il perd son épouse. La douleur de ce décès tragique ne cicatrisera jamais, et il portera le deuil jusqu’à sa propre mort. Mais c’est sans doute grâce à ce terrible événement que sa carrière bifurque vers des travaux de tous styles, emprunts de la véritable essence de l’âme tourmenté du veuf inconsolable. Mais déjà, avant cela, ses confrontations à l’Abîme étaient fréquentes et, depuis son enfance, on peut dire que Michaux aura avalé sa part de ténèbres.
Cet homme, qui deviendra un Maître dans ses domaines de prédilection, la poésie et la peinture, a connu une adolescence difficile, entre angoisse et dépressions. A cette époque, ses premiers travaux voient le jour, influencés sans aucun doute par ses plus jeunes années durant lesquelles il a connu les pensionnats et l’éducation à la dure des jésuites, mais surtout à la fréquentation des auteurs russes Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Tout en faisant ses premiers pas dans la littérature, il s’orientera vers la médecine pour l’abandonner assez vite, prenant la mer entre 1920 et 1921. C’est peu de temps après, en découvrant Lautréamont, qu’il se décide à se lancer corps et âme dans la littérature.
Durant les Années Folles, il arrive à Paris, une ville dont il tombera éperdument amoureux. Dès lors, il n’aura de cesse de renier tout ce qui le rattache à son pays natal et se considérera parisien. Même si, par la suite, il voyagera dans le monde entier, la capitale française restera son berceau. Il sera d’ailleurs, avec la plus grande fierté, naturalisé français en 1955. Aussi rédigera-t-il ses "Carnets de Voyages", réel ou fictifs, qui feront partie intégrale de son œuvre colossale, lancé par son éditeur et ami proche, Jacques-Olivier Fourcade. En plus de l’écriture, Henri Michaux commence à s’intéresser de plus en plus à l’art pictural dont il entamera des travaux, restés longtemps secrets.
C’est en 1948 que la vie de l’auteur prendra un tournant radical, suite au décès tragique de Marie-Louise Termet, son épouse, suite à d’atroces brûlures dues à un accident domestique. Michaux en rendra compte violemment avec l’écriture de "La Vie dans les Plis" (1949), l’un des textes les plus viscéraux qu’il aura écrit.
Suite à cet évènement, il se considèrera comme un mort en sursit et comme n’ayant plus rien à perdre, commencera les expériences littéraires sous l’influence des drogues, principalement la mescaline, le LSD et la psilocybine. Ces plongeons dans l’abîme des hallucinogènes commenceront tardivement, à l’âge de 55 ans, alors qu’il n’avait jamais touché auparavant aux produits stupéfiants, mis à part l’éther qu’il consomma plus jeune. Ces expériences psychédéliques renoueront Michaux et la médecine, principalement la psychiatrie, et donneront naissance à des travaux sous l’influence des drogues, avec l’assistance d’un médecin qui calculera les dosages avec précision. Il en ressortira des textes impressionnants, mélangés avec des dessins sur des carnets spécialement utilisés pour ce que l’auteur voulait comme des approches scientifiques des effets des substance et de la créativité littéraire et picturale pouvant en découler. Les toiles qu’il a laissé derrière lui sont autant de bijoux d’art atypique qui ne peuvent pas laisser indifférent. Notons certaines œuvres picturales significatives :
Henri MICHAUX "Têtes"
Henri MICHAUX "Clown"
Henri MICHAUX "Paysages"
Henri MICHAUX "Prince de la Nuit"
Henri MICHAUX "Dragon"
Henri MICHAUX "Combats"
Henri MICHAUX "Couché"
Henri MICHAUX "Parcours"
Henri MICHAUX "Description d’un trouble"
Henri MICHAUX "Arrachements"
Henri MICHAUX "Composition"
Henri MICHAUX "Frottage"
Henri MICHAUX "Mouvements"
Henri MICHAUX "Repos ans le Malheur"
Vers la fin de sa vie, Henri Michaux vivait en reclus et était perçu comme un personnage public fuyant son lectorat et la presse. Il meurt seul à Paris, sa ville d’enracinement, le 19 octobre 1984
La bibliographie de l’auteur étant colossale – 63 ouvrages dont 6 posthumes – on retiendra surtout ses recueils de textes poétiques modernes dont voici une liste non-exhaustive :
MICHAUX Henri "Connaissance par les Gouffres"
MICHAUX Henri "La Vie dans les Plis"
MICHAUX Henri "Epreuves, Exorcismes"
MICHAUX Henri "L’Infini turbulent"
MICHAUX Henri "Poteaux d’Angles"
MICHAUX Henri "L’Espace du Dedans"
MICHAUX Henri "La Nuit remue"
MICHAUX Henri "Plume"
MICHAUX Henri "Ecuador"
MICHAUX Henri "Lointain Intérieur"
Henri MICHAUX "Misérables miracles"
Ghislain GILBERTI
"Dictionnaire de l'Académie Nada"
Cet homme, qui deviendra un Maître dans ses domaines de prédilection, la poésie et la peinture, a connu une adolescence difficile, entre angoisse et dépressions. A cette époque, ses premiers travaux voient le jour, influencés sans aucun doute par ses plus jeunes années durant lesquelles il a connu les pensionnats et l’éducation à la dure des jésuites, mais surtout à la fréquentation des auteurs russes Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Tout en faisant ses premiers pas dans la littérature, il s’orientera vers la médecine pour l’abandonner assez vite, prenant la mer entre 1920 et 1921. C’est peu de temps après, en découvrant Lautréamont, qu’il se décide à se lancer corps et âme dans la littérature.
Durant les Années Folles, il arrive à Paris, une ville dont il tombera éperdument amoureux. Dès lors, il n’aura de cesse de renier tout ce qui le rattache à son pays natal et se considérera parisien. Même si, par la suite, il voyagera dans le monde entier, la capitale française restera son berceau. Il sera d’ailleurs, avec la plus grande fierté, naturalisé français en 1955. Aussi rédigera-t-il ses "Carnets de Voyages", réel ou fictifs, qui feront partie intégrale de son œuvre colossale, lancé par son éditeur et ami proche, Jacques-Olivier Fourcade. En plus de l’écriture, Henri Michaux commence à s’intéresser de plus en plus à l’art pictural dont il entamera des travaux, restés longtemps secrets.
C’est en 1948 que la vie de l’auteur prendra un tournant radical, suite au décès tragique de Marie-Louise Termet, son épouse, suite à d’atroces brûlures dues à un accident domestique. Michaux en rendra compte violemment avec l’écriture de "La Vie dans les Plis" (1949), l’un des textes les plus viscéraux qu’il aura écrit.
Suite à cet évènement, il se considèrera comme un mort en sursit et comme n’ayant plus rien à perdre, commencera les expériences littéraires sous l’influence des drogues, principalement la mescaline, le LSD et la psilocybine. Ces plongeons dans l’abîme des hallucinogènes commenceront tardivement, à l’âge de 55 ans, alors qu’il n’avait jamais touché auparavant aux produits stupéfiants, mis à part l’éther qu’il consomma plus jeune. Ces expériences psychédéliques renoueront Michaux et la médecine, principalement la psychiatrie, et donneront naissance à des travaux sous l’influence des drogues, avec l’assistance d’un médecin qui calculera les dosages avec précision. Il en ressortira des textes impressionnants, mélangés avec des dessins sur des carnets spécialement utilisés pour ce que l’auteur voulait comme des approches scientifiques des effets des substance et de la créativité littéraire et picturale pouvant en découler. Les toiles qu’il a laissé derrière lui sont autant de bijoux d’art atypique qui ne peuvent pas laisser indifférent. Notons certaines œuvres picturales significatives :
Henri MICHAUX "Têtes"
Henri MICHAUX "Clown"
Henri MICHAUX "Paysages"
Henri MICHAUX "Prince de la Nuit"
Henri MICHAUX "Dragon"
Henri MICHAUX "Combats"
Henri MICHAUX "Couché"
Henri MICHAUX "Parcours"
Henri MICHAUX "Description d’un trouble"
Henri MICHAUX "Arrachements"
Henri MICHAUX "Composition"
Henri MICHAUX "Frottage"
Henri MICHAUX "Mouvements"
Henri MICHAUX "Repos ans le Malheur"
Vers la fin de sa vie, Henri Michaux vivait en reclus et était perçu comme un personnage public fuyant son lectorat et la presse. Il meurt seul à Paris, sa ville d’enracinement, le 19 octobre 1984
La bibliographie de l’auteur étant colossale – 63 ouvrages dont 6 posthumes – on retiendra surtout ses recueils de textes poétiques modernes dont voici une liste non-exhaustive :
MICHAUX Henri "Connaissance par les Gouffres"
MICHAUX Henri "La Vie dans les Plis"
MICHAUX Henri "Epreuves, Exorcismes"
MICHAUX Henri "L’Infini turbulent"
MICHAUX Henri "Poteaux d’Angles"
MICHAUX Henri "L’Espace du Dedans"
MICHAUX Henri "La Nuit remue"
MICHAUX Henri "Plume"
MICHAUX Henri "Ecuador"
MICHAUX Henri "Lointain Intérieur"
Henri MICHAUX "Misérables miracles"
Ghislain GILBERTI
"Dictionnaire de l'Académie Nada"
Henri Michaux, l'existentiel (Namur, 24 mai 1899 – Paris, 19 octobre 1984)
Publié par Robert Paul le 10 Décembre 2009 à 12 30
Contemporain des surréalistes, Henri Michaux a cherché comme eux dans la poésie et dans l'art une aventure spirituelle comparable à certains égards à l'expérience mystique. Mais il se distingue nettement d'eux par le climat angoissé de son univers intérieur, par son esprit critique, sa curiosité intellectuelle, son refus de toute agitation tapageuse et de tout engagement idéologique. Il donne l'exemple de la plus grande liberté d'esprit dont un homme soit capable. Tenté, au début, de refuser la réalité pour s'évader dans l'imaginaire, il a finalement entrepris d'explorer le plus complètement possible, en tentant sur lui-même des expériences d'un caractère presque médical, le domaine mental de l'homme.
Qu'il s'agisse d'exprimer ses sentiments d'angoisse et de révolte, de raconter ses rêves, d'imaginer des histoires fantastiques, ou de rendre compte d'expériences psychologiques, Michaux le fait dans un style immédiatement reconnaissable et inimitable, sec, nerveux, haletant, saccadé, vibrant, qui traduit à la fois l'émotion et l'humour. Longtemps desservi par son originalité même, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands écrivains français. Il fut aussi un remarquable peintre, un des initiateurs du « tachisme » en France. L'évolution de son oeuvre graphique, depuis les figures monstrueuses du début jusqu'aux signes, aux taches et aux dessins « mescaliniens », sans être absolument liée à celle de son oeuvre littéraire, va dans le même sens : de l'angoisse paralysante à l'ivresse de la découverte.
De la révolte à l'aventure
Poète et peintre, Henri Michaux n'a quitté définitivement sa Belgique natale qu'à vingt-cinq ans et n'a été naturalisé français qu'à cinquante-cinq ans. Il est né le 24 mai 1899 à Namur dans une famille bourgeoise ardennaise et wallonne. Enfant et adolescent maladif, rêveur, révolté contre son milieu familial, il « boude la vie », existe « en marge », s'évade dans la lecture. Il découvre les mystiques. A vingt ans, refusant toute intégration sociale, il renonce à poursuivre ses études de médecine et s'embarque comme simple matelot. Au bout d'un an d'aventures maritimes, il revient à Bruxelles. Il semble être définitivement un « raté ».
La lecture de Lautréamont lui révèle sa vocation d'écrivain. Il débute par des essais et des textes poétiques en prose où l'imagination cocasse et le style percutant révèlent déjà sa profonde originalité. Venu à Paris, il se lie avec Jean Paulhan, qui est le premier à comprendre et à apprécier son génie. Son premier livre, Qui je fus , passe à peu près inaperçu. Un voyage en Amérique du Sud lui inspire Ecuador (1929) ; quelques années plus tard, il rapporte d'un grand voyage en Inde et en Chine un autre journal de bord, Un barbare en Asie (1932). Entre-temps, il a écrit ses premiers chefs-d'oeuvre : Mes Propriétés (1929) et Un certain Plume (1930, repris sous le titre de Plume en 1938), nom d'un personnage falot, éternelle victime des hommes et des événements, qui incarne l'angoisse de vivre.
Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, l'inspiration de Michaux s'approfondit. Il commence la description de ses pays imaginaires et il fixe les images du Lointain intérieur (1938). En même temps, il se consacre de plus en plus au dessin et à la peinture et commence à exposer des aquarelles et des gouaches aussi étranges, pour le grand public, que ses poèmes. La publication, en 1941, d'une conférence de Gide, Découvrons Henri Michaux , marque le début de la notoriété. Mais c'est seulement après 1955, au moment où il entreprend d'expérimenter sur lui-même les effets des drogues hallucinogènes, notamment de la mescaline, qu'il obtient la consécration définitive. Cependant, fidèle à sa vocation de poète réfractaire, jaloux de son autonomie, soucieux d'échapper à toutes les aliénations, même celle de la gloire, il refuse, en 1965, le grand prix national des Lettres.
L'espace du dedans
Michaux se désintéresse de ce qui est extérieur : paysages, objets, réalités économiques, relations sociales, devenir historique. Son regard plonge à l'intérieur de lui-même, dans ce domaine incirconscrit et obscur où naissent les pensées, les rêves, les images, les impressions fugitives, les pulsions. Aucun écrivain peut-être n'a jamais porté une telle attention aux mouvements les plus ténus de la vie intérieure. Il dit de l'art de Paul Klee, avec qui il a d'incontestables affinités, qu'il nous communique le sentiment d'être « avec l'âme même d'une chrysalide ».
Sa faculté maîtresse est l'imagination, mais une forme d'imagination qui refuse le pittoresque et la narration. Ce domaine de l'imaginaire, c'est ce qu'il appelle ses « propriétés ». Il est à la fois tout entier enclos dans son esprit et à la mesure de l'universel, puisqu'il est riche de « millions de possibles ». Ce que Michaux invente, ce n'est jamais une action, une intrigue (il n'est pas un conteur, même dans Plume ), mais des êtres et surtout des manières d'être. Au pays de la Magie ou dans celui des Meidosems (êtres filiformes et évanescents), il fait l'inventaire de nouvelles manières de vivre, d'aimer, de souffrir, de mourir.
L'imagination est source de trouble et d'angoisse, puisque c'est elle qui provoque les images obsédantes, sécrète les monstres, doue les objets et les êtres d'un pouvoir d'agression, fait du monde une perpétuelle menace pour le corps et la conscience de l'individu, également fragiles. Une grande partie de l'oeuvre de Michaux exprime la terreur d'être envahi par « les puissances environnantes du monde hostile ». Mais l'imagination, qui est une force de destruction du moi, est en même temps un instrument de défense et une force de restructuration. Toute une autre partie de l'oeuvre de Michaux montre les divers procédés d'« intervention » qui permettent au rêveur (endormi ou éveillé) de prendre sa revanche sur la réalité hostile, de corriger ou de compléter le monde dans le sens de ses plus secrets désirs. Dans cette perspective, la poésie et la peinture sont moins des moyens d'expression que des exorcismes.
La recherche de l'absolu
Michaux écrivait déjà dans son premier livre : « Je ne peux pas me reposer, ma vie est une insomnie [...]. Ne serait-ce pas la prudence qui me tient éveillé, car cherchant, cherchant et cherchant, c'est dans tout indifféremment que j'ai chance de trouver ce que je cherche puisque ce que je cherche je ne le sais. » Son entreprise consiste donc à tenter d'atteindre quelque chose qui se dérobe sans cesse et à quoi il ne lui est pas possible de renoncer sans que sa vie perde toute signification. Cette ferveur perpétuellement frustrée, ce « désir qui aboie dans le noir », les mouvements de ce « cerf-volant qui ne peut couper sa corde » définissent la situation spirituelle de l'homme contemporain, à qui sa pensée analytique et sa culture désacralisée ne permettent plus de « participer à l'Etre ». L'activité littéraire et artistique de Michaux, comme d'ailleurs toutes ses autres activités, est une « entreprise de salut ».
Dans sa jeunesse, la solution de la mystique chrétienne l'avait attiré. Plus tard, il a découvert la pensée de l'Inde et celle de la Chine, qui lui offrent des modèles et des techniques de méditation plus efficaces. Mais c'est finalement dans la poésie et dans l'art qu'il trouve la voie d'une réconciliation avec le monde et la vie. Il ne s'agit pas de trouver des solutions ou des réponses, mais de s'éveiller à la vraie vie, d'accéder au sens véritable du monde, qui est son mystère et son inépuisable nouveauté. Il faut retrouver l'esprit d'enfance : elle est l'« âge d'or des questions et c'est de réponses que l'homme meurt ». C'est encore à propos de Paul Klee que Michaux explique à quelles conditions l'art et la poésie permettent de dépasser la muraille de signes qui nous sépare du réel : « Il suffit d'avoir gardé la conscience de vivre dans un monde d'énigmes, auquel c'est en énigmes aussi qu'il convient le mieux de répondre. »
L'expérience de l'infini
Michaux avait jadis été tenté de recourir à la drogue (notamment l'éther) comme à un moyen de s'évader, de se retirer du monde, de vivre de l'autre côté. Plus tard, ce n'est plus l'évasion qu'il recherche, mais l'expérience. Il ne s'agit pas pour lui d'échapper à la condition humaine, mais d'en explorer toutes les possibilités. La drogue, qui donne des hallucinations et permet d'accéder à l'état second, est l'une des voies de l'aventure mentale dans laquelle le poète s'est engagé et qui consiste à « se parcourir », à faire l'« occupation progressive » de tout son être en exploitant toutes ses facultés.
La dernière partie de l'oeuvre de Michaux (depuis 1955) est consacrée à l'exploration de l'univers prodigieux que lui a révélé l'usage de drogues comme l'opium, le hachich, le L.S.D. et surtout la mescaline. Il montre que le drogué fait l'expérience de l'infini, mais aussi qu'il existe deux catégories, deux modalités de l'infini, dont l'une est le mal absolu et l'autre le bien absolu. Les titres des ouvrages qui décrivent les effets de la drogue : Misérable Miracle (1956), L'Infini turbulent (1957), Connaissance par les gouffres (1961), rendent compte du caractère essentiel de l'hallucination par le hachich ou de l'ivresse mescalinienne, qui est l'aliénation. Le drogué, comme le fou, est délogé de ses positions, chassé de lui-même, pris dans un « mécanisme d'infinité ». Avec la perception juste de son corps, il a « perdu sa demeure ». Il ne retrouve plus le « château de son être ». L'expérience de la folie mescalinienne enseigne à la fois que l'infini est l'ennemi de l'homme et que, pourtant, l'homme est vulnérable à l'infini, qu'il y est « poreux », parce que « ça lui rappelle quelque chose » et qu'il en vient. La finitude est conquise sur l'infini et la vie humaine normale est « une oasis », « une hernie de l'infini ».
Il existe pourtant une autre forme de l'infini, dont Michaux a fait parfois, d'une manière inattendue, l'expérience bouleversante : un infini non plus de désorganisation et de turbulence, mais de complétude, de transcendance, l'unité retrouvée. C'est l'extase, semblable à celle des mystiques, par laquelle il se sent « remis dans la circulation générale », « rentré au bercail de l'universel » et qui lui donne enfin accès à une « démesure qui est la vraie mesure de l'homme, de l'homme insoupçonné ».
Humour et poésie
L'originalité de l'art de Michaux, dans ses ouvrages littéraires comme dans ses peintures, tient à la fusion de deux éléments en apparence contradictoires, l'émotion et l'humour. D'un bout à l'autre de son oeuvre, il n'y a guère de phrase ou de trait qui n'exprime l'émotion la plus intense. Souffrance, terreur, ou au contraire ferveur, l'émotion se traduit par des images fulgurantes, des cris, des rythmes haletants, des répétitions. Mais l'émotion apparaît rarement à l'état brut, et Michaux, en règle générale, ne la prend pas entièrement au sérieux. Il y a chez lui un refus d'être dupe, un besoin d'observer et de comprendre qui établissent une distance entre lui et ses propres sentiments. Placé dans une situation difficile, il utilise l'humour comme un moyen de prendre du recul et de se protéger. Il ne s'agit pas de rire ou de faire rire, mais de neutraliser l'émotion, soit par un détail ou un tour saugrenu, soit par un flegme apparent. L'exemple d'humour le plus connu et le plus caractéristique de Michaux, c'est le personnage de Plume, à qui il arrive toutes sortes de mésaventures surprenantes sans que cela modifie jamais sa résignation attristée et sans qu'il ose intervenir pour détourner le cours du destin.
Que ce soit dans les récits de voyages réels ou imaginaires, dans les rêves de « vie plastique », où il invente la « mitrailleuse à gifles » ou la « fronde à hommes », dans les réflexions et les aphorismes sur les sujets les plus divers, le ton de Michaux unit presque toujours la gravité et la fantaisie, la tension et la désinvolture.
De toute manière, écrire (ou peindre) n'est jamais pour lui un acte gratuit ou un divertissement, mais une sorte d'épreuve ascétique : « Écrire, écrire : tuer, quoi. » Il crée, dit-il encore, « pour questionner, pour ausculter, pour approcher le problème d'être ». En cela, il incarne la tentation la plus forte de l'art contemporain et se rattache à la tradition des poètes voleurs de feu. Il est l'un de ceux qui ont le mieux pressenti ce que pourrait être une nouvelle culture, intégrant à la pensée occidentale des éléments empruntés à l'Orient, et une nouvelle mesure de l'homme, plus vaste que la nôtre.
Sagesse et contemplation
Un dernier massif est venu, dans la vieillesse, compléter l'oeuvre. Tout ce qui précédait se trouve repris et dépassé sur chacun des deux versants, dont l'un est tourné vers la sagesse, l'autre vers la contemplation.
On trouvait déjà, çà et là, dans les ouvrages de l'âge mûr, des aphorismes, qui étaient d'un moraliste. Poteaux d'angle est un recueil de préceptes que le poète s'adresse à lui-même ; et la sagesse qu'ils contiennent se situe au-delà de toute sagesse. Michaux se défend d'être un « gourou » : « Quoi qu'il arrive, ne te laisse jamais aller - faute suprême - à te croire maître, même pas un maître à mal penser. Il te reste beaucoup à faire, énormément, presque tout. La mort cueillera un fruit encore vert. »
Comment le poète réfractaire pourrait-il enseigner autre chose que la liberté ? Les principes de sa morale sont l'authenticité et l'autonomie : être soi, être à soi. Mais cela conduirait au blocage du moi si cette sagesse n'était pas aussi un mouvement d'ouverture au monde et d'élan vers l'inconnu. Comment conserver quelque chose du prodigieux foisonnement des possibles, sinon en gardant une totale disponibilité ? « Si tu ne t'es pas épaissi, si tu ne te crois pas devenu important..., alors peut-être l'Immense toujours là, le virtuel Infini se répandra de lui-même. »
Dans Face à ce qui se dérobe , Michaux décrivait la « survenue de la contemplation ». Elle ne peut naître que dans le silence. « Une fois repoussés les variations et ce qui nourrit les variations : les informations, les communications, le prurit de la communication... on retrouve la Permanence, son rayonnement, l'autre vie, la contre-vie. » Il est significatif que l'un de ses derniers textes soit la suite de poèmes intitulée Jours de Silence (recueillis dans Chemins cherchés, chemins perdus, transgressions ). Il ne décrit plus la contemplation mais la chante, la célèbre, avec la ferveur retrouvée des mystiques d'Occident et d'Orient.
Parallèlement au poète, parfois en discordance avec lui, le peintre Henri Michaux a connu lui aussi, dans sa vieillesse, l'accomplissement. Il a utilisé de nouvelles techniques pour jeter dans l'espace les lignes, les taches et les signes qui forment ce que Jean Grenier a appelé une « architecture de l'impermanence ». Plusieurs grandes expositions rétrospectives ont définitivement imposé cet art visionnaire, dont la profondeur est comparable à celle de l'oeuvre poétique.
Publié par Robert Paul le 10 Décembre 2009 à 12 30
Contemporain des surréalistes, Henri Michaux a cherché comme eux dans la poésie et dans l'art une aventure spirituelle comparable à certains égards à l'expérience mystique. Mais il se distingue nettement d'eux par le climat angoissé de son univers intérieur, par son esprit critique, sa curiosité intellectuelle, son refus de toute agitation tapageuse et de tout engagement idéologique. Il donne l'exemple de la plus grande liberté d'esprit dont un homme soit capable. Tenté, au début, de refuser la réalité pour s'évader dans l'imaginaire, il a finalement entrepris d'explorer le plus complètement possible, en tentant sur lui-même des expériences d'un caractère presque médical, le domaine mental de l'homme.
Qu'il s'agisse d'exprimer ses sentiments d'angoisse et de révolte, de raconter ses rêves, d'imaginer des histoires fantastiques, ou de rendre compte d'expériences psychologiques, Michaux le fait dans un style immédiatement reconnaissable et inimitable, sec, nerveux, haletant, saccadé, vibrant, qui traduit à la fois l'émotion et l'humour. Longtemps desservi par son originalité même, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands écrivains français. Il fut aussi un remarquable peintre, un des initiateurs du « tachisme » en France. L'évolution de son oeuvre graphique, depuis les figures monstrueuses du début jusqu'aux signes, aux taches et aux dessins « mescaliniens », sans être absolument liée à celle de son oeuvre littéraire, va dans le même sens : de l'angoisse paralysante à l'ivresse de la découverte.
De la révolte à l'aventure
Poète et peintre, Henri Michaux n'a quitté définitivement sa Belgique natale qu'à vingt-cinq ans et n'a été naturalisé français qu'à cinquante-cinq ans. Il est né le 24 mai 1899 à Namur dans une famille bourgeoise ardennaise et wallonne. Enfant et adolescent maladif, rêveur, révolté contre son milieu familial, il « boude la vie », existe « en marge », s'évade dans la lecture. Il découvre les mystiques. A vingt ans, refusant toute intégration sociale, il renonce à poursuivre ses études de médecine et s'embarque comme simple matelot. Au bout d'un an d'aventures maritimes, il revient à Bruxelles. Il semble être définitivement un « raté ».
La lecture de Lautréamont lui révèle sa vocation d'écrivain. Il débute par des essais et des textes poétiques en prose où l'imagination cocasse et le style percutant révèlent déjà sa profonde originalité. Venu à Paris, il se lie avec Jean Paulhan, qui est le premier à comprendre et à apprécier son génie. Son premier livre, Qui je fus , passe à peu près inaperçu. Un voyage en Amérique du Sud lui inspire Ecuador (1929) ; quelques années plus tard, il rapporte d'un grand voyage en Inde et en Chine un autre journal de bord, Un barbare en Asie (1932). Entre-temps, il a écrit ses premiers chefs-d'oeuvre : Mes Propriétés (1929) et Un certain Plume (1930, repris sous le titre de Plume en 1938), nom d'un personnage falot, éternelle victime des hommes et des événements, qui incarne l'angoisse de vivre.
Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, l'inspiration de Michaux s'approfondit. Il commence la description de ses pays imaginaires et il fixe les images du Lointain intérieur (1938). En même temps, il se consacre de plus en plus au dessin et à la peinture et commence à exposer des aquarelles et des gouaches aussi étranges, pour le grand public, que ses poèmes. La publication, en 1941, d'une conférence de Gide, Découvrons Henri Michaux , marque le début de la notoriété. Mais c'est seulement après 1955, au moment où il entreprend d'expérimenter sur lui-même les effets des drogues hallucinogènes, notamment de la mescaline, qu'il obtient la consécration définitive. Cependant, fidèle à sa vocation de poète réfractaire, jaloux de son autonomie, soucieux d'échapper à toutes les aliénations, même celle de la gloire, il refuse, en 1965, le grand prix national des Lettres.
L'espace du dedans
Michaux se désintéresse de ce qui est extérieur : paysages, objets, réalités économiques, relations sociales, devenir historique. Son regard plonge à l'intérieur de lui-même, dans ce domaine incirconscrit et obscur où naissent les pensées, les rêves, les images, les impressions fugitives, les pulsions. Aucun écrivain peut-être n'a jamais porté une telle attention aux mouvements les plus ténus de la vie intérieure. Il dit de l'art de Paul Klee, avec qui il a d'incontestables affinités, qu'il nous communique le sentiment d'être « avec l'âme même d'une chrysalide ».
Sa faculté maîtresse est l'imagination, mais une forme d'imagination qui refuse le pittoresque et la narration. Ce domaine de l'imaginaire, c'est ce qu'il appelle ses « propriétés ». Il est à la fois tout entier enclos dans son esprit et à la mesure de l'universel, puisqu'il est riche de « millions de possibles ». Ce que Michaux invente, ce n'est jamais une action, une intrigue (il n'est pas un conteur, même dans Plume ), mais des êtres et surtout des manières d'être. Au pays de la Magie ou dans celui des Meidosems (êtres filiformes et évanescents), il fait l'inventaire de nouvelles manières de vivre, d'aimer, de souffrir, de mourir.
L'imagination est source de trouble et d'angoisse, puisque c'est elle qui provoque les images obsédantes, sécrète les monstres, doue les objets et les êtres d'un pouvoir d'agression, fait du monde une perpétuelle menace pour le corps et la conscience de l'individu, également fragiles. Une grande partie de l'oeuvre de Michaux exprime la terreur d'être envahi par « les puissances environnantes du monde hostile ». Mais l'imagination, qui est une force de destruction du moi, est en même temps un instrument de défense et une force de restructuration. Toute une autre partie de l'oeuvre de Michaux montre les divers procédés d'« intervention » qui permettent au rêveur (endormi ou éveillé) de prendre sa revanche sur la réalité hostile, de corriger ou de compléter le monde dans le sens de ses plus secrets désirs. Dans cette perspective, la poésie et la peinture sont moins des moyens d'expression que des exorcismes.
La recherche de l'absolu
Michaux écrivait déjà dans son premier livre : « Je ne peux pas me reposer, ma vie est une insomnie [...]. Ne serait-ce pas la prudence qui me tient éveillé, car cherchant, cherchant et cherchant, c'est dans tout indifféremment que j'ai chance de trouver ce que je cherche puisque ce que je cherche je ne le sais. » Son entreprise consiste donc à tenter d'atteindre quelque chose qui se dérobe sans cesse et à quoi il ne lui est pas possible de renoncer sans que sa vie perde toute signification. Cette ferveur perpétuellement frustrée, ce « désir qui aboie dans le noir », les mouvements de ce « cerf-volant qui ne peut couper sa corde » définissent la situation spirituelle de l'homme contemporain, à qui sa pensée analytique et sa culture désacralisée ne permettent plus de « participer à l'Etre ». L'activité littéraire et artistique de Michaux, comme d'ailleurs toutes ses autres activités, est une « entreprise de salut ».
Dans sa jeunesse, la solution de la mystique chrétienne l'avait attiré. Plus tard, il a découvert la pensée de l'Inde et celle de la Chine, qui lui offrent des modèles et des techniques de méditation plus efficaces. Mais c'est finalement dans la poésie et dans l'art qu'il trouve la voie d'une réconciliation avec le monde et la vie. Il ne s'agit pas de trouver des solutions ou des réponses, mais de s'éveiller à la vraie vie, d'accéder au sens véritable du monde, qui est son mystère et son inépuisable nouveauté. Il faut retrouver l'esprit d'enfance : elle est l'« âge d'or des questions et c'est de réponses que l'homme meurt ». C'est encore à propos de Paul Klee que Michaux explique à quelles conditions l'art et la poésie permettent de dépasser la muraille de signes qui nous sépare du réel : « Il suffit d'avoir gardé la conscience de vivre dans un monde d'énigmes, auquel c'est en énigmes aussi qu'il convient le mieux de répondre. »
L'expérience de l'infini
Michaux avait jadis été tenté de recourir à la drogue (notamment l'éther) comme à un moyen de s'évader, de se retirer du monde, de vivre de l'autre côté. Plus tard, ce n'est plus l'évasion qu'il recherche, mais l'expérience. Il ne s'agit pas pour lui d'échapper à la condition humaine, mais d'en explorer toutes les possibilités. La drogue, qui donne des hallucinations et permet d'accéder à l'état second, est l'une des voies de l'aventure mentale dans laquelle le poète s'est engagé et qui consiste à « se parcourir », à faire l'« occupation progressive » de tout son être en exploitant toutes ses facultés.
La dernière partie de l'oeuvre de Michaux (depuis 1955) est consacrée à l'exploration de l'univers prodigieux que lui a révélé l'usage de drogues comme l'opium, le hachich, le L.S.D. et surtout la mescaline. Il montre que le drogué fait l'expérience de l'infini, mais aussi qu'il existe deux catégories, deux modalités de l'infini, dont l'une est le mal absolu et l'autre le bien absolu. Les titres des ouvrages qui décrivent les effets de la drogue : Misérable Miracle (1956), L'Infini turbulent (1957), Connaissance par les gouffres (1961), rendent compte du caractère essentiel de l'hallucination par le hachich ou de l'ivresse mescalinienne, qui est l'aliénation. Le drogué, comme le fou, est délogé de ses positions, chassé de lui-même, pris dans un « mécanisme d'infinité ». Avec la perception juste de son corps, il a « perdu sa demeure ». Il ne retrouve plus le « château de son être ». L'expérience de la folie mescalinienne enseigne à la fois que l'infini est l'ennemi de l'homme et que, pourtant, l'homme est vulnérable à l'infini, qu'il y est « poreux », parce que « ça lui rappelle quelque chose » et qu'il en vient. La finitude est conquise sur l'infini et la vie humaine normale est « une oasis », « une hernie de l'infini ».
Il existe pourtant une autre forme de l'infini, dont Michaux a fait parfois, d'une manière inattendue, l'expérience bouleversante : un infini non plus de désorganisation et de turbulence, mais de complétude, de transcendance, l'unité retrouvée. C'est l'extase, semblable à celle des mystiques, par laquelle il se sent « remis dans la circulation générale », « rentré au bercail de l'universel » et qui lui donne enfin accès à une « démesure qui est la vraie mesure de l'homme, de l'homme insoupçonné ».
Humour et poésie
L'originalité de l'art de Michaux, dans ses ouvrages littéraires comme dans ses peintures, tient à la fusion de deux éléments en apparence contradictoires, l'émotion et l'humour. D'un bout à l'autre de son oeuvre, il n'y a guère de phrase ou de trait qui n'exprime l'émotion la plus intense. Souffrance, terreur, ou au contraire ferveur, l'émotion se traduit par des images fulgurantes, des cris, des rythmes haletants, des répétitions. Mais l'émotion apparaît rarement à l'état brut, et Michaux, en règle générale, ne la prend pas entièrement au sérieux. Il y a chez lui un refus d'être dupe, un besoin d'observer et de comprendre qui établissent une distance entre lui et ses propres sentiments. Placé dans une situation difficile, il utilise l'humour comme un moyen de prendre du recul et de se protéger. Il ne s'agit pas de rire ou de faire rire, mais de neutraliser l'émotion, soit par un détail ou un tour saugrenu, soit par un flegme apparent. L'exemple d'humour le plus connu et le plus caractéristique de Michaux, c'est le personnage de Plume, à qui il arrive toutes sortes de mésaventures surprenantes sans que cela modifie jamais sa résignation attristée et sans qu'il ose intervenir pour détourner le cours du destin.
Que ce soit dans les récits de voyages réels ou imaginaires, dans les rêves de « vie plastique », où il invente la « mitrailleuse à gifles » ou la « fronde à hommes », dans les réflexions et les aphorismes sur les sujets les plus divers, le ton de Michaux unit presque toujours la gravité et la fantaisie, la tension et la désinvolture.
De toute manière, écrire (ou peindre) n'est jamais pour lui un acte gratuit ou un divertissement, mais une sorte d'épreuve ascétique : « Écrire, écrire : tuer, quoi. » Il crée, dit-il encore, « pour questionner, pour ausculter, pour approcher le problème d'être ». En cela, il incarne la tentation la plus forte de l'art contemporain et se rattache à la tradition des poètes voleurs de feu. Il est l'un de ceux qui ont le mieux pressenti ce que pourrait être une nouvelle culture, intégrant à la pensée occidentale des éléments empruntés à l'Orient, et une nouvelle mesure de l'homme, plus vaste que la nôtre.
Sagesse et contemplation
Un dernier massif est venu, dans la vieillesse, compléter l'oeuvre. Tout ce qui précédait se trouve repris et dépassé sur chacun des deux versants, dont l'un est tourné vers la sagesse, l'autre vers la contemplation.
On trouvait déjà, çà et là, dans les ouvrages de l'âge mûr, des aphorismes, qui étaient d'un moraliste. Poteaux d'angle est un recueil de préceptes que le poète s'adresse à lui-même ; et la sagesse qu'ils contiennent se situe au-delà de toute sagesse. Michaux se défend d'être un « gourou » : « Quoi qu'il arrive, ne te laisse jamais aller - faute suprême - à te croire maître, même pas un maître à mal penser. Il te reste beaucoup à faire, énormément, presque tout. La mort cueillera un fruit encore vert. »
Comment le poète réfractaire pourrait-il enseigner autre chose que la liberté ? Les principes de sa morale sont l'authenticité et l'autonomie : être soi, être à soi. Mais cela conduirait au blocage du moi si cette sagesse n'était pas aussi un mouvement d'ouverture au monde et d'élan vers l'inconnu. Comment conserver quelque chose du prodigieux foisonnement des possibles, sinon en gardant une totale disponibilité ? « Si tu ne t'es pas épaissi, si tu ne te crois pas devenu important..., alors peut-être l'Immense toujours là, le virtuel Infini se répandra de lui-même. »
Dans Face à ce qui se dérobe , Michaux décrivait la « survenue de la contemplation ». Elle ne peut naître que dans le silence. « Une fois repoussés les variations et ce qui nourrit les variations : les informations, les communications, le prurit de la communication... on retrouve la Permanence, son rayonnement, l'autre vie, la contre-vie. » Il est significatif que l'un de ses derniers textes soit la suite de poèmes intitulée Jours de Silence (recueillis dans Chemins cherchés, chemins perdus, transgressions ). Il ne décrit plus la contemplation mais la chante, la célèbre, avec la ferveur retrouvée des mystiques d'Occident et d'Orient.
Parallèlement au poète, parfois en discordance avec lui, le peintre Henri Michaux a connu lui aussi, dans sa vieillesse, l'accomplissement. Il a utilisé de nouvelles techniques pour jeter dans l'espace les lignes, les taches et les signes qui forment ce que Jean Grenier a appelé une « architecture de l'impermanence ». Plusieurs grandes expositions rétrospectives ont définitivement imposé cet art visionnaire, dont la profondeur est comparable à celle de l'oeuvre poétique.
un livre de chevet pour moi (encore un).
j'ai du lire prés de 1000 fois "mon roi"
j'ai du lire prés de 1000 fois "mon roi"
Une poésie ou une teinte de surréalisme se mélange à la réalité nue de la vie. Une gouache de couleurs et ces couleurs sont à notre appréciation. Si on préfère le noir, il dominera ; si on préfère le rouge, le jaune ou l'indigo, notre œil les percevra en premier. Une ironie douce (mais est-ce vraiment cela ?) parcoure certaines lignes. Ou un humour un peu froid, un peu noir ? J'ai laissé Henri Michaux de côté pendant longtemps. Je m'étais trop ennuyée à l'étudier. Mais je me suis toujours méfiée de mes ennuis pédagogiques.... J'ai redécouvert Henri Michaux, comme on se remet d'une indigestion après une diète salutaire. Un petit morceau de temps en temps comme toujours en poésie, on savoure lentement pour s'imprégner du goût et qu'il reste dans notre mémoire sensitive....
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Henri Michaux
Quiz
Voir plus
Oyez le parler médiéval !
Un destrier...
une catapulte
un cheval de bataille
un étendard
10 questions
1581 lecteurs ont répondu
Thèmes :
moyen-âge
, vocabulaire
, littérature
, culture générale
, challenge
, définitions
, histoireCréer un quiz sur cet auteur1581 lecteurs ont répondu