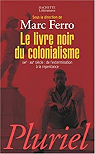Nationalité : France
Né(e) à : Paris , le 24/12/1924
Mort(e) à : Saint-Germain-en-Laye , le 21/04/2021
Né(e) à : Paris , le 24/12/1924
Mort(e) à : Saint-Germain-en-Laye , le 21/04/2021
Biographie :
Marc Ferro est un historien français, spécialiste de la Russie, de l'URSS et de l'histoire du cinéma.
Ayant quitté Paris en 1941, il prépare le certificat d'histoire-géographie à la faculté de Grenoble. Âgé de 20 ans en 1944, il est sous la menace d'une réquisition par le Service du travail obligatoire (STO). Après l'arrestation de plusieurs membres de son réseau, il participe à la Résistance dans le maquis du Vercors. Sa capacité à lire les cartes d'état-major décide de son affectation. Il reçoit pour mission de pointer avec précision sur les cartes les mouvements des forces en présence.
Après la guerre, il enseigne en Algérie. Bien que très attaché à cette terre, il la quitte pour devenir professeur à Paris et se spécialiser au début des années 1960 dans l'histoire soviétique (sa thèse de doctorat porte sur la Révolution russe de 1917), domaine dans lequel il a tenté de porter un discours non idéologique. Ses études dans le domaine de l'histoire sociale tranchent avec les analyses alors dominantes de l'"école" du totalitarisme.
Après avoir enseigné à l’École polytechnique, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (groupe de recherches Cinéma et Histoire), président de l'Association pour la recherche à l'EHESS et codirecteur des Annales, où il est nommé par Fernand Braudel en 1970. Ancien directeur de l'Institut du monde soviétique et de l'Europe centrale, il est Docteur honoris causa de l’université de Moscou depuis 1999.
Marc Ferro a lancé la réflexion sur le cinéma et l'histoire. Il utilise le cinéma comme instrument de connaissance de l'histoire des sociétés, considérant que le cinéma livre un témoignage au même titre que des sources traditionnelles.
Il a présenté à la télévision, d'abord sur la Sept à partir de 1989, puis sur Arte à partir de 1992, une émission historique de visionnage d'archives avec un décalage de 50 ans, nommée "Histoire parallèle".
+ Voir plusMarc Ferro est un historien français, spécialiste de la Russie, de l'URSS et de l'histoire du cinéma.
Ayant quitté Paris en 1941, il prépare le certificat d'histoire-géographie à la faculté de Grenoble. Âgé de 20 ans en 1944, il est sous la menace d'une réquisition par le Service du travail obligatoire (STO). Après l'arrestation de plusieurs membres de son réseau, il participe à la Résistance dans le maquis du Vercors. Sa capacité à lire les cartes d'état-major décide de son affectation. Il reçoit pour mission de pointer avec précision sur les cartes les mouvements des forces en présence.
Après la guerre, il enseigne en Algérie. Bien que très attaché à cette terre, il la quitte pour devenir professeur à Paris et se spécialiser au début des années 1960 dans l'histoire soviétique (sa thèse de doctorat porte sur la Révolution russe de 1917), domaine dans lequel il a tenté de porter un discours non idéologique. Ses études dans le domaine de l'histoire sociale tranchent avec les analyses alors dominantes de l'"école" du totalitarisme.
Après avoir enseigné à l’École polytechnique, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (groupe de recherches Cinéma et Histoire), président de l'Association pour la recherche à l'EHESS et codirecteur des Annales, où il est nommé par Fernand Braudel en 1970. Ancien directeur de l'Institut du monde soviétique et de l'Europe centrale, il est Docteur honoris causa de l’université de Moscou depuis 1999.
Marc Ferro a lancé la réflexion sur le cinéma et l'histoire. Il utilise le cinéma comme instrument de connaissance de l'histoire des sociétés, considérant que le cinéma livre un témoignage au même titre que des sources traditionnelles.
Il a présenté à la télévision, d'abord sur la Sept à partir de 1989, puis sur Arte à partir de 1992, une émission historique de visionnage d'archives avec un décalage de 50 ans, nommée "Histoire parallèle".
Source : Wikipedia
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (21)
Voir plusAjouter une vidéo
#histoire #cinéma #CulturePrime L'historien Marc Ferro est mort à l'âge de 96 ans. Ce féru de cinéma a oeuvré toute sa vie à replacer l'image au coeur du récit historique. Écoutez-le raconter ses deux passions en 1977. Abonnez-vous pour retrouver toutes nos vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCd5DKToXYTKAQ6khzewww2g/?sub_confirmation=1 Et retrouvez-nous sur... Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture
Citations et extraits (94)
Voir plus
Ajouter une citation
Quinze ans plus tard, je faisais une conférence à l'université d'Irkoutsk, en Sibérie, quand un étudiant m'interpella sur la différence d'interprétation des journées de juillet entre mon livre de 1967 et celui de 1976. Pris de court, je bottais en touche et lui répondais que je ne comprenais pas comment il pouvait me poser pareille question puisque mes deux livres étaient interdits de lecture en URSS.
"Mais vous connaissez bien notre système bureaucratique, continua-t-il. Si effectivement vous figurez sur la liste des historiens français interdits, vous ne figurez pas sur la liste des auteurs anglais interdits, or vos ouvrages ont été traduits en anglais..."
"Mais vous connaissez bien notre système bureaucratique, continua-t-il. Si effectivement vous figurez sur la liste des historiens français interdits, vous ne figurez pas sur la liste des auteurs anglais interdits, or vos ouvrages ont été traduits en anglais..."
Tout ceci alimentera une forme d'antiféminisme qui se traduire beaucoup plus tard par l'appel au retour des "vraies valeurs" du régime de Vichy : le travail, la famille, la patrie. Les anciens combattants avaient le sentiment que leur famille, les femmes surtout, les avait trahi.
Seules la prise en compte effective des nouvelles forces – les médias, la science, la finance internationale – et la construction de l’Europe peuvent poser les problèmes dont l’enjeu est à la hauteur de ceux des époques révolues. Mais à condition aussi que se régénèrent des circuits plus effectifs entre le pays réel – avec ses communes, ses cantons, ses associations et autres institutions de la société civile – et une représentation nationale qui, politiquement, donne volontiers l’impression de faire chambre à part.
Une réaction se dessinait cependant face à la bolchevisation (de la Russie). Elle avait pris forme bien avant Octobre, pouvant ainsi organiser la résistance dès le lendemain du coup d'état. Ses traits présentait quelques similitudes avec ceux du modèle fasciste qui se constituait en Italie et apparaîtrait bientôt en Allemagne (1) : réaction de défense contre la révolution sociale, rôle initiateur du grand capital, action des militaires et de l’Église, mise en cause de la lutte des classes, appel à la solidarité virile des combattants, recours à des groupes d'actions spéciaux, dénonciation de la faiblesse du gouvernements (avant Octobre), apparition d'hommes nouveaux – tels d'anciens révolutionnaires ralliés aux nationalistes et au culte du chef –, mais aussi antisémitisme, utilisation de la violence contre les organisations démocratiques …, sympathie et intervention active des gouvernements alliés.
(1) En 1919, Cyrille Romanov subventionne des groupes auxquels Hitler était lié.
2346 – [Texto, p. 48]
(1) En 1919, Cyrille Romanov subventionne des groupes auxquels Hitler était lié.
2346 – [Texto, p. 48]
Les chantres de la théorie totalitaire n'avaient pas vu que si les structures politiques de l'URSS n' ont guère changé depuis les années 1920, la structure de l'appareil d’État s'est transformée. Une nouvelle génération a peu à peu pris la relève des classes populaires qui l'avaient envahi précédemment. Ces jeunes bénéficiaient d'une éducation scientifique et technique développée, ce qui a eu pour effet de la "déplébéianiser". Ainsi, vers 1975-1980, seuls 20 % d'ouvriers participent à l'appareil d’État où ils ne rédigent que 6 % des rapports. Les autres, dans leur grande majorité, sont élaborés par des ingénieurs, des techniciens et des scientifiques divers. Ils développent leur savoir dans le cadre du système en critiquant le fonctionnement mais sans en bouleverser le principe, puisqu'ils en font eux-mêmes partie. On les a retrouvés ensuite économistes, écologistes, etc. Ils sont les premiers à remettre en cause l"incompétence" à gérer les affaires du parti en tant que tel. Ce son souvent des hommes du KGB qu'on retrouvera ensuite.Le KGB n'avait pas seulement des activités criminelles ou d'espionnage comme on se plaît à le répéter à l'Ouest, mais constituait une sorte d'"ENA" de la Russie. Andropov, parrain de la réforme en URSS, avait plus ou moins repéré ce décalage entre le blocage politique et l'autonomie du social.
Que va-t-on vendre ici ? demande ainsi un passant au premier quidam d'une longue file.
- Je ne sais pas, répond l'autre, adossé à une porte cochère. J'étais fatigué, j'ai pris appui sur la porte et me suis un peu assoupi, et une file s'est formée derrière moi.
- Il n'y a rien à vendre ? Mais alors, vous pouvez partir.
- Oh non ! Vous ne savez pas le bonheur d'être le premier de la file. Je reste !
- Je ne sais pas, répond l'autre, adossé à une porte cochère. J'étais fatigué, j'ai pris appui sur la porte et me suis un peu assoupi, et une file s'est formée derrière moi.
- Il n'y a rien à vendre ? Mais alors, vous pouvez partir.
- Oh non ! Vous ne savez pas le bonheur d'être le premier de la file. Je reste !
Ce voyage dans l'espace est aussi naturellement un voyage dans le temps. Il a la particularité de réfracter du passé des images mouvantes. Non seulement ce passé n'est pas le même pour tous, mais, pour chacun, son souvenir se modifie avec le temps : ces images changent à mesure que se transforment les savoirs, les idéologies, à mesure que change, dans les sociétés, la fonction de l'histoire.
Le personnage symbolisant la liberté, la droiture, de hongrois était passé tchèque; celui qui (du fait surtout de Carol Reed) trahit son ami et manque de caractère, se trouve être un Américain. Or, dans le scénario, il était anglais. Un changement qui n'est pas aussi innocemment lié à un changement dans le choix de l'acteur, qui à l'origine ne devait pas être Joseph Cotten. La transformation apparaît tout aussi significative pour Holly, car aucun des traits négatifs ne figurait dans le scénario: maladroit, inattentif, confondant Calloway et Callagham, Winckel et Vinkel, trahissant ainsi qu'il vient d'un pays où on ne reconnaît plus un Anglais d'un Irlandais, un Autrichien d'un Prussien, commettant gaffes et balourdises; bref, se comportant, pour un Anglais, comme un Américain pendant la Seconde Guerre Mondiale: agité, naïf, devant être guidé, confondant police et police militaire, monde "libre" et monde "communiste"; comme si la police des premiers ne pourchassait pas le crime, ces crimes que commettent les soviétiques, alliés forcés, avec qui néanmoins il faut bien s'entendre, tout en restant vigilant, plus que les Américains à Yalta.
( Chapitre "Un combat dans "Le troisième homme"
( Chapitre "Un combat dans "Le troisième homme"
Tandis que de gré ou de force, les métropoles devaient abandonner partie ou totalité de leurs colonies, leurs dirigeants économiques et politiques ont constitué une Union économique européenne, et ont fait appel à l'armée industrielle du tiers-monde pour réduire leurs coûts de production, contrecarrer et contourner les revendications de leurs salariés. Dans les anciennes métropoles s'est ainsi créée une situation de type colonial: Maghrébins, Caraïbes, Indiens et Pakistanais se sont retrouvés en Europe et ailleurs accomplissant des tâches dont les Européens ne voulaient plus, et cette population de travailleurs immigrés, longtemps temporaire, s'est, avec le regroupement familial, enracinée dans les pays d'accueil.
[Nicolas II] :
Lorsqu'il succéda à son père Alexandre III, en 1894, il avait certes bénéficié d'une éducation princière, mais il ne connaissait rien au métier de roi. Commander, agir, prendre des décisions ne l'intéressait pas, lui qui était passionné par la chasse -il était intarissable à ce sujet -, les parades militaires, les ballets... et les ballerines.
"Ce n'est qu'un enfant", disait de lui le tsar Alexandre III lorsqu'on avait voulu confier à son fils la présidence des chemins de fer d'Extrème-Orient. Et lorsqu'il apprit à l'âge de 26 ans qu'il allait rêgner, Nicolas éclata en sanglots.
Lorsqu'il succéda à son père Alexandre III, en 1894, il avait certes bénéficié d'une éducation princière, mais il ne connaissait rien au métier de roi. Commander, agir, prendre des décisions ne l'intéressait pas, lui qui était passionné par la chasse -il était intarissable à ce sujet -, les parades militaires, les ballets... et les ballerines.
"Ce n'est qu'un enfant", disait de lui le tsar Alexandre III lorsqu'on avait voulu confier à son fils la présidence des chemins de fer d'Extrème-Orient. Et lorsqu'il apprit à l'âge de 26 ans qu'il allait rêgner, Nicolas éclata en sanglots.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Marc Ferro
Lecteurs de Marc Ferro (608)Voir plus
Quiz
Voir plus
On entend les noms d'écrivaines et d'écrivains
Elle correspondit sans discontinuer avec Madame Bovary à partir de 1863.
George
Louise
Mathilde
Pauline
12 questions
115 lecteurs ont répondu
Thèmes :
Écrivains français
, 19ème siècle
, 20ème siècle
, 21ème siècleCréer un quiz sur cet auteur115 lecteurs ont répondu