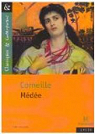Critiques de Pierre Corneille (520)
Aujourd'hui, je prends le risque — et ce n'est pas si fréquent —, je prends le risque, disais-je, de m'en venir vous parler d'une toute fraîche nouveauté, d'un colis posé encore tout fumant sur les étals et sur lequel personne, à ma connaissance, n'a encore levé le voile. C'est courageux, vous noterez…
C'est encore un peu tôt puisque nul n'en a, à ce jour, beaucoup entendu parler, mais je me hasarde à prédire à cette tragi-comédie en cinq actes un petit succès temporaire, une gloire éphémère voire une mode provisoire, le temps de quelques soirs. Il se pourrait même trouver des gens, une ou deux par ci par là, pour venir la voir et l'applaudir hors de nos frontières, mais là je m'avance sans doute un peu trop.
Trêve de plaisanterie, c'est sérieux la critique, passons vite à la pièce. Car s'il est un chef-d'oeuvre en ce monde, si ce mot n'est pas totalement vide de sens, s'il recouvre bien une réalité discernable, à quelle oeuvre mieux qu'à celle-ci s'appliquerait-il davantage ?
Le Cid, le fantastique Cid. Tu es mon élu, Cid, je reste collée à toi comme à une glu, Cid, je ne suis plus moi depuis que je t'ai lu, Cid, à chacun de mes pas tu me suis, Cid. Oui, le Cid ou la quintessence de la traduction. Car on peut disserter sans limite sur les mille et une façons de traduire ou de ne pas traduire telle ou telle oeuvre du domaine étranger. En l'occurrence ici, comment traduire en français une pièce en vers du siècle d'or espagnol ?
Et voilà qu'intervient le génie de Pierre Corneille car, mieux que traduire, il y a transcrire. Et c'est ce qu'a réussi avec succès Molière avec son Dom Juan, transcrit de Tirso de Molina ; Jean Racine avec ses Plaideurs, transcrit d'Aristophane ou, plus récemment, Antonin Artaud avec le Moine, transcrit de Lewis ou encore Les Possédés d'Albert Camus, transcrit de Dostoïevski.
À l'heure actuelle, les auteurs n'osent plus trop ; on veut des traductions qui collent parfaitement (comme si c'était possible !) à la matrice dont elles sont issues, et l'on est déçu, fatalement, car c'est une gageure ; alors on critique le traducteur ou l'on souligne l'incomparable valeur de l'original face à l'oeuvre traduite.
C'est une tendance actuelle mais qui évoluera peut-être, du moins l'espère-je. (C'est joli, n'est-ce pas, ce pied d'espère-je que je laisse pousser comme une mauvaise herbe au milieu de mes phrases, vous ne trouvez pas ?) On sait aussi qu'on a, depuis quelques années, quasiment laissé tomber la VF dans le cinéma ou les séries télévisées, alors même que c'était la VF de qualité qui pouvait transcender des films ou des séries pas nécessairement géniaux par ailleurs. (Je pense notamment à Starsky et Hutch, Amicalement Vôtre ou même Goldorak dont la VF est considérée comme très supérieure à la VO.)
Eh bien dans ce registre de la transcription, le maître incontesté, celui qui a laissé à jamais sa patte, c'est indéniablement le Cid de Corneille, transcrit de Guillén de Castro.
L'original, malheureusement et incompréhensiblement trop peu connu, était déjà très bon. Mais la transcription française de Pierre Corneille est un pur joyau, l'un des plus hauts degrés jamais atteints par un texte en français, une langue d'une beauté, d'une musique et d'un rythme à tomber en pâmoison. La seule chose d'ailleurs que j'aurais à lui reprocher, c'est justement de trop souvent omettre de préciser qu'elle est une transcription de l'espagnol et non une création originale depuis la page blanche.
Permettez-moi de revenir quelques instants sur les origines espagnoles de ce chef-d'oeuvre. Guillén de Castro y Bellvis écrit entre 1605 et 1615 Las Mocedades del Cid, littéralement La Jeunesse du Cid, une pièce à caractère autant historique que légendaire à propos du personnage réel de Rodrigo Díaz de Vivar. Celui-ci a réellement existé au XIème siècle et il est une figure importante du Moyen Âge espagnol, notamment de la Reconquista. Ce surnom de « cid », altération de l'arabe « seyid » et signifiant seigneur lui fut attribué par les Maures eux-mêmes suite à de nombreuses défaites qu'il leur infligea. Cette pièce était normalement suivie d'une seconde, intitulée Las Hazañas del Cid qu'on traduirait en français comme Les Exploits du Cid.
La première pièce de Guillén de Castro est particulièrement réussie et figure en bonne place dans cet ensemble que l'on nomme " le Siècle D'Or " espagnol et je comprends aisément qu'elle ait très favorablement impressionné l'ami Pierre Corneille, car j'avoue que moi-même, quand je l'ai lue, j'y ai pris grand plaisir. Même certaines figures de style du texte francophone, passées depuis lors à la postérité telle la fameuse litote : « Va, je ne te hais point. » ou des chiasmes savoureux sont eux aussi déjà présents dans le texte initial.
Donc, la tâche était difficile pour se hisser à la hauteur d'une telle dramaturgie, d'un tel texte de base. Mais c'est pourtant ce qui a dû galvaniser notre noir volatile normand car jamais je crois, il n'a atteint lui-même un tel niveau de perfection stylistique. On ne compte plus les vers ou les tirades qui ont désormais quasiment valeur de proverbes. Permettez-moi juste de vous en citer quelques uns :
Vers 434 : À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Vers 406 : La valeur n'attend point le nombre des années.
Vers 236 : Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
Vers 81 : L'amour est un tyran qui n'épargne personne.
Vers 393 : Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces.
Vers 410 : Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.
Vers 963 : Va, je ne te hais point.
Vers 290 : Va, cours, vole, et nous venge.
Etc., etc., etc.
Maintenant examinons quelle en est l'intrigue. C'est l'archétype du choix dit " cornélien" mais qui en fait, comme je viens de vous le dire, n'a rien de Corneille mais fut livré tel quel par de Castro y Bellvis mais dont l'auteur a perçu la richesse et qu'il resservira, entre autre, dès sa tragédie suivante, Horace.
Don Rodrigue aime Chimène et Chimène aime Don Rodrigue. Jusqu'ici tout va bien. Don Rodrigue est le fils de l'illustre Don Diègue, un vaillant guerrier qui a beaucoup fait pour le roi de Castille, du temps de sa jeunesse mais qui commence à accuser quelque peu le poids des ans. Chimène quant à elle est la fille de l'actuel plus grand guerrier du royaume, un certain Comte de Gormas, comparable par sa fougue et sa vaillance au vénérable Don Diègue mais dans la force de l'âge, pour sa part.
Et ces deux hommes, d'accords sur le principe du mariage de leur progéniture respective, sont pourtant si bouffis d'orgueil l'un et l'autre que lorsque Don Diègue reçoit un privilège du roi, le Comte s'en offusque car il considère que c'est lui qui mérite cet honneur, un peu à la manière d'Ajax qui devint fou de voir les armes d'Achille attribuées à Ulysse plutôt qu'à lui après tout ce qu'il avait fait lors du siège de Troie.
Si bien que le Comte de Gormas donne une claque à Don Diègue, pour bien lui signifier son mépris. le vieux soldat aimerait bien dégainer son épée mais il n'a plus la force de soutenir un combat face au géant lion de Gormas. Son honneur est meurtri comme jamais, c'est la honte, c'est la mort que seul un juste châtiment peut laver.
C'est donc à son fils, Don Rodrigue qu'il demande de laver l'affront fait à son grand âge et à sa valeur d'autrefois. Rodrigue, la mort dans l'âme, car il sait ce qu'il lui en coûtera, accepte de défier l'ombrageux guerrier père de Chimène. Et contre toute attente, c'est lui qui terrasse le plus grand guerrier du roi de sorte que l'honneur de son père est rétabli mais, du même coup, il voit son amour lui filer entre les doigts.
En effet, comment Chimène pourrait-elle aimer et épouser celui qui a transpercé le coeur de son père ? Mais en même temps, se venger de lui, c'est tuer son véritable amour. Faut-il ajouter une mort atroce sur une mort horrible ? Dans un cas comme dans l'autre, elle y perd quelque chose, soit l'honneur, soit l'amour, soit les deux. Chimène sera-t-elle comme le Héron jamais satisfait De La Fontaine ? Que choisir ? (ou 60 millions de Lecteurs consommateurs)...
Outre la merveille de l'écriture, outre la valeur de l'intrigue, outre le cachet d'une époque, outre tout ce qui fait de cette pièce un vibrant chef-d'oeuvre, permettez-moi encore d'aborder deux autres points qui font écho au théâtre espagnol de ce fameux siècle d'or.
En effet, le Cid, c'est aussi une réflexion sur la tragédie de l'âge. On se doute que Don Diègue, lui qui fut si fort, lui qui fut si grand est humilié de ne pouvoir répondre seul aux fanfaronnades du Comte. Être obligé d'aller quémander l'aide de vos enfants parce que votre bras tremble et que vos jambes sont débiles, comme c'est dégradant.
C'est pourtant la tragédie ordinaire que vivent nombre de personnes âgées qui se découvrent un jour, l'ombre d'elles-mêmes. Souvent, elles n'ont pas trop vu cela venir, car cela s'est fait très progressivement, mais un jour on prend conscience, et ce jour-là on pleure. Ce thème fut repris par Tirso de Molina dans son célèbre Abuseur de Séville avec le personnage du Commandeur trucidé par Don Juan dont il ne respecte pas même le tombeau.
Enfin, je voudrais en terminer en évoquant un personnage délicieusement ambigu, à savoir, l'infante Doña Urraque, secrètement folle amoureuse de Rodrigue et donc jalouse de Chimène. On se dit qu'elle est capable de faire capoter le mariage, non pas pour elle-même, puisque son statut lui interdit une union avec quelqu'un d'aussi modestement élevé socialement que Rodrigue, mais juste pour ne pas qu'une autre puisse jouir du loisir de partager la vie de celui qu'elle aime.
C'est exactement le thème d'une pièce tout à fait contemporaine de L'Enfance du Cid, intitulée le Chien du Jardinier de Lope de Vega. Lequel chien du jardinier, comme dit la fable d'Ésope, « ne mange pas de chou et ne permet pas qu'on en mange »... Mais je m'aperçois que cet avis est déjà beaucoup plus long que je ne l'avais déCIDé, il a poussé mieux qu'une mauvaise herbe sans herbiCID alors que manifestement, il ne signifie pas grand-chose face à ce texte géant que rien n'oxCID.
P. S. : le fameux vers 434 (À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.) est très vraisemblablement lui aussi un emprunt, à Sénèque cette fois, qui dans son de Providentia avait fait dire à un gladiateur fâché d'avoir à combattre trop faible partie : « Eum sine gloria vinci qui sine periculo vincitur. » Preuve encore, s'il en était besoin, du remarquable talent de transcripteur de Pierre Corneille.
C'est encore un peu tôt puisque nul n'en a, à ce jour, beaucoup entendu parler, mais je me hasarde à prédire à cette tragi-comédie en cinq actes un petit succès temporaire, une gloire éphémère voire une mode provisoire, le temps de quelques soirs. Il se pourrait même trouver des gens, une ou deux par ci par là, pour venir la voir et l'applaudir hors de nos frontières, mais là je m'avance sans doute un peu trop.
Trêve de plaisanterie, c'est sérieux la critique, passons vite à la pièce. Car s'il est un chef-d'oeuvre en ce monde, si ce mot n'est pas totalement vide de sens, s'il recouvre bien une réalité discernable, à quelle oeuvre mieux qu'à celle-ci s'appliquerait-il davantage ?
Le Cid, le fantastique Cid. Tu es mon élu, Cid, je reste collée à toi comme à une glu, Cid, je ne suis plus moi depuis que je t'ai lu, Cid, à chacun de mes pas tu me suis, Cid. Oui, le Cid ou la quintessence de la traduction. Car on peut disserter sans limite sur les mille et une façons de traduire ou de ne pas traduire telle ou telle oeuvre du domaine étranger. En l'occurrence ici, comment traduire en français une pièce en vers du siècle d'or espagnol ?
Et voilà qu'intervient le génie de Pierre Corneille car, mieux que traduire, il y a transcrire. Et c'est ce qu'a réussi avec succès Molière avec son Dom Juan, transcrit de Tirso de Molina ; Jean Racine avec ses Plaideurs, transcrit d'Aristophane ou, plus récemment, Antonin Artaud avec le Moine, transcrit de Lewis ou encore Les Possédés d'Albert Camus, transcrit de Dostoïevski.
À l'heure actuelle, les auteurs n'osent plus trop ; on veut des traductions qui collent parfaitement (comme si c'était possible !) à la matrice dont elles sont issues, et l'on est déçu, fatalement, car c'est une gageure ; alors on critique le traducteur ou l'on souligne l'incomparable valeur de l'original face à l'oeuvre traduite.
C'est une tendance actuelle mais qui évoluera peut-être, du moins l'espère-je. (C'est joli, n'est-ce pas, ce pied d'espère-je que je laisse pousser comme une mauvaise herbe au milieu de mes phrases, vous ne trouvez pas ?) On sait aussi qu'on a, depuis quelques années, quasiment laissé tomber la VF dans le cinéma ou les séries télévisées, alors même que c'était la VF de qualité qui pouvait transcender des films ou des séries pas nécessairement géniaux par ailleurs. (Je pense notamment à Starsky et Hutch, Amicalement Vôtre ou même Goldorak dont la VF est considérée comme très supérieure à la VO.)
Eh bien dans ce registre de la transcription, le maître incontesté, celui qui a laissé à jamais sa patte, c'est indéniablement le Cid de Corneille, transcrit de Guillén de Castro.
L'original, malheureusement et incompréhensiblement trop peu connu, était déjà très bon. Mais la transcription française de Pierre Corneille est un pur joyau, l'un des plus hauts degrés jamais atteints par un texte en français, une langue d'une beauté, d'une musique et d'un rythme à tomber en pâmoison. La seule chose d'ailleurs que j'aurais à lui reprocher, c'est justement de trop souvent omettre de préciser qu'elle est une transcription de l'espagnol et non une création originale depuis la page blanche.
Permettez-moi de revenir quelques instants sur les origines espagnoles de ce chef-d'oeuvre. Guillén de Castro y Bellvis écrit entre 1605 et 1615 Las Mocedades del Cid, littéralement La Jeunesse du Cid, une pièce à caractère autant historique que légendaire à propos du personnage réel de Rodrigo Díaz de Vivar. Celui-ci a réellement existé au XIème siècle et il est une figure importante du Moyen Âge espagnol, notamment de la Reconquista. Ce surnom de « cid », altération de l'arabe « seyid » et signifiant seigneur lui fut attribué par les Maures eux-mêmes suite à de nombreuses défaites qu'il leur infligea. Cette pièce était normalement suivie d'une seconde, intitulée Las Hazañas del Cid qu'on traduirait en français comme Les Exploits du Cid.
La première pièce de Guillén de Castro est particulièrement réussie et figure en bonne place dans cet ensemble que l'on nomme " le Siècle D'Or " espagnol et je comprends aisément qu'elle ait très favorablement impressionné l'ami Pierre Corneille, car j'avoue que moi-même, quand je l'ai lue, j'y ai pris grand plaisir. Même certaines figures de style du texte francophone, passées depuis lors à la postérité telle la fameuse litote : « Va, je ne te hais point. » ou des chiasmes savoureux sont eux aussi déjà présents dans le texte initial.
Donc, la tâche était difficile pour se hisser à la hauteur d'une telle dramaturgie, d'un tel texte de base. Mais c'est pourtant ce qui a dû galvaniser notre noir volatile normand car jamais je crois, il n'a atteint lui-même un tel niveau de perfection stylistique. On ne compte plus les vers ou les tirades qui ont désormais quasiment valeur de proverbes. Permettez-moi juste de vous en citer quelques uns :
Vers 434 : À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Vers 406 : La valeur n'attend point le nombre des années.
Vers 236 : Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
Vers 81 : L'amour est un tyran qui n'épargne personne.
Vers 393 : Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces.
Vers 410 : Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.
Vers 963 : Va, je ne te hais point.
Vers 290 : Va, cours, vole, et nous venge.
Etc., etc., etc.
Maintenant examinons quelle en est l'intrigue. C'est l'archétype du choix dit " cornélien" mais qui en fait, comme je viens de vous le dire, n'a rien de Corneille mais fut livré tel quel par de Castro y Bellvis mais dont l'auteur a perçu la richesse et qu'il resservira, entre autre, dès sa tragédie suivante, Horace.
Don Rodrigue aime Chimène et Chimène aime Don Rodrigue. Jusqu'ici tout va bien. Don Rodrigue est le fils de l'illustre Don Diègue, un vaillant guerrier qui a beaucoup fait pour le roi de Castille, du temps de sa jeunesse mais qui commence à accuser quelque peu le poids des ans. Chimène quant à elle est la fille de l'actuel plus grand guerrier du royaume, un certain Comte de Gormas, comparable par sa fougue et sa vaillance au vénérable Don Diègue mais dans la force de l'âge, pour sa part.
Et ces deux hommes, d'accords sur le principe du mariage de leur progéniture respective, sont pourtant si bouffis d'orgueil l'un et l'autre que lorsque Don Diègue reçoit un privilège du roi, le Comte s'en offusque car il considère que c'est lui qui mérite cet honneur, un peu à la manière d'Ajax qui devint fou de voir les armes d'Achille attribuées à Ulysse plutôt qu'à lui après tout ce qu'il avait fait lors du siège de Troie.
Si bien que le Comte de Gormas donne une claque à Don Diègue, pour bien lui signifier son mépris. le vieux soldat aimerait bien dégainer son épée mais il n'a plus la force de soutenir un combat face au géant lion de Gormas. Son honneur est meurtri comme jamais, c'est la honte, c'est la mort que seul un juste châtiment peut laver.
C'est donc à son fils, Don Rodrigue qu'il demande de laver l'affront fait à son grand âge et à sa valeur d'autrefois. Rodrigue, la mort dans l'âme, car il sait ce qu'il lui en coûtera, accepte de défier l'ombrageux guerrier père de Chimène. Et contre toute attente, c'est lui qui terrasse le plus grand guerrier du roi de sorte que l'honneur de son père est rétabli mais, du même coup, il voit son amour lui filer entre les doigts.
En effet, comment Chimène pourrait-elle aimer et épouser celui qui a transpercé le coeur de son père ? Mais en même temps, se venger de lui, c'est tuer son véritable amour. Faut-il ajouter une mort atroce sur une mort horrible ? Dans un cas comme dans l'autre, elle y perd quelque chose, soit l'honneur, soit l'amour, soit les deux. Chimène sera-t-elle comme le Héron jamais satisfait De La Fontaine ? Que choisir ? (ou 60 millions de Lecteurs consommateurs)...
Outre la merveille de l'écriture, outre la valeur de l'intrigue, outre le cachet d'une époque, outre tout ce qui fait de cette pièce un vibrant chef-d'oeuvre, permettez-moi encore d'aborder deux autres points qui font écho au théâtre espagnol de ce fameux siècle d'or.
En effet, le Cid, c'est aussi une réflexion sur la tragédie de l'âge. On se doute que Don Diègue, lui qui fut si fort, lui qui fut si grand est humilié de ne pouvoir répondre seul aux fanfaronnades du Comte. Être obligé d'aller quémander l'aide de vos enfants parce que votre bras tremble et que vos jambes sont débiles, comme c'est dégradant.
C'est pourtant la tragédie ordinaire que vivent nombre de personnes âgées qui se découvrent un jour, l'ombre d'elles-mêmes. Souvent, elles n'ont pas trop vu cela venir, car cela s'est fait très progressivement, mais un jour on prend conscience, et ce jour-là on pleure. Ce thème fut repris par Tirso de Molina dans son célèbre Abuseur de Séville avec le personnage du Commandeur trucidé par Don Juan dont il ne respecte pas même le tombeau.
Enfin, je voudrais en terminer en évoquant un personnage délicieusement ambigu, à savoir, l'infante Doña Urraque, secrètement folle amoureuse de Rodrigue et donc jalouse de Chimène. On se dit qu'elle est capable de faire capoter le mariage, non pas pour elle-même, puisque son statut lui interdit une union avec quelqu'un d'aussi modestement élevé socialement que Rodrigue, mais juste pour ne pas qu'une autre puisse jouir du loisir de partager la vie de celui qu'elle aime.
C'est exactement le thème d'une pièce tout à fait contemporaine de L'Enfance du Cid, intitulée le Chien du Jardinier de Lope de Vega. Lequel chien du jardinier, comme dit la fable d'Ésope, « ne mange pas de chou et ne permet pas qu'on en mange »... Mais je m'aperçois que cet avis est déjà beaucoup plus long que je ne l'avais déCIDé, il a poussé mieux qu'une mauvaise herbe sans herbiCID alors que manifestement, il ne signifie pas grand-chose face à ce texte géant que rien n'oxCID.
P. S. : le fameux vers 434 (À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.) est très vraisemblablement lui aussi un emprunt, à Sénèque cette fois, qui dans son de Providentia avait fait dire à un gladiateur fâché d'avoir à combattre trop faible partie : « Eum sine gloria vinci qui sine periculo vincitur. » Preuve encore, s'il en était besoin, du remarquable talent de transcripteur de Pierre Corneille.
J'ai commenté, il y a peu, une pièce de Racine, Iphigénie, pour laquelle j'écrivais à demis mots — même à trois quarts de mots —, que je la trouvais moyenne au goût, voire un peu en dessous. Je vous avoue avoir été un peu surprise de mon propre revirement vis-à-vis de Racine et de la tragédie du XVIIème pour laquelle il me semblait jusque là entretenir une certaine appétence. Voilà pourquoi j'ai ressenti le besoin d'enchaîner illico sur une autre tragédie XVIIème, histoire de vérifier si réellement mes goûts avaient changé ou si ça n'était imputable qu'à ladite Iphigénie.
Me voilà rassurée : j'aime encore la tragédie, j'aime encore ce français suranné (et pas Suréna, enfin je me comprends). Mais avant que d'en parler, permettez-moi préalablement, d'adresser un vrai remerciement, de faire le très grand éloge du tout petit livre que j'ai lu et que j'ai présentement sous les yeux.
Connaissez-vous cette admirable édition des Petits Classiques Bordas de 1968 ? Alors, c'est vrai, je vous le concède, la couverture est moche à souhait : elle représente une sorte de petit « b » pour Bordas, tronqué, dans les tons de rouge et de noir mal chevauchés ; à croire qu'on devait manquer de moyens, à l'époque, chez Bordas ou, non, plutôt, au lieu que de les investir dans le vernis, dans le clinquant, on les mettait plutôt dans le fond, dans le propos. À l'heure actuelle c'est tout l'inverse, c'est le triomphe de la superficialité, du « m'as-tu vu ? », du « ne réfléchis pas » ou si peu…
Il y est précisé que la pièce est présentée « avec une notice sur le théâtre au XVIIe siècle, une biographie chronologique de Corneille, une étude générale de son oeuvre, une analyse méthodique de la pièce, l'Examen de 1660, la Lettre de Balzac, des notes, des questions, des sujets de devoirs par Marcel BARRAL, agrégé de grammaire, maître assistant à la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Montpellier ».
Bon. Okay, pourquoi pas ? Ça paraît peut-être un peu ronflant dit comme ça mais, dans les faits, tout ce qui est annoncé y est et très bien amené. Je dirais même après examen que la publicité n'est pas surfaite, bien au contraire. Je tourne la page et je lis les « Principes de la collection » (desdits Petits Classiques Bordas), je cite :
« Mettre à la disposition de tous les élèves — des petites classes jusqu'aux classes préparatoires aux Grandes Écoles —, ainsi que des étudiants, les documents dont ils auront besoin sur l'auteur et sur l'oeuvre à étudier. Présenter, dans les bandeaux placés en regard du texte, des thèmes de réflexion utilisables en classe, et propres à guider l'élève dans l'étude personnelle des pages non retenues pour l'analyse magistrale. Dans ces bandeaux et dans l'étude finale de l'oeuvre, multiplier les sujets de devoirs et les questions pouvant donner lieu à un exercice écrit ou oral. À côté des jugements prononcés par les écrivains et les critiques des siècles passés, placer l'opinion de nos grands auteurs contemporains et des critiques les plus écoutés de notre époque. »
Alors, oui, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est peut-être un peu paternaliste comme programme mais d'un paternalisme que je qualifierais de « dans le bon sens du terme », dans le sens qui vise, à terme, à l'émancipation. N'est-ce pas là tout l'esprit et le programme des Lumières ? N'est-ce pas, par le questionnement, par la confrontation d'opinions contradictoires à propos d'une même oeuvre la formation d'un esprit critique, l'élévation et le positionnement de la sensibilité de l'élève par rapport à ces avis et à ces oeuvres dites « classiques », c'est-à-dire, je le rappelle, à l'origine celles qui étaient étudiées dans les « classes » (à présent on baptise tout « classique » sitôt que cela rencontre un certain succès ou que c'est un peu ancien) ? Quand je lis les présentations des éditions scolaires actuelles, les bras m'en tombent. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas plus bêtes, ce me semble, que ceux de 1968 ; seule la proportion de ceux qui poursuivent des études a changé.
Par exemple, à l'Acte III, Scène 2, l'édition nous propose une critique De Voltaire : « Pourquoi Cinna a-t-il à présent des remords ? S'est-il passé quelque chose de nouveau qui ait pu lui en donner ? » Et l'édition nous invite à y réfléchir : « Quelle réponse peut-on faire à cette critique ? » Elle ne donne pas de réponse, elle nous laisse en chercher une, elle nous laisse trouver chacun la nôtre, elle peut donner lieu à débat…
Car lire de la littérature, voyez-vous, ça n'est pas juste ni simplement un exercice rébarbatif qu'on impose aux ados, ça n'est pas juste telle figure, tel chiasme, tel sens de tel mot, telle note à la fin, au bac ou je ne sais quoi qui, de toute façon ne vaudra rien, c'est aussi, c'est avant tout, c'est surtout une possibilité mimétique, se mettre à la place de, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été Cinna, comment est-ce que j'aurais réagi si l'on m'avait dit ça à moi, s'il s'était passé ça ? C'est ce que nous faisons chaque nuit dans nos rêves, c'est prendre des costumes fictifs pour apprendre à nous connaître nous-mêmes, à nous comporter vis-à-vis des autres, à envisager qu'il puisse y avoir d'autres façons de faire chez l'autre, d'autres façons de penser, de ressentir…
On croit s'attirer les ados en rendant tout ludique, sucré, flashy, faible en contenu, accessible, en Nutellaïsant la câpre et l'origan, en les maintenant en enfance quand eux ne souhaitent qu'être traités en adultes. On se trompe probablement car le ludique est déjà contenu dedans : le jeu. Que dit-on de l'acteur ? Qu'il joue. Connaissez-vous des classes d'ados où aucun ne souhaite se mettre en scène ? Ils adorent ça, au contraire, ils en raffolent et même si la timidité en retient beaucoup de s'exposer face aux autres, tous ou presque voudraient être, l'espace d'un instant, ou Cinna ou Auguste ou Émilie ou Livie. On s'en fout des notes, on s'en fout du bac, mais être Auguste ou Livie, avec l'armure, avec la belle robe, on s'en souvient toute sa vie et l'on se dit, un jour, un soir, qu'on vienne de la banlieue, qu'on vienne de la campagne, qu'on soit noir, blanc, ocre jaune, bleu foncé ou rouge tagada, fils de gueux ou fille de roi, peut-être très longtemps après : « Il a été grand, Auguste, sur ce coup-là… Tiens, moi aussi, microbe, je te pardonne. »
Par pitié, remettez-nous des éditions de cette qualité-là. On sait bien que tous ne la liront pas, mais ils ne liront pas plus la flashy basse densité que vous leur proposerez, tandis que ceux qui la liront, eux, en tireront un quelque chose de plus et qui est l'essence même de ce que devrait concourir à permettre l'enseignement : forger des individus libres, capables de juger par eux-mêmes des événements et des obstacles que leur opposera le monde, sans une quelconque tutelle, sans une éternelle prééminence de « papa » État qui décide tout pour moi, permis de ceci, permis de cela, interdit de ci, interdit de ça. C'est devenu tellement grotesque que quand une canicule se pointe, quand un arbre se casse la gueule dans l'espace public à cause d'une tempête, aussitôt tout le monde cherche un responsable et se tourne vers la mairie, vers l'État : « Eh dis, l'État, tu ne m'avais pas prévenu que le soleil ça chauffait et que le vent ça soufflait, s'agirait peut-être de me remettre ma teuteute et de me changer mon bavoir parce que là, quand même, y a de l'abus ! » Fin de la parenthèse. (Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de vaccin, cette fois.)
« Tiens, au lieu d'écrire des conneries, ma petite, prends ton vaccin, remets ta teuteute et dépêche-toi, sinon tu vas prendre froid.
— Oui, Papa, tout de suite, Papa, je termine vite fait ma critique et j'arrive. »
Bon, alors, vous avez compris, faut que j'accélère… Il y a une différence fondamentale, selon moi, entre Corneille et Racine, et elle réside dans le secret de la formule — comme entre Pfizer et Astra-Zeneca. Racine, c'est incroyablement homogène, c'est calibré, c'est minuté, ça arrive toujours à l'heure, mais, parfois, l'on s'y ennuie.
Corneille, c'est comme un bruit de ron-ron et tout à coup, Paf ! une fusée, et juste après, Pif ! une autre. le ron-ron reprend, et là, BLAAAM ! une explosion thermonucléaire, vous êtes un peu secouée, forcément, alors il vous remet un p'tit coup de ron-ron, et puis Pan ! il vous achève, d'un vers dans le cœur.
Corneille a le sens de l'aphorisme, le sens de la formule qui fait mouche, Racine pas spécialement. Dans Cinna, il y a même beaucoup plus que cela, car l'auteur y incorpore une dimension psychologique, l'évolution des personnages, ce que Racine avait totalement loupé avec Agamemnon, Achille et Iphigénie dans sa pièce homonyme. Ici, je ne vais pas aller jusqu'à dire que tout est admirable ou crédible, psychologiquement parlant, mais l'on sent tout de même un réel soucis d'authenticité, sauf à la fin du dernier acte.
Le personnage le plus bancal m'apparaît être Maxime, l'ami et complice de Cinna, dont la psychologie à géométrie variable n'est là, d'après moi, que pour soutenir l'intérêt dramatique de la pièce. Il en va de même de Cinna et d'Émilie à la toute fin, ce qui est un peu dommage, voire dommageable, car ce n'était pas trop le cas jusques ici et ce qui me gâche un peu la dernière impression, d'où cette appréciation d'ensemble à 3,5/5.
De quoi est-il question dans la tragédie ? Corneille s'appuie sur la relation que donne Montaigne dans ses Essais, au chapitre XXIII, du comportement d'Auguste en apprenant le détail d'une conjuration destinée à l'abattre. (Montaigne s'appuyait quant à lui sur un écrit de Sénèque, le livre I de de la clémence, au chapitre 9.)
Cinna, fils de Pompée et Émilie, fille du tuteur d'Auguste ont l'un et l'autre une bonne raison d'en vouloir à l'empereur suite au traitement que lui ou ses alliés ont infligé à leur père respectif. Toutefois, depuis lors, Auguste s'est montré magnanime avec les deux rejetons, il les comble d'honneurs et de droits spéciaux. Il n'importe, la belle Émilie ne décolère pas et ne trouvera la tranquillité que quand Auguste aura été rétréci d'une octave. Elle compte pour cela sur le poignard de Cinna ; elle s'offre même pour prix d'un si glorieux exploit et est toute prête à épouser l'impéricide (qu'elle aime et qui l'aime indépendamment de la petite besogne envisagée conjointement).
Voilà, voilà, Cinna sait ce qu'il lui reste à faire s'il espère consommer son hyménée. Pour cela, il a regroupé autour de lui une troupe de conjurés prêts à lui filer un coup de main au moment du coup de poignard. Maxime est le plus important d'entre eux.
Voilà, voilà, tout se prépare gentiment en coulisse, chacun affute son couteau, son tranchet, son herminette ; Émilie se réjouit par avance de pouvoir prochainement boulotter du boudin, mais… (oui, car il y un mais), mais, disais-je, coup de théâtre (n'ayez crainte, ça ne fait pas mal), Auguste convoque personnellement Maxime et Cinna. Les deux se disent que ça sent méchamment le roussi pour leur grade, que quelqu'un a dû les balancer et puis…
Et puis, non. Auguste les consulte, tout simplement, parce qu'il en a ras le citron de l'empire, du pouvoir et de ses tracas. Il est même bien prêt à rendre son tablier, à tirer sa révérence et à leur refiler le bébé, aux deux cocos. du coup, ça libère ipso facto Rome du tyran, du coup il n'y a plus vraiment de justification ni de libération possible à la lame du couteau. Que devient la conjuration ? Qu'en pense Maxime ? Qu'en pense Cinna ? Qu'en dira Émilie si méchoui il n'y a pas ?
Il est question de Rome et de liberté, bien sûr, du comportement du tyran face à l'adversité, mais il est surtout question du prix mis en jeu à la tombola du coup de couteau. Qu'en diront ces trois-là ? Ça, c'est ce que précisément je me refuse à vous dévoiler. Y aura-t-il d'autres personnages impliqués, qu'en dira le principal intéressé ? Quels sont les ressorts qui nous poussent à agir, à ne pas agir, à nous insurger ou à nous assagir, à envier ou à consentir, à essayer du neuf ou à sans cesse resservir les mêmes vaisselles éculées ?
Si ça ne tenait qu'à mon avis, je vous signerais sans broncher votre attestation vacCINNAle mais vous savez bien à présent ce que représente mon avis sans QR code, assurément pas grand-chose par les temps qui courent… Je sais juste que j'ai une réaction immunitaire un peu plus forte pour Racine que pour Corneille mais on n'arrive pas encore à mesurer ça très bien dans les résultats de prise de sang. Cependant, ayons foi en la science et en l'intelligence artificielle, ce sera sans doute pour bientôt… comme l'immunité collective.
Me voilà rassurée : j'aime encore la tragédie, j'aime encore ce français suranné (et pas Suréna, enfin je me comprends). Mais avant que d'en parler, permettez-moi préalablement, d'adresser un vrai remerciement, de faire le très grand éloge du tout petit livre que j'ai lu et que j'ai présentement sous les yeux.
Connaissez-vous cette admirable édition des Petits Classiques Bordas de 1968 ? Alors, c'est vrai, je vous le concède, la couverture est moche à souhait : elle représente une sorte de petit « b » pour Bordas, tronqué, dans les tons de rouge et de noir mal chevauchés ; à croire qu'on devait manquer de moyens, à l'époque, chez Bordas ou, non, plutôt, au lieu que de les investir dans le vernis, dans le clinquant, on les mettait plutôt dans le fond, dans le propos. À l'heure actuelle c'est tout l'inverse, c'est le triomphe de la superficialité, du « m'as-tu vu ? », du « ne réfléchis pas » ou si peu…
Il y est précisé que la pièce est présentée « avec une notice sur le théâtre au XVIIe siècle, une biographie chronologique de Corneille, une étude générale de son oeuvre, une analyse méthodique de la pièce, l'Examen de 1660, la Lettre de Balzac, des notes, des questions, des sujets de devoirs par Marcel BARRAL, agrégé de grammaire, maître assistant à la Faculté des Lettres et des sciences humaines de Montpellier ».
Bon. Okay, pourquoi pas ? Ça paraît peut-être un peu ronflant dit comme ça mais, dans les faits, tout ce qui est annoncé y est et très bien amené. Je dirais même après examen que la publicité n'est pas surfaite, bien au contraire. Je tourne la page et je lis les « Principes de la collection » (desdits Petits Classiques Bordas), je cite :
« Mettre à la disposition de tous les élèves — des petites classes jusqu'aux classes préparatoires aux Grandes Écoles —, ainsi que des étudiants, les documents dont ils auront besoin sur l'auteur et sur l'oeuvre à étudier. Présenter, dans les bandeaux placés en regard du texte, des thèmes de réflexion utilisables en classe, et propres à guider l'élève dans l'étude personnelle des pages non retenues pour l'analyse magistrale. Dans ces bandeaux et dans l'étude finale de l'oeuvre, multiplier les sujets de devoirs et les questions pouvant donner lieu à un exercice écrit ou oral. À côté des jugements prononcés par les écrivains et les critiques des siècles passés, placer l'opinion de nos grands auteurs contemporains et des critiques les plus écoutés de notre époque. »
Alors, oui, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est peut-être un peu paternaliste comme programme mais d'un paternalisme que je qualifierais de « dans le bon sens du terme », dans le sens qui vise, à terme, à l'émancipation. N'est-ce pas là tout l'esprit et le programme des Lumières ? N'est-ce pas, par le questionnement, par la confrontation d'opinions contradictoires à propos d'une même oeuvre la formation d'un esprit critique, l'élévation et le positionnement de la sensibilité de l'élève par rapport à ces avis et à ces oeuvres dites « classiques », c'est-à-dire, je le rappelle, à l'origine celles qui étaient étudiées dans les « classes » (à présent on baptise tout « classique » sitôt que cela rencontre un certain succès ou que c'est un peu ancien) ? Quand je lis les présentations des éditions scolaires actuelles, les bras m'en tombent. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas plus bêtes, ce me semble, que ceux de 1968 ; seule la proportion de ceux qui poursuivent des études a changé.
Par exemple, à l'Acte III, Scène 2, l'édition nous propose une critique De Voltaire : « Pourquoi Cinna a-t-il à présent des remords ? S'est-il passé quelque chose de nouveau qui ait pu lui en donner ? » Et l'édition nous invite à y réfléchir : « Quelle réponse peut-on faire à cette critique ? » Elle ne donne pas de réponse, elle nous laisse en chercher une, elle nous laisse trouver chacun la nôtre, elle peut donner lieu à débat…
Car lire de la littérature, voyez-vous, ça n'est pas juste ni simplement un exercice rébarbatif qu'on impose aux ados, ça n'est pas juste telle figure, tel chiasme, tel sens de tel mot, telle note à la fin, au bac ou je ne sais quoi qui, de toute façon ne vaudra rien, c'est aussi, c'est avant tout, c'est surtout une possibilité mimétique, se mettre à la place de, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été Cinna, comment est-ce que j'aurais réagi si l'on m'avait dit ça à moi, s'il s'était passé ça ? C'est ce que nous faisons chaque nuit dans nos rêves, c'est prendre des costumes fictifs pour apprendre à nous connaître nous-mêmes, à nous comporter vis-à-vis des autres, à envisager qu'il puisse y avoir d'autres façons de faire chez l'autre, d'autres façons de penser, de ressentir…
On croit s'attirer les ados en rendant tout ludique, sucré, flashy, faible en contenu, accessible, en Nutellaïsant la câpre et l'origan, en les maintenant en enfance quand eux ne souhaitent qu'être traités en adultes. On se trompe probablement car le ludique est déjà contenu dedans : le jeu. Que dit-on de l'acteur ? Qu'il joue. Connaissez-vous des classes d'ados où aucun ne souhaite se mettre en scène ? Ils adorent ça, au contraire, ils en raffolent et même si la timidité en retient beaucoup de s'exposer face aux autres, tous ou presque voudraient être, l'espace d'un instant, ou Cinna ou Auguste ou Émilie ou Livie. On s'en fout des notes, on s'en fout du bac, mais être Auguste ou Livie, avec l'armure, avec la belle robe, on s'en souvient toute sa vie et l'on se dit, un jour, un soir, qu'on vienne de la banlieue, qu'on vienne de la campagne, qu'on soit noir, blanc, ocre jaune, bleu foncé ou rouge tagada, fils de gueux ou fille de roi, peut-être très longtemps après : « Il a été grand, Auguste, sur ce coup-là… Tiens, moi aussi, microbe, je te pardonne. »
Par pitié, remettez-nous des éditions de cette qualité-là. On sait bien que tous ne la liront pas, mais ils ne liront pas plus la flashy basse densité que vous leur proposerez, tandis que ceux qui la liront, eux, en tireront un quelque chose de plus et qui est l'essence même de ce que devrait concourir à permettre l'enseignement : forger des individus libres, capables de juger par eux-mêmes des événements et des obstacles que leur opposera le monde, sans une quelconque tutelle, sans une éternelle prééminence de « papa » État qui décide tout pour moi, permis de ceci, permis de cela, interdit de ci, interdit de ça. C'est devenu tellement grotesque que quand une canicule se pointe, quand un arbre se casse la gueule dans l'espace public à cause d'une tempête, aussitôt tout le monde cherche un responsable et se tourne vers la mairie, vers l'État : « Eh dis, l'État, tu ne m'avais pas prévenu que le soleil ça chauffait et que le vent ça soufflait, s'agirait peut-être de me remettre ma teuteute et de me changer mon bavoir parce que là, quand même, y a de l'abus ! » Fin de la parenthèse. (Vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de vaccin, cette fois.)
« Tiens, au lieu d'écrire des conneries, ma petite, prends ton vaccin, remets ta teuteute et dépêche-toi, sinon tu vas prendre froid.
— Oui, Papa, tout de suite, Papa, je termine vite fait ma critique et j'arrive. »
Bon, alors, vous avez compris, faut que j'accélère… Il y a une différence fondamentale, selon moi, entre Corneille et Racine, et elle réside dans le secret de la formule — comme entre Pfizer et Astra-Zeneca. Racine, c'est incroyablement homogène, c'est calibré, c'est minuté, ça arrive toujours à l'heure, mais, parfois, l'on s'y ennuie.
Corneille, c'est comme un bruit de ron-ron et tout à coup, Paf ! une fusée, et juste après, Pif ! une autre. le ron-ron reprend, et là, BLAAAM ! une explosion thermonucléaire, vous êtes un peu secouée, forcément, alors il vous remet un p'tit coup de ron-ron, et puis Pan ! il vous achève, d'un vers dans le cœur.
Corneille a le sens de l'aphorisme, le sens de la formule qui fait mouche, Racine pas spécialement. Dans Cinna, il y a même beaucoup plus que cela, car l'auteur y incorpore une dimension psychologique, l'évolution des personnages, ce que Racine avait totalement loupé avec Agamemnon, Achille et Iphigénie dans sa pièce homonyme. Ici, je ne vais pas aller jusqu'à dire que tout est admirable ou crédible, psychologiquement parlant, mais l'on sent tout de même un réel soucis d'authenticité, sauf à la fin du dernier acte.
Le personnage le plus bancal m'apparaît être Maxime, l'ami et complice de Cinna, dont la psychologie à géométrie variable n'est là, d'après moi, que pour soutenir l'intérêt dramatique de la pièce. Il en va de même de Cinna et d'Émilie à la toute fin, ce qui est un peu dommage, voire dommageable, car ce n'était pas trop le cas jusques ici et ce qui me gâche un peu la dernière impression, d'où cette appréciation d'ensemble à 3,5/5.
De quoi est-il question dans la tragédie ? Corneille s'appuie sur la relation que donne Montaigne dans ses Essais, au chapitre XXIII, du comportement d'Auguste en apprenant le détail d'une conjuration destinée à l'abattre. (Montaigne s'appuyait quant à lui sur un écrit de Sénèque, le livre I de de la clémence, au chapitre 9.)
Cinna, fils de Pompée et Émilie, fille du tuteur d'Auguste ont l'un et l'autre une bonne raison d'en vouloir à l'empereur suite au traitement que lui ou ses alliés ont infligé à leur père respectif. Toutefois, depuis lors, Auguste s'est montré magnanime avec les deux rejetons, il les comble d'honneurs et de droits spéciaux. Il n'importe, la belle Émilie ne décolère pas et ne trouvera la tranquillité que quand Auguste aura été rétréci d'une octave. Elle compte pour cela sur le poignard de Cinna ; elle s'offre même pour prix d'un si glorieux exploit et est toute prête à épouser l'impéricide (qu'elle aime et qui l'aime indépendamment de la petite besogne envisagée conjointement).
Voilà, voilà, Cinna sait ce qu'il lui reste à faire s'il espère consommer son hyménée. Pour cela, il a regroupé autour de lui une troupe de conjurés prêts à lui filer un coup de main au moment du coup de poignard. Maxime est le plus important d'entre eux.
Voilà, voilà, tout se prépare gentiment en coulisse, chacun affute son couteau, son tranchet, son herminette ; Émilie se réjouit par avance de pouvoir prochainement boulotter du boudin, mais… (oui, car il y un mais), mais, disais-je, coup de théâtre (n'ayez crainte, ça ne fait pas mal), Auguste convoque personnellement Maxime et Cinna. Les deux se disent que ça sent méchamment le roussi pour leur grade, que quelqu'un a dû les balancer et puis…
Et puis, non. Auguste les consulte, tout simplement, parce qu'il en a ras le citron de l'empire, du pouvoir et de ses tracas. Il est même bien prêt à rendre son tablier, à tirer sa révérence et à leur refiler le bébé, aux deux cocos. du coup, ça libère ipso facto Rome du tyran, du coup il n'y a plus vraiment de justification ni de libération possible à la lame du couteau. Que devient la conjuration ? Qu'en pense Maxime ? Qu'en pense Cinna ? Qu'en dira Émilie si méchoui il n'y a pas ?
Il est question de Rome et de liberté, bien sûr, du comportement du tyran face à l'adversité, mais il est surtout question du prix mis en jeu à la tombola du coup de couteau. Qu'en diront ces trois-là ? Ça, c'est ce que précisément je me refuse à vous dévoiler. Y aura-t-il d'autres personnages impliqués, qu'en dira le principal intéressé ? Quels sont les ressorts qui nous poussent à agir, à ne pas agir, à nous insurger ou à nous assagir, à envier ou à consentir, à essayer du neuf ou à sans cesse resservir les mêmes vaisselles éculées ?
Si ça ne tenait qu'à mon avis, je vous signerais sans broncher votre attestation vacCINNAle mais vous savez bien à présent ce que représente mon avis sans QR code, assurément pas grand-chose par les temps qui courent… Je sais juste que j'ai une réaction immunitaire un peu plus forte pour Racine que pour Corneille mais on n'arrive pas encore à mesurer ça très bien dans les résultats de prise de sang. Cependant, ayons foi en la science et en l'intelligence artificielle, ce sera sans doute pour bientôt… comme l'immunité collective.
Ce que j'aime chez Corneille, c'est de sentir toujours ce petit fond d'ironie, ce petit oeil pétillant, ce sourire en coin glissé au creux de quelques tirades. Car les tragiques grecs étaient des gens très sérieux ; l'ami Racine, malgré tous ses talents, n'était pas franchement un marrant non plus. Tandis que le regard facétieux de Pierre Corneille, on le retrouve jusque dans l'architecture de la pièce.
En tous points, on croirait dur comme fer assister à une tragédie : le ton, la grandiloquence, l'héroïsme, la trahison...
... mais tout se finit bien, le héros n'est pas lâchement assassiné par un fou démoniaque ou un calculateur politique et le sang brille même par son absence alors que du début à la fin on s'attend à s'en prendre des pleines giclées dans les yeux. Amateurs d'hémoglobine, passez votre chemin.
Outre cette entorse au canon de la tragédie, on retrouve quelques répliques qui, sans être de franche rigolade, dénote un fond d'humour, une saillie, une répartie comme Voltaire ne la dédaignait pas, lui qui a pourtant abondamment critiqué cette pièce. Serait-ce de la jalousie ? Allez savoir…
L'auteur s'inspire vaguement de l'histoire, et exhume de quelques lignes de Justin, d'Appien, de Diodore de Sicile ou encore de Plutarque, deux ou trois faits vraisemblables datant d'environ 200 ans avant JC qu'il badigeonne de sa peinture bien à lui pour en faire un tableau de l'Orient qui rappelle à s'y méprendre certains des événements de France contemporains de son écriture (1651).
Nous voilà donc au Proche-Orient, actuelle Turquie mais qui n'avait évidemment pas ce nom à l'époque, constellation de provinces et de petits royaumes qu'on nommait Bythynie, Cappadoce, Pont, Galatie, Phrygie, Lydie, Paphlagonie, etc.
Prusias est roi de Bythinie dont la capitale, Nicomédie (actuelle Izmit) n'est certainement pas étrangère au nom de son premier fils Nicomède, issu d'un premier mariage. Celui-ci est vaillant, noble et juste. Au demeurant, ce jeune prince est un chef de guerre étonnant qui a agrandi par ses conquêtes le royaume de son père de trois royaumes voisins.
Mais Prusias s'est remarié avec la belle et perfide Arsinoé dont il a un second fils, Attale. Arsinoé ne recule devant aucune vilenie et aucun complot pour favoriser son fils au détriment du légitime et populaire Nicomède. Attale, fraîchement arrivé dans le royaume de son père, a été élevé à Rome pour s'y imprégner des façons raffinées du grand terrifiant voisin SPQR.
Mais à la vérité, le problème n'est pas là. Ce qui coince de tous côtés, c'est la belle Laodice, héritière du trône d'Arménie, folle amoureuse de Nicomède. Rien ne semble contrecarrer ses projets puisque le noble héros brûle lui aussi d'une flamme sans égale pour Laodice.
Or, le hic de tout cela c'est que le jeune et inexpérimenté Attale s'est lui aussi piqué de la sublime Laodice et que Rome, dont la pesante tutelle sur Prusias se fait lourdement sentir verrait d'un très mauvais oeil qu'un conquérant tel que Nicomède augmente encore sa puissance en s'adjoignant l'Arménie par mariage.
L'ambassadeur romain Flaminius met donc toute son industrie et tout son savoir-faire à vouloir briser les ailes de Nicomède et faire capoter à tous prix son mariage avec Laodice. Sans compter sur le fait que la félonne Arsinoé oeuvre à qui mieux mieux dans ce sens, évidemment au bénéfice de son fils Attale.
À ce stade, on sent bien les ressorts classiques de la tragédie, on imagine l'injustice, la trahison, le bain de sang et... et... et bah... rien de tout ça mes pauvres enfants ! C'est pourquoi je m'en voudrais de vous gâcher la fin en vous la racontant platement tandis que le monsieur Corneille est si doué et qu'il fait sonner les vers comme personne.
Si l'on se demande maintenant pourquoi Corneille a refusé de faire mourir Nicomède, pourquoi la traitresse est incarnée par Arsinoé, pourquoi la révolte populaire est arrêtée de justesse, etc., etc., il faut probablement aller chercher l'explication dans le contexte politique français d'alors.
Quiconque voyait la pièce à l'époque ne pouvait s'empêcher de mettre Louis XIV sous la perruque de Nicomède, de même que les tractations troubles d'Arsinoé devaient évoquer, par certains aspects la cuisine d'Anne d'Autriche et la révolte populaire, la Fronde. On comprend mieux alors qu'il n'était pas vraiment possible à Pierre Corneille de faire mourir Nicomède, ni de faire s'écharper les grands du royaume dans un bain de sang frénétique, d'où cette construction surprenante, qui a la couleur d'une tragédie, l'odeur d'une tragédie, mais qui n'est nullement tragique.
En somme, une bonne tragi-comédie, probablement plus agréable à lire qu'à voir sur scène car elle repose davantage sur la réflexion et la parole que sur l'action. Je ne la trouve cependant pas du niveau des super tragédies ou tragi-comédies que nous a livré Corneille, mais ce n'est bien évidemment qu'un avis faiblement éclairé, qui n'engage que moi et qui, d'ailleurs, ne signifie pas grand-chose.
En tous points, on croirait dur comme fer assister à une tragédie : le ton, la grandiloquence, l'héroïsme, la trahison...
... mais tout se finit bien, le héros n'est pas lâchement assassiné par un fou démoniaque ou un calculateur politique et le sang brille même par son absence alors que du début à la fin on s'attend à s'en prendre des pleines giclées dans les yeux. Amateurs d'hémoglobine, passez votre chemin.
Outre cette entorse au canon de la tragédie, on retrouve quelques répliques qui, sans être de franche rigolade, dénote un fond d'humour, une saillie, une répartie comme Voltaire ne la dédaignait pas, lui qui a pourtant abondamment critiqué cette pièce. Serait-ce de la jalousie ? Allez savoir…
L'auteur s'inspire vaguement de l'histoire, et exhume de quelques lignes de Justin, d'Appien, de Diodore de Sicile ou encore de Plutarque, deux ou trois faits vraisemblables datant d'environ 200 ans avant JC qu'il badigeonne de sa peinture bien à lui pour en faire un tableau de l'Orient qui rappelle à s'y méprendre certains des événements de France contemporains de son écriture (1651).
Nous voilà donc au Proche-Orient, actuelle Turquie mais qui n'avait évidemment pas ce nom à l'époque, constellation de provinces et de petits royaumes qu'on nommait Bythynie, Cappadoce, Pont, Galatie, Phrygie, Lydie, Paphlagonie, etc.
Prusias est roi de Bythinie dont la capitale, Nicomédie (actuelle Izmit) n'est certainement pas étrangère au nom de son premier fils Nicomède, issu d'un premier mariage. Celui-ci est vaillant, noble et juste. Au demeurant, ce jeune prince est un chef de guerre étonnant qui a agrandi par ses conquêtes le royaume de son père de trois royaumes voisins.
Mais Prusias s'est remarié avec la belle et perfide Arsinoé dont il a un second fils, Attale. Arsinoé ne recule devant aucune vilenie et aucun complot pour favoriser son fils au détriment du légitime et populaire Nicomède. Attale, fraîchement arrivé dans le royaume de son père, a été élevé à Rome pour s'y imprégner des façons raffinées du grand terrifiant voisin SPQR.
Mais à la vérité, le problème n'est pas là. Ce qui coince de tous côtés, c'est la belle Laodice, héritière du trône d'Arménie, folle amoureuse de Nicomède. Rien ne semble contrecarrer ses projets puisque le noble héros brûle lui aussi d'une flamme sans égale pour Laodice.
Or, le hic de tout cela c'est que le jeune et inexpérimenté Attale s'est lui aussi piqué de la sublime Laodice et que Rome, dont la pesante tutelle sur Prusias se fait lourdement sentir verrait d'un très mauvais oeil qu'un conquérant tel que Nicomède augmente encore sa puissance en s'adjoignant l'Arménie par mariage.
L'ambassadeur romain Flaminius met donc toute son industrie et tout son savoir-faire à vouloir briser les ailes de Nicomède et faire capoter à tous prix son mariage avec Laodice. Sans compter sur le fait que la félonne Arsinoé oeuvre à qui mieux mieux dans ce sens, évidemment au bénéfice de son fils Attale.
À ce stade, on sent bien les ressorts classiques de la tragédie, on imagine l'injustice, la trahison, le bain de sang et... et... et bah... rien de tout ça mes pauvres enfants ! C'est pourquoi je m'en voudrais de vous gâcher la fin en vous la racontant platement tandis que le monsieur Corneille est si doué et qu'il fait sonner les vers comme personne.
Si l'on se demande maintenant pourquoi Corneille a refusé de faire mourir Nicomède, pourquoi la traitresse est incarnée par Arsinoé, pourquoi la révolte populaire est arrêtée de justesse, etc., etc., il faut probablement aller chercher l'explication dans le contexte politique français d'alors.
Quiconque voyait la pièce à l'époque ne pouvait s'empêcher de mettre Louis XIV sous la perruque de Nicomède, de même que les tractations troubles d'Arsinoé devaient évoquer, par certains aspects la cuisine d'Anne d'Autriche et la révolte populaire, la Fronde. On comprend mieux alors qu'il n'était pas vraiment possible à Pierre Corneille de faire mourir Nicomède, ni de faire s'écharper les grands du royaume dans un bain de sang frénétique, d'où cette construction surprenante, qui a la couleur d'une tragédie, l'odeur d'une tragédie, mais qui n'est nullement tragique.
En somme, une bonne tragi-comédie, probablement plus agréable à lire qu'à voir sur scène car elle repose davantage sur la réflexion et la parole que sur l'action. Je ne la trouve cependant pas du niveau des super tragédies ou tragi-comédies que nous a livré Corneille, mais ce n'est bien évidemment qu'un avis faiblement éclairé, qui n'engage que moi et qui, d'ailleurs, ne signifie pas grand-chose.
Vous savez tous que Pierre Corneille avait fait un long voyage aux Antilles avant d'écrire Horace et c'est sur place, en sirotant un ti-punch en joyeuse compagnie, qu'il recueillit un dicton populaire local, qu'il a, par la suite, quelque peu remanié pour coller au plus près du sujet de sa pièce. Il nous faut donc remercier les Antilles et le ti-punch pour cette remarquable contribution à l'histoire littéraire nationale. le dicton en question est toujours en vigueur ici ou là et je vous en donne la meilleure traduction possible :
« Rhum, l'unique objet de mes bons sentiments !
Rhum, lequel vient mon bras de verser franchement !
Rhum qui m'a vu ivre, et que mon corps adore !
Rhum enfin que je bois dès qu'il se colore ! »
Bon, trêve de plaisanterie, Horace est une pièce qui a compté plus que tout autre dans mon devenir de lectrice.
En effet, contrairement à beaucoup d'entre-vous sur le site, je n'ai pas toujours été une amoureuse de lecture, et assurément pas depuis ma plus tendre enfance. J'avais certes soif de découvertes, mais ma curiosité allait surtout vers les sciences et l'histoire-géographie. La littérature me laissait complètement indifférente et, pour être tout-à-fait exacte, elle m'ennuyait cordialement. À telle enseigne que je redoutais les lectures imposées, que je ne terminais, pour ainsi dire, jamais.
C'est en classe de troisième que ma professeur de français m'imposa, de son doigt inquisiteur et démoniaque pointé sur le bout de mon nez réfractaire, la lecture d'Horace. Ma réaction fut quelque peu disproportionnée puisqu'en grand secret, mais fermement, je décidai, je me jurai même, de ne jamais lire cette vieillerie qui devait sentir bien fort la naphtaline, coincée qu'elle était au fin fond d'un coffre humide, plus sombre que l'âme ténébreuse de Judas et que plus grand monde ne devait ouvrir. Ma résolution semblait prise et irrévocable.
Je ne sais par quel sortilège, probablement histoire de faire moindrement illusion, je me risquai à lire les quelques premières pages, avec la ferme intention de m'arrêter très vite et de ne pas perdre mon temps dans cette lecture inutile.
Or, à mon grand étonnement, je me suis surprise à aimer. Beaucoup, même ! Énormément, même ! Pierre Corneille venait de réussir le tour de force de sortir de l'obscurantisme et de l'ignorance une petite ado merdeuse de quinze ans tout juste, d'entrebâiller irrémédiablement la porte qui conduit à l'amour de la littérature, ou du moins d'en faire sauter le verrou. Balzac y mit un coup d'épaule, Hugo la poussa en grand et Laclos alluma la lumière. Les trois mousquetaires avaient fait leur apparition, mais c'est bien lui mon petit D Artagnan, cette fine lame de Corneille, qui en fut le déclencheur avec cet Horace de malheur. Merci Pierre Corneille pour ce que vous fîtes et me procurâtes, à l'époque, et à jamais.
Il faut probablement qu'à ce stade je vous entretienne au moins un peu de la pièce elle-même. Alors songez, vous êtes à Rome, pas de cette Rome impériale et présomptueuse, qui de son glaive ardent domine la Méditerranée et même un peu plus loin. Non, Rome n'est encore qu'une cité-état, qui a tout à prouver et tout à plier sous son coude imposant, à commencer par la cité voisine d'Albe (aujourd'hui Castel Gandolfo), dont les fondateurs légendaires de Rome, les jumeaux de la louve, sont issus.
Les deux cités soeurs, imbriquées l'une dans l'autre par d'innombrables liens familiaux et conjugaux, n'en peuvent plus de ne point savoir laquelle domine l'autre et c'est donc à la guerre qu'il se faut résoudre. Non moins braves d'un côté que de l'autre c'est tout de même avec un lourd pincement au coeur que les combattants forment leurs rangs, découvrant dans la rangée d'en face un beau-frère, un cousin ou son meilleur ami.
Sur le point d'engager une lutte fratricide, il est finalement décidé qu'il n'était point besoin de verser tout ce sang, mais qu'on pouvait jouer le destin des deux fougueux voisins, non pas vraiment aux dés, mais à l'épée de certains. Trois chez les Romains, trois chez les Albains. Les rois respectifs et leurs états-majors doivent donc désigner lesquels parmi tant de vaillants soldats sont dignes de se battre pour la domination ou pour l'asservissement. L'issue du combat règlera le destin des deux états voisins.
Pour Rome, ce seront les trois frères Horace qui combattront, pour Albe, les trois frères Curiace. Horace et Curiace sont les meilleurs amis du monde, et plus encore, ils ont chacun une soeur qui est l'épouse de l'autre. Camille, soeur d'Horace, est l'épouse de Curiace et Sabine, soeur de Curiace est la femme d'Horace.
Corneille dresse un tableau parfaitement symétrique et croisé, mais applique à ses protagonistes des profils psychologiques variés qu'il est très intéressant de comparer. de force et de vaillance égale, Horace et Curiace diffèrent néanmoins sensiblement : Curiace est animé de sentiments humains et se retrouve en proie à des hésitations cruelles et à un cas de conscience par cette situation qu'il n'a pas voulu. Horace, lui, bien qu'embêté de devoir s'en prendre à Curiace place avant tout son devoir et sa mission vis-à-vis de sa cité.
Même chose pour les soeurs, qui dans le même cas devraient éprouver des sentiments comparables. Or, Sabine est toujours animée par un espoir d'arrangement tandis que Camille ne se fait aucune illusion et est déjà convaincue et résignée à son malheur.
Le message de l'auteur semble clair, celui qui vainc est l'inhumain, celle qui a raison est la désespérée. Outre ce constat, les ressorts de la tragédie sont étirés à bloc, comme aux plus belles heures des tragédiens grecs, et s'achèvent non sur le point d'orgue du quatrième acte mais sur la réflexion du cinquième.
Le mot de la fin du roi Tulle me laisse toujours assez songeuse. Quel est le sens profond de cette tragédie ? Est-ce que la mort et le sacrifice de soi pour son pays revêtent toujours un petit quelque chose d'inutile et de vain ? Est-ce que l'opinion publique est bien ingrate et qu'elle oublie trop vite les brillantes actions d'un homme pour se focaliser sur ses errances ? Est-ce que seuls les êtres supérieurs sont capables de juger des actes et des éventuels châtiments car la frénésie des foules ne lui dit rien qui vaille ? je me pose encore ces questions sans y trouver de réponse, si ce n'est un certain désabusement de l'auteur.
D'ailleurs est-ce vraiment d'Horace qu'il parle ou de lui-même, lorsqu'il met son héros aux prises avec les réactions de la foule et sous l'arbitrage royal ? il y a fort à parier que sous un habit romain se cache une petite corneille au noir plumage...
Il me reste encore à glisser deux ou trois mots sur ce qui fait le plus grand intérêt de cette tragédie, à savoir, la forme.
Quelle rythmique sensationnelle ! À quels plus hauts sommets a déjà été hissée la langue française qu'à ceux de la tragédie du XVIIè siècle sous la plume de Racine et Corneille ?
C'est un bonheur que de lire une telle écriture, une telle cadence magique, un grand moment, qui justifie presque de le lire à voix haute tellement c'est beau, tellement ça sonne bien et tellement cet homme-là maniait grand l'alexandrin.
Pour finir, comme Sabine, comme Camille, faites un choix cornélien, d'Horace, lire ou ne pas lire, et lui trouver sa place, au risque d'à jamais en porter les stigmates et les traces. En outre, d'un verbe sans pareil, vous n'en pouvez pâtir, mais c'est là mon avis, bien peu, à vrai dire.
« Rhum, l'unique objet de mes bons sentiments !
Rhum, lequel vient mon bras de verser franchement !
Rhum qui m'a vu ivre, et que mon corps adore !
Rhum enfin que je bois dès qu'il se colore ! »
Bon, trêve de plaisanterie, Horace est une pièce qui a compté plus que tout autre dans mon devenir de lectrice.
En effet, contrairement à beaucoup d'entre-vous sur le site, je n'ai pas toujours été une amoureuse de lecture, et assurément pas depuis ma plus tendre enfance. J'avais certes soif de découvertes, mais ma curiosité allait surtout vers les sciences et l'histoire-géographie. La littérature me laissait complètement indifférente et, pour être tout-à-fait exacte, elle m'ennuyait cordialement. À telle enseigne que je redoutais les lectures imposées, que je ne terminais, pour ainsi dire, jamais.
C'est en classe de troisième que ma professeur de français m'imposa, de son doigt inquisiteur et démoniaque pointé sur le bout de mon nez réfractaire, la lecture d'Horace. Ma réaction fut quelque peu disproportionnée puisqu'en grand secret, mais fermement, je décidai, je me jurai même, de ne jamais lire cette vieillerie qui devait sentir bien fort la naphtaline, coincée qu'elle était au fin fond d'un coffre humide, plus sombre que l'âme ténébreuse de Judas et que plus grand monde ne devait ouvrir. Ma résolution semblait prise et irrévocable.
Je ne sais par quel sortilège, probablement histoire de faire moindrement illusion, je me risquai à lire les quelques premières pages, avec la ferme intention de m'arrêter très vite et de ne pas perdre mon temps dans cette lecture inutile.
Or, à mon grand étonnement, je me suis surprise à aimer. Beaucoup, même ! Énormément, même ! Pierre Corneille venait de réussir le tour de force de sortir de l'obscurantisme et de l'ignorance une petite ado merdeuse de quinze ans tout juste, d'entrebâiller irrémédiablement la porte qui conduit à l'amour de la littérature, ou du moins d'en faire sauter le verrou. Balzac y mit un coup d'épaule, Hugo la poussa en grand et Laclos alluma la lumière. Les trois mousquetaires avaient fait leur apparition, mais c'est bien lui mon petit D Artagnan, cette fine lame de Corneille, qui en fut le déclencheur avec cet Horace de malheur. Merci Pierre Corneille pour ce que vous fîtes et me procurâtes, à l'époque, et à jamais.
Il faut probablement qu'à ce stade je vous entretienne au moins un peu de la pièce elle-même. Alors songez, vous êtes à Rome, pas de cette Rome impériale et présomptueuse, qui de son glaive ardent domine la Méditerranée et même un peu plus loin. Non, Rome n'est encore qu'une cité-état, qui a tout à prouver et tout à plier sous son coude imposant, à commencer par la cité voisine d'Albe (aujourd'hui Castel Gandolfo), dont les fondateurs légendaires de Rome, les jumeaux de la louve, sont issus.
Les deux cités soeurs, imbriquées l'une dans l'autre par d'innombrables liens familiaux et conjugaux, n'en peuvent plus de ne point savoir laquelle domine l'autre et c'est donc à la guerre qu'il se faut résoudre. Non moins braves d'un côté que de l'autre c'est tout de même avec un lourd pincement au coeur que les combattants forment leurs rangs, découvrant dans la rangée d'en face un beau-frère, un cousin ou son meilleur ami.
Sur le point d'engager une lutte fratricide, il est finalement décidé qu'il n'était point besoin de verser tout ce sang, mais qu'on pouvait jouer le destin des deux fougueux voisins, non pas vraiment aux dés, mais à l'épée de certains. Trois chez les Romains, trois chez les Albains. Les rois respectifs et leurs états-majors doivent donc désigner lesquels parmi tant de vaillants soldats sont dignes de se battre pour la domination ou pour l'asservissement. L'issue du combat règlera le destin des deux états voisins.
Pour Rome, ce seront les trois frères Horace qui combattront, pour Albe, les trois frères Curiace. Horace et Curiace sont les meilleurs amis du monde, et plus encore, ils ont chacun une soeur qui est l'épouse de l'autre. Camille, soeur d'Horace, est l'épouse de Curiace et Sabine, soeur de Curiace est la femme d'Horace.
Corneille dresse un tableau parfaitement symétrique et croisé, mais applique à ses protagonistes des profils psychologiques variés qu'il est très intéressant de comparer. de force et de vaillance égale, Horace et Curiace diffèrent néanmoins sensiblement : Curiace est animé de sentiments humains et se retrouve en proie à des hésitations cruelles et à un cas de conscience par cette situation qu'il n'a pas voulu. Horace, lui, bien qu'embêté de devoir s'en prendre à Curiace place avant tout son devoir et sa mission vis-à-vis de sa cité.
Même chose pour les soeurs, qui dans le même cas devraient éprouver des sentiments comparables. Or, Sabine est toujours animée par un espoir d'arrangement tandis que Camille ne se fait aucune illusion et est déjà convaincue et résignée à son malheur.
Le message de l'auteur semble clair, celui qui vainc est l'inhumain, celle qui a raison est la désespérée. Outre ce constat, les ressorts de la tragédie sont étirés à bloc, comme aux plus belles heures des tragédiens grecs, et s'achèvent non sur le point d'orgue du quatrième acte mais sur la réflexion du cinquième.
Le mot de la fin du roi Tulle me laisse toujours assez songeuse. Quel est le sens profond de cette tragédie ? Est-ce que la mort et le sacrifice de soi pour son pays revêtent toujours un petit quelque chose d'inutile et de vain ? Est-ce que l'opinion publique est bien ingrate et qu'elle oublie trop vite les brillantes actions d'un homme pour se focaliser sur ses errances ? Est-ce que seuls les êtres supérieurs sont capables de juger des actes et des éventuels châtiments car la frénésie des foules ne lui dit rien qui vaille ? je me pose encore ces questions sans y trouver de réponse, si ce n'est un certain désabusement de l'auteur.
D'ailleurs est-ce vraiment d'Horace qu'il parle ou de lui-même, lorsqu'il met son héros aux prises avec les réactions de la foule et sous l'arbitrage royal ? il y a fort à parier que sous un habit romain se cache une petite corneille au noir plumage...
Il me reste encore à glisser deux ou trois mots sur ce qui fait le plus grand intérêt de cette tragédie, à savoir, la forme.
Quelle rythmique sensationnelle ! À quels plus hauts sommets a déjà été hissée la langue française qu'à ceux de la tragédie du XVIIè siècle sous la plume de Racine et Corneille ?
C'est un bonheur que de lire une telle écriture, une telle cadence magique, un grand moment, qui justifie presque de le lire à voix haute tellement c'est beau, tellement ça sonne bien et tellement cet homme-là maniait grand l'alexandrin.
Pour finir, comme Sabine, comme Camille, faites un choix cornélien, d'Horace, lire ou ne pas lire, et lui trouver sa place, au risque d'à jamais en porter les stigmates et les traces. En outre, d'un verbe sans pareil, vous n'en pouvez pâtir, mais c'est là mon avis, bien peu, à vrai dire.
Tite Et Bérénice de Pierre Corneille subit toujours un peu l'ombre de sa consoeur et rivale Bérénice de Jean Racine. Dès l'origine, la Bérénice de Racine fut conçue dans l'urgence comme une adversaire destinée à sortir juste avant la pièce de Corneille (une semaine seulement) et à siphonner tout le public potentiel au théâtre concurrent.
Je sais que Babelio fourmille d'amoureux des enquêtes, de gens qui adorent voir un têtu à la Columbo pinailler sur un détail pour en faire surgir du sens et tout ce registre de l'herméneutique des scènes de crime. C'est passionnant, il est vrai. Mais c'est tellement plus fort encore quand c'est vous-même qui menez l'enquête.
Ne vous y trompez pas, je ne m'en viens pas vous parler de cette fameuse série jeunesse des années 1980 " Les aventures dont VOUS êtes le héros ", qui avait certes plein de qualités et qui est la mère spirituelle des jeux de rôle. Non, ici, je viens vous parler d'une vraie petite manière d'enquête historique et ce livre est l'outil idéal pour s'y plonger en mettant en regard deux pièces nées à une semaine d'intervalle.
L'année 1670 est une année faste pour le théâtre français. Molière signe l'une de ses meilleures pièces, le Bourgeois Gentilhomme, les deux tragédiens vedette du moment, Corneille le finissant et Racine le montant sont donc très attendus.
Louis XIV est un jeune roi à qui tout sourit (du moins beaucoup de choses) et dont le pouvoir, peu à peu, ressemble de plus en plus à celui d'un empereur romain. Il convient donc de le brosser un peu dans le sens du poil lorsque vous voulez faire votre route au royaume de France.
Ce livre nous permet de retracer, outre cette période qui transparaît partout en filigrane, l'une des plus belles courses à l'échalote de l'histoire littéraire. On sait que c'était souvent le cas à l'époque de la Grèce antique, à qui allait coiffer l'autre sur le poteau puisqu'il y avait une sorte de concours. On sait aussi que l'une des dernières grandes empoignades de ce genre entre deux cadors s'est soldée par un match nul entre Oscar Wilde (Le Portrait de Dorian Gray) et Sir Arthur Conan Doyle (Le Signe Des Quatre).
Projetons-nous, si vous le voulez bien, au mois de novembre 1670 au moment de la création de Bérénice : Racine est alors un fringant jeune homme de trente ans, à peu près le même âge que le roi, très à la mode et qui vole de succès en succès.
Pierre Corneille, soixante-quatre ans (c'est très vieux pour l'époque), est au pinacle des auteurs tragiques mais c'est une gloire du passé, ses grands succès, le Cid, Horace, etc. datent de trente ans auparavant (Le Cid fut créé presque trois ans avant la naissance de Racine). Il a certes du prestige mais il est passé de mode.
Ajoutons à cela que l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Palais-Royal, les deux principales scènes parisiennes d'alors, se tirent une bourre pas possible pour essayer d'écraser son concurrent. le hasard faisant que des gens de l'Hôtel de Bourgogne furent au courant que le grand Corneille, sous contrat avec le Palais-Royal, préparait une pièce sur les amours de l'empereur romain Titus et de la reine de Palestine Bérénice, ceux-ci s'empressèrent de commander à Racine une tragédie sur ce même thème.
Sachant que papy Corneille n'avait plus besoin de travailler rapidement et que l'autre s'est fait un devoir de le coiffer sur le poteau, c'est donc Racine qui présente sa pièce en premier, l'intitulant Bérénice — titre que Corneille avait pressenti pour sa pièce — obligeant ce dernier à changer son titre en Tite et Bérénice pour sa propre pièce qui sort tout juste une semaine plus tard dans le théâtre concurrent.
L'histoire retient donc une victoire totale de Racine, pigeonnant son aîné, et remportant plus de succès que celui-ci. Cet état de fait poussent beaucoup à considérer l'oeuvre de Jean Racine comme très supérieure à celle de Pierre Corneille. Mais, m'étant aventurée à lire ces deux pièces coup sur coup, je ne partage pas du tout cet enthousiasme unilatéral.
Certes je ne suis pas là pour comparer les deux oeuvres qui d'ailleurs se répondent et se complètent bien plus qu'elles ne se marchent sur les pieds. Mais je ne vois nulle part où la versification racinienne serait tant supérieure à celle de Corneille ni en quoi sa gestion de l'intrigue surclasserait celle de son aîné. Je crois plutôt à un effet de mode qui fait long feu, sachant que les effets de mode de 1670, vus de notre fenêtre de l'an 2015, ont un petit quelque chose de risible.
Racine dans sa pièce nous proposait un ménage à trois entre Titus, Bérénice et Antiochus avant l'exil de Bérénice. Corneille place quant à lui sa comédie héroïque au retour d'exil de Bérénice et ne nous parle plus d'un ménage à trois mais d'un ménage à quatre entre Tite et Bérénice d'une part, (ça, vous l'auriez deviné), mais aussi avec Domitie et Domitian d'autre part.
Comme le dit la chanson de Brel, la valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps. du coup, l'histoire se complique avant l'heure d'une manière de Double Inconstance de Marivaux, que je vais essayer de vous présenter rapidement.
Domitie (entendez Domitia Longina, celle dont le buste à chevelure d'éponge est exposé au Louvre) est une prestigieuse belle romaine, de la lignée impériale de Néron et fille de Corbulon, le magnifique général qui a soumis l'Arménie et vaincu les Parthes. Domitian (entendez le futur empereur Domitien) n'est autre que le frère de Tite (entendez l'éphémère empereur Titus) et le fils de l'empereur Vespasien.
Cela fait déjà un beau pedigree. Je ne m'attarde pas sur Titus (voir ma critique de Bérénice) et précise seulement que Bérénice est la petite fille du roi Hérode, reine juive du royaume de Judée, rebaptisée Palestine par les Romains après leur conquête (et surtout après la révolte de Bar Kokhba).
La pièce de Racine nous avait montré comment, malgré l'amour fou qui unissait réciproquement Bérénice à Tite, celui-ci s'était vu contraint par la pression populaire romaine et le sénat à renoncer à un mariage avec elle et à " exiler " Bérénice hors de Rome en la renvoyant dans son royaume de Palestine.
Chez Corneille, les années ont passé et l'on retrouve une situation trouble où Domitie est amoureuse de longue date de Domitian. Mais elle est orgueilleuse, mais elle est ambitieuse cette belle dame, si bien que voyant Tite toujours à caser car n'arrivant pas à se retirer du coeur l'épieu nommé Bérénice, elle se dit soudain : « Aimer le jeune frère d'un empereur, c'est ballot, c'est comme de voir une éclipse totale de soleil à 98 %, c'est gâcher le spectacle. »
De sorte que Domitie aux dents longues verrait d'un très bon oeil que Tite la demande en mariage, même si elle n'éprouve rien pour lui amoureusement. Tite, dans le même esprit, est tout près de conclure l'affaire, sans amour, mais puisque Rome le veut, l'exige et quand l'on est empereur à Rome, l'on n'est presque plus homme ; la politique prend le pas sur la poétique.
Le dindon de la farce, comme vous le voyez, pour l'heure c'est Domitian. Mais il n'a pas encore dit son dernier mot, l'animal ! Il se dit — à raison — que si par un surprenant hasard, Bérénice se trouvait sur le chemin de Tite, les palpitements du coeur du frangin repartiraient comme en quarante (euh…, en 75 après JC, en vrai).
Et là, fatalement, quand on passe de la valse au quadrille, il faut un peu accorder les violons. Tite ne sait plus du tout s'il veut se marier avec Domitie, cette dernière, furieuse, demande à son véritable amour, Domitian, de l'aider dans son projet vis-à-vis de Tite, mais Domitian, pas folle la guêpe, s'arrange précisément pour la faire bisquer en prétendant que si elle ne veut plus de lui, il va demander la main de Bérénice…
L'orage gronde dans le crâne de la tempétueuse Domitie qui redoute de se retrouver le bec dans l'eau, ce que sa fierté ne tolèrerait pas. Pourtant elle aime Domitian, mais c'est un titre qu'elle veut… et le titre, c'est Tite. Et Tite, que fera-t-il ? Va-t-il finalement l'envoyer paître son sénat et se marier avec qui il aime vraiment ? Et Bérénice dans tout cela ?
J'aime autant vous laisser découvrir la fin par vous-même car j'ai très peur de me ramasser un coup de balais sur la tête de la part de Domitie qui devient hystérique dès qu'on parle d'homme ici…
Il demeure une bonne pièce, sans doute pas exceptionnelle, mais qui n'a absolument pas à rougir devant la Bérénice de Racine ; les deux se complétant et se répondant d'ailleurs admirablement car prenant la suite l'une de l'autre. Quant à vous, prenez plaisir, comme je l'ai fait moi-même, à mener votre propre petite enquête en vous souvenant que tout ceci, une fois encore et je ne le répèterai jamais assez, n'est que mon avis, un peu tiré par les cheveux (pas la chevelure de Bérénice, qui elle est une homonyme et était reine d'Égypte au IIIème siècle avant J.-C.) et qui ne représente pas grand-chose.
Je sais que Babelio fourmille d'amoureux des enquêtes, de gens qui adorent voir un têtu à la Columbo pinailler sur un détail pour en faire surgir du sens et tout ce registre de l'herméneutique des scènes de crime. C'est passionnant, il est vrai. Mais c'est tellement plus fort encore quand c'est vous-même qui menez l'enquête.
Ne vous y trompez pas, je ne m'en viens pas vous parler de cette fameuse série jeunesse des années 1980 " Les aventures dont VOUS êtes le héros ", qui avait certes plein de qualités et qui est la mère spirituelle des jeux de rôle. Non, ici, je viens vous parler d'une vraie petite manière d'enquête historique et ce livre est l'outil idéal pour s'y plonger en mettant en regard deux pièces nées à une semaine d'intervalle.
L'année 1670 est une année faste pour le théâtre français. Molière signe l'une de ses meilleures pièces, le Bourgeois Gentilhomme, les deux tragédiens vedette du moment, Corneille le finissant et Racine le montant sont donc très attendus.
Louis XIV est un jeune roi à qui tout sourit (du moins beaucoup de choses) et dont le pouvoir, peu à peu, ressemble de plus en plus à celui d'un empereur romain. Il convient donc de le brosser un peu dans le sens du poil lorsque vous voulez faire votre route au royaume de France.
Ce livre nous permet de retracer, outre cette période qui transparaît partout en filigrane, l'une des plus belles courses à l'échalote de l'histoire littéraire. On sait que c'était souvent le cas à l'époque de la Grèce antique, à qui allait coiffer l'autre sur le poteau puisqu'il y avait une sorte de concours. On sait aussi que l'une des dernières grandes empoignades de ce genre entre deux cadors s'est soldée par un match nul entre Oscar Wilde (Le Portrait de Dorian Gray) et Sir Arthur Conan Doyle (Le Signe Des Quatre).
Projetons-nous, si vous le voulez bien, au mois de novembre 1670 au moment de la création de Bérénice : Racine est alors un fringant jeune homme de trente ans, à peu près le même âge que le roi, très à la mode et qui vole de succès en succès.
Pierre Corneille, soixante-quatre ans (c'est très vieux pour l'époque), est au pinacle des auteurs tragiques mais c'est une gloire du passé, ses grands succès, le Cid, Horace, etc. datent de trente ans auparavant (Le Cid fut créé presque trois ans avant la naissance de Racine). Il a certes du prestige mais il est passé de mode.
Ajoutons à cela que l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Palais-Royal, les deux principales scènes parisiennes d'alors, se tirent une bourre pas possible pour essayer d'écraser son concurrent. le hasard faisant que des gens de l'Hôtel de Bourgogne furent au courant que le grand Corneille, sous contrat avec le Palais-Royal, préparait une pièce sur les amours de l'empereur romain Titus et de la reine de Palestine Bérénice, ceux-ci s'empressèrent de commander à Racine une tragédie sur ce même thème.
Sachant que papy Corneille n'avait plus besoin de travailler rapidement et que l'autre s'est fait un devoir de le coiffer sur le poteau, c'est donc Racine qui présente sa pièce en premier, l'intitulant Bérénice — titre que Corneille avait pressenti pour sa pièce — obligeant ce dernier à changer son titre en Tite et Bérénice pour sa propre pièce qui sort tout juste une semaine plus tard dans le théâtre concurrent.
L'histoire retient donc une victoire totale de Racine, pigeonnant son aîné, et remportant plus de succès que celui-ci. Cet état de fait poussent beaucoup à considérer l'oeuvre de Jean Racine comme très supérieure à celle de Pierre Corneille. Mais, m'étant aventurée à lire ces deux pièces coup sur coup, je ne partage pas du tout cet enthousiasme unilatéral.
Certes je ne suis pas là pour comparer les deux oeuvres qui d'ailleurs se répondent et se complètent bien plus qu'elles ne se marchent sur les pieds. Mais je ne vois nulle part où la versification racinienne serait tant supérieure à celle de Corneille ni en quoi sa gestion de l'intrigue surclasserait celle de son aîné. Je crois plutôt à un effet de mode qui fait long feu, sachant que les effets de mode de 1670, vus de notre fenêtre de l'an 2015, ont un petit quelque chose de risible.
Racine dans sa pièce nous proposait un ménage à trois entre Titus, Bérénice et Antiochus avant l'exil de Bérénice. Corneille place quant à lui sa comédie héroïque au retour d'exil de Bérénice et ne nous parle plus d'un ménage à trois mais d'un ménage à quatre entre Tite et Bérénice d'une part, (ça, vous l'auriez deviné), mais aussi avec Domitie et Domitian d'autre part.
Comme le dit la chanson de Brel, la valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps. du coup, l'histoire se complique avant l'heure d'une manière de Double Inconstance de Marivaux, que je vais essayer de vous présenter rapidement.
Domitie (entendez Domitia Longina, celle dont le buste à chevelure d'éponge est exposé au Louvre) est une prestigieuse belle romaine, de la lignée impériale de Néron et fille de Corbulon, le magnifique général qui a soumis l'Arménie et vaincu les Parthes. Domitian (entendez le futur empereur Domitien) n'est autre que le frère de Tite (entendez l'éphémère empereur Titus) et le fils de l'empereur Vespasien.
Cela fait déjà un beau pedigree. Je ne m'attarde pas sur Titus (voir ma critique de Bérénice) et précise seulement que Bérénice est la petite fille du roi Hérode, reine juive du royaume de Judée, rebaptisée Palestine par les Romains après leur conquête (et surtout après la révolte de Bar Kokhba).
La pièce de Racine nous avait montré comment, malgré l'amour fou qui unissait réciproquement Bérénice à Tite, celui-ci s'était vu contraint par la pression populaire romaine et le sénat à renoncer à un mariage avec elle et à " exiler " Bérénice hors de Rome en la renvoyant dans son royaume de Palestine.
Chez Corneille, les années ont passé et l'on retrouve une situation trouble où Domitie est amoureuse de longue date de Domitian. Mais elle est orgueilleuse, mais elle est ambitieuse cette belle dame, si bien que voyant Tite toujours à caser car n'arrivant pas à se retirer du coeur l'épieu nommé Bérénice, elle se dit soudain : « Aimer le jeune frère d'un empereur, c'est ballot, c'est comme de voir une éclipse totale de soleil à 98 %, c'est gâcher le spectacle. »
De sorte que Domitie aux dents longues verrait d'un très bon oeil que Tite la demande en mariage, même si elle n'éprouve rien pour lui amoureusement. Tite, dans le même esprit, est tout près de conclure l'affaire, sans amour, mais puisque Rome le veut, l'exige et quand l'on est empereur à Rome, l'on n'est presque plus homme ; la politique prend le pas sur la poétique.
Le dindon de la farce, comme vous le voyez, pour l'heure c'est Domitian. Mais il n'a pas encore dit son dernier mot, l'animal ! Il se dit — à raison — que si par un surprenant hasard, Bérénice se trouvait sur le chemin de Tite, les palpitements du coeur du frangin repartiraient comme en quarante (euh…, en 75 après JC, en vrai).
Et là, fatalement, quand on passe de la valse au quadrille, il faut un peu accorder les violons. Tite ne sait plus du tout s'il veut se marier avec Domitie, cette dernière, furieuse, demande à son véritable amour, Domitian, de l'aider dans son projet vis-à-vis de Tite, mais Domitian, pas folle la guêpe, s'arrange précisément pour la faire bisquer en prétendant que si elle ne veut plus de lui, il va demander la main de Bérénice…
L'orage gronde dans le crâne de la tempétueuse Domitie qui redoute de se retrouver le bec dans l'eau, ce que sa fierté ne tolèrerait pas. Pourtant elle aime Domitian, mais c'est un titre qu'elle veut… et le titre, c'est Tite. Et Tite, que fera-t-il ? Va-t-il finalement l'envoyer paître son sénat et se marier avec qui il aime vraiment ? Et Bérénice dans tout cela ?
J'aime autant vous laisser découvrir la fin par vous-même car j'ai très peur de me ramasser un coup de balais sur la tête de la part de Domitie qui devient hystérique dès qu'on parle d'homme ici…
Il demeure une bonne pièce, sans doute pas exceptionnelle, mais qui n'a absolument pas à rougir devant la Bérénice de Racine ; les deux se complétant et se répondant d'ailleurs admirablement car prenant la suite l'une de l'autre. Quant à vous, prenez plaisir, comme je l'ai fait moi-même, à mener votre propre petite enquête en vous souvenant que tout ceci, une fois encore et je ne le répèterai jamais assez, n'est que mon avis, un peu tiré par les cheveux (pas la chevelure de Bérénice, qui elle est une homonyme et était reine d'Égypte au IIIème siècle avant J.-C.) et qui ne représente pas grand-chose.
Le Cid, tragicomédie archiconnue s’il en est. Tellement qu’il m’a fallu me résoudre à l’étudier au collège-lycée. J’ose donc poser LA question : qui n’a jamais déclamé le « Je ne te hais point » qui a rendu célèbre la figure de style méconnue qu’est la litote ?
Pour revenir à l’œuvre proprement dite, Corneille, dans son style épique et tragique qu’on lui connaît, peint un drame classique : un amour menacé. Celui de Rodrigue et Chimène tient l’ensemble de la pièce à bout de bras et par des tirades mythiques. L’amour contrarié, la vengeance ourdie de longue date, d’atroces dilemmes moraux en toutes circonstances : que peut-on demander de plus ou de mieux pour aborder en profondeur les relations individuelles et les sombres sentiments de l’espèce humaine qui font du drame un magnifique élément de théâtre ?
L’intrigue se noue de manière attendue en respectant la fameuse « règle de trois » du théâtre classique français, celle des trois unités, d’action, de temps et de lieu. Si l’ensemble est classique au sens historique comme au sens stylistique, l’effet produit par cette pièce est en revanche au-delà du commun tant les enjeux nous empoignent le cœur et l’esprit sans daigner les lâcher avant le dernier mot.
Le mot de « référence » n’est pas donc volé ici. Pierre Corneille rend une copie parfaite avec cette œuvre, parfois oubliée, mais jamais déconsidérée, c’est mérité.
Pour revenir à l’œuvre proprement dite, Corneille, dans son style épique et tragique qu’on lui connaît, peint un drame classique : un amour menacé. Celui de Rodrigue et Chimène tient l’ensemble de la pièce à bout de bras et par des tirades mythiques. L’amour contrarié, la vengeance ourdie de longue date, d’atroces dilemmes moraux en toutes circonstances : que peut-on demander de plus ou de mieux pour aborder en profondeur les relations individuelles et les sombres sentiments de l’espèce humaine qui font du drame un magnifique élément de théâtre ?
L’intrigue se noue de manière attendue en respectant la fameuse « règle de trois » du théâtre classique français, celle des trois unités, d’action, de temps et de lieu. Si l’ensemble est classique au sens historique comme au sens stylistique, l’effet produit par cette pièce est en revanche au-delà du commun tant les enjeux nous empoignent le cœur et l’esprit sans daigner les lâcher avant le dernier mot.
Le mot de « référence » n’est pas donc volé ici. Pierre Corneille rend une copie parfaite avec cette œuvre, parfois oubliée, mais jamais déconsidérée, c’est mérité.
Deux 4ème au total, la seconde fut plus efficace que la première, maman était fière, l’honneur était sauf (ainsi soit-il). Cette année là je fus élu à l'unanimité membre éminent du « branlétériat » et en tant que tel, je me faisais une joie de lire cette grande pièce de théâtre dont je n’avais jamais entendu parlé et sur ce dernier point je faisais honneur à ma toute nouvelle nomination.
Nous avions hérité mes petits camarades et moi d’une jeune professeur de français, jolie à souhait, mais un peu "messe du dimanche" sur les formes et la mode. Il faut reconnaitre qu’elle était quand même moins nase que l’autre binoclarde dépressive de l’année d'avant.
Enfin bref, sortez le CID acte 1 scène 1
Ô Rodrigue, Ô Chimène…
Moi : pssssssitt psittttttttttttt
Future choupette : Quoiiiiiiiii
Moi : C’est quoi ton nom ?
Future choupette : Depuis 6 mois tu ne le connais pas ??
Moi : 6 mois déjà… bon alors c’est quoi ?
Future choupette : Choupette
Moi : Quoi tu es une meuf ?
Future choupette : Connard…
Prof messe du dimanche : Un commentaire M.Hugo
Moi : Oui Choupette est une meuf, et de face je me disais que ce n’était pas très flagrant…
(Rire général), oui j’étais cruel à cette époque et je prie chaque jour notre seigneur de pardonner mes offenses comme nous pardonnons bla bla bla…
Acte II
Ô Rodrigue, Ô Chimène… Ô Badi (celle là je peux l'a supprimer si nécessaire)
Moi : Putain c’est toujours la même chose cette pièce...
Mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort : ouep c’est clair,
mais je crois qu’il y a eu un mort ??
Moi : cool, sinon comment ça se passe avec ta meuf, vous avez couché ?
Mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort : Mais non putain, ça me vénère, j’ai quand même le droit de mettre mes doigts dedans, un truc de psychopathe...
Moi : Tropppppppppppppp cool "sa mère" (expression très en vogue à l'époque)… une vraie cochonne ta "Chimène..."
Mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort : ouep c’est clair…
Prof messe du dimanche : Un commentaire M.Hugo
Moi : Oui madame mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort est encore puceau "sa mère (très en vogue j'ai dit)
(Rire général), il faut garder à l’esprit que mes camarades avaient le même âge que moi…
Acte V
Les actes III et IV ne me semblent pas indispensables pour cet avis, à l’époque non plus d’ailleurs, bien sur j’ai relu cette pièce un plus tard et je dois reconnaitre que la maturité a su me convaincre que finalement les actes III et IV étaient tout de même importants, mine de rien.
Ce qu’il faut retenir c’est la rencontre avec ma "Chimène". Pour dire la vérité nous nous étions jamais adressés la parole cette année là et pendant les 4 années suivantes non plus…
Aujourd’hui ça fait 13 ans qu’on ne s’arrête plus… comme quoi des fois la vie est pleine de surprise.
Je n’ai jamais revu mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort depuis la 4ème, pourtant il n'est pas mort : dédicace à lui et toute la 4ème 2.
Une pensée particulière pour Corneille aussi. (Paix à son âme parce que lui il est bien clamsé)
A plus les copains
Nous avions hérité mes petits camarades et moi d’une jeune professeur de français, jolie à souhait, mais un peu "messe du dimanche" sur les formes et la mode. Il faut reconnaitre qu’elle était quand même moins nase que l’autre binoclarde dépressive de l’année d'avant.
Enfin bref, sortez le CID acte 1 scène 1
Ô Rodrigue, Ô Chimène…
Moi : pssssssitt psittttttttttttt
Future choupette : Quoiiiiiiiii
Moi : C’est quoi ton nom ?
Future choupette : Depuis 6 mois tu ne le connais pas ??
Moi : 6 mois déjà… bon alors c’est quoi ?
Future choupette : Choupette
Moi : Quoi tu es une meuf ?
Future choupette : Connard…
Prof messe du dimanche : Un commentaire M.Hugo
Moi : Oui Choupette est une meuf, et de face je me disais que ce n’était pas très flagrant…
(Rire général), oui j’étais cruel à cette époque et je prie chaque jour notre seigneur de pardonner mes offenses comme nous pardonnons bla bla bla…
Acte II
Ô Rodrigue, Ô Chimène… Ô Badi (celle là je peux l'a supprimer si nécessaire)
Moi : Putain c’est toujours la même chose cette pièce...
Mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort : ouep c’est clair,
mais je crois qu’il y a eu un mort ??
Moi : cool, sinon comment ça se passe avec ta meuf, vous avez couché ?
Mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort : Mais non putain, ça me vénère, j’ai quand même le droit de mettre mes doigts dedans, un truc de psychopathe...
Moi : Tropppppppppppppp cool "sa mère" (expression très en vogue à l'époque)… une vraie cochonne ta "Chimène..."
Mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort : ouep c’est clair…
Prof messe du dimanche : Un commentaire M.Hugo
Moi : Oui madame mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort est encore puceau "sa mère (très en vogue j'ai dit)
(Rire général), il faut garder à l’esprit que mes camarades avaient le même âge que moi…
Acte V
Les actes III et IV ne me semblent pas indispensables pour cet avis, à l’époque non plus d’ailleurs, bien sur j’ai relu cette pièce un plus tard et je dois reconnaitre que la maturité a su me convaincre que finalement les actes III et IV étaient tout de même importants, mine de rien.
Ce qu’il faut retenir c’est la rencontre avec ma "Chimène". Pour dire la vérité nous nous étions jamais adressés la parole cette année là et pendant les 4 années suivantes non plus…
Aujourd’hui ça fait 13 ans qu’on ne s’arrête plus… comme quoi des fois la vie est pleine de surprise.
Je n’ai jamais revu mon meilleur pote de tous les temps à la vie à la mort depuis la 4ème, pourtant il n'est pas mort : dédicace à lui et toute la 4ème 2.
Une pensée particulière pour Corneille aussi. (Paix à son âme parce que lui il est bien clamsé)
A plus les copains
Le dilemme cornélien ou l'art de s'empoisonner l'existence quand les amours s'épanouissent et les petits oiseaux gazouillent.
Adolescente, par détestation solidaire avec ma soeur ainée en proie à un enseignant aux tendances sadiques, je m'étais refusée à jeter la moindre oeillade sur le volatile classique, lui préférant le tubercule tout aussi classique. J'ai dévoré Racine et dédaigné Corneille. Lorsque ma propre fille commença à suer sur l'apprentissage d'une tirade (devinez laquelle) , je décidai d'entonner Le Cid, à voix haute, sans peur et sans reproche, jouant tous les rôles.
Une tirade déconnectée de son contexte me paraissait un exercice aussi vain que rébarbatif. Face donc à ma pré-adolescente, j'entamais la tragi-comédie avec le coeur d'une mère qu'aucun obstacle n'arrête.
Mais que diable allais-je faire dans cette galère? Non, ça c'est une autre pièce et ce n'est pas Corneille. Et ce ne fut pas une galère. Plutôt un plaisir. Même si… Chimène m'a considérablement agacée.
Chimène aime Rodrigue qui l'aime. Ils sont jeunes, beaux, de noble extraction et sentent bon le sable chaud. Mais la comédie romantique trébuche en raison d'une querelle gériatrique. Le papa de Chimène se dispute avec le papa de Rodrigue, lequel est méchamment souffleté. La santé chancelante mais l'honneur rougeoyant, le papa mande son rejeton afin que justice lui soit rendue.Le petit Rodrigue trucide donc celui qui aurait pu être son beau-papa. Entre amour et honneur, sentiment et devoir familial, on ne barguigne pas.
Chimène prend le même chemin que son amoureux et demande au roi sa tête, lequel envoie l'amoureux en entier chasser le Maure. Il en revient auréolé de gloire. Encore plus légionnaire que jamais (l'odeur de sable chaud, hum), Chimène succombe davantage mais mais mais… Rodrigue reste l'assassin de papa. Le devoir reste le devoir. Elle veut obtenir justice quitte à gâcher sa vie. Don Sanche qui aime Chimène sera son champion. Un duel est organisé par cette idiote de Chimène qui a un talent fou pour créer des situations inextricables. Elle épousera le vainqueur. Donc soit elle épousera l'assassin de papa (qu'elle aime), soit elle épousera l'assassin de son amoureux (qu'elle n'aime pas). On comprend qu'elle motive Rodrigue pour combattre, la petite hypocrite.
Au final, Rodrigue sort vainqueur. Chimène peut donc l'épouser en respectant sa parole. Son honneur est sauf.
Et ben, non! Elle chipote, elle tergiverse. Oui mais non. Je ne peux pas. Mon papa… Il faut que le roi lui ordonne de se marier avec Rodrigue après un délai de un an.
Combien les héroïnes raciniennes me touchent davantage!
Je me plais à imaginer que l'Infante, sensible aux charmes de Rodrigue, aura mis à profit les douze mois d'ergotage de Chimène. Je ne suis pas soumise à l'unité de temps.
Adolescente, par détestation solidaire avec ma soeur ainée en proie à un enseignant aux tendances sadiques, je m'étais refusée à jeter la moindre oeillade sur le volatile classique, lui préférant le tubercule tout aussi classique. J'ai dévoré Racine et dédaigné Corneille. Lorsque ma propre fille commença à suer sur l'apprentissage d'une tirade (devinez laquelle) , je décidai d'entonner Le Cid, à voix haute, sans peur et sans reproche, jouant tous les rôles.
Une tirade déconnectée de son contexte me paraissait un exercice aussi vain que rébarbatif. Face donc à ma pré-adolescente, j'entamais la tragi-comédie avec le coeur d'une mère qu'aucun obstacle n'arrête.
Mais que diable allais-je faire dans cette galère? Non, ça c'est une autre pièce et ce n'est pas Corneille. Et ce ne fut pas une galère. Plutôt un plaisir. Même si… Chimène m'a considérablement agacée.
Chimène aime Rodrigue qui l'aime. Ils sont jeunes, beaux, de noble extraction et sentent bon le sable chaud. Mais la comédie romantique trébuche en raison d'une querelle gériatrique. Le papa de Chimène se dispute avec le papa de Rodrigue, lequel est méchamment souffleté. La santé chancelante mais l'honneur rougeoyant, le papa mande son rejeton afin que justice lui soit rendue.Le petit Rodrigue trucide donc celui qui aurait pu être son beau-papa. Entre amour et honneur, sentiment et devoir familial, on ne barguigne pas.
Chimène prend le même chemin que son amoureux et demande au roi sa tête, lequel envoie l'amoureux en entier chasser le Maure. Il en revient auréolé de gloire. Encore plus légionnaire que jamais (l'odeur de sable chaud, hum), Chimène succombe davantage mais mais mais… Rodrigue reste l'assassin de papa. Le devoir reste le devoir. Elle veut obtenir justice quitte à gâcher sa vie. Don Sanche qui aime Chimène sera son champion. Un duel est organisé par cette idiote de Chimène qui a un talent fou pour créer des situations inextricables. Elle épousera le vainqueur. Donc soit elle épousera l'assassin de papa (qu'elle aime), soit elle épousera l'assassin de son amoureux (qu'elle n'aime pas). On comprend qu'elle motive Rodrigue pour combattre, la petite hypocrite.
Au final, Rodrigue sort vainqueur. Chimène peut donc l'épouser en respectant sa parole. Son honneur est sauf.
Et ben, non! Elle chipote, elle tergiverse. Oui mais non. Je ne peux pas. Mon papa… Il faut que le roi lui ordonne de se marier avec Rodrigue après un délai de un an.
Combien les héroïnes raciniennes me touchent davantage!
Je me plais à imaginer que l'Infante, sensible aux charmes de Rodrigue, aura mis à profit les douze mois d'ergotage de Chimène. Je ne suis pas soumise à l'unité de temps.
Quelle pièce de théâtre froide et vénale de pouvoir ! Quand on y pense, ils étaient assez barbares à cette époque là !
Tout commence avec une discussion animée entre Le roi et Don Diègue dont ce dernier reçoit un petit soufflet bien placé. Dieu, qu'a-t-il osé faire ?! Partant sous les menaces, l'offensé se rendit chez son fils, lui donnant l'ordre d'aller sauver l'honneur de leur famille en tuant ce comte qui a osé lui manquer de respect. Le gamin comprit qu'il n'avait pas le choix et sentit même le courage de le faire mais quand le nom de la personne tomba ... Il se fit souffleter aussi, de façon imaginaire ! Il devait tuer son futur-beau père, au risque presque sûr de perdre sa bien-aimée ! Oualala, que faire ? Tant pis, allons le tuer ... L'honneur de la famille prime avant tout. C'est ce qu'il fit. Les rumeurs courts et s'éloignent jusqu'aux oreilles de cette bien-aimée, Chimène qui ne veut pas croire en cette situation désastreuse qui, quelques heures auparavant, était tout autre. Perdue, effrayée et complètement colérique, elle se rend sur les terres où son père est mort. Le sang est répandu, sa haine monte contre celui qui avait emprisonné son coeur. Il fallait qu'elle aille voir le roi. Elle y alla et demanda la mort de Rodrigue, ce gamin qui n'avait écouter que la voix de son père et des valeurs familiales. Elle veut qu'on l'immole mais elle est triste, parce qu'elle l'aiiiiime. La vengeance prend le dessus sur les sentiments et Rodrigue, ivre de honte, va à la rencontre de la femme qu'il aime, pour qu'elle le tue de ses propres mains. Mais elle ne peut pas, elle en est incapable et donc, partant triste de ne pas être mort, Rodrigue se retrouve avec son père, l'élément déclencheur orgueilleux qui a déclaré tout ce bordel, qui lui dicte LA solution pour la reconquérir et ainsi reconquérir le roi qui trouvait normal qu'on l'immole. « Agis en guerrier et va niquer tout ses maures qui arrivent sur nos terres ». D'accord, il y alla. Briser des têtes et répandre des corps morts pour gagner le coeur d'une femme, c'est tout a fait faisable ! Et il le fit ! WOUAW, c'est devenu le CID ! Il devient LE guerrier que tout le monde redoute, qui fait trembler les familles à l'annonce de son nom.
Mais attention, Chimène n'est pas très contente bien sûr. Il est devenu le VIP de Séville, le mec qu'on vénère dans toute sa splendeur et cela ne lui convient pas. Elle veut qu'il souffre psychologiquement et à la fois, elle veut avoir sa tête entre ses mains pour venger son père.
Ok, un deal se fait ... Un DUEL proposé par Chimène. Celui qui coupera la tête de l'homme qu'elle aime, elle le fera sien. (J'ai éclaté de rire à cette scène). Don Sanche se propose, éperdument amoureux de la femme, c'est pour lui une occasion en OR. Donc bon, plus tard, Don Sanche se rend chez Chimène avec une épée ensanglantée ... Et là, elle s'emballe ! Comment a-t-il osé tué celui qu'elle adorait ??!! Elle réclame justice .... Elle va trouver le roi (dont je suis certaine n'en pouvait plus de cette femme!) et il lui annonce que son Rodrigue, être chérit qui en bave des tonnes, n'est pas mort. Outragée, elle se demande pourquoi la mort de son père n'est-elle pas vengée mais elle est tout à la fois soulagée de le savoir en vie ... Donc, ça se termine en « Chimène a un an pour sécher ses larmes pendant que Rodrigue aille se proclamer roi chez les Maures avant qu'ils ne se marient » ... Et voilà, c'est terminé et heureusement pour Chimène, car d'une manière ou d'une autre, je crois que je l'aurai étranglé pour qu'elle se taise. Déjà, je ne comprend pas comment le Roi a pu rester stoïque face à un comportement si lunatique et si ... bête. Si j'avais été à sa place, je lui aurai flanqué une chaussette puante dans la bouche pour qu'elle se taise pendant des heures après s'être évanouie !
Dans cette pièce, je plains deux personnes ... Le gentil toutou qu'est Rodrigue pour tout ce qu'il subit (si nous n'avions pas un peu de compassion pour lui, se serait dommage quand même) et pour l'Infante qui ne cesse de pleurer un amour qu'elle n'aura jamais ... Haaa, cette oeuvre m'a retourné sur bien des émotions ! Heureusement que son caractère poétique a réussit à ne pas me faire péter un plomb en milieu de lecture, que je suis entrain d'écrire maintenant ... pfiou ! Retenir son souffle durant toute l'histoire fut très difficile ...
Tout commence avec une discussion animée entre Le roi et Don Diègue dont ce dernier reçoit un petit soufflet bien placé. Dieu, qu'a-t-il osé faire ?! Partant sous les menaces, l'offensé se rendit chez son fils, lui donnant l'ordre d'aller sauver l'honneur de leur famille en tuant ce comte qui a osé lui manquer de respect. Le gamin comprit qu'il n'avait pas le choix et sentit même le courage de le faire mais quand le nom de la personne tomba ... Il se fit souffleter aussi, de façon imaginaire ! Il devait tuer son futur-beau père, au risque presque sûr de perdre sa bien-aimée ! Oualala, que faire ? Tant pis, allons le tuer ... L'honneur de la famille prime avant tout. C'est ce qu'il fit. Les rumeurs courts et s'éloignent jusqu'aux oreilles de cette bien-aimée, Chimène qui ne veut pas croire en cette situation désastreuse qui, quelques heures auparavant, était tout autre. Perdue, effrayée et complètement colérique, elle se rend sur les terres où son père est mort. Le sang est répandu, sa haine monte contre celui qui avait emprisonné son coeur. Il fallait qu'elle aille voir le roi. Elle y alla et demanda la mort de Rodrigue, ce gamin qui n'avait écouter que la voix de son père et des valeurs familiales. Elle veut qu'on l'immole mais elle est triste, parce qu'elle l'aiiiiime. La vengeance prend le dessus sur les sentiments et Rodrigue, ivre de honte, va à la rencontre de la femme qu'il aime, pour qu'elle le tue de ses propres mains. Mais elle ne peut pas, elle en est incapable et donc, partant triste de ne pas être mort, Rodrigue se retrouve avec son père, l'élément déclencheur orgueilleux qui a déclaré tout ce bordel, qui lui dicte LA solution pour la reconquérir et ainsi reconquérir le roi qui trouvait normal qu'on l'immole. « Agis en guerrier et va niquer tout ses maures qui arrivent sur nos terres ». D'accord, il y alla. Briser des têtes et répandre des corps morts pour gagner le coeur d'une femme, c'est tout a fait faisable ! Et il le fit ! WOUAW, c'est devenu le CID ! Il devient LE guerrier que tout le monde redoute, qui fait trembler les familles à l'annonce de son nom.
Mais attention, Chimène n'est pas très contente bien sûr. Il est devenu le VIP de Séville, le mec qu'on vénère dans toute sa splendeur et cela ne lui convient pas. Elle veut qu'il souffre psychologiquement et à la fois, elle veut avoir sa tête entre ses mains pour venger son père.
Ok, un deal se fait ... Un DUEL proposé par Chimène. Celui qui coupera la tête de l'homme qu'elle aime, elle le fera sien. (J'ai éclaté de rire à cette scène). Don Sanche se propose, éperdument amoureux de la femme, c'est pour lui une occasion en OR. Donc bon, plus tard, Don Sanche se rend chez Chimène avec une épée ensanglantée ... Et là, elle s'emballe ! Comment a-t-il osé tué celui qu'elle adorait ??!! Elle réclame justice .... Elle va trouver le roi (dont je suis certaine n'en pouvait plus de cette femme!) et il lui annonce que son Rodrigue, être chérit qui en bave des tonnes, n'est pas mort. Outragée, elle se demande pourquoi la mort de son père n'est-elle pas vengée mais elle est tout à la fois soulagée de le savoir en vie ... Donc, ça se termine en « Chimène a un an pour sécher ses larmes pendant que Rodrigue aille se proclamer roi chez les Maures avant qu'ils ne se marient » ... Et voilà, c'est terminé et heureusement pour Chimène, car d'une manière ou d'une autre, je crois que je l'aurai étranglé pour qu'elle se taise. Déjà, je ne comprend pas comment le Roi a pu rester stoïque face à un comportement si lunatique et si ... bête. Si j'avais été à sa place, je lui aurai flanqué une chaussette puante dans la bouche pour qu'elle se taise pendant des heures après s'être évanouie !
Dans cette pièce, je plains deux personnes ... Le gentil toutou qu'est Rodrigue pour tout ce qu'il subit (si nous n'avions pas un peu de compassion pour lui, se serait dommage quand même) et pour l'Infante qui ne cesse de pleurer un amour qu'elle n'aura jamais ... Haaa, cette oeuvre m'a retourné sur bien des émotions ! Heureusement que son caractère poétique a réussit à ne pas me faire péter un plomb en milieu de lecture, que je suis entrain d'écrire maintenant ... pfiou ! Retenir son souffle durant toute l'histoire fut très difficile ...
La comédie. Voilà un registre où l'on n'attend pas forcément le grand Corneille de prime abord et pourtant d'un battement d'aile le voici nous servant une tragi-comédie pleine d'humour et de finesse.
Par le biais d'une mise en abîme que j'ai peu l'habitude de croiser au théâtre, l'illustre tragédien donne donc dans le comique. Pour ce faire, et comme le nom de la pièce l'indique, le jeu des illusions est de mise.
J'ai particulièrement aimé les personnages secondaires, Lyse, la servante d'Isabelle, et le capitaine Matamore (le bien-nommé) qui m'ont fait beaucoup sourire. Les amours plus ou moins crédibles s'entrecroisent et les espoirs tournent casaque à chaque scène. Le pied-de-nez final est croustillant, je ne vous en dirais donc rien.
Alcandre, le mage grand illusionniste qui coordonne tout le récit, aura ce mot fataliste et philosophe que je goûte tout particulièrement parce qu'il nie sa capacité à dévier le destin par sa magie :
"Ainsi de notre espoir la fortune se joue :
Tout s’élève ou s’abaisse au branle de sa roue :
Et son ordre inégal, qui régit l’univers,
Au milieu du bonheur a ses plus grands revers."
Une belle découverte classique.
Par le biais d'une mise en abîme que j'ai peu l'habitude de croiser au théâtre, l'illustre tragédien donne donc dans le comique. Pour ce faire, et comme le nom de la pièce l'indique, le jeu des illusions est de mise.
J'ai particulièrement aimé les personnages secondaires, Lyse, la servante d'Isabelle, et le capitaine Matamore (le bien-nommé) qui m'ont fait beaucoup sourire. Les amours plus ou moins crédibles s'entrecroisent et les espoirs tournent casaque à chaque scène. Le pied-de-nez final est croustillant, je ne vous en dirais donc rien.
Alcandre, le mage grand illusionniste qui coordonne tout le récit, aura ce mot fataliste et philosophe que je goûte tout particulièrement parce qu'il nie sa capacité à dévier le destin par sa magie :
"Ainsi de notre espoir la fortune se joue :
Tout s’élève ou s’abaisse au branle de sa roue :
Et son ordre inégal, qui régit l’univers,
Au milieu du bonheur a ses plus grands revers."
Une belle découverte classique.
Rome et Albe, les sœurs ennemies, sont en guerre pour décider laquelle est supérieure et maîtresse de l’autre. Alors qu’elles s’apprêtent pour la bataille finale qui engendrera morts et désespoir des deux côtés, le roi d’Albe propose de résoudre la question tout en limitant les dégâts : un affrontement de champions. Mais le tragique du carnage annoncé se métamorphose en tragique familial, car les champions choisis – les trois Horace pour Rome et les trois Curiace pour Albe – sont liés par des liens d’amour et de mariage : Horace est marié à Sabine, sœur de Curiace, et Curiace est fiancé à Camille, sœur d’Horace. Les règles de l’honneur et l’amour de la Patrie l’emporte chez les hommes au grand désespoir des femmes ; l’affrontement est sans pitié, indécis, avec rebondissement. Au final Horace, mari de Sabine, demeure seul en vie et Rome est vainqueur. Dominée par le chagrin et l’envie de vengeance, Camille rejette Rome qui la prive de son bonheur. Horace n’accepte pas cette trahison et la tue. Le dernier acte conte le procès de cet homme qui apporte gloire à sa cité mais est aussi criminel. Son premier geste prévaut-il sur le second ? Tulle, le roi de Rome, décide que oui, car la raison de l’État ne peut que prévaloir devant l’injustice d’un crime de sang.
Il s’agit de la première vraie tragédie de Corneille, décrivant une situation qui justifie magnifiquement la création de l’adjectif « cornélien ». Les personnages sont déchirés entre amour et honneur, entre loyauté envers leur moitié et loyauté envers leur patrie. Chacun se détermine différemment devant ce choix. Horace est un bloc de gloire guerrière et de patriotisme à l’état brut, Curiace accepte aussi la primauté de l’honneur mais contraint et forcé, regrettant de devoir affronter son beau-frère. Camille n’a de cesse d’essayer de les dissuader et, quand son amour est détruit, rejette entièrement sa patrie. Sabine geint, dépassée par les évènements et la force de caractère des trois autres, elle tente à plusieurs reprises et sans succès d’élever son héroïsme au niveau de celui des autres.
L’édition du Livre de Poche est riche d’un commentaire détaillé sur la pièce. On apprend les diverses interprétations du comportement des acteurs qui ont dominé au cours des temps. Mais il ne faut pas le considérer comme un jugement définitivement cristallisé. L’apport majeur de cette pièce est en effet la réflexion qu’elle induit chez la personne qui la lit. Et cette réflexion ne peut être, ne doit être que multiforme. Le meurtre de Camille par son frère Horace est probablement le sujet de réflexion le plus riche. Corneille n’a pas inventé cet acte, il s’est inspiré de l’histoire racontée par Tite-Live. Dès la sortie de la pièce les critiques ont désapprouvé ce geste qui tâche la gloire naissante du héros. Longtemps il a imposé Horace comme une simple brute. Alain Couprie, le commentateur de l’édition Livre de Poche, s’oppose à cette interprétation, note nombre d’interventions d’Horace qui traduisent sa douleur profonde de la situation mais aussi son comportement de samouraï qui efface tout hormis la gloire et le service à la patrie dans l’apparence qu’il présente aux autres. Pour Couprie, le meurtre de Camille n’est que le prolongement raisonné de l’élimination de toutes les menaces envers Rome, au nom de la Raison d’État (vision qui soit dit en passant a dû plaire au Cardinal de Richelieu à qui la pièce est dédiée). Je ne le suis pas entièrement sur ce terrain. Horace m’est apparu effectivement comme un samouraï soumis à l’honneur, mais je vois le meurtre de Camille comme un geste inspiré par l’émotion de l’instant. Il vient de faire triompher Rome, la gloire éternelle lui est acquise, il est dévoré par ce sentiment jouissif et il est certain d’incarner en cet instant la justice divine. En cet instant il est au-dessus du Roi, il n’est plus soumis aux lois des hommes. Camille a alors le malheur de menacer Rome. Dans son état d’esprit Horace ne voit plus sa sœur mais seulement un autre Curiace, un autre obstacle à Rome qu’il incarne et qu’en tant qu’incarnation de la Justice il élimine d’un geste.
Je m’arrête là. On pourrait écrire un livre avec les impressions et les réflexions que peuvent inspirer la pièce et ses commentaires mais vous devez déjà être lassés de mes élucubrations.
Lisez-là. Faites-vous votre propre opinion.
Il s’agit de la première vraie tragédie de Corneille, décrivant une situation qui justifie magnifiquement la création de l’adjectif « cornélien ». Les personnages sont déchirés entre amour et honneur, entre loyauté envers leur moitié et loyauté envers leur patrie. Chacun se détermine différemment devant ce choix. Horace est un bloc de gloire guerrière et de patriotisme à l’état brut, Curiace accepte aussi la primauté de l’honneur mais contraint et forcé, regrettant de devoir affronter son beau-frère. Camille n’a de cesse d’essayer de les dissuader et, quand son amour est détruit, rejette entièrement sa patrie. Sabine geint, dépassée par les évènements et la force de caractère des trois autres, elle tente à plusieurs reprises et sans succès d’élever son héroïsme au niveau de celui des autres.
L’édition du Livre de Poche est riche d’un commentaire détaillé sur la pièce. On apprend les diverses interprétations du comportement des acteurs qui ont dominé au cours des temps. Mais il ne faut pas le considérer comme un jugement définitivement cristallisé. L’apport majeur de cette pièce est en effet la réflexion qu’elle induit chez la personne qui la lit. Et cette réflexion ne peut être, ne doit être que multiforme. Le meurtre de Camille par son frère Horace est probablement le sujet de réflexion le plus riche. Corneille n’a pas inventé cet acte, il s’est inspiré de l’histoire racontée par Tite-Live. Dès la sortie de la pièce les critiques ont désapprouvé ce geste qui tâche la gloire naissante du héros. Longtemps il a imposé Horace comme une simple brute. Alain Couprie, le commentateur de l’édition Livre de Poche, s’oppose à cette interprétation, note nombre d’interventions d’Horace qui traduisent sa douleur profonde de la situation mais aussi son comportement de samouraï qui efface tout hormis la gloire et le service à la patrie dans l’apparence qu’il présente aux autres. Pour Couprie, le meurtre de Camille n’est que le prolongement raisonné de l’élimination de toutes les menaces envers Rome, au nom de la Raison d’État (vision qui soit dit en passant a dû plaire au Cardinal de Richelieu à qui la pièce est dédiée). Je ne le suis pas entièrement sur ce terrain. Horace m’est apparu effectivement comme un samouraï soumis à l’honneur, mais je vois le meurtre de Camille comme un geste inspiré par l’émotion de l’instant. Il vient de faire triompher Rome, la gloire éternelle lui est acquise, il est dévoré par ce sentiment jouissif et il est certain d’incarner en cet instant la justice divine. En cet instant il est au-dessus du Roi, il n’est plus soumis aux lois des hommes. Camille a alors le malheur de menacer Rome. Dans son état d’esprit Horace ne voit plus sa sœur mais seulement un autre Curiace, un autre obstacle à Rome qu’il incarne et qu’en tant qu’incarnation de la Justice il élimine d’un geste.
Je m’arrête là. On pourrait écrire un livre avec les impressions et les réflexions que peuvent inspirer la pièce et ses commentaires mais vous devez déjà être lassés de mes élucubrations.
Lisez-là. Faites-vous votre propre opinion.
C'est toujours un plaisir de lire les tragédies classiques. Ici c'est la fameuse pièce de Corneille "Cinna". Une tragédie d'origine romaine dont le sujet est tiré d'une page d'Histoire que raconte Sénèque dans l'un de ses livres intitulé "De la clémence" et qui se trouve reproduite voire paraphrasée dans les "Essais" de Montaigne. D'ailleurs, Corneille a placé ce passage en tête de l'édition originale de sa pièce. Néanmoins, il se peut que cette histoire soit inventée ou modifiée par Sénèque puisqu’on ne peut vérifier sa réalité. Rappelons que le grand Suétone ne l’a jamais mentionnée dans ses ouvrages.
Par contre, l'intrigue renvoie aussi à un épisode plutôt contemporain où l'on retrouve un complot monté par une femme et où se mêlent politique et amour. Il s'agit d'une conspiration menée par une certaine Mme de Chevreuse et son amoureux le ministre Chalais contre l'illustre cardinal de Richelieu. Certes, cette période-là avait connu de nombreux incidents semblables à cause du pouvoir autoritaire du cardinal.
Dans cette tragédie, on retrouve le dilemme cornélien. Cette fois, il concerne plusieurs personnages dans la pièce et ces tiraillements on les trouve dans leur monologue. Et il faut avouer que ceux de Cinna et d'Auguste étaient de véritables chefs-d’œuvre. Dans celui d'Auguste, par exemple, Corneille nous présente une conception intéressante du pouvoir dans un style magnifique. Ce même Auguste qui fait preuve de clémence et donne ainsi un exemple de grandeur incomparable.
Corneille a choisi ici une intrigue très intéressante, voire captivante, pour créer sa tragédie. En outre, il met en œuvre tout son art et son éloquence ; son analyse psychologique pour nous présenter les nuances de sentiments forts qui animent ses personnages, les perdent ou les élèvent.
Par contre, l'intrigue renvoie aussi à un épisode plutôt contemporain où l'on retrouve un complot monté par une femme et où se mêlent politique et amour. Il s'agit d'une conspiration menée par une certaine Mme de Chevreuse et son amoureux le ministre Chalais contre l'illustre cardinal de Richelieu. Certes, cette période-là avait connu de nombreux incidents semblables à cause du pouvoir autoritaire du cardinal.
Dans cette tragédie, on retrouve le dilemme cornélien. Cette fois, il concerne plusieurs personnages dans la pièce et ces tiraillements on les trouve dans leur monologue. Et il faut avouer que ceux de Cinna et d'Auguste étaient de véritables chefs-d’œuvre. Dans celui d'Auguste, par exemple, Corneille nous présente une conception intéressante du pouvoir dans un style magnifique. Ce même Auguste qui fait preuve de clémence et donne ainsi un exemple de grandeur incomparable.
Corneille a choisi ici une intrigue très intéressante, voire captivante, pour créer sa tragédie. En outre, il met en œuvre tout son art et son éloquence ; son analyse psychologique pour nous présenter les nuances de sentiments forts qui animent ses personnages, les perdent ou les élèvent.
L'héroïsme cornélien apparaît dans cette tragédie d'inspiration romaine sous sa meilleure représentation. Il faut avouer qu'autrefois, on aimait cette manière si héroïque de mener une guerre, en choisissant un ou trois guerriers de chaque clan. Ces braves s'entretuent avec altruisme et abnégation pour la gloire de la patrie faisant preuve de courage et de patriotisme.
Je ne sais pas, mais on aime toujours voir ce genre de combat ou de duel. Rappelez-vous ceux dans le film de "Troie" avec Brad Pitt par exemple. Ici, on les décrit puisqu'on ne peut les présenter sur scène suivant les règles de bienséance. Il est vrai aussi que ces règles classiques limitaient beaucoup la liberté des dramaturges de l'époque. Mais pour Corneille, c'était un défi qu'il devait absolument affronter et réussir après la célèbre querelle du "Cid".
L'intrigue romaine renvoie aussi à ce conflit franco-espagnole où la reine de France affronte son frère le roi d'Espagne et où le roi de la France et frère de la reine d'Espagne ! Curiace et Sabine ; Horace et Camille ! Mais bref, laissons de côté cette page d'Histoire, et concentrons-nous sur cette tragédie.
En plus de cette histoire de duel décisif pour la victoire d'un clan, dont j'ai parlé au début, il y a dans cette tragédie cette affaire d'amours conflictuelles où deux personnes originaires de deux familles ennemies s'aiment. Le sujet même de "Romeo et Juliette" de notre cher Shakespeare. Sujet, d’ailleurs, qui a inspiré tant de romans et de films.
Finalement, j’aimerai attirer l’attention sur un point, que je vois important, concernant le dernier acte qui paraît un peu étrange. Rappelons que lors du quatrième acte, on est devant un sommet du tragique et un exemple extraordinaire de coup de théâtre grâce aux exploits du brave Horace. Ce dernier a mené jusqu’au bout son abnégation en sacrifiant tout pour sa patrie, même sa sœur ! Ce surhomme qui se croit tout permis pour la réalisation d’un projet si grand ! Alors, après ce grand spectacle, on doit assister au cinquième acte où on recommande le jugement de ce criminel, c’est d’ailleurs ce que demande un soupirant de la sœur d’Horace. Mais voilà que le roi doit intervenir pour donner sa grâce et montrer sa générosité. Mais est-ce là un message de Corneille que malgré les prouesses des héros, on se rappelle toujours du dernier mot ; celui du roi ? Peut-être !
Je ne sais pas, mais on aime toujours voir ce genre de combat ou de duel. Rappelez-vous ceux dans le film de "Troie" avec Brad Pitt par exemple. Ici, on les décrit puisqu'on ne peut les présenter sur scène suivant les règles de bienséance. Il est vrai aussi que ces règles classiques limitaient beaucoup la liberté des dramaturges de l'époque. Mais pour Corneille, c'était un défi qu'il devait absolument affronter et réussir après la célèbre querelle du "Cid".
L'intrigue romaine renvoie aussi à ce conflit franco-espagnole où la reine de France affronte son frère le roi d'Espagne et où le roi de la France et frère de la reine d'Espagne ! Curiace et Sabine ; Horace et Camille ! Mais bref, laissons de côté cette page d'Histoire, et concentrons-nous sur cette tragédie.
En plus de cette histoire de duel décisif pour la victoire d'un clan, dont j'ai parlé au début, il y a dans cette tragédie cette affaire d'amours conflictuelles où deux personnes originaires de deux familles ennemies s'aiment. Le sujet même de "Romeo et Juliette" de notre cher Shakespeare. Sujet, d’ailleurs, qui a inspiré tant de romans et de films.
Finalement, j’aimerai attirer l’attention sur un point, que je vois important, concernant le dernier acte qui paraît un peu étrange. Rappelons que lors du quatrième acte, on est devant un sommet du tragique et un exemple extraordinaire de coup de théâtre grâce aux exploits du brave Horace. Ce dernier a mené jusqu’au bout son abnégation en sacrifiant tout pour sa patrie, même sa sœur ! Ce surhomme qui se croit tout permis pour la réalisation d’un projet si grand ! Alors, après ce grand spectacle, on doit assister au cinquième acte où on recommande le jugement de ce criminel, c’est d’ailleurs ce que demande un soupirant de la sœur d’Horace. Mais voilà que le roi doit intervenir pour donner sa grâce et montrer sa générosité. Mais est-ce là un message de Corneille que malgré les prouesses des héros, on se rappelle toujours du dernier mot ; celui du roi ? Peut-être !
Je n’ai pas encore lu les versions de Médée d’Euripide et de Sénèque ; je ne peux donc pas comparer. En lisant la préface et l’examen par l’auteur (c’est systématique dans mon intégrale) j’ai cependant compris que Corneille, situé plutôt dans le camp des « modernes » opposé aux « anciens », a été « obligé » d’écrire une pièce se référant à la mythologie. Mais il l’a fait en prenant le parti d’effacer ce qu’il estimait être les incohérences des textes antiques, en les rationalisant en quelque sorte.
Mais de quoi parlons-t-on ici ? Médée est une magicienne séduite par Jason lors de la quête de ce dernier à la recherche de la toison d’or. Elle l’aide grandement à atteindre son but, allant jusqu’à verser le sang de sa famille (elle découpe son frère en morceaux quand même).
Tous deux trouvent asile à Corinthe. Là, Jason ‒ chez qui le mot fidélité résonne dans un vide abyssal ‒ craque pour Créuse, la fille du roi Créon, et l’attirance est évidemment réciproque. Il faut « seulement » écarter Médée. Comme si celle-ci allait se laisser faire. Médée, c’est Attila en femme : là où elle passe, l’herbe ne repousse pas. Créon et Créuse sont détruits parce qu’ils touchent un manteau de Médée qui a baigné dans un cocktail empoisonné dont on a perdu la formule. Pour désespérer Jason encore plus, elle tue elle-même les enfants qu’elle a eu avec lui (ses propres enfants, donc). Puis elle s’en va. Jason hésite entre la poursuivre et se tuer et finit par opter pour la deuxième solution.
C’est une pièce puissante dont la mélodie des vers est vraiment agréable à lire. A l’époque (c’est sa première véritable tragédie si on oublie Clitandre) Corneille ne fait pas trop d’effort pour respecter les unités de lieu et d’action. Il n’hésite pas à montrer de l’action sur scène.
On voit effectivement que l’auteur a fait des efforts pour expliquer des comportements plutôt bizarres, même si parfois ça fait flop – par exemple quand il explique que Créuse porte le manteau dont Médée lui fait don. Créuse aurait eu une passion totale pour ce manteau et aurait d »mandé à Jason de le lui offrir.
Moi je me serai méfié, sachant à qui j’ai affaire. Et on tombe là sur le problème principal du scénario : à qui a-t-on vraiment affaire avec Médée ? Elle se vante plusieurs fois d’être capable de déchaîner les éléments au point de pouvoir annihiler Corinthe. Elle serait aussi dangereuse qu’une bombe atomique. Pourtant, ses adversaires n’hésitent pas à l’exiler sans craindre son courroux ; ils la prennent de haut, la sous-estiment carrément.
Mais si elle est si puissante, pourquoi préfère-t-elle employer des méthodes sournoises pour se venger, alors qu’elle pourrait, selon elle, tout anéantir d’un geste ? Pourquoi cherche-t-elle un nouvel asile en portant assistance à Égée, roi d’Athènes ? Que peut-elle craindre vraiment ?
Mais si elle n’est pas puissante, comment fait-elle pour quitter la scène sur un char volant tiré par des dragons ?
Vous voyez, il y a un problème quelque part.
Mais de quoi parlons-t-on ici ? Médée est une magicienne séduite par Jason lors de la quête de ce dernier à la recherche de la toison d’or. Elle l’aide grandement à atteindre son but, allant jusqu’à verser le sang de sa famille (elle découpe son frère en morceaux quand même).
Tous deux trouvent asile à Corinthe. Là, Jason ‒ chez qui le mot fidélité résonne dans un vide abyssal ‒ craque pour Créuse, la fille du roi Créon, et l’attirance est évidemment réciproque. Il faut « seulement » écarter Médée. Comme si celle-ci allait se laisser faire. Médée, c’est Attila en femme : là où elle passe, l’herbe ne repousse pas. Créon et Créuse sont détruits parce qu’ils touchent un manteau de Médée qui a baigné dans un cocktail empoisonné dont on a perdu la formule. Pour désespérer Jason encore plus, elle tue elle-même les enfants qu’elle a eu avec lui (ses propres enfants, donc). Puis elle s’en va. Jason hésite entre la poursuivre et se tuer et finit par opter pour la deuxième solution.
C’est une pièce puissante dont la mélodie des vers est vraiment agréable à lire. A l’époque (c’est sa première véritable tragédie si on oublie Clitandre) Corneille ne fait pas trop d’effort pour respecter les unités de lieu et d’action. Il n’hésite pas à montrer de l’action sur scène.
On voit effectivement que l’auteur a fait des efforts pour expliquer des comportements plutôt bizarres, même si parfois ça fait flop – par exemple quand il explique que Créuse porte le manteau dont Médée lui fait don. Créuse aurait eu une passion totale pour ce manteau et aurait d »mandé à Jason de le lui offrir.
Moi je me serai méfié, sachant à qui j’ai affaire. Et on tombe là sur le problème principal du scénario : à qui a-t-on vraiment affaire avec Médée ? Elle se vante plusieurs fois d’être capable de déchaîner les éléments au point de pouvoir annihiler Corinthe. Elle serait aussi dangereuse qu’une bombe atomique. Pourtant, ses adversaires n’hésitent pas à l’exiler sans craindre son courroux ; ils la prennent de haut, la sous-estiment carrément.
Mais si elle est si puissante, pourquoi préfère-t-elle employer des méthodes sournoises pour se venger, alors qu’elle pourrait, selon elle, tout anéantir d’un geste ? Pourquoi cherche-t-elle un nouvel asile en portant assistance à Égée, roi d’Athènes ? Que peut-elle craindre vraiment ?
Mais si elle n’est pas puissante, comment fait-elle pour quitter la scène sur un char volant tiré par des dragons ?
Vous voyez, il y a un problème quelque part.
Si je dis « Va, cours, vole et nous venge » Tout le monde ou presque répondra Le Cid. Il est de ces œuvres qu’on connaît partiellement sans les avoir lues. C’est le cas de celle-ci, c’est ma première lecture mais j’ai rencontré régulièrement des vers que je connaissais.
Inspirée de la pièce de Guillén de Castro, Les enfances (les débuts) du Cid, inspirée de la vie de Rodrigo Diaz de Bivar, chevalier espagnol du 11ème siècle, héros de la Reconquista. (Je vous renvoie à l’excellente critique de Nastasia-B). L’Espagne est à la mode et Corneille y trouve les ingrédients d’une tragi-comédie, elle est jouée pour la première fois en janvier 1636.
C’est un théâtre où les plus hautes valeurs sont exaltées. Rodrigue et Chimène s’aiment et sont promis l’un à l’autre. Malheureusement pour une question de jalousie quant au rôle de Gouverneur du Prince, accordé par le Roi à Don Diègue, le père de Chimène, le conte de Gormas valeureux guerrier en pleine force de l’âge, soufflette le père de Rodrigue chevalier ayant également fait ses preuves mais amoindri par l’âge, qui ne peut soutenir le duel qui s’impose. A l’inverse d’un gamin d’aujourd’hui qui dirait « j’vais l’dire à mon papa, mon papa c’est l’plus fort ». Don Diègue, lui va se plaindre à son fils. Avec le fameux « Va, cours, vole et nous venge. » Nous venge, c’est le nom, le sang qu’on venge, on est loin du « Y m’a pété mon rétro, j’y crève son pneu ». Don Diègue est bien conscient que Rodrigue aime Chimène, et que tirer l’épée contre le père de la belle ne va pas arranger ses affaires, mais pour don Diègue « Nous n'avons qu'un honneur, il est tant de maîtresses ! L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir. » L’honneur, c’est certainement le mot qui revient le plus souvent dans la pièce.
C’est là qu’apparaît le fameux dilemme dit cornélien où quoique l’on choisisse, on est perdant. L’expression s’applique tout à fait ici où le choix entre l’amour et l’honneur s’impose à Rodrigue comme à Chimène. Rodrigue doit donc soit tuer le père de son amante, ou mourir de sa main, soit être indigne non seulement de son père mais aussi de l’amour de son amante. Il est d’ailleurs persuadé, qu’il va périr dans ce duel, mais que du moins, il mourra son offenser son amour. De même Chimène lorsqu’elle apprend la mort de son père doit soit renoncer à son amour et poursuivre le meurtrier, soit vivre sans honneur.
Les actes de Rodrigue sont clairs, il doit la vie à son père et ne tergiverse pas longtemps d’autant qu’il ne serait plus digne d’amour s’il laissait passer l’affront « Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père ; J'attire en me vengeant sa haine et sa colère ; J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. ». En revanche l’attitude de Chimène m’a parue plus ambiguë. Elle semble plus déchirée.
Autre question d’honneur : L’Infante aime Rodrigue mais s’oblige à l’oublier car son rang n’est pas digne du sien.
Pourtant malgré toute sa beauté, cette pièce a suscité beaucoup de reproches. En particulier de la part de deux rivaux de Corneille, Jean Mairet et George de Scudéry (frère de Madeleine). Ils lui reprochent de n’avoir guère fait plus que traduire la pièce d’un l’auteur espagnol, d’avoir fait une intrigue trop simple et dont on devine aisément le dénouement, d’ailleurs invraisemblable, le rôle de l’Infante n’était pas nécessaire… Peut-être un peu de jalousie. Corneille leur répond avec pas mal de hauteur. La Querelle du Cid se termine par un examen de la pièce par la toute nouvelle Académie Française, à la demande de Richelieu. Ses conclusions sont elles aussi relativement sévères.
Tant pis pour ces pisse-froid, lisons et relisons le Cid, pour notre plus grand plaisir.
C'est un véritable chef-d’œuvre de dramaturgie classique que nous offre le grand Pierre Corneille; un plaisir de poésie aussi. Si Racine était un perfectionniste de l'art théâtral, Corneille était un innovateur, un explorateur que les règles de la dramaturgie classique n'ont jamais effrayé. Rappelons-nous la fameuse querelle du Cid.
Dans Polyeucte, il a de nouveau effleuré la transgression de ces règles illustres : surtout celle de l'unité de l'action ; mêlant dans un affrontement d’intérêts divergents plusieurs personnages avec impétuosité. Mais l’ingéniosité de Corneille apparaît surtout dans ce choix audacieux de mettre sur scène, à un temps où le théâtre était un art profane (pour ne pas dire immoral), ce combat entre la grandeur romaine et la religion chrétienne. Dès le premier acte, qui est supposé être une exposition statique, on assiste à plusieurs rebondissements qui impliquent tous les personnages importants de la pièce : Polyeucte, Pauline, Félix et Sévère. Ces changements inattendus entraînent ces personnages dans des situations de dilemme où l'amour conjugal, l'amour filial, la dévotion, les intérêts politiques et la passion se croisent. On constate d’ailleurs qu’il n’y a pas de véritable héros unique ni même de méchant dans cette tragédie religieuse, politique et romaine ! ce qui ajoute plus de tension.
Personnellement, j’étais plutôt du côté de ce Sévère, héros de guerre, amoureux fidèle, personnage clément et honnête, qui a su contrôler son courroux et pardonner, et qui était très compréhensif. Par contre, Polyeucte représentait l’image de ce zélateur qui préfère la mort pour défendre sa cause, préférant le martyre aux plaisirs terrestres, délaissant toute obligation familiale pour sa religion. Cette position touchait au fanatisme. De l’autre côté, Pauline et son père subissent ces changements et essaient de trouver un compromis, mais se retrouvent débordés par les événements. Et l’on s’étonne parfois devant leurs réactions surtout Félix.
Dans Polyeucte, il a de nouveau effleuré la transgression de ces règles illustres : surtout celle de l'unité de l'action ; mêlant dans un affrontement d’intérêts divergents plusieurs personnages avec impétuosité. Mais l’ingéniosité de Corneille apparaît surtout dans ce choix audacieux de mettre sur scène, à un temps où le théâtre était un art profane (pour ne pas dire immoral), ce combat entre la grandeur romaine et la religion chrétienne. Dès le premier acte, qui est supposé être une exposition statique, on assiste à plusieurs rebondissements qui impliquent tous les personnages importants de la pièce : Polyeucte, Pauline, Félix et Sévère. Ces changements inattendus entraînent ces personnages dans des situations de dilemme où l'amour conjugal, l'amour filial, la dévotion, les intérêts politiques et la passion se croisent. On constate d’ailleurs qu’il n’y a pas de véritable héros unique ni même de méchant dans cette tragédie religieuse, politique et romaine ! ce qui ajoute plus de tension.
Personnellement, j’étais plutôt du côté de ce Sévère, héros de guerre, amoureux fidèle, personnage clément et honnête, qui a su contrôler son courroux et pardonner, et qui était très compréhensif. Par contre, Polyeucte représentait l’image de ce zélateur qui préfère la mort pour défendre sa cause, préférant le martyre aux plaisirs terrestres, délaissant toute obligation familiale pour sa religion. Cette position touchait au fanatisme. De l’autre côté, Pauline et son père subissent ces changements et essaient de trouver un compromis, mais se retrouvent débordés par les événements. Et l’on s’étonne parfois devant leurs réactions surtout Félix.
Chimène et Rodrigue s’aiment mais poussé par un père sénile qui porte son honneur comme un étendard celui-la assassine le géniteur de celle-ci pour une parole mal placé. Complètement défaite, Chimène réclame la tête de son ex bienaimé au roi. Pour rien, car entretemps Rodrigue est devenu un héros national en repoussant les Sarrasins à la mer et on exécute pas celui qui vient de sauver le pays et la cité. Sa demande de justice reste veine, de toute manière une partie d’elle même seulement la réclame l’autre étant encore profondément attachée à son amant. Finalement sur ordre du souverain et après un an de deuil, elle deviendra quand même sa femme (ce qui l’arrange bien, même si on ne nous dit pas comment moralement elle pourra vivre avec celui qui a tué son père). Quasiment chaques mots de cette pièce sont entrés dans le patrimoine littéraire de notre pays. Tous ceux qui sont passés par le collège on déclamé au moins une fois dans leur vie les fameux : "Rodrigue, as-tu du cœur" ou "à vaincre sans périls, on triomphe sans gloire". C’est un texte merveilleux et universel, une lecture indispensable pour tout ceux qui s'en réclament ou qui veulent connaitre à travers ces lignes notre culture ancestrale...
Voilà une pièce riche en séductions diverses.
L’intrigue que l’écheveau de sentiments rend complexe, d’abord. Corneille place l’action en 250 en Arménie, sous le règne de l’Empereur Decius – un persécuteur de Chrétiens. Félix, gouverneur romain d’Arménie, a donné sa fille Pauline à Polyeucte, seigneur arménien de premier plan. Pour Félix et sa fille, il s’agit d’un mariage de raison, plus exactement d’un « second choix » politique dépourvu d’amour. L’amour de la vie de Pauline s’appelait Sévère et est mort à la guerre. Polyeucte, lui, éprouve de vrais sentiments pour Pauline. Deux évènements se produisent : Polyeucte se convertit au christianisme militant et s’en prend immédiatement aux païennes cérémonies romaines, risquant du coup la mort. Et Sévère n’est pas décédé ; il a même l’oreille de l’empereur et arrive dans la cité en tant que son représentant.
Pauline se retrouve déchirée entre son ancien amour pour lequel elle éprouve encore une grande force d’amour, et son époux qu’elle entend soutenir par devoir (Pauline a le devoir chevillé au corps). Sévère espérait reprendre les choses où il les avait laissées avec Pauline, mais la situation de celle-ci le brise. Honnête, il peut la supporter mais comment gérer le comportement de lèse-majesté de Polyeucte ? Félix a peur que Sévère ne cherche à se venger de ne plus voir Pauline disponible. Il va hésiter entre un jugement dur sur Polyeucte afin de ne pas être taxé de tolérance envers les Chrétiens et l’envie de sauver son gendre qu’il apprécie.
Evidemment les personnages feront un nœud à leurs sentiments, s’accrocheront à leurs principes et l’inévitable et dramatique conclusion s’ensuivra. Corneille excelle à pousser ses personnages au bout de leur logique. J’ai retrouvé ici la même notion de devoir si puissante qu’elle annihile la liberté de choix et de bonheur que dans Horace.
Le contexte historique de l’époque de création, ensuite. Polyeucte est une tragédie chrétienne qui permet à Corneille de faire l’apologie de la religion catholique sans sombrer dans l’extrémisme du parti Dévot (parti qui froisse la reine régente Anne d’Autriche et son nouveau premier ministre Mazarin) et en prônant la tolérance religieuse (en référence aux Protestants).
Sur la tolérance, toutefois, seule la fin qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe l’exprime clairement à travers le personnage de Sévère. Pour le reste, comme homme de mon temps j’interprète le comportement « martyr » du chrétien Néarque et du tout juste converti Polyeucte comme du fanatisme religieux et de l’intolérance. Si, dans la France du 17ème siècle, il est concevable de louer de cette manière la ferveur religieuse chrétienne face au paganisme, c’est beaucoup moins acceptable de nos jours alors que nous subissons à nouveau le fanatisme religieux de plein fouet. L’attitude jusqu’au-boutiste de Polyeucte m’a mis mal à l’aise je l’admets.
Corneille use aussi beaucoup de la grâce divine afin de justifier le comportement de Polyeucte. Pourquoi est-ce lui, tout juste baptisé, qui prend l’initiative de l’action fanatique alors que son mentor chrétien Néarque hésite ? Pourquoi Polyeucte va-t-il jusqu’au bout, souhaite-t-il le martyr ? Parce qu’il a été frappé par la Grâce, lui seul. Dieu choisit à qui il l’a donne. C’est donc une idée très augustine, très janséniste qui est portée ici. Cependant, le débat théologique autour du jansénisme n’a pas encore eu lieu. Il faudra attendre une grosse dizaine d’années pour qu’il culmine avec la lutte entre Paris et l’abbaye de Port Royal.
Enfin, il y a la musique des mots de Corneille. C’est toujours un plaisir de lire ses alexandrins.
L’intrigue que l’écheveau de sentiments rend complexe, d’abord. Corneille place l’action en 250 en Arménie, sous le règne de l’Empereur Decius – un persécuteur de Chrétiens. Félix, gouverneur romain d’Arménie, a donné sa fille Pauline à Polyeucte, seigneur arménien de premier plan. Pour Félix et sa fille, il s’agit d’un mariage de raison, plus exactement d’un « second choix » politique dépourvu d’amour. L’amour de la vie de Pauline s’appelait Sévère et est mort à la guerre. Polyeucte, lui, éprouve de vrais sentiments pour Pauline. Deux évènements se produisent : Polyeucte se convertit au christianisme militant et s’en prend immédiatement aux païennes cérémonies romaines, risquant du coup la mort. Et Sévère n’est pas décédé ; il a même l’oreille de l’empereur et arrive dans la cité en tant que son représentant.
Pauline se retrouve déchirée entre son ancien amour pour lequel elle éprouve encore une grande force d’amour, et son époux qu’elle entend soutenir par devoir (Pauline a le devoir chevillé au corps). Sévère espérait reprendre les choses où il les avait laissées avec Pauline, mais la situation de celle-ci le brise. Honnête, il peut la supporter mais comment gérer le comportement de lèse-majesté de Polyeucte ? Félix a peur que Sévère ne cherche à se venger de ne plus voir Pauline disponible. Il va hésiter entre un jugement dur sur Polyeucte afin de ne pas être taxé de tolérance envers les Chrétiens et l’envie de sauver son gendre qu’il apprécie.
Evidemment les personnages feront un nœud à leurs sentiments, s’accrocheront à leurs principes et l’inévitable et dramatique conclusion s’ensuivra. Corneille excelle à pousser ses personnages au bout de leur logique. J’ai retrouvé ici la même notion de devoir si puissante qu’elle annihile la liberté de choix et de bonheur que dans Horace.
Le contexte historique de l’époque de création, ensuite. Polyeucte est une tragédie chrétienne qui permet à Corneille de faire l’apologie de la religion catholique sans sombrer dans l’extrémisme du parti Dévot (parti qui froisse la reine régente Anne d’Autriche et son nouveau premier ministre Mazarin) et en prônant la tolérance religieuse (en référence aux Protestants).
Sur la tolérance, toutefois, seule la fin qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe l’exprime clairement à travers le personnage de Sévère. Pour le reste, comme homme de mon temps j’interprète le comportement « martyr » du chrétien Néarque et du tout juste converti Polyeucte comme du fanatisme religieux et de l’intolérance. Si, dans la France du 17ème siècle, il est concevable de louer de cette manière la ferveur religieuse chrétienne face au paganisme, c’est beaucoup moins acceptable de nos jours alors que nous subissons à nouveau le fanatisme religieux de plein fouet. L’attitude jusqu’au-boutiste de Polyeucte m’a mis mal à l’aise je l’admets.
Corneille use aussi beaucoup de la grâce divine afin de justifier le comportement de Polyeucte. Pourquoi est-ce lui, tout juste baptisé, qui prend l’initiative de l’action fanatique alors que son mentor chrétien Néarque hésite ? Pourquoi Polyeucte va-t-il jusqu’au bout, souhaite-t-il le martyr ? Parce qu’il a été frappé par la Grâce, lui seul. Dieu choisit à qui il l’a donne. C’est donc une idée très augustine, très janséniste qui est portée ici. Cependant, le débat théologique autour du jansénisme n’a pas encore eu lieu. Il faudra attendre une grosse dizaine d’années pour qu’il culmine avec la lutte entre Paris et l’abbaye de Port Royal.
Enfin, il y a la musique des mots de Corneille. C’est toujours un plaisir de lire ses alexandrins.
Une des plus belles pièces de théâtre classique ! Bien sûr, le langage, les valeurs, les manières d'être.... sont devenus obsolètes. Mais c'est normal ! Il faut la considérer dans le contexte du 17e siècle ! Et à partir de là, tout coule de source ! Quelle belle analyse psychologique des personnages, quelle manière de s'exprimer nette et juste !
Cette pièce de Corneille est plutôt méconnue, au point que j’ai cru, d’après le titre, qu’elle parlait de l’un des empereurs du Saint Empire, durant le moyen-âge.
Que nenni ! Corneille remonte plus loin dans le temps et veut nous causer de l’éphémère Othon, empereur de la Rome antique en transit qui régna seulement trois mois, entre Galba (qui avait évincé Néron) et Vitellus (qui fera aussi long feu au profit de la dynastie des Flaviens).
Dans son avertissement au lecteur, Corneille dit avoir suivi les Histoires de Tacite au plus près. « J’y ai conservé les événements et pris la liberté de changer la manière dont ils arrivent », avoue-t-il. C’est plutôt vrai ; les événements, les caractères des personnages sont là (j’ai vérifié chez l’auteur antique) mais ce qui les mène devient un imbroglio politico-amoureux comme Corneille aime à les montrer.
Donc Galba règne, conseillé par trois opportunistes cherchant à tirer la couverture à eux : le consul Vinius, le préfet du Prétoire Lacus et l’affranchi Martian. Il n’a pas d’héritier naturel valable – « valable » signifiant masculin hein – mais il a une fille, Camille, et il peut adopter. Vinius essaie de placer Othon – qui a bien connu l’orgie sous Néron mais s’est refait une réputation en soutenant spontanément Galba – comme candidat en l’offrant à sa fille Plautine. Mais mince, voilà que c’est le coup de foudre réciproque.
Sauf que Vinius apprend que Camille est intéressée par Othon et, changeant de plan, lui propose de se placer auprès d’elle, et tant pis pour l’amour. Plautine le soutient, et tant pis pour l’amour.
Sauf qu’Othon a un rival qui a les faveurs de Galba, et soutenu par les deux autres conseillers : Pison.
Donc Othon avoue son « amour » à Camille. Mais celle-ci ne parvient qu’à moitié à tourner son père. Galba offre la main de Camille à Othon mais l’empire ira à Pison. Ni une ni deux, Othon aligne devant Camille une liste longue comme le bras de prétextes montrant pourquoi leur union ne va pas le faire si l’empire ne vient pas avec. Camille n’est pas dupe, faut pas pousser mémé dans les orties. Elle sait bien qu’Othon n’a d’yeux que pour Plautine. Elle va chercher à se venger en se replaçant auprès de Pison et en poussant le mariage de Plautine avec Martian l’ancien esclave (ce dernier bave devant elle), dégradante proposition pour la patricienne Plautine.
Acculé, Othon contre-attaque par la force, et là on retrouve Tacite. Profitant d’une erreur de Galba qui n’a pas offert les cadeaux nécessaires à la garde prétorienne, il se fait nommer empereur par quelques légionnaires et c’est la révolte. Galba et les conseillers Lacus et Vinius vont tomber dans un piège bien raconté par Corneille. Et hop : Othon empereur.
Empereur sans amour car Plautine ne veut plus de lui pour une raison qui m’échappe, je l’avoue. Elle vient de perdre son père, d’accord, mais cela suffit-il à expliquer son refus ? Son père est une victime collatérale de la révolte d’Othon (tué par Lacus en fait) et Plautine ne songe pas à l’en accuser. Elle sait qu’Othon a joué sur les deux tableaux – elle-même et Camille – mais elle l’a elle-même poussé dans cette direction. Un mélange de tout cela décide Plautine probablement.
Selon Catherine Salles dans La Rome des Flaviens, Othon aurait peut-être pu devenir un bon empereur si Vitellus ne l’avait pas éliminé. Corneille, qui arrête sa pièce à la prise de pouvoir d’Othon, ne donne pas d’opinion. Le comportement d’Othon semble plus retors que celui de Galba, mais moins que celui des conseillers veulent vraiment profiter à fond de leur pouvoir quelles qu’en soient les conséquences pour l’Empire (la tirade de Lacus à ce titre est superbe). Classé ni bon ni mauvais, il utilise les armes de son milieu, rien de plus.
Un bon moment de jeu de pouvoirs avec l’amour, réel ou simulé, comme arme de combat.
Que nenni ! Corneille remonte plus loin dans le temps et veut nous causer de l’éphémère Othon, empereur de la Rome antique en transit qui régna seulement trois mois, entre Galba (qui avait évincé Néron) et Vitellus (qui fera aussi long feu au profit de la dynastie des Flaviens).
Dans son avertissement au lecteur, Corneille dit avoir suivi les Histoires de Tacite au plus près. « J’y ai conservé les événements et pris la liberté de changer la manière dont ils arrivent », avoue-t-il. C’est plutôt vrai ; les événements, les caractères des personnages sont là (j’ai vérifié chez l’auteur antique) mais ce qui les mène devient un imbroglio politico-amoureux comme Corneille aime à les montrer.
Donc Galba règne, conseillé par trois opportunistes cherchant à tirer la couverture à eux : le consul Vinius, le préfet du Prétoire Lacus et l’affranchi Martian. Il n’a pas d’héritier naturel valable – « valable » signifiant masculin hein – mais il a une fille, Camille, et il peut adopter. Vinius essaie de placer Othon – qui a bien connu l’orgie sous Néron mais s’est refait une réputation en soutenant spontanément Galba – comme candidat en l’offrant à sa fille Plautine. Mais mince, voilà que c’est le coup de foudre réciproque.
Sauf que Vinius apprend que Camille est intéressée par Othon et, changeant de plan, lui propose de se placer auprès d’elle, et tant pis pour l’amour. Plautine le soutient, et tant pis pour l’amour.
Sauf qu’Othon a un rival qui a les faveurs de Galba, et soutenu par les deux autres conseillers : Pison.
Donc Othon avoue son « amour » à Camille. Mais celle-ci ne parvient qu’à moitié à tourner son père. Galba offre la main de Camille à Othon mais l’empire ira à Pison. Ni une ni deux, Othon aligne devant Camille une liste longue comme le bras de prétextes montrant pourquoi leur union ne va pas le faire si l’empire ne vient pas avec. Camille n’est pas dupe, faut pas pousser mémé dans les orties. Elle sait bien qu’Othon n’a d’yeux que pour Plautine. Elle va chercher à se venger en se replaçant auprès de Pison et en poussant le mariage de Plautine avec Martian l’ancien esclave (ce dernier bave devant elle), dégradante proposition pour la patricienne Plautine.
Acculé, Othon contre-attaque par la force, et là on retrouve Tacite. Profitant d’une erreur de Galba qui n’a pas offert les cadeaux nécessaires à la garde prétorienne, il se fait nommer empereur par quelques légionnaires et c’est la révolte. Galba et les conseillers Lacus et Vinius vont tomber dans un piège bien raconté par Corneille. Et hop : Othon empereur.
Empereur sans amour car Plautine ne veut plus de lui pour une raison qui m’échappe, je l’avoue. Elle vient de perdre son père, d’accord, mais cela suffit-il à expliquer son refus ? Son père est une victime collatérale de la révolte d’Othon (tué par Lacus en fait) et Plautine ne songe pas à l’en accuser. Elle sait qu’Othon a joué sur les deux tableaux – elle-même et Camille – mais elle l’a elle-même poussé dans cette direction. Un mélange de tout cela décide Plautine probablement.
Selon Catherine Salles dans La Rome des Flaviens, Othon aurait peut-être pu devenir un bon empereur si Vitellus ne l’avait pas éliminé. Corneille, qui arrête sa pièce à la prise de pouvoir d’Othon, ne donne pas d’opinion. Le comportement d’Othon semble plus retors que celui de Galba, mais moins que celui des conseillers veulent vraiment profiter à fond de leur pouvoir quelles qu’en soient les conséquences pour l’Empire (la tirade de Lacus à ce titre est superbe). Classé ni bon ni mauvais, il utilise les armes de son milieu, rien de plus.
Un bon moment de jeu de pouvoirs avec l’amour, réel ou simulé, comme arme de combat.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre Corneille
Lecteurs de Pierre Corneille Voir plus
Quiz
Voir plus
Rions avec Le Cid (Corneille)
Je suis jeune, il est vrai ;
mais aux ânes benêts, le râleur n’attend point le nombre des années.
mais à mon Amédée la chaleur de mon corps et mes boutons d’acné.
mais aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années.
mais j’amène à mon nez, malgré les persifleurs, ma langue dépliée.
10 questions
510 lecteurs ont répondu
Thème : Le Cid de
Pierre CorneilleCréer un quiz sur cet auteur510 lecteurs ont répondu