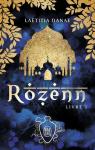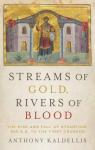Anthony Kaldellis/5
1 notes
Résumé :
A major new history of the eastern Roman Empire, from Constantine to 1453.
In recent decades, the study of the Eastern Roman Empire, also known as Byzantium, has been revolutionized by new approaches and more sophisticated models for how its society and state operated. No longer looked upon as a pale facsimile of classical Rome, Byzantium is now considered a vigorous state of its own, inheritor of many of Rome's features, and a vital node in the first... >Voir plus
In recent decades, the study of the Eastern Roman Empire, also known as Byzantium, has been revolutionized by new approaches and more sophisticated models for how its society and state operated. No longer looked upon as a pale facsimile of classical Rome, Byzantium is now considered a vigorous state of its own, inheritor of many of Rome's features, and a vital node in the first... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après The New Roman Empire: A History of ByzantiumVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Anthony Kaldellis est un historien byzantiniste connu dans l'université anglo-saxonne. Jusque-là, il avait écrit des livres sur des thèmes particuliers de sa période, comme la culture (Hellenism in Byzantium), les institutions (The Roman Republic), la nation et ses composantes (Romanland), ou sur des auteurs particuliers comme Procope ou Laonikos Chalkokondyles (A new Herodotos). A la demande de son éditeur, il a bien voulu écrire et publier en 2024 une histoire générale de "Byzance", The New Roman Empire : a history or Byzantium, dont le récit commence à la fondation de Constantinople en 330 et se termine à la prise par les Turcs en 1453. Ce livre est fort précieux car il permet de suivre en continu toute l'histoire de cette ville et de cet empire, dont le public n'a en général qu'une connaissance fragmentaire : on a entendu parler de Justinien grâce aux mosaïques de Ravenne, Delacroix a peint la prise et le sac de la Ville par les Croisés en 1204, et on sait définir les "querelles byzantines". Mais on ne sait pas qu'au moment où l'Europe occidentale régressait au niveau des chefferies féodales, en Orient un état nommé Empire Romain, faisant suite à l'empire romain que nous connaissons, non seulement subsistait, mais prospérait, résistait aux invasions barbares et rendait possible la transmission de la culture antique. Cet état fut privé de sa qualité de "romain" par ces mêmes occidentaux, qui le détruisirent en 1204 et ouvrirent ainsi la voie aux invasions turques du XIV°s. Cette qualité de romain, les historiens modernes continuent de la lui dénier, par ethnocentrisme, par papisme ou, plus récemment, par islamophilie, comme on l'a vu quand Sylvain Gouguenheim fut persécuté pour son "Aristote au Mont Saint-Michel". C'est pourquoi tous les livres d'Anthony Kaldellis comportent une mise au point terminologique, puisqu'il est impossible de faire l'histoire sans un vocabulaire maîtrisé et rigoureux, ni des notions claires.
En plus de remettre les choses dans une bonne perspective, l'historien a abattu un travail gigantesque de lecture, d'enquête et de synthèse pour élaborer son récit, qu'il sait mener grand train et avec talent. Les passages consacrés à la culture, à l'économie et de la politique sont particulièrement intéressants et éclairent bien les événements, essentiellement guerriers. La géographie a voulu que cet état romain d'Orient ait sans cesse à se battre sur trois fronts, celui du Danube, celui de la Mer Egée et celui de l'Arménie, ce qui a généré à Constantinople toute une diplomatie et une curiosité pour les peuples barbares les plus lointains (Kaldellis a aussi rédigé une étude sur "Le discours ethnographique à Byzance"). Des lecteurs sur Goodreads se sont plaints de la part excessive que tient la religion dans ce livre, sans comprendre ni mesurer que ce qu'ils appellent "religion" est une dimension fondamentale de la vie des Romains d'Orient, tant spirituelle que politique. La controverse, la discussion, la polémique, qui sont le mode normal de vie politique chez ces Romains, impliquent le souci du salut de l'âme et de l'identité terrestre que l'on se construit par la théologie. Un citoyen de Constantinople n'est pas seulement le supporter d'une équipe de chars (Bleus, Verts), il est aussi doté d'une personnalité religieuse qui le place dans une certaine communauté. C'est pourquoi la Ville ne cessa d'être agitée de querelles "religieuses" (à savoir identitaires, dogmatiques et intellectuelles), des premières définitions christologiques du IV°s aux débats sur la Lumière Incréée et sur l'Union avec Rome au XV°. Loin d'être de vaines querelles, ces questions engageaient les hommes dans ce qu'ils avaient de plus profond, chose que Kaldellis, un peu trop imprégné de laïcisme progressiste, a parfois du mal à mesurer. En Occident, la papauté se réserva la réflexion théologique, n'exigeant des fidèles que l'obéissance aveugle. L'Orient était tout autre (Ramsay McMullen, "Voter pour définir Dieu").
L'auteur, par ailleurs, n'hésite pas à prendre parti et à intervenir dans son récit, quand il compare l'état romain dans sa communication avec le peuple et les élites, avec les autres empires, tel l'empire arabe. Sa description en termes coloniaux de l'occupation franque de la Grèce, après 1204, est très frappante. Les croisés imposent un régime féodal et des pratiques de servage et de corvée que les Romains (= les "Grecs") ne connaissaient pas. Autre exemple, il qualifie le Mont Athos de "parc à thèmes monastique", comme une espèce de Disneyland ascétique et mystique du Moyen-Age. Il ne cache pas sa sympathie pour les premiers savants qui, dès Psellos et jusqu'au XV°s, tentèrent de critiquer la domination de la culture chrétienne et son emprise absolue dans l'empire. Ces interventions d'auteur n'ont rien de gênant, car elles introduisent dans le discours historique une part de discussion et de désaccord qui est vraiment bienvenue. L'auteur évite soigneusement d'aborder le thème de la "symphonie byzantine", notion définissant les rapports entre l'église et l'état chez les historiens russes (Schmemann) : il semble, à le lire, que la question est fausse et ne se pose même pas. Donc ses prises de position sont fermes et c'est un livre d'histoire engagé. On n'en finirait pas d'énumérer les beautés de cet ouvrage, et il n'y a plus, si on sait l'anglais, qu'à s'y plonger.
En plus de remettre les choses dans une bonne perspective, l'historien a abattu un travail gigantesque de lecture, d'enquête et de synthèse pour élaborer son récit, qu'il sait mener grand train et avec talent. Les passages consacrés à la culture, à l'économie et de la politique sont particulièrement intéressants et éclairent bien les événements, essentiellement guerriers. La géographie a voulu que cet état romain d'Orient ait sans cesse à se battre sur trois fronts, celui du Danube, celui de la Mer Egée et celui de l'Arménie, ce qui a généré à Constantinople toute une diplomatie et une curiosité pour les peuples barbares les plus lointains (Kaldellis a aussi rédigé une étude sur "Le discours ethnographique à Byzance"). Des lecteurs sur Goodreads se sont plaints de la part excessive que tient la religion dans ce livre, sans comprendre ni mesurer que ce qu'ils appellent "religion" est une dimension fondamentale de la vie des Romains d'Orient, tant spirituelle que politique. La controverse, la discussion, la polémique, qui sont le mode normal de vie politique chez ces Romains, impliquent le souci du salut de l'âme et de l'identité terrestre que l'on se construit par la théologie. Un citoyen de Constantinople n'est pas seulement le supporter d'une équipe de chars (Bleus, Verts), il est aussi doté d'une personnalité religieuse qui le place dans une certaine communauté. C'est pourquoi la Ville ne cessa d'être agitée de querelles "religieuses" (à savoir identitaires, dogmatiques et intellectuelles), des premières définitions christologiques du IV°s aux débats sur la Lumière Incréée et sur l'Union avec Rome au XV°. Loin d'être de vaines querelles, ces questions engageaient les hommes dans ce qu'ils avaient de plus profond, chose que Kaldellis, un peu trop imprégné de laïcisme progressiste, a parfois du mal à mesurer. En Occident, la papauté se réserva la réflexion théologique, n'exigeant des fidèles que l'obéissance aveugle. L'Orient était tout autre (Ramsay McMullen, "Voter pour définir Dieu").
L'auteur, par ailleurs, n'hésite pas à prendre parti et à intervenir dans son récit, quand il compare l'état romain dans sa communication avec le peuple et les élites, avec les autres empires, tel l'empire arabe. Sa description en termes coloniaux de l'occupation franque de la Grèce, après 1204, est très frappante. Les croisés imposent un régime féodal et des pratiques de servage et de corvée que les Romains (= les "Grecs") ne connaissaient pas. Autre exemple, il qualifie le Mont Athos de "parc à thèmes monastique", comme une espèce de Disneyland ascétique et mystique du Moyen-Age. Il ne cache pas sa sympathie pour les premiers savants qui, dès Psellos et jusqu'au XV°s, tentèrent de critiquer la domination de la culture chrétienne et son emprise absolue dans l'empire. Ces interventions d'auteur n'ont rien de gênant, car elles introduisent dans le discours historique une part de discussion et de désaccord qui est vraiment bienvenue. L'auteur évite soigneusement d'aborder le thème de la "symphonie byzantine", notion définissant les rapports entre l'église et l'état chez les historiens russes (Schmemann) : il semble, à le lire, que la question est fausse et ne se pose même pas. Donc ses prises de position sont fermes et c'est un livre d'histoire engagé. On n'en finirait pas d'énumérer les beautés de cet ouvrage, et il n'y a plus, si on sait l'anglais, qu'à s'y plonger.
Citations et extraits (6)
Voir plus
Ajouter une citation
Contrairement à une croyance répandue, Constantinople n'eut aucun plan d'ensemble pour convertir les nations étrangères. Bien que "la conversion des Slaves" soit considérée comme un haut fait, les Romains ne s'intéressèrent que peu, ou pas du tout, au baptême des Slaves qui ne vivaient pas dans l'empire. Ils ne donnèrent suite que froidement, par devoir plus que par enthousiasme, aux demandes d'aide que les rois étrangers leur faisaient pour convertir leur royaume. Les Romains ne considérèrent jamais les barbares baptisés comme des égaux. Tout au plus, le baptême pouvait "domestiquer" les sauvages, mais ils restaient des barbares ("Pearls before swine, missionary work in Byzantium", S. Ivanov, Paris, 2015). Les plus célèbres missionnaires de ce temps furent deux frères de Thessalonique, Constantin et Méthodios, qui furent envoyés en Moravie quand le roi Ratislav demanda à Michel III des savants qui pouvaient enseigner la langue slave. Constantin aurait étudié sous Léon le Philosophe et Photios, et était un ami de ce dernier. Il créa le Glagolitique, la plus ancienne écriture du slave, et traduisit de nombreux textes chrétiens en cette langue. L'écriture qui se développa à partir du Glagolitique, le Cyrillique, fut nommée d'après le nom monastique que Constantin prit avant sa mort en 869. Les deux frères croyaient que tous pouvaient célébrer la liturgie en leur propre langue vernaculaire, et pas seulement le grec et le latin, comme le croyaient certains en occident. A Venise, Constantin rappela aux sceptiques que les Arméniens, les Syriaques, les Perses, les Géorgiens, les Goths et autres, adoraient déjà Dieu dans leur propre langue. Pourtant Constantin-Cyril et Methodios ne sont pas présents dans les textes romains orientaux (= byzantins). Ils demeurèrent inconnus dans leur propre patrie, jusqu'à ce qu'ils soient mentionnés enfin dans des sources bulgares bien postérieures.
pp. 508-509
pp. 508-509
[1204 : la Quatrième Croisade]
Le sac commença pour de bon et dura trois jours (13 avril 1204). Aucun lieu dans le monde chrétien n'avait accumulé plus de trésors, d'antiquités, de livres, et de saintes reliques que Constantinople pendant ses neuf siècles d'existence. Ils furent méthodiquement pillés, brûlés, détruits, ou profanés selon que l'avidité, le caprice, la haine ou la fantaisie inspiraient les conquérants pillards. "Jamais depuis la Création du monde autant de butin ne fut pris dans une unique cité", déclara l'un des organisateurs de la Quatrième Croisade (Villehardouin). Ce que le conquérant ne pouvait comprendre, il le détruisait. Des chapitres entiers de l'histoire ancienne, de l'art, de la littérature furent balayés en quelques heures. Choniates consacra une partie de son Histoire à pleurer les statues anciennes détruites par les barbares latins...
La plus lourde responsabilité de la destruction de 1203-1204 revient bien sûr aux Croisés : non pas seulement aux acteurs de la Quatrième Croisade, mais au mouvement croisé dans son ensemble et à toute la culture (celle de l'Europe occidentale médiévale) qui lui a donné naissance. Beaucoup d'études récentes sur les croisades sont des justifications, et celles qui concernent la Quatrième Croisade sont des modèles d'emploi de la voix passive ("des erreurs furent commises", etc). Ces "erreurs" naquirent de préjugés et d'idéologies sous-jacents, comprenant la volonté de l'état-major de ne prendre en ligne de compte, par-dessus tout, que les contrats financiers ; la facilité avec laquelle les Vénitiens violèrent leur serment de défendre l'empire d'Orient, en échange de quoi ils avaient reçu de lucratives concessions ; la décision d'intervenir dans la vie politique des Romains d'Orient, à quoi les Croisés n'avaient aucun droit ; l'habitude normande d'utiliser des fantoches, candidats au trône de Constantinople, comme prétexte à l'agression ; le préjugé contre les "Grecs" qui, à chaque étape, incitait les Croisés à la violence contre les Romains d'Orient et justifiait l'agressivité pure ; l'avidité et l'envie avec lesquelles beaucoup avaient considéré Constantinople, et la pourriture morale [moral rottenness] de l'acte de croisade en général, qui non seulement inspirait la haine contre les ennemis de la foi, mais la générait, l'armait, la finançait. L'Orient romain était haï en partie parce qu'il avait montré un enthousiasme insuffisant pour le projet de croisade.
p. 723-724
Le sac commença pour de bon et dura trois jours (13 avril 1204). Aucun lieu dans le monde chrétien n'avait accumulé plus de trésors, d'antiquités, de livres, et de saintes reliques que Constantinople pendant ses neuf siècles d'existence. Ils furent méthodiquement pillés, brûlés, détruits, ou profanés selon que l'avidité, le caprice, la haine ou la fantaisie inspiraient les conquérants pillards. "Jamais depuis la Création du monde autant de butin ne fut pris dans une unique cité", déclara l'un des organisateurs de la Quatrième Croisade (Villehardouin). Ce que le conquérant ne pouvait comprendre, il le détruisait. Des chapitres entiers de l'histoire ancienne, de l'art, de la littérature furent balayés en quelques heures. Choniates consacra une partie de son Histoire à pleurer les statues anciennes détruites par les barbares latins...
La plus lourde responsabilité de la destruction de 1203-1204 revient bien sûr aux Croisés : non pas seulement aux acteurs de la Quatrième Croisade, mais au mouvement croisé dans son ensemble et à toute la culture (celle de l'Europe occidentale médiévale) qui lui a donné naissance. Beaucoup d'études récentes sur les croisades sont des justifications, et celles qui concernent la Quatrième Croisade sont des modèles d'emploi de la voix passive ("des erreurs furent commises", etc). Ces "erreurs" naquirent de préjugés et d'idéologies sous-jacents, comprenant la volonté de l'état-major de ne prendre en ligne de compte, par-dessus tout, que les contrats financiers ; la facilité avec laquelle les Vénitiens violèrent leur serment de défendre l'empire d'Orient, en échange de quoi ils avaient reçu de lucratives concessions ; la décision d'intervenir dans la vie politique des Romains d'Orient, à quoi les Croisés n'avaient aucun droit ; l'habitude normande d'utiliser des fantoches, candidats au trône de Constantinople, comme prétexte à l'agression ; le préjugé contre les "Grecs" qui, à chaque étape, incitait les Croisés à la violence contre les Romains d'Orient et justifiait l'agressivité pure ; l'avidité et l'envie avec lesquelles beaucoup avaient considéré Constantinople, et la pourriture morale [moral rottenness] de l'acte de croisade en général, qui non seulement inspirait la haine contre les ennemis de la foi, mais la générait, l'armait, la finançait. L'Orient romain était haï en partie parce qu'il avait montré un enthousiasme insuffisant pour le projet de croisade.
p. 723-724
[Destin des empires : le califat et l'empire romain transformé, après 700 et la conquête arabe]
... L'empire romain survécut au califat, qui l'avait ostensiblement remplacé.
Une des raisons de cela était que l'identité et le pouvoir n'étaient pas articulés de la même façon dans le califat et dans la Romania. Cette dernière était, et se présentait comme "l'état des Romains". Vers 700, presque tous ses citoyens parlaient grec, appartenaient à la même église chalcédonienne, et étaient, ethniquement, des Romains. Ils avaient un état unique, dont le but était leur protection et leur bien-être, à la fois matériel et spirituel. Le gouvernement préférait employer la persuasion et l'effort de consensus avec ses sujets, plutôt que la force, et favorisait la coopération, non la soumission. Les Romains disposaient d'un commandement militaire unique qui rassemblait toutes les ressources des provinces pour protéger la totalité du territoire romain. Leur armée était soutenue par un système unifié d'administration et de législation. Il n'y eut aucune révolte paysanne ni aucune tentative de créer des états sécessionnistes à cette époque. Les soulèvements provinciaux avaient pour but de protéger la capitale, Constantinople, et renouveler son gouvernement : c'étaient des coups d'état. La Romania était moins un empire qu'un état-nation.
Par contraste, le califat faisait face à une problème qui lui fut fatal : il n'élabora jamais une idéologie consensuelle de gouvernement. Un petit nombre de guerriers arabes, temporairement unifiés par un nouveau message religieux, profitèrent de la ruine provoquée par la guerre entre Rome et la Perse pour se tailler un empire à eux. Les populations conquises furent contraintes de payer des impôts pour entretenir cette armée de conquête. Mais quoi de plus ? A qui ce pouvoir appartenait-il et quel était son objectif ? Dans un premier temps, les conquérants ne se souciaient pas de convertir les autres : ils n'y avaient pas intérêt, car cela aurait diminué le montant des impôts (pesant sur les infidèles). Mais qu'apportaient les gouvernants aux gouvernés, sinon l'assurance de ne pas les tuer ? Les chrétiens, les Juifs, les zoroastriens conquis ne s'identifiaient pas au projet du califat, qui leur imposait une domination étrangère assortie d'impôts plus lourds. Pour la première fois depuis des siècles, il y eut à nouveau des révoltes agraires en Egypte.
De plus, qu'arrivait-il quand les conquis commençaient à se convertir à l'islam et à apprendre l'arabe ? Leur fallait-il encore payer des impôts ? Devenaient-ils des arabes, avaient-ils un droit sur le fonctionnement de l'empire ? Ces questions pressantes furent vite compliquées par un autre fait : les conquérants établis dans les villes engagèrent des mercenaires non-arabes, en particulier des Turcs, pour combattre à leur place. Comment, dans ce cas, tracer les lignes de l'identité et du pouvoir ? A qui toute cette structure était-elle censée profiter ? Enfin, sur quels critères choisir les gouvernants ? Il n'y eut aucun consensus sur ces problèmes critiques, et donc des dynasties, des familles, des tribus concurrentes rassemblaient des partisans. Ces factions se soupçonnaient l'une l'autre dès l'abord et se faisaient périodiquement la guerre. L'unité politique des musulmans, ordonnée par le Coran, était une fiction pieuse. La guerre civile commença presque immédiatement et finalement, le califat se désintégra, en même temps que des dynasties régionales se libéraient du centre. Les factions concurrentes étaient en violent désaccord mutuel sur l'identité et les objectifs, et sur les questions de savoir qui devait gouverner qui, pourquoi, et comment ? Les Romains avaient réglé ces questions depuis longtemps.
p. 417
... L'empire romain survécut au califat, qui l'avait ostensiblement remplacé.
Une des raisons de cela était que l'identité et le pouvoir n'étaient pas articulés de la même façon dans le califat et dans la Romania. Cette dernière était, et se présentait comme "l'état des Romains". Vers 700, presque tous ses citoyens parlaient grec, appartenaient à la même église chalcédonienne, et étaient, ethniquement, des Romains. Ils avaient un état unique, dont le but était leur protection et leur bien-être, à la fois matériel et spirituel. Le gouvernement préférait employer la persuasion et l'effort de consensus avec ses sujets, plutôt que la force, et favorisait la coopération, non la soumission. Les Romains disposaient d'un commandement militaire unique qui rassemblait toutes les ressources des provinces pour protéger la totalité du territoire romain. Leur armée était soutenue par un système unifié d'administration et de législation. Il n'y eut aucune révolte paysanne ni aucune tentative de créer des états sécessionnistes à cette époque. Les soulèvements provinciaux avaient pour but de protéger la capitale, Constantinople, et renouveler son gouvernement : c'étaient des coups d'état. La Romania était moins un empire qu'un état-nation.
Par contraste, le califat faisait face à une problème qui lui fut fatal : il n'élabora jamais une idéologie consensuelle de gouvernement. Un petit nombre de guerriers arabes, temporairement unifiés par un nouveau message religieux, profitèrent de la ruine provoquée par la guerre entre Rome et la Perse pour se tailler un empire à eux. Les populations conquises furent contraintes de payer des impôts pour entretenir cette armée de conquête. Mais quoi de plus ? A qui ce pouvoir appartenait-il et quel était son objectif ? Dans un premier temps, les conquérants ne se souciaient pas de convertir les autres : ils n'y avaient pas intérêt, car cela aurait diminué le montant des impôts (pesant sur les infidèles). Mais qu'apportaient les gouvernants aux gouvernés, sinon l'assurance de ne pas les tuer ? Les chrétiens, les Juifs, les zoroastriens conquis ne s'identifiaient pas au projet du califat, qui leur imposait une domination étrangère assortie d'impôts plus lourds. Pour la première fois depuis des siècles, il y eut à nouveau des révoltes agraires en Egypte.
De plus, qu'arrivait-il quand les conquis commençaient à se convertir à l'islam et à apprendre l'arabe ? Leur fallait-il encore payer des impôts ? Devenaient-ils des arabes, avaient-ils un droit sur le fonctionnement de l'empire ? Ces questions pressantes furent vite compliquées par un autre fait : les conquérants établis dans les villes engagèrent des mercenaires non-arabes, en particulier des Turcs, pour combattre à leur place. Comment, dans ce cas, tracer les lignes de l'identité et du pouvoir ? A qui toute cette structure était-elle censée profiter ? Enfin, sur quels critères choisir les gouvernants ? Il n'y eut aucun consensus sur ces problèmes critiques, et donc des dynasties, des familles, des tribus concurrentes rassemblaient des partisans. Ces factions se soupçonnaient l'une l'autre dès l'abord et se faisaient périodiquement la guerre. L'unité politique des musulmans, ordonnée par le Coran, était une fiction pieuse. La guerre civile commença presque immédiatement et finalement, le califat se désintégra, en même temps que des dynasties régionales se libéraient du centre. Les factions concurrentes étaient en violent désaccord mutuel sur l'identité et les objectifs, et sur les questions de savoir qui devait gouverner qui, pourquoi, et comment ? Les Romains avaient réglé ces questions depuis longtemps.
p. 417
[La population de Constantinople au IV°s]
Qui étaient les premiers nouveaux Romains ?
L'ancienne cité de Byzance avait peut-être 25000 habitants. Avant la peste de 542, soit en deux siècles, Constantinople avait atteint environ un demi-million d'habitants. Cela impliquait une augmentation annuelle de 2200 personnes, bien que l'augmentation ne fût pas constante, du moins au début. Les cités densément peuplées des temps prémodernes étaient si malsaines (avec les chauds bouillons de culture que les Romains appelaient "thermes", les ordures souvent jetées par les fenêtres dans les rues) qu'elles étaient vraiment des pièges mortels. Les gens mouraient de maladie, dans des incendies, et par la violence, à un taux bien supérieur à celui des campagnes. Constantinople a dû perdre 1% de sa population chaque année, ce qui veut dire qu'il fallait faire venir autant d'habitants uniquement pour ne pas décroître (certaines statistiques évaluent le taux de mortalité annuel à 3%). Vers 540, la Ville avait besoin de 5000 à 6000 nouveaux habitants par an, en plus de ceux qu'il lui fallait pour s'accroître. En d'autres termes, Constantinople se développa grâce à une importante migration constante venue des provinces.
Que représentent un demi-million d'habitants, comparés à la population globale de l'empire romain d'Orient ? Les estimations modernes pour l'année 164 (avant la grande peste antonine) placent le total à environ 25 millions. Si nous supposons (en gros) que l'empire perdit 10% de sa population dans la peste du second siècle et encore 10% lors des guerres et des pestes du troisième siècle, nous aurons un peu plus de 20 millions d'habitants à la fin du III°s, peut-être plus, sachant qu'en période favorable les populations anciennes pouvaient augmenter de 0,1% par an... D'après ces calculs, l'empire d'Orient était moins peuplé que la conurbation de Tokyo aujourd'hui.
pp. 21-22.
Qui étaient les premiers nouveaux Romains ?
L'ancienne cité de Byzance avait peut-être 25000 habitants. Avant la peste de 542, soit en deux siècles, Constantinople avait atteint environ un demi-million d'habitants. Cela impliquait une augmentation annuelle de 2200 personnes, bien que l'augmentation ne fût pas constante, du moins au début. Les cités densément peuplées des temps prémodernes étaient si malsaines (avec les chauds bouillons de culture que les Romains appelaient "thermes", les ordures souvent jetées par les fenêtres dans les rues) qu'elles étaient vraiment des pièges mortels. Les gens mouraient de maladie, dans des incendies, et par la violence, à un taux bien supérieur à celui des campagnes. Constantinople a dû perdre 1% de sa population chaque année, ce qui veut dire qu'il fallait faire venir autant d'habitants uniquement pour ne pas décroître (certaines statistiques évaluent le taux de mortalité annuel à 3%). Vers 540, la Ville avait besoin de 5000 à 6000 nouveaux habitants par an, en plus de ceux qu'il lui fallait pour s'accroître. En d'autres termes, Constantinople se développa grâce à une importante migration constante venue des provinces.
Que représentent un demi-million d'habitants, comparés à la population globale de l'empire romain d'Orient ? Les estimations modernes pour l'année 164 (avant la grande peste antonine) placent le total à environ 25 millions. Si nous supposons (en gros) que l'empire perdit 10% de sa population dans la peste du second siècle et encore 10% lors des guerres et des pestes du troisième siècle, nous aurons un peu plus de 20 millions d'habitants à la fin du III°s, peut-être plus, sachant qu'en période favorable les populations anciennes pouvaient augmenter de 0,1% par an... D'après ces calculs, l'empire d'Orient était moins peuplé que la conurbation de Tokyo aujourd'hui.
pp. 21-22.
[La ville et le désert : anciennes et nouvelles cultures]
La culture qui naquit de cette fascinante fusion d'éléments romains, grecs et chrétiens était un champ complexe de valeurs qui se chevauchaient ou rivalisaient entre elles, débouchant sur de captivants paradoxes : splendides mosaïques dorées de saints qui avaient renoncé à la richesse, orateurs rompus à la rhétorique classique convainquant leur auditoire qu'ils n'étaient que les modestes porte-parole d'une simple vérité - des universitaires au service d'humbles pêcheurs. Le chancelier eunuque Lausus, dont le palais magnifique se dressait près de l'Hippodrome, y réunit la plus fantastique collection d'art grec jamais vue, contenant le Zeus olympien de Phidias, l'Aphrodite de Cnide de Praxitèle, l'Héra de Samos, l'Athéna de Lindos, et d'autres. Pourtant Lausus fut le dédicataire de l'Histoire Lausiaque de Palladios, où l'on célèbre le renoncement ascétique à la vaine gloire et aux biens terrestres. C'était une culture qui s'efforçait de synthétiser des valeurs contradictoires, aussi bien terrestres que spirituelles.
p. 150
La culture qui naquit de cette fascinante fusion d'éléments romains, grecs et chrétiens était un champ complexe de valeurs qui se chevauchaient ou rivalisaient entre elles, débouchant sur de captivants paradoxes : splendides mosaïques dorées de saints qui avaient renoncé à la richesse, orateurs rompus à la rhétorique classique convainquant leur auditoire qu'ils n'étaient que les modestes porte-parole d'une simple vérité - des universitaires au service d'humbles pêcheurs. Le chancelier eunuque Lausus, dont le palais magnifique se dressait près de l'Hippodrome, y réunit la plus fantastique collection d'art grec jamais vue, contenant le Zeus olympien de Phidias, l'Aphrodite de Cnide de Praxitèle, l'Héra de Samos, l'Athéna de Lindos, et d'autres. Pourtant Lausus fut le dédicataire de l'Histoire Lausiaque de Palladios, où l'on célèbre le renoncement ascétique à la vaine gloire et aux biens terrestres. C'était une culture qui s'efforçait de synthétiser des valeurs contradictoires, aussi bien terrestres que spirituelles.
p. 150
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Anthony Kaldellis (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
l'histoire médiévale française niveau facile à moyen
Entre quelles période situe-t-on le Moyen-Age?
Période moderne et Révolution Française
Préhistoire et Antiquité
Antiquité et période moderne
Révolution française et période contemporaine
23 questions
266 lecteurs ont répondu
Thèmes :
médiéval
, moyen-âge
, histoire de franceCréer un quiz sur ce livre266 lecteurs ont répondu