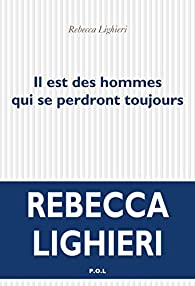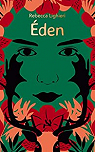Il est des hommes est un roman noir, au sens où il ambitionne de dire quelque chose du monde social, de sa dureté, de sa folie, de sa barbarie. Un roman qui se confronte aux forces du mal, qui raconte l'enfance dévastée, l'injustice, le sida, la drogue, la violence dans une cité de Marseille entre les années 80 et 2000.
Le narrateur, Karel, est un garçon des quartiers Nord. Il grandit dans la cité Antonin Artaud, cité fictive adossée au massif de l'Etoile et flanquée d'un bidonville, « le passage 50 », habité par des gitans sédentarisés. Karel vit avec sa soeur Hendricka et son petit frère Mohand, infirme. Ils essaient de survivre à leur enfance, entre maltraitance, toxicomanie, pauvreté des parents, et indifférence des institutions. le roman s'ouvre sur l'assassinat de leur père. Les trois enfants vont s'inventer chacun un destin. Karel s'interroge : « Qui a tué mon père ? » Et fantasme sur la vie qu'il aurait pu mener s'il était né sous une bonne étoile, s'il avait eu des parents moins déviants et moins maltraitants. Il se demande s'il n'a pas été contaminé par la violence, s'il n'est pas dépositaire d'un héritage à la fois tragique et minable, qui l'amènerait à abîmer les gens comme son père l'a fait. Il veille sur son petit frère et voit sa soeur réussir une carrière au cinéma.
C'est aussi le roman de Marseille, d'avant le MUCEM et d'avant la disparition du marché de la Plaine, qui constitue la géographie sentimentale du livre. Et c'est une plongée romanesque dans toute une culture populaire dont l'auteure saisit l'énergie et les émotions à travers les chansons de l'époque, de Céline Dion à Michael Jackson, en passant par IAM , Cheb Hasni, Richard Cocciante ou Elton John.
Un magnifique roman qui me rappelle mon enfance avec toute la cruauté que la belle Marseille cache en son sein.
Le narrateur, Karel, est un garçon des quartiers Nord. Il grandit dans la cité Antonin Artaud, cité fictive adossée au massif de l'Etoile et flanquée d'un bidonville, « le passage 50 », habité par des gitans sédentarisés. Karel vit avec sa soeur Hendricka et son petit frère Mohand, infirme. Ils essaient de survivre à leur enfance, entre maltraitance, toxicomanie, pauvreté des parents, et indifférence des institutions. le roman s'ouvre sur l'assassinat de leur père. Les trois enfants vont s'inventer chacun un destin. Karel s'interroge : « Qui a tué mon père ? » Et fantasme sur la vie qu'il aurait pu mener s'il était né sous une bonne étoile, s'il avait eu des parents moins déviants et moins maltraitants. Il se demande s'il n'a pas été contaminé par la violence, s'il n'est pas dépositaire d'un héritage à la fois tragique et minable, qui l'amènerait à abîmer les gens comme son père l'a fait. Il veille sur son petit frère et voit sa soeur réussir une carrière au cinéma.
C'est aussi le roman de Marseille, d'avant le MUCEM et d'avant la disparition du marché de la Plaine, qui constitue la géographie sentimentale du livre. Et c'est une plongée romanesque dans toute une culture populaire dont l'auteure saisit l'énergie et les émotions à travers les chansons de l'époque, de Céline Dion à Michael Jackson, en passant par IAM , Cheb Hasni, Richard Cocciante ou Elton John.
Un magnifique roman qui me rappelle mon enfance avec toute la cruauté que la belle Marseille cache en son sein.
Qu'est-ce qui peut sauver les enfants nés sous une mauvaise étoile ? Qui pour prendre soin de Karel, Hendricka, et leur petit frère handicapé Mohand, enfants d'un couple maltraitant et drogué jusqu'à l'os ? Dans les quartiers Nord de Marseille, les gitans voisins de la cité Artaud où essaient de grandir les trois gamins, sont les seuls à prendre soin d'eux. L'école ? Malgré les bons résultats de Karel, il est destiné par essence au même lycée pro que ses copains. Les services sociaux ont sans doute d'autres urgences à gérer. Karl, le père, tente de monnayer la beauté métisse de ses deux aînés en leur faisant courir les castings. Ça marche pour Hendricka, qui devient une star. Karel arrête l'école à 16 ans, beau gosse / bad boy typiquement marseillais, officiellement en couple avec la bouillante Shayenne, la petite soeur de son meilleur pote gitan.
Il s'en veut de gâcher sa vie. Il s'en veut de n'avoir jamais réussi à protéger Mohand de la cruauté de son père, de la surprotection toxique et toxicomane de sa mère, il s'en veut de tromper Shayenne, il s'en veut de sentir monter en lui la même violence que son père. Y a-t-il une malédictions pour les garçons comme lui, comme Michael Jackson, comme Marvin Gaye ?
C'est mon premier Rebecca Lighieri, et je suis sous le choc. Ce ne sera pas le dernier !
Il s'en veut de gâcher sa vie. Il s'en veut de n'avoir jamais réussi à protéger Mohand de la cruauté de son père, de la surprotection toxique et toxicomane de sa mère, il s'en veut de tromper Shayenne, il s'en veut de sentir monter en lui la même violence que son père. Y a-t-il une malédictions pour les garçons comme lui, comme Michael Jackson, comme Marvin Gaye ?
C'est mon premier Rebecca Lighieri, et je suis sous le choc. Ce ne sera pas le dernier !
Roman social noir, Il est des hommes qui se perdront toujours nous entraîne au coeur d'une cité (fictive) de Marseille et nous parle de la misère sociale et de ses ravages, de l'enfance sacrifiée et des vies enfermées dans un destin funeste marqué par la violence, l'absence d'amour, de tendresse et d'espoir, la drogue, le sida, la pauvreté.
Des années 80 aux années 2000, Karel, aîné d'une fratrie de 3, nous raconte son enfance et son adolescence au sein d'une cité gangrenée par une telle misère sociale que les petits trafics et la drogue semblent les seuls moyens de soulager un quotidien trop lourd.
Un quotidien fait de peurs et d'angoisses où l'ombre menaçante d'un père cruel et tyrannique étend son voile de nuit sur leur enfance brisée. Coups, insultes, humiliations, rien n'est épargné à Karel, Hendricka et Mohand, le petit dernier qui cumule en plus maladie et handicap. de rares mais intenses moments de lumière viennent néanmoins éclairer cette histoire déchirante : la musique d'IAM, les moments de liesses populaires a l'occasion de la victoire de l'OM sur le Milan AC, la chaleur de la ville, l'histoire d'amour entre Karel et Shayenne…
Avec une plume acérée et un style souvent cru, Rebecca Lighieri interroge ici le déterminisme social. Peut-on s'extraire de la pauvreté quand on a connu que cela? Sommes-nous destinés à reproduire ce que l'on a vécu dans son enfance ?
Ce roman est sombre et certaines images sont insoutenables, mais la grande force de l'autrice est de réussir à illuminer son récit grâce à des personnages poignants et des petites touches d'espoir salutaires. Je me suis énormément attachée aux personnages, même les secondaires ont beaucoup de profondeur. J'ai particulièrement aimé la façon dont l'autrice décrit les visages et les corps, leur diversité de formes, d'odeurs…il y a de la sensualité dans ses descriptions.
Ce roman est addictif, dès le premier chapitre, j'ai été happée. L'autrice maintient le rythme et le suspense jusqu'au bout avec beaucoup d'habileté.
En résumé, un récit poignant, prenant et bouleversant que je vous recommande à 100%.
Des années 80 aux années 2000, Karel, aîné d'une fratrie de 3, nous raconte son enfance et son adolescence au sein d'une cité gangrenée par une telle misère sociale que les petits trafics et la drogue semblent les seuls moyens de soulager un quotidien trop lourd.
Un quotidien fait de peurs et d'angoisses où l'ombre menaçante d'un père cruel et tyrannique étend son voile de nuit sur leur enfance brisée. Coups, insultes, humiliations, rien n'est épargné à Karel, Hendricka et Mohand, le petit dernier qui cumule en plus maladie et handicap. de rares mais intenses moments de lumière viennent néanmoins éclairer cette histoire déchirante : la musique d'IAM, les moments de liesses populaires a l'occasion de la victoire de l'OM sur le Milan AC, la chaleur de la ville, l'histoire d'amour entre Karel et Shayenne…
Avec une plume acérée et un style souvent cru, Rebecca Lighieri interroge ici le déterminisme social. Peut-on s'extraire de la pauvreté quand on a connu que cela? Sommes-nous destinés à reproduire ce que l'on a vécu dans son enfance ?
Ce roman est sombre et certaines images sont insoutenables, mais la grande force de l'autrice est de réussir à illuminer son récit grâce à des personnages poignants et des petites touches d'espoir salutaires. Je me suis énormément attachée aux personnages, même les secondaires ont beaucoup de profondeur. J'ai particulièrement aimé la façon dont l'autrice décrit les visages et les corps, leur diversité de formes, d'odeurs…il y a de la sensualité dans ses descriptions.
Ce roman est addictif, dès le premier chapitre, j'ai été happée. L'autrice maintient le rythme et le suspense jusqu'au bout avec beaucoup d'habileté.
En résumé, un récit poignant, prenant et bouleversant que je vous recommande à 100%.
Une fratrie soudée pour tout surmonter !
En vacances près de Marseille, j'ai embarqué avec moi ce texte de Rebecca Lighieri, pseudonyme de Emmanuelle Bayamack-Tam, sans savoir à quoi m'attendre. Pourtant, le titre donne le ton. Cette lecture a été éprouvante par la violence qui se dégage de ce roman. J'ai été happé par l'écriture et la vie de ces personnages.
C'est Karel, le narrateur, un enfant et un adulte perdu. Avec sa soeur Hendricka et son frère Mohand, ils vivent dans les quartiers Nord, sous les coups et humiliations de leur père et la folie de leur mère. Leur seul refuge est le passage 50 où parmi les gitans, ils trouvent un semblant de famille. le roman débute par l'assassinat du père et Karel remonte le temps jusqu'à ces 7 ans pour nous expliquer la vie de cette fratrie.
Le rythme est rapide, la décennie 90 défile sous nos yeux. Ce roman social est très sombre, noir, réaliste ? On veut savoir comment Karel, Hendricka et Mohand vont se construire, comment ces enfants détruits vont évoluer, car ils rêvent d'une vie normale, ils envient une vie normale. Des personnages féminins forts et positifs gravitent autour d'eux, Yolanda, Shayenne.
Il y a de nombreuses références populaires ou littéraires. La sexualité des personnages féminins comme masculins est crue, violente, assumée. Ce roman raconte la misère, la folie, des relations humaines qui se vivent avec les tripes. Certains passages sont marquant : L' épisode de la rencontre entre Karel et Gabrielle très douloureux. L'installation dans le nouvel appartement émouvant.
Je retiendrai les liens d'amour très forts qui unissent cette fratrie dans la même haine du père, l'esprit de résilience pour pouvoir s'en sortir. La violence de vouloir s'en sortir et faire mentir le déterminisme social. Un espoir ?
Un texte difficile, puissant avec des personnages que l'on oublie pas !
En vacances près de Marseille, j'ai embarqué avec moi ce texte de Rebecca Lighieri, pseudonyme de Emmanuelle Bayamack-Tam, sans savoir à quoi m'attendre. Pourtant, le titre donne le ton. Cette lecture a été éprouvante par la violence qui se dégage de ce roman. J'ai été happé par l'écriture et la vie de ces personnages.
C'est Karel, le narrateur, un enfant et un adulte perdu. Avec sa soeur Hendricka et son frère Mohand, ils vivent dans les quartiers Nord, sous les coups et humiliations de leur père et la folie de leur mère. Leur seul refuge est le passage 50 où parmi les gitans, ils trouvent un semblant de famille. le roman débute par l'assassinat du père et Karel remonte le temps jusqu'à ces 7 ans pour nous expliquer la vie de cette fratrie.
Le rythme est rapide, la décennie 90 défile sous nos yeux. Ce roman social est très sombre, noir, réaliste ? On veut savoir comment Karel, Hendricka et Mohand vont se construire, comment ces enfants détruits vont évoluer, car ils rêvent d'une vie normale, ils envient une vie normale. Des personnages féminins forts et positifs gravitent autour d'eux, Yolanda, Shayenne.
Il y a de nombreuses références populaires ou littéraires. La sexualité des personnages féminins comme masculins est crue, violente, assumée. Ce roman raconte la misère, la folie, des relations humaines qui se vivent avec les tripes. Certains passages sont marquant : L' épisode de la rencontre entre Karel et Gabrielle très douloureux. L'installation dans le nouvel appartement émouvant.
Je retiendrai les liens d'amour très forts qui unissent cette fratrie dans la même haine du père, l'esprit de résilience pour pouvoir s'en sortir. La violence de vouloir s'en sortir et faire mentir le déterminisme social. Un espoir ?
Un texte difficile, puissant avec des personnages que l'on oublie pas !
C'est pas la joie chez les Claeys. C'est même carrément l'horreur. le père, alcoolo, toxico est un monstre cruel et violent pour ses enfants. La mère, un peu plus aimante, mais effacée est soumise et paumée. Nous sommes à Marseille dans une cité populaire, au milieu des années 80 quand débute le récit de Karel, narrateur et fils ainé de la famille. Heureusement pour les minots, ils trouvent un peu de réconfort et de tendresse auprès d'une communauté de gitans sédentarisés sur un terrain vague à deux pas de la cité. Karel se rêve un destin différent, loin de la maltraitance, et de la misère sociale où il grandit. Mais peut-on échapper à un héritage familial aussi lourd ? Entre roman noir, roman d'apprentissage et récit familial, Rebecca Lighieri nous offre ici un très beau texte sur la lutte pour échapper au déterminisme social. L'histoire est sombre, violente, remplie de tortures et d'abus, mais paradoxalement jamais écoeurante. C'est pour moi un des grands talents de l'autrice de réussir à décrire l'horreur du quotidien sans jamais tomber dans le misérabilisme, dans les détails glauques ou malsains. Bien au contraire, elle couvre ses personnages d'une grande dignité, raconte avec sensualité leur fureur de vivre, explore avec empathie leur psychologie traumatisée, le tout baignant avec justesse dans la musique populaire des années 80 et 90. Une tragédie d'une envoutante et lumineuse noirceur que je recommande.
le narrateur nous immerge dans une cité des quartiers nord de Marseille dans les années 80. Mais l'immersion se fait progressivement. L'histoire commence dans un café du vieux port, la brasserie du Soleil, par une scène anodine en apparence, mais qui contient en réalité, à elle seule, la totalité du roman, avec au centre, la figure dévastatrice et terrifiante du père. Un père déjà mort, puisque le 1er chapitre, style prologue, en évoque l'assassinat, mais aussi toxique mort que vivant ; une mort qui enclenche le souvenir et le récit d'une enfance massacrée, d'une adolescence saccagée et d'un âge d'homme insoutenable.
Plus on plonge dans l'histoire de cette vie dépouillée de tout ce qui pourrait la rendre supportable, plus on a – en tant que lecteur – le sentiment d'être dans un film plus que dans un roman, au point que la musique manque. On a le rythme, on a les images, on a les mots, les paroles mêmes des chansons du moment, mais il manque la musique, et ce manque est gênant. A la scène d'ouverture, dans le café du vieux port où la mère, Loubna, fonce sur le juke-box et fait grésiller la voix « nasillarde » du chanteur italien Eros Ramazzotti « una storia importante... » pour conjurer la perfidie de Karl, répond, à l'avant dernier chapitre, la voix « suave » de Terence Trent D'Arby et son injonction : « Dance little sister, don't give up today... » qui fait vibrer le narrateur et virevolter sa soeur. Entre les deux, une avalanche de souffrances, de violences, de cruautés familiales, amicales, amoureuses, sexuelles.
Si, au début de l'histoire, dans la petite enfance, l'image de la mère vient éclairer quelque peu un quotidien sordide et insupportable, cette image se dégrade très vite et devient aussi toxique que celle du père, peut-être même plus toxique parce qu'elle ne se donne pas comme telle. A noter que la figure centrale du père atteint des summums de cruauté et de lâcheté, suscitant chez ses trois enfants une haine imprescriptible. Or, autant la littérature nous a habitués à des figures de mères monstrueuses, autant elle reste beaucoup plus nuancée sur les figures de pères. Ils peuvent être froids, volages, calculateurs, autoritaires, violents même, mais rarement, à ma connaissance en tout cas, monstrueux. En cela, Rebecca Lighieri inaugure un genre avec un modèle difficile à égaler et dont le réalisme confère une authenticité qui fait frémir.
Par ailleurs, il ressort de ce récit un pessimisme susceptible de décourager le plus acharné des humanistes. Si, au début du récit, le narrateur enfant peut encore se projeter dans un avenir désirable : « ...Je me sens grand, vertueux, presque heureux – le coeur gonflé d'espoir. C'est peut-être moi le sauveur, après tout. », ces illusions ne font pas long feu. Surgit alors, au fil des pages, le principe incontestable d'une détermination à laquelle nul ne peut échapper, Karel encore moins que quiconque. L'enfance malheureuse et sordide implique nécessairement une vie malheureuse et sordide. Karel, fils de Karl, est condamné à reproduire et à s'approprier violence et cruauté, condamné à rester enfermé dans ce cercle vicieux de la misère matérielle et affective. C'est ce déterminisme qui est asséné à chaque nouvel épisode du roman jusqu'à la citation d'Antonin Artaud, tirée du texte intitulé « La Liquidation de l'opium » paru dans La Révolution surréaliste en janvier 1925 « Il y a des âmes incurables et perdues pour le reste de la société. Supprimez-leur un moyen de folie, elles en inventeront dix mille autres. ». Et cette affirmation nous ramène au titre du roman, emprunté lui aussi à ce même texte dont je redonne ici l'extrait : « L'homme est misérable, l'âme est faible, il est des hommes qui se perdront toujours. Peu importe le moyen de la perte ; ça ne regarde pas la société. » Artaud affirme un déterminisme total que soutient et met en scène le récit de Rebecca Lighieri. Est-il possible d'y échapper ? Comme chez Artaud, qui a donné son nom à la cité marseillaise, la fratrie Claeys n'y échappe que grâce aux paradis artificiels, et encore, y échappent-ils vraiment ? « Tant que ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain... » (opus cité) il est probable que nul n'y échappe durablement. Ce devrait être le combat de la richesse de lutter contre la misère et d'en éradiquer les causes. Mais la richesse ne se bat que pour elle-même, et sa générosité n'est qu'un leurre ainsi que le démontre le fugitif et insipide personnage de Jérémie.
Autant de constats bien sombres et un tableau dérangeant de la détresse humaine. Ils mériteraient sans doute une adaptation cinématographique qui pourrait en préciser les contours et, avec un peu de génie, en extirper une parcelle d'espoir.
Plus on plonge dans l'histoire de cette vie dépouillée de tout ce qui pourrait la rendre supportable, plus on a – en tant que lecteur – le sentiment d'être dans un film plus que dans un roman, au point que la musique manque. On a le rythme, on a les images, on a les mots, les paroles mêmes des chansons du moment, mais il manque la musique, et ce manque est gênant. A la scène d'ouverture, dans le café du vieux port où la mère, Loubna, fonce sur le juke-box et fait grésiller la voix « nasillarde » du chanteur italien Eros Ramazzotti « una storia importante... » pour conjurer la perfidie de Karl, répond, à l'avant dernier chapitre, la voix « suave » de Terence Trent D'Arby et son injonction : « Dance little sister, don't give up today... » qui fait vibrer le narrateur et virevolter sa soeur. Entre les deux, une avalanche de souffrances, de violences, de cruautés familiales, amicales, amoureuses, sexuelles.
Si, au début de l'histoire, dans la petite enfance, l'image de la mère vient éclairer quelque peu un quotidien sordide et insupportable, cette image se dégrade très vite et devient aussi toxique que celle du père, peut-être même plus toxique parce qu'elle ne se donne pas comme telle. A noter que la figure centrale du père atteint des summums de cruauté et de lâcheté, suscitant chez ses trois enfants une haine imprescriptible. Or, autant la littérature nous a habitués à des figures de mères monstrueuses, autant elle reste beaucoup plus nuancée sur les figures de pères. Ils peuvent être froids, volages, calculateurs, autoritaires, violents même, mais rarement, à ma connaissance en tout cas, monstrueux. En cela, Rebecca Lighieri inaugure un genre avec un modèle difficile à égaler et dont le réalisme confère une authenticité qui fait frémir.
Par ailleurs, il ressort de ce récit un pessimisme susceptible de décourager le plus acharné des humanistes. Si, au début du récit, le narrateur enfant peut encore se projeter dans un avenir désirable : « ...Je me sens grand, vertueux, presque heureux – le coeur gonflé d'espoir. C'est peut-être moi le sauveur, après tout. », ces illusions ne font pas long feu. Surgit alors, au fil des pages, le principe incontestable d'une détermination à laquelle nul ne peut échapper, Karel encore moins que quiconque. L'enfance malheureuse et sordide implique nécessairement une vie malheureuse et sordide. Karel, fils de Karl, est condamné à reproduire et à s'approprier violence et cruauté, condamné à rester enfermé dans ce cercle vicieux de la misère matérielle et affective. C'est ce déterminisme qui est asséné à chaque nouvel épisode du roman jusqu'à la citation d'Antonin Artaud, tirée du texte intitulé « La Liquidation de l'opium » paru dans La Révolution surréaliste en janvier 1925 « Il y a des âmes incurables et perdues pour le reste de la société. Supprimez-leur un moyen de folie, elles en inventeront dix mille autres. ». Et cette affirmation nous ramène au titre du roman, emprunté lui aussi à ce même texte dont je redonne ici l'extrait : « L'homme est misérable, l'âme est faible, il est des hommes qui se perdront toujours. Peu importe le moyen de la perte ; ça ne regarde pas la société. » Artaud affirme un déterminisme total que soutient et met en scène le récit de Rebecca Lighieri. Est-il possible d'y échapper ? Comme chez Artaud, qui a donné son nom à la cité marseillaise, la fratrie Claeys n'y échappe que grâce aux paradis artificiels, et encore, y échappent-ils vraiment ? « Tant que ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain... » (opus cité) il est probable que nul n'y échappe durablement. Ce devrait être le combat de la richesse de lutter contre la misère et d'en éradiquer les causes. Mais la richesse ne se bat que pour elle-même, et sa générosité n'est qu'un leurre ainsi que le démontre le fugitif et insipide personnage de Jérémie.
Autant de constats bien sombres et un tableau dérangeant de la détresse humaine. Ils mériteraient sans doute une adaptation cinématographique qui pourrait en préciser les contours et, avec un peu de génie, en extirper une parcelle d'espoir.
L'espérance de vie de l'amour, c'est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. Dans les années 90, à Marseille, Karel, Hendricka et leur petit frère infirme Mohand, vivent dans une cité hlm fictive sous les coups de leur alcoolique et drogué de père et le regard triste de leur mère. Pour s'en sortir, ils fuient la maison et trouvent l'amour dans un camp de gitans. Mais La seule chose qui dure toujours, nous prévient l'auteure, c'est l'enfance quand elle s'est mal passée. Alors attendez-vous au pire !
Qu'elle les signe Emmanuelle Bayamack -Tam ou Rebecca Lighieri, les romans de cette auteure française sont d'une puissance troublante. Que ce soit dans Arcadie, Husbands ou Les garçons de l'été ou plus récemment dans Eden, la famille est toxique, elle offre à ses enfants un lieu de déséquilibre, de conflit, de violence, d'espoirs déçus, de rancoeur... Mais il y a de l'amour aussi, celui entre certains membres de ces familles calamiteuses et celui très cru que l'auteure décrit dans les scènes de sexe. Ces livres sont comme ces films que l'on regarde les mains devant les yeux en laissant un petit espace entre chaque doigt. On veut voir, mais en gardant une distance raisonnable pour ne pas être emporté. Une tension dingue fait se dresser les poils à chaque fois qu'on tourne une page, les personnages peuvent déraper dans la sauvagerie à tout moment. Dérangeants et addictifs, impossible de s'arrêter en route !
Qu'elle les signe Emmanuelle Bayamack -Tam ou Rebecca Lighieri, les romans de cette auteure française sont d'une puissance troublante. Que ce soit dans Arcadie, Husbands ou Les garçons de l'été ou plus récemment dans Eden, la famille est toxique, elle offre à ses enfants un lieu de déséquilibre, de conflit, de violence, d'espoirs déçus, de rancoeur... Mais il y a de l'amour aussi, celui entre certains membres de ces familles calamiteuses et celui très cru que l'auteure décrit dans les scènes de sexe. Ces livres sont comme ces films que l'on regarde les mains devant les yeux en laissant un petit espace entre chaque doigt. On veut voir, mais en gardant une distance raisonnable pour ne pas être emporté. Une tension dingue fait se dresser les poils à chaque fois qu'on tourne une page, les personnages peuvent déraper dans la sauvagerie à tout moment. Dérangeants et addictifs, impossible de s'arrêter en route !
Rebecca Lighieri, pseudonyme d'Emmanuelle Bayamack-Tam qui a notamment écrit le roman « Arcadie » qui a remporté le prix du livre inter 2019, nous livre ici un roman résolument contemporain. Je le précise tout de suite, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire « Arcadie » dont j'ai entendu beaucoup de bien, ni d'ailleurs d'autres livres de cette écrivaine, c'est donc une découverte avec ce roman. Je peux déjà dire que cela me donne envie de découvrir les autres livres de l'auteur.
Ce roman, c'est l'histoire d'une famille. A travers les yeux de Karel, on découvre déjà des parents aux abonnés absents. Un père qui vivote de petits trafics et qui dilapide l'argent en alcool ou en drogue. Une mère qui subit les violences du père. Elle ne s'occupe que du dernier enfant né avec un handicap très lourd et tombe également dans la drogue. Les enfants se serrent les coudes, essuient les coups, grandissent entre leur cité et le camp de gitan à proximité.
Ce roman aborde des thèmes très durs, la maltraitance familiale, la drogue, l'effet sur les enfants des carences parentales, le handicap et les différences. D'autres sujets également apparaissent au fur et à mesure que les enfants grandissent, les premiers amours par exemple. C'est très large mais admirablement maitrisé par l'auteur. Avec une très belle plume, elle arrive à nous immerger dans le quotidien de cette enfance très lourde et le lecteur ne pourra pas rester de marbre face à la violence de cette vie.
Un roman à découvrir, violent, émotionnellement intense, admirablement servi par cette écriture moderne et fluide. Aucun temps mort pour le lecteur dans ce récit qui nous décroche parfois un sourire mais qui est dans l'ensemble plutôt dramatique. C'est une belle découverte !
Ce roman, c'est l'histoire d'une famille. A travers les yeux de Karel, on découvre déjà des parents aux abonnés absents. Un père qui vivote de petits trafics et qui dilapide l'argent en alcool ou en drogue. Une mère qui subit les violences du père. Elle ne s'occupe que du dernier enfant né avec un handicap très lourd et tombe également dans la drogue. Les enfants se serrent les coudes, essuient les coups, grandissent entre leur cité et le camp de gitan à proximité.
Ce roman aborde des thèmes très durs, la maltraitance familiale, la drogue, l'effet sur les enfants des carences parentales, le handicap et les différences. D'autres sujets également apparaissent au fur et à mesure que les enfants grandissent, les premiers amours par exemple. C'est très large mais admirablement maitrisé par l'auteur. Avec une très belle plume, elle arrive à nous immerger dans le quotidien de cette enfance très lourde et le lecteur ne pourra pas rester de marbre face à la violence de cette vie.
Un roman à découvrir, violent, émotionnellement intense, admirablement servi par cette écriture moderne et fluide. Aucun temps mort pour le lecteur dans ce récit qui nous décroche parfois un sourire mais qui est dans l'ensemble plutôt dramatique. C'est une belle découverte !
Une petite pause dans la lecture des séries The Mortal Instruments pour lire un livre que je devais lire dans la cadre de mon cours de français. Dans tout le panel de lecture qu'on a à faire, c'est celui qui me tentait le plus grâce à son titre qui m'a tout de suite tapé dans l'oeil et à son résumé très énigmatique et beau. Donc j'avais pas mal d'attentes dans ce roman, attentes qu'il a vraiment bien relevé et je n'ai pas été déçue !
La plume de l'autrice, qui est très poétique, brut, impactante et qui contraste avec le langage cru employé par les personnages, nous emmène dans la vie de Karel, habitant dans une cité à Marseille.
La première page s'ouvre sur une question autour de laquelle va naviguer l'histoire : ''Qui a tué mon père ?''. Sous cet angle, on pourrait croire à un roman policier mais c'est tout le contraire : Karel, le narrateur, va nous faire vivre le parcours de sa vie qui est semée d'embûches ainsi que de violences, et nous présenter des personnages tous différents, apportant des aspects variés et des nuances indispensables à l'histoire.
Le récit se construit en plusieurs phases, chacune abordant un sujet différent et un questionnement essentiel.
On commence par suivre l'enfance horrible de Karel, battu par son père et ignoré par sa mère. Son enfance détruite va le briser de l'intérieur et être responsable de ses choix d'avenir ainsi que de la plupart de ses actes.
Ensuite, on découvre un Karel adolescent vivant son premier amour et tous les émois qui vont avec. Dans cette partie, l'autrice nous parle du dévouement amoureux, qui peut être étouffant, des promesses qui se voulaient éternelles, de la passion, de ruptures et d'un questionnement incessant à propos de l'avenir, de ses possibles et de son incertitude.
Enfin, c'est un Karel adulte qui se présente à nous, ayant commis une chose affreuse dont il ne peut se défaire. On va nous dévoiler Karel, confronté à ses démons, à cette action qui le détruit petit à petit et à sa capacité de résilience.
Ce roman m'a marqué et touché, davantage que ce à quoi je m'attendais. La détresse de Karel, qu'on ressent tout au long de l'histoire, est très impactante, et les sujets traités avec brio par l'autrice sont extrêmement importants.
Le langage est très cru et vulgaire par moment, peut-être même un peu trop, mais j'ai aimé le fait que la réalité de la vie soit représentée avec son côté très dur et impitoyable, mais aussi avec les moments de douceur et de répit qu'elle peut offrir.
J'ai été très surprise par le côté de la narration, que j'ai trouvé poétique, brut et fascinant ; ça rend le roman addictif et certains passages vraiment émouvants.
Ce fut une très belle découverte !
La plume de l'autrice, qui est très poétique, brut, impactante et qui contraste avec le langage cru employé par les personnages, nous emmène dans la vie de Karel, habitant dans une cité à Marseille.
La première page s'ouvre sur une question autour de laquelle va naviguer l'histoire : ''Qui a tué mon père ?''. Sous cet angle, on pourrait croire à un roman policier mais c'est tout le contraire : Karel, le narrateur, va nous faire vivre le parcours de sa vie qui est semée d'embûches ainsi que de violences, et nous présenter des personnages tous différents, apportant des aspects variés et des nuances indispensables à l'histoire.
Le récit se construit en plusieurs phases, chacune abordant un sujet différent et un questionnement essentiel.
On commence par suivre l'enfance horrible de Karel, battu par son père et ignoré par sa mère. Son enfance détruite va le briser de l'intérieur et être responsable de ses choix d'avenir ainsi que de la plupart de ses actes.
Ensuite, on découvre un Karel adolescent vivant son premier amour et tous les émois qui vont avec. Dans cette partie, l'autrice nous parle du dévouement amoureux, qui peut être étouffant, des promesses qui se voulaient éternelles, de la passion, de ruptures et d'un questionnement incessant à propos de l'avenir, de ses possibles et de son incertitude.
Enfin, c'est un Karel adulte qui se présente à nous, ayant commis une chose affreuse dont il ne peut se défaire. On va nous dévoiler Karel, confronté à ses démons, à cette action qui le détruit petit à petit et à sa capacité de résilience.
Ce roman m'a marqué et touché, davantage que ce à quoi je m'attendais. La détresse de Karel, qu'on ressent tout au long de l'histoire, est très impactante, et les sujets traités avec brio par l'autrice sont extrêmement importants.
Le langage est très cru et vulgaire par moment, peut-être même un peu trop, mais j'ai aimé le fait que la réalité de la vie soit représentée avec son côté très dur et impitoyable, mais aussi avec les moments de douceur et de répit qu'elle peut offrir.
J'ai été très surprise par le côté de la narration, que j'ai trouvé poétique, brut et fascinant ; ça rend le roman addictif et certains passages vraiment émouvants.
Ce fut une très belle découverte !
Une claque ce roman ! Terrible, lumineux et émouvant.
Comment trois enfants d'une cité de Marseille subissent la violence, les coups, les brimades et les privations d'un père diabolique, alcoolique et toxicomane sous le regard inerte de leur mère.
Et pourtant, entre eux, un lien indéfectible. L'ainé qui est aussi le narrateur, la fille ensuite d'une beauté stupéfiante et le dernier, handicapé, sur lequel le père s'acharne.
Ils se soutiennent envers et contre tout, se réfugient le plus souvent possible dans le camp gitan à proximité de leur cité, dans les caravanes peuplées d'enfants et de « vrais » parents, un havre de paix, un lieu de possibles.
Chaque enfant affrontera ses démons à sa manière, surprenante parfois, touchante ou de manière plus tragique avec des accès de violence.
« La seule chose qui dure toujours, c'est l'enfance, quand elle s'est mal passée, on est coincé à vie».
Le tout est servi par une langue sublime, un scénario qui ne faiblit jamais, une tragédie construite à la perfection qui se déroule sur une décennie des années 90 au passage à l'an 2000 dans la cité marseillaise que l'auteure connait parfaitement bien.
C'est noir, cru, violent et pourtant quelle lumière dans les yeux de ces trois enfants et l'amour qu'ils se portent ! J'ai été scotchée par le destin du petit dernier malgré ses handicaps, quelle force et quelle détermination.
Les personnages secondaires sont eux aussi inoubliables et tellement humains.
Quant à la musique, elle est présente tout au long du récit, l'énergie des chansons populaires « infuse le récit » en permanence (je cite Rebecca Lighieri) : chansons d'amour reprises par des chanteurs de cité improvisés qui clament Julio Iglesias, Céline Dion…. La musique qui galvanise, sert d'exutoire, le rap, les DJ. Michael Jackson et son père violent, Marvin Gaye assassiné par son propre père.
A lire en écoutant IAM et la chanson Petit frère en écho à ce très beau roman inoubliable.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les oubliés du confinement
Bibalice
44 livres

Les 98 livres à lire avant 25 ans
MaggyM
98 livres
Autres livres de Rebecca Lighieri (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (6 - polars et thrillers )
Roger-Jon Ellory : " **** le silence"
seul
profond
terrible
intense
20 questions
2889 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, thriller
, romans policiers et polarsCréer un quiz sur ce livre2889 lecteurs ont répondu