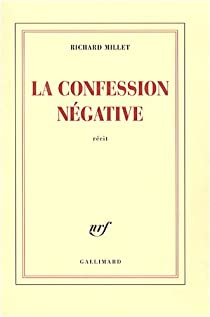« La confession négative » est un récit et non un roman. La mère de l'auteur a affirmé que la guerre avait un rapport avec l'écriture, Richard Millet est allé au Liban. Il nous révèle dans ce livre son passé abjecte de mercenaire et d'assassin dans les milices chrétiennes du Liban.
La mode est aux dictionnaires amoureux. Voila – extrait de « La confession négative » – ce qui pourrait être l'amorce de celui du criminel de guerre :
A gros : « Je regrettais presque qu'il ne se soit rien passé d'autre, au barrage, et que le conducteur de la 404, un homme rondouillard et tremblant, un peu ridicule aussi, s'en soi tiré à bon compte. (…) ces Palestinien, tout comme le type rondouillard, un chrétien probablement, me semblaient minables. le bruit de l'arme automatique, en revanche, m'avait plu.
A petit : « Je l'avais regardé en silence, détestant qu'un inconnu m'adresse la parole, surtout plus petit que moi, qui suis plutôt grand, ce qui force les gens de taille moindre à lever la tête, parfois à se dresser sur la pointe de leurs pieds et à se mesurer à moi avec aigreur, et celui-là avait un air déterminé qui me déplaisait tout en me dissuadant de lui répondre avec hauteur, ce qui fait que je me suis contenté de lui dire que je ne parlais jamais à la légère. »
A paix : « Cette même solitude, lorsque je voulais plaire ou que je plaisais malgré moi, me poussait à des paroles excessives qui était une manière d'atteindre à la vérité par la violence, car j'étais persuadé que la vérité est violence. C'était la raison pour laquelle j'avais, à l'intention de l'inconnu plus que pour mon camarade d'université, qui me semblait déjà quantité négligeable, tout juste une oreille complaisante, clamé que la littérature souffrait de ce qu'il n'y avait plus de guerre, que l'écrivain n'y était plus confronté, qu'il n'y aurait plus de guerres en Europe, et que nous étions condamnés à nous regarder le nombril au sein d'une paix à la longue aussi ennuyeuse qu'un mariage de raison.
A poils ou espèce humaine : « Ces cheveux, je me les étais fait couper fort court avant de partir pour le Liban, estimant que l'allongement excessif du poil, une caractéristique de cette décennie (celle des années soixante-dix, la plus laide, assurément, sur le plan esthétique), était le propre des gens de gauche, pour l'un desquels il me répugnait d'être pris, moi qui trouvais déjà vulgaire le grand sérieux militant et dérisoire la croyance selon laquelle l'humanité est innocente, bonne, perfectible. « L'espèce humaine n'est pas digne d'estime », m'avait dit ma mère, et mon travail au cimetière de Vincennes avait achevé de me monter qu'elle n'est rien. »
« (…) décennie poilue, époque de décadence, me redisais-je, comme toutes celles où le système pileux des hommes est à la mode, la supériorité des Romains se traduisait par des cheveux courts et la rareté des barbes ; quant aux barbus de l'ère victorienne ou du second Empire, ils sont l'étrange paradoxe d'une époque qui allait conduire à la Première Guerre mondiale, et le peu de goût que j'avais pour Karl Marx, et pour Trotski par exemple venait en grande partie de l'horreur que m'inspirait la pilosité et les hémorroïde du premier et la ressemblance du second avec un méchant boutiquier des Buiges (…) »
A journalisme : « Je n'étais pas un journaliste ; je ne ferais pas puer les mots, je ne mentirais pas ; je ne donnerais pas à la démocratie sa prière quotidienne. »
« Elles demeuraient à l'entrée d'un autre domaine : celui de la violence, ma mère et ma soeur ignorant que j'allais surtout dans ces manifestations pour le moment où, après la dispersion, celles-ci dégénéraient, comme le disaient les journalistes dont je ne lisait pas plus la prose que celle des romanciers contemporains, ayant déjà compris, ou du moins eu l'intuition (quoique incapable de le formuler aussi précisément), que le journalisme n'est qu'une prodigieuse entreprise de falsification, sous couvert d'informer et d'analyser, l'information ne parlant en vérité que d'elle-même et l'analyse servant les intérêts propres à renforcer l'ignorance et la déchéance spirituelle des hommes. de là mon soucis, qui irait croissant de n'être plus informé. »
A armes : « Les Palestinien, les Libanais, Les Syriens, les Israéliens, les chrétiens, les musulmans, les druzes, tout ça m'intéressait médiocrement ; si quelque chose me requérait c'était le bruit des armes, persuadé que la guerre et l'écriture sont soeurs. »
« Il fallait courir plié en deux, tout en lâchant des rafales de kalachnikov ou se poster à un carrefour et s'exposer un instant, sans bouger, pour lancer une roquette ou un RPG ou une Energa, grenade enfilée au bout d'un fusil d'assaut, armes dont la puissance donnait, plus encore que le mortier, un sentiment de souveraineté, puisqu'elles pulvérisaient quasi instantanément la cible, procurant tout à la fois la mort et le jugement dernier (…) »
A violence : « J'aimais le déclenchement de la violence, le temps d'infime silence où elle va survenir, le moment où les choses s'enclenchent : elle avait à voir avec la littérature, je le devinais, et avec la grâce créatrice, le trouble sexuel, les émotions supérieures données par les cris, l'odeur de gaz lacrymogène, le bruit des lance-grenades, des cocktails Molotov, du piétinement des chaussures lourdes (…) l'homme aime le défi, le bruit des armes, la guerre autant que l'amour, le silence ou le ciel étoilé. »
(…) je me suis demandé pourquoi la violence n'allait pas plus loi, pourquoi on n'entrait pas dans la dimension meurtrière du sacré, pourquoi un meurtre gratuit n'était pas possible, pourquoi je ne tuais pas, moi, ce gauchiste à qui me liait déjà ce meurtre potentiel, pourquoi je n'allais pas au bout de ma propre violence, par delà de toute haine idéologique ou instinctivement animale (…). »
A idéologie : « Elevé dans la haine du communisme et le mépris de tout ce qui peut ressembler à la philanthropie, soit dans ce mélange de socialisme bourgeois et de christianisme social qui s'est mis en place au XIXe siècle, je ne m'intéressais à aucune cause, pas même à ce dont on pourrait penser que j'étais partisan : je ne sais quel conservatisme, quelle catholicité momifiée. (…) j'étais, dès cette époque, persuadé que le progrès n'est qu'une version dérisoire du passé, que l'homme est ignoble, que la chute du christianisme entrainerait la fin de l'Europe, ce désenchantement serait encore, pour moi, une manière de vivre dans la lumière de l'affirmation. »
« (…) je n'étais que sérieux, moi qui ne croyais à rien, en tout cas pas à la bonté naturelle des hommes, et qui n'avais pour le moment d'autre raison de me battre que la haine du marxisme-léninisme.
(…) je n'aimais pas les discussions, les disputes, les idées générales, ce qui relève de la psychologie immédiate, de la sociologie et de la psychanalyse, lesquelles ne sont que des théologies dévoyées. Seules m'importaient la méditation, plume en main, et l'action, fût-elle la soeur douteuse du rêve, et la formidable poussée donnée par la ville qui avait enfin accouchée de sa guerre, laquelle avait la dimension idéale, humaine, joyeuse, de ce que j'aimais tant au cinéma et dans les récits que les hommes du haut Limousin me faisait de la Grande Guerre et des combats d'Indochine et d'Algérie.
A meurtre : « Qu'avais-je à faire, me redirais-je, des chrétien du Liban, et des musulmans, des Palestiniens, des progressistes, des fascistes, de tout à ce quoi la phraséologie de gauche donnait des figures séduisantes ou infâmes, au nom d'un idéal que tous trahiraient un jour ou l'autre, autant par lassitude que parce que la trahison est un principe politique majeur et l'iniquité un besoin humain fondamental, inévitable, sinistre, ou joyeux, comme le meurtre ? »
« Tout meurtre est rituel, même dans sa folie abstruse, ou dans ce que l'on appelle pudiquement le feu de l'action. C'est pourquoi, d'une certaine façon, il n'y a pas de criminel de guerre, ni de crime contre l'humanité – cette dernière étant coupable dès l'origine et ne cessant de choir, l'homme restant une abomination pour l'homme. »
« Tuer est un art, et non seulement l'apanage du bourreau ou du boucher, mais aussi du guerrier, ce qui m'a bientôt amené à penser qu'il n'y avait pas, dans le geste d'ôter la vie de différence quant au destinataire, homme ou animal (…) parce que je m'étais depuis longtemps forgé l'intime conviction que certains humains sont moins dignes de vivre que des animaux ou que bien des bêtes valent mieux que des hommes (…) de sorte que je n'ai jamais eu de religion de l'humain et que je suis capable de voir mourir des gens ou d'apprendre leur décès sans m'attrister, périraient-ils par milliers, toute considération malthusienne mise à part. »
« le visage du guerrier n'est pas plus beau que celui du tueur ou de l'amant en train de jouir : même laideur, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'exténuer en soi quelque chose d'extraordinairement ancien, et qui rend le fait de tuer aussi proche de la prière que l'acte sexuel ou de l'écriture. Je ne cherche pas à me juger ni à me disculper : pour la première fois de ma vie je ne me sentais pas coupable ; c'est pourquoi cette confession n'est pas une justification : séparée de l'espèce humaine sans appartenir à la mort ni aux puissances sataniques, je revendique une forme d'innocence que seuls les anciens guerriers, les vrais écrivains et les grandes amoureuses comprendront. La guerre m'apportait une légèreté inattendue (…) j'étais un combattant pas un meurtrier, même lors des exécutions aux barrages, ceux que nous tuions étaient eux aussi des combattants. Cette guerre avait ses lois : y manquer eu été me condamner moi-même. Et la force qui m'animait depuis le début ne relevait pas de l'individualisme ; c'était une force collective qui ne me poussait pas seulement à combattre et à muer ma peur en cruauté : elle me donnait l'assurance que j'écrirais un jour (…)
« J'ai beaucoup tiré et j'ai lancé des grenades, à la Quarantaine, et pas seulement sur des fédayins, sur des civils aussi, parce qu'il fallait aller vite et qu'ils étaient menaçants, c'est-à-dire coupables de vouloir me faire renier mon humanité. »
« Autrui, depuis la position que j'occupais, n'existe que dans la mesure où il peut être abattu, dans l'abstraction de cette intentionnalité ou de cette effectivité. La religion, la nationalité, le sexe l'âge importent-ils dès lors ? Ils ne sont que des vêtements de spectre, et pourtant il m'eût été difficile, sinon impossible, de tuer des chrétiens. »
« (…) et, puisque ma tâche était abjecte, je les ait épargnés, ce que je n'aurais pas fait si j'avais été seul, mon travail consistant à impliquer les civils dans la guerre, les blessant ou les tuant, puisqu'il n'y avait pas de civils entièrement innocents, l'ensemble d'une population étant toujours plus ou moins complice ou responsable du régime qui la gouverne. »
« Je l'ai aperçu au moment où il a décroché, ce matin là, après avoir abattu un homme qui tentait de franchir le passage en voiture d'est en ouest ; il s'était légèrement découvert pour tirer et j'avais entrevu sa silhouette juvénile, et la partie de son visage que de dissimulait pas son keffieh légèrement défait et dans un pan duquel il enveloppait son fusil afin qu'il ne jette pas d'éclat, et son coup où j'ai cru voir palpiter une veine que j'ai fait éclater au même instant : il est tombé en se tournant vers moi comme s'il me voyait enfin et qu'il voulait me laisser regarder son visage aux traits quasi féminins, à la beauté de guillotiné, ai-je pensé, puisqu'on était encore en un temps où les condamnés à mort, en France, avaient la tête tranchée. J'avais tué mon semblable, et j'en éprouvais une sorte de découragement, de tristesse qu'il m'a fallu faire passer en tuant ou en blessant, dans les minutes qui ont suivi, d'anonymes civils qui s'étaient crus oubliés ou protégés par ce combat d'hommes invisibles.
Je ne me sentais pas pour autant un tueur : la souffrance et la mort d'autrui ne me donnaient aucun plaisir. J'étais tout simplement indifférent, y compris à ma propre existence, m'attendant sans cesse à être tué et l'acceptant pourvu que je ne souffre pas. »
A guerre : « (…) le monde entier avait les yeux fixés sur nous ; on voulait voir la mort à distance et en direct, en se rappelant que la guerre est une fonction sacrée, excessive, en tout cas nécessaire, parce que terrible, comme l'impossible, gouverne nos vies. Qu'elle n'existe plus aujourd'hui qu'en tant que divertissement spectaculaire, en tant que lointain même et pour les peuples démocratisés de l'Occident, comme impensable nostalgie, voilà bien le signe d'un dérèglement de toutes les valeurs (…) »
A (achever les) blessés : « Mais l'homme ne pouvait pas se taire ni cesser de pleurer, laid, presque chauve, bedonnant, mal rasé, sentant la peur, et musulman, d'après sa carte d'identité, peut-être un espion, selon Elias ; et plus il nous suppliait, plus la colère de ce dernier grandissait : d'abord feinte, elle était devenue bien réelle et serait sans doute allée jusqu'à la fureur si, à la suite de mots que lui avait adressé Hadi en arabe, l'homme ne s'était agenouillé, les mains levées à mis corps, certain qu'il allait mourir. (…) Elias (…) n'avait rien fait pour empêcher Hadi de désactiver le mode rafale de sa kalachnikov puis de tirer plusieurs balles dans ses cuisses, ce qui sur le moment m'a paru une inutile cruauté. (…) le marchand, lui, se tordait à terre en gémissant, comme s'il continuait d'avoir peur et qu'il ne souffrît pas, alors qu'il devait endurer quelque chose de si atroce qu'un supplicié agonisant sur la roue. Il ne me quittait pas des yeux. Peut-être espérait-il que son silence le sauverait. (…) « Tire ! » a ordonné Nabil. (…) Puis il m'a regardé avec indulgence ; c'était sans doute que j'avais achevé le marchand.
A musulmans : « L'Armée secrète de libération de l'Arménie m'a d'emblée été sympathique, parce que l'Arménie est un pays chrétien et que ses cibles étaient des Turcs, c'est-à-dire des musulmans qui, on le verrait dans les années à venir, avec le développement de l'islamisme, se feraient un devoir de tuer des chrétiens ; »
« (…) les chrétien n'ont pas profané une seule mosquée, pas même l'unique mosquée d'Achrafiyé, la mosquée Beydoun, celle de la Quarantaine ayant été détruite avec le bidonville pour des raisons de sécurité (…)
A racisme : « Donner la mort n'était rien, dans ces circonstances ; je n'avais nulle estime pour les Palestiniens, non plus que pour les romanichels ou les Indiens d'Amériques, mais je ne les haïssais pas : c'est pourquoi je pouvais les tuer. J'avais été élevé dans cette distance, sinon ce mépris, et ce que je voyais à Beyrouth ne me convainquait pas que les choses puissent changer ; bien au contraire, mon indifférence pour ces peuples vaincus ou sortis de l'Histoire avait moins son origine dans mon enfance que dans le dégoût que m'inspirait déjà, le genre humain, aucun peuple ne trouvant grâce à mes yeux, en fin de compte. Tuer était tout à la fois exaltant et banal, voire fastidieux ; on participait à l'envers à la beauté générale, faite de bruit et de fureur, surtout la nuit (…) »
Ce qui m'indignait c'était l'existence même des taudis, non parce que des gens pouvait vivre là (la misère du monde ne m'a jamais touché, comme tous ceux qui ont été dès l'enfance enfermés en eux-mêmes), mais parce que c'est laid – une grotesque imitation d'urbanisme – et que ces gens là me semblaient aussi déplacés, sinon répugnants, que les romanichels qui rodaient autour de Siom, voleurs de poules plus que d'enfants, mais assurément inquiétants. »
« « Les races doivent rester chez elles ; leur mélange, du moins à grande échelle, serait une abomination, ou un suicide. le monde entier ne saurait être l'Amérique » disait Mme Malrieu, une des personnes les plus sensées qu'il m'ait été donné de connaître, qui aimait l'espèce humaine, elle, et respectait les races, les religions, mais qui aurait été horrifiée de voir, moins de trente ans après sa mort, l'Europe envahie par ce qu'elle eût appelé de nouveaux barbares, les indigènes devenant à leur tour des barbares, et des mosquées, des temples bouddhistes, des officines sectaires s'élevant dans les villes des vieux pays chrétiens. »
« (…) comment être musulman, comment vivre dans ce qui n'était pas la vraie religion, et surtout comment on pouvait baiser une musulmane, Skandar m'ayant assuré que les musulmans avaient une odeur spéciale (…) »
La place de Richard Millet est bien évidemment derrière des barreaux car, contrairement à ce qu'il affirme dans son livre, les crimes contre l'humanité existent bel et bien et ils sont imprescriptibles. « Indignez-vous ! » clame justement Stéphane Hessel. Je suis sous le choc. Un tel ouvrage a pu être édité ? Des critiques ont pu trouver des qualités à cet ignoble bréviaire de haine ? Les associations humanitaires n'ont pas poursuivi en justice cet assassin ?
La mode est aux dictionnaires amoureux. Voila – extrait de « La confession négative » – ce qui pourrait être l'amorce de celui du criminel de guerre :
A gros : « Je regrettais presque qu'il ne se soit rien passé d'autre, au barrage, et que le conducteur de la 404, un homme rondouillard et tremblant, un peu ridicule aussi, s'en soi tiré à bon compte. (…) ces Palestinien, tout comme le type rondouillard, un chrétien probablement, me semblaient minables. le bruit de l'arme automatique, en revanche, m'avait plu.
A petit : « Je l'avais regardé en silence, détestant qu'un inconnu m'adresse la parole, surtout plus petit que moi, qui suis plutôt grand, ce qui force les gens de taille moindre à lever la tête, parfois à se dresser sur la pointe de leurs pieds et à se mesurer à moi avec aigreur, et celui-là avait un air déterminé qui me déplaisait tout en me dissuadant de lui répondre avec hauteur, ce qui fait que je me suis contenté de lui dire que je ne parlais jamais à la légère. »
A paix : « Cette même solitude, lorsque je voulais plaire ou que je plaisais malgré moi, me poussait à des paroles excessives qui était une manière d'atteindre à la vérité par la violence, car j'étais persuadé que la vérité est violence. C'était la raison pour laquelle j'avais, à l'intention de l'inconnu plus que pour mon camarade d'université, qui me semblait déjà quantité négligeable, tout juste une oreille complaisante, clamé que la littérature souffrait de ce qu'il n'y avait plus de guerre, que l'écrivain n'y était plus confronté, qu'il n'y aurait plus de guerres en Europe, et que nous étions condamnés à nous regarder le nombril au sein d'une paix à la longue aussi ennuyeuse qu'un mariage de raison.
A poils ou espèce humaine : « Ces cheveux, je me les étais fait couper fort court avant de partir pour le Liban, estimant que l'allongement excessif du poil, une caractéristique de cette décennie (celle des années soixante-dix, la plus laide, assurément, sur le plan esthétique), était le propre des gens de gauche, pour l'un desquels il me répugnait d'être pris, moi qui trouvais déjà vulgaire le grand sérieux militant et dérisoire la croyance selon laquelle l'humanité est innocente, bonne, perfectible. « L'espèce humaine n'est pas digne d'estime », m'avait dit ma mère, et mon travail au cimetière de Vincennes avait achevé de me monter qu'elle n'est rien. »
« (…) décennie poilue, époque de décadence, me redisais-je, comme toutes celles où le système pileux des hommes est à la mode, la supériorité des Romains se traduisait par des cheveux courts et la rareté des barbes ; quant aux barbus de l'ère victorienne ou du second Empire, ils sont l'étrange paradoxe d'une époque qui allait conduire à la Première Guerre mondiale, et le peu de goût que j'avais pour Karl Marx, et pour Trotski par exemple venait en grande partie de l'horreur que m'inspirait la pilosité et les hémorroïde du premier et la ressemblance du second avec un méchant boutiquier des Buiges (…) »
A journalisme : « Je n'étais pas un journaliste ; je ne ferais pas puer les mots, je ne mentirais pas ; je ne donnerais pas à la démocratie sa prière quotidienne. »
« Elles demeuraient à l'entrée d'un autre domaine : celui de la violence, ma mère et ma soeur ignorant que j'allais surtout dans ces manifestations pour le moment où, après la dispersion, celles-ci dégénéraient, comme le disaient les journalistes dont je ne lisait pas plus la prose que celle des romanciers contemporains, ayant déjà compris, ou du moins eu l'intuition (quoique incapable de le formuler aussi précisément), que le journalisme n'est qu'une prodigieuse entreprise de falsification, sous couvert d'informer et d'analyser, l'information ne parlant en vérité que d'elle-même et l'analyse servant les intérêts propres à renforcer l'ignorance et la déchéance spirituelle des hommes. de là mon soucis, qui irait croissant de n'être plus informé. »
A armes : « Les Palestinien, les Libanais, Les Syriens, les Israéliens, les chrétiens, les musulmans, les druzes, tout ça m'intéressait médiocrement ; si quelque chose me requérait c'était le bruit des armes, persuadé que la guerre et l'écriture sont soeurs. »
« Il fallait courir plié en deux, tout en lâchant des rafales de kalachnikov ou se poster à un carrefour et s'exposer un instant, sans bouger, pour lancer une roquette ou un RPG ou une Energa, grenade enfilée au bout d'un fusil d'assaut, armes dont la puissance donnait, plus encore que le mortier, un sentiment de souveraineté, puisqu'elles pulvérisaient quasi instantanément la cible, procurant tout à la fois la mort et le jugement dernier (…) »
A violence : « J'aimais le déclenchement de la violence, le temps d'infime silence où elle va survenir, le moment où les choses s'enclenchent : elle avait à voir avec la littérature, je le devinais, et avec la grâce créatrice, le trouble sexuel, les émotions supérieures données par les cris, l'odeur de gaz lacrymogène, le bruit des lance-grenades, des cocktails Molotov, du piétinement des chaussures lourdes (…) l'homme aime le défi, le bruit des armes, la guerre autant que l'amour, le silence ou le ciel étoilé. »
(…) je me suis demandé pourquoi la violence n'allait pas plus loi, pourquoi on n'entrait pas dans la dimension meurtrière du sacré, pourquoi un meurtre gratuit n'était pas possible, pourquoi je ne tuais pas, moi, ce gauchiste à qui me liait déjà ce meurtre potentiel, pourquoi je n'allais pas au bout de ma propre violence, par delà de toute haine idéologique ou instinctivement animale (…). »
A idéologie : « Elevé dans la haine du communisme et le mépris de tout ce qui peut ressembler à la philanthropie, soit dans ce mélange de socialisme bourgeois et de christianisme social qui s'est mis en place au XIXe siècle, je ne m'intéressais à aucune cause, pas même à ce dont on pourrait penser que j'étais partisan : je ne sais quel conservatisme, quelle catholicité momifiée. (…) j'étais, dès cette époque, persuadé que le progrès n'est qu'une version dérisoire du passé, que l'homme est ignoble, que la chute du christianisme entrainerait la fin de l'Europe, ce désenchantement serait encore, pour moi, une manière de vivre dans la lumière de l'affirmation. »
« (…) je n'étais que sérieux, moi qui ne croyais à rien, en tout cas pas à la bonté naturelle des hommes, et qui n'avais pour le moment d'autre raison de me battre que la haine du marxisme-léninisme.
(…) je n'aimais pas les discussions, les disputes, les idées générales, ce qui relève de la psychologie immédiate, de la sociologie et de la psychanalyse, lesquelles ne sont que des théologies dévoyées. Seules m'importaient la méditation, plume en main, et l'action, fût-elle la soeur douteuse du rêve, et la formidable poussée donnée par la ville qui avait enfin accouchée de sa guerre, laquelle avait la dimension idéale, humaine, joyeuse, de ce que j'aimais tant au cinéma et dans les récits que les hommes du haut Limousin me faisait de la Grande Guerre et des combats d'Indochine et d'Algérie.
A meurtre : « Qu'avais-je à faire, me redirais-je, des chrétien du Liban, et des musulmans, des Palestiniens, des progressistes, des fascistes, de tout à ce quoi la phraséologie de gauche donnait des figures séduisantes ou infâmes, au nom d'un idéal que tous trahiraient un jour ou l'autre, autant par lassitude que parce que la trahison est un principe politique majeur et l'iniquité un besoin humain fondamental, inévitable, sinistre, ou joyeux, comme le meurtre ? »
« Tout meurtre est rituel, même dans sa folie abstruse, ou dans ce que l'on appelle pudiquement le feu de l'action. C'est pourquoi, d'une certaine façon, il n'y a pas de criminel de guerre, ni de crime contre l'humanité – cette dernière étant coupable dès l'origine et ne cessant de choir, l'homme restant une abomination pour l'homme. »
« Tuer est un art, et non seulement l'apanage du bourreau ou du boucher, mais aussi du guerrier, ce qui m'a bientôt amené à penser qu'il n'y avait pas, dans le geste d'ôter la vie de différence quant au destinataire, homme ou animal (…) parce que je m'étais depuis longtemps forgé l'intime conviction que certains humains sont moins dignes de vivre que des animaux ou que bien des bêtes valent mieux que des hommes (…) de sorte que je n'ai jamais eu de religion de l'humain et que je suis capable de voir mourir des gens ou d'apprendre leur décès sans m'attrister, périraient-ils par milliers, toute considération malthusienne mise à part. »
« le visage du guerrier n'est pas plus beau que celui du tueur ou de l'amant en train de jouir : même laideur, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'exténuer en soi quelque chose d'extraordinairement ancien, et qui rend le fait de tuer aussi proche de la prière que l'acte sexuel ou de l'écriture. Je ne cherche pas à me juger ni à me disculper : pour la première fois de ma vie je ne me sentais pas coupable ; c'est pourquoi cette confession n'est pas une justification : séparée de l'espèce humaine sans appartenir à la mort ni aux puissances sataniques, je revendique une forme d'innocence que seuls les anciens guerriers, les vrais écrivains et les grandes amoureuses comprendront. La guerre m'apportait une légèreté inattendue (…) j'étais un combattant pas un meurtrier, même lors des exécutions aux barrages, ceux que nous tuions étaient eux aussi des combattants. Cette guerre avait ses lois : y manquer eu été me condamner moi-même. Et la force qui m'animait depuis le début ne relevait pas de l'individualisme ; c'était une force collective qui ne me poussait pas seulement à combattre et à muer ma peur en cruauté : elle me donnait l'assurance que j'écrirais un jour (…)
« J'ai beaucoup tiré et j'ai lancé des grenades, à la Quarantaine, et pas seulement sur des fédayins, sur des civils aussi, parce qu'il fallait aller vite et qu'ils étaient menaçants, c'est-à-dire coupables de vouloir me faire renier mon humanité. »
« Autrui, depuis la position que j'occupais, n'existe que dans la mesure où il peut être abattu, dans l'abstraction de cette intentionnalité ou de cette effectivité. La religion, la nationalité, le sexe l'âge importent-ils dès lors ? Ils ne sont que des vêtements de spectre, et pourtant il m'eût été difficile, sinon impossible, de tuer des chrétiens. »
« (…) et, puisque ma tâche était abjecte, je les ait épargnés, ce que je n'aurais pas fait si j'avais été seul, mon travail consistant à impliquer les civils dans la guerre, les blessant ou les tuant, puisqu'il n'y avait pas de civils entièrement innocents, l'ensemble d'une population étant toujours plus ou moins complice ou responsable du régime qui la gouverne. »
« Je l'ai aperçu au moment où il a décroché, ce matin là, après avoir abattu un homme qui tentait de franchir le passage en voiture d'est en ouest ; il s'était légèrement découvert pour tirer et j'avais entrevu sa silhouette juvénile, et la partie de son visage que de dissimulait pas son keffieh légèrement défait et dans un pan duquel il enveloppait son fusil afin qu'il ne jette pas d'éclat, et son coup où j'ai cru voir palpiter une veine que j'ai fait éclater au même instant : il est tombé en se tournant vers moi comme s'il me voyait enfin et qu'il voulait me laisser regarder son visage aux traits quasi féminins, à la beauté de guillotiné, ai-je pensé, puisqu'on était encore en un temps où les condamnés à mort, en France, avaient la tête tranchée. J'avais tué mon semblable, et j'en éprouvais une sorte de découragement, de tristesse qu'il m'a fallu faire passer en tuant ou en blessant, dans les minutes qui ont suivi, d'anonymes civils qui s'étaient crus oubliés ou protégés par ce combat d'hommes invisibles.
Je ne me sentais pas pour autant un tueur : la souffrance et la mort d'autrui ne me donnaient aucun plaisir. J'étais tout simplement indifférent, y compris à ma propre existence, m'attendant sans cesse à être tué et l'acceptant pourvu que je ne souffre pas. »
A guerre : « (…) le monde entier avait les yeux fixés sur nous ; on voulait voir la mort à distance et en direct, en se rappelant que la guerre est une fonction sacrée, excessive, en tout cas nécessaire, parce que terrible, comme l'impossible, gouverne nos vies. Qu'elle n'existe plus aujourd'hui qu'en tant que divertissement spectaculaire, en tant que lointain même et pour les peuples démocratisés de l'Occident, comme impensable nostalgie, voilà bien le signe d'un dérèglement de toutes les valeurs (…) »
A (achever les) blessés : « Mais l'homme ne pouvait pas se taire ni cesser de pleurer, laid, presque chauve, bedonnant, mal rasé, sentant la peur, et musulman, d'après sa carte d'identité, peut-être un espion, selon Elias ; et plus il nous suppliait, plus la colère de ce dernier grandissait : d'abord feinte, elle était devenue bien réelle et serait sans doute allée jusqu'à la fureur si, à la suite de mots que lui avait adressé Hadi en arabe, l'homme ne s'était agenouillé, les mains levées à mis corps, certain qu'il allait mourir. (…) Elias (…) n'avait rien fait pour empêcher Hadi de désactiver le mode rafale de sa kalachnikov puis de tirer plusieurs balles dans ses cuisses, ce qui sur le moment m'a paru une inutile cruauté. (…) le marchand, lui, se tordait à terre en gémissant, comme s'il continuait d'avoir peur et qu'il ne souffrît pas, alors qu'il devait endurer quelque chose de si atroce qu'un supplicié agonisant sur la roue. Il ne me quittait pas des yeux. Peut-être espérait-il que son silence le sauverait. (…) « Tire ! » a ordonné Nabil. (…) Puis il m'a regardé avec indulgence ; c'était sans doute que j'avais achevé le marchand.
A musulmans : « L'Armée secrète de libération de l'Arménie m'a d'emblée été sympathique, parce que l'Arménie est un pays chrétien et que ses cibles étaient des Turcs, c'est-à-dire des musulmans qui, on le verrait dans les années à venir, avec le développement de l'islamisme, se feraient un devoir de tuer des chrétiens ; »
« (…) les chrétien n'ont pas profané une seule mosquée, pas même l'unique mosquée d'Achrafiyé, la mosquée Beydoun, celle de la Quarantaine ayant été détruite avec le bidonville pour des raisons de sécurité (…)
A racisme : « Donner la mort n'était rien, dans ces circonstances ; je n'avais nulle estime pour les Palestiniens, non plus que pour les romanichels ou les Indiens d'Amériques, mais je ne les haïssais pas : c'est pourquoi je pouvais les tuer. J'avais été élevé dans cette distance, sinon ce mépris, et ce que je voyais à Beyrouth ne me convainquait pas que les choses puissent changer ; bien au contraire, mon indifférence pour ces peuples vaincus ou sortis de l'Histoire avait moins son origine dans mon enfance que dans le dégoût que m'inspirait déjà, le genre humain, aucun peuple ne trouvant grâce à mes yeux, en fin de compte. Tuer était tout à la fois exaltant et banal, voire fastidieux ; on participait à l'envers à la beauté générale, faite de bruit et de fureur, surtout la nuit (…) »
Ce qui m'indignait c'était l'existence même des taudis, non parce que des gens pouvait vivre là (la misère du monde ne m'a jamais touché, comme tous ceux qui ont été dès l'enfance enfermés en eux-mêmes), mais parce que c'est laid – une grotesque imitation d'urbanisme – et que ces gens là me semblaient aussi déplacés, sinon répugnants, que les romanichels qui rodaient autour de Siom, voleurs de poules plus que d'enfants, mais assurément inquiétants. »
« « Les races doivent rester chez elles ; leur mélange, du moins à grande échelle, serait une abomination, ou un suicide. le monde entier ne saurait être l'Amérique » disait Mme Malrieu, une des personnes les plus sensées qu'il m'ait été donné de connaître, qui aimait l'espèce humaine, elle, et respectait les races, les religions, mais qui aurait été horrifiée de voir, moins de trente ans après sa mort, l'Europe envahie par ce qu'elle eût appelé de nouveaux barbares, les indigènes devenant à leur tour des barbares, et des mosquées, des temples bouddhistes, des officines sectaires s'élevant dans les villes des vieux pays chrétiens. »
« (…) comment être musulman, comment vivre dans ce qui n'était pas la vraie religion, et surtout comment on pouvait baiser une musulmane, Skandar m'ayant assuré que les musulmans avaient une odeur spéciale (…) »
La place de Richard Millet est bien évidemment derrière des barreaux car, contrairement à ce qu'il affirme dans son livre, les crimes contre l'humanité existent bel et bien et ils sont imprescriptibles. « Indignez-vous ! » clame justement Stéphane Hessel. Je suis sous le choc. Un tel ouvrage a pu être édité ? Des critiques ont pu trouver des qualités à cet ignoble bréviaire de haine ? Les associations humanitaires n'ont pas poursuivi en justice cet assassin ?
J'ai marché dedans, je n'ai pas été suffisamment attentif et l'odeur est absolument insoutenable. Richard Millet m'apparaissait – à tord – comme un auteur préoccupé d'écriture. Vous comprendrez que je sois pressé et que je n'examine pas en détail la consistance, la couleur de ce qui se trouve sur ma semelle. Cinq cent pages insoutenables cela suffit!
« Vivre, c'est s'occuper de merde. Ecrire, c'est la remuer », nous dit l'auteur. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'occupe de lui et son livre est un répugnant torche-cul.
« La confession négative » est donc un récit autobiographique et non un roman. La mère de l'auteur a affirmé que la guerre avait un rapport avec l'écriture, il est allé au Liban. L'ouvrage est le récit d'une soit disant entrée en littérature. L'obsession des belles-lettres justifie, sans autre démonstration, l'injustifiable. Richard Millet nous révèle dans ce livre son passé abjecte de mercenaire et d'assassin dans les milices chrétiennes du Liban.
L'obsession de Richard Millet pour l'écriture est sans doute une obsession de l'orthographe et de la grammaire certainement pas du style. Il est dans « La confession négative » un dactylographe et surtout pas un écrivain. Quelques exemples parmi d'autres. Il faut passer sur les nombreuses coquilles de cette édition de poche, le souci de la perfection n'allant pas jusqu'à relire les manuscrits. Il faut cependant supporter, des pages et des pages durant, des phrases débutant par : il m'apparaissait, il me semblait, pouvais-je penser, etc. … « Word synonymes » serait-il le nègre de Richard Millet ? Il faut également supporter – un véritable tic d'écrivaillon – un nombre incalculable de fois, le rappel du sujet en milieu phrase. Et que pensez-vous d'une phrase du genre : «une promenade oubliée sous des arbres à l'abandon, depuis laquelle entre les trouées d'arbres, on peut voir tout Paris » ? Est-ce de la musique répétitive ?
Hannah Arendt, répondant à un journaliste, affirmait que penser était dangereux et que de ne pas penser l'était d'avantage. Richard Millet est à ce titre dangereux et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, il hurle, dos au mur, sa volonté de ne pas penser. Je crois simplement qu'il en est incapable. Qu'une personne le somme de réfléchir et instantanément des envies de meurtre lui viennent. S'il est mis face à ses responsabilités et qu'il arrive – cas extrêmement rare – à esquisser un début de réponse, c'est pour affirmer, comme un enfant monstrueux, que les autres font pareil. S'il cite un auteur ou un livre qu'il avoue ne pas avoir lus, c'est hors de tout contexte. le crétin du Limousin existe, j'ai lu sa prose !
« Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi » nous dit Albert Einstein. Richard Millet en fat, raciste, misogyne, en est totalement incapable. Il juge tout à l'aune de son minuscule lui-même. Gare à vous si vous n'aviez pas sa religion, sa couleur de peau, son odeur, sa tenue ! A Beyrouth, cela pouvait vous couter la vie. Les petits secrets de cet impuissant masturbateur sont mesquins, pitoyables. L'épicerie de sa grand-mère a été chahutée par quelques résistants de la dernière heure et cet homoncule hait, comme il ne cesse de le répéter, la terre entière. Il admire Malraux qui serait intervenu dans la boutique, il méconnait complètement l'écrivain – l'anticolonialiste, l'antifasciste, l'homme des Anti mémoires. A contrario, pour les mêmes raisons pavloviennes, il cache difficilement son enthousiasme pour la SS.
La place de Richard Millet est bien évidemment derrière des barreaux car, contrairement à ce qu'il affirme dans son livre, les crimes contre l'humanité existent bel et bien et ils sont imprescriptibles. « Indignez-vous ! » clame justement Stéphane Hessel. Je suis sous le choc. Un tel ouvrage a pu être édité ? Des critiques ont pu trouver des qualités à cet ignoble bréviaire de haine ? Les associations humanitaires n'ont pas poursuivi en justice cet assassin ?
« Vivre, c'est s'occuper de merde. Ecrire, c'est la remuer », nous dit l'auteur. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'occupe de lui et son livre est un répugnant torche-cul.
« La confession négative » est donc un récit autobiographique et non un roman. La mère de l'auteur a affirmé que la guerre avait un rapport avec l'écriture, il est allé au Liban. L'ouvrage est le récit d'une soit disant entrée en littérature. L'obsession des belles-lettres justifie, sans autre démonstration, l'injustifiable. Richard Millet nous révèle dans ce livre son passé abjecte de mercenaire et d'assassin dans les milices chrétiennes du Liban.
L'obsession de Richard Millet pour l'écriture est sans doute une obsession de l'orthographe et de la grammaire certainement pas du style. Il est dans « La confession négative » un dactylographe et surtout pas un écrivain. Quelques exemples parmi d'autres. Il faut passer sur les nombreuses coquilles de cette édition de poche, le souci de la perfection n'allant pas jusqu'à relire les manuscrits. Il faut cependant supporter, des pages et des pages durant, des phrases débutant par : il m'apparaissait, il me semblait, pouvais-je penser, etc. … « Word synonymes » serait-il le nègre de Richard Millet ? Il faut également supporter – un véritable tic d'écrivaillon – un nombre incalculable de fois, le rappel du sujet en milieu phrase. Et que pensez-vous d'une phrase du genre : «une promenade oubliée sous des arbres à l'abandon, depuis laquelle entre les trouées d'arbres, on peut voir tout Paris » ? Est-ce de la musique répétitive ?
Hannah Arendt, répondant à un journaliste, affirmait que penser était dangereux et que de ne pas penser l'était d'avantage. Richard Millet est à ce titre dangereux et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, il hurle, dos au mur, sa volonté de ne pas penser. Je crois simplement qu'il en est incapable. Qu'une personne le somme de réfléchir et instantanément des envies de meurtre lui viennent. S'il est mis face à ses responsabilités et qu'il arrive – cas extrêmement rare – à esquisser un début de réponse, c'est pour affirmer, comme un enfant monstrueux, que les autres font pareil. S'il cite un auteur ou un livre qu'il avoue ne pas avoir lus, c'est hors de tout contexte. le crétin du Limousin existe, j'ai lu sa prose !
« Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi » nous dit Albert Einstein. Richard Millet en fat, raciste, misogyne, en est totalement incapable. Il juge tout à l'aune de son minuscule lui-même. Gare à vous si vous n'aviez pas sa religion, sa couleur de peau, son odeur, sa tenue ! A Beyrouth, cela pouvait vous couter la vie. Les petits secrets de cet impuissant masturbateur sont mesquins, pitoyables. L'épicerie de sa grand-mère a été chahutée par quelques résistants de la dernière heure et cet homoncule hait, comme il ne cesse de le répéter, la terre entière. Il admire Malraux qui serait intervenu dans la boutique, il méconnait complètement l'écrivain – l'anticolonialiste, l'antifasciste, l'homme des Anti mémoires. A contrario, pour les mêmes raisons pavloviennes, il cache difficilement son enthousiasme pour la SS.
La place de Richard Millet est bien évidemment derrière des barreaux car, contrairement à ce qu'il affirme dans son livre, les crimes contre l'humanité existent bel et bien et ils sont imprescriptibles. « Indignez-vous ! » clame justement Stéphane Hessel. Je suis sous le choc. Un tel ouvrage a pu être édité ? Des critiques ont pu trouver des qualités à cet ignoble bréviaire de haine ? Les associations humanitaires n'ont pas poursuivi en justice cet assassin ?
Confession, répulsion
Autant le dire d'emblée : j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, et si je l'ai tout de même terminé, c'est que je suis invraisemblablement consciencieuse. Et pourtant, j'avais à propos de cet auteur, réellement, « de grandes espérances ». J'avais beaucoup aimé le premier livre lu de lui (c'était "Ma vie parmi les ombres"), assez les deux autres ("Lauve le pur" et "La Voix d'alto"). Voici ce que j'écrivais en 2006 :
La première fois que j'ai lu un livre de Richard Millet, j'étais loin de me douter que j'allais m'embarquer dans une sorte de grand voyage au pays des mots, et que les caractéristiques mêmes qui ne m'inspiraient guère d'attirance chez un auteur de la stature de Proust – les longues périodes truffées de subordonnées, les détails de comportement individuels amenant à l'énoncé d'aphorismes universels, la traversée du temps vécu et ressuscité par le souvenir – allaient justement devenir pour moi chez Millet, par je ne sais quelle correspondance spécifique de sensibilité, les signes d'une reconnaissance d'un esprit dont la tournure, je le voyais bien à mesure que je progressais dans ma lecture, s'ajustait particulièrement bien à mon attente, en même temps que je constatais des similitudes de circonstances, de génération et d'origine (même si ma campagne n'était pas la sienne) qui me renforçaient dans cette sympathie, au sens de compassion, dans cette identification qui fait que la lecture d'un certain auteur vous accompagne d'une manière plus personnelle et qu'on se l'approprie, en quelque sorte, comme si on avait pu écrire, décrire, les mêmes phénomènes dans les mêmes termes.
Revenons à cette Confession négative. Un mot d'abord sur le titre. Il fait référence au Livre des Morts des anciens Egyptiens, dans sa formule 125 ; il s'agit de « ce qui doit être dit quand on accède à la salle des deux Maât ». Cette salle est en fait le tribunal d'Osiris, et le défunt va y prononcer une déclaration d'innocence : « Je n'ai pas commis l'iniquité contre les hommes, je n'ai pas maltraité les gens... Je n'ai pas fait le mal... Je n'ai pas affamé... etc. » La suite du titre de cette formule, énoncée ainsi : « Séparer le défunt de tous les péchés qu'il a commis », précise son but : le mort a péché et tout le monde le sait. Cependant, en prononçant cette formule dans son intégralité devant le tribunal, il sera purifié et pourra donc accéder au royaume d'Osiris.
Je ne sais pas si Millet, en écrivant ce livre, a recherché une telle purification. Ce qui m'embarrasse tout d'abord, c'est l'incertitude où je suis : dans quelle mesure le personnage du livre, qui en est le narrateur à la première personne, coïncide-t-il avec l'auteur ? Jusqu'où Millet, l'écrivain, le suit-il dans ses aberrantes affirmations ? Est-ce une autofiction ? Je sais que Millet a vécu au Liban, une partie de son enfance (selon la Wikipedia : de 6 à 14 ans). C'était donc dans les années 60, bien avant la guerre du Liban que ce livre retrace.
Donc le narrateur, restons-en sur le personnage. Agé de 22 ou 23 ans, il quitte la banlieue parisienne pour aller s'engager au Liban et combattre dans les milices chrétiennes. Ce garçon a été déraciné de son Limousin natal par une mère indifférente, qui l'avait jusque-là négligé et qui semble le tenir en bien piètre estime. Il ne sait presque rien de son père, qui est mort. Il n'a pas d'amis, pas d'amoureuse. S'il part, ce n'est pas par conviction politique (encore que : il lui semble évident de se situer d'un côté plutôt que l'autre), mais pour tenter de se confronter au réel, d'acquérir par là l'expérience du monde qui lui manque. Sa seule conviction, en fait – et le seul côté sympathique du personnage – c'est sa vocation d'écrivain ; il ne désire vraiment rien d'autre. « Les Palestiniens, les Libanais, les Syriens, les Israéliens, les chrétiens, les musulmans, les druzes, tout ça m'intéressait médiocrement ; si quelque chose me requérait, c'était le bruit des armes, persuadé que la guerre et l'écriture sont soeurs. » de cette parenté entre la guerre et l'écriture, le livre va développer la métaphore, avec de nombreuses variations. Il reflète également l'obsession de Millet quant à la décadence de la langue française : « la conversation ou l'esprit, choses qui disparaîtraient à la fin du siècle, avec le sentiment que chacun avait des nuances infinies de la langue, et dont on peut se demander si la simplification, voire la créolisation, n'entraînent pas la modification structurelle, l'appauvrissement et, à court terme, la fin de ce qu'on nomme encore, et de façon inappropriée, la littérature. »
Un personnage vraiment antipathique, en effet, insensible, veule, arrogant, affichant pour les combattants de l'autre camp un mépris incroyable, appuyé en cela sur des considérations physiques relevant du racisme, montrant avec ostentation un anti-communisme primaire et proclamant à chaque occasion son aversion du genre humain : « n'ayant en quelque sorte pas vécu, pour peu qu'on appelle vivre acquérir la connaissance des us et des coutumes, de la psychologie des hommes et des groupes humains, mais ayant beaucoup vécu si on s'en tient à la basse fondamentale de l'espèce humaine : sa chiennerie, son ignominie, ce par quoi elle ne cesse de choir. » Il se sent dans ce pays en guerre à la fois « un innocent et un imposteur ».
Je passe sur toutes les évocations de massacres, de tueries, d'exécutions, qui amènent le narrateur à constater, quant à sa propre indifférence devant ce spectacle : « C'était dans cette insensibilité que je trouverais à être moi-même, et non dans l'amour d'un prochain dont je me sentais plus que jamais éloigné. » Et quand il en est l'acteur : « J'ignorais tout des armes automatiques, et la première fois que j'ai tiré avec une slavia, puis avec une semenov, enfin avec une kalachnikov, le lendemain matin, j'ai éprouvé un plaisir si singulier que je ne peux le rapporter qu'à ma découverte du plaisir sexuel, je n'exagère rien, et si la dimension symbolique de la comparaison peut sembler un cliché, elle n'en est pas moins juste (…) ».
Je n'ai pas envie d'en dire plus. Je suis bien loin des dispositions où je me trouvais dans mon texte de 2006. Il ne faut sans doute pas confondre l'auteur avec son personnage, mais je ne vois pas dans la manière dont il est traité de désapprobation pour son point de vue. C'est sans doute délibérément que ce livre n'est pas aimable ; en ce qui me concerne, l'objectif est atteint.
Autant le dire d'emblée : j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, et si je l'ai tout de même terminé, c'est que je suis invraisemblablement consciencieuse. Et pourtant, j'avais à propos de cet auteur, réellement, « de grandes espérances ». J'avais beaucoup aimé le premier livre lu de lui (c'était "Ma vie parmi les ombres"), assez les deux autres ("Lauve le pur" et "La Voix d'alto"). Voici ce que j'écrivais en 2006 :
La première fois que j'ai lu un livre de Richard Millet, j'étais loin de me douter que j'allais m'embarquer dans une sorte de grand voyage au pays des mots, et que les caractéristiques mêmes qui ne m'inspiraient guère d'attirance chez un auteur de la stature de Proust – les longues périodes truffées de subordonnées, les détails de comportement individuels amenant à l'énoncé d'aphorismes universels, la traversée du temps vécu et ressuscité par le souvenir – allaient justement devenir pour moi chez Millet, par je ne sais quelle correspondance spécifique de sensibilité, les signes d'une reconnaissance d'un esprit dont la tournure, je le voyais bien à mesure que je progressais dans ma lecture, s'ajustait particulièrement bien à mon attente, en même temps que je constatais des similitudes de circonstances, de génération et d'origine (même si ma campagne n'était pas la sienne) qui me renforçaient dans cette sympathie, au sens de compassion, dans cette identification qui fait que la lecture d'un certain auteur vous accompagne d'une manière plus personnelle et qu'on se l'approprie, en quelque sorte, comme si on avait pu écrire, décrire, les mêmes phénomènes dans les mêmes termes.
Revenons à cette Confession négative. Un mot d'abord sur le titre. Il fait référence au Livre des Morts des anciens Egyptiens, dans sa formule 125 ; il s'agit de « ce qui doit être dit quand on accède à la salle des deux Maât ». Cette salle est en fait le tribunal d'Osiris, et le défunt va y prononcer une déclaration d'innocence : « Je n'ai pas commis l'iniquité contre les hommes, je n'ai pas maltraité les gens... Je n'ai pas fait le mal... Je n'ai pas affamé... etc. » La suite du titre de cette formule, énoncée ainsi : « Séparer le défunt de tous les péchés qu'il a commis », précise son but : le mort a péché et tout le monde le sait. Cependant, en prononçant cette formule dans son intégralité devant le tribunal, il sera purifié et pourra donc accéder au royaume d'Osiris.
Je ne sais pas si Millet, en écrivant ce livre, a recherché une telle purification. Ce qui m'embarrasse tout d'abord, c'est l'incertitude où je suis : dans quelle mesure le personnage du livre, qui en est le narrateur à la première personne, coïncide-t-il avec l'auteur ? Jusqu'où Millet, l'écrivain, le suit-il dans ses aberrantes affirmations ? Est-ce une autofiction ? Je sais que Millet a vécu au Liban, une partie de son enfance (selon la Wikipedia : de 6 à 14 ans). C'était donc dans les années 60, bien avant la guerre du Liban que ce livre retrace.
Donc le narrateur, restons-en sur le personnage. Agé de 22 ou 23 ans, il quitte la banlieue parisienne pour aller s'engager au Liban et combattre dans les milices chrétiennes. Ce garçon a été déraciné de son Limousin natal par une mère indifférente, qui l'avait jusque-là négligé et qui semble le tenir en bien piètre estime. Il ne sait presque rien de son père, qui est mort. Il n'a pas d'amis, pas d'amoureuse. S'il part, ce n'est pas par conviction politique (encore que : il lui semble évident de se situer d'un côté plutôt que l'autre), mais pour tenter de se confronter au réel, d'acquérir par là l'expérience du monde qui lui manque. Sa seule conviction, en fait – et le seul côté sympathique du personnage – c'est sa vocation d'écrivain ; il ne désire vraiment rien d'autre. « Les Palestiniens, les Libanais, les Syriens, les Israéliens, les chrétiens, les musulmans, les druzes, tout ça m'intéressait médiocrement ; si quelque chose me requérait, c'était le bruit des armes, persuadé que la guerre et l'écriture sont soeurs. » de cette parenté entre la guerre et l'écriture, le livre va développer la métaphore, avec de nombreuses variations. Il reflète également l'obsession de Millet quant à la décadence de la langue française : « la conversation ou l'esprit, choses qui disparaîtraient à la fin du siècle, avec le sentiment que chacun avait des nuances infinies de la langue, et dont on peut se demander si la simplification, voire la créolisation, n'entraînent pas la modification structurelle, l'appauvrissement et, à court terme, la fin de ce qu'on nomme encore, et de façon inappropriée, la littérature. »
Un personnage vraiment antipathique, en effet, insensible, veule, arrogant, affichant pour les combattants de l'autre camp un mépris incroyable, appuyé en cela sur des considérations physiques relevant du racisme, montrant avec ostentation un anti-communisme primaire et proclamant à chaque occasion son aversion du genre humain : « n'ayant en quelque sorte pas vécu, pour peu qu'on appelle vivre acquérir la connaissance des us et des coutumes, de la psychologie des hommes et des groupes humains, mais ayant beaucoup vécu si on s'en tient à la basse fondamentale de l'espèce humaine : sa chiennerie, son ignominie, ce par quoi elle ne cesse de choir. » Il se sent dans ce pays en guerre à la fois « un innocent et un imposteur ».
Je passe sur toutes les évocations de massacres, de tueries, d'exécutions, qui amènent le narrateur à constater, quant à sa propre indifférence devant ce spectacle : « C'était dans cette insensibilité que je trouverais à être moi-même, et non dans l'amour d'un prochain dont je me sentais plus que jamais éloigné. » Et quand il en est l'acteur : « J'ignorais tout des armes automatiques, et la première fois que j'ai tiré avec une slavia, puis avec une semenov, enfin avec une kalachnikov, le lendemain matin, j'ai éprouvé un plaisir si singulier que je ne peux le rapporter qu'à ma découverte du plaisir sexuel, je n'exagère rien, et si la dimension symbolique de la comparaison peut sembler un cliché, elle n'en est pas moins juste (…) ».
Je n'ai pas envie d'en dire plus. Je suis bien loin des dispositions où je me trouvais dans mon texte de 2006. Il ne faut sans doute pas confondre l'auteur avec son personnage, mais je ne vois pas dans la manière dont il est traité de désapprobation pour son point de vue. C'est sans doute délibérément que ce livre n'est pas aimable ; en ce qui me concerne, l'objectif est atteint.
La confession négative n'est pas un roman mais un récit.
Le récit d'un homme qui va partir à la guerre uniquement pour être en harmonie avec sa passion de la littérature.
Incroyable ! et pourtant c'est ce que nous explique Richard Millet dans ce récit, dont il est le héros et la littérature sa raison d'agir.
Avant de vivre cette aventure, Richard Millet explique qu'il y a d'abord eu les lectures de l'enfance souvent volées aux heures de sommeil. C'est là, au coeur de la nuit faiblement éclairée par une bougie que les livres déterminent sa vie future.
A l'âge de vingt-deux ans Richard Millet décide de partir au Liban : « le voyage en Orient » de Gérard de Nerval va faire de Beyrouth sa destination littéraire.
Mais il y part avec un but précis : devenir écrivain. C'est pour cela qu'il veut faire la guerre.
Car dit-il : "oui la guerre seule peut donner à l'écrivain sa vérité. Sans elle, que seraient Jünger, Hemingway, Faulkner, Céline, Drieu La Rochelle, Malaparte, Soljenistine, Claude Simon, pour ne pas parler d'Homère ? "(Extrait de la confession négative page 26)
Faire la guerre, tuer pour mieux servir l'écriture : étrange confession que l'auteur nous livre avec beaucoup de réalisme, de finesse et d'intelligence tout au long de ces 500 pages, mais aussi avec une certaine froideur car il écrit :
Je n'aimais pas davantage mon prochain, sauf sous une forme littéraire, et ne le supportais qu'en me disant qu'il pourrait nourrir un jour mes écrits. (Extrait de la confession négative page 21)
Richard Millet s'engage auprès des forces phalangistes chrétiennes, ainsi il se confie une fois de plus, car ce choix n'est pas anodin. Si cette guerre est pour lui un moyen de mieux servir la littérature, le choix de son camp est déterminé par ses idées qui l'emmènent envers et contre tout à faire un choix politique.En effet de 1975 à 1976, le Liban fut le théâtre d'une guerre dévastatrice entre des forces opposées sur son propre territoire. Des enjeux extrêmement complexes « pour les non initiés comme moi mais qui a puisé des informations sur le net et dans l'encyclopédie Larousse !! » Alors pour faire court, cette guerre a opposé les phalangistes chrétiens (chrétiens maronites) plutôt pro-israéliens contre les musulmans libanais (sunnites, chiites et druzes) alliés au palestiniens.
Ce récit est foisonnant d'idées, de réflexions, mais aussi d'images de la guerre, car Richard Millet ne nous épargne rien de l'horreur au quotidien d'un pays en conflit. A la fin de la guerre, « le grammairien » comme l'appelait ses camarades est reparti dans ses terres limousines pour devenir écrivain. Vivre une telle expérience, c'est aller au bout de soi-même, au bout de ses convictions. C'est peut-être là que l'on puise l'essence même de la création. Est-ce le message que veut nous transmettre Richard Millet en nous livrant cette « confession négative » ?
Un récit qui fait réfléchir, qui remue, qui dérange. Cette lecture me donne envie de lire aussi "Voyage en Orient" de Gérard de Nerval.
Le récit d'un homme qui va partir à la guerre uniquement pour être en harmonie avec sa passion de la littérature.
Incroyable ! et pourtant c'est ce que nous explique Richard Millet dans ce récit, dont il est le héros et la littérature sa raison d'agir.
Avant de vivre cette aventure, Richard Millet explique qu'il y a d'abord eu les lectures de l'enfance souvent volées aux heures de sommeil. C'est là, au coeur de la nuit faiblement éclairée par une bougie que les livres déterminent sa vie future.
A l'âge de vingt-deux ans Richard Millet décide de partir au Liban : « le voyage en Orient » de Gérard de Nerval va faire de Beyrouth sa destination littéraire.
Mais il y part avec un but précis : devenir écrivain. C'est pour cela qu'il veut faire la guerre.
Car dit-il : "oui la guerre seule peut donner à l'écrivain sa vérité. Sans elle, que seraient Jünger, Hemingway, Faulkner, Céline, Drieu La Rochelle, Malaparte, Soljenistine, Claude Simon, pour ne pas parler d'Homère ? "(Extrait de la confession négative page 26)
Faire la guerre, tuer pour mieux servir l'écriture : étrange confession que l'auteur nous livre avec beaucoup de réalisme, de finesse et d'intelligence tout au long de ces 500 pages, mais aussi avec une certaine froideur car il écrit :
Je n'aimais pas davantage mon prochain, sauf sous une forme littéraire, et ne le supportais qu'en me disant qu'il pourrait nourrir un jour mes écrits. (Extrait de la confession négative page 21)
Richard Millet s'engage auprès des forces phalangistes chrétiennes, ainsi il se confie une fois de plus, car ce choix n'est pas anodin. Si cette guerre est pour lui un moyen de mieux servir la littérature, le choix de son camp est déterminé par ses idées qui l'emmènent envers et contre tout à faire un choix politique.En effet de 1975 à 1976, le Liban fut le théâtre d'une guerre dévastatrice entre des forces opposées sur son propre territoire. Des enjeux extrêmement complexes « pour les non initiés comme moi mais qui a puisé des informations sur le net et dans l'encyclopédie Larousse !! » Alors pour faire court, cette guerre a opposé les phalangistes chrétiens (chrétiens maronites) plutôt pro-israéliens contre les musulmans libanais (sunnites, chiites et druzes) alliés au palestiniens.
Ce récit est foisonnant d'idées, de réflexions, mais aussi d'images de la guerre, car Richard Millet ne nous épargne rien de l'horreur au quotidien d'un pays en conflit. A la fin de la guerre, « le grammairien » comme l'appelait ses camarades est reparti dans ses terres limousines pour devenir écrivain. Vivre une telle expérience, c'est aller au bout de soi-même, au bout de ses convictions. C'est peut-être là que l'on puise l'essence même de la création. Est-ce le message que veut nous transmettre Richard Millet en nous livrant cette « confession négative » ?
Un récit qui fait réfléchir, qui remue, qui dérange. Cette lecture me donne envie de lire aussi "Voyage en Orient" de Gérard de Nerval.
(SUITE) « La confession négative » est un récit et non un roman. La mère de l'auteur a affirmé que la guerre avait un rapport avec l'écriture, Richard Millet est allé au Liban. Il nous révèle dans ce livre son passé abjecte de mercenaire et d'assassin dans les milices chrétiennes du Liban.
La mode est aux dictionnaires amoureux. Voila – extrait de « La confession négative » – ce qui pourrait être l'amorce de celui du criminel de guerre :
A massacre : « le 18, nous avons attaqué et pris la Quarantaine dont le bidonville a été aussitôt vidé de ses habitants, incendié puis rasé avec des bulldozers. C'est avec des forces retrouvées et une vraie joie que j'ai pris part à cet assaut, sous la direction de Sami, le chef des « Begins ». L'idée de nettoyer ce territoire me faisait jubiler, bien plus que celle de tuer, qui se faisait jour en moi depuis que j'avais vu mourir une famille toute entière dans l'explosion d'un obus, chez elle, dans un immeuble de la Cheldi, non loin des jardins de Sioufi. (…) Skandar, l'avant-veille, avait abattu l'un des francs-tireurs qui tenait les deux ponts depuis la minoterie. L'autre avait été blessé, s'était rendu, avait été exécuté sur-le-champ et, une corde d'acier attachée à ses pieds, dans une position que j'ai trouvé assez belle, presque érotique, sa profanation post mortem lui ayant rendu sinon de la grâce , du moins une sorte d'innocence (…) quel qu'il soit, un ennemi n'est pas un homme mais un animal dangereux ; le tuer compte seul ; et je n'ai jamais repensé aux hommes que j'ai tués en regrettant de l'avoir fait (…) Nous le sentions bien : tout se déciderait à l'aube. (…) J'ai mis un genou à terre et j'ai prié. (…) Quant au feu, nous tirions une grande part de notre courage de son intensité détonante et ininterrompue, avançant d'un barrage à l'autre,, défonçant les porte d'un coup de pied, lançant des grenade à l'intérieur, abattant ceux qui fuyaient, progressant méthodiquement entre les bicoques aux murs fabriqués à partir de bidons de pétrole ou d'huile d'olive martelés puis élevés sur des pilotis de parpaings en bas desquels, derrières des pare-vent en tôle ondulée, se cachaient des fédayins, ou des femmes et des enfants qui hurlaient ou imploraient une clémence que je leur aurais volontiers accordée, mais que Skandar, Hadi, Elias et les autres leur refusaient, les abattant séance tenante sous le prétexte que c'étaient là les vrais ennemis du Liban, ces femmes qui pondaient comme des lapines, et ces enfants bientôt en âge de tuer, disaient-ils. Je ne les regardais pas, je ne les entendais pas, à cause du bruit, du rythme auquel nous avancions et de ce qu'il fallait bien appeler l'innommable, afin de s'en défendre, oui, et je souriais, soudain inaccessible à toute pitié, et les cris, les hurlements, les pleurs me poussaient à tuer d'avantage, la gorge sèche, les yeux irrités par la poudre, en nage, les dents serrées, prêt à rire quand une tête explosait sous les balles avec un bruit de pastèque qui éclate sur le ciment, redoutant d'être tué à chaque pas, quoi que certain que se ne serait pas ce jour là, protégé par l'excès même du mal autant que par la bonté, la mansuétude, la commisération que je refusais à mes victimes, entré dans l'injustice absolue et dans la puissance du feu. Semblable à un soldat des guerres que j'avais tant aimé voir au cinéma, je mettais un point d'honneur à rester impassible, même quand Elias, d'un coup de Kalachnikov, a tué un nourrisson dans les bras de sa mère et d'une même rafale cette mère et son autre enfant qui, plus âgé, tentait de la protéger. Nous avancions. Sami qui dirigeait l'opération, nous avait ordonné d'épargner les civils mais il était difficile de les distinguer des combattants. Nous marchions dans des ruisseaux de sang : la métaphore était d'une exactitude si grande que j'ai su, à ce moment , avec plus d'évidence encore que les autres fois et une joie insensée, que je deviendrais écrivain, et que je devais échapper à ce genre de métaphores et à tous les clichés qui traînent dans la langue : écrire me disais-je en avançant, c'est échapper à la force des clichés ; je patauge dans du sang humain, et je n'ai rien d'autre que ces « ruisseaux de sang » pour désigner ce que je vois, rien de plus beau, rien de plus convainquant que la littérature (…) Derrière nous les bulldozers commençaient à déblayer : les cadavres d'abord, ensuite les taudis, certains fédayins faisant le mort et se cachant dans la benne des engins, parmi les corps dont le contact était si éprouvant que les vivants finissaient par se trahir et étaient abattus sur-le-champ. »
« Je n'ai pas participé à ces exactions. Je me rappelle cependant une altercation, à Achrafiyé, avec un journaliste italien qui nous comparait à des SS et à cet épisode au massacre des fosses Ardéatines, parce qu'il avait vu des cadavres de Palestiniens tirés par des voitures dans les rue du quartier et réduits en loques sanguinolentes. Il avait vu également un milicien tuer un nourrisson dans les bras de son père en clamant qu'il voulait enfin goûter au sang palestinien pour voir s'il avait une saveur supérieure ou bestiale. Je l'aurais volontiers abattu, non le milicien, qui avait sinon des excuses du moins des raisons d'agir ainsi (des raisons terrifiantes, sans doute, quelque chose qui était dû non seulement aux amphétamines qu'il avait avalées mais aussi à ce que lui dictait son sang et la loi du talion), mais le journaliste, une belle âme qui allait de révolution en révolution (…) »
« le vieux s'était avancé sur le seuil ; il avait sorti un révolver et le pointait sur moi : j'ai tiré une rafale de M16 puis je me suis mis en mode manuel, tirant balle après balle, hurlant furieux non seulement de tuer un vieillard mais, surtout, de mon imprudence et de la confiance que j'avais accordée à un ennemi ; honteux, également, de la peur que j'avais eue et comprenant que nous n'en finirions pas si nous faisions des exceptions, aussi bien pour les civils que pour les combattants (…) »
« (…) tirant sur lui de si puissantes rafales que j'avais fini par lui déloger le coeur de la cage thoracique et que je m'en étais emparé, de ce coeur, qui avait les dimensions de celui d'un veau, pour le monter à Nabil et aux autres (…) »
« Je regrettais d'avoir jeté le coeur du jeune Palestinien et que les rats s'en soient aussitôt emparés, bien que Hadi m'avait assuré que c'étaient de chats ; j'aurais aimé le montrer à sa mère, à l'une de ces poulinières capable d'enfanter tant de rejetons et de les envoyer à la mort avec désinvolture, de regarder, comme Andromaque du haut des remparts, de Troie, leurs fils, leurs pères, leurs époux choir des hauteurs de l'idéal patriotique, territorial, sentimental, surtout ceux qui n'avaient connu que les camps de réfugiés, tel que celui que je venais de tuer et ceux que j'allais peut-être encore abattre, ce jour là, combattant et civils, car il y a une nécessité du massacre, qui est sa volupté insensée, si l'on veut, ou la transe de l'excès, dès lors que la chance guerrière et avec soi et que le bruit des armes devient chant, tout comme le hurlement des victimes ; c'est là quelque chose de très supérieur à tout ce qu'on peut éprouver dans la vie courante, y compris à la gloire littéraire ou à la jubilation sexuelle, et qui rapproche de l'ivresse collective, et qui fait aimer l'atrocité pour elle-même les blessures franches, la mise à jour des viscères, l'expression la plus vive de terreur et l'absence totale de pitié, tout cela à peu près semblable à un sexe parfaitement durci lors du coït : une forme de pureté, j'ose le dire, quoique je sache que nul ne comprendra, pas même probablement, ceux qui se sont livrés avec fureur et qui ont oublié, ou qui garde une nostalgie inavouable. »
A argent : « (…) l'argent étant une puissance bien plus considérable et mystérieuse que la vie (…) »
A envie (de meurtre) : « J'étais simplement heureux d'être en hauteur, et seul, au sommet d'un immeuble, , caché croyais-je, alors que l'on savait où je me trouvais ou qu'on finissait par le savoir, les cachettes se ressemblant toutes et l'attente à la longue était impure, trop longue, insoutenable, et grande était la tentation de prendre pour cibles non plus ceux qui tentaient de traverser mais les gens que je pouvais observer à la lunette, dans leur appartement, en face et dans le secteur chrétien, comme cette vielle dame qui habitait une petite maison de l'autre coté de l'avenue, avec son petit fils et un singe minuscule (…) »
A joie, humour : Il arrivait même que le destin me fît des clins d'oeil, au sein de l'horreur, pour me rappeler que l'horreur n'est qu'une dimension du grotesque, comme ce jour où j'avais vu un père tirer son fils mort, par le bras, sur le trottoir, jusqu'à une caisse en carton sur laquelle était écrit « muy fràgil », en espagnol ; ou encore cette nuit où nous avions fait exploser une Fiat abandonnée dans une rue obscure et apparemment déserte mais où l'explosion avait révélé, derrière la carcasse, la présence de quatre Islamo-progressistes placés en embuscade.
« Fiat lux ! » avait crié Georges en riant aux éclats, tandis que nous déclenchions sur ces hommes un tir qui les eut bientôt couchés sur l'asphalte.
Car nous riions beaucoup, il le fallait, c'était le contre-point de la rage ou de l'opiniâtreté que nous mettions à combattre, alors que le franc-tireur lui ne rit jamais : il pense que tuer est une manière de méditer sur la proximité et le lointain de l'humain, ou sur son inévitable abstraction. C'est là une souveraineté dans le pire, mais sans la légèreté du combattant de rue, lequel peut ajouter à sa puissance celle, transfiguratrice, d'un rire qui dépassait celui que donne l'arak, le whisky, le hachich, les amphétamines, le bruit des armes. Et le rire m'appelait à moi-même, si peu exubérant que je fusse. »
« Il y avait toujours, même quand les Syriens s'en sont mêlés, quelque chose d'extrêmement juvénile, comme si une jeunesse se dépassait, s'épuisait là, dans une tragi-comédie, beaucoup de combattant jouant aux petits soldats, trouvant là un divertissement incomparable, et se disposant non pas à mourir, mais à faire mourir autrui, la mort n'étant pas pour eux une chose personnelle mais ce dont on se défausse sur autrui. »
A misogynie : « Il y avait longtemps que j'avais renoncé à comprendre le jeu de masques ou l'évidence des premiers regards, sachant pour le reste, que les femmes n'attendent d'un homme que sa semence, un toit et de l'argent. Je ne fais pas ici preuve de misogynie : j'ai été, je le rappelle, élevé par des saintes femmes, et les traitements que les hommes font subir à la gent féminine me révulsent. Cela ne m'empêche pas de penser que l'union légale de la femme et de l'homme, pour autre chose que la reproduction ou le plaisir, est un acte contre nature. »
A fasciste : « Les SS, j'y avais beaucoup pensé, quelques années auparavant, dans les premiers temps de ma vie à Montreuil. (…) je devrais trouver un ordre personnel, à l'écart de toute organisation sociale, c'est-à-dire dans une langue que je ferai mienne par la littérature, tout en restant fasciné par les ordres restreints, religieux ou militaires, notamment les moines soldats ou ce qui s'y apparentait le plus : la Légion étrangère (…) »
« (…) j'aurais eu le courage d'entendre parler de celui qui avait été mon père et qu'il avait probablement connu à la division Charlemagne, imaginais-je, l'un et l'autre ayant compté parmi les derniers défenseurs de Hitler, en 1945, sans être tués par les Asiates soviétiques, ni pendus par des Nègres américains, ni fusillé par des Français bourgeois de bonne famille (…)
« je ne le jugeais pas, la haine du bolchévisme qui avait conduit certains hommes à servir dans la SS ne me paraissant pas alors pire que les errements qui en avaient mené tant d'autres, au nom de l'amélioration de la condition humaine, à soutenir le communisme international et à écrire le panégyrique de Joseph Staline et de Mao Zedong. »
La place de Richard Millet est bien évidemment derrière des barreaux car, contrairement à ce qu'il affirme dans son livre, les crimes contre l'humanité existent bel et bien et ils sont imprescriptibles. « Indignez-vous ! » clame justement Stéphane Hessel. Je suis sous le choc. Un tel ouvrage a pu être édité ? Des critiques ont pu trouver des qualités à cet ignoble bréviaire de haine ? Les associations humanitaires n'ont pas poursuivi en justice cet assassin ?
La mode est aux dictionnaires amoureux. Voila – extrait de « La confession négative » – ce qui pourrait être l'amorce de celui du criminel de guerre :
A massacre : « le 18, nous avons attaqué et pris la Quarantaine dont le bidonville a été aussitôt vidé de ses habitants, incendié puis rasé avec des bulldozers. C'est avec des forces retrouvées et une vraie joie que j'ai pris part à cet assaut, sous la direction de Sami, le chef des « Begins ». L'idée de nettoyer ce territoire me faisait jubiler, bien plus que celle de tuer, qui se faisait jour en moi depuis que j'avais vu mourir une famille toute entière dans l'explosion d'un obus, chez elle, dans un immeuble de la Cheldi, non loin des jardins de Sioufi. (…) Skandar, l'avant-veille, avait abattu l'un des francs-tireurs qui tenait les deux ponts depuis la minoterie. L'autre avait été blessé, s'était rendu, avait été exécuté sur-le-champ et, une corde d'acier attachée à ses pieds, dans une position que j'ai trouvé assez belle, presque érotique, sa profanation post mortem lui ayant rendu sinon de la grâce , du moins une sorte d'innocence (…) quel qu'il soit, un ennemi n'est pas un homme mais un animal dangereux ; le tuer compte seul ; et je n'ai jamais repensé aux hommes que j'ai tués en regrettant de l'avoir fait (…) Nous le sentions bien : tout se déciderait à l'aube. (…) J'ai mis un genou à terre et j'ai prié. (…) Quant au feu, nous tirions une grande part de notre courage de son intensité détonante et ininterrompue, avançant d'un barrage à l'autre,, défonçant les porte d'un coup de pied, lançant des grenade à l'intérieur, abattant ceux qui fuyaient, progressant méthodiquement entre les bicoques aux murs fabriqués à partir de bidons de pétrole ou d'huile d'olive martelés puis élevés sur des pilotis de parpaings en bas desquels, derrières des pare-vent en tôle ondulée, se cachaient des fédayins, ou des femmes et des enfants qui hurlaient ou imploraient une clémence que je leur aurais volontiers accordée, mais que Skandar, Hadi, Elias et les autres leur refusaient, les abattant séance tenante sous le prétexte que c'étaient là les vrais ennemis du Liban, ces femmes qui pondaient comme des lapines, et ces enfants bientôt en âge de tuer, disaient-ils. Je ne les regardais pas, je ne les entendais pas, à cause du bruit, du rythme auquel nous avancions et de ce qu'il fallait bien appeler l'innommable, afin de s'en défendre, oui, et je souriais, soudain inaccessible à toute pitié, et les cris, les hurlements, les pleurs me poussaient à tuer d'avantage, la gorge sèche, les yeux irrités par la poudre, en nage, les dents serrées, prêt à rire quand une tête explosait sous les balles avec un bruit de pastèque qui éclate sur le ciment, redoutant d'être tué à chaque pas, quoi que certain que se ne serait pas ce jour là, protégé par l'excès même du mal autant que par la bonté, la mansuétude, la commisération que je refusais à mes victimes, entré dans l'injustice absolue et dans la puissance du feu. Semblable à un soldat des guerres que j'avais tant aimé voir au cinéma, je mettais un point d'honneur à rester impassible, même quand Elias, d'un coup de Kalachnikov, a tué un nourrisson dans les bras de sa mère et d'une même rafale cette mère et son autre enfant qui, plus âgé, tentait de la protéger. Nous avancions. Sami qui dirigeait l'opération, nous avait ordonné d'épargner les civils mais il était difficile de les distinguer des combattants. Nous marchions dans des ruisseaux de sang : la métaphore était d'une exactitude si grande que j'ai su, à ce moment , avec plus d'évidence encore que les autres fois et une joie insensée, que je deviendrais écrivain, et que je devais échapper à ce genre de métaphores et à tous les clichés qui traînent dans la langue : écrire me disais-je en avançant, c'est échapper à la force des clichés ; je patauge dans du sang humain, et je n'ai rien d'autre que ces « ruisseaux de sang » pour désigner ce que je vois, rien de plus beau, rien de plus convainquant que la littérature (…) Derrière nous les bulldozers commençaient à déblayer : les cadavres d'abord, ensuite les taudis, certains fédayins faisant le mort et se cachant dans la benne des engins, parmi les corps dont le contact était si éprouvant que les vivants finissaient par se trahir et étaient abattus sur-le-champ. »
« Je n'ai pas participé à ces exactions. Je me rappelle cependant une altercation, à Achrafiyé, avec un journaliste italien qui nous comparait à des SS et à cet épisode au massacre des fosses Ardéatines, parce qu'il avait vu des cadavres de Palestiniens tirés par des voitures dans les rue du quartier et réduits en loques sanguinolentes. Il avait vu également un milicien tuer un nourrisson dans les bras de son père en clamant qu'il voulait enfin goûter au sang palestinien pour voir s'il avait une saveur supérieure ou bestiale. Je l'aurais volontiers abattu, non le milicien, qui avait sinon des excuses du moins des raisons d'agir ainsi (des raisons terrifiantes, sans doute, quelque chose qui était dû non seulement aux amphétamines qu'il avait avalées mais aussi à ce que lui dictait son sang et la loi du talion), mais le journaliste, une belle âme qui allait de révolution en révolution (…) »
« le vieux s'était avancé sur le seuil ; il avait sorti un révolver et le pointait sur moi : j'ai tiré une rafale de M16 puis je me suis mis en mode manuel, tirant balle après balle, hurlant furieux non seulement de tuer un vieillard mais, surtout, de mon imprudence et de la confiance que j'avais accordée à un ennemi ; honteux, également, de la peur que j'avais eue et comprenant que nous n'en finirions pas si nous faisions des exceptions, aussi bien pour les civils que pour les combattants (…) »
« (…) tirant sur lui de si puissantes rafales que j'avais fini par lui déloger le coeur de la cage thoracique et que je m'en étais emparé, de ce coeur, qui avait les dimensions de celui d'un veau, pour le monter à Nabil et aux autres (…) »
« Je regrettais d'avoir jeté le coeur du jeune Palestinien et que les rats s'en soient aussitôt emparés, bien que Hadi m'avait assuré que c'étaient de chats ; j'aurais aimé le montrer à sa mère, à l'une de ces poulinières capable d'enfanter tant de rejetons et de les envoyer à la mort avec désinvolture, de regarder, comme Andromaque du haut des remparts, de Troie, leurs fils, leurs pères, leurs époux choir des hauteurs de l'idéal patriotique, territorial, sentimental, surtout ceux qui n'avaient connu que les camps de réfugiés, tel que celui que je venais de tuer et ceux que j'allais peut-être encore abattre, ce jour là, combattant et civils, car il y a une nécessité du massacre, qui est sa volupté insensée, si l'on veut, ou la transe de l'excès, dès lors que la chance guerrière et avec soi et que le bruit des armes devient chant, tout comme le hurlement des victimes ; c'est là quelque chose de très supérieur à tout ce qu'on peut éprouver dans la vie courante, y compris à la gloire littéraire ou à la jubilation sexuelle, et qui rapproche de l'ivresse collective, et qui fait aimer l'atrocité pour elle-même les blessures franches, la mise à jour des viscères, l'expression la plus vive de terreur et l'absence totale de pitié, tout cela à peu près semblable à un sexe parfaitement durci lors du coït : une forme de pureté, j'ose le dire, quoique je sache que nul ne comprendra, pas même probablement, ceux qui se sont livrés avec fureur et qui ont oublié, ou qui garde une nostalgie inavouable. »
A argent : « (…) l'argent étant une puissance bien plus considérable et mystérieuse que la vie (…) »
A envie (de meurtre) : « J'étais simplement heureux d'être en hauteur, et seul, au sommet d'un immeuble, , caché croyais-je, alors que l'on savait où je me trouvais ou qu'on finissait par le savoir, les cachettes se ressemblant toutes et l'attente à la longue était impure, trop longue, insoutenable, et grande était la tentation de prendre pour cibles non plus ceux qui tentaient de traverser mais les gens que je pouvais observer à la lunette, dans leur appartement, en face et dans le secteur chrétien, comme cette vielle dame qui habitait une petite maison de l'autre coté de l'avenue, avec son petit fils et un singe minuscule (…) »
A joie, humour : Il arrivait même que le destin me fît des clins d'oeil, au sein de l'horreur, pour me rappeler que l'horreur n'est qu'une dimension du grotesque, comme ce jour où j'avais vu un père tirer son fils mort, par le bras, sur le trottoir, jusqu'à une caisse en carton sur laquelle était écrit « muy fràgil », en espagnol ; ou encore cette nuit où nous avions fait exploser une Fiat abandonnée dans une rue obscure et apparemment déserte mais où l'explosion avait révélé, derrière la carcasse, la présence de quatre Islamo-progressistes placés en embuscade.
« Fiat lux ! » avait crié Georges en riant aux éclats, tandis que nous déclenchions sur ces hommes un tir qui les eut bientôt couchés sur l'asphalte.
Car nous riions beaucoup, il le fallait, c'était le contre-point de la rage ou de l'opiniâtreté que nous mettions à combattre, alors que le franc-tireur lui ne rit jamais : il pense que tuer est une manière de méditer sur la proximité et le lointain de l'humain, ou sur son inévitable abstraction. C'est là une souveraineté dans le pire, mais sans la légèreté du combattant de rue, lequel peut ajouter à sa puissance celle, transfiguratrice, d'un rire qui dépassait celui que donne l'arak, le whisky, le hachich, les amphétamines, le bruit des armes. Et le rire m'appelait à moi-même, si peu exubérant que je fusse. »
« Il y avait toujours, même quand les Syriens s'en sont mêlés, quelque chose d'extrêmement juvénile, comme si une jeunesse se dépassait, s'épuisait là, dans une tragi-comédie, beaucoup de combattant jouant aux petits soldats, trouvant là un divertissement incomparable, et se disposant non pas à mourir, mais à faire mourir autrui, la mort n'étant pas pour eux une chose personnelle mais ce dont on se défausse sur autrui. »
A misogynie : « Il y avait longtemps que j'avais renoncé à comprendre le jeu de masques ou l'évidence des premiers regards, sachant pour le reste, que les femmes n'attendent d'un homme que sa semence, un toit et de l'argent. Je ne fais pas ici preuve de misogynie : j'ai été, je le rappelle, élevé par des saintes femmes, et les traitements que les hommes font subir à la gent féminine me révulsent. Cela ne m'empêche pas de penser que l'union légale de la femme et de l'homme, pour autre chose que la reproduction ou le plaisir, est un acte contre nature. »
A fasciste : « Les SS, j'y avais beaucoup pensé, quelques années auparavant, dans les premiers temps de ma vie à Montreuil. (…) je devrais trouver un ordre personnel, à l'écart de toute organisation sociale, c'est-à-dire dans une langue que je ferai mienne par la littérature, tout en restant fasciné par les ordres restreints, religieux ou militaires, notamment les moines soldats ou ce qui s'y apparentait le plus : la Légion étrangère (…) »
« (…) j'aurais eu le courage d'entendre parler de celui qui avait été mon père et qu'il avait probablement connu à la division Charlemagne, imaginais-je, l'un et l'autre ayant compté parmi les derniers défenseurs de Hitler, en 1945, sans être tués par les Asiates soviétiques, ni pendus par des Nègres américains, ni fusillé par des Français bourgeois de bonne famille (…)
« je ne le jugeais pas, la haine du bolchévisme qui avait conduit certains hommes à servir dans la SS ne me paraissant pas alors pire que les errements qui en avaient mené tant d'autres, au nom de l'amélioration de la condition humaine, à soutenir le communisme international et à écrire le panégyrique de Joseph Staline et de Mao Zedong. »
La place de Richard Millet est bien évidemment derrière des barreaux car, contrairement à ce qu'il affirme dans son livre, les crimes contre l'humanité existent bel et bien et ils sont imprescriptibles. « Indignez-vous ! » clame justement Stéphane Hessel. Je suis sous le choc. Un tel ouvrage a pu être édité ? Des critiques ont pu trouver des qualités à cet ignoble bréviaire de haine ? Les associations humanitaires n'ont pas poursuivi en justice cet assassin ?
Dans un style parfait, foisonnant, précis et profond (si cela se dit pour un style), le narrateur raconte comment, à l'âge de vingt ans, il s'est engagé dans la guerre du Liban, aux côtés des phalangistes pour combattre les Palestiniens.
A sa manière, il parle de son désir de devenir écrivain qui passe par la guerre, de son désir de femmes qu'il n'aura pas, des corps, de son dégoût des odeurs, du délitement de la langue française.
Par des mécanismes invisibles, il parvient à nous faire glisser de Beyrouth à Siom, le village de son enfance, à nous parler de sa mère et de sa soeur Françoise, qui lui est très chère.
C'est encore un grand moment de littérature.
A sa manière, il parle de son désir de devenir écrivain qui passe par la guerre, de son désir de femmes qu'il n'aura pas, des corps, de son dégoût des odeurs, du délitement de la langue française.
Par des mécanismes invisibles, il parvient à nous faire glisser de Beyrouth à Siom, le village de son enfance, à nous parler de sa mère et de sa soeur Françoise, qui lui est très chère.
C'est encore un grand moment de littérature.
Je donne deux étoiles à ce livre car il est bien écrit.
Concernant le personnage a savoir Richard millet, c'est un personnage détestable, horrible, raciste... Il raconte le plaisir qu'il a eu à tuer,a massacrer des musulmans lors de la guerre du Liban après avoir rejoint les phalanges libanaises. Je me demande comment cette personne ainsi que ses semblables na pas été jugé et condamné. Comment un livre pareil a été édité. Cependant, je recommande quand même de le lire car la guerre entre chrétien et musulmans n'a jamais été très médiatisé et connu des gens.
Concernant le personnage a savoir Richard millet, c'est un personnage détestable, horrible, raciste... Il raconte le plaisir qu'il a eu à tuer,a massacrer des musulmans lors de la guerre du Liban après avoir rejoint les phalanges libanaises. Je me demande comment cette personne ainsi que ses semblables na pas été jugé et condamné. Comment un livre pareil a été édité. Cependant, je recommande quand même de le lire car la guerre entre chrétien et musulmans n'a jamais été très médiatisé et connu des gens.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Richard Millet (93)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1723 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1723 lecteurs ont répondu