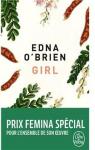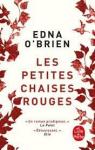[ Emprunté à la Bibliothèque Buffon – 21 septembre 2021]
En plus d'avoir depuis …une éternité dans ma liste de « classiques à lire », le « Ulysse », je n'ai toujours pas lu la moindre ligne de James Joyce. J'espérais quelque peu que l'enthousiasme d'Edna O'Brien pour cet écrivain qu'elle découvre avec passion, dans les années 50, m'en donnerait l'envie !
Au final, ce ne fut pas concluant du tout, en dehors du texte de Pierre-Emmanuel Dauzat, in-fine, qui analyse en détails et décortique la complexité de l'oeuvre de Joyce et surtout la quasi-impossibilité de sa traduction…commentaire introduit par une citation très significative de Marina Tsvetaieva :
« Je ne me laisserai pas séduire par ma langue
Maternelle, par son appel lacté.
Peu importe la langue dans laquelle
Je serai incomprise du passant »
Même si le texte d'Edna O'Brien a de l'intérêt et parfois de la drôlerie, il me laisse assez indifférente et ne m'incitera pas plus à aborder la « prose unique » de Joyce, dont la personnalité ne m'attire guère, en dehors de son obsession, et de ses recherches exigeantes pour l'Ecriture…
En dehors de cela, je reprends les propres mots de son admiratrice même : « … des tartines de refoulement sexuel et d'égocentrisme vertigineux » !!!...(p. 52)
Des parents peu accordés ; une préférence pour son père, en dépit de ses nombreux travers, ; un attachement contrarié à sa mère…et avec tout cela, des rapports des plus voraces et partagés avec les femmes : entre « muse », déesse ou catin… !!
Ici, il s'agit de son « amour » paroxystique, et continuellement ambivalent pour la femme de sa vie, Mona… Par ailleurs, ce qui habite essentiellement son existence, c'est L'ECRITURE…le travail sur la , les langues…
Texte sûrement éclairant, pour les lecteurs assidus de Joyce, ou curieux confirmés de son oeuvre… Quant à moi, je regrette de rester « mitigée » et me sens toujours à grande distance des écrits de cet écrivain irlandais, oeuvrant sur une planète complètement étrangère à la mienne, ce qui me fait terminer par une phrase de Pierre-Emmanuel Dauzat, avec laquelle je suis en accord absolu!!
« Il faut imaginer le texte de Joyce en mobile de Calder ou de Niki de Saint-Phalle, où l'oeuvre n'a qu'un sens éphémère au gré de l'angle de vue (...) (p. 78)”
En plus d'avoir depuis …une éternité dans ma liste de « classiques à lire », le « Ulysse », je n'ai toujours pas lu la moindre ligne de James Joyce. J'espérais quelque peu que l'enthousiasme d'Edna O'Brien pour cet écrivain qu'elle découvre avec passion, dans les années 50, m'en donnerait l'envie !
Au final, ce ne fut pas concluant du tout, en dehors du texte de Pierre-Emmanuel Dauzat, in-fine, qui analyse en détails et décortique la complexité de l'oeuvre de Joyce et surtout la quasi-impossibilité de sa traduction…commentaire introduit par une citation très significative de Marina Tsvetaieva :
« Je ne me laisserai pas séduire par ma langue
Maternelle, par son appel lacté.
Peu importe la langue dans laquelle
Je serai incomprise du passant »
Même si le texte d'Edna O'Brien a de l'intérêt et parfois de la drôlerie, il me laisse assez indifférente et ne m'incitera pas plus à aborder la « prose unique » de Joyce, dont la personnalité ne m'attire guère, en dehors de son obsession, et de ses recherches exigeantes pour l'Ecriture…
En dehors de cela, je reprends les propres mots de son admiratrice même : « … des tartines de refoulement sexuel et d'égocentrisme vertigineux » !!!...(p. 52)
Des parents peu accordés ; une préférence pour son père, en dépit de ses nombreux travers, ; un attachement contrarié à sa mère…et avec tout cela, des rapports des plus voraces et partagés avec les femmes : entre « muse », déesse ou catin… !!
Ici, il s'agit de son « amour » paroxystique, et continuellement ambivalent pour la femme de sa vie, Mona… Par ailleurs, ce qui habite essentiellement son existence, c'est L'ECRITURE…le travail sur la , les langues…
Texte sûrement éclairant, pour les lecteurs assidus de Joyce, ou curieux confirmés de son oeuvre… Quant à moi, je regrette de rester « mitigée » et me sens toujours à grande distance des écrits de cet écrivain irlandais, oeuvrant sur une planète complètement étrangère à la mienne, ce qui me fait terminer par une phrase de Pierre-Emmanuel Dauzat, avec laquelle je suis en accord absolu!!
« Il faut imaginer le texte de Joyce en mobile de Calder ou de Niki de Saint-Phalle, où l'oeuvre n'a qu'un sens éphémère au gré de l'angle de vue (...) (p. 78)”
Un tout petit texte par le nombre de pages, à peine une cinquantaine, dans lequel Edna O'Brien évoque James Joyce, et plus précisément son couple avec celle qui deviendra sa femme, Nora Barnacle. Leur rencontre, leurs relations, la vie difficile qu'ils ont menée, James Joyce ayant du mal à gagner sa vie.
Ce n'est pas un récit structuré, détaillé de leur existence, plutôt des moments saisis au vol, dans une écriture flamboyante et inspirée, qui tente de comprendre de l'intérieur, de faire ressentir. Joyce a été à l'origine de la vocation d'Edna O'Brien, il est celui avec qui elle entretient une sorte de dialogue permanent. Elle le raconte comme si elle le connaissait, comme si elle avait été là, à côté, ou à l'intérieur même de lui. Elle ne parle pas d'un autre, d'un écrivain, mais d'une sorte de double. C'est à la fois très lyrique, et très précis, concret. Un très beau texte.
J'ai en revanche été moins séduite par le texte qui fait suite, de Pierre-Emmanuel Dauzat, traducteur de Joyce et d'Edna O'Brien, qui explique la difficulté de la traduction joycienne, d'une manière un peu bavarde à mon sens.
Ce n'est pas un récit structuré, détaillé de leur existence, plutôt des moments saisis au vol, dans une écriture flamboyante et inspirée, qui tente de comprendre de l'intérieur, de faire ressentir. Joyce a été à l'origine de la vocation d'Edna O'Brien, il est celui avec qui elle entretient une sorte de dialogue permanent. Elle le raconte comme si elle le connaissait, comme si elle avait été là, à côté, ou à l'intérieur même de lui. Elle ne parle pas d'un autre, d'un écrivain, mais d'une sorte de double. C'est à la fois très lyrique, et très précis, concret. Un très beau texte.
J'ai en revanche été moins séduite par le texte qui fait suite, de Pierre-Emmanuel Dauzat, traducteur de Joyce et d'Edna O'Brien, qui explique la difficulté de la traduction joycienne, d'une manière un peu bavarde à mon sens.
Bizarrement, je n'ai pas eu l'impression de lire un livre complet... le portrait du couple James et Nora n'est pas mal fait, loin de là, mais pour moi c'est finalement plus une grosse préface aux lettres de James Joyce à Nora Bernacle.
La lecture du texte d'Edna O'Brien n'est pas simple, il y a du vocabulaire complexe ! Mais ça vaut le coup de s'y accrocher, surtout vu le peu de pages.
Par contre, je me suis sentie frustrée, il me fallait lire les lettres : ce que j'ai fait, et ce que je conseille.
(Par contre la postface ici n'a pas réussie à me passionner, désolée...)
La lecture du texte d'Edna O'Brien n'est pas simple, il y a du vocabulaire complexe ! Mais ça vaut le coup de s'y accrocher, surtout vu le peu de pages.
Par contre, je me suis sentie frustrée, il me fallait lire les lettres : ce que j'ai fait, et ce que je conseille.
(Par contre la postface ici n'a pas réussie à me passionner, désolée...)
L'auteure irlandaise dont la vocation d'écrivaine a été révélée par sa découverte de James Joyce, nous raconte l'épopée amoureuse de James Joyce et Nora Barnacle, de 1904, date de leur rencontre à 1941, date du décès de Nora. Emmanuel Dauzat, auteur de la traduction du texte d'Edna O'Brien, expose ensuite, en fin connaisseur de l'oeuvre de James Joyce la problématique des traductions, surtout quand la langue originale est-elle même constituée d'éléments disparates tenant à la culture et la sensibilité de l'auteur. Il semble que ce fut le cas des écrits de James Joyce empruntant à plusieurs langues, dont le yiddish, langue vernaculaire d'une partie de la communauté juive. Cette partie du livre, émanant d'un spécialiste de la traduction est un peu difficile à appréhender pour le néophyte que je suis.
J'ai hésité avant de faire un retour sur cette lecture. Et puis saperlipopette je me lance, car même si j'en parle avec deux mains gauches et la langue collée au palais, au moins vous saurez que ce petit livre vaut le détour et son pesant d'intérêt – tant le portrait de Joyce en couple que nous livre Edna, que la passionnante postface de Pierre-Emmanuel Dauzat.
Edna O'Brien a écrit cet essai en 1981. Elle a découvert James Joyce pendant ses années d'études. Devenu son mentor et sa muse, elle le lit depuis, quasiment chaque jour. Lire Edna qui lit Joyce est une expérience vivifiante, mais qui demande de l'attention. James Joyce et Nora Barnacle se sont rencontrés en juin 1904 dans la rue. Lui étudiant, elle femme de chambre originaire de Galway, ils sont transportés physiquement et mentalement dans « un sur-amour intense, obsessionnel et attentionné ». Perpétuellement dans la dèche, ils courent la Suisse, l'Italie et la France pour gagner quelques sous. Deux enfants naissent. Joyce, avec « ses qualités de monstre » et « son naturel railleur et méprisant », qui harcèle son frère par lettres pour qu'il lui trouve de l'argent, donne à préférer au lecteur le génie plutôt que l'homme. Son oeuvre se construit, exclusive et dévorante. James et Nora ont vécu une relation inclassable et charnelle qui semble avoir été au final – en tous cas au prisme de la plume d'Edna O'Brien -, dominée par la pauvreté et la solitude.
La postface est un régal, qui nous livre de nombreuses interrogations et anecdotes sur les difficultés et les enjeux de traduire Joyce, dont Pierre-Emmanuel Dauzat rapproche la langue, écrite en dix-sept autres, du Yiddish. Il nous explique aussi qu'Edna O'Brien apporte une analyse singulière sur le propos de Joyce, car étant irlandaise, elle connaît la prononciation de l'anglais dans les différentes régions de l'Irlande, et sait l'habillement anglais des mots irlandais. Quel casse-tête !
Et donc, le petit livre d'Edna O'Brien ouvre de nombreuses portes vers la vie et l'oeuvre de James Joyce – et cette édition française, avec sa postface, offre un éclairage passionnant sur la traduction.
Lien : https://lettresdirlandeetdai..
Edna O'Brien a écrit cet essai en 1981. Elle a découvert James Joyce pendant ses années d'études. Devenu son mentor et sa muse, elle le lit depuis, quasiment chaque jour. Lire Edna qui lit Joyce est une expérience vivifiante, mais qui demande de l'attention. James Joyce et Nora Barnacle se sont rencontrés en juin 1904 dans la rue. Lui étudiant, elle femme de chambre originaire de Galway, ils sont transportés physiquement et mentalement dans « un sur-amour intense, obsessionnel et attentionné ». Perpétuellement dans la dèche, ils courent la Suisse, l'Italie et la France pour gagner quelques sous. Deux enfants naissent. Joyce, avec « ses qualités de monstre » et « son naturel railleur et méprisant », qui harcèle son frère par lettres pour qu'il lui trouve de l'argent, donne à préférer au lecteur le génie plutôt que l'homme. Son oeuvre se construit, exclusive et dévorante. James et Nora ont vécu une relation inclassable et charnelle qui semble avoir été au final – en tous cas au prisme de la plume d'Edna O'Brien -, dominée par la pauvreté et la solitude.
La postface est un régal, qui nous livre de nombreuses interrogations et anecdotes sur les difficultés et les enjeux de traduire Joyce, dont Pierre-Emmanuel Dauzat rapproche la langue, écrite en dix-sept autres, du Yiddish. Il nous explique aussi qu'Edna O'Brien apporte une analyse singulière sur le propos de Joyce, car étant irlandaise, elle connaît la prononciation de l'anglais dans les différentes régions de l'Irlande, et sait l'habillement anglais des mots irlandais. Quel casse-tête !
Et donc, le petit livre d'Edna O'Brien ouvre de nombreuses portes vers la vie et l'oeuvre de James Joyce – et cette édition française, avec sa postface, offre un éclairage passionnant sur la traduction.
Lien : https://lettresdirlandeetdai..
Les choses sont ce qu'elles ont en littérature. C'est un peu comme dans le jeu des sept familles. Il faut distinguer le père et la mère, quelquefois des personnes additionnelles au couple, les enfants et enfin les oeuvres. Tout cela avant de comprendre comment ces dernières se sont formées, ont évolué et parvenues à leur stade actuel. Ainsi dans la famille Joyce, il y a tout d'abord la bibliographie de l'écrivain, quelquefois savante. On dira scholar pour ce qui concerne les anglo-saxons pour faire référence aux lecteurs souvent chenus que leurs études ont permis de décortiquer les différents stades de la vie de l'auteur ou de sa famille. C'est quelquefois exhaustif et ennuyeux à lire. Mais cela fournit souvent un éclairage différent de la façon dont les oeuvres furent conçues (voyage, difficultés conjugales, besoin urgent de financement, logorrhée maladive, …). Pour des auteurs réputés difficiles, il y a deux cas de bibliographies, l'un pour tenter d'expliquer ce que le lecteur aurait dû comprendre, l'autre pour replacer ce qui a été compris dans un contexte, forcément adéquat.
Survient le cas de James Joyce (1882-1941). La complexité augmente, bien que le couple soit simple (James et Nora Barnacle) sans compter les additifs (l'écrivain étant concentré sur son oeuvre). Les deux enfants (Giorgio et Lucia). Auxquels il faut rajouter les doubles du couple (Moly Bloom, Stephen Dedalus) du frère Stanislaus ou le petit fils Stephen, ou encore les amis comme Alfred H. Hunter de même qu'un étudiant italien Ettore Schmitz, plus connu sous le pseudonyme de Italo Svevo. Ces deux derniers serviront de modèle pour le personnage de Leopold Bloom.
Pour une bibliographie quasi exhaustive de James Joyce, on se reportera aux deux tomes de Richard Ellmann « Joyce » traduits par André Coeuroy et Marie Tadié (1987, Tel #118 et 119, Gallimard, 518 et 574 p.). On lira également le « James Joyce » de Edna O'Brien traduit par Geneviève Bigant-Boddaert (2002, Fides, Autrement, 241 p.), ou la version plus personnelle de Philippe Forest « Beaucoup de Jours, d'après Ulysse de James Joyce » (2011, Editions Cécile Defaut, 478 p.)
« Nora - La Vérité sur les Rapports de Nora et James Joyce » de Brenda Maddox, traduit par Marianne Véron (1990, Albin-Michel, 564 p.) est une bonne biographie de Nora Joyce, la femme de James Joyce. On y trouve aussi des éléments sur la vie des enfants Lucia et Giorgio. Egalement sur ce sujet, le romancé et très contre-versé livre de Annabel Abbs « La Fille de Joyce » traduit par Anne-Carole Grillot (2021, Editions Hervé Chopin, 416 p.). Mieux vaut se référer au livre de Brenda Maddox et à celui de Carol Loeb Shloss « Lucia Joyce, To Dance in the Wake » (2003, Bloomsbury, 561 p.).
Sur le couple, on peut se reporter au « James & Nora, Portrait de Joyce en couple » de Edna O'Brien, traduit par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (2021, Sabine Wespieser Editeur, 92 p.). Cet ouvrage est suivi par une intéressante postface d'une trentaine de pages de l'un des traducteurs, Pierre-Emmanuel Dauzat, intitulée « le Yiddish de Joyce » qui éclaire le lecteur européen, plus familier au mélange des langues. On y découvre les processus de fusion-mélange des 17 langues utilisées par James Joyce, sources de problèmes pour les traducteurs et quelquefois d'incompréhension pour les lecteurs.
Edna O'Brien n'a jamais caché son admiration et son goût pour la chose écrite que lui avait procuré la lecture de James Joyce.
Le petit opuscule de Edna O'Brien est suivi d'une remarquable postface de Pierre-Emmanuel Dauzat, l'autre traducteur, intitulée « le Yiddish de James Joyce ».
Le titre tout d'abord. On a beaucoup glossé sur la religion de James Joyce, à savoir s'il était circoncis ou non. La scène de la plage dans laquelle Stephen Dedalus se promène sur la plage de Sandymount et au moment où Gerty MacDowell renvoie un ballon égaré, en retroussant légèrement ses jupes. Puis, l'esprit échauffé, elle offre aux yeux indécents de l'inconnu en costume noir le spectacle de ses cuisses et de ses dessous, jusqu'à l'extase. Stephen qui en profite pour se masturber semble ne pas être circoncis.
Par ailleurs James Joyce identifiait « sa mère à l'Eglise Catholique, qu'il tenait pour fille de cuisine de la chrétienté ». D'ailleurs il n'a jamais caché son aversion pour la religion. de même qu'il quitte son pays, et avec lui « le patriotisme, la pisse-au-vent philosophique, la filouterie, la vacuité et la diarrhée verbale qui réservait le sentiment à Dieu et aux morts ».
Ceci dit, le Yiddish est ici utilisé comme un exemple de mélanges des langues, tel qu'il a été conçu et utilisé dans la MittelEuropa. L'auteur relève l'utilisation dans ses livres de pas moins de 17 langues. Un peu comme le Yiddish. L'opuscule de Pierre-Emmanuel Dauzat s'ouvre sur une comparaison avec Humpty Dumpty, ce qui n'est pas rien. On se souvient de sa discussion avec Alice à propos du sens et de l'utilisation des mots « Quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que j'ai décidé qu'il signifie, ni plus, ni moins ». Voilà qui est clair, du moins dans le jargon de Humpty Dumpty.
En fait cela signifie que le lecteur a ou interprète un texte selon ses propres critères, et qu'une lecture unique ne saurait suffire. D'autant plus, que « le plus évident devient étranger. Y compris dans sa langue maternelle ».
Reste la question qui trouble Pierre-Emmanuel Dauzat. « En quel sens Joyce pouvait-il chercher à être incompris, lui qui mettait tant de scrupule à s'assurer que les critiques saisissaient bien ses intentions ? »
Il semble que l'alliance entre Edna O'Brien, Aude de Saint Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat ait bien fonctionné. Edna qui voyait en Joyce un « funnominal » Pierre-Emmanuel Dauzat relève par la suite des assonances entre « deepbrow funding » et « de Profundis » ou « Adeste fideles » devient « dusty fidelios », de même que la « Panther monster » dissimule mal le « Pater Noster ». autre coups de pieds de l'âne à la religion catholique, apostolique et romaine, un peu comme la salade du même nom qui peut devenir batavia au gré des baptêmes hollandais.
Comment faut il encore traduire le « Finnegans Wake » qui débute par « erre revie, pass'Evant notre Adame, d'erre rive en rêvière » (riverrun, past Eve and Adam's) et qui se termine par « Au large vire et tiens bon lof pour lof la barque au fond de l'onde de l' » (A way a lone a last a loved a long the). On retrouve là la théorie des cycles chère à Giambattista Vico (Philippe Lavergne précise « recourante via Vico par chaise percée de recirculation »
Ou comment encore traduite les mots de 100 Lettres qui parsèment « Finnegans Wake » comme « bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk! «
« D'où l'autre intraduisibilité : dans sa propre langue, avec la quasi-certitude de ne jamais être sûr de se comprendre soi-même, tel un archéologue arpentant les reliquats d'un vestige d'habitat paléolithique »
« Et si Joyce écrivait Yiddish » parce que Joyce pratique une langue, « comme le yiddish », « formée de toutes les langues », la « langue maternelle devenue à elle-même inconnue, unheimlich ». L'intérêt étant que dans ce yiddish, la traduction se fait à l'infini. A peine terminée, elle recommence en un mouvement perpétuel, rejoignant ainsi à nouveau les idées de Vico.
Survient le cas de James Joyce (1882-1941). La complexité augmente, bien que le couple soit simple (James et Nora Barnacle) sans compter les additifs (l'écrivain étant concentré sur son oeuvre). Les deux enfants (Giorgio et Lucia). Auxquels il faut rajouter les doubles du couple (Moly Bloom, Stephen Dedalus) du frère Stanislaus ou le petit fils Stephen, ou encore les amis comme Alfred H. Hunter de même qu'un étudiant italien Ettore Schmitz, plus connu sous le pseudonyme de Italo Svevo. Ces deux derniers serviront de modèle pour le personnage de Leopold Bloom.
Pour une bibliographie quasi exhaustive de James Joyce, on se reportera aux deux tomes de Richard Ellmann « Joyce » traduits par André Coeuroy et Marie Tadié (1987, Tel #118 et 119, Gallimard, 518 et 574 p.). On lira également le « James Joyce » de Edna O'Brien traduit par Geneviève Bigant-Boddaert (2002, Fides, Autrement, 241 p.), ou la version plus personnelle de Philippe Forest « Beaucoup de Jours, d'après Ulysse de James Joyce » (2011, Editions Cécile Defaut, 478 p.)
« Nora - La Vérité sur les Rapports de Nora et James Joyce » de Brenda Maddox, traduit par Marianne Véron (1990, Albin-Michel, 564 p.) est une bonne biographie de Nora Joyce, la femme de James Joyce. On y trouve aussi des éléments sur la vie des enfants Lucia et Giorgio. Egalement sur ce sujet, le romancé et très contre-versé livre de Annabel Abbs « La Fille de Joyce » traduit par Anne-Carole Grillot (2021, Editions Hervé Chopin, 416 p.). Mieux vaut se référer au livre de Brenda Maddox et à celui de Carol Loeb Shloss « Lucia Joyce, To Dance in the Wake » (2003, Bloomsbury, 561 p.).
Sur le couple, on peut se reporter au « James & Nora, Portrait de Joyce en couple » de Edna O'Brien, traduit par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (2021, Sabine Wespieser Editeur, 92 p.). Cet ouvrage est suivi par une intéressante postface d'une trentaine de pages de l'un des traducteurs, Pierre-Emmanuel Dauzat, intitulée « le Yiddish de Joyce » qui éclaire le lecteur européen, plus familier au mélange des langues. On y découvre les processus de fusion-mélange des 17 langues utilisées par James Joyce, sources de problèmes pour les traducteurs et quelquefois d'incompréhension pour les lecteurs.
Edna O'Brien n'a jamais caché son admiration et son goût pour la chose écrite que lui avait procuré la lecture de James Joyce.
Le petit opuscule de Edna O'Brien est suivi d'une remarquable postface de Pierre-Emmanuel Dauzat, l'autre traducteur, intitulée « le Yiddish de James Joyce ».
Le titre tout d'abord. On a beaucoup glossé sur la religion de James Joyce, à savoir s'il était circoncis ou non. La scène de la plage dans laquelle Stephen Dedalus se promène sur la plage de Sandymount et au moment où Gerty MacDowell renvoie un ballon égaré, en retroussant légèrement ses jupes. Puis, l'esprit échauffé, elle offre aux yeux indécents de l'inconnu en costume noir le spectacle de ses cuisses et de ses dessous, jusqu'à l'extase. Stephen qui en profite pour se masturber semble ne pas être circoncis.
Par ailleurs James Joyce identifiait « sa mère à l'Eglise Catholique, qu'il tenait pour fille de cuisine de la chrétienté ». D'ailleurs il n'a jamais caché son aversion pour la religion. de même qu'il quitte son pays, et avec lui « le patriotisme, la pisse-au-vent philosophique, la filouterie, la vacuité et la diarrhée verbale qui réservait le sentiment à Dieu et aux morts ».
Ceci dit, le Yiddish est ici utilisé comme un exemple de mélanges des langues, tel qu'il a été conçu et utilisé dans la MittelEuropa. L'auteur relève l'utilisation dans ses livres de pas moins de 17 langues. Un peu comme le Yiddish. L'opuscule de Pierre-Emmanuel Dauzat s'ouvre sur une comparaison avec Humpty Dumpty, ce qui n'est pas rien. On se souvient de sa discussion avec Alice à propos du sens et de l'utilisation des mots « Quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que j'ai décidé qu'il signifie, ni plus, ni moins ». Voilà qui est clair, du moins dans le jargon de Humpty Dumpty.
En fait cela signifie que le lecteur a ou interprète un texte selon ses propres critères, et qu'une lecture unique ne saurait suffire. D'autant plus, que « le plus évident devient étranger. Y compris dans sa langue maternelle ».
Reste la question qui trouble Pierre-Emmanuel Dauzat. « En quel sens Joyce pouvait-il chercher à être incompris, lui qui mettait tant de scrupule à s'assurer que les critiques saisissaient bien ses intentions ? »
Il semble que l'alliance entre Edna O'Brien, Aude de Saint Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat ait bien fonctionné. Edna qui voyait en Joyce un « funnominal » Pierre-Emmanuel Dauzat relève par la suite des assonances entre « deepbrow funding » et « de Profundis » ou « Adeste fideles » devient « dusty fidelios », de même que la « Panther monster » dissimule mal le « Pater Noster ». autre coups de pieds de l'âne à la religion catholique, apostolique et romaine, un peu comme la salade du même nom qui peut devenir batavia au gré des baptêmes hollandais.
Comment faut il encore traduire le « Finnegans Wake » qui débute par « erre revie, pass'Evant notre Adame, d'erre rive en rêvière » (riverrun, past Eve and Adam's) et qui se termine par « Au large vire et tiens bon lof pour lof la barque au fond de l'onde de l' » (A way a lone a last a loved a long the). On retrouve là la théorie des cycles chère à Giambattista Vico (Philippe Lavergne précise « recourante via Vico par chaise percée de recirculation »
Ou comment encore traduite les mots de 100 Lettres qui parsèment « Finnegans Wake » comme « bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk! «
« D'où l'autre intraduisibilité : dans sa propre langue, avec la quasi-certitude de ne jamais être sûr de se comprendre soi-même, tel un archéologue arpentant les reliquats d'un vestige d'habitat paléolithique »
« Et si Joyce écrivait Yiddish » parce que Joyce pratique une langue, « comme le yiddish », « formée de toutes les langues », la « langue maternelle devenue à elle-même inconnue, unheimlich ». L'intérêt étant que dans ce yiddish, la traduction se fait à l'infini. A peine terminée, elle recommence en un mouvement perpétuel, rejoignant ainsi à nouveau les idées de Vico.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Edna O’Brien (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz de la Saint-Patrick
Qui est Saint-Patrick?
Le saint patron de l’Irlande
Le saint-patron des brasseurs
8 questions
252 lecteurs ont répondu
Thèmes :
fêtes
, irlandais
, irlande
, bière
, barCréer un quiz sur ce livre252 lecteurs ont répondu