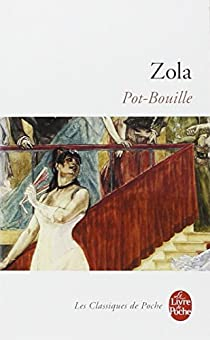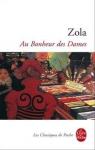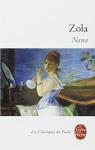Critiques filtrées sur 4 étoiles
Octave Mouret vient s'installer à Paris, rue de Choiseul dans un immeuble bourgeois où se côtoient un architecte, un conseiller à la cour, des employés, des commerçants – dont le vieux propriétaire, Vabre – et toute leur domesticité.
Octave entre aussi dans un monde de convenances, un univers de façade où les maîtres cachent sans cesse le scandale sur lequel l'église – représentée par l'abbé Mauduit – jette un voile de morale.
Pour le jeune homme, la réussite passe par la séduction des familles et surtout des femmes. Un peu sur le même plan, les jeunes filles –les filles Josserand, filles d'un petit employé – sont poussées par leur mère dans le monde afin de conclure un bon mariage, dotées par un oncle riche, le fameux oncle Bachelard, sorte de parvenu vulgaire et soiffard. Les hommes plus mûrs, comme le conseiller Duveyrier, sont menés par les femmes, notamment leurs maîtresses qui vengent leur condition – et en quelque sorte les jeunes filles en chasse- en choisissant un plus riche. Tout ce petit monde, ce microcosme social se retrouve dans l'immeuble dont la configuration même permet aux domestiques de montrer le côté obscur des frasques de leurs maîtres, où le flot des paroles ordurières monte du cloaque des ordures déversées par les fenêtres que l'on s'envoie par jeu ou par provocation.
Octave monte donc la gamme des femmes à séduire en bon disciple de Rastignac. Il y a la gentille, sur qui l'on peut toujours compter, la veuve effarouchée mais dont on sent le désir inassouvi, la jeune femme qui cherche l'aventure mais surtout l'argent de ses besoins égoïstes et enfin la commerçante dont le mariage se conclut comme un contrat marchand.
Ce roman – qui préfigure assez bien sa suite logique , Au bonheur des dames– m'a permis de renouer avec Zola qui m'avait jusqu'ici laissé une impression mitigée : fins convenues, style un peu lourd parfois. Ici, tout s'enchaîne à merveille. On sent bien sûr que l'auteur a une thèse à remplir mais il n'a pas son pareil pour camper une ambiance, décrire les travers aussi bien bourgeois que domestiques, et passer au scalpel des scènes qui font frémir d'angoisse et de douleur dont l'accouchement d'Adèle, la bonne des Josserand, seule, dans la nuit froide.
Rachel, bonne silencieuse et taciturne du jeune ménage Vabre, me semble assez bien résumer la pensée de l'ouvrage lorsqu'elle est renvoyée et donne enfin ses vrais sentiments :
" Je ne suis qu'une bonne, mais je suis honnête ! criait-elle, en mettant à ce cri ses dernières forces. Il n'y a pas une de vos garces de dames qui me vaille, dans votre baraque de maison ! … Bien sûr, que je m'en vais, vous me faites tous mal au coeur ! "
Octave entre aussi dans un monde de convenances, un univers de façade où les maîtres cachent sans cesse le scandale sur lequel l'église – représentée par l'abbé Mauduit – jette un voile de morale.
Pour le jeune homme, la réussite passe par la séduction des familles et surtout des femmes. Un peu sur le même plan, les jeunes filles –les filles Josserand, filles d'un petit employé – sont poussées par leur mère dans le monde afin de conclure un bon mariage, dotées par un oncle riche, le fameux oncle Bachelard, sorte de parvenu vulgaire et soiffard. Les hommes plus mûrs, comme le conseiller Duveyrier, sont menés par les femmes, notamment leurs maîtresses qui vengent leur condition – et en quelque sorte les jeunes filles en chasse- en choisissant un plus riche. Tout ce petit monde, ce microcosme social se retrouve dans l'immeuble dont la configuration même permet aux domestiques de montrer le côté obscur des frasques de leurs maîtres, où le flot des paroles ordurières monte du cloaque des ordures déversées par les fenêtres que l'on s'envoie par jeu ou par provocation.
Octave monte donc la gamme des femmes à séduire en bon disciple de Rastignac. Il y a la gentille, sur qui l'on peut toujours compter, la veuve effarouchée mais dont on sent le désir inassouvi, la jeune femme qui cherche l'aventure mais surtout l'argent de ses besoins égoïstes et enfin la commerçante dont le mariage se conclut comme un contrat marchand.
Ce roman – qui préfigure assez bien sa suite logique , Au bonheur des dames– m'a permis de renouer avec Zola qui m'avait jusqu'ici laissé une impression mitigée : fins convenues, style un peu lourd parfois. Ici, tout s'enchaîne à merveille. On sent bien sûr que l'auteur a une thèse à remplir mais il n'a pas son pareil pour camper une ambiance, décrire les travers aussi bien bourgeois que domestiques, et passer au scalpel des scènes qui font frémir d'angoisse et de douleur dont l'accouchement d'Adèle, la bonne des Josserand, seule, dans la nuit froide.
Rachel, bonne silencieuse et taciturne du jeune ménage Vabre, me semble assez bien résumer la pensée de l'ouvrage lorsqu'elle est renvoyée et donne enfin ses vrais sentiments :
" Je ne suis qu'une bonne, mais je suis honnête ! criait-elle, en mettant à ce cri ses dernières forces. Il n'y a pas une de vos garces de dames qui me vaille, dans votre baraque de maison ! … Bien sûr, que je m'en vais, vous me faites tous mal au coeur ! "
Roman de moeurs, roman d'un immeuble, roman des débuts d'Octave Mouret ce roman est une formidable fresque sociale. Acide, cruel, féroce, drôle, jubilatoire, cet opus des Rougon Macquart est une grande réussite. A lire bien sûr. Vous ne le regretterez pas.
Une "Vie mode d'emploi" avant l'heure, déjà dans du hausmannien, mais à une époque où les chambres de bonnes en étaient vraiment ; leurs patrons ne dédaignaient d'ailleurs pas d'y monter, histoire d'assouvir les pulsions que leurs bourgeoises répugnaient à satisfaire… Tout cela reste assez vaudevillesque, profondément misanthrope et furieusement misogyne, mais le talent littéraire de Zola et ses réflexions bien senties sur l'hypocrisie des moeurs du second Empire font tout passer, n'est-ce-pas ?
Zola atteint des sommets de réalisme, cruel et cynique, sans jamais se montrer moralisateur ni se départir de son regard d'investigateur éclairé.
Avec les Rougon-Macquart, il précise avoir voulu décrire "la bousculade des ambitions et des appétits" et dans ce dixième épisode s'attaquer plus précisément aux "vanités imbéciles des petits appartements bourgeois".
De fait, il expose ici la chronique de la vie d'un immeuble bourgeois parisien, topographie d'un plaisir clandestin, avec des adultères sans passions à tous les étages. Nous assistons à une représentation de cirque, d'une ménagerie aux dessous nauséabonds mise à nue, ramassis abject de grotesques abrutis.
Oui... la pourriture est ici dévoilée avec une esthétique crudité : des mesquines intrigues pour des magots inexistants à la lubricité violente qui sévit contre les femmes. Tout cela en catimini, entre deux confessions à l'église, en gueulardise avant le buffet des hypocrites où chacun flattera ses flétrissures avec d'ineptes grimaces de complicité , comédie pour mieux briller en société.
"Quels gredins que les honnêtes gens !", s'exclamait Claude Lantier dans "Le Ventre de Paris". Ici, leur frénésie d'instincts débridés, leur avide fourberie enrobée d'inculture, leurs unions d'aliénations nous imposent ce constat : dans les cloaques bourgeois aux tapisseries brodées de soie, la névrose est reine.
Avec les Rougon-Macquart, il précise avoir voulu décrire "la bousculade des ambitions et des appétits" et dans ce dixième épisode s'attaquer plus précisément aux "vanités imbéciles des petits appartements bourgeois".
De fait, il expose ici la chronique de la vie d'un immeuble bourgeois parisien, topographie d'un plaisir clandestin, avec des adultères sans passions à tous les étages. Nous assistons à une représentation de cirque, d'une ménagerie aux dessous nauséabonds mise à nue, ramassis abject de grotesques abrutis.
Oui... la pourriture est ici dévoilée avec une esthétique crudité : des mesquines intrigues pour des magots inexistants à la lubricité violente qui sévit contre les femmes. Tout cela en catimini, entre deux confessions à l'église, en gueulardise avant le buffet des hypocrites où chacun flattera ses flétrissures avec d'ineptes grimaces de complicité , comédie pour mieux briller en société.
"Quels gredins que les honnêtes gens !", s'exclamait Claude Lantier dans "Le Ventre de Paris". Ici, leur frénésie d'instincts débridés, leur avide fourberie enrobée d'inculture, leurs unions d'aliénations nous imposent ce constat : dans les cloaques bourgeois aux tapisseries brodées de soie, la névrose est reine.
Agréablement surpris par ce Pot-Bouille de Zola. Moins pénible que le Eugène Rougon que j'ai lu le mois dernier. Peut-être est-ce le mode d'écriture qui en est la cause, puisque Pot-Bouille fut publié par épisodes dans un journal. Ce qui est certain est que j'ai trouvé la lecture agréable.
Un Pot-Bouille qui m'a fait pensé, par son principe, à La vie Mode d'emploi de Georges Pérec. Zola prend un immeuble haussmannien du Paris en transformation sous Napoléon III et il nous fait découvrir la vie de chaque famille ou habitant de cet ensemble de la Rue de Choiseul. de la loge du concierge aux mansardes des bonnes, en passant par les appartements bourgeois des beaux étages. Pour cela, nous avons pour guide Octave, un jeune marseillais venu chercher fortune à Paris, comme beaucoup d'autres héros de la littérature de cette époque.
Octave découvre cette société bourgeoise parisienne dont les moeurs sont loin d'êtres jolies-jolies ! Les femmes doivent chercher un mari ayant des moyens pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, dépendantes qu'elles sont des hommes. Pilotées par des mères-générales, les stratégies sont mises en place pour trouver le clampin idéal à prendre dans les filets du mariage. Les maris aiment leurs femmes parce qu'elles sont une attache solide, mais ils ont plaisir à prendre maîtresses, qui elles-mêmes abusent de leur position pour soutirer cadeaux, argent et logements à ces maris volages. Certaines femmes, jouant les innocentes, profitent également d'amants. Les bonnes sont vraiment à tout faire et se trouvent très souvent culbutées par leur maître. Situation qu'elles acceptent ou dont elles profitent selon les caractères.
Tout cela se passe dans un esprit Vaudeville, avec des maris/amants qui passent par les escaliers de service ou qui se cachent dans le placard quand Monsieur ou Madame surgit à l'improviste, et au milieu de cette indécence trône l'Hypocrisie. Car on ferme les yeux sur ce que l'on sait et quand l'éclat survient, il convient de rapidement mettre un mouchoir blanc sur l'évènement.
Encore une fois, Emile Zola nous dépeint une société du second empire laide, où la méchanceté côtoie le vice et où l'innocence est exploitée et salie.
Très bon roman qui m'amènera, d'ici peu, à suivre Octave dans la suite, Au bonheur des dames.
Un Pot-Bouille qui m'a fait pensé, par son principe, à La vie Mode d'emploi de Georges Pérec. Zola prend un immeuble haussmannien du Paris en transformation sous Napoléon III et il nous fait découvrir la vie de chaque famille ou habitant de cet ensemble de la Rue de Choiseul. de la loge du concierge aux mansardes des bonnes, en passant par les appartements bourgeois des beaux étages. Pour cela, nous avons pour guide Octave, un jeune marseillais venu chercher fortune à Paris, comme beaucoup d'autres héros de la littérature de cette époque.
Octave découvre cette société bourgeoise parisienne dont les moeurs sont loin d'êtres jolies-jolies ! Les femmes doivent chercher un mari ayant des moyens pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, dépendantes qu'elles sont des hommes. Pilotées par des mères-générales, les stratégies sont mises en place pour trouver le clampin idéal à prendre dans les filets du mariage. Les maris aiment leurs femmes parce qu'elles sont une attache solide, mais ils ont plaisir à prendre maîtresses, qui elles-mêmes abusent de leur position pour soutirer cadeaux, argent et logements à ces maris volages. Certaines femmes, jouant les innocentes, profitent également d'amants. Les bonnes sont vraiment à tout faire et se trouvent très souvent culbutées par leur maître. Situation qu'elles acceptent ou dont elles profitent selon les caractères.
Tout cela se passe dans un esprit Vaudeville, avec des maris/amants qui passent par les escaliers de service ou qui se cachent dans le placard quand Monsieur ou Madame surgit à l'improviste, et au milieu de cette indécence trône l'Hypocrisie. Car on ferme les yeux sur ce que l'on sait et quand l'éclat survient, il convient de rapidement mettre un mouchoir blanc sur l'évènement.
Encore une fois, Emile Zola nous dépeint une société du second empire laide, où la méchanceté côtoie le vice et où l'innocence est exploitée et salie.
Très bon roman qui m'amènera, d'ici peu, à suivre Octave dans la suite, Au bonheur des dames.
Féroce ! C'est le mot qui me vient à l'esprit dès les premiers chapitres du livre. le roman aborde des thèmes qui sont « dans l'air du temps », mais on sent tout de suite que Zola n'a aucune sympathie pour ses personnages, et qu'il va tirer à boulets rouges sur ce microcosme que constitue l'immeuble de la rue de Choiseul, dans lequel l'intrigue se situe tout entière.
Nous voici chez les Josserand : un couple dont le principal souci est de trouver des maris pour ses deux filles. Cela vous rappelle peut-être un autre roman ? Oui, « Orgueil et préjugés », de Jane Austen ! Mais la similitude s'arrête bien vite : le ton du roman anglais est plutôt léger et élégant, éclairé par l'humour de Mr. Benett. Ici, rien de tel, Mme Josserand est obsédée par le besoin de trouver des mariages avantageux, de faire cracher la dot par son frère, alors que son mari, complètement dépassé, en est réduit à passer ses nuits à copier des adresses pour combler les besoins du ménage qui vit au-dessus de ses moyens. Elle a clamé au début du livre sa doctrine :
« Dans la vie, il n'y a que les plus honteux qui perdent. L'argent est l'argent : quand on n'en a pas, le plus court est de se coucher. Moi, lorsque j'ai eu vingt sous, j'ai toujours dit que j'en avais quarante ; car toute la sagesse est là, il vaut mieux faire envie que pitié… On a beau avoir reçu de l'instruction, si l'on n'est pas bien mis, les gens vous méprisent. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi… Je porterais plutôt des jupons sales qu'une robe d'indienne. Mangez des pommes de terre, mais ayez un poulet, quand vous avez du monde à dîner… Et ceux qui disent le contraire sont des imbéciles ! »
Et elle a si bien inculqué cette doctrine à sa famille, que sa fille Berthe, mal mariée à Auguste, reprend la même formulation mot pour mot.
Et puis le principal personnage, Octave Mouret, qui est-il ? le frère de l'abbé Mouret, que nous avons suivi cinq volumes plus tôt, dans son délire mystique … mais Octave n'a rien d'un religieux, il est terrestre et charnel. Son projet ? Venir de Plassans à Paris pour faire fortune, en utilisant les femmes. Voilà qui rappelle un autre héros romantique, un certain Julien Sorel … mais Octave est bien loin de tenir la comparaison. C'est un séducteur besogneux, qui échoue dans ses premières tentatives, et doit se contenter de la conquête peu glorieuse de la douce et insignifiante Marie, sa voisine. Il vise ensuite un peu plus haut avec la femme de son patron, Berthe. Mais il y a peu de sentiment dans tout cela, et lorsque Octave arrive à « conclure » avec chacune de ses maîtresses, il se soucie bien peu de savoir si la dame est vraiment consentante…
L'immeuble de la rue de Choiseul symbolise la vision de Zola sur la société bourgeoise de son temps. Il y a l'escalier principal, là où résident le propriétaire et les familles importantes, avec tapis rouge et portes d'acajou… jusqu'au troisième étage ; après, on reste dans la bourgeoisie, mais à un niveau inférieur, et le tapis est « une simple toile grise ». Puis, il y a l'escalier de service, celui des bonnes et des domestiques, celui dans lequel se glissent les messieurs bourgeois en quête d'aventures. C'est l'accès au « monde du dessous », là où les serviteurs mettent à nu la vulgarité et la rapacité de leurs maîtres dans des conversations sans pitié. Monsieur Gourd, le concierge, règne en petit chef sur l'immeuble, et veille à entretenir par-dessus tout l'image du bon ordre bourgeois, quitte à martyriser les plus faibles.
Dans les volumes précédents des Rougon-Macquart, j'ai souvent évoqué, pour caractériser la manière dont Zola décrit les lieux et les ambiances, les tableaux des impressionnistes : Manet, Renoir, Degas … Mais ici, les descriptions évoquent bien plus les rudes caricaturistes que furent Daumier ou Gavarni. le trait est simple et direct, les personnages sont sans nuances, et tous plutôt antipathiques.
A la fin du volume, alors que la bonne Adèle se remet à grand'peine de son accouchement clandestin, Octave semble être parvenu à ses fins en ayant enfin épousé Madame Hédouin, la patronne du magasin « Au bonheur des dames ». Et la domestique Julie conclut sur un constat : « …Celle-ci ou celle-là, toutes les baraques se ressemblent. Au jour d'aujourd'hui, qui a fait l'une a fait l'autre. C'est cochon et compagnie. »
Nous voici chez les Josserand : un couple dont le principal souci est de trouver des maris pour ses deux filles. Cela vous rappelle peut-être un autre roman ? Oui, « Orgueil et préjugés », de Jane Austen ! Mais la similitude s'arrête bien vite : le ton du roman anglais est plutôt léger et élégant, éclairé par l'humour de Mr. Benett. Ici, rien de tel, Mme Josserand est obsédée par le besoin de trouver des mariages avantageux, de faire cracher la dot par son frère, alors que son mari, complètement dépassé, en est réduit à passer ses nuits à copier des adresses pour combler les besoins du ménage qui vit au-dessus de ses moyens. Elle a clamé au début du livre sa doctrine :
« Dans la vie, il n'y a que les plus honteux qui perdent. L'argent est l'argent : quand on n'en a pas, le plus court est de se coucher. Moi, lorsque j'ai eu vingt sous, j'ai toujours dit que j'en avais quarante ; car toute la sagesse est là, il vaut mieux faire envie que pitié… On a beau avoir reçu de l'instruction, si l'on n'est pas bien mis, les gens vous méprisent. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi… Je porterais plutôt des jupons sales qu'une robe d'indienne. Mangez des pommes de terre, mais ayez un poulet, quand vous avez du monde à dîner… Et ceux qui disent le contraire sont des imbéciles ! »
Et elle a si bien inculqué cette doctrine à sa famille, que sa fille Berthe, mal mariée à Auguste, reprend la même formulation mot pour mot.
Et puis le principal personnage, Octave Mouret, qui est-il ? le frère de l'abbé Mouret, que nous avons suivi cinq volumes plus tôt, dans son délire mystique … mais Octave n'a rien d'un religieux, il est terrestre et charnel. Son projet ? Venir de Plassans à Paris pour faire fortune, en utilisant les femmes. Voilà qui rappelle un autre héros romantique, un certain Julien Sorel … mais Octave est bien loin de tenir la comparaison. C'est un séducteur besogneux, qui échoue dans ses premières tentatives, et doit se contenter de la conquête peu glorieuse de la douce et insignifiante Marie, sa voisine. Il vise ensuite un peu plus haut avec la femme de son patron, Berthe. Mais il y a peu de sentiment dans tout cela, et lorsque Octave arrive à « conclure » avec chacune de ses maîtresses, il se soucie bien peu de savoir si la dame est vraiment consentante…
L'immeuble de la rue de Choiseul symbolise la vision de Zola sur la société bourgeoise de son temps. Il y a l'escalier principal, là où résident le propriétaire et les familles importantes, avec tapis rouge et portes d'acajou… jusqu'au troisième étage ; après, on reste dans la bourgeoisie, mais à un niveau inférieur, et le tapis est « une simple toile grise ». Puis, il y a l'escalier de service, celui des bonnes et des domestiques, celui dans lequel se glissent les messieurs bourgeois en quête d'aventures. C'est l'accès au « monde du dessous », là où les serviteurs mettent à nu la vulgarité et la rapacité de leurs maîtres dans des conversations sans pitié. Monsieur Gourd, le concierge, règne en petit chef sur l'immeuble, et veille à entretenir par-dessus tout l'image du bon ordre bourgeois, quitte à martyriser les plus faibles.
Dans les volumes précédents des Rougon-Macquart, j'ai souvent évoqué, pour caractériser la manière dont Zola décrit les lieux et les ambiances, les tableaux des impressionnistes : Manet, Renoir, Degas … Mais ici, les descriptions évoquent bien plus les rudes caricaturistes que furent Daumier ou Gavarni. le trait est simple et direct, les personnages sont sans nuances, et tous plutôt antipathiques.
A la fin du volume, alors que la bonne Adèle se remet à grand'peine de son accouchement clandestin, Octave semble être parvenu à ses fins en ayant enfin épousé Madame Hédouin, la patronne du magasin « Au bonheur des dames ». Et la domestique Julie conclut sur un constat : « …Celle-ci ou celle-là, toutes les baraques se ressemblent. Au jour d'aujourd'hui, qui a fait l'une a fait l'autre. C'est cochon et compagnie. »
Octave Mouret arrive de Plassans à Paris avec pour objectif de « réussir » grâce aux femmes. Il se fait embaucher comme commis dans un magasin de tissus. Il habite une chambre qu'il loue dans un immeuble bourgeois. Sa vie amoureuse n'est qu'un prétexte pour suivre la vie des habitants de cet immeuble, entre vertu affichée et vices cachés.
Finalement Octave subit les caprices de ces femmes et on s'aperçoit que ce sont elles qui ont le vrai pouvoir, sur lui, sur leurs maris et en fait sur leurs vies.
Je suis une fan inconditionnelle de Zola et de son écriture. Dans ce roman, la scène du mariage de Berthe, perturbé par la découverte par Théophile de l'adultère de sa femme, est succulente. Je me croyais au cinéma : Zola balade son lecteur d'un coin de l'église à l'autre, comme le ferait une caméra.
Ce n'est pas le meilleur des Rougon-Macquart, mais l'observation des moeurs bourgeoises de cette époque est si croustillante que ce volume vaut la peine d'être lu.
Finalement Octave subit les caprices de ces femmes et on s'aperçoit que ce sont elles qui ont le vrai pouvoir, sur lui, sur leurs maris et en fait sur leurs vies.
Je suis une fan inconditionnelle de Zola et de son écriture. Dans ce roman, la scène du mariage de Berthe, perturbé par la découverte par Théophile de l'adultère de sa femme, est succulente. Je me croyais au cinéma : Zola balade son lecteur d'un coin de l'église à l'autre, comme le ferait une caméra.
Ce n'est pas le meilleur des Rougon-Macquart, mais l'observation des moeurs bourgeoises de cette époque est si croustillante que ce volume vaut la peine d'être lu.
C'est avec Pot-Bouille que j'entame ma découverte d'Émile Zola. Je commencerai par dire que son écriture est remarquable. Ses descriptifs sont loin de desservir le récit, de l'alourdir ou même de le ralentir. C'est un roman qui ne fait pas dans la finesse ! Il ne prend aucune pincette pour nous dévoiler la petite bourgeoisie parisienne. Cet immeuble, dans lequel ils cohabitent, n'est autre que le reflet de leur société. le paraitre avant tout ! Ce petit monde s'emploie à entretenir des apparences lisses et vertueuse alors que l'adultère est monnaie-courante à chaque étage. L'auteur se permet même un clin d'oeil à sa propre personne. Et pour agrémenter le tout, le récit est parsemé de pointe d'humour très révélatrices de sa pensée. Ce roman reste très actuel, malgré son époque, si l'on fait le parallèle avec les réseaux sociaux qui sont eux aussi le sanctuaire des apparences, de l'hypocrisie et des vices en tout genre.
Pot-Bouille traine dans ma PAL depuis bien trop longtemps et je suis contente de l'en avoir sorti grâce à cette lecture commune organisée sur Livraddict par Mypianocanta.
Quel plaisir de retrouver Zola et sa plume si particulière, ses descriptions qui vous font revivre toute une époque. Il dresse ici le portrait d'une maison bourgeoise qui se veut respectable au premier abord. On y découvre les différentes familles qui y vivent et on pénètre dans leur intimité. Leurs petits secrets sont révélés et l'hypocrisie bourgeoise trône en grande place. C'est un portrait sans concession, parfois cruel et l'auteur ne mâche pas ses mots puisque tout y passe : mariage arrangé, problème financier, adultère….
Personnages très intéressants, surtout dans l'opposition bourgeois et domesticité. C'est un peu comme dans un épisode de Downtown abbey mais en bien plus cru. Les domestiques ne mâchent pas leurs mots et ne se font aucun cadeau.
Un Zola très moderne, avec des scènes de sexe que j'ai trouvé osé pour l'époque. J'ai aussi été impressionné par la scène de l'accouchement qui est incroyablement bien décrit venant de la plume d'un homme. Pourtant, on sent que le point de vue d'un homme de son temps quand a la description générale des femmes qui semblent toutes futiles et faibles.
Une petite déception en ce qui concerne la fin. J'attendais un événement, un retournement de situation et finalement tout ça retombe un peu comme un soufflé.
Lien : https://missmolko1.blogspot...
Quel plaisir de retrouver Zola et sa plume si particulière, ses descriptions qui vous font revivre toute une époque. Il dresse ici le portrait d'une maison bourgeoise qui se veut respectable au premier abord. On y découvre les différentes familles qui y vivent et on pénètre dans leur intimité. Leurs petits secrets sont révélés et l'hypocrisie bourgeoise trône en grande place. C'est un portrait sans concession, parfois cruel et l'auteur ne mâche pas ses mots puisque tout y passe : mariage arrangé, problème financier, adultère….
Personnages très intéressants, surtout dans l'opposition bourgeois et domesticité. C'est un peu comme dans un épisode de Downtown abbey mais en bien plus cru. Les domestiques ne mâchent pas leurs mots et ne se font aucun cadeau.
Un Zola très moderne, avec des scènes de sexe que j'ai trouvé osé pour l'époque. J'ai aussi été impressionné par la scène de l'accouchement qui est incroyablement bien décrit venant de la plume d'un homme. Pourtant, on sent que le point de vue d'un homme de son temps quand a la description générale des femmes qui semblent toutes futiles et faibles.
Une petite déception en ce qui concerne la fin. J'attendais un événement, un retournement de situation et finalement tout ça retombe un peu comme un soufflé.
Lien : https://missmolko1.blogspot...
Un de seuls tomes de la série Rougon-Macquart que je n'avais pas lu. J'ai beaucoup aimé cette intrigue avec tous les personnages. Il y a certains moments j'ai décroché: manque de temps (avec 2 enfants ce n'est pas étonnant). Je vais continuer de lire la série car Zola reste toujours un incontournable.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Madame est servie !
Gwen21
66 livres

Les maisons, corps et âme
HundredDreams
127 livres
Autres livres de Émile Zola (295)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les personnages des Rougon Macquart
Dans l'assommoir, quelle est l'infirmité qui touche Gervaise dès la naissance
Elle est alcoolique
Elle boîte
Elle est myope
Elle est dépensière
7 questions
594 lecteurs ont répondu
Thème :
Émile ZolaCréer un quiz sur ce livre594 lecteurs ont répondu