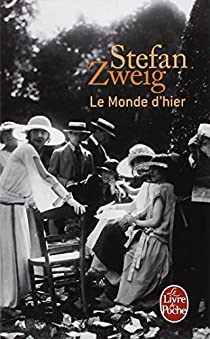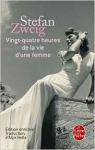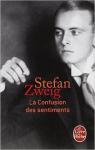Plus de 500 pages écrites serrées, 175'000 mots, c'est un des plus gros pavés de la littérature classique, et aussi l'un des meilleurs, en tout cas le plus parfait à mes yeux.
Il faut être fou pour mettre autre chose qu'un 5/5.
Il faut être fou pour mettre autre chose qu'un 5/5.
S. Zweig jette un regard lucide sur le monde qu'il a connu et vu évoluer, du début du XXème siècle jusqu'à ce qu'il vivait comme l'effondrement de la civilisation humaniste, avec la montée du nazisme et les horreurs de la deuxième guerre mondiale. Certaines descriptions sont émouvantes, comme l'observation fortuite, à la frontière autrichienne, du train du dernier Empereur, forcé de quitter son pays après la ruine de la première guerre mondiale.
Le Monde d'hier, livre testament autobiographique, débuté en septembre 1939, montre que Stefan Zweig en tant qu'écrivain juif autrichien, humaniste et pacifique, fut le témoin malmené d'une époque sismique.
Stefan Zweig qui débute son récit par Vienne aux temps heureux, avant la grande Guerre, quand la ville était tournée vers la création artistique la plus exigeante. Un dynamisme culturel soutenu par la bourgeoisie juive fortunée, polyglotte et cultivée dont Zweig faisait partie avec ses amis, tous assoiffés d'un renouveau artistique mais attachés à un conservatisme politique.
Une situation politique et sociale en apparence immuable bientôt bousculée par l'apparition d'un parti socialiste autrichien auquel s'opposent un parti chrétien-social, petit bourgeois et antisémite, et plus anti juif encore, un parti national-allemand agressif, dont Hitler devait reprendre les méthodes brutales et la théorie raciale antisémite : « La saloperie c'est la race ».
A l'époque Zweig, étudiant en philosophie, n'est pas encore sensible à ce danger émergent. Il commence à publier et est heureux de cette reconnaissance. Mais la découverte de Berlin de ses idées nouvelles et de son atmosphère épicée le poussent à se remettre en cause ; il décide de « commencer par apprendre du monde ce qu'il a d'essentiel ». Il traduit Baudelaire, Verlaine, Keats, voyage en Europe, en Inde en Amérique en Afrique, découvre Émile Verhaeren dont l'enthousiasme pour le monde moderne le fascine, devient l'ami de Paul Valéry, Romain Rolland, Rilke, qu'il admire profondément, et de tant d'autres.
Une curiosité et une quête intellectuelles qui ne se démentiront jamais au cours de sa vie. Mais si Stefan Zweig témoigne de joies incomparables, de rencontres et de lectures merveilleuses, de voyages oh combien enrichissants, qui furent les siens pendant cinquante ans, les ouragans du monde, avec le gâchis de 1914, l'effondrement de l'empire austro-hongrois, les épouvantables régimes nationalistes et le sort inique qu'ils ont réservé aux juifs, auront raison de tout cela, et par conséquent de son envie de vivre. Et c'est assez émouvant.
Challenge MULTI-DÉFIS 2020
Stefan Zweig qui débute son récit par Vienne aux temps heureux, avant la grande Guerre, quand la ville était tournée vers la création artistique la plus exigeante. Un dynamisme culturel soutenu par la bourgeoisie juive fortunée, polyglotte et cultivée dont Zweig faisait partie avec ses amis, tous assoiffés d'un renouveau artistique mais attachés à un conservatisme politique.
Une situation politique et sociale en apparence immuable bientôt bousculée par l'apparition d'un parti socialiste autrichien auquel s'opposent un parti chrétien-social, petit bourgeois et antisémite, et plus anti juif encore, un parti national-allemand agressif, dont Hitler devait reprendre les méthodes brutales et la théorie raciale antisémite : « La saloperie c'est la race ».
A l'époque Zweig, étudiant en philosophie, n'est pas encore sensible à ce danger émergent. Il commence à publier et est heureux de cette reconnaissance. Mais la découverte de Berlin de ses idées nouvelles et de son atmosphère épicée le poussent à se remettre en cause ; il décide de « commencer par apprendre du monde ce qu'il a d'essentiel ». Il traduit Baudelaire, Verlaine, Keats, voyage en Europe, en Inde en Amérique en Afrique, découvre Émile Verhaeren dont l'enthousiasme pour le monde moderne le fascine, devient l'ami de Paul Valéry, Romain Rolland, Rilke, qu'il admire profondément, et de tant d'autres.
Une curiosité et une quête intellectuelles qui ne se démentiront jamais au cours de sa vie. Mais si Stefan Zweig témoigne de joies incomparables, de rencontres et de lectures merveilleuses, de voyages oh combien enrichissants, qui furent les siens pendant cinquante ans, les ouragans du monde, avec le gâchis de 1914, l'effondrement de l'empire austro-hongrois, les épouvantables régimes nationalistes et le sort inique qu'ils ont réservé aux juifs, auront raison de tout cela, et par conséquent de son envie de vivre. Et c'est assez émouvant.
Challenge MULTI-DÉFIS 2020
Un sot dans le temps autobiographique vertigineux. le plus grand écrivain de langue allemande du XXe siècle nous livre, au seuil de son suicide en 1941, un témoignage sans équivalent des bouleversements du temps. Dès la préface, on est frappé par la raisonnance actuelle de certaines de ses analyses sur l'idée du progrès, de la mondialisation et des enjeux de l'accélération croissante de la communication et de l'information. Une plongée sans égale, à la croisée des siècles industriels, qui nous porte inévitablement à questionner notre époque.
Si seulement un auteur pouvait aujourd'hui décrire comme lui l'insouciance d'une fin de siècle, et les prémices des catastrophes à venir. Ce basculement, cet aveuglement des élites, au croisement de l'histoire, de l'art, de la politique internationale, des amitiés intellectuelles. Puis surgit la première guerre, avec une rumeur et rapidement la folie collective qui emporte tout. Comme Zweig, on se sent attaché sur les rails et à l'horizon fonce un monstre mécanique et hurlant. Un témoignage humaniste, essentiel pour comprendre hier. Et peut-être un peu éclairer aujourd'hui..
Les souvenirs de l'auteur d'Amok et de la Lettre d'un inconnu, écrits, semble-t-il, d'un jet à la veille de son suicide au Brésil, ne sauraient laisser indifférents. Outre les circonstances et le style (remarquablement mis en valeur par la traduction de Jean-Paul Zimmermann, même si l'édition des Belles Lettres déçoit par le nombre de coquilles et la pauvreté de la reliure), l'intérêt du Monde d'Hier réside, comme l'a voulu l'écrivain, dans la fresque historique et sociale que brossent ces confessions qui n'en sont pas. du coup, le genre diariste flirte avec l'essai, une des spécialités du romancier avec la biographie et la nouvelle. On traverse avec fulgurance Vienne à la Belle Epoque, la chute de l'empire austro-hongrois et la montée du nazisme, tout en parcourant le monde au gré des voyages de l'auteur.
Cela faisait longtemps que je n'avais lu Zweig et j'ai retrouvé avec bonheur sa passion communicative, ce feu qui consume si bien que l'on ne peut lâcher l'ouvrage avant la fin. Dans un dernier retour sur sa méthode, le romancier autrichien dévoile d'ailleurs les secrets de cette flamme qu'il alimente sciemment : loin de jeter sur le papier tous ses affects, il avoue n'éprouver aucunement la même impatience que son lecteur, mais se concentrer au contraire sur l'élision, la coupure ; la concision est son ressort. le meilleur moment de l'écriture est pour lui celui de tailler dans la masse, pour se concentrer sur l'essentiel. A la façon d'un sculpteur, donc, et l'on savourera la description fameuse de sa rencontre avec Rodin - de même que toutes les pages consacrées au Paris d'avant 1914, entre toutes...
Le sentiment amer d'un créateur rejeté sur le rivage par son époque tumultueuse prend une dimension épique dans ces mémoires d'une haute ambition. Rarement la conjonction de l'individuel et du collectif, de la personne et de l'Histoire atteint le degré d'intime union qui se manifeste là, et en quittant le Monde d'Hier l'admiration le dispute aux regrets.
Cela faisait longtemps que je n'avais lu Zweig et j'ai retrouvé avec bonheur sa passion communicative, ce feu qui consume si bien que l'on ne peut lâcher l'ouvrage avant la fin. Dans un dernier retour sur sa méthode, le romancier autrichien dévoile d'ailleurs les secrets de cette flamme qu'il alimente sciemment : loin de jeter sur le papier tous ses affects, il avoue n'éprouver aucunement la même impatience que son lecteur, mais se concentrer au contraire sur l'élision, la coupure ; la concision est son ressort. le meilleur moment de l'écriture est pour lui celui de tailler dans la masse, pour se concentrer sur l'essentiel. A la façon d'un sculpteur, donc, et l'on savourera la description fameuse de sa rencontre avec Rodin - de même que toutes les pages consacrées au Paris d'avant 1914, entre toutes...
Le sentiment amer d'un créateur rejeté sur le rivage par son époque tumultueuse prend une dimension épique dans ces mémoires d'une haute ambition. Rarement la conjonction de l'individuel et du collectif, de la personne et de l'Histoire atteint le degré d'intime union qui se manifeste là, et en quittant le Monde d'Hier l'admiration le dispute aux regrets.
Comme on le sait, Zweig a rédigé cette autobiographie en 1941, après avoir été chassé d'Europe par l'antisémitisme et la guerre. Devenu apatride avec l'Anschluss, il s'est d'abord réfugié au Royaume-Uni avant de s'installer finalement au Brésil. Lorsqu'il écrit ces mémoires, il a pratiquement tout abandonné derrière lui hormis son nom, ce qui n'est évidemment pas rien pour quelqu'un qui est déjà célébré comme l'un des plus grands écrivains de son temps.
A mesure que l'on avance dans la lecture du Monde d'hier, on sent l'immense lassitude et le désespoir pesant sur cet homme, qui se disait citoyen du monde à une époque où l'expression n'avait hélas aucun sens (en a-t-elle davantage aujourd'hui, à vrai dire...). Zweig s'est suicidé au début de 1942, juste après avoir envoyé le manuscrit à son éditeur, et un mois à peine après la conférence de Wannsee où venait de se sceller le sort des juifs européens. L'écrivain n'a évidemment rien su de ce dernier événement, mais il suffit de lire son texte pour comprendre qu'il redoutait l'innommable et qu'il ne voulait pas le voir advenir.
Son livre est comme un testament de la culture européenne. C'est le récit très simple de ses soixante années d'existence, moitié autobiographie moitié analyse des évolutions internationales. Zweig appartient à une génération qui a traversé un nombre effarant d'épreuves collectives : né dans « le monde de la sécurité » (Vienne dans les dernières décennies des Habsbourg), il a vu son pays se précipiter dans la guerre en 1914. L'épuisement, la défaite, la ruine, le chaos économique et monétaire d'après-guerre, la montée de l'antisémitisme, la progression du fascisme, l'expansionnisme hitlérien, la capitulation des démocraties occidentales, les persécutions puis une nouvelle guerre... Tout cela, Zweig le raconte, mais de son point de vue. Or il ne faut pas oublier, sous peine de contresens, que son point de vue est celui d'un bourgeois issu d'une riche famille juive de Vienne. Il est parfaitement conscient d'appartenir à un monde privilégié et ne cherche pas à le dissimuler : sa première guerre mondiale ne se déroule pas dans les tranchées et il n'est que spectateur de la misère des autres. Je ne vois cependant pas ce que cela enlève à la valeur de son témoignage ni à son caractère poignant, ni à la sincérité de son émotion et de son effroi.
Il a certes fréquenté quelques-uns des esprits les plus brillants du premier vingtième siècle (et son livre fourmille de portraits d'écrivains et artistes pris sur le vif, parfois assez étonnants), mais Zweig porte surtout un regard très lucide sur le naufrage collectif de l'Europe. C'est la partie qui m'a le plus impressionné, sans doute par déformation professionnelle. J'avais initialement le projet de distiller des citations au fil de ma lecture mais j'y aurais mis au moins le tiers du livre. Alors je me suis abstenu, et en fait je n'ai pas besoin de dire plus que cela : il faut lire ce livre. Surtout aujourd'hui, à l'heure où la Bête, qui ne dort jamais que d'un oeil, manifeste à nouveau les signes de son éveil.
A mesure que l'on avance dans la lecture du Monde d'hier, on sent l'immense lassitude et le désespoir pesant sur cet homme, qui se disait citoyen du monde à une époque où l'expression n'avait hélas aucun sens (en a-t-elle davantage aujourd'hui, à vrai dire...). Zweig s'est suicidé au début de 1942, juste après avoir envoyé le manuscrit à son éditeur, et un mois à peine après la conférence de Wannsee où venait de se sceller le sort des juifs européens. L'écrivain n'a évidemment rien su de ce dernier événement, mais il suffit de lire son texte pour comprendre qu'il redoutait l'innommable et qu'il ne voulait pas le voir advenir.
Son livre est comme un testament de la culture européenne. C'est le récit très simple de ses soixante années d'existence, moitié autobiographie moitié analyse des évolutions internationales. Zweig appartient à une génération qui a traversé un nombre effarant d'épreuves collectives : né dans « le monde de la sécurité » (Vienne dans les dernières décennies des Habsbourg), il a vu son pays se précipiter dans la guerre en 1914. L'épuisement, la défaite, la ruine, le chaos économique et monétaire d'après-guerre, la montée de l'antisémitisme, la progression du fascisme, l'expansionnisme hitlérien, la capitulation des démocraties occidentales, les persécutions puis une nouvelle guerre... Tout cela, Zweig le raconte, mais de son point de vue. Or il ne faut pas oublier, sous peine de contresens, que son point de vue est celui d'un bourgeois issu d'une riche famille juive de Vienne. Il est parfaitement conscient d'appartenir à un monde privilégié et ne cherche pas à le dissimuler : sa première guerre mondiale ne se déroule pas dans les tranchées et il n'est que spectateur de la misère des autres. Je ne vois cependant pas ce que cela enlève à la valeur de son témoignage ni à son caractère poignant, ni à la sincérité de son émotion et de son effroi.
Il a certes fréquenté quelques-uns des esprits les plus brillants du premier vingtième siècle (et son livre fourmille de portraits d'écrivains et artistes pris sur le vif, parfois assez étonnants), mais Zweig porte surtout un regard très lucide sur le naufrage collectif de l'Europe. C'est la partie qui m'a le plus impressionné, sans doute par déformation professionnelle. J'avais initialement le projet de distiller des citations au fil de ma lecture mais j'y aurais mis au moins le tiers du livre. Alors je me suis abstenu, et en fait je n'ai pas besoin de dire plus que cela : il faut lire ce livre. Surtout aujourd'hui, à l'heure où la Bête, qui ne dort jamais que d'un oeil, manifeste à nouveau les signes de son éveil.
Je reçois ce récit quelques avertissements. Premièrement, aucun progrès n'est jamais acquis. Zweig écrit: «J'ai dû être le témoin impuissant et sans défenses de l'inimaginable régression de l'humanité à un état de barbarie qu'on croyait avoir oublié depuis longtemps.» Deuxièmement, la régression se produit imperceptiblement. Zweig observe qu'une loi immuable de l'histoire interdit «aux contemporains de discerner dès le début les grands mouvements qui déterminent leur époque». Ainsi s'avoue-t-il incapable de se rappeler quand il a entendu la première fois le nom de Hitler. Troisièmement, la régression agit à coups d'aveuglements, de lâchetés, de compromissions populistes, de minimisation de l'inacceptable.
Témoignage exceptionnel de l'Europe du XIXe siècle !
Stefan Zweig nous retrace son parcours (ses longues études, sa famille juive bourgeoise, ses voyages, la publication de ses premiers textes, sa carrière d'écrivain) sur fond d'histoire européenne (le drame de la première guerre mondiale, les tensions natonalistes, la montée de l'hitlerisme).
Son récit est parsemé de rencontres exceptionnelles et d'anecdotes jouissives.
Zweig nous donne là un livre essentiel, profondément européen, plus que nécessaire aujourd'hui !
Stefan Zweig nous retrace son parcours (ses longues études, sa famille juive bourgeoise, ses voyages, la publication de ses premiers textes, sa carrière d'écrivain) sur fond d'histoire européenne (le drame de la première guerre mondiale, les tensions natonalistes, la montée de l'hitlerisme).
Son récit est parsemé de rencontres exceptionnelles et d'anecdotes jouissives.
Zweig nous donne là un livre essentiel, profondément européen, plus que nécessaire aujourd'hui !
Stefan Zweig n'a plus que quelques heures à vivre quand il poste le manuscrit de son dernier livre.
Davantage que des mémoires, "Le monde d'hier" est un portrait collectif, celui d'une époque et d'une société qui sont piétinées, écrasées par les deux guerres mondiales et les dictatures. En 1941, Stefan Zweig est devenu apatride (il a perdu sa nationalité autrichienne parce que juif), il a perdu sa mère restée à Vienne au moment de l'Anschluss, ses livres sont interdits dans son pays, la plupart de ses amis sont morts.
Mais quelle vie que la sienne ! Elevé dans une famille bourgeoise, il fréquente assidûment les théâtres, l'opéra, à son adolescence il baigne dans une effervescence intellectuelle qui stimule ses ambitions littéraires. Ses succès et son goût des autres l'amènent à fréquenter Romain Rolland, Rodin, Rilke, Freud, Paul Valéry…
Mais des ombres planent sans cesse sur l'Europe : la Grande Guerre à laquelle il échappe car il est déclaré inapte (il confesse avec franchise cependant que l'héroïsme est étranger à sa nature), la montée du nazisme (habitant Salzburg près de la frontière allemande, il devient le voisin bien involontaire de Hitler). pour finir l'annexion de l'Autriche qui l'oblige à s'exiler en Angleterre puis au Brésil.
Ironie de l'histoire, c'est au moment où l'armée allemande connaît ses premiers revers en URSS, et à quelques mois des victoires alliées de Midway et de Bir Hakeim, qu'il met fin à ses jours (le 22 février 42). Evidemment, les raisons qui président à un tel acte ne sont pas seulement d'ordre géopolitique !
On retrouve dans ce livre la passion, l'enthousiasme, la curiosité qu'on lit dans ses nouvelles.
Celle qui fait le plus écho au spleen qui émane des derniers chapitres, est assurément "le bouquiniste Mendel". Une merveille de délicatesse !
Davantage que des mémoires, "Le monde d'hier" est un portrait collectif, celui d'une époque et d'une société qui sont piétinées, écrasées par les deux guerres mondiales et les dictatures. En 1941, Stefan Zweig est devenu apatride (il a perdu sa nationalité autrichienne parce que juif), il a perdu sa mère restée à Vienne au moment de l'Anschluss, ses livres sont interdits dans son pays, la plupart de ses amis sont morts.
Mais quelle vie que la sienne ! Elevé dans une famille bourgeoise, il fréquente assidûment les théâtres, l'opéra, à son adolescence il baigne dans une effervescence intellectuelle qui stimule ses ambitions littéraires. Ses succès et son goût des autres l'amènent à fréquenter Romain Rolland, Rodin, Rilke, Freud, Paul Valéry…
Mais des ombres planent sans cesse sur l'Europe : la Grande Guerre à laquelle il échappe car il est déclaré inapte (il confesse avec franchise cependant que l'héroïsme est étranger à sa nature), la montée du nazisme (habitant Salzburg près de la frontière allemande, il devient le voisin bien involontaire de Hitler). pour finir l'annexion de l'Autriche qui l'oblige à s'exiler en Angleterre puis au Brésil.
Ironie de l'histoire, c'est au moment où l'armée allemande connaît ses premiers revers en URSS, et à quelques mois des victoires alliées de Midway et de Bir Hakeim, qu'il met fin à ses jours (le 22 février 42). Evidemment, les raisons qui président à un tel acte ne sont pas seulement d'ordre géopolitique !
On retrouve dans ce livre la passion, l'enthousiasme, la curiosité qu'on lit dans ses nouvelles.
Celle qui fait le plus écho au spleen qui émane des derniers chapitres, est assurément "le bouquiniste Mendel". Une merveille de délicatesse !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Stefan Zweig (176)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le joueur d'échec de Zweig
Quel est le nom du champion du monde d'échecs ?
Santovik
Czentovick
Czentovic
Zenovic
9 questions
1894 lecteurs ont répondu
Thème : Le Joueur d'échecs de
Stefan ZweigCréer un quiz sur ce livre1894 lecteurs ont répondu