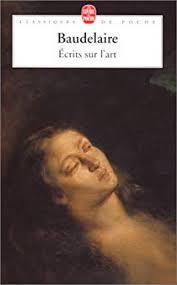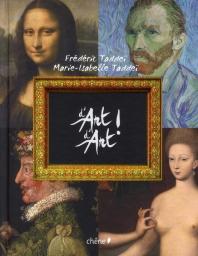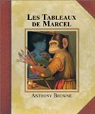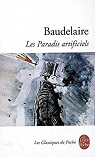Charles Baudelaire
Francis Moulinat (Éditeur scientifique)/5 58 notes
Francis Moulinat (Éditeur scientifique)/5 58 notes
Résumé :
« Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique ; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine ni amour, et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament ; mais, - un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, - celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. [...] Pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la criti... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Ecrits sur l'art Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Ce recueil de tous les écrits sur l'art de Baudelaire, au moins aussi imposant par le nombre de pages que toute son oeuvre poétique, est d'une qualité inégale. le malheur est qu'il commence, comme l'ordre chronologique l'impose, par une introduction assez longue et fastidieuse, c'est-à-dire le compte-rendu du salon de 1845, qui, de tout le livre, est la partie la plus inintéressante ; à peine plus qu'un catalogage. Second bémol, comme Baudelaire n'avait probablement jamais envisagé que tous ces articles pussent être un jour réunis dans un même livre, il y a d'assez nombreuses et rébarbatives répétitions. Malgré tout, l'ensemble reflète assez bien les différents débats qui ont animé la vie artistique française au milieu du dix-neuvième siècle. « Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion) » a écrit Baudelaire dans Mon coeur mis à nu. Iconolâtre dans son adoration de la peinture, il fut aussi iconoclaste dans ses attaques contre la tradition classique. La dualité est une constante dans les critiques artistiques de Baudelaire. Il défend toujours contre. le romantisme contre le classicisme, l'imagination contre le réalisme, les sentiments contre l'idéal, la couleur contre le dessin, le génie contre les ouvriers d'atelier, l'individualité contre la conformité (ce qu'il appelle dédaigneusement le style, le manque de personnalité). Mais, toutes ses prises de position n'ont pratiquement qu'une cause : l'adoration qu'il voue à Delacroix et sa ferveur à l'exalter. Son admiration est sans bornes, c'est le génie du siècle. Il en parle avec passion, à tel point que le peintre et le poète se confondent et, parfois, on ne sait plus si Baudelaire décrit les tableaux de Delacroix ou sa propre oeuvre à venir : « Ce petit poème d'intérieur, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brimborions de toilette, exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondés de la tristesse. En général, il ne peint pas de jolies femmes, au point de vue des gens du monde toutefois. Presque toutes sont malades, et resplendissent d'une certaine beauté intérieure. Il n'exprime point la force par la grosseur des muscles, mais par la tension des nerfs. C'est non seulement la douleur qu'il sait le mieux exprimer, mais surtout, - prodigieux mystère de sa peinture, - la douleur morale ! » On sent Les fleurs du mal en gestation. D'ailleurs à l'occasion, toujours en commentant Delacroix, il n'hésite pas à citer et expliciter les vers « d'un poète dont la sincérité peut faire passer la bizarrerie » qui n'est autre que lui-même. Cependant, s'il soutient indéfectiblement Delacroix contre Ingres, son grand rival (en particulier dans le débat qui consistait à faire d'Ingres un meilleur dessinateur), il reconnait tout de même à ce dernier un « admirable talent » et n'hésite pas à le défendre tant qu'il ne se trouve pas en concurrence avec son champion (voir l'article sur le musée classique du bazar Bonne-Nouvelle). Par contre, il est sans pitié pour les imitateurs de toutes sortes, que ce soit des grands maîtres, des antiquités ou de la nature ; il ne leur pardonne pas leur manque d'imagination. L'art est une affaire de sentiments et un plat imitateur ne peut en aucun cas transmettre des sentiments intimes et sincères. Cette primauté de l'imagination qu'il développe surtout dans le salon de 1859 recoupe en grande partie, il me semble, la notion de naïveté à laquelle il donne beaucoup d'importance dans ses premiers Salons. L'Art, le Beau, est le mélange d'un idéal éternel, insaisissable, et d'une multiplicité de sentiments tout aussi fuyants. D'où la bienveillance de Baudelaire envers les caricaturistes toujours prêts à reproduire, avec un humour satanique, le caractère mouvementé de ses contemporains. Ainsi que son intérêt pour Constantin Guys, peintre de la modernité (et précurseur d'artistes tels que Degas ou Toulouse-Lautrec) qui serait probablement tombé dans l'oubli sans son illustre commentateur. À part ça, il y a dans ces Ecrits sur l'art quelques passages assez savoureux quand Baudelaire se risque à des considérations politiques. Des introductions à ses deux premiers Salons, qui ne sont qu'apologies du bourgeois (rouage essentiel de la société, il est vrai, et accessoirement son lectorat), jusqu'au Salon de 1859 - après une révolution passée sur les barricades et un procès pour atteinte aux bonnes moeurs - où il exprime son envie d'envoyer « son écritoire à la face de l'âme bourgeoise » et « avec une vigueur qu'elle ne soupçonne pas »… tout ça est plutôt drôle.
******
Depuis Diderot, la critique d'art prétend au titre de genre littéraire à part entière.
Baudelaire le sait bien et fait son entrée en 1845 dans la vie littéraire. Grâce à ses Salons, il va gagner une réputation littéraire nouvelle.
Charles ne cesse de fréquenter le Louvre, visite les Salons, devient ami avec les peintres : Courbet brossera son portrait. Pour Baudelaire, la peinture était supérieure aux autres arts plastiques.
Eugène Delacroix, à ses yeux, est le « type du peintre-poète » : l'archétype de l'artiste. C'est à partir de lui que Baudelaire élabore, définit une partie de son esthétique, le peintre de « Sardanapale » exprime tout ce que l'art et l'artiste devaient être.
L'art pour Baudelaire est « le beau exprimé par le sentiment, la passion, la rêverie de chacun ». Il prépare sa propre définition du romantisme. C'est par elle que s'affirment toute l'originalité et la nouveauté de sa critique. Pour lui, le beau devient mouvant. L'art doit épouser le mouvement ondoyant de la sensibilité.
De 1845 à 1859, les idées esthétiques de Baudelaire ne varieront guère pour l'essentiel. La peinture est « une évocation, une opération magique » ; c'est le « langage du rêve ».
En 1855, l'exposition universelle rend hommage aux deux Maîtres de l'art pictural français, Ingres et Delacroix, qui sont les deux derniers grands peintres d'histoire, le romantique de la ligne et le romantique de la couleur. Non loin d'eux le réaliste Gustave Courbet expose dans un pavillon séparé.
Cette année-là l'ensemble des idées de Baudelaire trouve son centre de gravité : l'imagination. « C'est l'imagination qui a enseigné à l'homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. » Pour lui, plus que jamais, Delacroix incarne l'artiste-poète : « les sons tintent musicalement, les couleurs parlent, les parfums racontent des mondes d'idées ».
En 1863, six années après la publication «des « Fleurs de mal » et quatre ans avant sa mort, le poète fait paraître « le peintre de la vie moderne » qui résume et ordonne sa conception.
Paradoxal, prophétique : tel fut Baudelaire au sein du 19e siècle, dans sa poésie comme dans sa critique d'art, qui est à sa manière une oeuvre d'art.
Lien : http://www.httpsilartetaitco..
Depuis Diderot, la critique d'art prétend au titre de genre littéraire à part entière.
Baudelaire le sait bien et fait son entrée en 1845 dans la vie littéraire. Grâce à ses Salons, il va gagner une réputation littéraire nouvelle.
Charles ne cesse de fréquenter le Louvre, visite les Salons, devient ami avec les peintres : Courbet brossera son portrait. Pour Baudelaire, la peinture était supérieure aux autres arts plastiques.
Eugène Delacroix, à ses yeux, est le « type du peintre-poète » : l'archétype de l'artiste. C'est à partir de lui que Baudelaire élabore, définit une partie de son esthétique, le peintre de « Sardanapale » exprime tout ce que l'art et l'artiste devaient être.
L'art pour Baudelaire est « le beau exprimé par le sentiment, la passion, la rêverie de chacun ». Il prépare sa propre définition du romantisme. C'est par elle que s'affirment toute l'originalité et la nouveauté de sa critique. Pour lui, le beau devient mouvant. L'art doit épouser le mouvement ondoyant de la sensibilité.
De 1845 à 1859, les idées esthétiques de Baudelaire ne varieront guère pour l'essentiel. La peinture est « une évocation, une opération magique » ; c'est le « langage du rêve ».
En 1855, l'exposition universelle rend hommage aux deux Maîtres de l'art pictural français, Ingres et Delacroix, qui sont les deux derniers grands peintres d'histoire, le romantique de la ligne et le romantique de la couleur. Non loin d'eux le réaliste Gustave Courbet expose dans un pavillon séparé.
Cette année-là l'ensemble des idées de Baudelaire trouve son centre de gravité : l'imagination. « C'est l'imagination qui a enseigné à l'homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. » Pour lui, plus que jamais, Delacroix incarne l'artiste-poète : « les sons tintent musicalement, les couleurs parlent, les parfums racontent des mondes d'idées ».
En 1863, six années après la publication «des « Fleurs de mal » et quatre ans avant sa mort, le poète fait paraître « le peintre de la vie moderne » qui résume et ordonne sa conception.
Paradoxal, prophétique : tel fut Baudelaire au sein du 19e siècle, dans sa poésie comme dans sa critique d'art, qui est à sa manière une oeuvre d'art.
Lien : http://www.httpsilartetaitco..
*******
Je reprends ci-dessous, la critique que j'ai faite pour l'édition améliorée du livre (bibliographie, notes, chronologie, etc.) des Ecrits sur l'art de Charles Baudelaire parue en 2012. le reste des critiques d'art du poète sont évidemment les mêmes dans les deux livres.
Depuis Diderot, la critique d'art prétend au titre de genre littéraire à part entière.
Baudelaire le sait bien et fait son entrée en 1845 dans la vie littéraire. Grâce à ses Salons, il va gagner une réputation littéraire nouvelle.
Charles ne cesse de fréquenter le Louvre, visite les Salons, devient ami avec les peintres : Courbet brossera son portrait. Pour Baudelaire, la peinture était supérieure aux autres arts plastiques.
Eugène Delacroix, à ses yeux, est le « type du peintre-poète » : l'archétype de l'artiste. C'est à partir de lui que Baudelaire élabore, définit une partie de son esthétique, le peintre de « Sardanapale » exprime tout ce que l'art et l'artiste devaient être.
L'art pour Baudelaire est « le beau exprimé par le sentiment, la passion, la rêverie de chacun ». Il prépare sa propre définition du romantisme. C'est par elle que s'affirment toute l'originalité et la nouveauté de sa critique. Pour lui, le beau devient mouvant. L'art doit épouser le mouvement ondoyant de la sensibilité.
De 1845 à 1859, les idées esthétiques de Baudelaire ne varieront guère pour l'essentiel. La peinture est « une évocation, une opération magique » ; c'est le « langage du rêve ».
En 1855, l'exposition universelle rend hommage aux deux Maîtres de l'art pictural français, Ingres et Delacroix, qui sont les deux derniers grands peintres d'histoire, le romantique de la ligne et le romantique de la couleur. Non loin d'eux le réaliste Gustave Courbet expose dans un pavillon séparé.
Cette année-là l'ensemble des idées de Baudelaire trouve son centre de gravité : l'imagination. « C'est l'imagination qui a enseigné à l'homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. » Pour lui, plus que jamais, Delacroix incarne l'artiste-poète : « les sons tintent musicalement, les couleurs parlent, les parfums racontent des mondes d'idées ».
En 1863, six années après la publication «des « Fleurs de mal » et quatre ans avant sa mort, le poète fait paraître « le peintre de la vie moderne » qui résume et ordonne sa conception.
Paradoxal, prophétique : tel fut Baudelaire au sein du 19e siècle, dans sa poésie comme dans sa critique d'art, qui est à sa manière une oeuvre d'art.
Lien : http://www.httpsilartetaitco..
Je reprends ci-dessous, la critique que j'ai faite pour l'édition améliorée du livre (bibliographie, notes, chronologie, etc.) des Ecrits sur l'art de Charles Baudelaire parue en 2012. le reste des critiques d'art du poète sont évidemment les mêmes dans les deux livres.
Depuis Diderot, la critique d'art prétend au titre de genre littéraire à part entière.
Baudelaire le sait bien et fait son entrée en 1845 dans la vie littéraire. Grâce à ses Salons, il va gagner une réputation littéraire nouvelle.
Charles ne cesse de fréquenter le Louvre, visite les Salons, devient ami avec les peintres : Courbet brossera son portrait. Pour Baudelaire, la peinture était supérieure aux autres arts plastiques.
Eugène Delacroix, à ses yeux, est le « type du peintre-poète » : l'archétype de l'artiste. C'est à partir de lui que Baudelaire élabore, définit une partie de son esthétique, le peintre de « Sardanapale » exprime tout ce que l'art et l'artiste devaient être.
L'art pour Baudelaire est « le beau exprimé par le sentiment, la passion, la rêverie de chacun ». Il prépare sa propre définition du romantisme. C'est par elle que s'affirment toute l'originalité et la nouveauté de sa critique. Pour lui, le beau devient mouvant. L'art doit épouser le mouvement ondoyant de la sensibilité.
De 1845 à 1859, les idées esthétiques de Baudelaire ne varieront guère pour l'essentiel. La peinture est « une évocation, une opération magique » ; c'est le « langage du rêve ».
En 1855, l'exposition universelle rend hommage aux deux Maîtres de l'art pictural français, Ingres et Delacroix, qui sont les deux derniers grands peintres d'histoire, le romantique de la ligne et le romantique de la couleur. Non loin d'eux le réaliste Gustave Courbet expose dans un pavillon séparé.
Cette année-là l'ensemble des idées de Baudelaire trouve son centre de gravité : l'imagination. « C'est l'imagination qui a enseigné à l'homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. » Pour lui, plus que jamais, Delacroix incarne l'artiste-poète : « les sons tintent musicalement, les couleurs parlent, les parfums racontent des mondes d'idées ».
En 1863, six années après la publication «des « Fleurs de mal » et quatre ans avant sa mort, le poète fait paraître « le peintre de la vie moderne » qui résume et ordonne sa conception.
Paradoxal, prophétique : tel fut Baudelaire au sein du 19e siècle, dans sa poésie comme dans sa critique d'art, qui est à sa manière une oeuvre d'art.
Lien : http://www.httpsilartetaitco..
Baudelaire est ici critique d'art. Il critique les tableaux exposés aux Salons de 1845, 1846 et 1859.
Dans l'ensemble, les critiques de Baudelaire sont enthousiastes, élogieuses, parfois acérées.
En tant que critique d'art, Baudelaire semble rechercher dans la peinture l'originalité, de belles couleurs, "la recherche sincère de la vérité", du "neuf"....
Des réflexions intéressantes sur l'art.
Instructif, captivant.
Baudelaire est ici un critique d'art subtil, au style fluide, raffiné.
Dans l'ensemble, les critiques de Baudelaire sont enthousiastes, élogieuses, parfois acérées.
En tant que critique d'art, Baudelaire semble rechercher dans la peinture l'originalité, de belles couleurs, "la recherche sincère de la vérité", du "neuf"....
Des réflexions intéressantes sur l'art.
Instructif, captivant.
Baudelaire est ici un critique d'art subtil, au style fluide, raffiné.
Malgré une certaine férocité de critique assumée et parfois excessive , Baudelaire porte un regard aigu sur ses contemporains, c'est fabuleux de parcourir une partie de l'histoire de l'Art avec un tel guide.
Citations et extraits (31)
Voir plus
Ajouter une citation
Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique ; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n’a ni haine ni amour, et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament ; mais, — un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, — celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi le meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie.
Mais ce genre de critique est destiné aux recueils de poésie et aux lecteurs poétiques. Quant à la critique proprement dite, j’espère que les philosophes comprendront ce que je vais dire : pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons.
Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur aux dépens de la ligne, sans doute, c’est un point de vue ; mais ce n’est ni très large ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières.
Vous ignorez à quelle dose la nature a mêlé dans chaque esprit le goût de la ligne et le goût de la couleur, et par quels mystérieux procédés elle opère cette fusion, dont le résultat est un tableau.
Ainsi un point de vue plus large sera l’individualisme bien entendu : commander à l’artiste la naïveté et l’expression sincère de son tempérament, aidée par tous les moyens que lui fournit son métier. Qui n’a pas de tempérament n’est pas digne de faire des tableaux, et, — comme nous sommes las des imitateurs, et surtout des éclectiques, — doit entrer comme ouvrier au service d’un peintre à tempérament.
[…]
Désormais muni d’un critérium certain, critérium tiré de la nature, le critique doit accomplir son devoir avec passion ; car pour être critique on n’est pas moins homme, et la passion rapproche les tempéraments analogues et soulève la raison à des hauteurs nouvelles.
Comme [les arts] sont toujours le beau exprimé par le sentiment la passion et la rêverie de chacun, c’est-à-dire la variété dans l’unité, ou les faces diverses de l’absolu, — la critique touche à chaque instant à la métaphysique.
Chaque siècle, chaque peuple ayant possédé l’expression de sa beauté et de sa morale, — si l’on veut entendre par romantisme l’expression la plus récente et la plus moderne de la beauté, — le grand artiste sera donc, — pour le critique raisonnable et passionné, — celui qui unira à la condition demandée ci-dessus, la naïveté, — le plus de romantisme possible.
Extrait du chapitre : À quoi bon la critique ?
Mais ce genre de critique est destiné aux recueils de poésie et aux lecteurs poétiques. Quant à la critique proprement dite, j’espère que les philosophes comprendront ce que je vais dire : pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons.
Exalter la ligne au détriment de la couleur, ou la couleur aux dépens de la ligne, sans doute, c’est un point de vue ; mais ce n’est ni très large ni très juste, et cela accuse une grande ignorance des destinées particulières.
Vous ignorez à quelle dose la nature a mêlé dans chaque esprit le goût de la ligne et le goût de la couleur, et par quels mystérieux procédés elle opère cette fusion, dont le résultat est un tableau.
Ainsi un point de vue plus large sera l’individualisme bien entendu : commander à l’artiste la naïveté et l’expression sincère de son tempérament, aidée par tous les moyens que lui fournit son métier. Qui n’a pas de tempérament n’est pas digne de faire des tableaux, et, — comme nous sommes las des imitateurs, et surtout des éclectiques, — doit entrer comme ouvrier au service d’un peintre à tempérament.
[…]
Désormais muni d’un critérium certain, critérium tiré de la nature, le critique doit accomplir son devoir avec passion ; car pour être critique on n’est pas moins homme, et la passion rapproche les tempéraments analogues et soulève la raison à des hauteurs nouvelles.
Comme [les arts] sont toujours le beau exprimé par le sentiment la passion et la rêverie de chacun, c’est-à-dire la variété dans l’unité, ou les faces diverses de l’absolu, — la critique touche à chaque instant à la métaphysique.
Chaque siècle, chaque peuple ayant possédé l’expression de sa beauté et de sa morale, — si l’on veut entendre par romantisme l’expression la plus récente et la plus moderne de la beauté, — le grand artiste sera donc, — pour le critique raisonnable et passionné, — celui qui unira à la condition demandée ci-dessus, la naïveté, — le plus de romantisme possible.
Extrait du chapitre : À quoi bon la critique ?
Monsieur,
Je voudrais, une fois encore, une fois suprême, rendre hommage au génie d’Eugène Delacroix, et je vous prie de vouloir bien accueillir dans votre journal ces quelques pages où j’essaierai d’enfermer, aussi brièvement que possible, l’histoire de son talent, la raison de sa supériorité, qui n’est pas encore, selon moi, suffisamment reconnue, et enfin quelques anecdotes et quelques observations sur sa vie et son caractère.
J’ai eu le bonheur d’être lié très-jeune (dès 1845, autant que je peux me souvenir) avec l’illustre défunt, et dans cette liaison, d’où le respect de ma part et l’indulgence de la sienne n’excluaient pas la confiance et la familiarité réciproques, j’ai pu à loisir puiser les notions les plus exactes, non-seulement sur sa méthode, mais aussi sur les qualités les plus intimes de sa grande âme.
Vous n’attendez pas, monsieur, que je fasse ici une analyse détaillée des œuvres de Delacroix. Outre que chacun de nous l’a faite, selon ses forces et au fur et à mesure que le grand peintre montrait au public les travaux successifs de sa pensée, le compte en est si long, qu’en accordant seulement quelques lignes à chacun de ses principaux ouvrages, une pareille analyse remplirait presque un volume. Qu’il nous suffise d’en exposer ici un vif résumé.
Ses peintures monumentales s’étalent dans le Salon du Roi à la Chambre des députés, à la bibliothèque de la Chambre des députés, à la bibliothèque du palais du Luxembourg, à la galerie d’Apollon au Louvre, et au Salon de la Paix à l’Hôtel de ville. Ces décorations comprennent une masse énorme de sujets allégoriques, religieux et historiques, appartenant tous au domaine le plus noble de l’intelligence. Quant à ses tableaux dits de chevalet, ses esquisses, ses grisailles, ses aquarelles, etc., le compte monte à un chiffre approximatif de deux cent trente-six.
Les grands sujets exposés à divers Salons sont au nombre de soixante-dix-sept. Je tire ces notes du catalogue que M. Théophile Silvestre a placé à la suite de son excellente notice sur Eugène Delacroix, dans son livre intitulé : Histoire des peintres vivants.
J’ai essayé plus d’une fois, moi-même, de dresser cet énorme catalogue ; mais ma patience a été brisée par cette incroyable fécondité, et, de guerre lasse, j’y ai renoncé. Si M. Théophile Silvestre s’est trompé, il n’a pu se tromper qu’en moins.
Je crois, monsieur, que l’important ici est simplement de chercher la qualité caractéristique du génie de Delacroix et d’essayer de la définir ; de chercher en quoi il diffère de ses plus illustres devanciers, tout en les égalant ; de montrer enfin, autant que la parole écrite le permet, l’art magique grâce auquel il a pu traduire la parole par des images plastiques plus vives et plus appropriées que celles d’aucun créateur de même profession, — en un mot, de quelle spécialité la Providence avait chargé Eugène Delacroix dans le développement historique de la Peinture.
I
Qu’est-ce que Delacroix ? Quels furent son rôle et son devoir en ce monde ? Telle est la première question à examiner. Je serai bref et j’aspire à des conclusions immédiates. La Flandre a Rubens, l’Italie a Raphaël et Véronèse ; la France a Lebrun, David et Delacroix.
Un esprit superficiel pourra être choqué, au premier aspect, par l’accouplement de ces noms, qui représentent des qualités et des méthodes si différentes. Mais un œil spirituel plus attentif verra tout de suite qu’il y a entre tous une parenté commune, une espèce de fraternité ou de cousinage dérivant de leur amour du grand, du national, de l’immense et de l’universel, amour qui s’est toujours exprimé dans la peinture dite décorative ou dans les grandes machines.
Beaucoup d’autres, sans doute, ont fait de grandes machines ; mais ceux-là que j’ai nommés les ont faites de la manière la plus propre à laisser une trace éternelle dans la mémoire humaine. Quel est le plus grand de ces grands hommes si divers ? Chacun peut décider la chose à son gré, suivant que son tempérament le pousse à préférer l’abondance prolifique, rayonnante, joviale presque, de Rubens, la douce majesté et l’ordre eurythmique de Raphaël, la couleur paradisiaque et comme d’après-midi de Véronèse, la sévérité austère et tendue de David, ou la faconde dramatique et quasi littéraire de Lebrun.
Aucun de ces hommes ne peut être remplacé ; visant tous à un but semblable, ils ont employé des moyens différents tirés de leur nature personnelle. Delacroix, le dernier venu, a exprimé avec une véhémence et une ferveur admirables, ce que les autres n’avaient traduit que d’une manière incomplète. Au détriment de quelque autre chose peut-être, comme eux-mêmes avaient fait d’ailleurs ? C’est possible ; mais ce n’est pas la question à examiner.
Bien d’autres que moi ont pris soin de s’appesantir sur les conséquences fatales d’un génie essentiellement personnel ; et il serait bien possible aussi, après tout, que les plus belles expressions du génie, ailleurs que dans le ciel pur, c’est-à-dire sur cette pauvre terre où la perfection elle-même est imparfaite, ne pussent être obtenues qu’au prix d’un inévitable sacrifice.
Mais enfin, monsieur, direz-vous sans doute, quel est donc ce je ne sais quoi de mystérieux que Delacroix, pour la gloire de notre siècle, a mieux traduit qu’aucun autre ? C’est l’invisible, c’est l’impalpable, c’est le rêve, c’est les nerfs, c’est l’âme ; et il a fait cela, — observez-le bien, monsieur, — sans autres moyens que le contour et la couleur ; il l’a fait mieux que pas un ; il l’a fait avec la perfection d’un peintre consommé, avec la rigueur d’un littérateur subtil, avec l’éloquence d’un musicien passionné. C’est, du reste, un des diagnostics de l’état spirituel de notre siècle que les arts aspirent, sinon à se suppléer l’un l’autre, du moins à se prêter réciproquement des forces nouvelles.
Delacroix est le plus suggestif de tous les peintres, celui dont les œuvres, choisies même parmi les secondaires et les inférieures, font le plus penser, et rappellent à la mémoire le plus de sentiments et de pensées poétiques déjà connus, mais qu’on croyait enfouis pour toujours dans la nuit du passé.
L’œuvre de Delacroix m’apparaît quelquefois comme une espèce de mnémotechnie de la grandeur et de la passion native de l’homme universel. Ce mérite très-particulier et tout nouveau de M. Delacroix, qui lui a permis d’exprimer, simplement avec le contour, le geste de l’homme, si violent qu’il soit, et avec la couleur ce qu’on pourrait appeler l’atmosphère du drame humain, ou l’état de l’âme du créateur, — ce mérite tout original a toujours rallié autour de lui les sympathies de tous les poëtes ; et si, d’une pure manifestation matérielle il était permis de tirer une vérification philosophique, je vous prierais d’observer, monsieur, que, parmi la foule accourue pour lui rendre les suprêmes honneurs, on pouvait compter beaucoup plus de littérateurs que de peintres. Pour dire la vérité crue, ces derniers ne l’ont jamais parfaitement compris.
II
Et en cela, quoi de bien étonnant, après tout ? Ne savons-nous pas que la saison des Michel-Ange, des Raphaël, des Léonard de Vinci, disons même des Reynolds, est depuis longtemps passée, et que le niveau intellectuel général des artistes a singulièrement baissé ? Il serait sans doute injuste de chercher parmi les artistes du jour des philosophes, des poëtes et des savants ; mais il serait légitime d’exiger d’eux qu’ils s’intéressassent, un peu plus qu’ils ne font, à la religion, à la poésie et à la science.
Hors de leurs ateliers que savent-ils ? qu’aiment-ils ? qu’expriment-ils ? Or, Eugène Delacroix était, en même temps qu’un peintre épris de son métier, un homme d’éducation générale, au contraire des autres artistes modernes qui, pour la plupart, ne sont guère que d’illustres ou d’obscurs rapins, de tristes spécialistes, vieux ou jeunes ; de purs ouvriers, les uns sachant fabriquer des figures académiques, les autres des fruits, les autres des bestiaux. Eugène Delacroix aimait tout, savait tout peindre, et savait goûter tous les genres de talents. C’était l’esprit le plus ouvert à toutes les notions et à toutes les impressions, le jouisseur le plus éclectique et le plus impartial.
Grand liseur, cela va sans dire. La lecture des poëtes laissait en lui des images grandioses et rapidement définies, des tableaux tout faits, pour ainsi dire. Quelque différent qu’il soit de son maître Guérin par la méthode et la couleur, il a hérité de la grande école républicaine et impériale l’amour des poëtes et je ne sais quel esprit endiablé de rivalité avec la parole écrite. David, Guérin et Girodet enflammaient leur esprit au contact d’Homère, de Virgile, de Racine et d’Ossian. Delacroix fut le traducteur émouvant de Shakspeare, de Dante, de Byron et d’Arioste. Ressemblance importante et différence légère.
Mais entrons un peu plus avant, je vous prie, dans ce qu’on pourrait appeler l’enseignement du maître, enseignement qui, pour moi, résulte non seulement de la contemplation successive de toutes ses œuvres et de la contemplation simultanée de quelques-unes, comme vous avez pu en jouir à l’Exposition universelle de 1855, mais aussi de maintes conversations que j’ai eues avec lui.
Je voudrais, une fois encore, une fois suprême, rendre hommage au génie d’Eugène Delacroix, et je vous prie de vouloir bien accueillir dans votre journal ces quelques pages où j’essaierai d’enfermer, aussi brièvement que possible, l’histoire de son talent, la raison de sa supériorité, qui n’est pas encore, selon moi, suffisamment reconnue, et enfin quelques anecdotes et quelques observations sur sa vie et son caractère.
J’ai eu le bonheur d’être lié très-jeune (dès 1845, autant que je peux me souvenir) avec l’illustre défunt, et dans cette liaison, d’où le respect de ma part et l’indulgence de la sienne n’excluaient pas la confiance et la familiarité réciproques, j’ai pu à loisir puiser les notions les plus exactes, non-seulement sur sa méthode, mais aussi sur les qualités les plus intimes de sa grande âme.
Vous n’attendez pas, monsieur, que je fasse ici une analyse détaillée des œuvres de Delacroix. Outre que chacun de nous l’a faite, selon ses forces et au fur et à mesure que le grand peintre montrait au public les travaux successifs de sa pensée, le compte en est si long, qu’en accordant seulement quelques lignes à chacun de ses principaux ouvrages, une pareille analyse remplirait presque un volume. Qu’il nous suffise d’en exposer ici un vif résumé.
Ses peintures monumentales s’étalent dans le Salon du Roi à la Chambre des députés, à la bibliothèque de la Chambre des députés, à la bibliothèque du palais du Luxembourg, à la galerie d’Apollon au Louvre, et au Salon de la Paix à l’Hôtel de ville. Ces décorations comprennent une masse énorme de sujets allégoriques, religieux et historiques, appartenant tous au domaine le plus noble de l’intelligence. Quant à ses tableaux dits de chevalet, ses esquisses, ses grisailles, ses aquarelles, etc., le compte monte à un chiffre approximatif de deux cent trente-six.
Les grands sujets exposés à divers Salons sont au nombre de soixante-dix-sept. Je tire ces notes du catalogue que M. Théophile Silvestre a placé à la suite de son excellente notice sur Eugène Delacroix, dans son livre intitulé : Histoire des peintres vivants.
J’ai essayé plus d’une fois, moi-même, de dresser cet énorme catalogue ; mais ma patience a été brisée par cette incroyable fécondité, et, de guerre lasse, j’y ai renoncé. Si M. Théophile Silvestre s’est trompé, il n’a pu se tromper qu’en moins.
Je crois, monsieur, que l’important ici est simplement de chercher la qualité caractéristique du génie de Delacroix et d’essayer de la définir ; de chercher en quoi il diffère de ses plus illustres devanciers, tout en les égalant ; de montrer enfin, autant que la parole écrite le permet, l’art magique grâce auquel il a pu traduire la parole par des images plastiques plus vives et plus appropriées que celles d’aucun créateur de même profession, — en un mot, de quelle spécialité la Providence avait chargé Eugène Delacroix dans le développement historique de la Peinture.
I
Qu’est-ce que Delacroix ? Quels furent son rôle et son devoir en ce monde ? Telle est la première question à examiner. Je serai bref et j’aspire à des conclusions immédiates. La Flandre a Rubens, l’Italie a Raphaël et Véronèse ; la France a Lebrun, David et Delacroix.
Un esprit superficiel pourra être choqué, au premier aspect, par l’accouplement de ces noms, qui représentent des qualités et des méthodes si différentes. Mais un œil spirituel plus attentif verra tout de suite qu’il y a entre tous une parenté commune, une espèce de fraternité ou de cousinage dérivant de leur amour du grand, du national, de l’immense et de l’universel, amour qui s’est toujours exprimé dans la peinture dite décorative ou dans les grandes machines.
Beaucoup d’autres, sans doute, ont fait de grandes machines ; mais ceux-là que j’ai nommés les ont faites de la manière la plus propre à laisser une trace éternelle dans la mémoire humaine. Quel est le plus grand de ces grands hommes si divers ? Chacun peut décider la chose à son gré, suivant que son tempérament le pousse à préférer l’abondance prolifique, rayonnante, joviale presque, de Rubens, la douce majesté et l’ordre eurythmique de Raphaël, la couleur paradisiaque et comme d’après-midi de Véronèse, la sévérité austère et tendue de David, ou la faconde dramatique et quasi littéraire de Lebrun.
Aucun de ces hommes ne peut être remplacé ; visant tous à un but semblable, ils ont employé des moyens différents tirés de leur nature personnelle. Delacroix, le dernier venu, a exprimé avec une véhémence et une ferveur admirables, ce que les autres n’avaient traduit que d’une manière incomplète. Au détriment de quelque autre chose peut-être, comme eux-mêmes avaient fait d’ailleurs ? C’est possible ; mais ce n’est pas la question à examiner.
Bien d’autres que moi ont pris soin de s’appesantir sur les conséquences fatales d’un génie essentiellement personnel ; et il serait bien possible aussi, après tout, que les plus belles expressions du génie, ailleurs que dans le ciel pur, c’est-à-dire sur cette pauvre terre où la perfection elle-même est imparfaite, ne pussent être obtenues qu’au prix d’un inévitable sacrifice.
Mais enfin, monsieur, direz-vous sans doute, quel est donc ce je ne sais quoi de mystérieux que Delacroix, pour la gloire de notre siècle, a mieux traduit qu’aucun autre ? C’est l’invisible, c’est l’impalpable, c’est le rêve, c’est les nerfs, c’est l’âme ; et il a fait cela, — observez-le bien, monsieur, — sans autres moyens que le contour et la couleur ; il l’a fait mieux que pas un ; il l’a fait avec la perfection d’un peintre consommé, avec la rigueur d’un littérateur subtil, avec l’éloquence d’un musicien passionné. C’est, du reste, un des diagnostics de l’état spirituel de notre siècle que les arts aspirent, sinon à se suppléer l’un l’autre, du moins à se prêter réciproquement des forces nouvelles.
Delacroix est le plus suggestif de tous les peintres, celui dont les œuvres, choisies même parmi les secondaires et les inférieures, font le plus penser, et rappellent à la mémoire le plus de sentiments et de pensées poétiques déjà connus, mais qu’on croyait enfouis pour toujours dans la nuit du passé.
L’œuvre de Delacroix m’apparaît quelquefois comme une espèce de mnémotechnie de la grandeur et de la passion native de l’homme universel. Ce mérite très-particulier et tout nouveau de M. Delacroix, qui lui a permis d’exprimer, simplement avec le contour, le geste de l’homme, si violent qu’il soit, et avec la couleur ce qu’on pourrait appeler l’atmosphère du drame humain, ou l’état de l’âme du créateur, — ce mérite tout original a toujours rallié autour de lui les sympathies de tous les poëtes ; et si, d’une pure manifestation matérielle il était permis de tirer une vérification philosophique, je vous prierais d’observer, monsieur, que, parmi la foule accourue pour lui rendre les suprêmes honneurs, on pouvait compter beaucoup plus de littérateurs que de peintres. Pour dire la vérité crue, ces derniers ne l’ont jamais parfaitement compris.
II
Et en cela, quoi de bien étonnant, après tout ? Ne savons-nous pas que la saison des Michel-Ange, des Raphaël, des Léonard de Vinci, disons même des Reynolds, est depuis longtemps passée, et que le niveau intellectuel général des artistes a singulièrement baissé ? Il serait sans doute injuste de chercher parmi les artistes du jour des philosophes, des poëtes et des savants ; mais il serait légitime d’exiger d’eux qu’ils s’intéressassent, un peu plus qu’ils ne font, à la religion, à la poésie et à la science.
Hors de leurs ateliers que savent-ils ? qu’aiment-ils ? qu’expriment-ils ? Or, Eugène Delacroix était, en même temps qu’un peintre épris de son métier, un homme d’éducation générale, au contraire des autres artistes modernes qui, pour la plupart, ne sont guère que d’illustres ou d’obscurs rapins, de tristes spécialistes, vieux ou jeunes ; de purs ouvriers, les uns sachant fabriquer des figures académiques, les autres des fruits, les autres des bestiaux. Eugène Delacroix aimait tout, savait tout peindre, et savait goûter tous les genres de talents. C’était l’esprit le plus ouvert à toutes les notions et à toutes les impressions, le jouisseur le plus éclectique et le plus impartial.
Grand liseur, cela va sans dire. La lecture des poëtes laissait en lui des images grandioses et rapidement définies, des tableaux tout faits, pour ainsi dire. Quelque différent qu’il soit de son maître Guérin par la méthode et la couleur, il a hérité de la grande école républicaine et impériale l’amour des poëtes et je ne sais quel esprit endiablé de rivalité avec la parole écrite. David, Guérin et Girodet enflammaient leur esprit au contact d’Homère, de Virgile, de Racine et d’Ossian. Delacroix fut le traducteur émouvant de Shakspeare, de Dante, de Byron et d’Arioste. Ressemblance importante et différence légère.
Mais entrons un peu plus avant, je vous prie, dans ce qu’on pourrait appeler l’enseignement du maître, enseignement qui, pour moi, résulte non seulement de la contemplation successive de toutes ses œuvres et de la contemplation simultanée de quelques-unes, comme vous avez pu en jouir à l’Exposition universelle de 1855, mais aussi de maintes conversations que j’ai eues avec lui.
Il me reste, pour compléter cette analyse, à noter une dernière qualité chez Delacroix, la plus remarquable de toutes, et qui fait de lui le vrai peintre du XIXe siècle : c’est cette mélancolie singulière et opiniâtre qui s’exhale de toutes ses œuvres, et qui s’exprime et par le choix du sujet, et par l’expression des figures, et par le geste, et par le style de la couleur. Delacroix affectionne Dante et Shakespeare, deux autres grands peintres de la douleur humaine ; il les connaît à fond, et il sait les traduire librement. En contemplant la série de ses tableaux, on dirait qu’on assiste à la célébration de quelque mystère douloureux […]. Dans plusieurs on trouve, par je ne sais quel constant hasard, une figure plus désolée, plus affaissée que les autres, en qui se résument toutes les douleurs environnantes […]. Cette mélancolie respire jusque dans Les Femmes d’Alger, son tableau le plus coquet et le plus fleuri. Ce petit poème d’intérieur, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brimborions de toilette, exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondés de la tristesse.
On eût dit que Delacroix avait réservé toute sa sensibilité, qui était virile et profonde, pour l’austère sentiment de l’amitié. Il y a des gens qui s’éprennent facilement du premier venu ; d’autres réservent l’usage de la faculté divine pour les grandes occasions. L’homme célèbre dont je vous entretiens avec tant de plaisir, s’il n’aimait pas qu’on le dérangeât pour de petites choses, savait devenir serviable, courageux, ardent, s’il s’agissait de choses importantes. Ceux qui l’ont bien connu ont pu apprécier, en maintes occasions, sa fidélité, son exactitude et sa solidité tout anglaise dans les rapports sociaux. S’il était exigeant pour les autres, il n’était pas moins sévère pour lui-même.
Ce n’est qu’avec tristesse et mauvaise humeur que je veux dire quelques mots de certaines accusations portées contre Eugène Delacroix. J’ai entendu des gens le taxer d’égoïsme et même d’avarice. Observez, monsieur, que ce reproche est toujours adressé par l’innombrable classe des âmes banales à celles qui s’appliquent à placer leur générosité aussi bien que leur amitié.
Delacroix était fort économe ; c’était pour lui le seul moyen d’être, à l’occasion, fort généreux : je pourrais le prouver par quelques exemples, mais je craindrais de le faire sans y avoir été autorisé par lui, non plus que par ceux qui ont eu à se louer de lui.
Observez aussi que pendant de nombreuses années ses peintures se sont vendues fort mal, et que ses travaux de décoration absorbaient presque la totalité de son salaire, quand il n’y mettait pas de sa bourse. Il a prouvé un grand nombre de fois son mépris de l’argent, quand des artistes pauvres laissaient voir le désir de posséder quelqu’une de ses œuvres. Alors, semblable aux médecins d’un esprit libéral et généreux, qui tantôt font payer leurs soins et tantôt les donnent, il donnait ses tableaux ou les cédait à n’importe quel prix.
Enfin, monsieur, notons bien que l’homme supérieur est obligé, plus que tout autre, de veiller à sa défense personnelle. On peut dire que toute la société est en guerre contre lui. Nous avons pu vérifier le cas plus d’une fois. Sa politesse, on l’appelle froideur ; son ironie, si mitigée qu’elle soit, méchanceté ; son économie, avarice. Mais si, au contraire, le malheureux se montre imprévoyant, bien loin de le plaindre, la société dira : « C’est bien fait ; sa pénurie est la punition de sa prodigalité. »
Je puis affirmer que Delacroix, en matière d’argent et d’économie, partageait complétement l’opinion de Stendhal opinion qui concilie la grandeur et la prudence.
« L’homme d’esprit, disait ce dernier, doit s’appliquer à acquérir ce qui lui est strictement nécessaire pour ne dépendre de personne (du temps de Stendhal, c’était 6,000 francs de revenu) ; mais si, cette sûreté obtenue, il perd son temps à augmenter sa fortune, c’est un misérable. »
Recherche du nécessaire et mépris du superflu, c’est une conduite d’homme sage et de stoïcien.
Une des grandes préoccupations de notre peintre dans ses dernières années était le jugement de la postérité et la solidité incertaine de ses œuvres. Tantôt son imagination si sensible s’enflammait à l’idée d’une gloire immortelle, tantôt il parlait amèrement de la fragilité des toiles et des couleurs. D’autres fois il citait avec envie les anciens maîtres, qui ont eu presque tous le bonheur d’être traduits par des graveurs habiles, dont la pointe ou le burin a su s’adapter à la nature de leur talent, et il regrettait ardemment de n’avoir pas trouvé son traducteur. Cette friabilité de l’œuvre peinte, comparée avec la solidité de l’œuvre imprimée, était un de ses thèmes habituels de conversation.
Quand cet homme si frêle et si opiniâtre, si nerveux et si vaillant, cet homme unique dans l’histoire de l’art européen, l’artiste maladif et frileux, qui rêvait sans cesse de couvrir des murailles de ses grandioses conceptions, a été emporté par une de ces fluxions de poitrine dont il avait, ce semble, le convulsif pressentiment, nous avons tous senti quelque chose d’analogue à cette dépression d’âme, à cette sensation de solitude croissante que nous avaient fait déjà connaître la mort de Chateaubriand et celle de Balzac, sensation renouvelée tout récemment par la disparition d’Alfred de Vigny. Il y a dans un grand deuil national un affaissement de vitalité générale, un obscurcissement de l’intellect qui ressemble à une éclipse solaire, imitation momentanée de la fin du monde.
Je crois cependant que cette impression affecte surtout ces hautains solitaires qui ne peuvent se faire une famille que par les relations intellectuelles. Quant aux autres citoyens, pour la plupart, ils n’apprennent que peu à peu à connaître tout ce qu’a perdu la patrie en perdant le grand homme, et quel vide il fait en la quittant. Encore faut-il les avertir.
Je vous remercie de tout mon cœur, monsieur, d’avoir bien voulu me laisser dire librement tout ce que me suggérait le souvenir d’un des rares génies de notre malheureux siècle, — si pauvre et si riche à la fois, tantôt trop exigeant, tantôt trop indulgent, et trop souvent injuste.
Ce n’est qu’avec tristesse et mauvaise humeur que je veux dire quelques mots de certaines accusations portées contre Eugène Delacroix. J’ai entendu des gens le taxer d’égoïsme et même d’avarice. Observez, monsieur, que ce reproche est toujours adressé par l’innombrable classe des âmes banales à celles qui s’appliquent à placer leur générosité aussi bien que leur amitié.
Delacroix était fort économe ; c’était pour lui le seul moyen d’être, à l’occasion, fort généreux : je pourrais le prouver par quelques exemples, mais je craindrais de le faire sans y avoir été autorisé par lui, non plus que par ceux qui ont eu à se louer de lui.
Observez aussi que pendant de nombreuses années ses peintures se sont vendues fort mal, et que ses travaux de décoration absorbaient presque la totalité de son salaire, quand il n’y mettait pas de sa bourse. Il a prouvé un grand nombre de fois son mépris de l’argent, quand des artistes pauvres laissaient voir le désir de posséder quelqu’une de ses œuvres. Alors, semblable aux médecins d’un esprit libéral et généreux, qui tantôt font payer leurs soins et tantôt les donnent, il donnait ses tableaux ou les cédait à n’importe quel prix.
Enfin, monsieur, notons bien que l’homme supérieur est obligé, plus que tout autre, de veiller à sa défense personnelle. On peut dire que toute la société est en guerre contre lui. Nous avons pu vérifier le cas plus d’une fois. Sa politesse, on l’appelle froideur ; son ironie, si mitigée qu’elle soit, méchanceté ; son économie, avarice. Mais si, au contraire, le malheureux se montre imprévoyant, bien loin de le plaindre, la société dira : « C’est bien fait ; sa pénurie est la punition de sa prodigalité. »
Je puis affirmer que Delacroix, en matière d’argent et d’économie, partageait complétement l’opinion de Stendhal opinion qui concilie la grandeur et la prudence.
« L’homme d’esprit, disait ce dernier, doit s’appliquer à acquérir ce qui lui est strictement nécessaire pour ne dépendre de personne (du temps de Stendhal, c’était 6,000 francs de revenu) ; mais si, cette sûreté obtenue, il perd son temps à augmenter sa fortune, c’est un misérable. »
Recherche du nécessaire et mépris du superflu, c’est une conduite d’homme sage et de stoïcien.
Une des grandes préoccupations de notre peintre dans ses dernières années était le jugement de la postérité et la solidité incertaine de ses œuvres. Tantôt son imagination si sensible s’enflammait à l’idée d’une gloire immortelle, tantôt il parlait amèrement de la fragilité des toiles et des couleurs. D’autres fois il citait avec envie les anciens maîtres, qui ont eu presque tous le bonheur d’être traduits par des graveurs habiles, dont la pointe ou le burin a su s’adapter à la nature de leur talent, et il regrettait ardemment de n’avoir pas trouvé son traducteur. Cette friabilité de l’œuvre peinte, comparée avec la solidité de l’œuvre imprimée, était un de ses thèmes habituels de conversation.
Quand cet homme si frêle et si opiniâtre, si nerveux et si vaillant, cet homme unique dans l’histoire de l’art européen, l’artiste maladif et frileux, qui rêvait sans cesse de couvrir des murailles de ses grandioses conceptions, a été emporté par une de ces fluxions de poitrine dont il avait, ce semble, le convulsif pressentiment, nous avons tous senti quelque chose d’analogue à cette dépression d’âme, à cette sensation de solitude croissante que nous avaient fait déjà connaître la mort de Chateaubriand et celle de Balzac, sensation renouvelée tout récemment par la disparition d’Alfred de Vigny. Il y a dans un grand deuil national un affaissement de vitalité générale, un obscurcissement de l’intellect qui ressemble à une éclipse solaire, imitation momentanée de la fin du monde.
Je crois cependant que cette impression affecte surtout ces hautains solitaires qui ne peuvent se faire une famille que par les relations intellectuelles. Quant aux autres citoyens, pour la plupart, ils n’apprennent que peu à peu à connaître tout ce qu’a perdu la patrie en perdant le grand homme, et quel vide il fait en la quittant. Encore faut-il les avertir.
Je vous remercie de tout mon cœur, monsieur, d’avoir bien voulu me laisser dire librement tout ce que me suggérait le souvenir d’un des rares génies de notre malheureux siècle, — si pauvre et si riche à la fois, tantôt trop exigeant, tantôt trop indulgent, et trop souvent injuste.
La détestable couleur d’Horace Vernet ne l’empêchait pas de sentir la virtualité personnelle qui anime la plupart de ses tableaux, et il trouvait des expressions étonnantes pour louer ce pétillement et cette infatigable ardeur. Son admiration pour Meissonier allait un peu trop loin. Il s’était approprié, presque par violence, les dessins qui avaient servi à préparer la composition de la Barricade, le meilleur tableau de M. Meissonier, dont le talent, d’ailleurs, s’exprime bien plus énergiquement par le simple crayon que par le pinceau. De celui-ci il disait souvent, comme rêvant avec inquiétude de l’avenir : « Après tout, de nous tous, c’est lui qui est le plus sûr de vivre ! » N’est-il pas curieux de voir l’auteur de si grandes choses jalouser presque celui qui n’excelle que dans les petites ?
Le seul homme dont le nom eût puissance pour arracher quelques gros mots à cette bouche aristocratique était Paul Delaroche. Dans les œuvres de celui-là il ne trouvait sans doute aucune excuse, et il gardait indélébile le souvenir des souffrances que lui avait causées cette peinture sale et amère, faite avec de l’encre et du cirage, comme a dit autrefois Théophile Gautier.
Mais celui qu’il choisissait plus volontiers pour s’expatrier dans d’immenses causeries était l’homme qui lui ressemblait le moins par le talent comme par les idées, son véritable antipode, un homme à qui on n’a pas encore rendu toute la justice qui lui est due, et dont le cerveau, quoique embrumé comme le ciel charbonné de sa ville natale, contient une foule d’admirables choses. J’ai nommé M. Paul Chenavard.
Les théories abstruses du peintre philosophe lyonnais faisaient sourire Delacroix, et le pédagogue abstracteur considérait les voluptés de la pure peinture comme choses frivoles, sinon coupables. Mais si éloignés qu’ils fussent l’un de l’autre, et à cause même de cet éloignement, ils aimaient à se rapprocher, et comme deux navires attachés par les grappins d’abordage, ils ne pouvaient plus se quitter. Tous deux, d’ailleurs, étaient fort lettrés et doués d’un remarquable esprit de sociabilité, ils se rencontraient sur le terrain commun de l’érudition. On sait qu’en général ce n’est pas la qualité par laquelle brillent les artistes.
Chenavard était donc pour Delacroix une rare ressource. C’était vraiment plaisir de les voir s’agiter dans une lutte innocente, la parole de l’un marchant pesamment comme un éléphant en grand appareil de guerre, la parole de l’autre vibrant comme un fleuret, également aiguë et flexible. Dans les dernières heures de sa vie, notre grand peintre témoigna le désir de serrer la main de son amical contradicteur. Mais celui-ci était alors loin de Paris.
VII
Les femmes sentimentales et précieuses seront peut-être choquées d’apprendre que, semblable à Michel-Ange (rappelez-vous la fin d’un de ses sonnets : "Sculpture ! divine Sculpture, tu es ma seule amante ! »), Delacroix avait fait de la Peinture son unique muse, son unique maîtresse, sa seule et suffisante volupté.
Sans doute il avait beaucoup aimé la femme aux heures agitées de sa jeunesse. Qui n’a pas trop sacrifié à cette idole redoutable ? Et qui ne sait que ce sont justement ceux qui l’ont le mieux servie qui s’en plaignent le plus ? Mais longtemps déjà avant sa fin ; il avait exclu la femme de sa vie. Musulman, il ne l’eût peut-être pas chassée de sa mosquée, mais il se fût étonné de l’y voir entrer, ne comprenant pas bien quelle sorte de conversation elle peut tenir avec Allah.
En cette question, comme en beaucoup d’autres, l’idée orientale prenait en lui vivement et despotiquement le dessus. Il considérait la femme comme un objet d’art, délicieux et propre à exciter l’esprit, mais un objet d’art désobéissant et troublant, si on lui livre le seuil du cœur, et dévorant gloutonnement le temps et les forces.
Je me souviens qu’une fois, dans un lieu public, comme je lui montrais le visage d’une femme d’une originale beauté et d’un caractère mélancolique, il voulut bien en goûter la beauté, mais me dit, avec son petit rire, pour répondre au reste : « Comment voulez-vous qu’une femme puisse être mélancolique ? » insinuant sans doute par là que, pour connaître le sentiment de la mélancolie, il manque à la femme certaine chose essentielle.
C’est là, malheureusement, une théorie bien injurieuse, et je ne voudrais pas préconiser des opinions diffamatoires sur un sexe qui a si souvent montré d’ardentes vertus. Mais on m’accordera bien que c’est une théorie de prudence ; que le talent ne saurait trop s’armer de prudence dans un monde plein d’embûches, et que l’homme de génie possède le privilège de certaines doctrines (pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre) qui nous scandaliseraient justement chez le pur citoyen ou le simple père de famille.
Je dois ajouter, au risque de jeter une ombre sur sa mémoire, au jugement des âmes élégiaques, qu’il ne montrait pas non plus de tendres faiblesses pour l’enfance. L’enfance n’apparaissait à son esprit que les mains barbouillées de confitures (ce qui salit la toile et le papier), ou battant le tambour (ce qui trouble la méditation), ou incendiaire et animalement dangereuse comme le singe.
« Je me souviens fort bien, — disait-il parfois, — que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du devoir ne s’acquiert que très-lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment et par l’exercice progressif de la raison, que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle. »
Ainsi, par le simple bon sens, il faisait un retour vers l’idée catholique. Car on peut dire que l’enfant, en général, est, relativement à l’homme, en général, beaucoup plus rapproché du péché originel.
Le seul homme dont le nom eût puissance pour arracher quelques gros mots à cette bouche aristocratique était Paul Delaroche. Dans les œuvres de celui-là il ne trouvait sans doute aucune excuse, et il gardait indélébile le souvenir des souffrances que lui avait causées cette peinture sale et amère, faite avec de l’encre et du cirage, comme a dit autrefois Théophile Gautier.
Mais celui qu’il choisissait plus volontiers pour s’expatrier dans d’immenses causeries était l’homme qui lui ressemblait le moins par le talent comme par les idées, son véritable antipode, un homme à qui on n’a pas encore rendu toute la justice qui lui est due, et dont le cerveau, quoique embrumé comme le ciel charbonné de sa ville natale, contient une foule d’admirables choses. J’ai nommé M. Paul Chenavard.
Les théories abstruses du peintre philosophe lyonnais faisaient sourire Delacroix, et le pédagogue abstracteur considérait les voluptés de la pure peinture comme choses frivoles, sinon coupables. Mais si éloignés qu’ils fussent l’un de l’autre, et à cause même de cet éloignement, ils aimaient à se rapprocher, et comme deux navires attachés par les grappins d’abordage, ils ne pouvaient plus se quitter. Tous deux, d’ailleurs, étaient fort lettrés et doués d’un remarquable esprit de sociabilité, ils se rencontraient sur le terrain commun de l’érudition. On sait qu’en général ce n’est pas la qualité par laquelle brillent les artistes.
Chenavard était donc pour Delacroix une rare ressource. C’était vraiment plaisir de les voir s’agiter dans une lutte innocente, la parole de l’un marchant pesamment comme un éléphant en grand appareil de guerre, la parole de l’autre vibrant comme un fleuret, également aiguë et flexible. Dans les dernières heures de sa vie, notre grand peintre témoigna le désir de serrer la main de son amical contradicteur. Mais celui-ci était alors loin de Paris.
VII
Les femmes sentimentales et précieuses seront peut-être choquées d’apprendre que, semblable à Michel-Ange (rappelez-vous la fin d’un de ses sonnets : "Sculpture ! divine Sculpture, tu es ma seule amante ! »), Delacroix avait fait de la Peinture son unique muse, son unique maîtresse, sa seule et suffisante volupté.
Sans doute il avait beaucoup aimé la femme aux heures agitées de sa jeunesse. Qui n’a pas trop sacrifié à cette idole redoutable ? Et qui ne sait que ce sont justement ceux qui l’ont le mieux servie qui s’en plaignent le plus ? Mais longtemps déjà avant sa fin ; il avait exclu la femme de sa vie. Musulman, il ne l’eût peut-être pas chassée de sa mosquée, mais il se fût étonné de l’y voir entrer, ne comprenant pas bien quelle sorte de conversation elle peut tenir avec Allah.
En cette question, comme en beaucoup d’autres, l’idée orientale prenait en lui vivement et despotiquement le dessus. Il considérait la femme comme un objet d’art, délicieux et propre à exciter l’esprit, mais un objet d’art désobéissant et troublant, si on lui livre le seuil du cœur, et dévorant gloutonnement le temps et les forces.
Je me souviens qu’une fois, dans un lieu public, comme je lui montrais le visage d’une femme d’une originale beauté et d’un caractère mélancolique, il voulut bien en goûter la beauté, mais me dit, avec son petit rire, pour répondre au reste : « Comment voulez-vous qu’une femme puisse être mélancolique ? » insinuant sans doute par là que, pour connaître le sentiment de la mélancolie, il manque à la femme certaine chose essentielle.
C’est là, malheureusement, une théorie bien injurieuse, et je ne voudrais pas préconiser des opinions diffamatoires sur un sexe qui a si souvent montré d’ardentes vertus. Mais on m’accordera bien que c’est une théorie de prudence ; que le talent ne saurait trop s’armer de prudence dans un monde plein d’embûches, et que l’homme de génie possède le privilège de certaines doctrines (pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre) qui nous scandaliseraient justement chez le pur citoyen ou le simple père de famille.
Je dois ajouter, au risque de jeter une ombre sur sa mémoire, au jugement des âmes élégiaques, qu’il ne montrait pas non plus de tendres faiblesses pour l’enfance. L’enfance n’apparaissait à son esprit que les mains barbouillées de confitures (ce qui salit la toile et le papier), ou battant le tambour (ce qui trouble la méditation), ou incendiaire et animalement dangereuse comme le singe.
« Je me souviens fort bien, — disait-il parfois, — que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du devoir ne s’acquiert que très-lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment et par l’exercice progressif de la raison, que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle. »
Ainsi, par le simple bon sens, il faisait un retour vers l’idée catholique. Car on peut dire que l’enfant, en général, est, relativement à l’homme, en général, beaucoup plus rapproché du péché originel.
Videos de Charles Baudelaire (136)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Charles Baudelaire (133)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Baudelaire
Dans quelle ville est né Charles Baudelaire ?
Bordeaux
Paris
Lille
Lyon
12 questions
415 lecteurs ont répondu
Thème :
Charles BaudelaireCréer un quiz sur ce livre415 lecteurs ont répondu