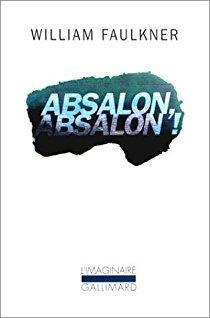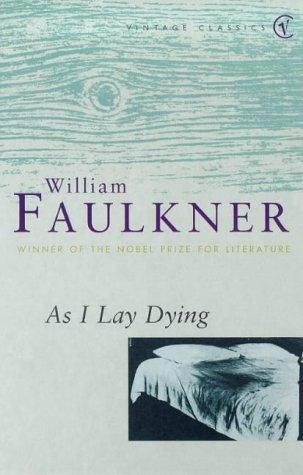William Faulkner
René-Noël Raimbault (Traducteur)François Pitavy (Éditeur scientifique)/5 277 notes
René-Noël Raimbault (Traducteur)François Pitavy (Éditeur scientifique)/5 277 notes
Résumé :
"Absalon, Absalon !" est tout d'abord l'histoire de Thomas Sutpen et de sa descendance - l'histoire de son dessein: créer une plantation et y établir une dynastie pérenne, en sorte que ne puisse se reproduire la scène où s'origine ce dessein, lorsque le petit garçon qu'il était fut empêché par un esclave noir de franchir la porte d'entrée de la maison du planteur où son père l'avait envoyé porter un message.
Cette porte-miroir lui renvoie, précisément parce q... >Voir plus
Cette porte-miroir lui renvoie, précisément parce q... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Absalon, Absalon !Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (29)
Voir plus
Ajouter une critique
Un univers tragique digne des maudits Atrides, mais en version fluviale, Mississippi et longues phrases hypnotiques qui charrient l'effarement, les souvenirs et ressassements des fantômes dupés du Sud ténébreux.
Celui de ces fantômes dupés qui est au centre du livre, autour duquel s'enroulent les phrases titubantes et haletantes des narrateurs, c'est Thomas Sutpen. À noter, puisqu'on nous présente parfois Faulkner comme enraciné dans un terroir, Sutpen n'est pas originaire du Mississippi, c'est un déraciné, au départ un petit môme d'un coin de montagne en Virginie-Occidentale, qui ressemble étonnamment chez Faulkner au monde d'avant la société civile de Rousseau:
«là où il habitait, la terre était au premier venu et à tout le monde, si bien que celui qui se serait donné la peine d'en clôturer un lopin en disant «ceci est à moi» aurait été un fou; quant aux biens, personne n'en possédait plus que son voisin, parce que chacun ne possédait que ce qu'il avait la force et l'énergie de prendre et de garder, et qu'il n'y aurait eu que ce fou à se donner la peine de prendre et de désirer plus qu'il n'aurait pu manger ou échanger contre de la poudre ou du whisky.»
C'est en émigrant que Stupen va apprendre que la société peut être divisée en compartiments nettement déterminés selon la quantité de biens que l'on possède et la couleur de sa peau. Et concevoir, alors qu'il n'est qu'un jeune adolescent, l'ambition obstinée d'appartenir à la classe des riches planteurs.
L'histoire d'une ambition, bon, on pourrait penser que c'est un terrain bien balisé. Mais on n'est pas dans un roman du XIXéme siècle, ici les choses sont bien plus compliquées à appréhender, et on a parfois l'impression de se retrouver perdus en forêt profonde. L'aspect si déroutant du roman tient en partie aux particularités des narrateurs, à la «voix revêche, inquiète, effarée» de Rosa Coldfield qui raconte à Quentin Compson son histoire du démon-Sutpen «jusqu'à ce qu'enfin on cessa de l'écouter, qu'on ne l'entendît plus que de façon confuse». À la façon dont Quentin cherche à saisir ou plutôt à rêver cette histoire, écoutant Miss Rosa ou son père, s'interrogeant, se projetant par l'imaginaire au côté des Sutpen, échafaudant des hypothèses en discutant avec son ami Shreve,
«tous deux créant entre eux deux, à l'aide d'un ramassis de vieilles histoires et de vieux ragots, des personnages qui, peut-être, n'avaient jamais existé nulle part».
Un style narratif tumultueux, déboussolant, une écriture poétique, ténébreuse, hantée, qui semble plonger de multiples racines dans la culture universelle: Bible, tragédie grecque, tout aussi bien que la malédiction liée à l'origine de l'inégalité dans le Discours de notre Jean-Jacques «vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne», à laquelle s'ajoute la malédiction du Sud, qui a oublié aussi qu'un être humain ne pouvait être la propriété d'un autre - une écriture unique, puissante, sidérante, qui donne au roman une épaisseur incroyable.
Celui de ces fantômes dupés qui est au centre du livre, autour duquel s'enroulent les phrases titubantes et haletantes des narrateurs, c'est Thomas Sutpen. À noter, puisqu'on nous présente parfois Faulkner comme enraciné dans un terroir, Sutpen n'est pas originaire du Mississippi, c'est un déraciné, au départ un petit môme d'un coin de montagne en Virginie-Occidentale, qui ressemble étonnamment chez Faulkner au monde d'avant la société civile de Rousseau:
«là où il habitait, la terre était au premier venu et à tout le monde, si bien que celui qui se serait donné la peine d'en clôturer un lopin en disant «ceci est à moi» aurait été un fou; quant aux biens, personne n'en possédait plus que son voisin, parce que chacun ne possédait que ce qu'il avait la force et l'énergie de prendre et de garder, et qu'il n'y aurait eu que ce fou à se donner la peine de prendre et de désirer plus qu'il n'aurait pu manger ou échanger contre de la poudre ou du whisky.»
C'est en émigrant que Stupen va apprendre que la société peut être divisée en compartiments nettement déterminés selon la quantité de biens que l'on possède et la couleur de sa peau. Et concevoir, alors qu'il n'est qu'un jeune adolescent, l'ambition obstinée d'appartenir à la classe des riches planteurs.
L'histoire d'une ambition, bon, on pourrait penser que c'est un terrain bien balisé. Mais on n'est pas dans un roman du XIXéme siècle, ici les choses sont bien plus compliquées à appréhender, et on a parfois l'impression de se retrouver perdus en forêt profonde. L'aspect si déroutant du roman tient en partie aux particularités des narrateurs, à la «voix revêche, inquiète, effarée» de Rosa Coldfield qui raconte à Quentin Compson son histoire du démon-Sutpen «jusqu'à ce qu'enfin on cessa de l'écouter, qu'on ne l'entendît plus que de façon confuse». À la façon dont Quentin cherche à saisir ou plutôt à rêver cette histoire, écoutant Miss Rosa ou son père, s'interrogeant, se projetant par l'imaginaire au côté des Sutpen, échafaudant des hypothèses en discutant avec son ami Shreve,
«tous deux créant entre eux deux, à l'aide d'un ramassis de vieilles histoires et de vieux ragots, des personnages qui, peut-être, n'avaient jamais existé nulle part».
Un style narratif tumultueux, déboussolant, une écriture poétique, ténébreuse, hantée, qui semble plonger de multiples racines dans la culture universelle: Bible, tragédie grecque, tout aussi bien que la malédiction liée à l'origine de l'inégalité dans le Discours de notre Jean-Jacques «vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne», à laquelle s'ajoute la malédiction du Sud, qui a oublié aussi qu'un être humain ne pouvait être la propriété d'un autre - une écriture unique, puissante, sidérante, qui donne au roman une épaisseur incroyable.
Ce roman de Faulkner, "Absalon, Absalon !", est fabuleux. Oui, il est l'oeuvre d'un auteur d'exception, qui aura forcément ouvert de nouveaux champs à la littérature : sémantique, poétique ou même historique. On pourrait objecter qu'il serait pompeux, voire même précieux, de définir du nom de génie un auteur qui plonge son lecteur dès le début du roman dans un gouffre de perplexité, dans une espèce de labyrinthe intérieur, nous engonçant dans ce dédale pour nous forcer à trouver nos propres clés et ouvrir nos propres brèches afin de ne pas s'installer dans la position facile et tentante du lecteur passif et inerte, mais plutôt dans celle du lecteur explorateur et chercheur, créant son propre chemin, ou, encore plus intéressant, ses propres chemins, dans la masse immense et vertigineuse proposée par Faulkner. "Absalon, Absalon !" est donc une oeuvre qui se lit patiemment, bien qu'elle devrait aussi, idéalement, se lire d'une traite (ce ne fut pas mon cas, le roman fait plus de quatre cent pages), car elle demande attention et suppositions. Elle ne plaira sûrement pas aux adeptes des romans formatés qui n'attendent de leurs lecteurs que de sortir les gros billets des poches, de mettre le cerveau en veille et enfin d'oublier le livre dans une bibliothèque de décorum ou mieux encore dans le fond d'une fumeuse décharge. Faulkner n'a pas écrit pour nous divertir, nous faire rire un bon coup. On sent qu'il y avait chez lui comme une nécessité impérieuse d'écrire. Ce roman en est un reflet car il traite à la fois de son histoire personnelle, celle du Sud des Etats-Unis, de la Guerre de Sécession et de ses conséquences sur les générations qui lui succédèrent, et traite aussi de la question même de l'écriture, de son processus, de sa lente et difficile maturation et enfin de son essence, de sa substance.
Au delà du récit d'un homme débarquant de je ne sais où, un certain Sutpen, s'installant à Jefferson, Mississippi, dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour y bâtir une plantation cotonnière, avec une vingtaine de sauvages à son service et un curieux architecte et ayant pour projet d'initier une sorte de dynastie familiale, une lignée Sutpen, au delà de ce récit ce roman est avant tout celui de la distanciation face aux principes de la fiction. Les différents narrateurs, témoins ou protagonistes de l'histoire, ne cessent en effet de nous signaler leurs incertitudes et leurs interrogations sur la réalité de ce qu'ils nous racontent. Souvent, les personnages apparaissent comme des ombres, des entités troubles et indéfinies, exposant ainsi magistralement les mécanismes du processus d'écriture de Faulkner. Enfin, comme le dit très bien la belle préface de François Pitavy, ce roman est l'expression d'un fardeau, le fardeau de l'esclavage des Noirs des anciens Etats confédérés. Un fardeau perpétuel parce qu'il ne fut jamais assumé. Il est d'ailleurs très intéressant de lire aujourd'hui les dernières pages du livre au regard de l'actualité politique américaine et de la récente élection à la présidence de Barack Obama. William Faulkner était donc bien un génie de la littérature, puisqu'il nous parle encore, il parle à Obama, il parle aux Américains. Je ne sais pas si Marc Lévy, Dan Brown ou Amélie Nothomb leur parlent, parlent-ils d'ailleurs ? Non ! ils bavardent.
Au delà du récit d'un homme débarquant de je ne sais où, un certain Sutpen, s'installant à Jefferson, Mississippi, dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour y bâtir une plantation cotonnière, avec une vingtaine de sauvages à son service et un curieux architecte et ayant pour projet d'initier une sorte de dynastie familiale, une lignée Sutpen, au delà de ce récit ce roman est avant tout celui de la distanciation face aux principes de la fiction. Les différents narrateurs, témoins ou protagonistes de l'histoire, ne cessent en effet de nous signaler leurs incertitudes et leurs interrogations sur la réalité de ce qu'ils nous racontent. Souvent, les personnages apparaissent comme des ombres, des entités troubles et indéfinies, exposant ainsi magistralement les mécanismes du processus d'écriture de Faulkner. Enfin, comme le dit très bien la belle préface de François Pitavy, ce roman est l'expression d'un fardeau, le fardeau de l'esclavage des Noirs des anciens Etats confédérés. Un fardeau perpétuel parce qu'il ne fut jamais assumé. Il est d'ailleurs très intéressant de lire aujourd'hui les dernières pages du livre au regard de l'actualité politique américaine et de la récente élection à la présidence de Barack Obama. William Faulkner était donc bien un génie de la littérature, puisqu'il nous parle encore, il parle à Obama, il parle aux Américains. Je ne sais pas si Marc Lévy, Dan Brown ou Amélie Nothomb leur parlent, parlent-ils d'ailleurs ? Non ! ils bavardent.
Absalom ! Absalom !
Traduction : R. N. Raimbault avec la collaboration de Ch. P. Vorce
ISBN : 9782070284849
L'apogée, le chef-d'oeuvre absolu. Un récit où quatre voix s'entremêlent étroitement dans une clameur pleine de tristesse, de désespoir, de férocité et de haine mais qui n'en reste pas moins, paradoxal et émouvant parallèle, un chant d'amour à la mémoire de ce Sud dont Faulkner ne cessa de dénoncer l'arrière-plan de corruption et d'injustice mais qu'il ne s'avéra jamais tout-à-fait capable de renier en raison des racines puissantes qu'il y puisait et qui constituent l'essence même de son génie. Un récit qui descend en droite ligne du "Bruit & la Fureur", tant par la technique utilisée - ellipses, vérité qui se dévoile peu à peu, points de vue multiples - que par la réapparition, pour l'occasion, du personnage de Quentin Compson. Une nouveauté cependant : son père, faible, fin de race et dévoré par l'alcoolisme, que l'on distingue toujours comme un être passif dans "Le Bruit ...", est ici une voix majeure. Il faut dire qu'il n'est pas encore mort - le récit en lui-même se situe en 1909, année qui précède d'un an le suicide de Quentin et de trois le décès de Mr Compson - et que les souvenirs de son propre père lui permettent d'éclaircir divers éléments de la tragédie qui emporta la famille Sutpen. Autre différence : en dépit des réitérations multiples, de la sinuosité travaillée des phrases (qui ne sont pas sans évoquer pour nous, Français, les longueurs, parfois brillantes, parfois désespérantes, d'un Marcel Proust) et du style quasi-hypnotique, lesquels portent tous fort bien la marque de l'auteur, la construction se révèle bien plus linéaire que dans "Le Bruit & la Fureur." Faulkner est ici au sommet de son art : de la première majuscule au point final, il maîtrise tout et même si l'on se doute bien que cela ne dut pas être facile d'en arriver à une telle splendeur, l'ensemble s'élève avec un tel naturel, une telle aisance, une telle beauté que le lecteur finit par ne plus songer à la somme de travail que représente sans conteste "Absalon ! Absalon !"
Les grands thèmes faulkneriens sont tous au rendez-vous : le Sud d'abord, celui d'avant la guerre de Sécession, puis de la Reconstruction, ce Sud qui mourut en 1865 à la reddition de Lee mais qui hante à jamais les Etats-Unis d'Amérique et qui, comble de ce raffinement qu'il symbolisait, parvient à se hanter lui-même - comme le dit si bien Wash Jones à Thomas Sutpen : "Y nous ont p'têt tués, mais y nous ont pas battus !" ; la famille maudite, écrasée sous le poids d'un patriarche dont le seul rêve fut de s'élever de sa condition de fils de tout petits fermiers des montagnes à celui de "gentleman du Sud" mais qui n'y parvint jamais réellement - en tous cas, pas de la manière dont il le souhaitait - parce que le Destin avait pipé dès le départ les dés avec lesquels il devait jouer sa partie ; la relation frère-soeur (et même frère-frère) aboutissant à un inceste aussi subtil que purement mental ; l'homosexualité latente, issue tout à la fois de la "virilité" imposée par le système sociétal que par les rapports que Faulkner entretenait, via sa mère, Maud Falkner, avec l'image de la Femme ; et, bien entendu, le Malheur, le Drame qui naît de tous ces non-dits sexuels au sein d'une société qui n'entendait vivre dans la mémoire des hommes que par son panache, sa bravoure et cette chevalerie dont "Autant En Emporte le Vent", sorti d'ailleurs la même année que "Absalon ! Absalon !" est le reflet résolu et prêt à tout pour occulter l'autre visage du Sud.
On le dit souvent : "Absalon ! Absalon!" et "Autant En Emporte le Vent" sont de parfaits opposés qui se complètent admirablement l'un l'autre. En outre, leurs auteurs respectifs, l'un en dénonçant avec fureur, l'autre en encensant avec ferveur, communient tous deux à la même source, devant l'autel sacré du Vieux Sud dont ils sont et seront toujours les enfants. Si "Autant En Emporte le Vent" offre le beau visage tourmenté mais idéaliste, voire utopique d'un romantisme qui se voile volontairement la face, "Absalon ..." prend à sa charge la part d'ombre du Sud qui n'est jamais aussi cruelle ni aussi franche que dans l'exploitation sexuelle de la femme noire. En n'hésitant pas à faire des enfants aux plus jolies esclaves de leurs domaines, les notables blancs ont été les premiers à contrevenir à la règle qui fonde leur société : en succombant à leur instinct sexuel, ils ont corrompu leur credo initial et hautement racial qui voulait que le sang noir ne se mélangeât sous aucun prétexte au sang blanc. Déjà, dans "Lumière d'Août", avec le personnage de Joe Christmas, Faulkner nous avait fait plonger au coeur de la tragédie que ce mélange engendrait pour ceux qui en naissaient - bien que le doute soit maintenu jusqu'à la fin sur les supposés ancêtres noirs de Joe. Avec "Absalon ! Absalon !", il mène le thème jusqu'à son explosion ultime, et ce avec un sadisme redoutable et un esprit que certains n'hésiteront pas à qualifier de "tordu" bien que, aussi sûrement qu'il a existé des planteurs comme Gerald O'Hara, le Sud a eu son lot de Thomas Sutpen.
En effet, Sutpen a eu un fils d'une première épouse dont il ignorait qu'elle avait du sang noir. Il la répudie en lui laissant cependant tous les biens qu'il avait pu acquérir à l'époque et il repart à l'aventure. Vingt ans plus tard, remarié avec une jeune fille de la meilleure société mississippienne, il a deux autres enfants, un fils, Henry, et une fille, Judith, lesquels développent avec le temps cette complicité troublante et semi-incestueuse qui existait déjà dans "Le Bruit et la Fureur" entre Quentin Compson et sa soeur, Candace. A l'université, Henry fait la connaissance de Charles Bon, qui est en fait son demi-frère et l'introduit alors dans sa famille. Les sentiments que Henry porte à cet homme dont il ne soupçonne absolument pas la parenté étroite qui les rapproche,sont au moins aussi ambigus que ceux qu'il éprouve envers leur soeur, Judith, et, pour résoudre le problème, l'idée lui vient de concocter un mariage entre les deux êtres qu'il aime le plus au monde, Charles et Judith : ainsi, tous trois resteront unis. Ce qui amène bien sûr Thomas Sutpen, au courant depuis le début la véritable identité de Charles, à dévoiler la vérité à Henry après avoir cherché à justifier son opposition au mariage par l'histoire d'une autre union, que Charles a conclue avec une octavonne de la New-Orleans dont il a d'ailleurs un fils ...
Les voyez-vous, l'ampleur, la grâce et la cruauté de cette superbe toile tissée - sans aucun pathos, rassurez-vous - par cette araignée sans égal qu'est le Destin ? Eh ! bien, ajoutez-y les obsessions personnelles de Faulkner et la maîtrise indéniable qu'il possédait à l'époque de toutes les méthodes modernistes qu'il avait mises et remises à l'épreuve dans les romans précédents, et vous commencerez à vous faire une (faible) idée d'"Absalon ! Absalon !", livre que nous tenons, à notre humble avis, pour le meilleur texte de son auteur, l'un de ces textes qu'on lit, qu'on relit et qu'on relit encore parce que l'on y découvre toujours quelque chose de nouveau.
De toutes façons, Faulkner est un auteur qu'il faut non seulement lire - bien que la prise de contact soit souvent très difficile - mais qui, après, ne vous lâche plus et que vous reprenez périodiquement sur vos étagères en vous demandant toujours et encore par quel miracle on peut atteindre un tel niveau dans l'écriture et la technique du récit. C'est le propre du génie, nous direz-vous. N'empêche : on n'arrête pas de se demander comment et pourquoi. Mais lisez vous-même "Absalon ! Absalon !" : vous verrez bien. ;o)
Traduction : R. N. Raimbault avec la collaboration de Ch. P. Vorce
ISBN : 9782070284849
L'apogée, le chef-d'oeuvre absolu. Un récit où quatre voix s'entremêlent étroitement dans une clameur pleine de tristesse, de désespoir, de férocité et de haine mais qui n'en reste pas moins, paradoxal et émouvant parallèle, un chant d'amour à la mémoire de ce Sud dont Faulkner ne cessa de dénoncer l'arrière-plan de corruption et d'injustice mais qu'il ne s'avéra jamais tout-à-fait capable de renier en raison des racines puissantes qu'il y puisait et qui constituent l'essence même de son génie. Un récit qui descend en droite ligne du "Bruit & la Fureur", tant par la technique utilisée - ellipses, vérité qui se dévoile peu à peu, points de vue multiples - que par la réapparition, pour l'occasion, du personnage de Quentin Compson. Une nouveauté cependant : son père, faible, fin de race et dévoré par l'alcoolisme, que l'on distingue toujours comme un être passif dans "Le Bruit ...", est ici une voix majeure. Il faut dire qu'il n'est pas encore mort - le récit en lui-même se situe en 1909, année qui précède d'un an le suicide de Quentin et de trois le décès de Mr Compson - et que les souvenirs de son propre père lui permettent d'éclaircir divers éléments de la tragédie qui emporta la famille Sutpen. Autre différence : en dépit des réitérations multiples, de la sinuosité travaillée des phrases (qui ne sont pas sans évoquer pour nous, Français, les longueurs, parfois brillantes, parfois désespérantes, d'un Marcel Proust) et du style quasi-hypnotique, lesquels portent tous fort bien la marque de l'auteur, la construction se révèle bien plus linéaire que dans "Le Bruit & la Fureur." Faulkner est ici au sommet de son art : de la première majuscule au point final, il maîtrise tout et même si l'on se doute bien que cela ne dut pas être facile d'en arriver à une telle splendeur, l'ensemble s'élève avec un tel naturel, une telle aisance, une telle beauté que le lecteur finit par ne plus songer à la somme de travail que représente sans conteste "Absalon ! Absalon !"
Les grands thèmes faulkneriens sont tous au rendez-vous : le Sud d'abord, celui d'avant la guerre de Sécession, puis de la Reconstruction, ce Sud qui mourut en 1865 à la reddition de Lee mais qui hante à jamais les Etats-Unis d'Amérique et qui, comble de ce raffinement qu'il symbolisait, parvient à se hanter lui-même - comme le dit si bien Wash Jones à Thomas Sutpen : "Y nous ont p'têt tués, mais y nous ont pas battus !" ; la famille maudite, écrasée sous le poids d'un patriarche dont le seul rêve fut de s'élever de sa condition de fils de tout petits fermiers des montagnes à celui de "gentleman du Sud" mais qui n'y parvint jamais réellement - en tous cas, pas de la manière dont il le souhaitait - parce que le Destin avait pipé dès le départ les dés avec lesquels il devait jouer sa partie ; la relation frère-soeur (et même frère-frère) aboutissant à un inceste aussi subtil que purement mental ; l'homosexualité latente, issue tout à la fois de la "virilité" imposée par le système sociétal que par les rapports que Faulkner entretenait, via sa mère, Maud Falkner, avec l'image de la Femme ; et, bien entendu, le Malheur, le Drame qui naît de tous ces non-dits sexuels au sein d'une société qui n'entendait vivre dans la mémoire des hommes que par son panache, sa bravoure et cette chevalerie dont "Autant En Emporte le Vent", sorti d'ailleurs la même année que "Absalon ! Absalon !" est le reflet résolu et prêt à tout pour occulter l'autre visage du Sud.
On le dit souvent : "Absalon ! Absalon!" et "Autant En Emporte le Vent" sont de parfaits opposés qui se complètent admirablement l'un l'autre. En outre, leurs auteurs respectifs, l'un en dénonçant avec fureur, l'autre en encensant avec ferveur, communient tous deux à la même source, devant l'autel sacré du Vieux Sud dont ils sont et seront toujours les enfants. Si "Autant En Emporte le Vent" offre le beau visage tourmenté mais idéaliste, voire utopique d'un romantisme qui se voile volontairement la face, "Absalon ..." prend à sa charge la part d'ombre du Sud qui n'est jamais aussi cruelle ni aussi franche que dans l'exploitation sexuelle de la femme noire. En n'hésitant pas à faire des enfants aux plus jolies esclaves de leurs domaines, les notables blancs ont été les premiers à contrevenir à la règle qui fonde leur société : en succombant à leur instinct sexuel, ils ont corrompu leur credo initial et hautement racial qui voulait que le sang noir ne se mélangeât sous aucun prétexte au sang blanc. Déjà, dans "Lumière d'Août", avec le personnage de Joe Christmas, Faulkner nous avait fait plonger au coeur de la tragédie que ce mélange engendrait pour ceux qui en naissaient - bien que le doute soit maintenu jusqu'à la fin sur les supposés ancêtres noirs de Joe. Avec "Absalon ! Absalon !", il mène le thème jusqu'à son explosion ultime, et ce avec un sadisme redoutable et un esprit que certains n'hésiteront pas à qualifier de "tordu" bien que, aussi sûrement qu'il a existé des planteurs comme Gerald O'Hara, le Sud a eu son lot de Thomas Sutpen.
En effet, Sutpen a eu un fils d'une première épouse dont il ignorait qu'elle avait du sang noir. Il la répudie en lui laissant cependant tous les biens qu'il avait pu acquérir à l'époque et il repart à l'aventure. Vingt ans plus tard, remarié avec une jeune fille de la meilleure société mississippienne, il a deux autres enfants, un fils, Henry, et une fille, Judith, lesquels développent avec le temps cette complicité troublante et semi-incestueuse qui existait déjà dans "Le Bruit et la Fureur" entre Quentin Compson et sa soeur, Candace. A l'université, Henry fait la connaissance de Charles Bon, qui est en fait son demi-frère et l'introduit alors dans sa famille. Les sentiments que Henry porte à cet homme dont il ne soupçonne absolument pas la parenté étroite qui les rapproche,sont au moins aussi ambigus que ceux qu'il éprouve envers leur soeur, Judith, et, pour résoudre le problème, l'idée lui vient de concocter un mariage entre les deux êtres qu'il aime le plus au monde, Charles et Judith : ainsi, tous trois resteront unis. Ce qui amène bien sûr Thomas Sutpen, au courant depuis le début la véritable identité de Charles, à dévoiler la vérité à Henry après avoir cherché à justifier son opposition au mariage par l'histoire d'une autre union, que Charles a conclue avec une octavonne de la New-Orleans dont il a d'ailleurs un fils ...
Les voyez-vous, l'ampleur, la grâce et la cruauté de cette superbe toile tissée - sans aucun pathos, rassurez-vous - par cette araignée sans égal qu'est le Destin ? Eh ! bien, ajoutez-y les obsessions personnelles de Faulkner et la maîtrise indéniable qu'il possédait à l'époque de toutes les méthodes modernistes qu'il avait mises et remises à l'épreuve dans les romans précédents, et vous commencerez à vous faire une (faible) idée d'"Absalon ! Absalon !", livre que nous tenons, à notre humble avis, pour le meilleur texte de son auteur, l'un de ces textes qu'on lit, qu'on relit et qu'on relit encore parce que l'on y découvre toujours quelque chose de nouveau.
De toutes façons, Faulkner est un auteur qu'il faut non seulement lire - bien que la prise de contact soit souvent très difficile - mais qui, après, ne vous lâche plus et que vous reprenez périodiquement sur vos étagères en vous demandant toujours et encore par quel miracle on peut atteindre un tel niveau dans l'écriture et la technique du récit. C'est le propre du génie, nous direz-vous. N'empêche : on n'arrête pas de se demander comment et pourquoi. Mais lisez vous-même "Absalon ! Absalon !" : vous verrez bien. ;o)
Dès la première phrase, on comprend que l'on vient d'ouvrir la porte d'un monument littéraire. Autant en emporte le vent pou les grands. La guerre de sécession comme on ne l'a jamais dite, le racisme qui coule dans le sang des petits blancs, leur monde qui s'effondre sans qu'ils vascillent, prêts à renaître après l'incendie. On entend derrière les mots grommeler un Faulkner groggy de désespérance, un auteur qui comme d'habitude n'aide pas son lecteur en choisissant la narration indirecte par les voix entrecroisées, auxquelles il semble mêler la sienne, de tante Rosa et d'un descendant pour raconter la terrible histoire du non moins terrible Stupen, sa détermination clinique à braver son destin et construire un empire dans le sud, sa relation complexe à l'autre et à la race, ses chutes et résurrections.
Au-delà de cette folle histoire, c'est réellement par l'écriture fascinante, lourde, hypnotique que Faulkner nous plonge avec lui dans l'ADN d'une certaine Amérique toujours bien vivante, elle.
Au-delà de cette folle histoire, c'est réellement par l'écriture fascinante, lourde, hypnotique que Faulkner nous plonge avec lui dans l'ADN d'une certaine Amérique toujours bien vivante, elle.
Quelque chose ne va pas dans (ce) Faulkner, et cette critique s'efforcera, sans le savoir d'avance, d'exprimer ce dont il s'agit.
On ne peut pas reprocher à un roman, je pense, la singulière littérarité qui en fait une oeuvre, c'est-à-dire une pièce d'art, au style distinct et ouvragé, élaborée : c'est un livre d'auteur véritable et original, que caractérise une fluence particulière et reconnaissable, un pléthorisme plutôt mathématique de la syntaxe, où les incises variées se juxtaposent sans souci de priorité thématique, où surabondent des détails de circonstances, où des développements de théorème s'encastrent selon des lois pratiques de comptables, où le travail des insertions et encastrements implique un calcul de binarités, où la complémentation de phrase devient une habitude qui tend à soustraire la simplicité de la beauté, où les inclusions, intégrations et accumulations servent un goût d'allongement où la loquacité presque complaisante frôle la verbosité superflue. Toutes ces exacerbations, chez le lecteur philologue, créent perplexité et soupçon, car elles confinent au déploiement d'épate, au point qu'il n'est pas douteux que l'auteur lui-même se soit contraint à reporter, ici ou là, comme une retenue, la proposition principale. Ces périodes arrêtées, dont la fixation traduit comme un arbitraire de pseudo-audace et de caractérisation, bien qu'assez fines pour ne jamais confiner à l'asphyxie (si Faulkner à un génie, c'est celui de la dose-limite ; il a la science de la posologie où le lecteur s'estime instruit et élevé de sa patience sans pour autant se trouver épuisé de multiplications circonstancielles – c'est très malin, cette façon d'aller à la rencontre d'un public de culture qui ne soit pas encore un public de niche, pas aussi rare), constituent, par le dessin de leurs arabesques et la densité qu'elles suggèrent, pour le lecteur un additif typique à la sensation de profondeur, et pour l'auteur sans doute un repère idéal de haut style. Or, c'est également, comme tout effet qu'un écrivain a trouvé et dont il ne se sépare plus, une sorte de tic ou de méthode, un procédé traduisant une image personnelle à rendre (peut-être l'image de sagesse que confère la réalisation d'une certaine complication vaine) ou un système déterminé à ne pas déroger (c'est une expérience commune, quand on s'est reconnu une patte en des figures récurrentes, de craindre d'en changer et d'attribuer le principal de sa confiance à la perpétuation de procédés identiques) plutôt qu'un moyen de vérité ou de transmission, et ce mécanisme de complémentation figure en maints endroits une technique manifestement inutile et probablement forcée, sans autre apport qu'un maniérisme et qu'une démonstration, et même une entrave au message, trop ostentatoire, un leurre peut-être, une illusion de bravoure en ce que ces amples rebonds, ces phrases perpétuellement relancées, renvoient un peu facilement à une représentation de profondeur comme les euphuismes de Shakespeare, confortant l'auteur lui-même, que je soupçonne d'avoir été au moins aussi finaud que fin, dans une posture d'artiste novateur, tandis qu'à bien y regarder ces longues prothèses syntaxiques, qui ne sont pas si ardues à produire et nécessitent plus de science et de patience que de sensibilité et de poésie, ne servent guère au sens, sinon, d'artifice ou d'autorité, en induisant une sensation d'épanchement intarissable, un sentiment d'irrépressible humanité, une conception de ductilité fatidique de la parole, sans parler de la théorie absolument fausse d'une transcription de l'oralité, théorie que, dans notre monde d'universitariens artificiels et appesantis, il est impossible qu'un microcosme aussi savant qu'artificieux n'ait pas reconnue. Il est d'usage, particulièrement chez les auteurs que des usages ont salués et installés dans le respect inconditionnel de la postérité, parmi ceux où l'on traque les valeurs bien davantage que la réalité des vices et des vertus, de confondre le haut style avec une syntaxe simplement allongée, de fabriquer de la profondeur spirituelle sur un fonds d'emphases et d'hypotaxes, d'indissocier définitivement l'envol supposé des pensées avec les excès de l'expression – où le génie ne devrait pas nécessairement appartenir à celui qui épate et qui enfle, à mon avis, mais je ne veux, à ce stade de mon article, rien présumer de Faulkner lui-même. Seulement, je remarque que l'indéniable méticulosité de son style et de son vocabulaire, qualité irréfragable de l'écrivain qui compose et élabore, s'accompagne malgré tout de superfétations caractérisées qui ne semblent souvent servir qu'à marquer l'idiosyncrasie à la façon des impressionnistes ou des pointillistes, qu'à insister sur la singularité à la façon des nouveaux-romanciers, qu'à induire l'idée d'une rupture à la façon des conceptualistes, mais sans nets apports expressifs ou spirituels – comme on trouva moderne et opportun de procéder dès la fin du XIXe siècle et en tous arts après avoir constaté les triomphes de la publicité dans une florissante et superficielle société de consommation où lançage et tapage attiraient bien plus l'attention que la qualité et l'effort. Et, en l'occurrence, j'affirme qu'il n'est pas vraisemblable qu'un esprit ait développé le style de ce Faulkner à l'imitation d'un sentiment intime et d'une nécessité impérieuse, il s'y mêle trop de factice, d'abruption, d'incohérence, d'inconséquence, en un mot appliqué ici à l'esprit de « solution de continuité », en décalage avec les ressorts (psycho)logiques de l'imagination et du langage, et que d'ailleurs c'est régulièrement qu'on peut percevoir, examiner et démontrer la façon dont l'écrivain, arrivant au bout de son période mental, s'efforce d'y adjoindre par contrainte une multitude de propositions circonstancielles sans qu'elles y apportent plus, à cet endroit d'essoufflement précis, qu'une parure relative et qu'une unifiante référence – comme, disais-je, une tentative de style qui aurait finalement bien pris, stratagème d'entre-deux ou d'après-guerre valorisé par une époque entichée de mode et dont le clinquant relatif faisait les engouements et les succès populaires ou critiques – ; Faulkner me paraît en cela aussi un poseur, « aussi » c'est-à-dire : sans exclusion de talent.
Quant à la composition, Absalon, Absalon ! relève sans conteste d'une intrigue fouillée et intelligemment mise en scène, difficile et subtile, délicate, abondante d'intentions et de défis, avec sa succession de narrateurs parvenant à compléter par révélations successives et insérées astucieusement, la relation d'une vie, celle de Thomas Sutpen, dont la brutale irruption dans un village du sud des États-Unis évoque les entités sombres et inhumaines, instables et torturées, de créatures des Brontë ou de Conrad, je pense à Heathcliff et à Kurtz, à Lord Jim ou à James Durie chez Stevenson. La progression, extrêmement soignée et planifiée, livre de façon comme involontaire et fortuite, les secrets du protagoniste, ses motifs profonds, ses recels d'expériences et de frustration, ses excuses l'ayant mené aux entreprises hardies et a priori incompréhensibles qu'on constate au début du roman, en un récit achronologique qui établit les causes principales et de plus en plus intimes de son caractère, et qui explique une partie de ses bizarreries et de ses violences, mais, exactement à l'instar des personnages que j'ai cités, sans éclaircir foncièrement toutes ses réactions et la tournure étrangère, imprévisible et démoniaque, de son esprit intrus. C'est alors par besoin d'auteur et probablement encore par astuce que se mêle au portrait de ces sombreurs que l'intégralité de leur histoire ne suffit à circonvenir un ingrédient supplémentaire, en l'espèce d'une destinée, d'une force maudite, d'une tension de paria, qui est malgré tout un instrument trop commode et devrait censément excuser les développements peu crédibles d'une personnalité. Car, en somme, ni Sutpen, ni Heatcliff, ni Kurtz, ni Lord Jim et ni James Durie ne sont ni ne seront véritablement ou même profondément expliqués ; ce que leur relation apprend au lecteur ne justifie pas ce qu'ils sont devenus ni comment ils se comportent, leur intrinsèque inhumanité, leur altérité ou leur aliénité (si l'on me pardonne cette création), tandis que le roman s'était initialement proposé leur peinture éclairante, incapable in fine de tenir sa promesse : on prétendra que le personnage « déborde la fiction » et qu'il a pris telle consistance et telle densité qu'il échappe à l'emprise de son auteur et du récit, qu'il a surgi dans le monde des hommes en quittant celui des personnages circonscrits à force de vraisemblance, et ce sera alors un joli mot de piètre critique, dans une analyse favorablement prévenue, que d'affirmer la preuve que le personnage est supérieurement développé puisqu'il devient alors un être qu'il est impossible « comme dans la réalité » (à ce qu'on veut croire) de définir tout à fait par le récit et la somme de ses expériences, belle vantardise littéraire ! Mais d'autres plus profonds et plus justes auront des scrupules à soutenir de pareilles naïvetés, voyant que pas davantage Fitzgerald n'explique Gatsby, et que la manière dont l'écrivain achoppe à tenir la cohérence d'un protagoniste dont l'oeuvre repose a priori sur l'intérêt d'un mystère progressivement dévoilé et d'une explicitation complète d'un individu constitue une inaptitude et une déception, un aveu d'échec ou plutôt une dissimulation d'échec, en somme que l'auteur a failli à son propre but que rien ni personne ne l'obligeait à fixer : ce n'est pas, au contraire de ce qu'on vante, que le personnage fut si finement tracé qu'il est devenu plus vrai que nature et ainsi ne peut plus trouver d'explication dans le cadre même du récit et de la conscience de son propre créateur (parce qu'il aurait, en quelque sorte, évolué par lui-même et acquis une réalité autonome en-dehors de la conception du démiurge) – cette vision romantique n'a rien de technique ou de critique, elle considère par défaut que le personnage est une conscience, c'est une vision poétique, symboliste et puérile qui fait fit de toute notion narratologique et créative –, mais c'est que l'auteur n'a pas tenu les rênes de son projet en se cantonnant aux règles de vraisemblance, car en vérité cet être de papier n'existe pas davantage à dépasser les normes de la psychologie et de la cohérence humaines, bien au contraire il existe moins, il est moins un individu et plus une convention, il devient une représentation et un acteur puisqu'il n'a pas de causalité à la différence d'une personne véritable (car au monde, foin des mièvreries ! il n'existe pas de mentalité sans étroite cohérence c'est-à-dire de psychologie inexplicable), il est surtout un rôle que le dramaturge n'est pas parvenu à rendre plausible, dont il a oublié ou abandonné la peinture de pans si vastes et nécessaires que le portrait est demeuré inachevé par bien des morceaux auxquels il accorde in extremis le nom de « mystères » pour se rattraper : et par quelle complaisance se satisfaire que le tableau expose la trame blanche de la toile non peinte au prétexte qu'ainsi on ignore davantage le sujet présenté, qu'on le perçoit moins net, ce qui correspondrait, pour les gens ignorants ou incurieux de la vie, au caractère de tout sujet réel ? Si l'on se propose à composer une mélodie comme on dresse avec art une méticuleuse et exacte description, ce n'est sans doute pas pour finir par indiquer qu'on ne sait pas à quoi sert telle mesure ou telle note, que la symphonie est essentiellement un hasard, et que c'est d'ailleurs une preuve de perfection qu'on ne puisse pas expliquer comment elle est construite et se justifie puisque « dans la nature » rien ne précise l'origine des sons. C'est une question de cohérence et de fidélité à un projet : si en particulier un romancier propose principalement le dévoilement de l'énigme d'un caractère, je n'aurais pas mon compte à ce qu'il arguât que son personnage, dont je ne suis pas dupe qu'il l'a inventé de (presque) toutes pièces, est « à ce point humain et crédible qu'il ne se décèle pas en son entier » car ce n'est rien qu'un personnage, contrairement à l'illusion que l'auteur veut en donner d'une personne réelle dont la compréhension, pour le siècle ordinaire des apparences, ne saurait être absolue, quelles que soient les analogies de vérités qu'il sert dans son livre pour entretenir une semblable illusion d'authenticité. Ici, on lit, page 127 : « Oui, Judith, Bon, Henry, Sutpen, tous autant qu'ils sont. Les voilà tous, mais il manque quelque chose : on dirait une formule chimique exhumée en même temps que les lettres de ce coffre oublié, avec précaution, le papier ancien et passé tombant en morceaux, l'écriture passée, presque indéchiffrable, mais significative, familière dans sa forme et son sens, disant le nom et la présence de forces instables et vivantes ; on les mélange dans les proportions requises, mais rien ne se produit ; on relit la formule, lentement, attentivement, pour s'y absorber et s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs ; on mélange de nouveau et, de nouveau, rien ne se produit ; rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, indistinctes, énigmatiques et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine. » ; et je pardonne cette insistance à entretenir l'illusion, il n'y a même rien à pardonner puisque la citation s'inscrit elle-même dans l'illusion de la fiction, prêtant aux personnages du roman une indubitable réalité comme s'ils avaient existé et comme s'ils étaient patiemment reconstitués par leurs témoins et successeurs (ce qui est un procédé dont a priori nul n'est dupe), mais, quand il l'écrit, Faulkner sait pertinemment que la seule vérité de cette citation c'est sa généralisation à toute autre chose qu'au roman même qu'il rédige, que le seul univers auquel il est certain que cette citation ne peut pas s'appliquer est précisément celui qu'il a fabriqué pour Absalon, Absalon !, et l'on peut l'imaginer sans mal s'amuser de ce mensonge et se dire : « Mais Judith, Bon, Henry et Sutpen tous autant qu'ils ne sont pas, justement ! Hé ! La bonne trouvaille que d'en faire sortir des lettres d'une malle : leurs papiers, ce ne sont que les mots que j'ai, moi, inventés et que j'arbore comme des pièces certifiées, tous ces faux en écriture ! » Ainsi, son personnage est bel et bien création et composition et non transposition ou témoignage, et si son dessein est de ramener au domaine de la vraisemblance un être de fiction dont les attitudes sont d'emblée inexplicables, alors il est logique de considérer que toute l'oeuvre doit être, du point de vue des motivations, une démonstration de rigueur et de contrôle, au même titre que Les quatre saisons de Vivaldi ne peut se permettre d'inclure un nombre essentiel de sonorités qui n'empruntent rien à la nature que son projet consiste à imiter. Dès lors, l'excuse du personnage qui serait « devenu si réel qu'il ne trouve pas d'explication » trompe et entourloupe, c'est une façon de jouer sur plusieurs plans et d'abuser ensuite de la confusion du lecteur et de son oubli de l'intention initiale, car ou bien l'auteur proposait autre chose que le dévoilement d'un personnage, proposant par exemple la livraison « telle quelle » d'une mentalité plausible et largement obscure, et alors il a eu tort de focaliser l'attention sur des énigmes qu'il a progressivement levées, ou bien dans son projet d'explicitation d'une étrange humeur il a failli à en identifier les causes, se laissant déborder par l'ampleur du caractère qu'il souhaitait d'emblée dépeindre et qu'il n'a pas réussi à démêler, et alors il a eu tort de vouloir passer son incapacité, son insuffisance, son renoncement et sa déception en la vraisemblance selon quoi « un homme réel ne saurait entièrement se définir » ; autrement dit, ou bien il inclut un personnage relativement arbitraire dans la fiction comme une personne surgissant impromptue dans l'existence, ou bien il propose l'examen méthodique de ce personnage réaliste dont il fait le sujet même de sa fiction, mais, en l'occurrence, Faulkner, après avoir imité le psychologue et l'analyste, finit par abandonner la gageure qu'il s'est fixée en s'écriant : « la psychologie et l'analyse sont dérisoires à remonter l'origine de cet homme… et voilà qui est heureux ! » : pétition de principe où il finit par admettre la réalité d'un homme qu'il n'est pas parvenu à créer dans toute sa vraisemblance… oui, ça semble une sagesse ainsi dit, ce miracle du personnage qui, indéfinissable au juste, prend vie, à l'exception que c'est lui qui a fabriqué son sujet, ce qu'il ne faut tout de même pas oublier !
Car enfin, il faut y insister, Sutpen pas davantage que la plupart des autres personnages du roman n'est expliqué de façon satisfaisante, il n'est pas crédible d'un point de vue humain, il ne s'élabore pas, au bout du compte, comme une mentalité cohérente, toutes ses péripéties ne traduisent pas une volonté intègre et constante et aucune ne justifie ce qu'il est devenu, au point que ce qu'il reste de plus fascinant chez cette figure – comme chez Heathcliff, Kurtz, Lord Jim, James Durie et peut-être Gatsby (je ne sais plus) – c'est leur dimension absurde et arbitraire, c'est la façon dont le drame romanesque, en un maniérisme excessif, introduit dans des intrigues vraisemblables des éléments irrationnels que le contexte plausible enrobe et emporte, par abus du lecteur sentimental et naïf, ce lecteur décidément sans distance sur ce qu'il fait quand il lit une histoire, ce lecteur sans recul critique ni analyse élémentaire, éléments irrationnels qu'il rapporte dans le tout façonné et relativement plausible d'un univers crédible, feignant de prêter lui-même, auteur, foi aux inventions les plus énormes, comme on échafaude le faux témoignage convaincant à partir de vérités majoritaires auxquelles il ajoute de ponctuels mensonges. Mais ce n'est qu'à la condition de ce sentimentalisme et de cette naïveté principiels justement, que je ne suppose pourtant point l'apanage de la littérature ni le nécessaire pour entrer efficacement dans un récit, que ces héros transportent, que le lecteur se laisse envahir par ces idioties, qu'il abdique son esprit en bienheureuse confiance, et que la mémoire d'une postérité conserve de pareils fantoches comme références, parce qu'ils sont plus que largement bizarres, au même titre que nombre de difformités de Shakespeare ou de Hugo, comme des trésors d'imagination, alors qu'ils ne consistent en fait qu'en des grotesques introduits en semi-tapinois dans la réalité à l'occasion d'un endormissement de vigilance du lecteur. Jamais Sutpen ne donne à l'examen du philologue sérieux une impression de bon aloi et de science, de rigueur : l'obstination même du lecteur à le comprendre ne procède que de cette promesse tacite qu'au terme du roman ses étrangetés seront découvertes et expliquées, faute de cela le lecteur ne s'y intéresserait même pas tant – est-ce qu'on comprend davantage Heathcliff ou Kurtz ? La persistance de l'énigme au-delà du livre, loin de fonder le gage d'une fascinante réussite, est, j'ose le dire, u
Lien : http://henrywar.canalblog.com
On ne peut pas reprocher à un roman, je pense, la singulière littérarité qui en fait une oeuvre, c'est-à-dire une pièce d'art, au style distinct et ouvragé, élaborée : c'est un livre d'auteur véritable et original, que caractérise une fluence particulière et reconnaissable, un pléthorisme plutôt mathématique de la syntaxe, où les incises variées se juxtaposent sans souci de priorité thématique, où surabondent des détails de circonstances, où des développements de théorème s'encastrent selon des lois pratiques de comptables, où le travail des insertions et encastrements implique un calcul de binarités, où la complémentation de phrase devient une habitude qui tend à soustraire la simplicité de la beauté, où les inclusions, intégrations et accumulations servent un goût d'allongement où la loquacité presque complaisante frôle la verbosité superflue. Toutes ces exacerbations, chez le lecteur philologue, créent perplexité et soupçon, car elles confinent au déploiement d'épate, au point qu'il n'est pas douteux que l'auteur lui-même se soit contraint à reporter, ici ou là, comme une retenue, la proposition principale. Ces périodes arrêtées, dont la fixation traduit comme un arbitraire de pseudo-audace et de caractérisation, bien qu'assez fines pour ne jamais confiner à l'asphyxie (si Faulkner à un génie, c'est celui de la dose-limite ; il a la science de la posologie où le lecteur s'estime instruit et élevé de sa patience sans pour autant se trouver épuisé de multiplications circonstancielles – c'est très malin, cette façon d'aller à la rencontre d'un public de culture qui ne soit pas encore un public de niche, pas aussi rare), constituent, par le dessin de leurs arabesques et la densité qu'elles suggèrent, pour le lecteur un additif typique à la sensation de profondeur, et pour l'auteur sans doute un repère idéal de haut style. Or, c'est également, comme tout effet qu'un écrivain a trouvé et dont il ne se sépare plus, une sorte de tic ou de méthode, un procédé traduisant une image personnelle à rendre (peut-être l'image de sagesse que confère la réalisation d'une certaine complication vaine) ou un système déterminé à ne pas déroger (c'est une expérience commune, quand on s'est reconnu une patte en des figures récurrentes, de craindre d'en changer et d'attribuer le principal de sa confiance à la perpétuation de procédés identiques) plutôt qu'un moyen de vérité ou de transmission, et ce mécanisme de complémentation figure en maints endroits une technique manifestement inutile et probablement forcée, sans autre apport qu'un maniérisme et qu'une démonstration, et même une entrave au message, trop ostentatoire, un leurre peut-être, une illusion de bravoure en ce que ces amples rebonds, ces phrases perpétuellement relancées, renvoient un peu facilement à une représentation de profondeur comme les euphuismes de Shakespeare, confortant l'auteur lui-même, que je soupçonne d'avoir été au moins aussi finaud que fin, dans une posture d'artiste novateur, tandis qu'à bien y regarder ces longues prothèses syntaxiques, qui ne sont pas si ardues à produire et nécessitent plus de science et de patience que de sensibilité et de poésie, ne servent guère au sens, sinon, d'artifice ou d'autorité, en induisant une sensation d'épanchement intarissable, un sentiment d'irrépressible humanité, une conception de ductilité fatidique de la parole, sans parler de la théorie absolument fausse d'une transcription de l'oralité, théorie que, dans notre monde d'universitariens artificiels et appesantis, il est impossible qu'un microcosme aussi savant qu'artificieux n'ait pas reconnue. Il est d'usage, particulièrement chez les auteurs que des usages ont salués et installés dans le respect inconditionnel de la postérité, parmi ceux où l'on traque les valeurs bien davantage que la réalité des vices et des vertus, de confondre le haut style avec une syntaxe simplement allongée, de fabriquer de la profondeur spirituelle sur un fonds d'emphases et d'hypotaxes, d'indissocier définitivement l'envol supposé des pensées avec les excès de l'expression – où le génie ne devrait pas nécessairement appartenir à celui qui épate et qui enfle, à mon avis, mais je ne veux, à ce stade de mon article, rien présumer de Faulkner lui-même. Seulement, je remarque que l'indéniable méticulosité de son style et de son vocabulaire, qualité irréfragable de l'écrivain qui compose et élabore, s'accompagne malgré tout de superfétations caractérisées qui ne semblent souvent servir qu'à marquer l'idiosyncrasie à la façon des impressionnistes ou des pointillistes, qu'à insister sur la singularité à la façon des nouveaux-romanciers, qu'à induire l'idée d'une rupture à la façon des conceptualistes, mais sans nets apports expressifs ou spirituels – comme on trouva moderne et opportun de procéder dès la fin du XIXe siècle et en tous arts après avoir constaté les triomphes de la publicité dans une florissante et superficielle société de consommation où lançage et tapage attiraient bien plus l'attention que la qualité et l'effort. Et, en l'occurrence, j'affirme qu'il n'est pas vraisemblable qu'un esprit ait développé le style de ce Faulkner à l'imitation d'un sentiment intime et d'une nécessité impérieuse, il s'y mêle trop de factice, d'abruption, d'incohérence, d'inconséquence, en un mot appliqué ici à l'esprit de « solution de continuité », en décalage avec les ressorts (psycho)logiques de l'imagination et du langage, et que d'ailleurs c'est régulièrement qu'on peut percevoir, examiner et démontrer la façon dont l'écrivain, arrivant au bout de son période mental, s'efforce d'y adjoindre par contrainte une multitude de propositions circonstancielles sans qu'elles y apportent plus, à cet endroit d'essoufflement précis, qu'une parure relative et qu'une unifiante référence – comme, disais-je, une tentative de style qui aurait finalement bien pris, stratagème d'entre-deux ou d'après-guerre valorisé par une époque entichée de mode et dont le clinquant relatif faisait les engouements et les succès populaires ou critiques – ; Faulkner me paraît en cela aussi un poseur, « aussi » c'est-à-dire : sans exclusion de talent.
Quant à la composition, Absalon, Absalon ! relève sans conteste d'une intrigue fouillée et intelligemment mise en scène, difficile et subtile, délicate, abondante d'intentions et de défis, avec sa succession de narrateurs parvenant à compléter par révélations successives et insérées astucieusement, la relation d'une vie, celle de Thomas Sutpen, dont la brutale irruption dans un village du sud des États-Unis évoque les entités sombres et inhumaines, instables et torturées, de créatures des Brontë ou de Conrad, je pense à Heathcliff et à Kurtz, à Lord Jim ou à James Durie chez Stevenson. La progression, extrêmement soignée et planifiée, livre de façon comme involontaire et fortuite, les secrets du protagoniste, ses motifs profonds, ses recels d'expériences et de frustration, ses excuses l'ayant mené aux entreprises hardies et a priori incompréhensibles qu'on constate au début du roman, en un récit achronologique qui établit les causes principales et de plus en plus intimes de son caractère, et qui explique une partie de ses bizarreries et de ses violences, mais, exactement à l'instar des personnages que j'ai cités, sans éclaircir foncièrement toutes ses réactions et la tournure étrangère, imprévisible et démoniaque, de son esprit intrus. C'est alors par besoin d'auteur et probablement encore par astuce que se mêle au portrait de ces sombreurs que l'intégralité de leur histoire ne suffit à circonvenir un ingrédient supplémentaire, en l'espèce d'une destinée, d'une force maudite, d'une tension de paria, qui est malgré tout un instrument trop commode et devrait censément excuser les développements peu crédibles d'une personnalité. Car, en somme, ni Sutpen, ni Heatcliff, ni Kurtz, ni Lord Jim et ni James Durie ne sont ni ne seront véritablement ou même profondément expliqués ; ce que leur relation apprend au lecteur ne justifie pas ce qu'ils sont devenus ni comment ils se comportent, leur intrinsèque inhumanité, leur altérité ou leur aliénité (si l'on me pardonne cette création), tandis que le roman s'était initialement proposé leur peinture éclairante, incapable in fine de tenir sa promesse : on prétendra que le personnage « déborde la fiction » et qu'il a pris telle consistance et telle densité qu'il échappe à l'emprise de son auteur et du récit, qu'il a surgi dans le monde des hommes en quittant celui des personnages circonscrits à force de vraisemblance, et ce sera alors un joli mot de piètre critique, dans une analyse favorablement prévenue, que d'affirmer la preuve que le personnage est supérieurement développé puisqu'il devient alors un être qu'il est impossible « comme dans la réalité » (à ce qu'on veut croire) de définir tout à fait par le récit et la somme de ses expériences, belle vantardise littéraire ! Mais d'autres plus profonds et plus justes auront des scrupules à soutenir de pareilles naïvetés, voyant que pas davantage Fitzgerald n'explique Gatsby, et que la manière dont l'écrivain achoppe à tenir la cohérence d'un protagoniste dont l'oeuvre repose a priori sur l'intérêt d'un mystère progressivement dévoilé et d'une explicitation complète d'un individu constitue une inaptitude et une déception, un aveu d'échec ou plutôt une dissimulation d'échec, en somme que l'auteur a failli à son propre but que rien ni personne ne l'obligeait à fixer : ce n'est pas, au contraire de ce qu'on vante, que le personnage fut si finement tracé qu'il est devenu plus vrai que nature et ainsi ne peut plus trouver d'explication dans le cadre même du récit et de la conscience de son propre créateur (parce qu'il aurait, en quelque sorte, évolué par lui-même et acquis une réalité autonome en-dehors de la conception du démiurge) – cette vision romantique n'a rien de technique ou de critique, elle considère par défaut que le personnage est une conscience, c'est une vision poétique, symboliste et puérile qui fait fit de toute notion narratologique et créative –, mais c'est que l'auteur n'a pas tenu les rênes de son projet en se cantonnant aux règles de vraisemblance, car en vérité cet être de papier n'existe pas davantage à dépasser les normes de la psychologie et de la cohérence humaines, bien au contraire il existe moins, il est moins un individu et plus une convention, il devient une représentation et un acteur puisqu'il n'a pas de causalité à la différence d'une personne véritable (car au monde, foin des mièvreries ! il n'existe pas de mentalité sans étroite cohérence c'est-à-dire de psychologie inexplicable), il est surtout un rôle que le dramaturge n'est pas parvenu à rendre plausible, dont il a oublié ou abandonné la peinture de pans si vastes et nécessaires que le portrait est demeuré inachevé par bien des morceaux auxquels il accorde in extremis le nom de « mystères » pour se rattraper : et par quelle complaisance se satisfaire que le tableau expose la trame blanche de la toile non peinte au prétexte qu'ainsi on ignore davantage le sujet présenté, qu'on le perçoit moins net, ce qui correspondrait, pour les gens ignorants ou incurieux de la vie, au caractère de tout sujet réel ? Si l'on se propose à composer une mélodie comme on dresse avec art une méticuleuse et exacte description, ce n'est sans doute pas pour finir par indiquer qu'on ne sait pas à quoi sert telle mesure ou telle note, que la symphonie est essentiellement un hasard, et que c'est d'ailleurs une preuve de perfection qu'on ne puisse pas expliquer comment elle est construite et se justifie puisque « dans la nature » rien ne précise l'origine des sons. C'est une question de cohérence et de fidélité à un projet : si en particulier un romancier propose principalement le dévoilement de l'énigme d'un caractère, je n'aurais pas mon compte à ce qu'il arguât que son personnage, dont je ne suis pas dupe qu'il l'a inventé de (presque) toutes pièces, est « à ce point humain et crédible qu'il ne se décèle pas en son entier » car ce n'est rien qu'un personnage, contrairement à l'illusion que l'auteur veut en donner d'une personne réelle dont la compréhension, pour le siècle ordinaire des apparences, ne saurait être absolue, quelles que soient les analogies de vérités qu'il sert dans son livre pour entretenir une semblable illusion d'authenticité. Ici, on lit, page 127 : « Oui, Judith, Bon, Henry, Sutpen, tous autant qu'ils sont. Les voilà tous, mais il manque quelque chose : on dirait une formule chimique exhumée en même temps que les lettres de ce coffre oublié, avec précaution, le papier ancien et passé tombant en morceaux, l'écriture passée, presque indéchiffrable, mais significative, familière dans sa forme et son sens, disant le nom et la présence de forces instables et vivantes ; on les mélange dans les proportions requises, mais rien ne se produit ; on relit la formule, lentement, attentivement, pour s'y absorber et s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs ; on mélange de nouveau et, de nouveau, rien ne se produit ; rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, indistinctes, énigmatiques et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine. » ; et je pardonne cette insistance à entretenir l'illusion, il n'y a même rien à pardonner puisque la citation s'inscrit elle-même dans l'illusion de la fiction, prêtant aux personnages du roman une indubitable réalité comme s'ils avaient existé et comme s'ils étaient patiemment reconstitués par leurs témoins et successeurs (ce qui est un procédé dont a priori nul n'est dupe), mais, quand il l'écrit, Faulkner sait pertinemment que la seule vérité de cette citation c'est sa généralisation à toute autre chose qu'au roman même qu'il rédige, que le seul univers auquel il est certain que cette citation ne peut pas s'appliquer est précisément celui qu'il a fabriqué pour Absalon, Absalon !, et l'on peut l'imaginer sans mal s'amuser de ce mensonge et se dire : « Mais Judith, Bon, Henry et Sutpen tous autant qu'ils ne sont pas, justement ! Hé ! La bonne trouvaille que d'en faire sortir des lettres d'une malle : leurs papiers, ce ne sont que les mots que j'ai, moi, inventés et que j'arbore comme des pièces certifiées, tous ces faux en écriture ! » Ainsi, son personnage est bel et bien création et composition et non transposition ou témoignage, et si son dessein est de ramener au domaine de la vraisemblance un être de fiction dont les attitudes sont d'emblée inexplicables, alors il est logique de considérer que toute l'oeuvre doit être, du point de vue des motivations, une démonstration de rigueur et de contrôle, au même titre que Les quatre saisons de Vivaldi ne peut se permettre d'inclure un nombre essentiel de sonorités qui n'empruntent rien à la nature que son projet consiste à imiter. Dès lors, l'excuse du personnage qui serait « devenu si réel qu'il ne trouve pas d'explication » trompe et entourloupe, c'est une façon de jouer sur plusieurs plans et d'abuser ensuite de la confusion du lecteur et de son oubli de l'intention initiale, car ou bien l'auteur proposait autre chose que le dévoilement d'un personnage, proposant par exemple la livraison « telle quelle » d'une mentalité plausible et largement obscure, et alors il a eu tort de focaliser l'attention sur des énigmes qu'il a progressivement levées, ou bien dans son projet d'explicitation d'une étrange humeur il a failli à en identifier les causes, se laissant déborder par l'ampleur du caractère qu'il souhaitait d'emblée dépeindre et qu'il n'a pas réussi à démêler, et alors il a eu tort de vouloir passer son incapacité, son insuffisance, son renoncement et sa déception en la vraisemblance selon quoi « un homme réel ne saurait entièrement se définir » ; autrement dit, ou bien il inclut un personnage relativement arbitraire dans la fiction comme une personne surgissant impromptue dans l'existence, ou bien il propose l'examen méthodique de ce personnage réaliste dont il fait le sujet même de sa fiction, mais, en l'occurrence, Faulkner, après avoir imité le psychologue et l'analyste, finit par abandonner la gageure qu'il s'est fixée en s'écriant : « la psychologie et l'analyse sont dérisoires à remonter l'origine de cet homme… et voilà qui est heureux ! » : pétition de principe où il finit par admettre la réalité d'un homme qu'il n'est pas parvenu à créer dans toute sa vraisemblance… oui, ça semble une sagesse ainsi dit, ce miracle du personnage qui, indéfinissable au juste, prend vie, à l'exception que c'est lui qui a fabriqué son sujet, ce qu'il ne faut tout de même pas oublier !
Car enfin, il faut y insister, Sutpen pas davantage que la plupart des autres personnages du roman n'est expliqué de façon satisfaisante, il n'est pas crédible d'un point de vue humain, il ne s'élabore pas, au bout du compte, comme une mentalité cohérente, toutes ses péripéties ne traduisent pas une volonté intègre et constante et aucune ne justifie ce qu'il est devenu, au point que ce qu'il reste de plus fascinant chez cette figure – comme chez Heathcliff, Kurtz, Lord Jim, James Durie et peut-être Gatsby (je ne sais plus) – c'est leur dimension absurde et arbitraire, c'est la façon dont le drame romanesque, en un maniérisme excessif, introduit dans des intrigues vraisemblables des éléments irrationnels que le contexte plausible enrobe et emporte, par abus du lecteur sentimental et naïf, ce lecteur décidément sans distance sur ce qu'il fait quand il lit une histoire, ce lecteur sans recul critique ni analyse élémentaire, éléments irrationnels qu'il rapporte dans le tout façonné et relativement plausible d'un univers crédible, feignant de prêter lui-même, auteur, foi aux inventions les plus énormes, comme on échafaude le faux témoignage convaincant à partir de vérités majoritaires auxquelles il ajoute de ponctuels mensonges. Mais ce n'est qu'à la condition de ce sentimentalisme et de cette naïveté principiels justement, que je ne suppose pourtant point l'apanage de la littérature ni le nécessaire pour entrer efficacement dans un récit, que ces héros transportent, que le lecteur se laisse envahir par ces idioties, qu'il abdique son esprit en bienheureuse confiance, et que la mémoire d'une postérité conserve de pareils fantoches comme références, parce qu'ils sont plus que largement bizarres, au même titre que nombre de difformités de Shakespeare ou de Hugo, comme des trésors d'imagination, alors qu'ils ne consistent en fait qu'en des grotesques introduits en semi-tapinois dans la réalité à l'occasion d'un endormissement de vigilance du lecteur. Jamais Sutpen ne donne à l'examen du philologue sérieux une impression de bon aloi et de science, de rigueur : l'obstination même du lecteur à le comprendre ne procède que de cette promesse tacite qu'au terme du roman ses étrangetés seront découvertes et expliquées, faute de cela le lecteur ne s'y intéresserait même pas tant – est-ce qu'on comprend davantage Heathcliff ou Kurtz ? La persistance de l'énigme au-delà du livre, loin de fonder le gage d'une fascinante réussite, est, j'ose le dire, u
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Citations et extraits (61)
Voir plus
Ajouter une citation
On laisse si peu de trace, voyez-vous. On naît, on essaye ceci ou cela sans savoir pourquoi, mais on continue d’essayer ; on naît en même temps qu’un tas d’autres gens, tout embrouillé avec eux, comme si on s’efforçait, comme si on était obligé de faire mouvoir avec des ficelles ses bras et ses jambes, mais les mêmes ficelles sont attachées à tous les autres bras et jambes et tous les autres essayent également et ne savent pas non plus pourquoi, si ce n’est qu’ils se prennent dans les ficelles des autres comme si cinq ou six personnes essayaient de tisser un tapis sur le même métier mais avec chacune d’elles voulant tisser sur le tapis son propre dessin ; et cela ne peut pas avoir d’importance, on le sait, ou bien Ceux qui ont installé le métier à tisser auraient un peu mieux arrangé les choses, et pourtant cela doit avoir de l’importance puisque l’on continue à essayer ou que l’on est obligé de continuer, et puis tout à coup tout est fini et tout ce qui vous reste est un bloc de pierre avec quelque chose de griffonné dessus, en admettant qu’il y ait quelqu’un qui se souvienne ou qui ait le temps de faire mettre le marbre en place et d’y faire marquer quelque chose, et il pleut dessus et le soleil brille dessus et au bout d’un peu de temps on ne se rappelle plus ni le nom ni ce que les marques essayaient de dire, et cela n’a pas d’importance.
On laisse si peu de trace, voyez-vous. On naît, on essaye ceci ou cela sans savoir pourquoi, mais on continue d’essayer ; on naît en même temps qu’un tas d’autres gens, tout embrouillé avec eux, comme si on s’efforçait, comme si on était obligé de faire mouvoir avec des ficelles ses bras et ses jambes, mais les mêmes ficelles sont attachées à tous les autres bras et jambes et tous les autres essayent également et ne savent pas non plus pourquoi, si ce n’est qu’ils se prennent dans les ficelles des autres comme si cinq ou six personnes essayaient de tisser un tapis sur le même métier mais avec chacune d’elles voulant tisser sur le tapis son propre dessin ; et cela ne peut pas avoir d’importance, on le sait, ou bien Ceux qui ont installé le métier à tisser auraient un peu mieux arrangé les choses, et pourtant cela doit avoir de l’importance puisque l’on continue à essayer ou que l’on est obligé de continuer, et puis tout à coup tout est fini et tout ce qui vous reste est un bloc de pierre avec quelque chose de griffonné dessus, en admettant qu’il y ait quelqu’un qui se souvienne ou qui ait le temps de faire mettre le marbre en place et d’y faire marquer quelque chose, et il pleut dessus et le soleil brille dessus et au bout d’un peu de temps on ne se rappelle plus ni le nom ni ce que les marques essayaient de dire, et cela n’a pas d’importance.
[...] ... D'abord les deux, puis quatre : maintenant, de nouveau deux. La chambre, en vérité, était comme un tombeau : elle avait quelque chose de faisandé, de figé, de moribond, qui dépassait la mesure du simple froid vif et vivant. Pourtant [Quentin & Shreve] y restèrent, bien qu'à moins de trente pieds de là il y eût le lit et la chaleur. Quentin n'avait même pas mis son pardessus, qui gisait sur le plancher à l'endroit où il était tombé du fauteuil sur lequel Shreve l'avait posé. Le froid ne les faisait pas battre en retraite. Ils le supportaient tous deux dans une sorte d'exaltation masochiste et préméditée de misère physique transmuée en la souffrance morale de deux jeunes gens durant cette période, il y avait de cela cinquante ans, ou plutôt quarante-huit, puis quarante-sept, puis quarante-six, puisque c'était 64, puis 65 et les débris guenilleux de l'armée ayant battu en retraite à travers l'Alabama et la Géorgie jusque dans la Caroline, non pas talonnée par une armée victorieuse, mais plutôt par la marée montante des noms de batailles perdues d'un côté comme de l'autre - Chickamauga et Franklin, Vicksburg, Corinth & Atlanta - batailles perdues non seulement à cause de la supériorité numérique, des munitions et des approvisionnements déficients, mais à cause des généraux, qui l'étaient non pour leur pratique des méthodes contemporaines ou de leur aptitude à les apprendre, mais en vertu du droit divin de dire "Allez-y" conféré à eux par le pouvoir illimité d'un régime de caste ; ou parce que ces généraux n'ont jamais vécu assez longtemps pour apprendre comment livrer avec circonspection des batailles mettant en ligne des masses d'hommes accrues, puisqu'ils étaient déjà aussi périmés que Richard Coeur-de-Lion, Rolan ou Du Guesclin, des généraux emplumé aux capotes doublées d'écarlate, qui, à vingt-huit, trente et trente-deux ans, prenaient des bateaux de guerre avec des charges de cavalerie, mais sans grain, viande ni boulets, qui, en autant de journées, battaient trois armées en trois endroits différents, puis démolissaient leurs propres fortifications pour faire cuire la viande volée à leurs propres fumoirs, qui, en une nuit, avec une poignée d'hommes, incendiaient et détruisaient à l'ennemi un dépôt de vivres d'un million de dollars, et, la nuit d'après, se faisaient descendre d'un coup de fusil par un voisin qui les trouvait couchés avec sa femme - deux, quatre, deux maintenant de nouveau selon Quentin et Shreve, les deux, les quatre, les deux qui continuaient de parler, celui qui ne savait pas encore ce qu'il allait faire, l'autre qui savait ce qu'il devrait faire mais qui ne pouvait pas encore s'y résigner - Henry citant lui-même d'illustres exemples d'incestes, parlant du duc Jean de Lorraine, comme s'il espérait peut-être évoquer ce fantôme condamné et excommunié pour lui dire, à lui en personne, qu'il avait raison, comme les gens qui, avant et depuis, ont essayé d'évoquer Dieu ou le Diable pour se justifier de ce qu'exigeaient leurs glandes - les deux, les quatre, les deux, se regardant l'un l'autre dans cette chambre sépulcrale : Shreve le Canadien, l'enfant des blizzards et du froid, dans son peignoir de bain avec son pardessus remonté jusqu'aux oreilles ; Quentin, l'homme du Sud, produit morose et délicat de la pluie et de la chaleur humide, dans ses minces vêtements appropriés qu'il avait apportés du Mississippi, son pardessus (aussi mince et inutile en son genre que le complet) gisant sur le plancher et qu'il ne s'était pas donné la peine de ramasser :
(...) l'hiver de 64 à présent, l'armée en retraite à travers l'Alabama, se réfugiant en Géorgie ; maintenant, ils venaient de laisser la Caroline derrière eux et Bon, l'officier, pensait : ... [...]
(...) l'hiver de 64 à présent, l'armée en retraite à travers l'Alabama, se réfugiant en Géorgie ; maintenant, ils venaient de laisser la Caroline derrière eux et Bon, l'officier, pensait : ... [...]
[...] ... "Oui, ce fut Henry qui séduisit Judith : ce ne fut pas Bon ; je n'en veux pour preuve que la froideur suspecte et la durée de la cour que celui-ci fit à Judith : des fiançailles, si fiançailles il y eut, qui se prolongent toute une année et se composent de deux visites de vacances en qualité d'invité d'un frère, visites que Bon semble avoir passées à monter à cheval et à chasser avec Henry ou à jouer le rôle de fleur de serre élégante, ésotérique, à laquelle un nom de grande ville tenait lieu d'origine, d'histoire et de passé, et autour de laquelle Ellen [= mère de Judith et Henry] coquetait et papillonnait son frivole été de la Saint Martin : lui, en tant qu'homme, il était accaparé, tu comprends. Il n'y avait pas, dans ses journées trop remplies, de moment, d'intervalle, de répit, pendant lequel il aurait pu faire la cour à Judith. Impossible même de se les figurer seuls, Judith et lui. Le tenterait-on, le plus qu'on puisse imaginer c'est une extériorisation d'eux-mêmes, alors que leurs deux personnes réelles étaient sans doute séparées et dans des endroits différents - deux ombres se promenant, sereines et exemptes des tracas de la chair, dans un jardin d'été - les deux mêmes ombres sereines qui semblent observer et flotter, impartiales, attentives et paisibles, au-dessus d'eux et derrière l'inexplicable et orageuse nuée d'interdictions, de défis, de reniements, d'où Sutpen, semblable à un roc, et l'impétueux et violent Henry lançaient feu et flamme, puis s'arrêtaient - Henry qui, jusqu'alors, n'était même jamais allé jusqu'à Memphis, qui n'était jamais sorti de chez lui avant ce mois de septembre où il se rendit à l'université, avec ses vêtements de coupe campagnarde, son cheval de selle et son palefrenier nègre : les six ou sept qu'ils étaient, dont l'âge et le milieu ne différaient que superficiellement, par la nourriture, les vêtements et les occupations journalières, de ceux des esclaves noirs qui les faisaient vivre - même sueur, à cette différence que, d'un côté, elle était le résultat du travail des champs, de l'autre la rançon des piètres et sobres plaisirs accessibles à ceux qui n'étaient pas obligés de suer dans les champs : les exercices rudes et violents, chasse et chevauchées ; mêmes plaisirs : d'un côté le jeu pour de vieux couteaux, des bijoux de cuivre, des carottes de tabac, des boutons, des vêtements, parce que c'étaient ces choses-là qu'ils avaient le plus facilement et le plus rapidement dans la main ; de l'autre, pour de l'argent, des chevaux, des fusils, des montres, et pour la même raison ; mêmes réjouissances : une musique exactement semblable sur des instruments identiques, violons et guitares, joués par des mazettes, tantôt dans de vastes demeures avec lustres, robes de soie et champagne, tantôt dans des cases au sol de terre battue, avec des torches de résine, des robes de calicot et de l'eau sucrée à la mélasse - ce fut Henry car à cette époque-là, Bon n'avait pas même vu Judith. Il n'avait probablement pas accordé assez d'attention aux rabâchages incohérents d'Henry sur son son existence et son milieu étriqué et bourré de préjugés pour se rappeler qu'Henry avait une soeur - lui, l'homme nonchalant et trop mûr pour trouver même une camaraderie parmi les jeunes, les gosses, avec lesquels il vivait actuellement ; cet homme mal adapté à son temps et qui le savait, qui l'acceptait pour une raison vraisemblablement assez bonne pour le lui faire supporter et manifestement trop sérieuse, ou du moins trop personnelle, pour qu'il en fît part aux relations qu'il possédait maintenant ; cet homme qui, par la suite, fit preuve de la même indolence, presque de la même indifférence, du même détachement, quand s'éleva tout ce bruit au sujet de ses fiançailles qui, d'après ce qu'en surent les gens de Jefferson, n'avaient jamais eu lieu officiellement, que Bon lui-même n'avait ni confirmées ni niées, et lui, à l'arrière-plan, impartial, impassible, comme si ce n'était pas lui qui était en cause, qu'il agît pour le compte de quelque ami absent mais que la personne en question, le réprouvé, fût quelqu'un dont il n'avait jamais entendu parler et qui lui fût parfaitement indifférent. ... [...]
"Je me suis trouvé dans la situation d'avoir à fermer les yeux sur une chose que l'on m'avait refilée à mon insu pendant que je travaillais à la réalisation de mon dessein, une chose qui signifiait la négation absolue et irrévocable de ce dessein, ou bien de devoir m'en tenir au plan originel formé pour la réalisation de ce dessein dans la poursuite duquel j'avais rencontré cette négation. J'ai choisi, et j'ai réparé dans toute la mesure du possible le tort que j'avais pu causer en faisant ce choix, allant même jusqu'à payer, pour avoir le privilège de choisir comme je l'ai fait, plus qu'on aurait pu espérer de moi ou même (légalement) me réclamer. Pourtant, me voici actuellement dans l'obligation de choisir une deuxième fois, et ce qu'il y a de singulier n'est pas, comme vous me l'avez fait remarquer et comme cela m'est tout d'abord apparu, que je me trouve dans la nécessité de faire un nouveau choix, mais que, quelque choix que je fasse, quelque ligne de conduite que je choisisse, cela aboutit au même résultat : ou bien je détruis mon dessein de mes propres mains, ce que je ferai si je suis forcé de jouer mon dernier atout, ou je ne fais rien, je laisse les choses suivre le cours que je sais qu'elles suivront et je vois mon dessein se réaliser de façon tout à fait normale, naturelle et heureuse aux yeux du public, mais apparaissant aux miens comme une moquerie et une trahison vis-à-vis de ce petit garçon qui vint à cette porte voici cinquante ans et qui en fut renvoyé, ce petit garçon pour la revanche de qui tout le dessein a été conçu et poursuivi jusqu'au moment de ce choix, ce second choix étant la conséquence du premier, qui lui-même m'avait été imposé comme résultat d'un accord, d'un arrangement auquel j'avais adhéré de bonne foi, sans rien cacher, alors que l'autre partie, ou les autres parties, me cachaient le seul et unique facteur qui allait détruire le plan et le dessein qui avaient été l'objet de mes efforts, le cachaient si bien que ce fut seulement après la naissance de l'enfant que je découvris l'existence de ce facteur..."
Videos de William Faulkner (21)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
De quel écrivain génial André Malraux parlait-il quand il a dit : « C'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier » ?
« le Bruit et la fureur » de William Faulkner, c'est à lire en poche chez Folio.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
De quel écrivain génial André Malraux parlait-il quand il a dit : « C'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier » ?
« le Bruit et la fureur » de William Faulkner, c'est à lire en poche chez Folio.
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de William Faulkner (65)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres des œuvres de William Faulkner
Quel est le titre correct ?
Le Bruit et l'Odeur
Le Bruit et la Peur
Le Bruit et la Fureur
Le Bruit et la Clameur
12 questions
173 lecteurs ont répondu
Thème :
William FaulknerCréer un quiz sur ce livre173 lecteurs ont répondu