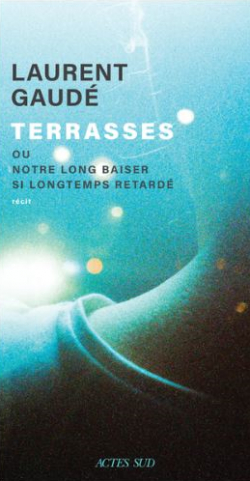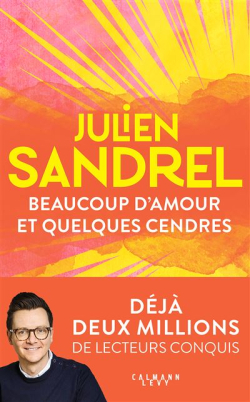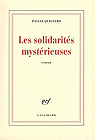L'auteur Pascal Quignard a bâti une oeuvre érudite et sensible. Avec "Compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour", il poursuit sa réflexion sur la sexualité et la relation amoureuse et nous parle d'art, de masochisme, ou encore de sirènes... Il est l'invité de Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux.
Visuel de la vignette : Les Amants / René Magritte
#amour #litterature #language
______________
Écoutez d'autres personnalités qui font l'actualité de la culture dans Les Midis de Culture par ici https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrrNrtLHABD8SVUCtlaznTaG&si=FstLwPCTj-EzNwcv
ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-midis-de-culture
Suivez France Culture sur :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture
Twitter : https://twitter.com/franceculture
Instagram : https://www.instagram.com/franceculture
TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture
Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture

Pascal QuignardPetits traités (Pascal Quignard) tome 2 sur 8
EAN : 978B0014HZ03K
Clivages (30/11/-1)
/5
46 notes
Clivages (30/11/-1)
Résumé :
Les Petits traités furent longtemps inaccessibles. Commencés en 1977, achevés en 1980, refusés par de nombreux éditeurs, les huit volumes ont attendu 1991 pour paraître dans leur intégralité. C'était à mes yeux une quête mythique. Les Petits traités recueillent les os calcinés dans ce qui reste du feu le plus ancien, prélèvent les taches sur les rideaux de litière, fouillent les crevasses des grottes, surprennent l'énigme du rejet de la lettre z au bout de l'alphabe... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Petits traités, tome 2Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Ces traités rassemblent des textes d'une à 136 pages alternant réflexions, aphorismes, observations ponctuelles, dissertations savantes ou fictions. Ils sont rédigés dans la plus grande liberté, ou mieux dans un parti pris d'arbitraire créatif, sans volonté de séduire. A qui aime les commentaires érudits, ils offrent des monographies non conformistes sur l'écrit (forme des livres, forme des lettres, accents, ponctuation, orthographe, mise en page, supports, illustrations et dédicaces, voir le 17ème traité), sur le langage (en particulier le 20ème traité, qui ferait frémir les linguistes), ou sur la langue en tant qu'organe (« la langue connaît quatre principaux emplois très différenciés : nutrition, gustation, langage, baiser » (p 547). Ces thèses sont administrées sans pédagogie mais avec une pénétration saisissante : « Quel est ce texte le plus ancien qu'un homme a noté ? le fragment d'un poème comparable à celui de Dante ? le décompte d'un troupeau de vaches ? Une formule-talisman pour se défendre de la mort ? Liste des noms des rois ?, d'astres ?, de soldats morts ?, de céréales ?, des dieux ?, des parties d'un corps malade ? (Je penche pour le troupeau de vaches) » (p 326). A qui aime l'imaginaire, ces traités offrent aussi des portraits cachés (Spinoza dans le 2ème traité), des fictions historiques (7 pages puissantes sur mort du comte d'Orange dans le 4ème traité) ou un conte libre (Vie de Lu, 10ème traité).
Comme toujours chez Quignard, on y trouve des incises ou des images fulgurantes : « Il souffrait d'une insomnie chronique qu'il avait transformée en bonheur en lisant » (p 41) ; « Les enfants qui flottent dans l'eau obscure de leur mère, quand ils ouvrent la bouche, mangent. Ils sont sans l'air, qu'ils ignorent, et incapables de la voix, qu'ils entendent » (p 81) ; « L'image est proprement l'interdit du dire » (p 133). A propos de l'image, Quignard soutient qu'un livre ne peut être illustré sans trahir (« Toute image est à proscrire dans les livres qu'on ouvre et dans la lecture dans laquelle on se plonge » (p 132), et il cite Flaubert en appui (7ème traité). Cela surprend quand on connait le scénariste de Tous les matins du monde, l'extraordinaire illustration dans le sexe et l'effroi, et chez Flaubert, des monceaux d'images splendides (voir le travelling avant depuis Massada dans Hérodias). Quignard est, comme on sait, féru de latin et d'étymologie. Il cite de multiples textes et nous fait la bonté de les traduire (Hominem pagina nostra sapit « mon livre a la saveur de ce qui est humain » p 302). Il traduit les mots latins avec une grande liberté : « Que veut dire le mot « objet » ? un sein qu'une femme dénude » (p 221). On se rappelle que fascinus dans le sexe et l'effroi était le phallos et la fascinatio, le regard qui ne peut s'en détacher.
On trouve dans ce livre un raccourci de l'admiration et du doute qu'il inspire : « Les plus beaux livres font douter des intentions qui les ont animés » (p 282). Surprise : on n'y parle pas de musique.
Comme toujours chez Quignard, on y trouve des incises ou des images fulgurantes : « Il souffrait d'une insomnie chronique qu'il avait transformée en bonheur en lisant » (p 41) ; « Les enfants qui flottent dans l'eau obscure de leur mère, quand ils ouvrent la bouche, mangent. Ils sont sans l'air, qu'ils ignorent, et incapables de la voix, qu'ils entendent » (p 81) ; « L'image est proprement l'interdit du dire » (p 133). A propos de l'image, Quignard soutient qu'un livre ne peut être illustré sans trahir (« Toute image est à proscrire dans les livres qu'on ouvre et dans la lecture dans laquelle on se plonge » (p 132), et il cite Flaubert en appui (7ème traité). Cela surprend quand on connait le scénariste de Tous les matins du monde, l'extraordinaire illustration dans le sexe et l'effroi, et chez Flaubert, des monceaux d'images splendides (voir le travelling avant depuis Massada dans Hérodias). Quignard est, comme on sait, féru de latin et d'étymologie. Il cite de multiples textes et nous fait la bonté de les traduire (Hominem pagina nostra sapit « mon livre a la saveur de ce qui est humain » p 302). Il traduit les mots latins avec une grande liberté : « Que veut dire le mot « objet » ? un sein qu'une femme dénude » (p 221). On se rappelle que fascinus dans le sexe et l'effroi était le phallos et la fascinatio, le regard qui ne peut s'en détacher.
On trouve dans ce livre un raccourci de l'admiration et du doute qu'il inspire : « Les plus beaux livres font douter des intentions qui les ont animés » (p 282). Surprise : on n'y parle pas de musique.
Citations et extraits (20)
Voir plus
Ajouter une citation
Pascal Quignard : Petits traités II (1990)
Cette édition de poche inclut les traités XXV à LVI. Le lecteur de Quignard reconnaitra le style du premier volume (voir la critique précédente). Les auxiliaires sont répétés, employés avec sécheresse, d’autres verbes frappent par un détour du sens, l’absence de complément, le rejet en fin de phrase. Les phrases sont courtes, interrompues de points, la germination de l’idée est découpée par la typographie, segmentée, examinée sur plusieurs facettes, reprise en écho dans le même paragraphe, ou même un autre paragraphe du chapitre, imposant une respiration très personnelle. On reconnait aussi ses thèmes : la langue, l’organe et aussi bien le vocable — le français, le latin, le grec —, les mots et leur étymologie, la lecture, l’écriture, le livre, le lecteur, le dictionnaire (un chapitre sidérant sur Littré), la bouche. Et de là le sexe, la blessure et la naissance, le mensonge et la postérité. Un exercice provocant de la part de Quignard, sportif de la part du lecteur tour à tour ravi, fasciné ou impatient.
Puis viennent des confidences : « Le premier signe clinique de la dépression : une personne ne peut soutenir la lecture de ce qu’elle lit. Elle comprend les mots mais rien ne fait plus “pages” » (p 77). Ou encore, un art d’écrire : « Ceux qui écrivent ne savent pas ce qu’ils font. Comment le sauraient-ils puisque par définition ce à quoi ils œuvrent n’est pas encore ? C’est à peine s’ils savent s’ils donneront au jour ce à quoi ils tâchent en secret. Comment auraient-ils l’idée des conséquences éventuelles de ce qui n’a encore ni forme ni existence ? Les os, la chair, poil et peau, membres et corps, tout pullule autour d’eux. Ce sont les mots, les phrases, les figures, les émotions, les scènes, les souvenirs des livres, ceux qu’on est et ceux qu’on a connus. Tout conspire à une œuvre qui n’aura de visage qu’une fois achevée et d’efficience que lue. Et la vie insufflée, on peut l’évoquer comme ce style, comme cette énergie sourde qui rythme l’œuvre et contraint proprement à la gorge celui qui l’écrit. Ils le conduisent où son souffle le peut et où un vieux chant régurgité espère. Mais ce qui en résulte, et son pouvoir, et son prestige, et ses effets, ou l’absence d’effet, nul ne peut les prédire. Ni la dévoration qui guette. Ni l’angoisse qui point. Ni le plaisir qu’elle peut donner. Ni la mort qui les menace et les presse sans cesse » (p 478).
Cette édition de poche inclut les traités XXV à LVI. Le lecteur de Quignard reconnaitra le style du premier volume (voir la critique précédente). Les auxiliaires sont répétés, employés avec sécheresse, d’autres verbes frappent par un détour du sens, l’absence de complément, le rejet en fin de phrase. Les phrases sont courtes, interrompues de points, la germination de l’idée est découpée par la typographie, segmentée, examinée sur plusieurs facettes, reprise en écho dans le même paragraphe, ou même un autre paragraphe du chapitre, imposant une respiration très personnelle. On reconnait aussi ses thèmes : la langue, l’organe et aussi bien le vocable — le français, le latin, le grec —, les mots et leur étymologie, la lecture, l’écriture, le livre, le lecteur, le dictionnaire (un chapitre sidérant sur Littré), la bouche. Et de là le sexe, la blessure et la naissance, le mensonge et la postérité. Un exercice provocant de la part de Quignard, sportif de la part du lecteur tour à tour ravi, fasciné ou impatient.
Puis viennent des confidences : « Le premier signe clinique de la dépression : une personne ne peut soutenir la lecture de ce qu’elle lit. Elle comprend les mots mais rien ne fait plus “pages” » (p 77). Ou encore, un art d’écrire : « Ceux qui écrivent ne savent pas ce qu’ils font. Comment le sauraient-ils puisque par définition ce à quoi ils œuvrent n’est pas encore ? C’est à peine s’ils savent s’ils donneront au jour ce à quoi ils tâchent en secret. Comment auraient-ils l’idée des conséquences éventuelles de ce qui n’a encore ni forme ni existence ? Les os, la chair, poil et peau, membres et corps, tout pullule autour d’eux. Ce sont les mots, les phrases, les figures, les émotions, les scènes, les souvenirs des livres, ceux qu’on est et ceux qu’on a connus. Tout conspire à une œuvre qui n’aura de visage qu’une fois achevée et d’efficience que lue. Et la vie insufflée, on peut l’évoquer comme ce style, comme cette énergie sourde qui rythme l’œuvre et contraint proprement à la gorge celui qui l’écrit. Ils le conduisent où son souffle le peut et où un vieux chant régurgité espère. Mais ce qui en résulte, et son pouvoir, et son prestige, et ses effets, ou l’absence d’effet, nul ne peut les prédire. Ni la dévoration qui guette. Ni l’angoisse qui point. Ni le plaisir qu’elle peut donner. Ni la mort qui les menace et les presse sans cesse » (p 478).
Quelque divers que soient les hommes, les civilisations, les époques, les langues, les oeuvres, il semble parfois jusqu'à l'hallucination qu'il monte d'eux une apparence de plainte terrifiée, générale, qui paraît toujours dépouillée et neuve, comme un fond sonore qui rend fou. Langue au-dessous des langues, qui est le son d'un fragment de peur commune, que chacun émet sans doute à sa façon, et plus ou moins, mais qui erre de lèvres en lèvres, sur la protrusion presque sexuelle et toujours dénudée des visages, au cours des millénaires. Terreur peut-être élémentaire que durant des ères entières des hommes tenant des morceaux de cailloux ont grommelée, qui est aussi l'enfance même où elle se renouvelle, et qui nous assemble. Ce son qui geint, rythmique, puis arythmique, puis rythmique, ce plaisir de plainte qui est la vraie clochette des "troupeaux qui parlent une langue"
Vous étiez cette jaunasserie tour à tour un peu blanchâtre, ou grisâtre, ou un peu violacée dans le rare blanc des pages des versions du collège, l'obscurité brune, affamée et humide de la nuit commençante, l'odeur suffocante de fadeur que dégage le corps des morts, mêlée de cuir, d'urine, et de laine mouillée. Ce qui a vécu et qui, ayant cessé de vivre, n'est pas, n'était il pas, de quelque manière, moins encore qu'il n'était avant qu'il n'apparût ? Je ne pouvais mendier auprès de vous la moindre assurance, ni poser la moindre interrogation. Vous n'aviez plus d'avis sur rien. Vous n'étiez ni pour ni contre : vous n'étiez pas « contre » moi-même, vous n'étiez même pas « pour » vous-même. Presque de l'affection ! Au bout d'un si long temps je trouvais enfin quelqu'un qui n'affirmait ni ne niait, qui ne résolvait aucune contradiction. Qui laissait les choses les unes à côté des autres. Qui laissait tout à côté de tout et tout, le laissait enfin de côté !
(à propos des langues mortes)
(à propos des langues mortes)
Pas de phrase qui ne se décompose d'abord en moi dans le goût qui me conduit à en analyser la figure (le rythme de destruction). D'où l'attention passionnée pour la ponctuation, la trace sacrificielle, annulatrice. La place des plaies. Si la phrase sur laquelle s'arrêtent mes yeux peut être transformée, ou si sa forme n'a pas épousé une construction intransposable : déception, ennui, quel que soit le sens. Quand je lis ma tête récrit tout, sacrifie tout, tue mieux, change. Les grands textes pour moi : où je ne déplace rien
L'illustration est anti-littéraire. Vous voulez que le premier imbécile venu dessine ce que je me suis tué à ne pas montrer.
Gustave Flaubert à Gervais Charpentier, éditeur.
(Petits traités 1, VIIe traité, Sur les rapports que le texte et l'image n'entretiennent pas, p. 131)
Gustave Flaubert à Gervais Charpentier, éditeur.
(Petits traités 1, VIIe traité, Sur les rapports que le texte et l'image n'entretiennent pas, p. 131)
Videos de Pascal Quignard (60)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pascal Quignard (86)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Tous les matins du monde
En qu'elle année Pascal Quignard a-t-il écrit Tous les matins du monde?
1816
1917
1991
1899
10 questions
285 lecteurs ont répondu
Thème : Tous les matins du monde de
Pascal QuignardCréer un quiz sur ce livre285 lecteurs ont répondu