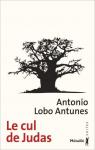Critiques de Antonio Lobo Antunes (169)
Antonio Lobo Antunes c'est avant tout une plume unique, stupéfiante, d'une élégance folle, qui le place parmi les auteurs nobélisables. Une plume à nulle autre pareille, reconnaissable entre toute. Lobo Antunes, c'est la phrase qui court sur des pages et des pages, voire un chapitre entier, la phrase qui entremêle le passé et le présent, qui entrelace pensées brutes sans filtre, souvenirs, rêves, faits et gestes du moment dans un mouvement de vient et va incessant donnant au déploiement de la phrase la fluidité, le rythme et les rondeurs d'un ruban lancé au vent, d'un ruban tour à tour claquant ou caressant ; Lobo Antunes ce sont certaines phrases répétées, mantras hypnotiques et métronomiques, ritournelles révélant failles, amertume, malaise, part de folie ; Lobo Antunes c'est une prose sublime qui mêle détestation de la dictature Salazarienne et nostalgie de l'enfance, qui fait se conjuguer faits passés crus, violents et radicaux, et poésie sensorielle et bucolique, prose au charme suranné liée aux souvenirs. Voilà pourquoi Lobo Antunes aura le Prix Nobel, doit avoir le Prix Nobel, et comme il vient de sortir un nouveau livre, « La dernière porte avant la nuit », aux fameuses éditions Bourgois, je ne peux m'empêcher de penser que c'est peut-être pour cette année. Pour bientôt. La dernière porte avant le Graal. Boa Sorte Antonio !
Le passé et le présent, l'avant et l'après, pour Lobo Antunes se résume très souvent à l'avant et l'après Révolution portugaise des oeillets d'avril 1974 renversant la dictature, et par là même le pouvoir de toutes les personnes gravitant autour de Salazar. La dictature par opposition à la démocratie. Avec au milieu cette fracture béante qu'a constitué la guerre coloniale en Afrique, en Angola en particulier. Antonio Lobo Antunes y a servi vingt-sept mois, entre 1971 et 1973, comme jeune médecin militaire. Il y amputait les blessés à la scie. de cette expérience terrible va émerger un écrivain unique. Qui sait à la fois crier les horreurs, dénoncer la société portugaise, ses inégalités, son patriarcat, son racisme envers les africains, dire clairement sans détour ce qui est, tout en étant d'une sensibilité extrême à la beauté.
« C'était le mois de juillet et les vagues si bleues si bleues si bleues, vous n'imaginez pas combien elles étaient bleues, d'un bleu plus intense que ce chemisier, jamais au grand jamais, ni en Sicile ni en Grèce, je n'ai vu un bleu pareil, ça donnait envie d'être pauvre et d'habiter dans une cabane rien que pour le bleu de la mer, quel dommage que ces gens, par manque de sensibilité, n'apprécient pas la nature et préfèrent à une vue de rêve les cinq premiers escudos venus, je ne comprends pas comment fait Dieu dans le ciel pour traiter avec ces gens sans manières, quelle corvée… »
Cet avant et après Révolution est témoin d'une évolution radicale de la société : le Portugal passe d'une société de castes, une société patriarcale où le pouvoir est détenu par une poignée d'hommes sans foi ni loi, à une société plus démocratique. Je suis le fruit de cette société. La petite-fille d'un dominant ayant abusé d'une femme pauvre. La petite fille d'une union hasardeuse entre un maitre tout puissant et une servante qui n'a jamais osé protester. La fille d'un batard. D'un père biberonné au « fils de pute » répété à l'envi. Ce livre a fait vibrer mes racines qui ont même réussi, en forçant douloureusement à bourgeonner, légèrement, du terreau de mon âme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Dans le manuel des inquisiteurs, le narrateur, Joao, est le fils d'un tel homme de pouvoir, un personnage proche du dictateur Salazar, un quasi ministre ou député, on ne sait pas trop, gouvernant en secret, pouvant décider d'un coup de téléphone l'emprisonnement ou la libération de n'importe qui, propriétaire dans la ville de Palmela d'un magnifique domaine, une vaste demeure aux escaliers flanqués d'anges de granit, aux jacinthes poussant le long des murs, a la magnifique serre d'orchidées, aux eucalyptus murmurant dans le marais, croissant et diminuant suivant la respiration des algues, aux effluves de rose-thé.
Le décor est aussi sublime que le personnage est haïssable. Un homme au sans-gêne incroyable, à l'impudence inouïe, renversant sur la table de l'office, du bout de ses bottes crasseuses, les servantes muettes sans même prendre la peine d'ôter son chapeau de la tête, jugeant les femmes, leur hanche, leurs mensurations, comme on juge une génisse, s'achetant pour quelques mensualités une jeune fille pétrifiée de peur qu'il déguise en épouse de notable, buvant le thé en compagnie de Salazar et d'un amiral à la poitrine blindée de médailles, tout en distribuant ses conseils sur le gouvernement du monde. Un homme odieux, dangereux, marqué du sceau de l'oppression, du mépris de classe, du mépris pour les femmes, de l'arrogance, du pouvoir tout puissant. Mon mystérieux grand-père fut, à un degré moindre, un tel homme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Aujourd'hui cet homme (l'homme du livre, concernant mon aïeul inconnu, je ne sais pas) est un vieillard sénile placé dans un institut, un vase de nuit glissé entre ses jambes squelettiques, atteint de la maladie d'Alzheimer. le tout puissant « transformé en un mikado de tibias, en une paire de narines dilatées, en un fantoche sans mérite ». Nourri comme un petit enfant, changé comme un nourrisson. Décrépitude d'un homme au pouvoir bref, chute vertigineuse, le fils Joao raconte avec amertume, avec haine comment fut ce père, ce qu'il a vu et entendu alors qu'il était haut comme trois pommes, et ce qu'est devenu ce père haï. Il raconte comment, de façon concomitante, avec le déclin de son propriétaire, le domaine a également sombré laissant une maison éventrée, dévorée par son marais avec ses eucalyptus monstrueux, aux conduits d'irrigation obstrués par le chiendent, aux hêtres et aux cyprès dépouillés par les corbeaux, aux tableaux éparpillés au sol, aux tapis décolorés, à la chapelle envahie par des plantes grimpantes et à la piscine dans laquelle l'eau est en train de pourrir...Intimidante majesté décrépite des moulures dorées en miette sur le sol. Décadence d'un homme, décadence d'un lieu avec l'arrive de la démocratie.
Des chapitres intercalés laissent parler les personnages qui ont gravité autour de cet homme, notamment de nombreuses femmes, toutes humiliées, depuis la jeune servante abusée de façon odieuse par le père, en passant par la belle-fille qu'il ne ménage pas, ou encore la vieille nourrice Titina qui a élevé ce fils sans repère, ce fils devenu presque le sien, mais on entend aussi la voix de quelques hommes comme le vétérinaire se transformant parfois en accoucheur des pauvres femmes que cet homme a engrossé.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Le côté choral du livre permet de se placer tour à tour dans les pensées et les sentiments des opprimés et des oppresseurs pendant la dictature, au moment du renversement et après la dictature. Ce fut passionnant et intéressant de voir les prises de positions des uns et des autres, leurs craintes, leurs croyances. Mes racines plongent dans ces deux camps extrêmes, ce fut pour moi perturbant.
« Les vitres brisées de la serre, les châssis fracassés, les vases en morceaux, les orchidées aux pétales dilatés pendillant en longues lèvres violacées » métaphore de ce qui s'est passé…un tesson de miroir vert-de-gris ce livre qui fait comme une coupure de laquelle s'écoule une « tristesse mielleuse comme lorsqu'il arrive de pleuvoir un après-midi de septembre » …Le manuel des inquisiteurs, c'est la tentative douce-amère de se construire lorsqu'on hérite de cette histoire...un chef d'oeuvre.
Le passé et le présent, l'avant et l'après, pour Lobo Antunes se résume très souvent à l'avant et l'après Révolution portugaise des oeillets d'avril 1974 renversant la dictature, et par là même le pouvoir de toutes les personnes gravitant autour de Salazar. La dictature par opposition à la démocratie. Avec au milieu cette fracture béante qu'a constitué la guerre coloniale en Afrique, en Angola en particulier. Antonio Lobo Antunes y a servi vingt-sept mois, entre 1971 et 1973, comme jeune médecin militaire. Il y amputait les blessés à la scie. de cette expérience terrible va émerger un écrivain unique. Qui sait à la fois crier les horreurs, dénoncer la société portugaise, ses inégalités, son patriarcat, son racisme envers les africains, dire clairement sans détour ce qui est, tout en étant d'une sensibilité extrême à la beauté.
« C'était le mois de juillet et les vagues si bleues si bleues si bleues, vous n'imaginez pas combien elles étaient bleues, d'un bleu plus intense que ce chemisier, jamais au grand jamais, ni en Sicile ni en Grèce, je n'ai vu un bleu pareil, ça donnait envie d'être pauvre et d'habiter dans une cabane rien que pour le bleu de la mer, quel dommage que ces gens, par manque de sensibilité, n'apprécient pas la nature et préfèrent à une vue de rêve les cinq premiers escudos venus, je ne comprends pas comment fait Dieu dans le ciel pour traiter avec ces gens sans manières, quelle corvée… »
Cet avant et après Révolution est témoin d'une évolution radicale de la société : le Portugal passe d'une société de castes, une société patriarcale où le pouvoir est détenu par une poignée d'hommes sans foi ni loi, à une société plus démocratique. Je suis le fruit de cette société. La petite-fille d'un dominant ayant abusé d'une femme pauvre. La petite fille d'une union hasardeuse entre un maitre tout puissant et une servante qui n'a jamais osé protester. La fille d'un batard. D'un père biberonné au « fils de pute » répété à l'envi. Ce livre a fait vibrer mes racines qui ont même réussi, en forçant douloureusement à bourgeonner, légèrement, du terreau de mon âme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Dans le manuel des inquisiteurs, le narrateur, Joao, est le fils d'un tel homme de pouvoir, un personnage proche du dictateur Salazar, un quasi ministre ou député, on ne sait pas trop, gouvernant en secret, pouvant décider d'un coup de téléphone l'emprisonnement ou la libération de n'importe qui, propriétaire dans la ville de Palmela d'un magnifique domaine, une vaste demeure aux escaliers flanqués d'anges de granit, aux jacinthes poussant le long des murs, a la magnifique serre d'orchidées, aux eucalyptus murmurant dans le marais, croissant et diminuant suivant la respiration des algues, aux effluves de rose-thé.
Le décor est aussi sublime que le personnage est haïssable. Un homme au sans-gêne incroyable, à l'impudence inouïe, renversant sur la table de l'office, du bout de ses bottes crasseuses, les servantes muettes sans même prendre la peine d'ôter son chapeau de la tête, jugeant les femmes, leur hanche, leurs mensurations, comme on juge une génisse, s'achetant pour quelques mensualités une jeune fille pétrifiée de peur qu'il déguise en épouse de notable, buvant le thé en compagnie de Salazar et d'un amiral à la poitrine blindée de médailles, tout en distribuant ses conseils sur le gouvernement du monde. Un homme odieux, dangereux, marqué du sceau de l'oppression, du mépris de classe, du mépris pour les femmes, de l'arrogance, du pouvoir tout puissant. Mon mystérieux grand-père fut, à un degré moindre, un tel homme.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Aujourd'hui cet homme (l'homme du livre, concernant mon aïeul inconnu, je ne sais pas) est un vieillard sénile placé dans un institut, un vase de nuit glissé entre ses jambes squelettiques, atteint de la maladie d'Alzheimer. le tout puissant « transformé en un mikado de tibias, en une paire de narines dilatées, en un fantoche sans mérite ». Nourri comme un petit enfant, changé comme un nourrisson. Décrépitude d'un homme au pouvoir bref, chute vertigineuse, le fils Joao raconte avec amertume, avec haine comment fut ce père, ce qu'il a vu et entendu alors qu'il était haut comme trois pommes, et ce qu'est devenu ce père haï. Il raconte comment, de façon concomitante, avec le déclin de son propriétaire, le domaine a également sombré laissant une maison éventrée, dévorée par son marais avec ses eucalyptus monstrueux, aux conduits d'irrigation obstrués par le chiendent, aux hêtres et aux cyprès dépouillés par les corbeaux, aux tableaux éparpillés au sol, aux tapis décolorés, à la chapelle envahie par des plantes grimpantes et à la piscine dans laquelle l'eau est en train de pourrir...Intimidante majesté décrépite des moulures dorées en miette sur le sol. Décadence d'un homme, décadence d'un lieu avec l'arrive de la démocratie.
Des chapitres intercalés laissent parler les personnages qui ont gravité autour de cet homme, notamment de nombreuses femmes, toutes humiliées, depuis la jeune servante abusée de façon odieuse par le père, en passant par la belle-fille qu'il ne ménage pas, ou encore la vieille nourrice Titina qui a élevé ce fils sans repère, ce fils devenu presque le sien, mais on entend aussi la voix de quelques hommes comme le vétérinaire se transformant parfois en accoucheur des pauvres femmes que cet homme a engrossé.
« Je fais tout ce qu'elles veulent mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron ».
Le côté choral du livre permet de se placer tour à tour dans les pensées et les sentiments des opprimés et des oppresseurs pendant la dictature, au moment du renversement et après la dictature. Ce fut passionnant et intéressant de voir les prises de positions des uns et des autres, leurs craintes, leurs croyances. Mes racines plongent dans ces deux camps extrêmes, ce fut pour moi perturbant.
« Les vitres brisées de la serre, les châssis fracassés, les vases en morceaux, les orchidées aux pétales dilatés pendillant en longues lèvres violacées » métaphore de ce qui s'est passé…un tesson de miroir vert-de-gris ce livre qui fait comme une coupure de laquelle s'écoule une « tristesse mielleuse comme lorsqu'il arrive de pleuvoir un après-midi de septembre » …Le manuel des inquisiteurs, c'est la tentative douce-amère de se construire lorsqu'on hérite de cette histoire...un chef d'oeuvre.
Cela faisait longtemps que j'avais envie de découvrir ce livre. Je n'en avais entendu parler qu'en bien ; aussi, mesurerez-vous mieux toute l'étendue de ma déception quand je vous confierai que cette lecture a été un vrai calvaire pour moi. le livre est petit (environ deux cents pages) et pourtant je ne compte plus les fois où j'ai failli le refermer définitivement et à jamais avant d'en avoir atteint la fin.
Il convient, je pense, de préciser que ce que j'exprime ici n'est évidemment que mon avis et ne répond qu'à mes propres critères d'appréciation. Je ne prétends pas qu'ils soient ni fiables ni généralisables. Toutefois, je tiens à distinguer très nettement mes ressentis à propos de la forme et du fond.
Le fond m'a paru extrêmement intéressant et fort : guerre de décolonisation dans un pays d'Afrique au début des années 1970, en l'espèce, l'Angola ; sachant que le pays colonisateur est lui-même un pays dictatorial à l'époque, en l'espèce, le Portugal du non regretté António de Oliveira Salazar (ou tout simplement Salazar) et de son non regretté mais regrettable Estado Novo.
L'auteur fait un portrait féroce, désabusé et violemment anti-dictatorial et anti-colonial. Il dénonce sans ambages la guerre coloniale et le traitement de semi esclavage qui était réservé aux populations angolaises. Il dénonce également l'embrigadement de force de la jeunesse non dorée portugaise dans cette guerre à laquelle les jeunes Portugais ne comprennent pas grand-chose et au nom d'intérêts qui les dépassent. Ils sont amenés à vivre l'enfer et les affres de la boucherie, à se faire exploser sur des mines posées par les rebelles ou tomber sous leurs balles ou encore à crever des suites d'une maladie tropicale bien ragoûtante.
Sur ce plan, ce livre est un modèle du genre, qui se veut probablement, par la vigueur de sa verve et par son ton pessimiste et désabusé, dans la lignée de Voyage Au Bout de la Nuit. Il met aussi le doigt sur le traumatisme et l'inadaptation à la vie normale de ceux qui ont vécu ces années d'atrocités. Sur ce point, le livre m'a rappelé des témoignages que j'ai pu lire ou entendre de vive voix de ceux qui ont vécu le génocide au Rwanda dans la première moitié des années 1990.
Là-dessus, le livre est irréprochable. Il est criant de vérité et il ne fait pas de doute que l'auteur est allé abondamment puiser dans ce qu'il a lui-même vécu en tant que médecin envoyé d'office au front. Mais en ce qui concerne la forme, mes aïeux ! que c'est mal écrit mes pauvres amis ! que c'est pénible et quasi illisible ! Si l'on considère le chemin entre une idée et son expression littéraire comme un fil tendu, alors António Lobo Antunes le tord, l'épaissit, le ramifie, accroche des tas de trucs pelucheux dessus et ça devient un gros boa aux couleurs criardes enroulé au cou de l'idée qu'il prétend véhiculer. Bref, une vraie géhenne pour qui se soucie tant soit peu du style.
Je vais tenter une illustration grammaticale de mon point de vue. Quand vous considérez le nom du groupe sujet, vous lui collez systématiquement à la super glue LOCTITE un adjectif derrière ; ça, à la limite, c'est courant, mais vous lui en adjoignez un aussi devant — question d'équilibre, sans doute ; puis vous n'oubliez surtout pas d'accrocher à cette locomotive ALSTOM un complément du nom, lequel sera également et invariablement lesté d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Ensuite vous embrayez deux fois par phrase au moins sur une comparaison avec un quartier de Lisbonne ou un poète portugais du XIXe que vous ne connaissez pas ou des références pléthoriques, inutiles et/ou mal amenées de tableaux de maître, de films muets, de chansons américaines citées in extenso, de sigles propres au régime salazariste ou de noms de maladies longues comme une famille de ténia, et alors, alors seulement, si vous avez de la chance et si l'absence de ponctuation façon Saramago ne vous a pas totalement asphyxié, alors vous risquez de tomber sur le verbe de la phrase. Il faudra ensuite reprendre un peu haleine en haut de l'Alpe d'Huez avant d'aborder le complément d'objet, direct ou indirect, qui vous attend avec quelques dizaines de litres de sauce aux lipides façon HEINZ. (Vous aurez compris que ce paragraphe est une tentative allégée de reconstitution du style de l'auteur.)
En somme, voilà !, c'est ça le style « flamboyant, torrentueux » de Lobo Antunes selon Télérama comme le précise la quatrième de couverture. Moi j'appelle ça juste « mal écrit » et des maladresses d'auteur débutant qu'un éditeur digne de ce nom aurait dû conseiller pour permettre de livrer le véritable potentiel littéraire de cet auteur qui a, je n'en doute pas, de vrais trésors de formule enfouis parmi toute cette poix. Et comme si l'épaisseur de la mélasse n'était pas suffisante, l'auteur utilise un procédé littéraire inutile et lourdingue de pseudo confession à une femme rencontrée dans un bar et qu'il cherche à tout prix à emmener dans son lit.
En fait, j'ai eu l'impression de revivre les affres du Max Havelaar de Multatuli qui lui aussi avait des choses intéressantes et fortes à dire mais qui a utilisé la pire des formes littéraires pour les exprimer. Je ne doute pas, également, que bon nombre des références utilisées par l'auteur perdront leur sens à mesure qu'on avancera dans le temps. (Par exemple, au moment de la sortie du livre, beaucoup de gens connaissaient les chansons de Paul Simon mais je doute que cette référence fasse encore sens longtemps dans de larges portions de la population mondiale. Or, l'auteur nous inflige une page et demie de citation complète et non traduite de ladite chanson ; à mon sens, c'est une faiblesse d'écriture et rien d'autre.)
Donc, j'ai une impression composite à propos de cette oeuvre. Sur le fond, un livre fort et dérangeant qui ne mâche pas ses mots. Sur la forme, un style rococo + + + absolument imbuvable. Si vous aimez l'épure, passez votre chemin. J'imagine que je ne couperai pas aux remarques du genre : « Ouais mais faut le lire en portugais pour pouvoir juger. T'as lu une traduction, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. » etc., etc.
Certes, l'argument vaut ce qu'il vaut ; mais je doute qu'un traducteur, qui plus est en travaillant pour l'éditeur Métailié qui s'est fait une manière de spécialité dans le domaine des auteurs latinos, se permettrait de son propre chef de rendre un style aussi lourd et d'accoler une telle proportion d'adjectifs, sans parler des comparaisons qui n'ont probablement pas été inventées par le traducteur. Je constate également que le portugais est l'une des langues qui se traduit le mieux et le plus fidèlement en français. (Cf. les traductions françaises de Pessoa qui ont obtenu des récompenses portugaises pour leur rendu et leur grande qualité.)
Bref, outre son côté un brin déprimant, à vous de voir si stylistiquement ce livre peut vous convenir. Personnellement, je n'avais lu que des avis positifs et dithyrambiques. J'imagine que, statistiquement, il doit bien y avoir deux ou trois personnes qui ont à peu près la même sensibilité littéraire que moi : elles pourront désormais lire un avis un peu alternatif mais qui, j'en ai bien conscience, ne représente pas grand-chose, un cul de Judas, et encore…
Il convient, je pense, de préciser que ce que j'exprime ici n'est évidemment que mon avis et ne répond qu'à mes propres critères d'appréciation. Je ne prétends pas qu'ils soient ni fiables ni généralisables. Toutefois, je tiens à distinguer très nettement mes ressentis à propos de la forme et du fond.
Le fond m'a paru extrêmement intéressant et fort : guerre de décolonisation dans un pays d'Afrique au début des années 1970, en l'espèce, l'Angola ; sachant que le pays colonisateur est lui-même un pays dictatorial à l'époque, en l'espèce, le Portugal du non regretté António de Oliveira Salazar (ou tout simplement Salazar) et de son non regretté mais regrettable Estado Novo.
L'auteur fait un portrait féroce, désabusé et violemment anti-dictatorial et anti-colonial. Il dénonce sans ambages la guerre coloniale et le traitement de semi esclavage qui était réservé aux populations angolaises. Il dénonce également l'embrigadement de force de la jeunesse non dorée portugaise dans cette guerre à laquelle les jeunes Portugais ne comprennent pas grand-chose et au nom d'intérêts qui les dépassent. Ils sont amenés à vivre l'enfer et les affres de la boucherie, à se faire exploser sur des mines posées par les rebelles ou tomber sous leurs balles ou encore à crever des suites d'une maladie tropicale bien ragoûtante.
Sur ce plan, ce livre est un modèle du genre, qui se veut probablement, par la vigueur de sa verve et par son ton pessimiste et désabusé, dans la lignée de Voyage Au Bout de la Nuit. Il met aussi le doigt sur le traumatisme et l'inadaptation à la vie normale de ceux qui ont vécu ces années d'atrocités. Sur ce point, le livre m'a rappelé des témoignages que j'ai pu lire ou entendre de vive voix de ceux qui ont vécu le génocide au Rwanda dans la première moitié des années 1990.
Là-dessus, le livre est irréprochable. Il est criant de vérité et il ne fait pas de doute que l'auteur est allé abondamment puiser dans ce qu'il a lui-même vécu en tant que médecin envoyé d'office au front. Mais en ce qui concerne la forme, mes aïeux ! que c'est mal écrit mes pauvres amis ! que c'est pénible et quasi illisible ! Si l'on considère le chemin entre une idée et son expression littéraire comme un fil tendu, alors António Lobo Antunes le tord, l'épaissit, le ramifie, accroche des tas de trucs pelucheux dessus et ça devient un gros boa aux couleurs criardes enroulé au cou de l'idée qu'il prétend véhiculer. Bref, une vraie géhenne pour qui se soucie tant soit peu du style.
Je vais tenter une illustration grammaticale de mon point de vue. Quand vous considérez le nom du groupe sujet, vous lui collez systématiquement à la super glue LOCTITE un adjectif derrière ; ça, à la limite, c'est courant, mais vous lui en adjoignez un aussi devant — question d'équilibre, sans doute ; puis vous n'oubliez surtout pas d'accrocher à cette locomotive ALSTOM un complément du nom, lequel sera également et invariablement lesté d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Ensuite vous embrayez deux fois par phrase au moins sur une comparaison avec un quartier de Lisbonne ou un poète portugais du XIXe que vous ne connaissez pas ou des références pléthoriques, inutiles et/ou mal amenées de tableaux de maître, de films muets, de chansons américaines citées in extenso, de sigles propres au régime salazariste ou de noms de maladies longues comme une famille de ténia, et alors, alors seulement, si vous avez de la chance et si l'absence de ponctuation façon Saramago ne vous a pas totalement asphyxié, alors vous risquez de tomber sur le verbe de la phrase. Il faudra ensuite reprendre un peu haleine en haut de l'Alpe d'Huez avant d'aborder le complément d'objet, direct ou indirect, qui vous attend avec quelques dizaines de litres de sauce aux lipides façon HEINZ. (Vous aurez compris que ce paragraphe est une tentative allégée de reconstitution du style de l'auteur.)
En somme, voilà !, c'est ça le style « flamboyant, torrentueux » de Lobo Antunes selon Télérama comme le précise la quatrième de couverture. Moi j'appelle ça juste « mal écrit » et des maladresses d'auteur débutant qu'un éditeur digne de ce nom aurait dû conseiller pour permettre de livrer le véritable potentiel littéraire de cet auteur qui a, je n'en doute pas, de vrais trésors de formule enfouis parmi toute cette poix. Et comme si l'épaisseur de la mélasse n'était pas suffisante, l'auteur utilise un procédé littéraire inutile et lourdingue de pseudo confession à une femme rencontrée dans un bar et qu'il cherche à tout prix à emmener dans son lit.
En fait, j'ai eu l'impression de revivre les affres du Max Havelaar de Multatuli qui lui aussi avait des choses intéressantes et fortes à dire mais qui a utilisé la pire des formes littéraires pour les exprimer. Je ne doute pas, également, que bon nombre des références utilisées par l'auteur perdront leur sens à mesure qu'on avancera dans le temps. (Par exemple, au moment de la sortie du livre, beaucoup de gens connaissaient les chansons de Paul Simon mais je doute que cette référence fasse encore sens longtemps dans de larges portions de la population mondiale. Or, l'auteur nous inflige une page et demie de citation complète et non traduite de ladite chanson ; à mon sens, c'est une faiblesse d'écriture et rien d'autre.)
Donc, j'ai une impression composite à propos de cette oeuvre. Sur le fond, un livre fort et dérangeant qui ne mâche pas ses mots. Sur la forme, un style rococo + + + absolument imbuvable. Si vous aimez l'épure, passez votre chemin. J'imagine que je ne couperai pas aux remarques du genre : « Ouais mais faut le lire en portugais pour pouvoir juger. T'as lu une traduction, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. » etc., etc.
Certes, l'argument vaut ce qu'il vaut ; mais je doute qu'un traducteur, qui plus est en travaillant pour l'éditeur Métailié qui s'est fait une manière de spécialité dans le domaine des auteurs latinos, se permettrait de son propre chef de rendre un style aussi lourd et d'accoler une telle proportion d'adjectifs, sans parler des comparaisons qui n'ont probablement pas été inventées par le traducteur. Je constate également que le portugais est l'une des langues qui se traduit le mieux et le plus fidèlement en français. (Cf. les traductions françaises de Pessoa qui ont obtenu des récompenses portugaises pour leur rendu et leur grande qualité.)
Bref, outre son côté un brin déprimant, à vous de voir si stylistiquement ce livre peut vous convenir. Personnellement, je n'avais lu que des avis positifs et dithyrambiques. J'imagine que, statistiquement, il doit bien y avoir deux ou trois personnes qui ont à peu près la même sensibilité littéraire que moi : elles pourront désormais lire un avis un peu alternatif mais qui, j'en ai bien conscience, ne représente pas grand-chose, un cul de Judas, et encore…
Les formes dessinées machinalement, tout en ayant l’esprit occupé, auraient, dit-on, une signification quant à l’état psychique de leur auteur.
J’imagine Antonio Lobo Antunes faire de tels dessins, automatiques…nous verrions sur la page de rondes arabesques emmêlées, ou alors une sorte de labyrinthe, un trait horizontal, puis un trait vertical à l’une des extrémités du premier, et ainsi de suite. Impasses multiples et implacables, briques de mur occupant toute une page au fur et à mesure du temps. Je serais même d’avis que nous y verrions sans doute à la fois, et des arabesques et des formes labyrinthiques, de couleur sombre…C’est pour moi une forme imagée de ses romans. Tout comme la couverture, magnifique par son abstraction et sa noirceur verdâtre, cratère incandescent, qui donne l’impression de dévoiler en une image l’univers d’Antunes…Mais en lieu et place des dessins, des mots… et quels mots ! L’auteur est le maître incontesté des pensées labyrinthiques, des digressions en arabesque qui s’entortillent, denses, complexes. Les comprendre nécessite du temps, de la patience et surtout du lâcher prise ; les années m’ont peu à peu procuré cette clé.
Lobo Antunes tricote, entrelaçant incessamment les pensées qui viennent à chaque protagoniste, des bouts de paroles, des rêves, le passé entremêlé au présent, d’autres pensées parasites et ce, dans une seule phrase. Pas de point car l’auteur est dans la tête de chaque personnage, véritablement, littéralement dans son flot de pensées et nos pensées, incessantes, ne sont jamais interrompues. Nous pensons sans arrêt. Un chapitre, un protagoniste, une phrase, un soliloque. Lobo Antunes tricote et cela donne une dentelle unique, singulière, d’une beauté sensorielle, d’une poésie sombre, d’une musique envoutante. Lire Lobo Antunes est une aventure intellectuelle. Une expérience, adorée ou détestée.
Les livres que je préfère de cet auteur portugais parlent de l’histoire et de la politique du Portugal, de la guerre en Angola, de l’opposition entre l’avant et l’après Révolution des œillets de 1974, l’avant et l’après dictature de Salazar. Ce fut le cas avec « L’exhortation aux crocodiles », et ces voix fantomatiques de femmes, épouses d’hommes proches du dictateur à qui il donne voix au chapitre, et surtout avec « Le manuel des inquisiteurs », un de mes livres préférés, donnant la parole à un homme issu de l’union improbable entre un homme proche du dictateur et une servante pauvre.
Ici, rien de tout ça, nous sommes avec cinq hommes tous liés par un pacte criminel : ils ont tous participé au kidnapping et à l’assassinat d’un chef d’entreprise fortuné. Kidnapping devant sa propre petite fille laissée seule dans le parking souterrain d’où ce père a été embarqué. Pourtant ces cinq hommes le connaissaient depuis l’enfance. Ils ont même fait disparaitre le corps de façon ignoble : à l’acide avant de jeter ce qui restait de lui dans une rivière. Car pas de corps, pas de crime, ne cessent-ils de répéter. Chacun des protagonistes évoque tour à tour, en une ronde vertigineuse donnant le tournis, le déroulement des faits, en pensée, évocation entrecoupée de multiples digressions sur ses états d’âme, ses souvenirs d’enfances, ses obsessions, ses relations conjugales et familiales… Et c’est peu de dire qu’ils moulinent, les nerfs complètement à vif… A nous, lecteurs ahuris, de tamiser ce flot ininterrompu, mais souvent tronqué, et de percevoir la culpabilité, les névroses qui en jaillissent…A nous d’en faire émerger des pépites. A nous d’extraire de ce flux de conscience ininterrompu une signification arrêtée de l’inconscient…
Qui sont ces cinq meurtriers qui doivent absolument garder le secret ? Qui sont ces cinq énergumènes qui vont se faire complétement dépassés par le crime ignoble commis, l’étau se resserrant peu à peu autour d’eux ? Il y a le collecteur de créances (c’est joliment dit pour quelqu’un qui rançonne les clients en retard), dit « collecteur du billard » du fait de sa passion pour ce loisir, le personnage pour moi le plus touchant, qui évoque souvent, et de façon poignante, sa grand-mère, toujours présente malgré sa mort, présente dans les petites graines poilues flottant au hasard entre deux eaux de l’air au printemps, il y a le frère du patron, amoureux de la sœur de l’homme assassiné et assez limité intellectuellement, l’herboriste un homme souffrant d’impuissance, malheureux en ménage et obnubilé par ses problèmes sexuels persuadé que sans corps pas de crime, le second collecteur de créances dont le père est parti à l’âge de sept ans le laissant seul avec sa mère, et enfin le patron, homme gros et laid, lui aussi amoureux de la sœur de l’homme assassiné qui n’a jamais voulu de lui. Des hommes malheureux, des hommes touchants, des hommes misogynes, à la fois fascinés par les femmes et les détestant, parfois odieux et lâches, des hommes ayant hérité d’un lourd passé, jouant très jeunes des rôles qu’ils n’auraient pas dû jouer ou abandonnés. Des hommes restés petits garçons qui voudraient juste être aimés…Des hommes de plus en plus touchants au fil des rondes, à mesure que nous comprenons l’ignominie des gestes exécutés, à mesure que croît la culpabilité…la ronde va s’enrayer, hoqueter, les condamner.
« Après le départ de mon père en compagnie de l’ombrelle j’ai commencé à dormir avec ma mère dans un creux du lit trop grand pour moi et qui avait son odeur à lui, il aurait suffi qu’on jette de la terre dans ce trou pour que je fleurisse en mai, des racines à la place des jambes, des feuilles à la place des bras, ma mère m’arrosant avec l’eau de la bouilloire et le petit bouton de ma tête apparaissant peu à peu… ».
Cette nuit tragique, qui est venu rajouter du sordide au malheur, n’en finit pas, elle n’en finira jamais, plus aucune promesse d’aube, aucun vestige du jour, elle est sans relâche dans les pensées, obsédante, écœurante, malsaine, noire, elle gangrène leurs têtes, elle agit comme l’acide qu’ils ont utilisé, bouillonnant dans leurs pensées, en bulles presque dorées dans l’obscurité, pour finir par les ronger. C’est une porte impossible à refermer avant la fin, avant la Nuit éternelle… « rien que la nuit et nous minuscules, perdus, sans personne pour nous aider, si au moins un bras pour arranger le drap, si au moins une voix – Gamin – et il n’y a ni bras, ni voix hormis la nôtre – Au secours- ».
De multiples réflexions sont abordées par l’auteur, celle des peurs ancestrales, peur du noir, peur de ne pas être aimé, le thème dévorant de la culpabilité, des pulsions, de la mort, des silences au sein de la famille, de l’absence de désir, de la subjectivité quant à l’existence des éléments quand on ne les voit pas, la paranoïa…Une satire sur les turpitudes de la vie, les efforts vains d’y apporter du sens…mille et une réflexions qui bruissent, qui tournoient, virevoltent, éclosent en explosant, rouge sang, ou carrément noires, par ci, par-là, pour former une forêt foisonnante assez angoissante dans laquelle se frayer un chemin au milieu de bruits incessants :
« …mon Dieu la quantité de bruits qu’on peut entendre dans ce monde pour peu qu’on se montre attentif, depuis celui que fait l’axe de la Terre jusqu’aux murmures des personnes qui sont déjà parties (…) en même temps que le vent dans les pins, un chien dans une ferme au loin, le silence remplis de menus sons de la campagne, insectes, feuilles, herbes, les bruits mats de fruits qui tombaient, les changements d’humeur du vent, l’éternel train trop lointain pour nous emmener à son bord qui traversait la nuit en direction du néant, arrivé au bout de la Terre il tombera… ».
Ce livre n’était a priori pas celui que je préfère de Lobo Antunes de par le thème traité, j’aime avec cet auteur apprendre l’histoire de mon pays d’origine, mais je dois avouer que cette trame policière m’a passionnée…Sorte de vrai faux policier, c’est un livre incroyable, unique, d’où jaillit la pâte inimitable de l’auteur. C’est une lecture que l’on peut qualifier d’exigeante, passionnante, parfois pesante pour peu que nous soyons fatigués, et alors une petite pause est nécessaire pour pouvoir ensuite reprendre le fil de la narration, ou plutôt les fils de la narration devrait-on plutôt dire, mais une lecture toujours surprenante et impressionnante… « La dernière porte avant la nuit » est sorti en 2018 et a été traduit en 2022 en français, je me prends à rêver que ce soit enfin l’année pour lui d’avoir le Prix Nobel. Mention spéciale également à Dominique Nédellec pour la traduction, il faut dire qu’il avait remporté le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles 2019 pour sa traduction d’un autre livre de Lobo Antunes « Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau », publié en janvier 2019 par les Éditions Christian Bourgois fidèles à l’écrivain. Traduire un tel style est une prouesse. A-t-il eu l’impression, en parcourant cette œuvre, comme moi, de boire « le lait caillé du souffle de la lune » directement au goulot ? Les yeux ronds, l’esprit en ébullition, à tenter de nous fabriquer un sourire avec les matériaux, pas évidents à plier, de l’admiration...
J’imagine Antonio Lobo Antunes faire de tels dessins, automatiques…nous verrions sur la page de rondes arabesques emmêlées, ou alors une sorte de labyrinthe, un trait horizontal, puis un trait vertical à l’une des extrémités du premier, et ainsi de suite. Impasses multiples et implacables, briques de mur occupant toute une page au fur et à mesure du temps. Je serais même d’avis que nous y verrions sans doute à la fois, et des arabesques et des formes labyrinthiques, de couleur sombre…C’est pour moi une forme imagée de ses romans. Tout comme la couverture, magnifique par son abstraction et sa noirceur verdâtre, cratère incandescent, qui donne l’impression de dévoiler en une image l’univers d’Antunes…Mais en lieu et place des dessins, des mots… et quels mots ! L’auteur est le maître incontesté des pensées labyrinthiques, des digressions en arabesque qui s’entortillent, denses, complexes. Les comprendre nécessite du temps, de la patience et surtout du lâcher prise ; les années m’ont peu à peu procuré cette clé.
Lobo Antunes tricote, entrelaçant incessamment les pensées qui viennent à chaque protagoniste, des bouts de paroles, des rêves, le passé entremêlé au présent, d’autres pensées parasites et ce, dans une seule phrase. Pas de point car l’auteur est dans la tête de chaque personnage, véritablement, littéralement dans son flot de pensées et nos pensées, incessantes, ne sont jamais interrompues. Nous pensons sans arrêt. Un chapitre, un protagoniste, une phrase, un soliloque. Lobo Antunes tricote et cela donne une dentelle unique, singulière, d’une beauté sensorielle, d’une poésie sombre, d’une musique envoutante. Lire Lobo Antunes est une aventure intellectuelle. Une expérience, adorée ou détestée.
Les livres que je préfère de cet auteur portugais parlent de l’histoire et de la politique du Portugal, de la guerre en Angola, de l’opposition entre l’avant et l’après Révolution des œillets de 1974, l’avant et l’après dictature de Salazar. Ce fut le cas avec « L’exhortation aux crocodiles », et ces voix fantomatiques de femmes, épouses d’hommes proches du dictateur à qui il donne voix au chapitre, et surtout avec « Le manuel des inquisiteurs », un de mes livres préférés, donnant la parole à un homme issu de l’union improbable entre un homme proche du dictateur et une servante pauvre.
Ici, rien de tout ça, nous sommes avec cinq hommes tous liés par un pacte criminel : ils ont tous participé au kidnapping et à l’assassinat d’un chef d’entreprise fortuné. Kidnapping devant sa propre petite fille laissée seule dans le parking souterrain d’où ce père a été embarqué. Pourtant ces cinq hommes le connaissaient depuis l’enfance. Ils ont même fait disparaitre le corps de façon ignoble : à l’acide avant de jeter ce qui restait de lui dans une rivière. Car pas de corps, pas de crime, ne cessent-ils de répéter. Chacun des protagonistes évoque tour à tour, en une ronde vertigineuse donnant le tournis, le déroulement des faits, en pensée, évocation entrecoupée de multiples digressions sur ses états d’âme, ses souvenirs d’enfances, ses obsessions, ses relations conjugales et familiales… Et c’est peu de dire qu’ils moulinent, les nerfs complètement à vif… A nous, lecteurs ahuris, de tamiser ce flot ininterrompu, mais souvent tronqué, et de percevoir la culpabilité, les névroses qui en jaillissent…A nous d’en faire émerger des pépites. A nous d’extraire de ce flux de conscience ininterrompu une signification arrêtée de l’inconscient…
Qui sont ces cinq meurtriers qui doivent absolument garder le secret ? Qui sont ces cinq énergumènes qui vont se faire complétement dépassés par le crime ignoble commis, l’étau se resserrant peu à peu autour d’eux ? Il y a le collecteur de créances (c’est joliment dit pour quelqu’un qui rançonne les clients en retard), dit « collecteur du billard » du fait de sa passion pour ce loisir, le personnage pour moi le plus touchant, qui évoque souvent, et de façon poignante, sa grand-mère, toujours présente malgré sa mort, présente dans les petites graines poilues flottant au hasard entre deux eaux de l’air au printemps, il y a le frère du patron, amoureux de la sœur de l’homme assassiné et assez limité intellectuellement, l’herboriste un homme souffrant d’impuissance, malheureux en ménage et obnubilé par ses problèmes sexuels persuadé que sans corps pas de crime, le second collecteur de créances dont le père est parti à l’âge de sept ans le laissant seul avec sa mère, et enfin le patron, homme gros et laid, lui aussi amoureux de la sœur de l’homme assassiné qui n’a jamais voulu de lui. Des hommes malheureux, des hommes touchants, des hommes misogynes, à la fois fascinés par les femmes et les détestant, parfois odieux et lâches, des hommes ayant hérité d’un lourd passé, jouant très jeunes des rôles qu’ils n’auraient pas dû jouer ou abandonnés. Des hommes restés petits garçons qui voudraient juste être aimés…Des hommes de plus en plus touchants au fil des rondes, à mesure que nous comprenons l’ignominie des gestes exécutés, à mesure que croît la culpabilité…la ronde va s’enrayer, hoqueter, les condamner.
« Après le départ de mon père en compagnie de l’ombrelle j’ai commencé à dormir avec ma mère dans un creux du lit trop grand pour moi et qui avait son odeur à lui, il aurait suffi qu’on jette de la terre dans ce trou pour que je fleurisse en mai, des racines à la place des jambes, des feuilles à la place des bras, ma mère m’arrosant avec l’eau de la bouilloire et le petit bouton de ma tête apparaissant peu à peu… ».
Cette nuit tragique, qui est venu rajouter du sordide au malheur, n’en finit pas, elle n’en finira jamais, plus aucune promesse d’aube, aucun vestige du jour, elle est sans relâche dans les pensées, obsédante, écœurante, malsaine, noire, elle gangrène leurs têtes, elle agit comme l’acide qu’ils ont utilisé, bouillonnant dans leurs pensées, en bulles presque dorées dans l’obscurité, pour finir par les ronger. C’est une porte impossible à refermer avant la fin, avant la Nuit éternelle… « rien que la nuit et nous minuscules, perdus, sans personne pour nous aider, si au moins un bras pour arranger le drap, si au moins une voix – Gamin – et il n’y a ni bras, ni voix hormis la nôtre – Au secours- ».
De multiples réflexions sont abordées par l’auteur, celle des peurs ancestrales, peur du noir, peur de ne pas être aimé, le thème dévorant de la culpabilité, des pulsions, de la mort, des silences au sein de la famille, de l’absence de désir, de la subjectivité quant à l’existence des éléments quand on ne les voit pas, la paranoïa…Une satire sur les turpitudes de la vie, les efforts vains d’y apporter du sens…mille et une réflexions qui bruissent, qui tournoient, virevoltent, éclosent en explosant, rouge sang, ou carrément noires, par ci, par-là, pour former une forêt foisonnante assez angoissante dans laquelle se frayer un chemin au milieu de bruits incessants :
« …mon Dieu la quantité de bruits qu’on peut entendre dans ce monde pour peu qu’on se montre attentif, depuis celui que fait l’axe de la Terre jusqu’aux murmures des personnes qui sont déjà parties (…) en même temps que le vent dans les pins, un chien dans une ferme au loin, le silence remplis de menus sons de la campagne, insectes, feuilles, herbes, les bruits mats de fruits qui tombaient, les changements d’humeur du vent, l’éternel train trop lointain pour nous emmener à son bord qui traversait la nuit en direction du néant, arrivé au bout de la Terre il tombera… ».
Ce livre n’était a priori pas celui que je préfère de Lobo Antunes de par le thème traité, j’aime avec cet auteur apprendre l’histoire de mon pays d’origine, mais je dois avouer que cette trame policière m’a passionnée…Sorte de vrai faux policier, c’est un livre incroyable, unique, d’où jaillit la pâte inimitable de l’auteur. C’est une lecture que l’on peut qualifier d’exigeante, passionnante, parfois pesante pour peu que nous soyons fatigués, et alors une petite pause est nécessaire pour pouvoir ensuite reprendre le fil de la narration, ou plutôt les fils de la narration devrait-on plutôt dire, mais une lecture toujours surprenante et impressionnante… « La dernière porte avant la nuit » est sorti en 2018 et a été traduit en 2022 en français, je me prends à rêver que ce soit enfin l’année pour lui d’avoir le Prix Nobel. Mention spéciale également à Dominique Nédellec pour la traduction, il faut dire qu’il avait remporté le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles 2019 pour sa traduction d’un autre livre de Lobo Antunes « Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau », publié en janvier 2019 par les Éditions Christian Bourgois fidèles à l’écrivain. Traduire un tel style est une prouesse. A-t-il eu l’impression, en parcourant cette œuvre, comme moi, de boire « le lait caillé du souffle de la lune » directement au goulot ? Les yeux ronds, l’esprit en ébullition, à tenter de nous fabriquer un sourire avec les matériaux, pas évidents à plier, de l’admiration...
Un livre magnifique, solitaire et extrêmement mélancolique…
Il vaudrait mieux, parfois, être capable de tout oublier. Ne pas se souvenir, ne pas s'encombrer la tête à cause de cette mémoire d'éléphant qui remplit tête, coeur et âme de souvenirs, de nostalgie, de regrets, grignotant lentement notre raison à la manière d'une fine et délicate dentelle, d'une porcelaine fissurée proche de l'explosion, d'un azuléjo décrépi menaçant de tomber des façades… Tel est le cas de ce psychiatre dont les pensées sont phagocytées alternativement par sa séparation récente avec sa femme et ses deux petites filles et son retour, plus ancien, de la guerre d'Angola où une partie de lui est restée. Pensées lénifiantes au point de se sentir comme dans une camisole de force, sans plus pouvoir bouger, ligoté par les courroies du dégout de soi-même et de l'isolement.
Nous sommes à Lisbonne et nous suivons, au cours d'une journée interminable et désespérée, ce psychiatre d'une trentaine d'années. Il exorcise ses démons, inlassablement, depuis la blessure amère d'un amour trop intense pour ne pas être sans espoir, en passant par la hantise de ses souvenirs de guerre en Angola où, tout comme l'auteur d'ailleurs, il a exercé en tant que psychiatre et a été témoin d'horreurs, jusqu'à sa conscience exacerbée de mener une existence vide et de servir une institution dont il condamne le rationalisme forcené. C'est une confession touchante, lancinante, un fado qui ne peut s'expliquer mais qui se ressent. O barco negro, le bateau noir, celui de la vie dans lequel le psychiatre tangue et perd la raison au fil des marées de saudade qui le submergent. Un radeau sans passagers, condamnés à la compagnie les uns des autres, comme à l'intérieur des barbelés en Afrique.
« Pourquoi est-ce que je me souviens toujours de l'enfer ? se demanda-t-il : parce que je n'en suis pas encore sorti ou parce que je l'ai remplacé par un autre genre de torture ? ».
L'amour exprimé par le psychiatre pour sa femme dont il est séparé est sublime et je crois bien que c'est la première fois que je vois de véritables déclarations d'amour dans un livre de Lobo Antunes lui qui, d'habitude, traite le couple avec beaucoup d'amertume et d'ironie. D'ailleurs, il me semble que l'auteur ne croit pas au bonheur conjugal qui se transforme toujours en ennui et dont le sens échappe à tout amour – notez que ce genre de couples peuple également ce livre, Lobo Antunes les décrit avec beaucoup d'ironie et de façon totalement jubilatoire mais irrévérencieuse - ici la séparation a permis de garder intacte la pureté originelle des débuts. L'amour est toujours fantasmé chez Lobo Antunes. Et surtout, je constate qu'il a une véritable réserve de tendresse qu'il cache sous un sarcasme trop évident pour être sincère…
« Avec qui viens-tu ici, se demanda la jalousie enflammée du psychiatre, de quoi parles-tu, au côté de qui t'allonges-tu dans des lits que je ne connais pas, qui serre entre ses mains la sveltesse de tes hanches ? Qui occupe la place qui a été la mienne, qui est encore la mienne en moi, espace de tendresse de mes baisers, tillac lisse pour le mât de mon pénis ? Qui navigue à la bouline dans ton ventre ? [ … ] Je n'ai jamais connu de corps qui me conviennent autant que le tien se dit le médecin en versant sa bière dans sa chope, qui soit aussi adapté à mes mesures humaines et inhumaines, les authentiques comme les imaginaires, n'en sont pas moins réelles, je n'ai jamais connu une capacité aussi grande et aussi profonde de communication avec une autre personne, d'absolue coïncidence, cette faculté d'être compris sans parler et d'entendre le silence et les émotions et les pensées de l'autre, cela m'a toujours semblé miraculeux que nous nous soyons connus sur la plage où je t'ai connue, maigre, brune, fragile, ton très antique profil sérieux posé sur tes genoux repliés… ».
Il suffit d'un rien, d'une odeur, d'un goût, d'un bruit, pour raviver les souvenirs et mettre en branle le mécanisme impitoyable de la nostalgie…ainsi, par exemple, le gout de la bière qui lui rappelle Portimao, « l'odeur d'haleine de diabétique qui se dégage de la mer, frissonnante du souffle féminin du vent d'est », odeurs entremêlées qui lui rappelle la première fois qu'ils avaient fait l'amour…
Le style est stupéfiant. Comme toujours avec Lobo Antunes. A coup de phrases travaillées, précieuses, étonnantes, il sculpte un style inimitable et totalement singulier. Mémoire D éléphant fait partie des premiers livres de l'auteur, les chapitres ne font pas encore des phrases entières, elles sont ici plus courtes. le procédé du flux de conscience, du soliloque vécu en directe, comme branché au cerveau du protagoniste, est utilisé de manière légère. Quelques transformations du « il » au « je » dans la même phrase sont bien présentes mais restent discrètes, substitution permettant de souligner avec plus de sensibilité la confession que nous livre le personnage.
« Seul dans la nuit de la rue Augusto-Gil, assis dans sa voiture, moteur coupé et phares éteints, le psychiatre appuya ses mains sur le volant et se mit à pleurer : il s'efforçait de n'émettre aucun son, de sorte que ses épaules tremblaient comme celles des actrices du cinéma muet lorsqu'elles cachaient leurs boucles de cheveux et leurs larmes dans les bras d'un grand-père barbu : Merde merde merde merde merde, disait-il à l'intérieur de lui-même, parce que je ne trouvais pas en moi d'autres mots que ceux-ci, sorte de faible protestation contre la noire tristesse qui me remplissait ».
C'est un livre aux trouvailles littéraires, aux métaphores, stupéfiantes et uniques, tout en étant plus accessible que les derniers livres de l'auteur où le style a atteint son paroxysme en matière de soliloques, de flux de conscience, d'ellipses. Mais c'est un récit également dans lequel la fantaisie des trouvailles littéraires ainsi que la subtilité et la préciosité de l'écriture donne un attrait proche d'un conte de fées maléfique et pour cette raison, malgré sa jeunesse dans la bibliographie de l'auteur, je le trouve absolument délicieux. Frais malgré sa noirceur. le noir est d'ailleurs vivant dans ce livre, il est magique.
« Il entra dans le bar avec l'état d'esprit de celui qui pénètre dans l'ombre humide d'une treille à l'heure de la grosse chaleur et, avant que ses pupilles ne s'habituent à la demi-obscurité de l'établissement, il distingua seulement dans une brume ténébreuse, de vagues éclats de lampes et des reflets de bouteilles ou d'objets métalliques, comme les lumières éparses de Lisbonne vue de la mer durant les nuits de brouillard. Il se dirigea en hésitant vers le comptoir, par pur instinct, chien myope cheminant vers un os hypothétique, pendant que peu à peu émergeaient des visages, les dents d'un sourire flottèrent près de lui, un bras tenant un verre ondula à sa gauche, un monde de tables et de chaises et quelques personnes surgirent du néant, gagnèrent du volume et de la consistance, l'encerclèrent, et il lui sembla soudain que le soleil au-dehors et les arbres et les arches de pierre du jardin des Amoreiras étaient très loin, perdus dans la dimension irréelle du passé ».
Ce livre est exceptionnel. Y souffle déjà l'inspiration des grandes sagas à venir d'Antonio Lobo Antunes, tant par le regard à la fois tendre et irrévérencieux jeté sur les personnages, que par le style dont il sème ici les prémisses d'une singularité qui va se faire grandissante au fil des oeuvres. J'aurais aimé pouvoir le lire en portugais pour apprécier encore davantage la richesse syntaxique du livre et les différents niveaux de langage que nous entrapercevons dans ce livre brillamment traduit par Violante do Canto et Yves Coleman. Mais je n'ai pas le niveau pour tant de subtilité. Peut-être devrais-je m'inspirer de la façon de faire de @Creisification qui lit en portugais (du Portugal) avec la version française à côté. C'est une excellente idée, je la retiens pour mes lectures lusophones à venir !
« Ma vie a basculé cul par-dessus tête, je me suis retrouvé comme un cafard gigotant sur le dos, les pattes en l'air, désemparé ».
Il vaudrait mieux, parfois, être capable de tout oublier. Ne pas se souvenir, ne pas s'encombrer la tête à cause de cette mémoire d'éléphant qui remplit tête, coeur et âme de souvenirs, de nostalgie, de regrets, grignotant lentement notre raison à la manière d'une fine et délicate dentelle, d'une porcelaine fissurée proche de l'explosion, d'un azuléjo décrépi menaçant de tomber des façades… Tel est le cas de ce psychiatre dont les pensées sont phagocytées alternativement par sa séparation récente avec sa femme et ses deux petites filles et son retour, plus ancien, de la guerre d'Angola où une partie de lui est restée. Pensées lénifiantes au point de se sentir comme dans une camisole de force, sans plus pouvoir bouger, ligoté par les courroies du dégout de soi-même et de l'isolement.
Nous sommes à Lisbonne et nous suivons, au cours d'une journée interminable et désespérée, ce psychiatre d'une trentaine d'années. Il exorcise ses démons, inlassablement, depuis la blessure amère d'un amour trop intense pour ne pas être sans espoir, en passant par la hantise de ses souvenirs de guerre en Angola où, tout comme l'auteur d'ailleurs, il a exercé en tant que psychiatre et a été témoin d'horreurs, jusqu'à sa conscience exacerbée de mener une existence vide et de servir une institution dont il condamne le rationalisme forcené. C'est une confession touchante, lancinante, un fado qui ne peut s'expliquer mais qui se ressent. O barco negro, le bateau noir, celui de la vie dans lequel le psychiatre tangue et perd la raison au fil des marées de saudade qui le submergent. Un radeau sans passagers, condamnés à la compagnie les uns des autres, comme à l'intérieur des barbelés en Afrique.
« Pourquoi est-ce que je me souviens toujours de l'enfer ? se demanda-t-il : parce que je n'en suis pas encore sorti ou parce que je l'ai remplacé par un autre genre de torture ? ».
L'amour exprimé par le psychiatre pour sa femme dont il est séparé est sublime et je crois bien que c'est la première fois que je vois de véritables déclarations d'amour dans un livre de Lobo Antunes lui qui, d'habitude, traite le couple avec beaucoup d'amertume et d'ironie. D'ailleurs, il me semble que l'auteur ne croit pas au bonheur conjugal qui se transforme toujours en ennui et dont le sens échappe à tout amour – notez que ce genre de couples peuple également ce livre, Lobo Antunes les décrit avec beaucoup d'ironie et de façon totalement jubilatoire mais irrévérencieuse - ici la séparation a permis de garder intacte la pureté originelle des débuts. L'amour est toujours fantasmé chez Lobo Antunes. Et surtout, je constate qu'il a une véritable réserve de tendresse qu'il cache sous un sarcasme trop évident pour être sincère…
« Avec qui viens-tu ici, se demanda la jalousie enflammée du psychiatre, de quoi parles-tu, au côté de qui t'allonges-tu dans des lits que je ne connais pas, qui serre entre ses mains la sveltesse de tes hanches ? Qui occupe la place qui a été la mienne, qui est encore la mienne en moi, espace de tendresse de mes baisers, tillac lisse pour le mât de mon pénis ? Qui navigue à la bouline dans ton ventre ? [ … ] Je n'ai jamais connu de corps qui me conviennent autant que le tien se dit le médecin en versant sa bière dans sa chope, qui soit aussi adapté à mes mesures humaines et inhumaines, les authentiques comme les imaginaires, n'en sont pas moins réelles, je n'ai jamais connu une capacité aussi grande et aussi profonde de communication avec une autre personne, d'absolue coïncidence, cette faculté d'être compris sans parler et d'entendre le silence et les émotions et les pensées de l'autre, cela m'a toujours semblé miraculeux que nous nous soyons connus sur la plage où je t'ai connue, maigre, brune, fragile, ton très antique profil sérieux posé sur tes genoux repliés… ».
Il suffit d'un rien, d'une odeur, d'un goût, d'un bruit, pour raviver les souvenirs et mettre en branle le mécanisme impitoyable de la nostalgie…ainsi, par exemple, le gout de la bière qui lui rappelle Portimao, « l'odeur d'haleine de diabétique qui se dégage de la mer, frissonnante du souffle féminin du vent d'est », odeurs entremêlées qui lui rappelle la première fois qu'ils avaient fait l'amour…
Le style est stupéfiant. Comme toujours avec Lobo Antunes. A coup de phrases travaillées, précieuses, étonnantes, il sculpte un style inimitable et totalement singulier. Mémoire D éléphant fait partie des premiers livres de l'auteur, les chapitres ne font pas encore des phrases entières, elles sont ici plus courtes. le procédé du flux de conscience, du soliloque vécu en directe, comme branché au cerveau du protagoniste, est utilisé de manière légère. Quelques transformations du « il » au « je » dans la même phrase sont bien présentes mais restent discrètes, substitution permettant de souligner avec plus de sensibilité la confession que nous livre le personnage.
« Seul dans la nuit de la rue Augusto-Gil, assis dans sa voiture, moteur coupé et phares éteints, le psychiatre appuya ses mains sur le volant et se mit à pleurer : il s'efforçait de n'émettre aucun son, de sorte que ses épaules tremblaient comme celles des actrices du cinéma muet lorsqu'elles cachaient leurs boucles de cheveux et leurs larmes dans les bras d'un grand-père barbu : Merde merde merde merde merde, disait-il à l'intérieur de lui-même, parce que je ne trouvais pas en moi d'autres mots que ceux-ci, sorte de faible protestation contre la noire tristesse qui me remplissait ».
C'est un livre aux trouvailles littéraires, aux métaphores, stupéfiantes et uniques, tout en étant plus accessible que les derniers livres de l'auteur où le style a atteint son paroxysme en matière de soliloques, de flux de conscience, d'ellipses. Mais c'est un récit également dans lequel la fantaisie des trouvailles littéraires ainsi que la subtilité et la préciosité de l'écriture donne un attrait proche d'un conte de fées maléfique et pour cette raison, malgré sa jeunesse dans la bibliographie de l'auteur, je le trouve absolument délicieux. Frais malgré sa noirceur. le noir est d'ailleurs vivant dans ce livre, il est magique.
« Il entra dans le bar avec l'état d'esprit de celui qui pénètre dans l'ombre humide d'une treille à l'heure de la grosse chaleur et, avant que ses pupilles ne s'habituent à la demi-obscurité de l'établissement, il distingua seulement dans une brume ténébreuse, de vagues éclats de lampes et des reflets de bouteilles ou d'objets métalliques, comme les lumières éparses de Lisbonne vue de la mer durant les nuits de brouillard. Il se dirigea en hésitant vers le comptoir, par pur instinct, chien myope cheminant vers un os hypothétique, pendant que peu à peu émergeaient des visages, les dents d'un sourire flottèrent près de lui, un bras tenant un verre ondula à sa gauche, un monde de tables et de chaises et quelques personnes surgirent du néant, gagnèrent du volume et de la consistance, l'encerclèrent, et il lui sembla soudain que le soleil au-dehors et les arbres et les arches de pierre du jardin des Amoreiras étaient très loin, perdus dans la dimension irréelle du passé ».
Ce livre est exceptionnel. Y souffle déjà l'inspiration des grandes sagas à venir d'Antonio Lobo Antunes, tant par le regard à la fois tendre et irrévérencieux jeté sur les personnages, que par le style dont il sème ici les prémisses d'une singularité qui va se faire grandissante au fil des oeuvres. J'aurais aimé pouvoir le lire en portugais pour apprécier encore davantage la richesse syntaxique du livre et les différents niveaux de langage que nous entrapercevons dans ce livre brillamment traduit par Violante do Canto et Yves Coleman. Mais je n'ai pas le niveau pour tant de subtilité. Peut-être devrais-je m'inspirer de la façon de faire de @Creisification qui lit en portugais (du Portugal) avec la version française à côté. C'est une excellente idée, je la retiens pour mes lectures lusophones à venir !
« Ma vie a basculé cul par-dessus tête, je me suis retrouvé comme un cafard gigotant sur le dos, les pattes en l'air, désemparé ».
L’écrivain Antonio Lobo Antunes a coutume, dans ses livres, de critiquer le nationalisme qui a marqué une partie de sa vie : « Je ne comprends pas le patriotisme, je me méfie du nationalisme, j’ai grandi sous Salazar. D’ailleurs, je suis très étonné par la manière dont vous séparez dans vos librairies vos livres nationaux et les livres étrangers. Les dictatures commencent comme ça ».
Avec « Le retour des caravelles », l’un des plus grands auteurs lusophones nous offre une traversée de l’histoire de son pays totalement baroque, et jette en pâture le mythe des grandes découvertes et conquêtes territoriales sapant ainsi les bases du nationalisme portugais…je comprends pourquoi ce livre a fait grand bruit au Portugal à sa sortie, ce sont les héros de la splendeur de ce pays dont il se moque avec cynisme !
Ceux qui me lisent le savent, Antonio Lobo Antunes est mon écrivain préféré. Le retour des caravelles n’a cependant ma préférence parmi sa longue bibliographie. Si je retrouve dans ce livre la plume flamboyante et nostalgique, sensorielle, de l’auteur portugais, ses métaphores, ses personnifications, ses nombreuses figures de style, en revanche je le trouve moins original en ce qui concerne sa façon unique de rendre compte des soliloques empreints d’obsessions de ses personnages, chaque chapitre pouvant habituellement être le déroulement incroyable d’une seule phrase qui entremêle passé et présent, pensées et sensations (le maître d’Antonio Lobo Antunes est William Faulkner et il m’est d’avis, qu’en matière de flux de conscience, l’élève a dépassé le maître, mais cela est un avis bien personnel fondé qui plus est sur une seule lecture de Faulkner, je ne suis guère objective).
Ici la plume est plus conventionnelle et l’originalité du récit tient non pas à cette manière, quasi hypnotique, de se connecter au flux de conscience des personnages mais à celle, assez insolite tout de même, de prendre des personnages historiques connus sur lesquels se fonde la soi-disant splendeur du Portugal pour les parachuter dans le Lisbonne d’après la décolonisation, celle des années 70, ville qu’ils ne reconnaissent plus évidemment, dans laquelle ils errent et où ils espèrent le retour des caravelles leur permettant de retrouver grandeur et dignité.
Cette façon de faire permet d’une part de descendre les personnages légendaires de leur piédestal en les montrant tels de pauvres hères errant dans une terre natale devenue étrangère, dans des endroits sordides et crasseux, et de souligner d’autre part toute la vacuité de la colonisation… Tout ça pour ça, sommes-nous tentés de dire. L’Angola, mais aussi La Guinée-Bissau, le Mozambique, le Cap-Vert (et même Macau), toutes les colonies d’Afrique portugaises sont ainsi appréhendées et l’indépendance, suite à la révolution des œillets d’avril 1974, a fait fuir les portugais, coupables, aux yeux des autochtones, de l’exploitation dominatrice de ces terres et des abus perpétrés sur ces peuples. Nous vivons la tragédie que constitue le retour de tout exilé en terre natale qui n’est plus tout à fait la même de sorte qu’un exilé est finalement de nulle part, étranger dans son propre pays. Antunes est souvent cynique et dénonce les exactions commises entrainent son lecteur dans un sentiment de révolte et de dégout. L’auteur se délecte en jetant en vrac tous les héros nationaux de cette époque des grandes découvertes, désormais perdus, éperdus, amères, accueillis dans un hôtel sordide « L’Apôtre des indes », dont le gérant, François-Xavier, est revenu du Mozambique en échangeant sa jeune épouse contre un billet d’avion. Il gère un grand nombre de prostituées qu’il exploite abusivement. Les scènes décrites de cet hôtel où se côtoient prostituées et anciens héros sont épiques, pathétiques, révoltantes, marquées du sceau de la décrépitude et de la lassitude…
« Le mari eut l’impression qu’ils habitaient dans une sorte de ruine d’apocalypse ou de cimetière abandonné : les plafonniers cassés se décollaient de la peinture comme des grappes de chagrin dont les larmes n’auraient pas encore fini de couler ; on avait entaillé au couteau le bois des armoires ; les cicatrices des abat-jour, qui se réduisaient pratiquement à leur armature en fil de fer, témoignaient d’un impitoyable combat avec des fantômes arabes… ».
Les deux personnages qui m’ont le plus marqués, parmi les nombreux personnages mentionnés par l’auteur, se sont Luis de Camoëns, grand poète portugais qui a écrit les Lusiades où est faite l’apologie de la conquête des territoires et où sont décrits les faits d’armes des anciens héros, ainsi que le célèbre navigateur Vasco de Gama. Nous voyons le poète revenir avec son père mort sillonner sans relâche la capitale avec ce cercueil où pourrit le cadavre paternel, dernier signe de la gloire passée désormais moribonde. Fardeau encombrant, le cercueil délabré sera jeté dans le Tage et le cadavre sera dilué à l’acide et enfermé dans une bouteille avec l’aide d’un garçon de café…sordide, le grand poète est ici capable des pires vilénies.
Nous découvrons par ailleurs Vasco de Gama évoquer ses souvenirs avec le roy Manoel, contemplant tous deux le Tage du haut du pont au nom emblématique, le pont du 25 avril. Tous deux jouent à la belote puis seront expédiés dans un asile psychiatrique suite à une virée en pleine nuit totalement déjantée. Fin absurde pour ce grand héros national.
Captivante cette présence du passé dans le présent, qui opère dans les premières pages où nous découvrons la présence d’une caravelle, grand voilier d’antan, aux côtés des pétroliers irakiens, ou encore la concomitance d’attelages de bœufs transportant des blocs de pierre et de cars remplis d’Américains. Drôle cette façon de découvrir Vasco de Gama et le Roy Manoel habillés comme au temps des grandes découvertes - poignard en fer blanc à la poitrine, mocassins pointus en velours, pourpoints à rayures et « longues mèches sentant l’origan d’arrière-cuisine dans lesquelles pullulaient des parasites des siècles révolus » - dans le Lisbonne des années 70. Anachronismes intéressants donnant un air d’éternité, de permanence, fantômes toujours présents, le passé expliquant sans cesse le présent. A noter la présence surprenante de Don Quichotte et même de Miró, vieillard en survêtement, des héros espagnols dont l’allusion s’explique par l’histoire singulière entre le Portugal et l’Espagne…
A noter que les chapitres démarrent par la présentation d’un personnage (chaque chapitre peut être vu comme une nouvelle d’ailleurs ce qui n’est pas ce que je préfère) et au fur et à mesure de l’avancée dans le chapitre, le « je » prend la place du « il », comme si l’auteur arrivait à chaque fois à se mettre à la place du personnage mentionné une fois celui-ci en pleine saudade comme s’il en devenait finalement plus proche à mesure que le héros devenait un personnage déchu.
Désireux de dénoncer la vision héroïque de l’histoire qui maintient le peuple dans l’ignorance et l’aveuglement, Le retour des caravelles milite pour une recontextualisation, une mise au point, où la guerre, l’hypocrisie, les vilénies au sein des colonies, l’absurdité du monde, le rôle de la bourgeoisie corrompue et complice du pouvoir salazariste sont replacés au centre du récit et revisitent l’histoire. C’est un texte exigeant qui nécessite de connaitre ou de se documenter sur l’histoire du Portugal, c’est une plume flamboyante mais pas aussi expérimentale que certains autres livres de l’auteur. C’est un livre sans concession où la saudade vous cerne de toute part et infuse en vous un sentiment d’abandon et de décrépitude, devenant alors confusément, à l’image des personnages perdus du récit, plus vulnérables et plus fragiles qu’un mousse tombé en disgrâce…
« Les chauve-souris, qui reniflaient les réverbères, en quête de papillons tropicaux arrivés avec les esclaves de Guinée, s’enfonçaient par erreur dans les reflets mauves des vagues mourantes du Tage ».
Avec « Le retour des caravelles », l’un des plus grands auteurs lusophones nous offre une traversée de l’histoire de son pays totalement baroque, et jette en pâture le mythe des grandes découvertes et conquêtes territoriales sapant ainsi les bases du nationalisme portugais…je comprends pourquoi ce livre a fait grand bruit au Portugal à sa sortie, ce sont les héros de la splendeur de ce pays dont il se moque avec cynisme !
Ceux qui me lisent le savent, Antonio Lobo Antunes est mon écrivain préféré. Le retour des caravelles n’a cependant ma préférence parmi sa longue bibliographie. Si je retrouve dans ce livre la plume flamboyante et nostalgique, sensorielle, de l’auteur portugais, ses métaphores, ses personnifications, ses nombreuses figures de style, en revanche je le trouve moins original en ce qui concerne sa façon unique de rendre compte des soliloques empreints d’obsessions de ses personnages, chaque chapitre pouvant habituellement être le déroulement incroyable d’une seule phrase qui entremêle passé et présent, pensées et sensations (le maître d’Antonio Lobo Antunes est William Faulkner et il m’est d’avis, qu’en matière de flux de conscience, l’élève a dépassé le maître, mais cela est un avis bien personnel fondé qui plus est sur une seule lecture de Faulkner, je ne suis guère objective).
Ici la plume est plus conventionnelle et l’originalité du récit tient non pas à cette manière, quasi hypnotique, de se connecter au flux de conscience des personnages mais à celle, assez insolite tout de même, de prendre des personnages historiques connus sur lesquels se fonde la soi-disant splendeur du Portugal pour les parachuter dans le Lisbonne d’après la décolonisation, celle des années 70, ville qu’ils ne reconnaissent plus évidemment, dans laquelle ils errent et où ils espèrent le retour des caravelles leur permettant de retrouver grandeur et dignité.
Cette façon de faire permet d’une part de descendre les personnages légendaires de leur piédestal en les montrant tels de pauvres hères errant dans une terre natale devenue étrangère, dans des endroits sordides et crasseux, et de souligner d’autre part toute la vacuité de la colonisation… Tout ça pour ça, sommes-nous tentés de dire. L’Angola, mais aussi La Guinée-Bissau, le Mozambique, le Cap-Vert (et même Macau), toutes les colonies d’Afrique portugaises sont ainsi appréhendées et l’indépendance, suite à la révolution des œillets d’avril 1974, a fait fuir les portugais, coupables, aux yeux des autochtones, de l’exploitation dominatrice de ces terres et des abus perpétrés sur ces peuples. Nous vivons la tragédie que constitue le retour de tout exilé en terre natale qui n’est plus tout à fait la même de sorte qu’un exilé est finalement de nulle part, étranger dans son propre pays. Antunes est souvent cynique et dénonce les exactions commises entrainent son lecteur dans un sentiment de révolte et de dégout. L’auteur se délecte en jetant en vrac tous les héros nationaux de cette époque des grandes découvertes, désormais perdus, éperdus, amères, accueillis dans un hôtel sordide « L’Apôtre des indes », dont le gérant, François-Xavier, est revenu du Mozambique en échangeant sa jeune épouse contre un billet d’avion. Il gère un grand nombre de prostituées qu’il exploite abusivement. Les scènes décrites de cet hôtel où se côtoient prostituées et anciens héros sont épiques, pathétiques, révoltantes, marquées du sceau de la décrépitude et de la lassitude…
« Le mari eut l’impression qu’ils habitaient dans une sorte de ruine d’apocalypse ou de cimetière abandonné : les plafonniers cassés se décollaient de la peinture comme des grappes de chagrin dont les larmes n’auraient pas encore fini de couler ; on avait entaillé au couteau le bois des armoires ; les cicatrices des abat-jour, qui se réduisaient pratiquement à leur armature en fil de fer, témoignaient d’un impitoyable combat avec des fantômes arabes… ».
Les deux personnages qui m’ont le plus marqués, parmi les nombreux personnages mentionnés par l’auteur, se sont Luis de Camoëns, grand poète portugais qui a écrit les Lusiades où est faite l’apologie de la conquête des territoires et où sont décrits les faits d’armes des anciens héros, ainsi que le célèbre navigateur Vasco de Gama. Nous voyons le poète revenir avec son père mort sillonner sans relâche la capitale avec ce cercueil où pourrit le cadavre paternel, dernier signe de la gloire passée désormais moribonde. Fardeau encombrant, le cercueil délabré sera jeté dans le Tage et le cadavre sera dilué à l’acide et enfermé dans une bouteille avec l’aide d’un garçon de café…sordide, le grand poète est ici capable des pires vilénies.
Nous découvrons par ailleurs Vasco de Gama évoquer ses souvenirs avec le roy Manoel, contemplant tous deux le Tage du haut du pont au nom emblématique, le pont du 25 avril. Tous deux jouent à la belote puis seront expédiés dans un asile psychiatrique suite à une virée en pleine nuit totalement déjantée. Fin absurde pour ce grand héros national.
Captivante cette présence du passé dans le présent, qui opère dans les premières pages où nous découvrons la présence d’une caravelle, grand voilier d’antan, aux côtés des pétroliers irakiens, ou encore la concomitance d’attelages de bœufs transportant des blocs de pierre et de cars remplis d’Américains. Drôle cette façon de découvrir Vasco de Gama et le Roy Manoel habillés comme au temps des grandes découvertes - poignard en fer blanc à la poitrine, mocassins pointus en velours, pourpoints à rayures et « longues mèches sentant l’origan d’arrière-cuisine dans lesquelles pullulaient des parasites des siècles révolus » - dans le Lisbonne des années 70. Anachronismes intéressants donnant un air d’éternité, de permanence, fantômes toujours présents, le passé expliquant sans cesse le présent. A noter la présence surprenante de Don Quichotte et même de Miró, vieillard en survêtement, des héros espagnols dont l’allusion s’explique par l’histoire singulière entre le Portugal et l’Espagne…
A noter que les chapitres démarrent par la présentation d’un personnage (chaque chapitre peut être vu comme une nouvelle d’ailleurs ce qui n’est pas ce que je préfère) et au fur et à mesure de l’avancée dans le chapitre, le « je » prend la place du « il », comme si l’auteur arrivait à chaque fois à se mettre à la place du personnage mentionné une fois celui-ci en pleine saudade comme s’il en devenait finalement plus proche à mesure que le héros devenait un personnage déchu.
Désireux de dénoncer la vision héroïque de l’histoire qui maintient le peuple dans l’ignorance et l’aveuglement, Le retour des caravelles milite pour une recontextualisation, une mise au point, où la guerre, l’hypocrisie, les vilénies au sein des colonies, l’absurdité du monde, le rôle de la bourgeoisie corrompue et complice du pouvoir salazariste sont replacés au centre du récit et revisitent l’histoire. C’est un texte exigeant qui nécessite de connaitre ou de se documenter sur l’histoire du Portugal, c’est une plume flamboyante mais pas aussi expérimentale que certains autres livres de l’auteur. C’est un livre sans concession où la saudade vous cerne de toute part et infuse en vous un sentiment d’abandon et de décrépitude, devenant alors confusément, à l’image des personnages perdus du récit, plus vulnérables et plus fragiles qu’un mousse tombé en disgrâce…
« Les chauve-souris, qui reniflaient les réverbères, en quête de papillons tropicaux arrivés avec les esclaves de Guinée, s’enfonçaient par erreur dans les reflets mauves des vagues mourantes du Tage ».
Ma grand-mère portugaise m'a donné un seul conseil un brin solennel le jour où je lui ai présenté le père de mes enfants : "s'il te bat, tu ne dis rien". Comprenant parfois mal le portugais, je lui ai demandé de répéter. Et elle de réitérer : "s'il te bat, surtout tu ne dis rien". Cette femme a perdu son mari, et 7 enfants sur les 9 qu'elle a eu durant les années 40 et 50, période de la dictature au Portugal. Mon père est un rescapé. Leur fuite en France est évidente, mais ma grand-mère en 30 ans n'aura pas réussi à apprendre un mot de français, tant elle se sentais déracinée, loin des tombes de ses enfants, et très souvent les larmes lui venaient rien qu'en évoquant le Portugal.
Les auteurs portugais me rappellent ces racines, Saramago et Pessoa notamment. J'y retrouve cette mélancolie qui a toujours habité ma grand-mère. Voilà longtemps qu'Antunes m'attire aussi. Mais j'avais essayé de le lire il y a 20 ans et je n'y étais pas parvenue tant son style est difficile. Je ne comprenais rien. Et puis j'ai décidé de persévérer ces derniers jours. Et là, avec émotion et poésie, j'ai retrouvé ma grand-mère.
Quatre femmes sont au centre de ce roman. La voix n'est donnée qu'à ces femmes. Domestique, maîtresse, épouse ou veuve, elles vivent dans l'ombre d'hommes qui ont participé au régime dictatorial en place au Portugal jusqu'en 1974. Épargnés par la Révolution des Œillets qui libéra le pays, ces " crocodiles " (pourquoi les appelle-t-on des crocodiles ces hommes...pour moi un crocodile est un animal à grande gueule et petite queue...curieux) sont prêts à tout pour abattre la démocratie naissante. Exécutions, attentats. Leurs femmes, témoins des complots et attentats organisés, sont condamnées au silence. Des femmes silencieuses, méprisées, bafouées (la phrase de ma grand-mère en ritournelle). L'une est sourde et a un cancer, une autre est très grosse, une autre est veuve. Mais dans leurs monologues intérieurs, elles peuvent enfin prendre la parole en toute liberté, brasser les faits et les émotions, revenir à l'enfance perdue, décrire leur condition, la survivance de la haine, la médiocrité des consciences, ... Le chœur de ces quatre femmes retrace l'envers de l'histoire du Portugal et Antonio Lobo Antunes nous livre ainsi un époustouflant requiem.
Pour aborder et apprécier ce requiem, il faut se laisser aller. Imaginer un océan, se mettre en étoile de mer sur cet océan en se laissant bercer par les vagues, le ressac, les remous. Accepter de se perdre, de ne pas lutter contre, de dériver, de ne plus avoir de repères, le passé et le présent, s'entremêlant parfois dans un même paragraphe, les voix s'interpénétrant par moment, juste accueillir la poésie époustouflante qui donne toute la fraicheur à ce texte et petit à petit le fil apparait, la sensibilité des personnages émerge. C'est une belle expérience de littérature.
Il faut véritablement plonger dans ce style et cet univers et lire le livre en quasi apnée. Ne pas le laisser pour le reprendre plus tard. Non. Plonger, se laisser aller et accueillir. Accueillir l'intensité poétique.
Oui l'écriture de cet auteur , vous l'aurez compris, est très particulière, originale, exigeante : de longs passages courant sur plusieurs pages, empreints d'une poésie à couper le souffle, entrecoupés par les obsessions des personnages qui reviennent comme des leitmotivs rythmer le roman de leurs questions, de leurs angoisses, de leurs peurs. Une ritournelle. Comme celle laissée, cadeau bien particulier, par ma grand-mère.
Les auteurs portugais me rappellent ces racines, Saramago et Pessoa notamment. J'y retrouve cette mélancolie qui a toujours habité ma grand-mère. Voilà longtemps qu'Antunes m'attire aussi. Mais j'avais essayé de le lire il y a 20 ans et je n'y étais pas parvenue tant son style est difficile. Je ne comprenais rien. Et puis j'ai décidé de persévérer ces derniers jours. Et là, avec émotion et poésie, j'ai retrouvé ma grand-mère.
Quatre femmes sont au centre de ce roman. La voix n'est donnée qu'à ces femmes. Domestique, maîtresse, épouse ou veuve, elles vivent dans l'ombre d'hommes qui ont participé au régime dictatorial en place au Portugal jusqu'en 1974. Épargnés par la Révolution des Œillets qui libéra le pays, ces " crocodiles " (pourquoi les appelle-t-on des crocodiles ces hommes...pour moi un crocodile est un animal à grande gueule et petite queue...curieux) sont prêts à tout pour abattre la démocratie naissante. Exécutions, attentats. Leurs femmes, témoins des complots et attentats organisés, sont condamnées au silence. Des femmes silencieuses, méprisées, bafouées (la phrase de ma grand-mère en ritournelle). L'une est sourde et a un cancer, une autre est très grosse, une autre est veuve. Mais dans leurs monologues intérieurs, elles peuvent enfin prendre la parole en toute liberté, brasser les faits et les émotions, revenir à l'enfance perdue, décrire leur condition, la survivance de la haine, la médiocrité des consciences, ... Le chœur de ces quatre femmes retrace l'envers de l'histoire du Portugal et Antonio Lobo Antunes nous livre ainsi un époustouflant requiem.
Pour aborder et apprécier ce requiem, il faut se laisser aller. Imaginer un océan, se mettre en étoile de mer sur cet océan en se laissant bercer par les vagues, le ressac, les remous. Accepter de se perdre, de ne pas lutter contre, de dériver, de ne plus avoir de repères, le passé et le présent, s'entremêlant parfois dans un même paragraphe, les voix s'interpénétrant par moment, juste accueillir la poésie époustouflante qui donne toute la fraicheur à ce texte et petit à petit le fil apparait, la sensibilité des personnages émerge. C'est une belle expérience de littérature.
Il faut véritablement plonger dans ce style et cet univers et lire le livre en quasi apnée. Ne pas le laisser pour le reprendre plus tard. Non. Plonger, se laisser aller et accueillir. Accueillir l'intensité poétique.
Oui l'écriture de cet auteur , vous l'aurez compris, est très particulière, originale, exigeante : de longs passages courant sur plusieurs pages, empreints d'une poésie à couper le souffle, entrecoupés par les obsessions des personnages qui reviennent comme des leitmotivs rythmer le roman de leurs questions, de leurs angoisses, de leurs peurs. Une ritournelle. Comme celle laissée, cadeau bien particulier, par ma grand-mère.
« Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau »…En voilà un étrange titre, en ellipse, en voilà un désir surprenant qui ne dit d'ailleurs pas ce que nous devons faire pour parvenir à cet état impossible. Faut-il les caresser ces pierres, les broyer le plus finement possible, les dissoudre jusqu'à les faire disparaitre, les plonger dans l'acide, les croire aussi douce que l'eau par la simple force du mental, par la mise à distance… ? Et les pierres dans ce livre sont à la fois très concrètes, calculs rénaux faisant souffrir atrocement l'épouse d'un des protagonistes du livre, et métaphoriques : ce sont les pierres de la culpabilité, ce sont les pierres des traumatismes commis ou subis, ce sont les pierres d'un passé d'une violence inouïe, des pierres qui font couler, sombrer même lorsqu'elles sont vieilles. Des pierres tranchantes qui vous fracassent le crâne, percutent toutes vos pensées, vous étouffent de par leur roulement incessant…Deux réponses semblent pourtant se profiler pour réussir à rendre ces pierres aussi douces que l'eau : la vengeance ou l'amour, réactions opposées pour contrer la mémoire, courant qui emporte et détruit tout…peut-être justement jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau…
Le thème de ce livre est la guerre en Angola. Cette guerre et ses séquelles sur ceux qui l'ont vécue est une thématique habituelle d'Antonio Lobo Antunes, lui-même ayant été médecin de guerre dans cette ancienne colonie portugaise, expérience qui l'a marqué du fait de sa grande violence. L'originalité réside sans doute ici dans le fait de découvrir ces séquelles aussi bien du côté des portugais que du côté des angolais.
Thématique habituelle, mais aussi et surtout style habituel. Nous retrouvons dans ce livre paru en 2019 aux éditions Christian Bourgois, la façon d'écrire unique de l'auteur portugais, ce style exigeant, reconnaissable immédiatement, qui entremêle pensées, obsessions, paroles ; qui regroupe en un flot de pensée ininterrompu des images disparates comme elles apparaissent en une fraction de seconde dans nos têtes ; qui conjugue étonnamment un passé incurable à un présent instable, timide et précaire. Un chapitre, une seule et unique phrase, un personnage, un soliloque. Une syntaxe permettant de rentrer dans l'intimité des personnages tout en nous dévoilant l'Histoire de façon objective. Une manière percutante d'exprimer les atrocités au détour d'une page, alors que le lecteur ne s'y attend pas. Un livre dur qui ne cherche nullement à plaire, à édulcorer mais à nous plonger la tête dans le pire de l'homme. de façon presque hypnotique, en nous répétant, tels des mantras, certaines phrases clés mettant en valeur l'obsession qui confine à la folie.
Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola pendant vingt-sept mois, rentre au pays où il ramène un jeune orphelin. C'est lui qui a tué ses parents. Il va élever cet enfant noir, qui a survécu à la destruction de son village et au massacre des siens par l'armée portugaise, comme son propre fils.
Plus de quarante ans plus tard, le vétéran et sa femme font le trajet depuis Lisbonne pour rejoindre la vieille maison de famille, dans un village reculé, quasi abandonné, quelque part au pied des montagnes. Dans trois jours, conformément à la tradition annuelle, on tuera le cochon. Comme chaque année, leur fille, leur fils adoptif, son épouse les rejoignent pour l'occasion. Or ce jour-là, l'animal ne sera pas le seul à se vider de son sang.
Force est de se demander pourquoi il a ramené cet enfant, lui qui a été témoin des atrocités commises sur ses parents. Sans doute le besoin de racheter les meurtres commis, ou de se sentir moins seul, plus que celui de ramener un trophée. Pourtant les soldats présents avaient prévenu leur sous-lieutenant :
« - Ne le ramenez pas avec vous au Portugal mon sous-lieutenant il a assisté à ce que vous avez fait à ses parents et tôt ou tard il se vengera ce n'est qu'une question de temps car les nègres sont comme les chiens, ils n'oublient pas, s'ils étaient comme nous ils seraient blancs, même à coups de cravache pas moyen de les redresser, creusez une fosse, mettez le dedans, refermez-là et vous verrez que malgré tout il s'agitera là-dessous en vous détestant, s'il parvient à revenir à la surface avec une machette ce sera votre fête… ».
Tout le livre est centré sur alternativement la culpabilité du père, resté à tout jamais en Afrique dans sa tête, et les traumatismes du fils adoptif, ainsi que les humiliations subies au Portugal du fait de sa couleur de peau, même par sa propre femme qui le méprise. Structure polyphonique jusqu'au drame où les sangs vont se mêler, même sang rouge de la peau blanche, de la peau noire, de la peau rose.
Tout au long de ma lecture, je n'ai pu m'empêcher de penser au travail de traduction sous-jacent… et pour cause, le travail remarquable du traducteur, Dominique Nedellec, a reçu pour cette traduction difficile, tout en nuances et en complexités, le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles 2019. Pouvoir traduire de la sorte des livres qui constituent de véritables expériences de littérature est admirable et permet de découvrir de grands et rares auteurs.
Le manuel des inquisiteurs reste à ce jour mon livre préféré de Lobo Antunes. Celui-ci est sans doute plus violent et percutant, plus dérangeant. de façon générale, les livres de cet auteur portugais sont des lectures qu'il est délicat de conseiller, elles sont grandioses mais tellement singulières, étonnantes mais tellement dérangeantes, innovantes mais tellement difficiles…Elles ouvrent une porte comme seules les expériences de littérature savent le faire pour marquer à jamais leur lecteurs.
Le thème de ce livre est la guerre en Angola. Cette guerre et ses séquelles sur ceux qui l'ont vécue est une thématique habituelle d'Antonio Lobo Antunes, lui-même ayant été médecin de guerre dans cette ancienne colonie portugaise, expérience qui l'a marqué du fait de sa grande violence. L'originalité réside sans doute ici dans le fait de découvrir ces séquelles aussi bien du côté des portugais que du côté des angolais.
Thématique habituelle, mais aussi et surtout style habituel. Nous retrouvons dans ce livre paru en 2019 aux éditions Christian Bourgois, la façon d'écrire unique de l'auteur portugais, ce style exigeant, reconnaissable immédiatement, qui entremêle pensées, obsessions, paroles ; qui regroupe en un flot de pensée ininterrompu des images disparates comme elles apparaissent en une fraction de seconde dans nos têtes ; qui conjugue étonnamment un passé incurable à un présent instable, timide et précaire. Un chapitre, une seule et unique phrase, un personnage, un soliloque. Une syntaxe permettant de rentrer dans l'intimité des personnages tout en nous dévoilant l'Histoire de façon objective. Une manière percutante d'exprimer les atrocités au détour d'une page, alors que le lecteur ne s'y attend pas. Un livre dur qui ne cherche nullement à plaire, à édulcorer mais à nous plonger la tête dans le pire de l'homme. de façon presque hypnotique, en nous répétant, tels des mantras, certaines phrases clés mettant en valeur l'obsession qui confine à la folie.
Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola pendant vingt-sept mois, rentre au pays où il ramène un jeune orphelin. C'est lui qui a tué ses parents. Il va élever cet enfant noir, qui a survécu à la destruction de son village et au massacre des siens par l'armée portugaise, comme son propre fils.
Plus de quarante ans plus tard, le vétéran et sa femme font le trajet depuis Lisbonne pour rejoindre la vieille maison de famille, dans un village reculé, quasi abandonné, quelque part au pied des montagnes. Dans trois jours, conformément à la tradition annuelle, on tuera le cochon. Comme chaque année, leur fille, leur fils adoptif, son épouse les rejoignent pour l'occasion. Or ce jour-là, l'animal ne sera pas le seul à se vider de son sang.
Force est de se demander pourquoi il a ramené cet enfant, lui qui a été témoin des atrocités commises sur ses parents. Sans doute le besoin de racheter les meurtres commis, ou de se sentir moins seul, plus que celui de ramener un trophée. Pourtant les soldats présents avaient prévenu leur sous-lieutenant :
« - Ne le ramenez pas avec vous au Portugal mon sous-lieutenant il a assisté à ce que vous avez fait à ses parents et tôt ou tard il se vengera ce n'est qu'une question de temps car les nègres sont comme les chiens, ils n'oublient pas, s'ils étaient comme nous ils seraient blancs, même à coups de cravache pas moyen de les redresser, creusez une fosse, mettez le dedans, refermez-là et vous verrez que malgré tout il s'agitera là-dessous en vous détestant, s'il parvient à revenir à la surface avec une machette ce sera votre fête… ».
Tout le livre est centré sur alternativement la culpabilité du père, resté à tout jamais en Afrique dans sa tête, et les traumatismes du fils adoptif, ainsi que les humiliations subies au Portugal du fait de sa couleur de peau, même par sa propre femme qui le méprise. Structure polyphonique jusqu'au drame où les sangs vont se mêler, même sang rouge de la peau blanche, de la peau noire, de la peau rose.
Tout au long de ma lecture, je n'ai pu m'empêcher de penser au travail de traduction sous-jacent… et pour cause, le travail remarquable du traducteur, Dominique Nedellec, a reçu pour cette traduction difficile, tout en nuances et en complexités, le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles 2019. Pouvoir traduire de la sorte des livres qui constituent de véritables expériences de littérature est admirable et permet de découvrir de grands et rares auteurs.
Le manuel des inquisiteurs reste à ce jour mon livre préféré de Lobo Antunes. Celui-ci est sans doute plus violent et percutant, plus dérangeant. de façon générale, les livres de cet auteur portugais sont des lectures qu'il est délicat de conseiller, elles sont grandioses mais tellement singulières, étonnantes mais tellement dérangeantes, innovantes mais tellement difficiles…Elles ouvrent une porte comme seules les expériences de littérature savent le faire pour marquer à jamais leur lecteurs.
Les récits de Lobo Antunes sont immenses et d'une densité étrange, proche de l'étonnement et du rêve…
Connaissez-vous ce sentiment diffus, celui ressenti à chaque livre ouvert d'un même auteur, de se sentir comme chez soi ? C'est ce sentiment rassurant que j'éprouve avec force à la lecture de chaque livre de Lobo Antunes. Cet auteur me permet de retrouver une ambiance, un décor, un paysage, une vie que mes ancêtres ont vécu, que personnellement je n'ai jamais connu, mais dont les multiples et étranges réminiscences à la lecture de ses livres prouvent la présence dans mes gènes. Comment expliquer sinon cette germination que je sens frétiller au plus profond de moi à chacun des romans avec cette sensation confuse de déjà-vu, de familier, et même d'intime ? Ses livres sont pour moi un ordre naturel des choses, sans doute ainsi ne suis-je pas très objective le concernant…
La marque de fabrique de cet auteur portugais est reconnaissable entre toute : des flux de conscience se faisant flots, puis torrents, entrelaçant pensées brutes sans filtre, souvenirs, rêves, faits et gestes du moment dans un mouvement de vient et va incessant entre passé et présent. Souvent un chapitre est constitué d'une seule phrase lue en apnée, envoutante et exigeante. Unique.
Pourtant, dans « L'ordre naturel des choses », paru en 2000, sans doute moins connu que quelques précédents livres comme le cul de Judas, le manuel des inquisiteurs ou encore L'exhortation aux crocodiles par exemple, cette singularité est moins présente, elle n'a pas atteint sa maturité de laquelle il ne déviera plus comme le montrent les livres parus ensuite, que ce soit La dernière porte avant la nuit, ou Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus légères que l'eau. Ici le flux de conscience apparait juste à certains moments, dans certains chapitres précis, lors d'émotions vives…comme certaines scènes de tortures. Sinon, il y a bien des phrases, séparées par des points et peut-être un peu moins d'obsessions, moins de soliloques. Bref, un texte plus structuré, plus classique donc un peu moins fascinant à mes yeux.
Cependant nous retrouvons le même souci de faire cohabiter le passé et le présent, l'avant et l'après, la faille entre les deux rivages étant constituée par la Révolution des oeillets de 1974. le passage de la dictature à la démocratie, fracture troublante pour ceux qui ont vécu les deux périodes, entrelacement perpétuel du fait des conséquences traumatiques de la guerre sanglante en Angola. Antonio Lobo Antunes a été présent dans cette colonie portugaise en tant que médecin et il a vu et vécu de telles horreurs que ses livres sont tous marqués par le sceau de cette histoire coloniale lusitanienne avec son lot de remords, de culpabilité et de rédemption.
Et nous retrouvons cette plume, magnifique, sombre, qui suinte la mélancolie, la décrépitude, comme l'atteste la présence régulière de ruines envahies de plantes grimpantes et de tourterelles donnant lieu à un surgissement par moment d'images gothiques surprenantes et inquiétantes.
« ...les clochettes des cabris tintinnabulaient dans la chapelle sans images, réduite à trois murs calcinés et à un bout d'autel, avec une nappe, submergé par les plantes grimpantes ; je regardais la nuit avancer de dalle funéraire en dalle funéraire, coagulant les bénédictions des saints en taches de ténèbres ».
Ce livre est une ronde. Une ronde lisboète autour de Iolanda, une jeune diabétique. Pas une ronde dansante entrainante, solaire, ayant la gaieté de l'enfance, l'innocence de la jeunesse, mais une ronde au son d'un fado lancinant, sombre et poétique. Pathétique aussi. Aux pas lents de l'angoisse de la vieillesse. Autour d'elle gravite en effet tout un monde d'êtres misérables ou délirants, son amant de trente ans son aîné, son père un mineur à moitié fou, sa tante qui se meurt doucement de calculs rénaux monstrueux et quelques autres laissés pour compte comme cette prostitué angolaise.
Chacun joue sa partie, fait entendre sa voix, affirme sa vérité, raconte ses peurs et ses faiblesses ; le résultat est une étrange polyphonie où entre satire et onirisme passent tous les rêves de grandeur du Portugal et ses errements dans des guerres coloniales et des luttes fratricides, toutes les dénonciations de Lobo Antunes pour les masques sociaux, celui de la religion, du couple, de la famille, de l'armée et du pouvoir.
Une polyphonie qui n'est jamais cacophonie, chaque chapitre étant dédié à un personnage apportant un éclairage nouveau au monde qui entoure Iolanda.
Part belle est faite à cet amant et ses origines familiales. Même si c'est courant, ce n'est pas l'ordre naturel des choses d'être avec une femme qui ne vous aime pas, qui a trente ans de moins que vous, qui vous méprise et joue avec vos sentiments. Surtout lorsque vous êtes fou amoureux, vous raccrochant en vérité à ce sentiment pour échapper à votre propre vieillesse. Tel est le calvaire que vit l'amant de Iolanda, source de revenus pour toute la famille, méprisé par tous pourtant, lui et son sourire niais. Il ne trouve la paix que la nuit, lors de ses insomnies à regarder Iolanda dormir, à écouter et sentir son souffle odorant de diabétique, une odeur de fleur fanée, de pétales de chrysanthème écrasés, comme si sous la peau parfaite de la jeunesse, se cachait subrepticement un monde souterrain malade et proche de la mort, « tes organes, coeur, estomac, foie, très anciens et pourris comme ceux des héros dans les cryptes, se décomposaient sous la victorieuse jeunesse de la peau ». Là, la nuit, il dit tout son amour qui parfois frise la haine dès que l'aube peu à peu projette ses lumières mauve. C'est d'une beauté renversante, troublante aussi, tant l'obsession de cette jeunesse qui frôle la mort n'est elle-même pas dans l'ordre naturel des choses…
« Parfois, quand je prends conscience du matin dans le premier ambre des miroirs vides, labourés par les larmes de la nuit, quand ton corps surgit de l'obscurité sous le drap comme les fauteuils d'août dans une maison déserte et que tes épaules et ton nez émergent de l'ombre, telles des corolles mortes sur l'oreiller,
parfois mon amour, quand il fait définitivement jour, quand le réveil est sur le point de sonner, quand les savates de ton père traversent le parquet, faisant trembler les armoires, pour aller boire un verre d'eau à l'évier de la cuisine, et que ta tante se déplace dans sa chambre pour s'habiller avec des mouvements de chrysalide,
parfois quand je me tais sur le matelas, maudissant l'histoire que je raconte, quelques secondes avant que la sonnerie de la pendulette ne m'appelle à grands cris pour mon travail de fonctionnaire,
il m'arrive de te haïr,
pardonne moi, »
La nuit, il ne ment pas, mais prend des trains à travers la plaine, à raconter à Iolanda profondément endormie son enfance dans une sorte de pension au bord de mer, abandonné honteusement par sa famille, sa mère ayant fauté avec un autre homme que son mari. le père « ne voulait pas qu'on sache que la mère de ses quatre rejetons avait enfanté d'un autre mâle ». C'est une pension envahie par des généraux de la Pide, la police salazarienne. Et ces voix du passé de murmurer, de l'entourer de leur crépitation attendrie, de leur vapeur de paroles imaginaires, l'oppressant du poids de l'enfance…
Il y a une nostalgie ironique, très présente, éprouvée par ceux qui ont tout perdu avec la Révolution, les anciens généraux, les anciens fascistes. Ces personnes sont tombés de leur piédestal et ont du se faire tout petit ensuite. Comme cet homme, mandaté par l'auteur lui-même, pour aller enquêter sur l'amant de Iolanda afin d'écrire son livre (l'auteur se met ainsi en scène dans le livre cherchant le matériau de son livre). Cet homme menait des interrogatoires, via des méthodes que nous pressentons musclées, et aujourd'hui il s'est converti…en enseignant d'hypnose par correspondance, métier pathétique traité avec beaucoup d'humour. Il passe du temps avec une prostituée angolaise régulièrement frappée par son maquereau.
Avant la révolution, c'est également une société patriarcale que l'auteur dépeint avec beaucoup d'humanité à travers les voix de l'amant et des parents de Iolanda, images troublantes pour moi de ce Portugal d'antan qui semble inscrit profondément en chacune de mes cellules…
« Après le dîner mon oncle m'emmenait à la pâtisserie en face de l'église et, un verre de limonade à la main, j'assistais à sa conversation avec ses amis bronchitiques qui crachaient leurs poumons dans leur mouchoir entre deux gorgées de café. Les tonneaux de bière poussaient des soupirs entremêlés de bulles de gaz. Un groupe de dames fardées, avec des boucles d'oreilles en fausses perles, tapotaient leurs mèches autour d'une théière, et mon oncle, cigarette au bec, leur lançait des oeillades en enflant comme un pigeon dans son vaste gilet ».
En plus de la maladie, symbolisée par le diabète de Iolanda, les calculs rénaux de sa tante, la sciatique de la femme de ménage – la femme souffre beaucoup dans les romans d'Antunes - la folie est approchée par la plume implacable d'Antunes via le père de Iolanda, ancien mineur devenu vieux et fou, se prenant pour un oiseau et se souvenant de sa femme, devenue folle elle aussi il y a si longtemps, qu'il a du laisser en Afrique. Lui aussi parle à Iolanda…
« Maintenant que je suis vieux et que la mort dentèle ma colonne vertébrale et durcit mes artères, je me dis, quand il m'arrive de penser à elle, que chacun vole comme il peut, ma grande, chacun vole réellement comme il peut, moi sous la terre, à Johannesburg, poussant des wagonnets de minerai dans les galeries et ta mère à l'asile de fous, vrillant les murs de ses yeux pour apercevoir les chalutiers, toi sur le nuage de giroflée de ta maladie, et l'imbécile qui habite avec nous à l'arrière du jardin décoiffant les choux du bout de sa chaussure et humant la nuit avec son sempiternel sourire niais ».
Livre sur la mémoire et le deuil impossible d'une époque, livre sur les affres de la vieillesse et son lot de maux, sur l'angoisse de la mort qui est pourtant dans l'ordre naturel des choses, Antunes, au moyen de sa plume à nulle autre pareil, nous déstabilise par ses pensées inavouables sur la vieillesse qu'il ose nous livrer, disant tout haut des choses parfois honteusement enfouies en nous, et aussi par ses pensées sur la mort, brutales et inattendues…
« Vous n'avez jamais pensé à cela ? Vous ne vous êtes jamais imaginé nu, puant le formol, flottant ventre en l'air dans une cuve de marbre en attendant qu'on vous charcute les côtes avec une cisaille énorme ? ».
Et pourtant, malgré ces pensées glaçantes, malgré cette saudade sombre, malgré ces horreurs telles que la maladie ou la démence, qui sont dans l'ordre naturel des choses, nous amenant peu à peu vers la mort, moi j'aime poser ma tête sur l'épaule d'Antonio Lobo Antunes, j'aime l'ambiance surannée qui se dégage de ses livres, je trouve sa plume d'une beauté stupéfiante et surtout, ses réflexions sur la fin - fin d'un régime, fin d'un empire, fin de l'enfance -, ses pensées, voire ses obsessions, sur la mort notamment, réveillent instantanément en moi mes racines de vie, les racines premières, telles une réaction atavique…
Et vous, quel auteur vous procure ce sentiment incroyable d'être enfin chez vous ?
Connaissez-vous ce sentiment diffus, celui ressenti à chaque livre ouvert d'un même auteur, de se sentir comme chez soi ? C'est ce sentiment rassurant que j'éprouve avec force à la lecture de chaque livre de Lobo Antunes. Cet auteur me permet de retrouver une ambiance, un décor, un paysage, une vie que mes ancêtres ont vécu, que personnellement je n'ai jamais connu, mais dont les multiples et étranges réminiscences à la lecture de ses livres prouvent la présence dans mes gènes. Comment expliquer sinon cette germination que je sens frétiller au plus profond de moi à chacun des romans avec cette sensation confuse de déjà-vu, de familier, et même d'intime ? Ses livres sont pour moi un ordre naturel des choses, sans doute ainsi ne suis-je pas très objective le concernant…
La marque de fabrique de cet auteur portugais est reconnaissable entre toute : des flux de conscience se faisant flots, puis torrents, entrelaçant pensées brutes sans filtre, souvenirs, rêves, faits et gestes du moment dans un mouvement de vient et va incessant entre passé et présent. Souvent un chapitre est constitué d'une seule phrase lue en apnée, envoutante et exigeante. Unique.
Pourtant, dans « L'ordre naturel des choses », paru en 2000, sans doute moins connu que quelques précédents livres comme le cul de Judas, le manuel des inquisiteurs ou encore L'exhortation aux crocodiles par exemple, cette singularité est moins présente, elle n'a pas atteint sa maturité de laquelle il ne déviera plus comme le montrent les livres parus ensuite, que ce soit La dernière porte avant la nuit, ou Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus légères que l'eau. Ici le flux de conscience apparait juste à certains moments, dans certains chapitres précis, lors d'émotions vives…comme certaines scènes de tortures. Sinon, il y a bien des phrases, séparées par des points et peut-être un peu moins d'obsessions, moins de soliloques. Bref, un texte plus structuré, plus classique donc un peu moins fascinant à mes yeux.
Cependant nous retrouvons le même souci de faire cohabiter le passé et le présent, l'avant et l'après, la faille entre les deux rivages étant constituée par la Révolution des oeillets de 1974. le passage de la dictature à la démocratie, fracture troublante pour ceux qui ont vécu les deux périodes, entrelacement perpétuel du fait des conséquences traumatiques de la guerre sanglante en Angola. Antonio Lobo Antunes a été présent dans cette colonie portugaise en tant que médecin et il a vu et vécu de telles horreurs que ses livres sont tous marqués par le sceau de cette histoire coloniale lusitanienne avec son lot de remords, de culpabilité et de rédemption.
Et nous retrouvons cette plume, magnifique, sombre, qui suinte la mélancolie, la décrépitude, comme l'atteste la présence régulière de ruines envahies de plantes grimpantes et de tourterelles donnant lieu à un surgissement par moment d'images gothiques surprenantes et inquiétantes.
« ...les clochettes des cabris tintinnabulaient dans la chapelle sans images, réduite à trois murs calcinés et à un bout d'autel, avec une nappe, submergé par les plantes grimpantes ; je regardais la nuit avancer de dalle funéraire en dalle funéraire, coagulant les bénédictions des saints en taches de ténèbres ».
Ce livre est une ronde. Une ronde lisboète autour de Iolanda, une jeune diabétique. Pas une ronde dansante entrainante, solaire, ayant la gaieté de l'enfance, l'innocence de la jeunesse, mais une ronde au son d'un fado lancinant, sombre et poétique. Pathétique aussi. Aux pas lents de l'angoisse de la vieillesse. Autour d'elle gravite en effet tout un monde d'êtres misérables ou délirants, son amant de trente ans son aîné, son père un mineur à moitié fou, sa tante qui se meurt doucement de calculs rénaux monstrueux et quelques autres laissés pour compte comme cette prostitué angolaise.
Chacun joue sa partie, fait entendre sa voix, affirme sa vérité, raconte ses peurs et ses faiblesses ; le résultat est une étrange polyphonie où entre satire et onirisme passent tous les rêves de grandeur du Portugal et ses errements dans des guerres coloniales et des luttes fratricides, toutes les dénonciations de Lobo Antunes pour les masques sociaux, celui de la religion, du couple, de la famille, de l'armée et du pouvoir.
Une polyphonie qui n'est jamais cacophonie, chaque chapitre étant dédié à un personnage apportant un éclairage nouveau au monde qui entoure Iolanda.
Part belle est faite à cet amant et ses origines familiales. Même si c'est courant, ce n'est pas l'ordre naturel des choses d'être avec une femme qui ne vous aime pas, qui a trente ans de moins que vous, qui vous méprise et joue avec vos sentiments. Surtout lorsque vous êtes fou amoureux, vous raccrochant en vérité à ce sentiment pour échapper à votre propre vieillesse. Tel est le calvaire que vit l'amant de Iolanda, source de revenus pour toute la famille, méprisé par tous pourtant, lui et son sourire niais. Il ne trouve la paix que la nuit, lors de ses insomnies à regarder Iolanda dormir, à écouter et sentir son souffle odorant de diabétique, une odeur de fleur fanée, de pétales de chrysanthème écrasés, comme si sous la peau parfaite de la jeunesse, se cachait subrepticement un monde souterrain malade et proche de la mort, « tes organes, coeur, estomac, foie, très anciens et pourris comme ceux des héros dans les cryptes, se décomposaient sous la victorieuse jeunesse de la peau ». Là, la nuit, il dit tout son amour qui parfois frise la haine dès que l'aube peu à peu projette ses lumières mauve. C'est d'une beauté renversante, troublante aussi, tant l'obsession de cette jeunesse qui frôle la mort n'est elle-même pas dans l'ordre naturel des choses…
« Parfois, quand je prends conscience du matin dans le premier ambre des miroirs vides, labourés par les larmes de la nuit, quand ton corps surgit de l'obscurité sous le drap comme les fauteuils d'août dans une maison déserte et que tes épaules et ton nez émergent de l'ombre, telles des corolles mortes sur l'oreiller,
parfois mon amour, quand il fait définitivement jour, quand le réveil est sur le point de sonner, quand les savates de ton père traversent le parquet, faisant trembler les armoires, pour aller boire un verre d'eau à l'évier de la cuisine, et que ta tante se déplace dans sa chambre pour s'habiller avec des mouvements de chrysalide,
parfois quand je me tais sur le matelas, maudissant l'histoire que je raconte, quelques secondes avant que la sonnerie de la pendulette ne m'appelle à grands cris pour mon travail de fonctionnaire,
il m'arrive de te haïr,
pardonne moi, »
La nuit, il ne ment pas, mais prend des trains à travers la plaine, à raconter à Iolanda profondément endormie son enfance dans une sorte de pension au bord de mer, abandonné honteusement par sa famille, sa mère ayant fauté avec un autre homme que son mari. le père « ne voulait pas qu'on sache que la mère de ses quatre rejetons avait enfanté d'un autre mâle ». C'est une pension envahie par des généraux de la Pide, la police salazarienne. Et ces voix du passé de murmurer, de l'entourer de leur crépitation attendrie, de leur vapeur de paroles imaginaires, l'oppressant du poids de l'enfance…
Il y a une nostalgie ironique, très présente, éprouvée par ceux qui ont tout perdu avec la Révolution, les anciens généraux, les anciens fascistes. Ces personnes sont tombés de leur piédestal et ont du se faire tout petit ensuite. Comme cet homme, mandaté par l'auteur lui-même, pour aller enquêter sur l'amant de Iolanda afin d'écrire son livre (l'auteur se met ainsi en scène dans le livre cherchant le matériau de son livre). Cet homme menait des interrogatoires, via des méthodes que nous pressentons musclées, et aujourd'hui il s'est converti…en enseignant d'hypnose par correspondance, métier pathétique traité avec beaucoup d'humour. Il passe du temps avec une prostituée angolaise régulièrement frappée par son maquereau.
Avant la révolution, c'est également une société patriarcale que l'auteur dépeint avec beaucoup d'humanité à travers les voix de l'amant et des parents de Iolanda, images troublantes pour moi de ce Portugal d'antan qui semble inscrit profondément en chacune de mes cellules…
« Après le dîner mon oncle m'emmenait à la pâtisserie en face de l'église et, un verre de limonade à la main, j'assistais à sa conversation avec ses amis bronchitiques qui crachaient leurs poumons dans leur mouchoir entre deux gorgées de café. Les tonneaux de bière poussaient des soupirs entremêlés de bulles de gaz. Un groupe de dames fardées, avec des boucles d'oreilles en fausses perles, tapotaient leurs mèches autour d'une théière, et mon oncle, cigarette au bec, leur lançait des oeillades en enflant comme un pigeon dans son vaste gilet ».
En plus de la maladie, symbolisée par le diabète de Iolanda, les calculs rénaux de sa tante, la sciatique de la femme de ménage – la femme souffre beaucoup dans les romans d'Antunes - la folie est approchée par la plume implacable d'Antunes via le père de Iolanda, ancien mineur devenu vieux et fou, se prenant pour un oiseau et se souvenant de sa femme, devenue folle elle aussi il y a si longtemps, qu'il a du laisser en Afrique. Lui aussi parle à Iolanda…
« Maintenant que je suis vieux et que la mort dentèle ma colonne vertébrale et durcit mes artères, je me dis, quand il m'arrive de penser à elle, que chacun vole comme il peut, ma grande, chacun vole réellement comme il peut, moi sous la terre, à Johannesburg, poussant des wagonnets de minerai dans les galeries et ta mère à l'asile de fous, vrillant les murs de ses yeux pour apercevoir les chalutiers, toi sur le nuage de giroflée de ta maladie, et l'imbécile qui habite avec nous à l'arrière du jardin décoiffant les choux du bout de sa chaussure et humant la nuit avec son sempiternel sourire niais ».
Livre sur la mémoire et le deuil impossible d'une époque, livre sur les affres de la vieillesse et son lot de maux, sur l'angoisse de la mort qui est pourtant dans l'ordre naturel des choses, Antunes, au moyen de sa plume à nulle autre pareil, nous déstabilise par ses pensées inavouables sur la vieillesse qu'il ose nous livrer, disant tout haut des choses parfois honteusement enfouies en nous, et aussi par ses pensées sur la mort, brutales et inattendues…
« Vous n'avez jamais pensé à cela ? Vous ne vous êtes jamais imaginé nu, puant le formol, flottant ventre en l'air dans une cuve de marbre en attendant qu'on vous charcute les côtes avec une cisaille énorme ? ».
Et pourtant, malgré ces pensées glaçantes, malgré cette saudade sombre, malgré ces horreurs telles que la maladie ou la démence, qui sont dans l'ordre naturel des choses, nous amenant peu à peu vers la mort, moi j'aime poser ma tête sur l'épaule d'Antonio Lobo Antunes, j'aime l'ambiance surannée qui se dégage de ses livres, je trouve sa plume d'une beauté stupéfiante et surtout, ses réflexions sur la fin - fin d'un régime, fin d'un empire, fin de l'enfance -, ses pensées, voire ses obsessions, sur la mort notamment, réveillent instantanément en moi mes racines de vie, les racines premières, telles une réaction atavique…
Et vous, quel auteur vous procure ce sentiment incroyable d'être enfin chez vous ?
« On entre chez António Lobo Antunes comme on rentre en religion ».
Cette lecture commune fut une belle découverte et je remercie ici notre petite communauté de Babelpotes sans laquelle l'auteur serait resté pour moi un illustre inconnu. « le cul de Judas » reste une lecture difficile dans son approche, dans ses mots, dans son histoire. Ce roman dénonce l'enrôlement de l'auteur comme jeune appelé médecin durant le conflit colonial qui opposa jusqu'en 1975 le Portugal du dictateur Salazar aux velléités d'indépendance de l'Angola.
Le style d'Antonio Lobo Antunes est noir et brut de décoffrage. Il nous jette en pleine figure ses deux années de service militaire dans un pays africain aux moeurs et à la culture bien opposés au jeune bourgeois portugais qu'il est, habitué aux douceurs de vie de sa capitale Lisbonne où il vit encore chez ses parents. C'est lors d'une rencontre d'un soir, lors d'une de ses beuveries habituelles, qu'il va s'épancher sur ses souvenirs de guerre. Il le fera en compagnie d'une femme rencontrée dans un bar, de la nuit à l'aube. Ce dialogue deviendra rapidement un monologue de 200 pages débordant de souvenirs sanguinolents, d'une violence exceptionnelle, avec des relents fétides de mort et de corps déchiquetés. Un monologue où il sera à la fois narrateur mais aussi héros malgré lui du drame angolais.
Les images d'horreur se mêlant aux odeurs nauséabondes et répugnantes des combats, le flot des mots nous emporte dans un tourbillon d'épouvante et de cruauté. L'ambiance du récit est lourde de vérité, on entend le cri des blessés, l'explosion des combats, les hurlements des femmes violées. On se trouve plongé au fond de l'enfer. António Lobo Antunes avec sa plume devient comme Jérôme Bosch dans son jugement dernier ou Picasso dans son Guernica avec leurs pinceaux, un artiste engagé dans cette quête qui dénonce la brutalité de la guerre dans toutes ses formes qu'elle soit divine ou humaine. L'auteur fait souvent référence à ces peintres de l'impossible à qui l'on peut ajouter les Chagall, Dali et autres Magritte.
Le Cul de Judas est aussi le parcours initiatique d'un jeune homme qui doit au cours de ses deux années de service militaire en Angola devenir un homme comme le pense l'ensemble de sa famille. du zoo de son enfance symbole de son innocence à son retour à Lisbonne comme vétéran traumatisé d'une guerre qu'il n'a pas voulu et surtout qu'il n'a pas eu le courage de dénoncer, on assiste à une métamorphose ratée. le cri du soldat « Putain, putain et putain » repris ensuite par le narrateur tout au long du roman, montre son impuissance à atteindre cette soi-disant forme de maturité humaine. Ce cinglant échec, on le retrouvera dans toutes les guerres qui ont utilisé des jeunes hommes comme chair à canon et qu'on appellera pudiquement pour les militaires revenants d'une confrontation brutale avec la mort : syndrome de stress post-traumatique.
On ne peut pas terminer avec António Lobo Antunes sans parler de cette musicalité qu'il met dans sa prose. Ce léger bruissement donne du rythme à ses mots et nous permet de supporter le chaos des images causé par son éprouvant témoignage. Cette étrange mélodie pourrait presque nous aider à transformer cette laideur en une certaine beauté mais sans tomber dans une fausse ingénuité. Cette musique n'est là que pour nous aider à supporter ce monologue nocturne sorti du cul de judas.
« le Vietnam est une guerre où l'Homme Blanc envoie l'Homme Noir tuer l'Homme Jaune pour garder la terre qu'il a volé à l'Homme Rouge ! »
Citation de Forrest dans Forrest Gump le film (1994)
Cette lecture commune fut une belle découverte et je remercie ici notre petite communauté de Babelpotes sans laquelle l'auteur serait resté pour moi un illustre inconnu. « le cul de Judas » reste une lecture difficile dans son approche, dans ses mots, dans son histoire. Ce roman dénonce l'enrôlement de l'auteur comme jeune appelé médecin durant le conflit colonial qui opposa jusqu'en 1975 le Portugal du dictateur Salazar aux velléités d'indépendance de l'Angola.
Le style d'Antonio Lobo Antunes est noir et brut de décoffrage. Il nous jette en pleine figure ses deux années de service militaire dans un pays africain aux moeurs et à la culture bien opposés au jeune bourgeois portugais qu'il est, habitué aux douceurs de vie de sa capitale Lisbonne où il vit encore chez ses parents. C'est lors d'une rencontre d'un soir, lors d'une de ses beuveries habituelles, qu'il va s'épancher sur ses souvenirs de guerre. Il le fera en compagnie d'une femme rencontrée dans un bar, de la nuit à l'aube. Ce dialogue deviendra rapidement un monologue de 200 pages débordant de souvenirs sanguinolents, d'une violence exceptionnelle, avec des relents fétides de mort et de corps déchiquetés. Un monologue où il sera à la fois narrateur mais aussi héros malgré lui du drame angolais.
Les images d'horreur se mêlant aux odeurs nauséabondes et répugnantes des combats, le flot des mots nous emporte dans un tourbillon d'épouvante et de cruauté. L'ambiance du récit est lourde de vérité, on entend le cri des blessés, l'explosion des combats, les hurlements des femmes violées. On se trouve plongé au fond de l'enfer. António Lobo Antunes avec sa plume devient comme Jérôme Bosch dans son jugement dernier ou Picasso dans son Guernica avec leurs pinceaux, un artiste engagé dans cette quête qui dénonce la brutalité de la guerre dans toutes ses formes qu'elle soit divine ou humaine. L'auteur fait souvent référence à ces peintres de l'impossible à qui l'on peut ajouter les Chagall, Dali et autres Magritte.
Le Cul de Judas est aussi le parcours initiatique d'un jeune homme qui doit au cours de ses deux années de service militaire en Angola devenir un homme comme le pense l'ensemble de sa famille. du zoo de son enfance symbole de son innocence à son retour à Lisbonne comme vétéran traumatisé d'une guerre qu'il n'a pas voulu et surtout qu'il n'a pas eu le courage de dénoncer, on assiste à une métamorphose ratée. le cri du soldat « Putain, putain et putain » repris ensuite par le narrateur tout au long du roman, montre son impuissance à atteindre cette soi-disant forme de maturité humaine. Ce cinglant échec, on le retrouvera dans toutes les guerres qui ont utilisé des jeunes hommes comme chair à canon et qu'on appellera pudiquement pour les militaires revenants d'une confrontation brutale avec la mort : syndrome de stress post-traumatique.
On ne peut pas terminer avec António Lobo Antunes sans parler de cette musicalité qu'il met dans sa prose. Ce léger bruissement donne du rythme à ses mots et nous permet de supporter le chaos des images causé par son éprouvant témoignage. Cette étrange mélodie pourrait presque nous aider à transformer cette laideur en une certaine beauté mais sans tomber dans une fausse ingénuité. Cette musique n'est là que pour nous aider à supporter ce monologue nocturne sorti du cul de judas.
« le Vietnam est une guerre où l'Homme Blanc envoie l'Homme Noir tuer l'Homme Jaune pour garder la terre qu'il a volé à l'Homme Rouge ! »
Citation de Forrest dans Forrest Gump le film (1994)
Nous sommes dans les années qui suivent la fin, en 1975, de l’empire colonial portugais en Afrique. Comme déposés pêle-mêle par la vague du temps, les personnages historiques qui ont fait la grandeur et la fierté du Portugal, grands navigateurs, auteurs et poètes d’antan, reviennent à Lisbonne. Les y attend le destin pathétique des rapatriés coloniaux, qui ont tout perdu dans la débâcle et qui découvrent une métropole inconnue et misérable, indifférente à leur sort.
Dans un style baroque où les phrases courent sur plusieurs pages, sautant d’un narrateur à l’autre en cours de route, multipliant les allusions et les métaphores dans un jeu qui rend indispensables les annotations des traductrices pour les lecteurs non familiers des figures mythiques portugaises, l’auteur superpose allégrement la gloire passée du pays et sa piteuse décadence au lendemain d’une guerre coloniale qui a finit par faire chuter son régime dictatorial. Le contraste n’en est que plus cruel et permet à Antonio Lobo Antunes de dénoncer les manipulations politiques qui ont pu abuser tout un peuple, lui faisant croire en des chimères qui ne le menèrent qu’à une crise majeure.
Fond et forme du récit s’allient dans la volonté de l’auteur de secouer la société portugaise : au-delà de sa portée politique et historique, le texte rompt avec le schéma rédactionnel classique, et emporte le lecteur dans un délire aux apparences déstructurées et absurdes. Au début bluffée et séduite par cette audace et cette originalité, j’ai assez rapidement trouvé ce parti-pris lassant et fatigant, prise par une impression de répétition un peu lourde et la sensation frustrante de parfois passer à côté des nombreuses références typiquement portugaises.
Cette œuvre audacieuse et engagée, sans doute un peu datée, mais à son époque d’une portée politique et sociale considérable, m’a permis de découvrir une facette essentielle de la culture et de l’histoire portugaises, en même temps qu’un grand nom de la littérature lusitanienne. Le récit, noir et désespéré, et surtout si délibérément en rupture avec les conventions littéraires habituelles, s’est néanmoins transformé pour moi en une véritable épreuve de lecture.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Dans un style baroque où les phrases courent sur plusieurs pages, sautant d’un narrateur à l’autre en cours de route, multipliant les allusions et les métaphores dans un jeu qui rend indispensables les annotations des traductrices pour les lecteurs non familiers des figures mythiques portugaises, l’auteur superpose allégrement la gloire passée du pays et sa piteuse décadence au lendemain d’une guerre coloniale qui a finit par faire chuter son régime dictatorial. Le contraste n’en est que plus cruel et permet à Antonio Lobo Antunes de dénoncer les manipulations politiques qui ont pu abuser tout un peuple, lui faisant croire en des chimères qui ne le menèrent qu’à une crise majeure.
Fond et forme du récit s’allient dans la volonté de l’auteur de secouer la société portugaise : au-delà de sa portée politique et historique, le texte rompt avec le schéma rédactionnel classique, et emporte le lecteur dans un délire aux apparences déstructurées et absurdes. Au début bluffée et séduite par cette audace et cette originalité, j’ai assez rapidement trouvé ce parti-pris lassant et fatigant, prise par une impression de répétition un peu lourde et la sensation frustrante de parfois passer à côté des nombreuses références typiquement portugaises.
Cette œuvre audacieuse et engagée, sans doute un peu datée, mais à son époque d’une portée politique et sociale considérable, m’a permis de découvrir une facette essentielle de la culture et de l’histoire portugaises, en même temps qu’un grand nom de la littérature lusitanienne. Le récit, noir et désespéré, et surtout si délibérément en rupture avec les conventions littéraires habituelles, s’est néanmoins transformé pour moi en une véritable épreuve de lecture.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Le Cul de Judas eut une portée retentissante à sa sortie en 1979 dans le Portugal post-Salazar. Il raconte en effet avec force le cauchemar que constitua la guerre coloniale (1961-1974) pour le pays. Antonio Lobo Antunes alors tout jeune psychiatre fraîchement marié passa vingt-sept mois de service militaire en Angola comme médecin militaire. Il revint traumatisé dans un pays qui avait entre-temps changé.
le narrateur est dans un bar, ivre d'alcool, de rage et de désespoir. Il raconte à une inconnue le voyage au coeur des ténèbres que fut pour lui son service en Angola. On peut penser à Conrad ou à Céline mais la langue d'Antunes n'a pas d'équivalent et fait toute la puissance du livre. Les phrases sont longues, riches et denses, gorgées d'images saisissantes qui vous embarquent complètement. La réalité crue est transfigurée par une créativité débordante. le ton irrévérencieux, aigre ou cynique traduit sa rage, son mépris et sa solitude.
le roman est un monologue constitué de 23 chapitres intitulés par une lettre de l'alphabet portugais. le narrateur raconte à sa confidente sa guerre de A à Z telle qu'elle lui vient par vagues successives qu'il ressasse. Sa famille confite dans les traditions militaires et le catholicisme ; ses femmes (le mariage à la va vite, la petite fille qui ne le reconnait pas, Sofia une Africaine pleine de vie) ; sa guerre dans toute son horreur vécue comme médecin : les corps torturés, piétinés, amputés, les cadavres amoncelés, les hurlements. Il tourne en dérision les corps vivants déjà morts, celui de sa confidente qui deviendra grosse, le sien futur gros chat châtré. Il parle de ce retour impossible et désespérant dans ce Portugal étroit, figé et poussiéreux qu'il oppose à l'immensité et à la beauté naturelle de l'Angola. le cul de Judas c'est bien sûr le trou pourri dans lequel on l'a jeté mais c'est aussi le cul bien gras de la Mère patrie qui l'a trahi.
Merci Chrystèle de m'avoir fait découvrir Antonio Lobo Antunes.
le narrateur est dans un bar, ivre d'alcool, de rage et de désespoir. Il raconte à une inconnue le voyage au coeur des ténèbres que fut pour lui son service en Angola. On peut penser à Conrad ou à Céline mais la langue d'Antunes n'a pas d'équivalent et fait toute la puissance du livre. Les phrases sont longues, riches et denses, gorgées d'images saisissantes qui vous embarquent complètement. La réalité crue est transfigurée par une créativité débordante. le ton irrévérencieux, aigre ou cynique traduit sa rage, son mépris et sa solitude.
le roman est un monologue constitué de 23 chapitres intitulés par une lettre de l'alphabet portugais. le narrateur raconte à sa confidente sa guerre de A à Z telle qu'elle lui vient par vagues successives qu'il ressasse. Sa famille confite dans les traditions militaires et le catholicisme ; ses femmes (le mariage à la va vite, la petite fille qui ne le reconnait pas, Sofia une Africaine pleine de vie) ; sa guerre dans toute son horreur vécue comme médecin : les corps torturés, piétinés, amputés, les cadavres amoncelés, les hurlements. Il tourne en dérision les corps vivants déjà morts, celui de sa confidente qui deviendra grosse, le sien futur gros chat châtré. Il parle de ce retour impossible et désespérant dans ce Portugal étroit, figé et poussiéreux qu'il oppose à l'immensité et à la beauté naturelle de l'Angola. le cul de Judas c'est bien sûr le trou pourri dans lequel on l'a jeté mais c'est aussi le cul bien gras de la Mère patrie qui l'a trahi.
Merci Chrystèle de m'avoir fait découvrir Antonio Lobo Antunes.
Si je vous parle d'une histoire contée par un idiot qui soliloque évoquant la trajectoire décadente d'une famille, une histoire brisée, presque incohérente à première vue, fragmentée avec des flux de conscience qui naviguent entre passé et présent, que me répondrez-vous ? le bruit et la fureur, de William Faulkner. Et moi je vous répondrai La nébuleuse de l'insomnie, d'António Lobo Antunes. Cela dit, vous n'aurez pas tout à fait tort, ma première incursion dans l'oeuvre de ce grand écrivain portugais m'a fait découvrir la dimension faulknérienne de son écriture.
Un grand écrivain se reconnaît souvent aussi à sa manière de donner forme au contenu.
Ici, la forme du texte est un récit qui hésite, balbutie, se lance, s'arrête, entremêlé de voix intérieures, interrompu par la clameur du paysage et des bêtes, des images foisonnantes s'invitent dans ce dédale inextricable qui nous fait cheminer sans cesse à quelques encablures du vide, au bord de la rupture avec la réalité. Perdre pied dans des lambeaux de souvenirs…
L'histoire tient ici à peu de choses.
Par où faut-il commencer ? C'est une histoire de générations, dominée par la figure imposante, brutale, autoritaire du grand-père qui écrase tout de sa stature. Nous sommes dans la campagne portugaise. L'homme est à la tête d'une vaste exploitation agricole, aidé dans sa mission par le dévouement indéfectible de son contremaître.
Le grand-père gouverne le domaine en despote : soumettant les paysans à sa loi comme il traite durement ses bêtes, usant d'un droit de cuissage auprès des bonnes qui s'affairent dans la cuisine, méprisant son fils qu'il considère comme un bon à rien, ainsi que l'un de ses deux petits-fils, « l'idiot », celui qui nous parle. L'autre c'est le favori celui à qui l'héritage est promis, est-il mieux considéré pour autant ?
Et les femmes, que sont-elles lorsqu'elle ne sont pas des bonnes entraînées sauvagement dans le grenier et « troussées » comme on disait à l'époque, parce que « violées » n'étaient pas le terme approprié, mot qu'on n'osait pas encore prononcer dans cette société-là ?
Pourtant, d'autres femmes aussi font entendre leurs voix. Égrènent leurs prénoms. À commencer par la grand-mère qui ne cesse d'écorcher des lapins et de caresser leurs dépouilles. Maria Adelaïde, amour d'enfance de l'idiot et épouse de son frère, la vieille cousine Hortelinda, avec son petit chapeau à voilette et ses giroflées… Curieusement la mère de l'idiot m'est apparue absente du récit…
Et puis brusquement, le paysage penche, bascule dans une dimension qui nous échappe, un destin inexorable emporté dans les ruines du passé.
C'est un monde dévoré par la déchéance et le malheur. La splendeur ancienne des terres est vite oubliée.
Ici j'ai été emporté par la folie des hommes, la hargne des bêtes, la fatalité du paysage.
De temps en temps, on reconnaît parmi toutes ces voix celle fielleuse du grand-père qui ponctue le récit d'un toujours laconique et méprisant : « Idiot », comme s'il cherchait à interrompre le récit de son petit-fils.
Je suis entré dans ce texte hypnotique, sa cadence narrative, comme on plonge en apnée dans le flot chaotique des mots. J'ai cherché à poser ma respiration sur cette polyphonie à l'apparence cacophonique qui ne dit rien d'autre que l'écho d'une voix à l'autre, peut-être que l'écho de sa propre voix, celle de celui qui parle, tente de nous parler, l'idiot justement.
J'ai cherché à rassurer les morceaux éparpillés du puzzle...
Le texte est habité aussi par le gémissement des bêtes, le vacarme des oiseaux, les milans qui s'acharnent sur les chèvres, les crapauds au bord de la lagune, les toucans, les lézards. Il y a ce côté animal du récit qui n'est pas seulement du côté des bêtes.
C'est un texte habité par les vivants et les morts.
Même s'il y a une poésie envoûtante, parfois onirique, c'est un texte terriblement noir, hanté par les secrets de famille et ce terrifiant manque d'amour qui cloue au piloris le moindre espoir qui serait tenté d'émerger.
Ce petit-fils, - dont on finit par se demander de qui il est le fils : de son père, de son grand-père, du contremaître… ? - ce petit-fils nous narre un récit par bribes, tout simplement parce qu'il ne sait pas faire autrement.
Mais, désormais, la splendeur du domaine n'est plus qu'un lointain souvenir. le blé et le maïs ne poussent plus. Les milans s'en prennent aux chèvres. Il suffit de se pencher au bord du puits pour avoir envie de s'y jeter. C'est devenu comme une malédiction.
J'ai eu l'impression de visiter un monde clos dont les individus n'étaient pas libres de s'échapper et dont, à hauteur d'enfant, on ne voyait pas la frontière, à quel endroit ce territoire s'arrêtait, ce qui pouvait y avoir après. À hauteur d'enfant, à hauteur « d'idiot », à hauteur de lecteur… À hauteur d'humanité.
Il y a ici un côté qui semble a priori répétitif, lancinant, donnant le rythme et le ton d'un fado et nous emporte à l'extrême promontoire de ce texte, sur ces rivages où la littérature sait nous entraîner et nous faire échouer avec ravissement.
Il y a un côté addictif dans ces scènes répétitives. Des rideaux qui s'agitent, une horloge sans chiffres, le tremblotement d'une tasse de thé, une lèvre qui tressaute, un cheval qu'on détache de son attèle pour aller à la ville…
Et puis il y a cette omniprésence des bêtes, jour et nuit, qui nous rassure et nous effraie à la fois, qui confère au récit une dimension presque fantastique à travers le regard effrayé d'un enfant pas comme les autres.
Il en ressort une écriture puissante qui donne en effet forme au contenu, mais dont le contenu, c'est-à-dire les mots mais surtout le sens des mots s'entrelacent dans cette polyphonie insensée pour finir par nous toucher au coeur.
Je contemple une dernière fois les milans qui décrivent des cercles au-dessus des pages de ce livre avant de le refermer, mais je sais que cela ne les empêchera pas de continuer de tourner dans le ciel.
« Le flux les apporta, le reflux les emporte. »
Le Cid, Acte IV, Scène 3, Pierre Corneille.
Un grand écrivain se reconnaît souvent aussi à sa manière de donner forme au contenu.
Ici, la forme du texte est un récit qui hésite, balbutie, se lance, s'arrête, entremêlé de voix intérieures, interrompu par la clameur du paysage et des bêtes, des images foisonnantes s'invitent dans ce dédale inextricable qui nous fait cheminer sans cesse à quelques encablures du vide, au bord de la rupture avec la réalité. Perdre pied dans des lambeaux de souvenirs…
L'histoire tient ici à peu de choses.
Par où faut-il commencer ? C'est une histoire de générations, dominée par la figure imposante, brutale, autoritaire du grand-père qui écrase tout de sa stature. Nous sommes dans la campagne portugaise. L'homme est à la tête d'une vaste exploitation agricole, aidé dans sa mission par le dévouement indéfectible de son contremaître.
Le grand-père gouverne le domaine en despote : soumettant les paysans à sa loi comme il traite durement ses bêtes, usant d'un droit de cuissage auprès des bonnes qui s'affairent dans la cuisine, méprisant son fils qu'il considère comme un bon à rien, ainsi que l'un de ses deux petits-fils, « l'idiot », celui qui nous parle. L'autre c'est le favori celui à qui l'héritage est promis, est-il mieux considéré pour autant ?
Et les femmes, que sont-elles lorsqu'elle ne sont pas des bonnes entraînées sauvagement dans le grenier et « troussées » comme on disait à l'époque, parce que « violées » n'étaient pas le terme approprié, mot qu'on n'osait pas encore prononcer dans cette société-là ?
Pourtant, d'autres femmes aussi font entendre leurs voix. Égrènent leurs prénoms. À commencer par la grand-mère qui ne cesse d'écorcher des lapins et de caresser leurs dépouilles. Maria Adelaïde, amour d'enfance de l'idiot et épouse de son frère, la vieille cousine Hortelinda, avec son petit chapeau à voilette et ses giroflées… Curieusement la mère de l'idiot m'est apparue absente du récit…
Et puis brusquement, le paysage penche, bascule dans une dimension qui nous échappe, un destin inexorable emporté dans les ruines du passé.
C'est un monde dévoré par la déchéance et le malheur. La splendeur ancienne des terres est vite oubliée.
Ici j'ai été emporté par la folie des hommes, la hargne des bêtes, la fatalité du paysage.
De temps en temps, on reconnaît parmi toutes ces voix celle fielleuse du grand-père qui ponctue le récit d'un toujours laconique et méprisant : « Idiot », comme s'il cherchait à interrompre le récit de son petit-fils.
Je suis entré dans ce texte hypnotique, sa cadence narrative, comme on plonge en apnée dans le flot chaotique des mots. J'ai cherché à poser ma respiration sur cette polyphonie à l'apparence cacophonique qui ne dit rien d'autre que l'écho d'une voix à l'autre, peut-être que l'écho de sa propre voix, celle de celui qui parle, tente de nous parler, l'idiot justement.
J'ai cherché à rassurer les morceaux éparpillés du puzzle...
Le texte est habité aussi par le gémissement des bêtes, le vacarme des oiseaux, les milans qui s'acharnent sur les chèvres, les crapauds au bord de la lagune, les toucans, les lézards. Il y a ce côté animal du récit qui n'est pas seulement du côté des bêtes.
C'est un texte habité par les vivants et les morts.
Même s'il y a une poésie envoûtante, parfois onirique, c'est un texte terriblement noir, hanté par les secrets de famille et ce terrifiant manque d'amour qui cloue au piloris le moindre espoir qui serait tenté d'émerger.
Ce petit-fils, - dont on finit par se demander de qui il est le fils : de son père, de son grand-père, du contremaître… ? - ce petit-fils nous narre un récit par bribes, tout simplement parce qu'il ne sait pas faire autrement.
Mais, désormais, la splendeur du domaine n'est plus qu'un lointain souvenir. le blé et le maïs ne poussent plus. Les milans s'en prennent aux chèvres. Il suffit de se pencher au bord du puits pour avoir envie de s'y jeter. C'est devenu comme une malédiction.
J'ai eu l'impression de visiter un monde clos dont les individus n'étaient pas libres de s'échapper et dont, à hauteur d'enfant, on ne voyait pas la frontière, à quel endroit ce territoire s'arrêtait, ce qui pouvait y avoir après. À hauteur d'enfant, à hauteur « d'idiot », à hauteur de lecteur… À hauteur d'humanité.
Il y a ici un côté qui semble a priori répétitif, lancinant, donnant le rythme et le ton d'un fado et nous emporte à l'extrême promontoire de ce texte, sur ces rivages où la littérature sait nous entraîner et nous faire échouer avec ravissement.
Il y a un côté addictif dans ces scènes répétitives. Des rideaux qui s'agitent, une horloge sans chiffres, le tremblotement d'une tasse de thé, une lèvre qui tressaute, un cheval qu'on détache de son attèle pour aller à la ville…
Et puis il y a cette omniprésence des bêtes, jour et nuit, qui nous rassure et nous effraie à la fois, qui confère au récit une dimension presque fantastique à travers le regard effrayé d'un enfant pas comme les autres.
Il en ressort une écriture puissante qui donne en effet forme au contenu, mais dont le contenu, c'est-à-dire les mots mais surtout le sens des mots s'entrelacent dans cette polyphonie insensée pour finir par nous toucher au coeur.
Je contemple une dernière fois les milans qui décrivent des cercles au-dessus des pages de ce livre avant de le refermer, mais je sais que cela ne les empêchera pas de continuer de tourner dans le ciel.
« Le flux les apporta, le reflux les emporte. »
Le Cid, Acte IV, Scène 3, Pierre Corneille.
Crime et châtiment revisité (d'avance désolée pour cette critique, mes plombs ont sauté après 400 pages de Lobo Antunes dans le texte - livre à ne pas lire sans un bon électricien à portée de main^^).
.
Cinq personnes (2 collecteurs de dettes dont l'un jouant au billard, un avocat, son frère et l'herboriste) impliquées dans un crime et rongées par leurs consciences -ou plutôt par la peur d'être pris - laissent tour à tour, au fil de l'alternance de chapitres qui leur sont consacrés individuellement comme une farandole d'apparence sans fin ni queue ni tête, libre cours à leurs pensées les plus profondes, secrètes, inavouables, dans un flot de conscience tellement ininterrompu (avez-vous déjà essayé d'arrêter de penser - ou même de noter tout ce qui vous passe par la tête durant 5 minutes ?) qu'aucun point ne vient reposer les neurones du lecteur, pourtant parfois en surchauffe devant les sauts spatio-temporels de leur intimité dérangée, avant la fin de chaque chapitre.
.
En les écoutant se torturer les méninges, nous en apprenons un peu plus sur les circonstances du crime : ses causes, sa réalisation, ses intervenants et ses conséquences mais de là à savoir s'ils se feront prendre, l'herboriste à eux
- pas de corps pas de crime
il faudra vous farcir chacune de leurs pensées pour le découvrir
tout cela étant bien sûr noyé dans un gloubi-boulga de surgissements intempestifs de souvenirs d'enfance, de traumatismes expliquant ou non leurs personnalités, de dialogues d'aujourd'hui mêlés aux résurgences d'hier qui résonnent dans leurs actes et réactions actuelles.
.
L'exercice est probablement aussi amusant à écrire qu'à décrypter, amusant d'intercaler sans prévenir des faits différant dans le temps et dans l'espace au sein d'une même phrase, amusant de démêler ces intrications aléatoires de la pensée - ou d'un simulacre, d'une tentative de reproduction de la pensée - intéressant d'observer son propre cerveau replacer les pièces du puzzle au fil de notre lecture et avec quelle dextérité à n'en pas douter
pourtant, les pourtants sont des oiseaux que seule la jeune fille du parc fait naître même si vous ne pouvez pas les voir avec vos esprits cartésiens, bien que stimulant ce procédé m'est apparu souvent artificiel dans son exécution Chou à moi
- oulala ce n'est pas un livre pour moi ça
car ce qui aurait pu fonctionner avec l'un des personnages n'est que répétition d'un même mode de pensée appliqué à chacun des cinq personnages, pourtant (encore eux, ils sont partout quand je pense à elle) censés être différents moi à Chou
- non c'est à peu près sûr, mon coeur
cela rend les personnages difficilement distinguables - ils le sont par le contenu de leurs pensées à la rigueur, ayant eu des enfances différentes, mais non par leur style d'expression, leur vocabulaire etc qui pourraient, qui devraient, les distinguer
cet effet un peu lisse sur tout le livre contribue à décrédibiliser l'exercice, puisqu'on a rapidement du mal à croire à l'existence de 5 personnes différentes (à moins d'envisager les personnalités multiples d'une seule et encore), mais tend aussi à le rendre un peu monotone, comme le bip incessant régulier et entêtant des machines retenant mon grand-père en vie par un fil, dix ans seulement c'est trop tôt pour perdre son protecteur
il contribue surtout à décrédibiliser chaque personnage pris individuellement : j'ai eu l'impression que chacun d'entre eux était un gros bébé tout peureux et complexé à l'intérieur, chacun d'eux soi-disant gros moche mal aimé, montrant que la personne qu'on est aujourd'hui est bien la somme de celles que nous avons été à chaque étape de nos vies, la somme de nos vécus accumulés, qui plus est avec des histoires, pensées et réactions un peu trop similaires de l'un à l'autre pour sembler réalistes mon grand père à moi
- deviens quelqu'un de bien
certes, nous ne sommes pas tous originaux, mais nous sommes tous uniques et je n'ai pas assez senti cela au fil de ma lecture
heureusement cela est compensé par le fait que nous sommes, malgré nous, trop occupés à notre puzzle pour le déplorer avec fracas
c'est pourquoi je ne révèlerai rien d'autre de l'intrigue, puisque tout l'intérêt est que votre lecture la voit émerger, se dessiner, au fur et à mesure de cette somme de mots intriqués, ma grand-mère à moi tricotant au son des aiguilles qui montrent du doigt le temps qui passe
- une maille en dessus une maille en dessous.
.
Le procédé d'écriture que j'affectionne en lui même est connu, Belle du seigneur d'Albert Cohen en est un spécimen exemplaire, comme tant d'autres que je dévore à chaque fois
et pourtant, même si je commence à douter qu'ils existent vraiment en dehors de la tête de la fille du parc, je ne crois pas avoir eu ce problème dans G.A.V. de Marin Fouquet, par exemple, où certes le fil conducteur de l'auteur était également de nous enfermer dans les pensées des protagonistes jusqu'à en suffoquer tout autant, mais où je crois me souvenir que les pensées de chacun étaient reconnaissables à chaque chapitre, et de fait cassaient régulièrement la monotonie du rythme qui s'installait.
.
La lecture de Lobo Antunes demeure néanmoins originale et, en cela, globalement satisfaisante
elle offre surtout, parmi ce vomi tourbillonnant de tourments, de nombreuses fulgurances dans les descriptions des situations, laissant apercevoir, à ceux qui n'ont pas peur de se fatiguer les yeux et le cerveau, la virtuosité dont la plume de l'auteur peut faire preuve : j'ai aimé observer la plume s'enrouler autour de chaque personnage comme une liane un peu étouffante qui ne veut plus les lâcher, et le lecteur non-plus par la même occasion, ce fut parfois long de se perdre dans les méandres de leurs cerveaux mais cependant fascinant et irrésistible car extrêmement fluide
je vous conseille cependant de ne faire des pauses qu'à la fin d'un chapitre, sous peine de ne plus rien biter à la reprise de lecture - rapport au fait que vous seriez obligés de vous arrêter en plein milieu d'une phrase, et que le style monocorde de l'auteur ne permet pas de distinguer rapidement le personnage dans lequel vous (re)plongerez ensuite.
.
Une découverte aussi divertissante qu'elle peut être éprouvante pour la concentration, tant les dix pages d'intrigue sont noyées dans 450 pages de pensées à démêler ; à réserver aux aventuriers de la littérature, les autres pourraient s'y ennuyer sévère et abandonner !
.
Cinq personnes (2 collecteurs de dettes dont l'un jouant au billard, un avocat, son frère et l'herboriste) impliquées dans un crime et rongées par leurs consciences -ou plutôt par la peur d'être pris - laissent tour à tour, au fil de l'alternance de chapitres qui leur sont consacrés individuellement comme une farandole d'apparence sans fin ni queue ni tête, libre cours à leurs pensées les plus profondes, secrètes, inavouables, dans un flot de conscience tellement ininterrompu (avez-vous déjà essayé d'arrêter de penser - ou même de noter tout ce qui vous passe par la tête durant 5 minutes ?) qu'aucun point ne vient reposer les neurones du lecteur, pourtant parfois en surchauffe devant les sauts spatio-temporels de leur intimité dérangée, avant la fin de chaque chapitre.
.
En les écoutant se torturer les méninges, nous en apprenons un peu plus sur les circonstances du crime : ses causes, sa réalisation, ses intervenants et ses conséquences mais de là à savoir s'ils se feront prendre, l'herboriste à eux
- pas de corps pas de crime
il faudra vous farcir chacune de leurs pensées pour le découvrir
tout cela étant bien sûr noyé dans un gloubi-boulga de surgissements intempestifs de souvenirs d'enfance, de traumatismes expliquant ou non leurs personnalités, de dialogues d'aujourd'hui mêlés aux résurgences d'hier qui résonnent dans leurs actes et réactions actuelles.
.
L'exercice est probablement aussi amusant à écrire qu'à décrypter, amusant d'intercaler sans prévenir des faits différant dans le temps et dans l'espace au sein d'une même phrase, amusant de démêler ces intrications aléatoires de la pensée - ou d'un simulacre, d'une tentative de reproduction de la pensée - intéressant d'observer son propre cerveau replacer les pièces du puzzle au fil de notre lecture et avec quelle dextérité à n'en pas douter
pourtant, les pourtants sont des oiseaux que seule la jeune fille du parc fait naître même si vous ne pouvez pas les voir avec vos esprits cartésiens, bien que stimulant ce procédé m'est apparu souvent artificiel dans son exécution Chou à moi
- oulala ce n'est pas un livre pour moi ça
car ce qui aurait pu fonctionner avec l'un des personnages n'est que répétition d'un même mode de pensée appliqué à chacun des cinq personnages, pourtant (encore eux, ils sont partout quand je pense à elle) censés être différents moi à Chou
- non c'est à peu près sûr, mon coeur
cela rend les personnages difficilement distinguables - ils le sont par le contenu de leurs pensées à la rigueur, ayant eu des enfances différentes, mais non par leur style d'expression, leur vocabulaire etc qui pourraient, qui devraient, les distinguer
cet effet un peu lisse sur tout le livre contribue à décrédibiliser l'exercice, puisqu'on a rapidement du mal à croire à l'existence de 5 personnes différentes (à moins d'envisager les personnalités multiples d'une seule et encore), mais tend aussi à le rendre un peu monotone, comme le bip incessant régulier et entêtant des machines retenant mon grand-père en vie par un fil, dix ans seulement c'est trop tôt pour perdre son protecteur
il contribue surtout à décrédibiliser chaque personnage pris individuellement : j'ai eu l'impression que chacun d'entre eux était un gros bébé tout peureux et complexé à l'intérieur, chacun d'eux soi-disant gros moche mal aimé, montrant que la personne qu'on est aujourd'hui est bien la somme de celles que nous avons été à chaque étape de nos vies, la somme de nos vécus accumulés, qui plus est avec des histoires, pensées et réactions un peu trop similaires de l'un à l'autre pour sembler réalistes mon grand père à moi
- deviens quelqu'un de bien
certes, nous ne sommes pas tous originaux, mais nous sommes tous uniques et je n'ai pas assez senti cela au fil de ma lecture
heureusement cela est compensé par le fait que nous sommes, malgré nous, trop occupés à notre puzzle pour le déplorer avec fracas
c'est pourquoi je ne révèlerai rien d'autre de l'intrigue, puisque tout l'intérêt est que votre lecture la voit émerger, se dessiner, au fur et à mesure de cette somme de mots intriqués, ma grand-mère à moi tricotant au son des aiguilles qui montrent du doigt le temps qui passe
- une maille en dessus une maille en dessous.
.
Le procédé d'écriture que j'affectionne en lui même est connu, Belle du seigneur d'Albert Cohen en est un spécimen exemplaire, comme tant d'autres que je dévore à chaque fois
et pourtant, même si je commence à douter qu'ils existent vraiment en dehors de la tête de la fille du parc, je ne crois pas avoir eu ce problème dans G.A.V. de Marin Fouquet, par exemple, où certes le fil conducteur de l'auteur était également de nous enfermer dans les pensées des protagonistes jusqu'à en suffoquer tout autant, mais où je crois me souvenir que les pensées de chacun étaient reconnaissables à chaque chapitre, et de fait cassaient régulièrement la monotonie du rythme qui s'installait.
.
La lecture de Lobo Antunes demeure néanmoins originale et, en cela, globalement satisfaisante
elle offre surtout, parmi ce vomi tourbillonnant de tourments, de nombreuses fulgurances dans les descriptions des situations, laissant apercevoir, à ceux qui n'ont pas peur de se fatiguer les yeux et le cerveau, la virtuosité dont la plume de l'auteur peut faire preuve : j'ai aimé observer la plume s'enrouler autour de chaque personnage comme une liane un peu étouffante qui ne veut plus les lâcher, et le lecteur non-plus par la même occasion, ce fut parfois long de se perdre dans les méandres de leurs cerveaux mais cependant fascinant et irrésistible car extrêmement fluide
je vous conseille cependant de ne faire des pauses qu'à la fin d'un chapitre, sous peine de ne plus rien biter à la reprise de lecture - rapport au fait que vous seriez obligés de vous arrêter en plein milieu d'une phrase, et que le style monocorde de l'auteur ne permet pas de distinguer rapidement le personnage dans lequel vous (re)plongerez ensuite.
.
Une découverte aussi divertissante qu'elle peut être éprouvante pour la concentration, tant les dix pages d'intrigue sont noyées dans 450 pages de pensées à démêler ; à réserver aux aventuriers de la littérature, les autres pourraient s'y ennuyer sévère et abandonner !
Je découvre Antonio Lobo Antunes avec ce roman : Le retour des caravelles...
Des caravelles pleines de rêves qui partent vers des colonies encore inconnues : Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, entre autres... Et quelques siècles plus tard ce sont des hommes brisés qui reviendront dans un Portugal qu'ils ne connaissent plus !
L'écriture d'Antonio Lobo Antunes n'est pas facile, elle est pleine de bruit, de fureur... et d'images !
Première difficulté : Dans ce livre le passé se superpose constamment avec le présent et les personnages portent le même nom que les anciens explorateurs (Vasco de Gama, Pedro Alvares Cabral, etc.) !
C'est bien compliqué tout ça, c'est vrai !
Mais cela permet de mettre en parallèle l'ancienne splendeur du Portugal et la déchéance de ces colons qui reviennent tête basse dans un pays qui n'est plus le leur... et j'ai trouvé que, du point de vue narratif, c'est une idée de génie !
Autre complication : Si en début d'une phrase la narration commence à la troisième personne, elle peut brusquement passer au je sans prévenir !
Et pour y comprendre quelque chose, j'ai dû relire les premières pages puis revenir à la préface de Michelle Giudicelli... tout ça une bonne dizaine de fois !
Mais une fois qu'on a compris "le truc" : WAOUH ! On VIT l'histoire, on EST les personnages !
Donc même si ce livre a été une lecture difficile, je me suis complètement immergée dedans pour en ressortir toute chamboulée !
Un énorme coup de cœur !
Des caravelles pleines de rêves qui partent vers des colonies encore inconnues : Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, entre autres... Et quelques siècles plus tard ce sont des hommes brisés qui reviendront dans un Portugal qu'ils ne connaissent plus !
L'écriture d'Antonio Lobo Antunes n'est pas facile, elle est pleine de bruit, de fureur... et d'images !
Première difficulté : Dans ce livre le passé se superpose constamment avec le présent et les personnages portent le même nom que les anciens explorateurs (Vasco de Gama, Pedro Alvares Cabral, etc.) !
C'est bien compliqué tout ça, c'est vrai !
Mais cela permet de mettre en parallèle l'ancienne splendeur du Portugal et la déchéance de ces colons qui reviennent tête basse dans un pays qui n'est plus le leur... et j'ai trouvé que, du point de vue narratif, c'est une idée de génie !
Autre complication : Si en début d'une phrase la narration commence à la troisième personne, elle peut brusquement passer au je sans prévenir !
Et pour y comprendre quelque chose, j'ai dû relire les premières pages puis revenir à la préface de Michelle Giudicelli... tout ça une bonne dizaine de fois !
Mais une fois qu'on a compris "le truc" : WAOUH ! On VIT l'histoire, on EST les personnages !
Donc même si ce livre a été une lecture difficile, je me suis complètement immergée dedans pour en ressortir toute chamboulée !
Un énorme coup de cœur !
Un des premiers « Manuel de l'Inquisiteur », écrit en 1376 par Eymerich pour légiférer la torture et déjouer les astuces des hérétiques, utilise à la fois la véhémence « on les gardera dans une prison horrible et obscure », le pragmatisme, car les ruses de ces hérétiques sont cousues de fil blanc, et le cynisme « la condamnation à mort n'a pas pour but de sauver l'âme de ces damnés, mais de terroriser le peuple. »
Antonio Lobo Antunes reprend le titre, presque la pagination entre récit et commentaire ( appelés scolies au Moyen-Age) et sûrement l'esprit des inquisiteurs, en leur donnant la parole, cynique, brute de décoffrage, brutale , à propos du ministre Francisco, celui à qui Salazar demandait : « que fait-on pour l'Europe ? Que fait-on pour l'Afrique ? » -celui qui pouvait tout se permettre, décider de la prison ou de la mort, « suicider » son père, tuer ses chiens, demander à une petite paysanne à qui il dit « bouge pas poulette » et qui pense alors qu'il veut la vider comme un poulet pendant qu'elle se courbe pour qu'il la possède par derrière- .
Paroles –souvent ponctuées du : « Oui, vous pouvez le noter » des interrogés- du vétérinaire qui fait accoucher une « génisse », autrement dit, une petite violée, du fils, méprisé par le père, pas aimé de la première épouse, Isabel, qui a fui, de l'autre petite, que Francisco s'évertue à vêtir des dentelles moisies et des chaussures usées, en lui demandant « est ce que tu m'aimes, Isabel », de la gouvernante Titina toute puissante, épousant les pensées du maitre, de la belle famille du fils, persuadée qu'elle peut en toute bonne foi ruiner et le fils et le père, et , forte de la Révolution des oeillets, détruire le palais , les serres des orchidées, fusiller les oiseaux, et construire un centre de loisirs.
Avec des phrases longues, très longues, et cependant seulement descriptives, à la différence de Proust, seulement parlant de détails culinaires, décoratifs ou vestimentaires, Antonio Lobo Antunes nous présente une certaine société, celle de la dictature, puis celle d'après la révolution.
C'est l'histoire d'une chute, d'une déperdition, d'un déclassement de ces possédants qui ne se doutent pas du tout de ce qui est dit derrière eux. Ils croient que ce monde durera toujours, et la seule solution pour eux serait de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, les pauvres ne demandant jamais autre chose que de ne rien faire, d'attendre et de mendier un peu de soupe. Les Noirs d'Angola n'ont eux aussi qu'une chose à faire, continuer d'applaudir pour remercier de mourir de faim.
Et pourtant :
La phrase : « Je fais tout ce qu'elles veulent, mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron », reprise maintes fois, est détournée de façon cynique : « le chapeau, pour qu'on ne voit pas les cornes ». (de plus, il ne fait jamais ce qu'elles veulent, pour lui ce sont des animaux.)
Et l'autre phrase « un petit pipi, je dois rendre mon autobus, vous n'allez pas mouiller votre pyjama »répétée maintes et maintes fois, nous fait mesurer la distance entre le « monsieur le ministre », cocu , certes, mais tout puissant dans son domaine, et le pauvre vieux incontinent qu'il est devenu, muet, soumis, inutile, humilié aux mains d'infirmières pressées.
Ai-je aimé ce roman ? Non, je dois l'avouer, malgré l'écriture enthousiaste de Chystèle. Beaucoup trop long, avec ce tic de répétition de la même phrase qui m'a plus paru un jeu stylistique qu'une nécessité, ces descriptions qui veulent symboliser la politique, comme si nous avions besoin d'un chat en porcelaine pour comprendre le changement définitif accueilli par le Portugal, enfin l'Angola n'étant que profilé de loin.
Pour positiver, ce serait, transposé littérairement, la fin d'un monde colonial et dictatorial dont, avec un plaisir évident Lobo Antunes nous fait partager les pensées
rétrogrades et répétitives donnant une idée du monde ancien révolu qui rabâche.
Antonio Lobo Antunes reprend le titre, presque la pagination entre récit et commentaire ( appelés scolies au Moyen-Age) et sûrement l'esprit des inquisiteurs, en leur donnant la parole, cynique, brute de décoffrage, brutale , à propos du ministre Francisco, celui à qui Salazar demandait : « que fait-on pour l'Europe ? Que fait-on pour l'Afrique ? » -celui qui pouvait tout se permettre, décider de la prison ou de la mort, « suicider » son père, tuer ses chiens, demander à une petite paysanne à qui il dit « bouge pas poulette » et qui pense alors qu'il veut la vider comme un poulet pendant qu'elle se courbe pour qu'il la possède par derrière- .
Paroles –souvent ponctuées du : « Oui, vous pouvez le noter » des interrogés- du vétérinaire qui fait accoucher une « génisse », autrement dit, une petite violée, du fils, méprisé par le père, pas aimé de la première épouse, Isabel, qui a fui, de l'autre petite, que Francisco s'évertue à vêtir des dentelles moisies et des chaussures usées, en lui demandant « est ce que tu m'aimes, Isabel », de la gouvernante Titina toute puissante, épousant les pensées du maitre, de la belle famille du fils, persuadée qu'elle peut en toute bonne foi ruiner et le fils et le père, et , forte de la Révolution des oeillets, détruire le palais , les serres des orchidées, fusiller les oiseaux, et construire un centre de loisirs.
Avec des phrases longues, très longues, et cependant seulement descriptives, à la différence de Proust, seulement parlant de détails culinaires, décoratifs ou vestimentaires, Antonio Lobo Antunes nous présente une certaine société, celle de la dictature, puis celle d'après la révolution.
C'est l'histoire d'une chute, d'une déperdition, d'un déclassement de ces possédants qui ne se doutent pas du tout de ce qui est dit derrière eux. Ils croient que ce monde durera toujours, et la seule solution pour eux serait de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, les pauvres ne demandant jamais autre chose que de ne rien faire, d'attendre et de mendier un peu de soupe. Les Noirs d'Angola n'ont eux aussi qu'une chose à faire, continuer d'applaudir pour remercier de mourir de faim.
Et pourtant :
La phrase : « Je fais tout ce qu'elles veulent, mais je n'enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu'on sache bien qui est le patron », reprise maintes fois, est détournée de façon cynique : « le chapeau, pour qu'on ne voit pas les cornes ». (de plus, il ne fait jamais ce qu'elles veulent, pour lui ce sont des animaux.)
Et l'autre phrase « un petit pipi, je dois rendre mon autobus, vous n'allez pas mouiller votre pyjama »répétée maintes et maintes fois, nous fait mesurer la distance entre le « monsieur le ministre », cocu , certes, mais tout puissant dans son domaine, et le pauvre vieux incontinent qu'il est devenu, muet, soumis, inutile, humilié aux mains d'infirmières pressées.
Ai-je aimé ce roman ? Non, je dois l'avouer, malgré l'écriture enthousiaste de Chystèle. Beaucoup trop long, avec ce tic de répétition de la même phrase qui m'a plus paru un jeu stylistique qu'une nécessité, ces descriptions qui veulent symboliser la politique, comme si nous avions besoin d'un chat en porcelaine pour comprendre le changement définitif accueilli par le Portugal, enfin l'Angola n'étant que profilé de loin.
Pour positiver, ce serait, transposé littérairement, la fin d'un monde colonial et dictatorial dont, avec un plaisir évident Lobo Antunes nous fait partager les pensées
rétrogrades et répétitives donnant une idée du monde ancien révolu qui rabâche.
Me voici revenu vers António Lobo Antunes par la lecture de la dernière porte avant la nuit, roman ô combien déconcertant, déstabilisant même par son style d'écriture.
Au travers d'un récit polyphonique construit sur vingt-cinq chapitres, c'est-à-dire le nombre d'années de prison que les protagonistes de ce meurtre sordide encourent, il y a quelque chose d'obsessionnel dans le narratif de l'auteur, mais qui m'était presque déjà familier. J'avais déjà rencontré cette manière étonnante de nous raconter une histoire dans ma dernière lecture de cet auteur, La nébuleuse de l'insomnie.
L'intrigue tient à trois fois rien. Cinq hommes sont impliqués dans le meurtre d'un chef d'entreprise fortuné auquel ils sont liés depuis l'enfance. Un pacte tacite les lie désormais. Par les différentes voix des protagonistes de ce meurtre qui résonnent dans ce texte à la forme d'un kaléidoscope textuel, nous entrevoyons l'horreur de la scène de crime, l'enlèvement de la victime sous les yeux de sa petite fille, l'assassinat et la disparition du corps dans un baril d'acide sulfurique, avant de jeter le tout dans une rivière toute proche. Autant vous dire que la préservation de la faune et la flore, le sort des poissons qui fraient ici, c'était le cadet de leurs soucis !
Visiblement les cinq protagonistes connaissaient leur victime depuis l'enfance.
Le déroulement des faits est terrible, dans la manière de convoquer la parole de chacun, balbutiante, décrivant froidement l'ignoble événement.
Et puis il y a ces phrases qui se répètent comme des litanies, inlassablement. Certaines font mal.
« Pas de corps, pas de crime. »
« Ne faites pas de mal à ma fille. »
« Quelqu'un nous a balancé. »
Ces cinq meurtriers complices semblent vouloir préserver à jamais le secret qui les a amenés à commettre l'horreur. Une histoire d'argent, semble-t-il.
Chacun, sur ce crime, porte sa voix, posant froidement un regard dénué de compassion. Les voix se croisent, résonnent, s'entremêlent, se délient dans la phrase particulière d'Antunes.
La force de l'écriture démêle les silences, amène des confidences, évoque peut-être des chemins qui ont amené les uns et les autres à se retrouver un jour dans cet entrepôt et commettre l'impensable, l'impensable qui a été cependant savamment orchestré.
Leurs voix s'entrecroisent et délient le passé, emprisonné jusqu'à présent dans des corps trop sûrs d'eux. Ces hommes, ces mâles sûrs d'eux, ces assassins qui continuent à se jauger les uns les autres après, redeviennent sous nos yeux, ce qu'ils sont dans leur existence, ce qu'ils furent aussi, des enfants apprenant la vie, déjà les coups, les rebuffades, les premières désillusions.
Ils expriment leur ressenti, chacun a ses mots, disant la souffrance d'un passé compliqué, l'enfance battue, grandir avec des rêves meurtris ou inexistants. Souvent ce qui est évoqué est une enfance maltraitée avec comme seuls repères des parents qui ne sont plus des parents depuis longtemps quand bien même il existe encore une mère et un père ici ou là. Comment grandir avec cela sur des décombres ? Plus tard, ces enfants grandissent et tentent avec des bras d'albatros d'étreindre des femmes aussi fragiles qu'eux. Ils sont devenus des hommes à la fois odieux, violents et touchants et vont commettre ce crime sordide qui ressemble à ce qu'ils sont à présent.
On entre dans leur maison, dans leur enfance, dans leur corps. On ressent ce qu'ils ressentent.
Craignant d'être arrêtés par la police, ils redeviennent presque naïfs. S'il n'y avait pas ce crime horrible, cette petite fille dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on pourrait rire comme on rit devant une BD des Pieds Nickelés.
Sur cette trame presque ordinaire, Antonio Lobo Antunes va construire un récit porté par une écriture déroutante, cassée comme une vague qui s'éperonne sur des rochers, tentant de rejoindre le rivage…
C'est cette forme qui saisit à la gorge. D'emblée la couleur est annoncée, on aime ou on n'aime pas.
Mais force est de constater que le procédé non seulement peut prendre tout son sens, mais va bien au-delà du simple exercice de style. Il porte des voix d'hommes autant ahuris par la question de l'assassinat qu'ils ont commis que par celle du doute qui les assaille après, non pas du remords mais quelque chose qui remonte à la surface d'une eau saumâtre. Ce meurtre convoque pour chacun d'eux un passé chez eux qui ne passe pas.
Alors, forcément, chacun cogite, soliloque, revient sur les pas d'avant, revient dans l'entrepôt, revient à la rivière où fut déversé le baril contenant l'acide encore frémissant de bulles, revient à son enfance, c'est un aller-retour avec du gravier dans les chaussures, mais aussi dans la mémoire.
Plus les récits des uns et des autres se sont déliés, plus j'ai été happé dans l'horreur sordide et presque ordinaire de cet assassinat qui prend peut-être son appui bien avant cette nuit tragique.
La force hypnotique d'Antunes nous oblige à déconstruire ce crime pour en déceler l'origine, à commencer par l'ignorance, des peurs d'enfance, des démons qui remontent à si loin.
Derrière ce prétexte d'une trame policière, Antunes nous révèle ce qui n'aurait peut-être pas pu être dit dans une autre langue que celle de ce récit.
Car l'écriture d'Antunes est une langue presque à part entière, qu'on peut aimer ou détester, dans laquelle on peut entrer et se laisser prendre, envoûter, se laisser happer, se laisser défaire, ou bien au contraire rester à la porte de cette écriture, peut-être celle de la dernière porte avant la nuit.
À force de découvrir peu à peu António Lobo Antunes, je le découvre comme aucun autre écrivain. Son écriture est un tempo unique, intérieur, intime.
Il y a dans ce récit presque ordinaire la révélation d'un malaise, celui d'appartenir à un monde dans lequel on a mal grandi. L'écriture non seulement raconte ce malaise, - ce décalage dans le temps, celui de l'enfance, celui du crime, celui d'après où l'on tâche de se raccrocher au déni, mais elle nous raconte bien autre chose dans sa manière d'opérer.
C'est une écriture à la fois éclatée et paradoxalement continue qui oblige à faire venir le passé dans le présent sans lui demander quelconque autorisation.
C'est une écriture belle et fascinante, qui désoriente dans un premier temps pour finalement faire corps, étrangement, dans l'esprit du récit, faire corps à l'ensemble du texte, faire corps avec le lecteur que j'ai été.
C'est sans doute pour cela que j'ai adoré ce roman et continuerai de visiter l'oeuvre d'Antunes.
Au travers d'un récit polyphonique construit sur vingt-cinq chapitres, c'est-à-dire le nombre d'années de prison que les protagonistes de ce meurtre sordide encourent, il y a quelque chose d'obsessionnel dans le narratif de l'auteur, mais qui m'était presque déjà familier. J'avais déjà rencontré cette manière étonnante de nous raconter une histoire dans ma dernière lecture de cet auteur, La nébuleuse de l'insomnie.
L'intrigue tient à trois fois rien. Cinq hommes sont impliqués dans le meurtre d'un chef d'entreprise fortuné auquel ils sont liés depuis l'enfance. Un pacte tacite les lie désormais. Par les différentes voix des protagonistes de ce meurtre qui résonnent dans ce texte à la forme d'un kaléidoscope textuel, nous entrevoyons l'horreur de la scène de crime, l'enlèvement de la victime sous les yeux de sa petite fille, l'assassinat et la disparition du corps dans un baril d'acide sulfurique, avant de jeter le tout dans une rivière toute proche. Autant vous dire que la préservation de la faune et la flore, le sort des poissons qui fraient ici, c'était le cadet de leurs soucis !
Visiblement les cinq protagonistes connaissaient leur victime depuis l'enfance.
Le déroulement des faits est terrible, dans la manière de convoquer la parole de chacun, balbutiante, décrivant froidement l'ignoble événement.
Et puis il y a ces phrases qui se répètent comme des litanies, inlassablement. Certaines font mal.
« Pas de corps, pas de crime. »
« Ne faites pas de mal à ma fille. »
« Quelqu'un nous a balancé. »
Ces cinq meurtriers complices semblent vouloir préserver à jamais le secret qui les a amenés à commettre l'horreur. Une histoire d'argent, semble-t-il.
Chacun, sur ce crime, porte sa voix, posant froidement un regard dénué de compassion. Les voix se croisent, résonnent, s'entremêlent, se délient dans la phrase particulière d'Antunes.
La force de l'écriture démêle les silences, amène des confidences, évoque peut-être des chemins qui ont amené les uns et les autres à se retrouver un jour dans cet entrepôt et commettre l'impensable, l'impensable qui a été cependant savamment orchestré.
Leurs voix s'entrecroisent et délient le passé, emprisonné jusqu'à présent dans des corps trop sûrs d'eux. Ces hommes, ces mâles sûrs d'eux, ces assassins qui continuent à se jauger les uns les autres après, redeviennent sous nos yeux, ce qu'ils sont dans leur existence, ce qu'ils furent aussi, des enfants apprenant la vie, déjà les coups, les rebuffades, les premières désillusions.
Ils expriment leur ressenti, chacun a ses mots, disant la souffrance d'un passé compliqué, l'enfance battue, grandir avec des rêves meurtris ou inexistants. Souvent ce qui est évoqué est une enfance maltraitée avec comme seuls repères des parents qui ne sont plus des parents depuis longtemps quand bien même il existe encore une mère et un père ici ou là. Comment grandir avec cela sur des décombres ? Plus tard, ces enfants grandissent et tentent avec des bras d'albatros d'étreindre des femmes aussi fragiles qu'eux. Ils sont devenus des hommes à la fois odieux, violents et touchants et vont commettre ce crime sordide qui ressemble à ce qu'ils sont à présent.
On entre dans leur maison, dans leur enfance, dans leur corps. On ressent ce qu'ils ressentent.
Craignant d'être arrêtés par la police, ils redeviennent presque naïfs. S'il n'y avait pas ce crime horrible, cette petite fille dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on pourrait rire comme on rit devant une BD des Pieds Nickelés.
Sur cette trame presque ordinaire, Antonio Lobo Antunes va construire un récit porté par une écriture déroutante, cassée comme une vague qui s'éperonne sur des rochers, tentant de rejoindre le rivage…
C'est cette forme qui saisit à la gorge. D'emblée la couleur est annoncée, on aime ou on n'aime pas.
Mais force est de constater que le procédé non seulement peut prendre tout son sens, mais va bien au-delà du simple exercice de style. Il porte des voix d'hommes autant ahuris par la question de l'assassinat qu'ils ont commis que par celle du doute qui les assaille après, non pas du remords mais quelque chose qui remonte à la surface d'une eau saumâtre. Ce meurtre convoque pour chacun d'eux un passé chez eux qui ne passe pas.
Alors, forcément, chacun cogite, soliloque, revient sur les pas d'avant, revient dans l'entrepôt, revient à la rivière où fut déversé le baril contenant l'acide encore frémissant de bulles, revient à son enfance, c'est un aller-retour avec du gravier dans les chaussures, mais aussi dans la mémoire.
Plus les récits des uns et des autres se sont déliés, plus j'ai été happé dans l'horreur sordide et presque ordinaire de cet assassinat qui prend peut-être son appui bien avant cette nuit tragique.
La force hypnotique d'Antunes nous oblige à déconstruire ce crime pour en déceler l'origine, à commencer par l'ignorance, des peurs d'enfance, des démons qui remontent à si loin.
Derrière ce prétexte d'une trame policière, Antunes nous révèle ce qui n'aurait peut-être pas pu être dit dans une autre langue que celle de ce récit.
Car l'écriture d'Antunes est une langue presque à part entière, qu'on peut aimer ou détester, dans laquelle on peut entrer et se laisser prendre, envoûter, se laisser happer, se laisser défaire, ou bien au contraire rester à la porte de cette écriture, peut-être celle de la dernière porte avant la nuit.
À force de découvrir peu à peu António Lobo Antunes, je le découvre comme aucun autre écrivain. Son écriture est un tempo unique, intérieur, intime.
Il y a dans ce récit presque ordinaire la révélation d'un malaise, celui d'appartenir à un monde dans lequel on a mal grandi. L'écriture non seulement raconte ce malaise, - ce décalage dans le temps, celui de l'enfance, celui du crime, celui d'après où l'on tâche de se raccrocher au déni, mais elle nous raconte bien autre chose dans sa manière d'opérer.
C'est une écriture à la fois éclatée et paradoxalement continue qui oblige à faire venir le passé dans le présent sans lui demander quelconque autorisation.
C'est une écriture belle et fascinante, qui désoriente dans un premier temps pour finalement faire corps, étrangement, dans l'esprit du récit, faire corps à l'ensemble du texte, faire corps avec le lecteur que j'ai été.
C'est sans doute pour cela que j'ai adoré ce roman et continuerai de visiter l'oeuvre d'Antunes.
La guerre en fera un homme. C’est sur ces mots qu’un jeune médecin part pout l’Angola.
27 mois plus tard, le voici qui descend d’avion, poignée de main à ses compagnons d’arme, retour à la vie normale, c’est fini. Mais ou est l’interrupteur ? Comment oublier ?
« … j’aurais voulu ne pas être né pour ne pas assister à cela, à l’idiote et colossale de cela… »
La guerre s’est encastrée, incorporée, imbriquée, incrustée en lui.
« … j’ai vu la misère et la méchanceté de la guerre, l’inutilité de la guerre dans les yeux d’oiseaux blessés des militaires, dans leur découragement et leur abandon… »
Les nuits sont longues, alors reste l’alcool, le sexe pour fuir le cortège des horreurs vécues : membres éparpillés, longues agonies des blessés, morts dans les champs, odeurs, maladies, peur, la colère envers ceux qui décident depuis le Portugal.
« … les soldats me croyaient capable de les accompagner et de lutter pour eux, de m’unir à leur haine ingénue contre les seigneurs de Lisbonne qui tiraient contre nous les balles empoisonnées de leurs discours patriotiques… »
Un texte qui vous donne la nausée, un texte lu avec des pauses, je croyais tout savoir de cette guerre mais en fait il n’y a que le narrateur et ses réflexions. Pourtant je l’ai lu pour son auteur Antonio Lobo Antunes dont l’écriture est magnifique : une pépite. Il est l’architecte des phrases longues, des figures de style. Il joue avec les mots s’en sert à des moments inattendus, c’est un cours magistral.
Et pourtant je ne mets que trois étoiles car c’est trop cru, trop noir, trop laid, tout simplement pas pour moi, même si j’y ai trouvé un très beau passage.
« Vous pouvez éteindre la lumière : je n’en ai plus besoin. Quand je pense à Isabelle je cesse d’avoir peur du noir, une clarté ambrée revêt les objets de la sérénité complice des matins de juillet qui me faisaient toujours l’effet de disposer devant moi, avec leur soleil enfantin, les matériaux nécessaires pour construire quelque chose d’ineffablement agréable que je n’arriverai jamais à élucider. »
Antonio Lobo Antunes m’a donné la clef qui m’a permis d’apprécier, de comprendre mon malaise vis-à-vis de cette lecture poursuivie cahin-caha
« Vous, par exemple, vous qui offrez l’aspect aseptisé, compétent et sans pellicules des secrétaires de direction, seriez-vous capables de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d’œufs, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
27 mois plus tard, le voici qui descend d’avion, poignée de main à ses compagnons d’arme, retour à la vie normale, c’est fini. Mais ou est l’interrupteur ? Comment oublier ?
« … j’aurais voulu ne pas être né pour ne pas assister à cela, à l’idiote et colossale de cela… »
La guerre s’est encastrée, incorporée, imbriquée, incrustée en lui.
« … j’ai vu la misère et la méchanceté de la guerre, l’inutilité de la guerre dans les yeux d’oiseaux blessés des militaires, dans leur découragement et leur abandon… »
Les nuits sont longues, alors reste l’alcool, le sexe pour fuir le cortège des horreurs vécues : membres éparpillés, longues agonies des blessés, morts dans les champs, odeurs, maladies, peur, la colère envers ceux qui décident depuis le Portugal.
« … les soldats me croyaient capable de les accompagner et de lutter pour eux, de m’unir à leur haine ingénue contre les seigneurs de Lisbonne qui tiraient contre nous les balles empoisonnées de leurs discours patriotiques… »
Un texte qui vous donne la nausée, un texte lu avec des pauses, je croyais tout savoir de cette guerre mais en fait il n’y a que le narrateur et ses réflexions. Pourtant je l’ai lu pour son auteur Antonio Lobo Antunes dont l’écriture est magnifique : une pépite. Il est l’architecte des phrases longues, des figures de style. Il joue avec les mots s’en sert à des moments inattendus, c’est un cours magistral.
Et pourtant je ne mets que trois étoiles car c’est trop cru, trop noir, trop laid, tout simplement pas pour moi, même si j’y ai trouvé un très beau passage.
« Vous pouvez éteindre la lumière : je n’en ai plus besoin. Quand je pense à Isabelle je cesse d’avoir peur du noir, une clarté ambrée revêt les objets de la sérénité complice des matins de juillet qui me faisaient toujours l’effet de disposer devant moi, avec leur soleil enfantin, les matériaux nécessaires pour construire quelque chose d’ineffablement agréable que je n’arriverai jamais à élucider. »
Antonio Lobo Antunes m’a donné la clef qui m’a permis d’apprécier, de comprendre mon malaise vis-à-vis de cette lecture poursuivie cahin-caha
« Vous, par exemple, vous qui offrez l’aspect aseptisé, compétent et sans pellicules des secrétaires de direction, seriez-vous capables de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d’œufs, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
À Lisbonne, une nuit, dans un bar, un homme parle à une femme qui lui était jusqu'alors inconnue... Nous allons suivre ce narrateur omniscient dans les méandres d'un long soliloque nocturne et éthylique.
Le titre en dit déjà long... Sans avoir versé dans les saintes écritures des Évangiles, j'avais déjà une vague idée de ce versant retors de l'humanité, voilà qu'une métaphore anatomique vient préciser l'endroit où veut nous entraîner l'auteur et nous donne ainsi le ton.
Entrer dans le cul de Judas, - pardonnez-moi l'expression imagée, c'est comme entrer dans un tableau de Jérôme Bosch avec les odeurs et les effluves qui viennent jusqu'à vous et vous emportent jusqu'au bout de la nuit.
Cet homme a besoin de parler, c'est comme une catharsis. Évoquer son séjour comme médecin en Angola. Parler de ses souvenirs, c'est comme évoquer un cauchemar horrible et destructeur dont on ne revient jamais indemne. Alors il invite cette femme, son interlocutrice d'un soir, dans un voyage à la fois cru et onirique, dans cette tendresse désespérée de la nuit où nous nous apprêtons à écouter son monologue comme des passagers clandestins.
Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin la source qui a inspiré ce livre : António Lobo Antunes a écrit le cul de Judas au cours des années qui ont suivi son retour, en 1973, de la guerre coloniale en Angola. Il y a passé vingt-sept mois, tout comme le narrateur, « vingt-sept mois d'esclavage sanglant », il en est revenu vieilli, cynique, désabusé, peut-être mort aussi, en tous cas naufragé à jamais, revenu d'une Afrique mise à feu et à sang, jeté ce soir sur le rivage de ce bar où l'alcool l'aide à délier cette parole vitale comme on tient debout, survivant parmi les cadavres en putréfaction au milieu d'un charnier.
Est-ce ainsi que les hommes rêvent d'amour, apprivoisent le désir, rencontrent le sexe et les guerres puis en reviennent avec comme seul bagage la folie avant d'être anéantis par la mort ?
Le narrateur évoque l'horreur d'un monde, mais le monde n'est pas laid, ce sont les hommes qui s'en arrangent... À quoi tient la fabrique irrationnelle des dictatures, tandis que certains s'y soumettent de bonne grâce ?
Le cul de Judas, c'est la métamorphose d'un homme dans ce monde à la dérive. Un homme qui fut enfant, qui rêva devant les animaux d'un jardin zoologique de Benfica, peut-être fuyait-il déjà les injonctions de ses tantes lui intimant de devenir un homme, un vrai, grandir, partir là-bas jeté dans la poudrière de l'Angola, découvrir les lépreux, les ventres gonflés de faim des enfants immobiles, entrevoir le silence humide des cases, rêver aux corps d'autres femmes, se saigner les doigts sur des barbelés sanglants, enjamber les membres déchiquetés par les mines, être oublié avec les siens, trahi, se sentir passif, résigné, fautif peut-être...
Tout d'abord c'est une écriture au service d'une sidération, une écriture qui m'a envoûté.
C'est une écriture imbibée d'alcools, jonchée de plaies et de furoncles nauséabonds, qui traverse les nuits putrides et tente de comprendre la cruelle inutilité de la souffrance.
Cette écriture, c'est la langue d'António Lobo Antunes, âpre, baroque, sensuelle. Dans chaque mot j'ai senti le sang battre à mes tempes. J'ai vu des processions de fantômes se lever devant moi, des spectres couverts de gangrènes qui revenaient de ce trou perdu, là-bas, oubliés. J'ai entendu les plaintes des soldats agonisants qui reviennent comme des fantômes. J'ai deviné des ténèbres inhabitées, l'insomnie des morts, la peur et le dégoût, le rire répugnant des défunts qui continuera de poursuivre le narrateur du soir au matin jusque dans ses rêves. J'ai entrevu le désir dans des chambres sordides, des lits comme des naufrages, l'abandon des corps comme un remède fugitif à la douleur inexorable qui ne se refermera jamais...
Cette écriture m'a fait penser à celle de Faulkner, de Giono, de Louis-Ferdinand Céline...
Le cul de Judas, c'est une plongée en apnée.
C'est une écriture qui dit la misère et méchanceté obstinée de la guerre, la révolte qui dénonce les exactions d'un régime colonial, c'est une écriture tordue de douleurs, de résignation mais aussi d'indignation, c'est une écriture qui dit aussi l'impossibilité d'aimer.
J'ai vu cet homme d'un soir accroché au bastingage du comptoir, comme un naufragé bousculé par les tangages de sa mémoire, si incertain d'être encore en vie.
Et puis j'ai vu brusquement cette femme africaine, Sofia, qui se tenait debout devant lui, debout parmi les morts et les survivants, comme un soleil d'Afrique, ultime rêve d'un soir, d'une passion brûlée, anéantie, ensevelie dans les décombres du temps.
Cette écriture, comme un long poème en prose, est autant traversée de rage que de lumières.
Entrer dans le cul de Judas, c'est accepter de se perdre dans l'étrange labyrinthe du passé d'un homme qui n'en est jamais revenu.
J'y ai vu un magnifique plaidoyer contre les guerres, les régimes coloniaux, contre la bêtise humaine qui fabrique les dictatures, mais c'est aussi un hymne à l'amour dans cette Afrique miraculeuse, ardente et sacrifiée.
Le cul de Judas, c'est un cri.
Le titre en dit déjà long... Sans avoir versé dans les saintes écritures des Évangiles, j'avais déjà une vague idée de ce versant retors de l'humanité, voilà qu'une métaphore anatomique vient préciser l'endroit où veut nous entraîner l'auteur et nous donne ainsi le ton.
Entrer dans le cul de Judas, - pardonnez-moi l'expression imagée, c'est comme entrer dans un tableau de Jérôme Bosch avec les odeurs et les effluves qui viennent jusqu'à vous et vous emportent jusqu'au bout de la nuit.
Cet homme a besoin de parler, c'est comme une catharsis. Évoquer son séjour comme médecin en Angola. Parler de ses souvenirs, c'est comme évoquer un cauchemar horrible et destructeur dont on ne revient jamais indemne. Alors il invite cette femme, son interlocutrice d'un soir, dans un voyage à la fois cru et onirique, dans cette tendresse désespérée de la nuit où nous nous apprêtons à écouter son monologue comme des passagers clandestins.
Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin la source qui a inspiré ce livre : António Lobo Antunes a écrit le cul de Judas au cours des années qui ont suivi son retour, en 1973, de la guerre coloniale en Angola. Il y a passé vingt-sept mois, tout comme le narrateur, « vingt-sept mois d'esclavage sanglant », il en est revenu vieilli, cynique, désabusé, peut-être mort aussi, en tous cas naufragé à jamais, revenu d'une Afrique mise à feu et à sang, jeté ce soir sur le rivage de ce bar où l'alcool l'aide à délier cette parole vitale comme on tient debout, survivant parmi les cadavres en putréfaction au milieu d'un charnier.
Est-ce ainsi que les hommes rêvent d'amour, apprivoisent le désir, rencontrent le sexe et les guerres puis en reviennent avec comme seul bagage la folie avant d'être anéantis par la mort ?
Le narrateur évoque l'horreur d'un monde, mais le monde n'est pas laid, ce sont les hommes qui s'en arrangent... À quoi tient la fabrique irrationnelle des dictatures, tandis que certains s'y soumettent de bonne grâce ?
Le cul de Judas, c'est la métamorphose d'un homme dans ce monde à la dérive. Un homme qui fut enfant, qui rêva devant les animaux d'un jardin zoologique de Benfica, peut-être fuyait-il déjà les injonctions de ses tantes lui intimant de devenir un homme, un vrai, grandir, partir là-bas jeté dans la poudrière de l'Angola, découvrir les lépreux, les ventres gonflés de faim des enfants immobiles, entrevoir le silence humide des cases, rêver aux corps d'autres femmes, se saigner les doigts sur des barbelés sanglants, enjamber les membres déchiquetés par les mines, être oublié avec les siens, trahi, se sentir passif, résigné, fautif peut-être...
Tout d'abord c'est une écriture au service d'une sidération, une écriture qui m'a envoûté.
C'est une écriture imbibée d'alcools, jonchée de plaies et de furoncles nauséabonds, qui traverse les nuits putrides et tente de comprendre la cruelle inutilité de la souffrance.
Cette écriture, c'est la langue d'António Lobo Antunes, âpre, baroque, sensuelle. Dans chaque mot j'ai senti le sang battre à mes tempes. J'ai vu des processions de fantômes se lever devant moi, des spectres couverts de gangrènes qui revenaient de ce trou perdu, là-bas, oubliés. J'ai entendu les plaintes des soldats agonisants qui reviennent comme des fantômes. J'ai deviné des ténèbres inhabitées, l'insomnie des morts, la peur et le dégoût, le rire répugnant des défunts qui continuera de poursuivre le narrateur du soir au matin jusque dans ses rêves. J'ai entrevu le désir dans des chambres sordides, des lits comme des naufrages, l'abandon des corps comme un remède fugitif à la douleur inexorable qui ne se refermera jamais...
Cette écriture m'a fait penser à celle de Faulkner, de Giono, de Louis-Ferdinand Céline...
Le cul de Judas, c'est une plongée en apnée.
C'est une écriture qui dit la misère et méchanceté obstinée de la guerre, la révolte qui dénonce les exactions d'un régime colonial, c'est une écriture tordue de douleurs, de résignation mais aussi d'indignation, c'est une écriture qui dit aussi l'impossibilité d'aimer.
J'ai vu cet homme d'un soir accroché au bastingage du comptoir, comme un naufragé bousculé par les tangages de sa mémoire, si incertain d'être encore en vie.
Et puis j'ai vu brusquement cette femme africaine, Sofia, qui se tenait debout devant lui, debout parmi les morts et les survivants, comme un soleil d'Afrique, ultime rêve d'un soir, d'une passion brûlée, anéantie, ensevelie dans les décombres du temps.
Cette écriture, comme un long poème en prose, est autant traversée de rage que de lumières.
Entrer dans le cul de Judas, c'est accepter de se perdre dans l'étrange labyrinthe du passé d'un homme qui n'en est jamais revenu.
J'y ai vu un magnifique plaidoyer contre les guerres, les régimes coloniaux, contre la bêtise humaine qui fabrique les dictatures, mais c'est aussi un hymne à l'amour dans cette Afrique miraculeuse, ardente et sacrifiée.
Le cul de Judas, c'est un cri.
Après le pâté en croûte, la tourte aux patates, la tartiflette, la saucisse- aligot, vous reprendrez bien une part de kouign-amann avec une bonne louche de crème fraîche ?
Pour qualifier une telle succession de plats au demeurant goûteux, le premier terme me venant à l'esprit est indigeste.
C'est aussi celui qui s'impose à moi après avoir - très péniblement et laborieusement- avalé la dernière page du livre.
Mon taux de cholesterolitteraire vient d'en prendre un coup, il me faut d'urgence le faire redescendre avec une ordonnance d'une histoire bien ficelée, simple, distanciée et second degré, tel un San Antonio par exemple.
Cet ouvrage est lourdement verbeux, ou plutôt adjectiveux, le challenge devait être d'en placer un minimum de 150 par page, et de caser un maximum d'images comparatives bancales.
Avec ce roman quasi-illisible, l'auteur fait partie de ceux que je qualifie d'écrivain qui aime s'écouter écrire.
En convoquant régulièrement de grands auteurs et pléthore de poètes connus dans leur rue, Lobo Antunes étale bien sa culture et alourdit encore son œuvre.
Il doit aussi avoir été payé par le syndicat d'initiative de Lisbonne vu les très nombreuses références et descriptions de la ville et des alentours.
Après la forme, le fond.
L'idée de départ est originale, un long monologue de sa vie comme plan drague. Ceci dit les passages des scènes de sexe et les descriptions "littérateuses" des organes en question sont ennuyeuses à souhait.
Sa vie reste marquée par son expérience de jeune médecin envoyé de longs mois au front de la dernière sale guerre coloniale européenne en Angola dans les années 1970.
Lobo Antunes puise dans cette période traumatisante autobiographique des passages descriptifs très réalistes et puissants d'une guerre peu médiatique voire oubliée, ou tout au moins poussée sous le tapis.
Malheureusement le style surchargé et illisible rend le message inaudible.Un peu de sobriété n'aurait pas fait de mal pour appréhender pleinement le fond du roman.
Il semble que l'auteur n'était satisfait d'aucune des traductions française de ses oeuvres. Par respect de son avis je n'achèterai ni ne lirai plus aucune d'elles.
...Rarement été autant déçu d'un livre, survendu au demeurant...
Ce n'est pas parce qu' un roman évoque une expérience guerrière qu'il est forcément intouchable.
Une lecture éprouvante, un texte qui raconte l’incommensurable tristesse de la vieillesse.
Une ancienne actrice de théâtre vit à Lisbonne. Elle n’est pas seule et abandonnée, car une « femme d’un certain âge » vient s’occuper d’elle chaque jour et tout au long de son déclin, la faire manger, changer ses couches, etc.
Le roman place le lecteur dans les pensées des personnages. La septuagénaire démente, avec ses souvenirs, qui se mêlent, s’arrêtant tantôt sur la virgule d’une dictée de son institutrice du primaire, tantôt sur l’un de ses maris défunts ou de ses parents ou grands-parents. En parallèle, les mots du présent, les commentaires de la femme qui en prend soin ou du neveu qui administre ses biens, avec les cruelles interrogations sur le temps qui lui reste à vivre…
Tout n’est cependant pas morose, car loin de la réalité, la vieille dame sent son chat qui ronronne, elle se retrouve dans son village natal avec ses parents, elle n’est pas malheureuse.
C’est un long roman de 450 pages, long comme la lente agonie des personnes âgées atteintes de dégénérescence cognitive. Pas facile à lire, surtout si ça nous rappelle des gens de notre entourage dont l’esprit s’enfuit aussi.
Une ancienne actrice de théâtre vit à Lisbonne. Elle n’est pas seule et abandonnée, car une « femme d’un certain âge » vient s’occuper d’elle chaque jour et tout au long de son déclin, la faire manger, changer ses couches, etc.
Le roman place le lecteur dans les pensées des personnages. La septuagénaire démente, avec ses souvenirs, qui se mêlent, s’arrêtant tantôt sur la virgule d’une dictée de son institutrice du primaire, tantôt sur l’un de ses maris défunts ou de ses parents ou grands-parents. En parallèle, les mots du présent, les commentaires de la femme qui en prend soin ou du neveu qui administre ses biens, avec les cruelles interrogations sur le temps qui lui reste à vivre…
Tout n’est cependant pas morose, car loin de la réalité, la vieille dame sent son chat qui ronronne, elle se retrouve dans son village natal avec ses parents, elle n’est pas malheureuse.
C’est un long roman de 450 pages, long comme la lente agonie des personnes âgées atteintes de dégénérescence cognitive. Pas facile à lire, surtout si ça nous rappelle des gens de notre entourage dont l’esprit s’enfuit aussi.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Antonio Lobo Antunes
Lecteurs de Antonio Lobo Antunes (804)Voir plus
Quiz
Voir plus
L'écume des jours (de Cécile )
Qui a écrit : "L'écume des jours" ?
Boris Vian
Emile Zola
Guy de Maupassant
20 questions
522 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur522 lecteurs ont répondu