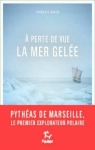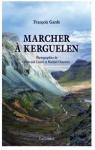Critiques de François Garde (380)
De toute évidence la survie chez un être très jeune mobilise toute son énergie jusqu'à le priver petit à petit à toute réactivité émotive affective, les sentiments s'assèchent et le privent de la réalité antérieure de son existence même et ou de son identité !
Une expérience passionnante de l'enfant Sauvage ! Narcisse désapprend pour s'adapter.
Ses besoins vitaux, comme boire et manger, l'aliènent au groupe pour sa survie jusqu'à le priver de son équilibre mental... meurtri de souffrances, ses ressources de résistance semblent verrouillées pour toujours ! et le secret des aborigènes reste bien gardé...
Quel beau sujet !!! Aux riches critiques.
Une expérience passionnante de l'enfant Sauvage ! Narcisse désapprend pour s'adapter.
Ses besoins vitaux, comme boire et manger, l'aliènent au groupe pour sa survie jusqu'à le priver de son équilibre mental... meurtri de souffrances, ses ressources de résistance semblent verrouillées pour toujours ! et le secret des aborigènes reste bien gardé...
Quel beau sujet !!! Aux riches critiques.
Premier roman tiré d'une histoire vraie, Ce qu'il advint du sauvage blanc apparaît comme un récit authentique et maîtrisé, à l'histoire attachante. Une alternance de point de vue (les yeux du sauvage blanc et de celui qui le recueille) qui contribue à éclairer l'histoire pour lui donner une nouvelle dimension. Un récit intéressant qui, malgré quelques longueurs, traite son sujet avec humanité et empathie. Un premier roman à découvrir pour sa réflexion sur la notion de civilisation et son, rapport à l'homme.
Lien : http://art-enciel.over-blog...
Lien : http://art-enciel.over-blog...
Milieu du XIXe siècle. Narcisse Pelletier, matelot, se retrouve seul sur une île du Pacifique suite à un malheureux concours de circonstance.
Octave de Vallombrun, voyageur et anthropologue avant l’heure, le recueille dix-sept ans plus tard et le ramène en France.
Narcisse a profondément changé. Il est devenu un « sauvage blanc » à qui il faut réapprendre la vie à l’occidentale.
Le récit alterne les aventures de Narcisse sur son île pas si déserte que ça et des lettres qu’écrit Octave au président de la Société de géographie pour expliquer l’évolution du sauvage. Une alternance entre le passé et le présent qui donne un rythme agréable au récit.
La survie sur une île déserte est un thème que j’apprécie particulièrement. En plus de nous offrir une robinsonnade, l’auteur traite des mentalités de l’époque sur la découverte de peuplades dites « sauvages », de l’exploitation de celles-ci et du mépris que les personnes dites érudites portent aux cultures trop différentes des leurs.
J’ai aimé ce livre pour sa vraisemblance, pour son suspens (on a très envie de savoir ce qu’il advint justement du sauvage blanc). Il se laisse lire avec plaisir grâce à sa fluidité et son écriture maîtrisée.
Je regrette le côté un peu trop lisse de l’histoire dû probablement au choix de nous faire connaître le retour de Narcisse par des lettres adressées à une personnalité éminente, ce procédé n’offrant pas beaucoup de spontanéité.
En conclusion, c’est un bon roman qui oscille entre aventures et réflexion.
Octave de Vallombrun, voyageur et anthropologue avant l’heure, le recueille dix-sept ans plus tard et le ramène en France.
Narcisse a profondément changé. Il est devenu un « sauvage blanc » à qui il faut réapprendre la vie à l’occidentale.
Le récit alterne les aventures de Narcisse sur son île pas si déserte que ça et des lettres qu’écrit Octave au président de la Société de géographie pour expliquer l’évolution du sauvage. Une alternance entre le passé et le présent qui donne un rythme agréable au récit.
La survie sur une île déserte est un thème que j’apprécie particulièrement. En plus de nous offrir une robinsonnade, l’auteur traite des mentalités de l’époque sur la découverte de peuplades dites « sauvages », de l’exploitation de celles-ci et du mépris que les personnes dites érudites portent aux cultures trop différentes des leurs.
J’ai aimé ce livre pour sa vraisemblance, pour son suspens (on a très envie de savoir ce qu’il advint justement du sauvage blanc). Il se laisse lire avec plaisir grâce à sa fluidité et son écriture maîtrisée.
Je regrette le côté un peu trop lisse de l’histoire dû probablement au choix de nous faire connaître le retour de Narcisse par des lettres adressées à une personnalité éminente, ce procédé n’offrant pas beaucoup de spontanéité.
En conclusion, c’est un bon roman qui oscille entre aventures et réflexion.
Le roman de François Garde, son tout premier, aussi difficile que cela soit à croire, eu égard à sa maîtrise narrative et à son style délié et très agréable, son roman, donc, s'intitule Ce qu'il advint du sauvage blanc et non Ce qu'il advint du blanc devenu sauvage. Ceci mérite explications. Le héros du livre est un marin, abandonné dans une baie australienne inhabitée, en 1843, et récupéré, par hasard, par l'équipage d'un navire anglais quelque 18 ans plus tard. Que s'est-il passé entre temps ? François Garde (ne) nous le raconte (pas) à travers deux récits qui se succèdent avec la régularité d'un métronome. D'une part, les premiers jours, solitaires, puis au sein d'une tribu de "sauvages" du matelot largué ; d'autre part, le compte-rendu d'un scientifique français qui a recueilli et apprivoisé ce même homme méconnaissable, incapable de s'exprimer (après sa réapparition) et amnésique (ou pas). Ce procédé de juxtaposition de deux époques, s'il se révèle agaçant dans bon nombre de romans, est ici subtilement dosé et ajoute un certain suspense à un livre qui ne s'essouffle jamais et possède bien d'autres qualités. La crainte de lire une énième resucée de Robinson Crusoé ou une nouvelle version de Kaspar Hauser s'évanouit vite. Rien à voir. Outre ses questionnements sur ce que représente l'identité, la différence, le langage et la liberté, ce roman d'aventures a toutes les vertus d'un ouvrage philosophique qui est aussi riche dans ce qu'il évoque et laisse imaginer, que dans ce qu'il décrit avec précision. Plusieurs chapitres se démarquent par leur ironie tranchante et leur humour ciselé, comme celui de la présentation du "bon sauvage" à l'assemblée de la Société de Géographie, ou encore l'entrevue avec l'impératrice Eugénie, elle-même. Le plus fort est que le livre ne fait qu'effleurer le mystère de ce que vécut ce blanc naufragé au contact des indigènes. Cela pourrait être frustrant pour le lecteur, ce n'en est que plus excitant pour son imagination.
Cet ouvrage n'est ni un récit de voyage, ni un roman historique écrit à partir de données biographiques tangibles. "Nous ne savons rien de Pythéas, sinon qu'il s'aventura au-delà du monde connu", explique François Garde. Il faut donc prendre ce livre pour ce qu'il est, c'est à dire une fiction construite autour d'un personnage sur lequel on ne dispose que des très peu d'informations. Toutefois, Pythéas, originaire de Marseille, a bel et bien existé au IVème siècle avent JC, et il a entrepris, sous couvert de faire du commerce, une, voire deux expéditions maritimes vers le Nord de l'Europe. Il aurait ainsi découvert l'Islande lors d'un premier voyage, et lors d'un second, les rivages de la mer Baltique riches en ambre. Il aurait également consigné ses observations en matière de géographie, océanographie et astronomie dans un traité, dont on n'a malheureusement pas retrouvé de traces formelles.
En écrivant ce récit, François Garde a souhaité, en utilisant un tutoiement amical, redonner vie à ce personnage méconnu et quasi-oublié de la la grande Histoire des conquêtes maritimes et de la mémoire collective. En se servant de connaissances désormais acquises sur le contexte historique de l'époque de Pythéas, l'auteur laisse libre cours à son imagination, inventant à son héros une famille, des amis, et le dotant d'une personnalité curieuse et attachante.
le lecteur savoure ainsi des pages d'écriture vivantes et colorées, à la fois sur les paysages maritimes des régions septentrionales de l'Europe, et sur le monde méditerranéen de cette époque de l'Antiquité.
En écrivant ce récit, François Garde a souhaité, en utilisant un tutoiement amical, redonner vie à ce personnage méconnu et quasi-oublié de la la grande Histoire des conquêtes maritimes et de la mémoire collective. En se servant de connaissances désormais acquises sur le contexte historique de l'époque de Pythéas, l'auteur laisse libre cours à son imagination, inventant à son héros une famille, des amis, et le dotant d'une personnalité curieuse et attachante.
le lecteur savoure ainsi des pages d'écriture vivantes et colorées, à la fois sur les paysages maritimes des régions septentrionales de l'Europe, et sur le monde méditerranéen de cette époque de l'Antiquité.
Monsieur le « vice roi des albatros, proconsul des îles froides, connétable des brumes, procurateur des manchots royaux » vous avez réalisé un de mes rêves : marcher à Kerguelen !
Je rêve de voir le « spectacle où la force du vent l’emporte sur la gravité, et où le ruisseau qui s’apprête à tomber est saisi dans son élan et renvoyé dans les nuages » … moi j’en rêve, vous vous l’avez fait !
Kerguelen est peut être un mirage, cette île où « Les espérances s’y fracassent, les rêves s’y dissipent, les ambitions y font naufrage » … mais vous Monsieur, vous vous êtes confronté à l’impossible !
À Kerguelen il n’y a qu’un seul produit d’exportation, le rêve … peut être et vous, Monsieur nous avez permis de partager le vôtre!
Une lecture où j’avais constamment recours à la carte pour comprendre ce parcours et découvrir ces cabanes où ce qu’il en reste !
Ce qu’on trouve dans ce livre …
La découverte d’un lieu au bout du bout du bout …
Une réflexion sur ce qui régit des individus qui ont décidé de poursuivre le même but …
Les pensées les plus intimes qui accompagnent ce cheminement au bout de soi-même
Kerguelen … j’en rêvais, vous l’avez fait !
Je rêve de voir le « spectacle où la force du vent l’emporte sur la gravité, et où le ruisseau qui s’apprête à tomber est saisi dans son élan et renvoyé dans les nuages » … moi j’en rêve, vous vous l’avez fait !
Kerguelen est peut être un mirage, cette île où « Les espérances s’y fracassent, les rêves s’y dissipent, les ambitions y font naufrage » … mais vous Monsieur, vous vous êtes confronté à l’impossible !
À Kerguelen il n’y a qu’un seul produit d’exportation, le rêve … peut être et vous, Monsieur nous avez permis de partager le vôtre!
Une lecture où j’avais constamment recours à la carte pour comprendre ce parcours et découvrir ces cabanes où ce qu’il en reste !
Ce qu’on trouve dans ce livre …
La découverte d’un lieu au bout du bout du bout …
Une réflexion sur ce qui régit des individus qui ont décidé de poursuivre le même but …
Les pensées les plus intimes qui accompagnent ce cheminement au bout de soi-même
Kerguelen … j’en rêvais, vous l’avez fait !
François Garde livre ici un roman historique intéressant qui permet d'en savoir plus sur Joachim Murat, illustre militaire du Premier Empire.
J'ai quelques notions sur les évènements de cette période, sans être un expert, loin de là même, mais je ne connaissais pas bien Murat. Ce livre est franchement bien écrit, passionnant et éclairant. Un petit chapitre final intitulé "postérité" permet à l'auteur de poser la frontière entre le roman et l'histoire en indiquant les points inventés et ceux avérés.
La matière pour faire un bon roman était là puisque celui-ci se déroule à une période riche de l'histoire (mais y-a-t-il des périodes pauvres dans l'histoire ?). L'auteur couvre toute la vie de Murat, ce qui est un bon point puisque l'on cerne de mieux en mieux le personnage et ses motivations ainsi que le contexte de certaines de ces décisions.
Quelques périodes historiques auraient éventuellement être un peu plus développées avec plus de détails sur le contexte, mais ce n'est pas bien grave puisque le lecteur pourra aller chercher des informations dans les nombreux ouvrages concernant cette période.
Après tout, c'est un roman, et non un livre d'histoire, qui concerne un illustre personnage que l'on retrouve bien au centre du roman tout au long de l'histoire.
Un bon roman historique donc, à l'écriture bien agréable. C'est écrit par un passionné d'histoire, cela se sent et cela donne envie de découvrir les autres ouvrages de l'auteur.
J'ai quelques notions sur les évènements de cette période, sans être un expert, loin de là même, mais je ne connaissais pas bien Murat. Ce livre est franchement bien écrit, passionnant et éclairant. Un petit chapitre final intitulé "postérité" permet à l'auteur de poser la frontière entre le roman et l'histoire en indiquant les points inventés et ceux avérés.
La matière pour faire un bon roman était là puisque celui-ci se déroule à une période riche de l'histoire (mais y-a-t-il des périodes pauvres dans l'histoire ?). L'auteur couvre toute la vie de Murat, ce qui est un bon point puisque l'on cerne de mieux en mieux le personnage et ses motivations ainsi que le contexte de certaines de ces décisions.
Quelques périodes historiques auraient éventuellement être un peu plus développées avec plus de détails sur le contexte, mais ce n'est pas bien grave puisque le lecteur pourra aller chercher des informations dans les nombreux ouvrages concernant cette période.
Après tout, c'est un roman, et non un livre d'histoire, qui concerne un illustre personnage que l'on retrouve bien au centre du roman tout au long de l'histoire.
Un bon roman historique donc, à l'écriture bien agréable. C'est écrit par un passionné d'histoire, cela se sent et cela donne envie de découvrir les autres ouvrages de l'auteur.
Narcisse Pelletier a tout juste 18 ans en 1843 quand le bateau sur lequel il est marin repart de cette baie isolée et inconnue d’Australie sans lui.
Il attend les secours jour après jour.
Puis c'est la rencontre avec une tribu aborigène qui le nourrira et l'intégrera peu à peu.
18 ans plus tard un bateau anglais découvre un homme blanc entièrement tatoué et totalement nu qui vit avec des aborigènes dans une partie de l'Australie non encore explorée.
Ils le captureront, s'ensuivra alors une enquête pour savoir qui il est et finir par découvrir qu'il n'est autre que Narcisse porté mort depuis 17 ans.
Octave de Vallombrun explorateur français pour le compte de la Société Géographique va le prendre en charge et le ramener à la civilisation.
Mais comment Narcisse qui a tout oublié de sa vie d'homme blanc va t-il le supporter lui qui ne se souvient de rien pas même de son prénom?
Ce livre dont chaque chapitre se compose de deux parties, l'une sur la vie de Narcisse en Australie parmi les aborigènes, l'autre sur les lettres d'Octave de Vallombrun à la Société Géographique sur les réactions de Narcisse replongé dans la vie à l'européenne nous oblige à nous poser la question : est-ce que ce que l'on croit le meilleur pour un homme n'est-il pas en réalité qu'une illusion ?
Il attend les secours jour après jour.
Puis c'est la rencontre avec une tribu aborigène qui le nourrira et l'intégrera peu à peu.
18 ans plus tard un bateau anglais découvre un homme blanc entièrement tatoué et totalement nu qui vit avec des aborigènes dans une partie de l'Australie non encore explorée.
Ils le captureront, s'ensuivra alors une enquête pour savoir qui il est et finir par découvrir qu'il n'est autre que Narcisse porté mort depuis 17 ans.
Octave de Vallombrun explorateur français pour le compte de la Société Géographique va le prendre en charge et le ramener à la civilisation.
Mais comment Narcisse qui a tout oublié de sa vie d'homme blanc va t-il le supporter lui qui ne se souvient de rien pas même de son prénom?
Ce livre dont chaque chapitre se compose de deux parties, l'une sur la vie de Narcisse en Australie parmi les aborigènes, l'autre sur les lettres d'Octave de Vallombrun à la Société Géographique sur les réactions de Narcisse replongé dans la vie à l'européenne nous oblige à nous poser la question : est-ce que ce que l'on croit le meilleur pour un homme n'est-il pas en réalité qu'une illusion ?
19ème siècle, un jeune matelot français embarqué sur la goélette Saint-Paul se voit vivre en Australie auprès d'aborigènes dont il ne connait rien; langue, coutumes, traditions, mode de vie.
Le choc des cultures est rude.
Style simple, construction du roman basique, une histoire qui s'essouffle.
Le choc des cultures est rude.
Style simple, construction du roman basique, une histoire qui s'essouffle.
Pour trois couronnes est très en dessous du premier roman de François Garde « ce qu’il advint du sauvage blanc »L.’auteur, haut fonctionnaire, connaît bien les Tropiques notamment la Nouvelle Calédonie. Son roman se passe à Bourg-Tapage, colonie imaginaire.Comme s’il avait peur de le situer dans une de ces villes coloniales qu’il connaît bien.Devoir de réserve ou crainte d’une interprétation trop précise de l’Histoire de nos Colonies. L’histoire est assez amusante mais peu crédible.Beaucoup de clichés et même quelques erreurs .L’hiver austral en janvier!
Toutes ces approximations, un style certes très bon mais qui manque de couleur pour une aventure tropicale. Un livre qui se disperse sur tous les continents.Je n’ai pas réussi à accrocher à cette enquête aventureuse à la recherche de l’histoire de ces fameuses trois couronnes.
Si vous voulez lire un bon livre e François Garde, sans hésitation, choisissez « ce qu’il advint du sauvage blanc »
Toutes ces approximations, un style certes très bon mais qui manque de couleur pour une aventure tropicale. Un livre qui se disperse sur tous les continents.Je n’ai pas réussi à accrocher à cette enquête aventureuse à la recherche de l’histoire de ces fameuses trois couronnes.
Si vous voulez lire un bon livre e François Garde, sans hésitation, choisissez « ce qu’il advint du sauvage blanc »
Inspiré d'une histoire vraie largement romancée, une fiction à 2 voix qui retrace l'extraordinaire destin d'un matelot vendéen devenu aborigène. Ce livre ouvre à réflexion et à polémique, mais évoque un phénomène fascinant : comment peut-on tout oublier de son éducation, de sa langue ? Octave, par son regard scientifique, détonne dans son époque raciste et prône plus d'humanisme, malgré ses défauts.
Lien : http://appuyezsurlatouchelec..
Lien : http://appuyezsurlatouchelec..
Un peu tirée par les cheveux, la trame du livre glisse vers une description assez juste des médias, de l'artificiel qui le gouverne, des victimes du "quart d'heure de célébrité" qui use et détruit nombre d'égos qui ne voient pas venir la fin de la récréation. Etre en haut de l'affiche contre son gré sans souffrir de surexposition médiatique et se faire virer juste parce que l'on a agi selon sa conscience, incroyable dans cet univers cynique, tel est l'aventure d'un musicien anonyme de l'Opéra de Paris.
La question est : Pourquoi ce chef d'orchestre fait-il le salut nazi en criant Heil Hitler en pleine représentation télévisée ? C'est le point de départ du roman, la question qui nous hante tout au long de l'ouvrage. La frustration liée à une réponse éventuelle va crescendo jusqu'au dénouement et à une explication pour le moins hasardeuse et qui ne justifiait pas cette plongée dans le Paris politico-médiatique et les affres (un peu naïves) du héros malgré lui. Il est trop gentil cet homme-là, il n'existe pas et même perdu dans son univers musical, on n'imagine pas un seul instant qu'un tel personnage puisse exister.
Roman frustrant qui ne répond pas aux attentes de son entame.
Dommage
La question est : Pourquoi ce chef d'orchestre fait-il le salut nazi en criant Heil Hitler en pleine représentation télévisée ? C'est le point de départ du roman, la question qui nous hante tout au long de l'ouvrage. La frustration liée à une réponse éventuelle va crescendo jusqu'au dénouement et à une explication pour le moins hasardeuse et qui ne justifiait pas cette plongée dans le Paris politico-médiatique et les affres (un peu naïves) du héros malgré lui. Il est trop gentil cet homme-là, il n'existe pas et même perdu dans son univers musical, on n'imagine pas un seul instant qu'un tel personnage puisse exister.
Roman frustrant qui ne répond pas aux attentes de son entame.
Dommage
En 1843, Narcisse Pelletier est un matelot de dix-huit ans, qui navigue sur la goélette Saint-Paul. Lors d'une escale sur une plage australienne pour aller chercher de l'eau, il s'éloigne du groupe puis découvre avec effroi que l'équipage n'a pas attendu son retour. Le bateau est reparti, le laissant abandonné sur une terre hostile…
Durant ses premières heures sur l'île, le jeune homme se pose de nombreuses questions. Tous les sentiments le traversent, de la colère à la peur, en passant par le désarroi le plus complet ou l'optimisme forcené. Il attend le retour de ses camarades ; comment pourraient-ils ne pas revenir le chercher ? Après plusieurs jours sans manger, livré à lui-même, il est soigné par une vieille femme « sauvage ». Une fois guéri, il découvre l'existence d'une tribu, d'une communauté entière, avec hommes, femmes et enfants. Il est en quelque sorte intégré à cette dernière, dans une relative indifférence. Dix-huit années passeront ainsi, avant que des marins anglais accostés sur l'île ne remarquent cet homme blanc évoluant au milieu des sauvages et ne l'emmènent sur leur bateau, le ramenant à Sydney. Pris en charge pour le gouverneur de la ville, il est confié à Octave de Vallombrun, un homme passionné de géographie. Patient, curieux et extrêmement tolérant envers Narcisse, il devient son protecteur, le ramène en France et tente de comprendre ce qu'il a vécu. Peu à peu, l'homme de science essaye de redonner sa véritable identité au « sauvage blanc » qu'il est devenu.
Chaque chapitre alterne le récit de ce qu'à vécu Narcisse sur l'île et des observations d'Octave. Le procédé narratif fonctionne parfaitement, créant un écho constant qui retient l'attention du lecteur tout au long du livre. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas lu un roman qui ne se passe pas au XXème siècle et je dois dire que cela m'a beaucoup dépaysé ! Parfois, lorsque des romanciers contemporains tentent d'écrire comme des auteurs du XIXème siècle, le résultat est surfait, la magie « ne prend pas ». Ici, on comprend pourquoi ce roman s'est vu attribuer le Goncourt du premier roman en 2012 ; l'illusion est parfaite, on est totalement transporté à l'époque des personnages. Récit d'un incroyable destin, Ce qu'il advint du sauvage blanc donne à réfléchir à de nombreuses thématiques, comme l'intégration, la curiosité de l'autre, la gestion des traumatismes, tout en divertissant, tant par l'aspect romanesque de l'histoire que par la verve de Narcisse et les situations cocasses qu'il provoque.
Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment en compagnie de ce sauvage blanc. Je vous le recommande vivement et remercie au passage la personne qui m'a offert ce livre !
Lien : http://manouselivre.com/quil..
Durant ses premières heures sur l'île, le jeune homme se pose de nombreuses questions. Tous les sentiments le traversent, de la colère à la peur, en passant par le désarroi le plus complet ou l'optimisme forcené. Il attend le retour de ses camarades ; comment pourraient-ils ne pas revenir le chercher ? Après plusieurs jours sans manger, livré à lui-même, il est soigné par une vieille femme « sauvage ». Une fois guéri, il découvre l'existence d'une tribu, d'une communauté entière, avec hommes, femmes et enfants. Il est en quelque sorte intégré à cette dernière, dans une relative indifférence. Dix-huit années passeront ainsi, avant que des marins anglais accostés sur l'île ne remarquent cet homme blanc évoluant au milieu des sauvages et ne l'emmènent sur leur bateau, le ramenant à Sydney. Pris en charge pour le gouverneur de la ville, il est confié à Octave de Vallombrun, un homme passionné de géographie. Patient, curieux et extrêmement tolérant envers Narcisse, il devient son protecteur, le ramène en France et tente de comprendre ce qu'il a vécu. Peu à peu, l'homme de science essaye de redonner sa véritable identité au « sauvage blanc » qu'il est devenu.
Chaque chapitre alterne le récit de ce qu'à vécu Narcisse sur l'île et des observations d'Octave. Le procédé narratif fonctionne parfaitement, créant un écho constant qui retient l'attention du lecteur tout au long du livre. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas lu un roman qui ne se passe pas au XXème siècle et je dois dire que cela m'a beaucoup dépaysé ! Parfois, lorsque des romanciers contemporains tentent d'écrire comme des auteurs du XIXème siècle, le résultat est surfait, la magie « ne prend pas ». Ici, on comprend pourquoi ce roman s'est vu attribuer le Goncourt du premier roman en 2012 ; l'illusion est parfaite, on est totalement transporté à l'époque des personnages. Récit d'un incroyable destin, Ce qu'il advint du sauvage blanc donne à réfléchir à de nombreuses thématiques, comme l'intégration, la curiosité de l'autre, la gestion des traumatismes, tout en divertissant, tant par l'aspect romanesque de l'histoire que par la verve de Narcisse et les situations cocasses qu'il provoque.
Vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment en compagnie de ce sauvage blanc. Je vous le recommande vivement et remercie au passage la personne qui m'a offert ce livre !
Lien : http://manouselivre.com/quil..
C'est un récit à deux voix. On alterne entre le récit de la vie de Narcisse parmi les sauvages et les rapports qu'Octave adresse au président de la Société de géographie, dans lesquels il consigne rigoureusement les étapes de la difficile réadaptation ou rééducation de celui qu'il considère à la fois comme un sujet d'étude et un élève.
Ce récit a pour point de départ une histoire vraie : Alphonse Narcisse Pierre Pelletier, né le 1er janvier 1844 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est retrouvé dix huit ans après son abandon sur une île d'Australie.
Cette histoire n'est pas sans rappeler un grand classique de l'aventure : Robinson Crusoé.
Présenté comme cela, ce livre semble avoir tout pour plaire. Mais, voilà, assez vite je me suis ennuyée. La partie Narcisse est très intéressante même si celui ci ne fait jamais récit de ses aventures. Dépaysement garanti sur cette île aride et ce groupe d’aborigènes hors du temps. Concernant la partie d'Octave, je n'ai pas accroché. C'est monotone et cela ne nous apprend pas grand chose sur la réinsertion de Narcisse. Il est décrit comme silencieux, toujours hors norme de part son comportement, s'adaptant sans s'adapter au monde moderne. La fin du livre est bizarre : Narcisse a disparu. Est il retourné sur son île ? J'aimerais le croire mais d'après les articles sur internet, il a mené une vie normale.
Cela me laisse un goût d'inachevé.
Lien : http://jelisquoi.blogspot.fr..
Ce récit a pour point de départ une histoire vraie : Alphonse Narcisse Pierre Pelletier, né le 1er janvier 1844 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie est retrouvé dix huit ans après son abandon sur une île d'Australie.
Cette histoire n'est pas sans rappeler un grand classique de l'aventure : Robinson Crusoé.
Présenté comme cela, ce livre semble avoir tout pour plaire. Mais, voilà, assez vite je me suis ennuyée. La partie Narcisse est très intéressante même si celui ci ne fait jamais récit de ses aventures. Dépaysement garanti sur cette île aride et ce groupe d’aborigènes hors du temps. Concernant la partie d'Octave, je n'ai pas accroché. C'est monotone et cela ne nous apprend pas grand chose sur la réinsertion de Narcisse. Il est décrit comme silencieux, toujours hors norme de part son comportement, s'adaptant sans s'adapter au monde moderne. La fin du livre est bizarre : Narcisse a disparu. Est il retourné sur son île ? J'aimerais le croire mais d'après les articles sur internet, il a mené une vie normale.
Cela me laisse un goût d'inachevé.
Lien : http://jelisquoi.blogspot.fr..
C'est l'alternance de ces deux récits qui fait la force de ce roman. Les romans se déroulant en partie sur des bateaux me rebutent, je ne m'en explique pas la raison, mais c'est ainsi. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Narcisse est un personnage taciturne mais silencieux. Si François Garde saupoudre quelques touches comiques, il ne fait pas de Narcisse un phénomène de foire et il le rend très touchant. Bien sûr, le thème du sauvage déraciné a été traité, celui du blanc qui devient sauvage aussi mais celui du blanc forcé de s'adapter à la vie sauvage et qui revient de force à la "civilisation" ne me semble pas l'avoir été beaucoup. Et la découverte, vers la fin du roman, d'un élément important de sa vie interroge le lecteur et le met mal à l'aise par rapport au parcours suivi. C'est un roman qui avait toutes les chances de me déplaire et qui m'a beaucoup plu.
Descendus sur une île australienne pour chercher de l'eau, des marins ont la surprise de découvrir parmi les sauvages un Blanc nu et tatoué qui parle leur langage. Ils l'emmènent à leur bord où il reste prostré. Que va-t-on faire du « sauvage blanc »?
On découvre qu'il est sans doute Français et a passé dix-huit ans en compagnie des aborigènes. Un jeune savant, Octave de Vallombrun, va le prendre en charge. Le « sauvage blanc » livrera-t-il ses secrets à la société de géographie? Redeviendra-t-il un être civilisé?
Le récit est composé d'une alternance de chapitres pris en charge par un narrateur extérieur et consacrés à la vie de Narcisse (puisque tel est son nom) sur l'île, et d'autres présentés sous forme de lettres adressées par Octave au président de la société de géographie, qui ne nous donnent que sa vision, le président ne répondant jamais.
Le roman est frustrant en ce sens que nous ne saurons rien, ou presque, de la vie de Narcisse pendant ces dix-huit années. Nous n'en connaissons que les débuts, parfois d'une brutalité inouïe. Etait-il prisonnier de la tribu ou bien heureux avec elle? Le doute reste permis.
Cette œuvre est instructive et passionnante, très bien écrite, mais le lecteur restera seul face aux questions qu'il se pose.
On découvre qu'il est sans doute Français et a passé dix-huit ans en compagnie des aborigènes. Un jeune savant, Octave de Vallombrun, va le prendre en charge. Le « sauvage blanc » livrera-t-il ses secrets à la société de géographie? Redeviendra-t-il un être civilisé?
Le récit est composé d'une alternance de chapitres pris en charge par un narrateur extérieur et consacrés à la vie de Narcisse (puisque tel est son nom) sur l'île, et d'autres présentés sous forme de lettres adressées par Octave au président de la société de géographie, qui ne nous donnent que sa vision, le président ne répondant jamais.
Le roman est frustrant en ce sens que nous ne saurons rien, ou presque, de la vie de Narcisse pendant ces dix-huit années. Nous n'en connaissons que les débuts, parfois d'une brutalité inouïe. Etait-il prisonnier de la tribu ou bien heureux avec elle? Le doute reste permis.
Cette œuvre est instructive et passionnante, très bien écrite, mais le lecteur restera seul face aux questions qu'il se pose.
Comment l'Impératrice Eugénie, en la roseraie de Compiègne, entourée de ses dames dont la Princesse Pauline Metternich, réussit-elle à capter l'esprit, l'âme, les souvenirs de Narcisse Pelletier ? C'est seulement en face d'elle qu'il va laisser échapper des bribes de son passé.
Nous sommes en 1861 et le comte Octave de Vallombrun, féru de science et plus particulièrement d'anthropologie, fait à l'Impératrice le plaisir de lui amener un homme d'une trentaine d'années, convenablement vêtu et s'exprimant en un français sommaire mais correct après des mois de ré-apprentissage. Cet homme peu disert est Narcisse Pelletier, rapatrié d'Australie il y a quelques mois après un séjour de dix-huit ans au milieu de « sauvages » de la côte australienne. Pris en charge par Octave, il a appris un peu de français et « se civilise », de retour dans ce qui fut autrefois sa famille de Saint-Gilles-de-vie.
Le livre est construit selon deux narrations : celle, au jour le jour, du matelot Narcisse Pelletier, oublié par ses pairs puis abandonné sur une côte inconnue, et celle, sous forme de lettres adressées au Président de la Société de Géographie par Octave, voyageur et précurseur des anthropologues, ethnologues de la fin du 19ème siècle.
L'histoire vécue par Narcisse s'inspire d'un fait réel, celui de la découverte d'un « sauvage blanc » probablement intégré dans un milieu aborigène en Australie. Outre l'aspect pittoresque, instructif et émouvant du livre, c'est le débat scientifique qui s'instaure qui retient l'attention et les problèmes éthiques qui en découlent : jusqu'où peut-on aller au nom de la science ? Quelle déontologie doit-on appliquer face à des découvertes qui mettent en jeu la liberté et la dignité de « sujets » d'étude ?
En cette époque où la recherche ethnologique était balbutiante, le principal acteur, qu'on n'a pas trop envie de qualifier de « chercheur » au sens moderne du terme, se pose mille questions, tâtonne, se fourvoie, blesse son « sujet » et suscite jalousie, ricanements et scepticisme chez ses pairs. L'ambiance entre scientifiques, déjà à l'époque, était apparemment un peu sulfureuse...
Un livre intelligent, sensible, déconcertant.
Nous sommes en 1861 et le comte Octave de Vallombrun, féru de science et plus particulièrement d'anthropologie, fait à l'Impératrice le plaisir de lui amener un homme d'une trentaine d'années, convenablement vêtu et s'exprimant en un français sommaire mais correct après des mois de ré-apprentissage. Cet homme peu disert est Narcisse Pelletier, rapatrié d'Australie il y a quelques mois après un séjour de dix-huit ans au milieu de « sauvages » de la côte australienne. Pris en charge par Octave, il a appris un peu de français et « se civilise », de retour dans ce qui fut autrefois sa famille de Saint-Gilles-de-vie.
Le livre est construit selon deux narrations : celle, au jour le jour, du matelot Narcisse Pelletier, oublié par ses pairs puis abandonné sur une côte inconnue, et celle, sous forme de lettres adressées au Président de la Société de Géographie par Octave, voyageur et précurseur des anthropologues, ethnologues de la fin du 19ème siècle.
L'histoire vécue par Narcisse s'inspire d'un fait réel, celui de la découverte d'un « sauvage blanc » probablement intégré dans un milieu aborigène en Australie. Outre l'aspect pittoresque, instructif et émouvant du livre, c'est le débat scientifique qui s'instaure qui retient l'attention et les problèmes éthiques qui en découlent : jusqu'où peut-on aller au nom de la science ? Quelle déontologie doit-on appliquer face à des découvertes qui mettent en jeu la liberté et la dignité de « sujets » d'étude ?
En cette époque où la recherche ethnologique était balbutiante, le principal acteur, qu'on n'a pas trop envie de qualifier de « chercheur » au sens moderne du terme, se pose mille questions, tâtonne, se fourvoie, blesse son « sujet » et suscite jalousie, ricanements et scepticisme chez ses pairs. L'ambiance entre scientifiques, déjà à l'époque, était apparemment un peu sulfureuse...
Un livre intelligent, sensible, déconcertant.
Bof. On aurait voulu y croire. Mais quelque chose, d’immatériel, fait que l’on décroche assez rapidement. On aurait voulu y croire. Mais on finit par s’en foutre de ce qu’il advint de ce sauvage blanc, par moment attendrissant, mais pas assez pour qu’on puisse l’écouter sans bailler.
L’écriture est claire, limpide. Il n’y a rien à dire. C’est écrit en bon français. Mais est-ce cela qui fait les bons romans ? Il manque la niaque de ce qui qui a tout à perdre, tout à gagner. Il y a bien le vent, les alizées, mais ça ressemble à un décor de carton pâte. On n’y croit pas.
Et on ne peut pas dire que les français ne savent pas écrire des histoires de marins. Il n’y a qu’à lire Daniel Vaxelaire et son « les mutins de la liberté » édition phébus pour s’en convaincre.
Mais là… C’est au creux de la vague que l’auteur à puiser son inspiration et il y a jeté son ancre.
L’écriture est claire, limpide. Il n’y a rien à dire. C’est écrit en bon français. Mais est-ce cela qui fait les bons romans ? Il manque la niaque de ce qui qui a tout à perdre, tout à gagner. Il y a bien le vent, les alizées, mais ça ressemble à un décor de carton pâte. On n’y croit pas.
Et on ne peut pas dire que les français ne savent pas écrire des histoires de marins. Il n’y a qu’à lire Daniel Vaxelaire et son « les mutins de la liberté » édition phébus pour s’en convaincre.
Mais là… C’est au creux de la vague que l’auteur à puiser son inspiration et il y a jeté son ancre.
Très déçue par ce livre que j'avais pourtant hâte de découvrir. François Garde prend énormément de libertés avec la vraie histoire de Narcisse Pelletier et sa description de la tribu aborigène qui l'a adoptée est totalement imaginaire. L'auteur a admis lui-même plus tard (après avoir reçu son prix...) qu'il ne s'était pas renseigné sur elle. Il n'a même pas lu le vrai témoignage de Narcisse lui-même, ne cite pas le livre en question "Chez les sauvages (...)" de Constant Merland. Un comble. Aurait-il eu son prix Goucourt s'il s'était donné la peine de préciser tout cela?
Le vrai Narcisse Pelletier n'avait que 14 ans quand il fut abandonné sur la plage (et non 18), et a beaucoup témoigné sur son histoire. Rongé par la solitude et la faim, il surmonta ses craintes et suivi des femmes aborigènes. Le chef de la tribu en question décida qu'il n'était pas dangereux et l'adopta car il n'avait pas d'enfants. Narcisse étant d'une nature plutôt conciliante s'intégra rapidement. Le neveu du chef, qui avait son âge, lui enseigna leurs coutumes et tout ce qu'il devait savoir. Voilà, de façon très résumée, comment le vrai Narcisse Pelletier s'est retrouvé avec des "sauvages".
Car c'est bien la description des aborigènes faite par François Garde qui est indigne. J'ai très vite eu des doutes à la lecture du livre sur les quelques passages qui mettent en scène le jeune mousse et les aborigènes. Leur comportement était plus qu'étrange; ils le sauvent d'une mort certaine, puis le repoussent. Ils acceptent sa présence, mais l'ignorent totalement. Les "sauvages" de ce livre vont jusqu'à commettre un viol publiquement, sans que personne n'y prête la moindre attention... Leur sexualité se pratique au sus et à la vue de tous. L'auteur de cette fiction (le mot est laché !) confond nudité et sexualité.
Narcisse n'est pas en reste niveau bizarrerie du comportement: il les suit mais leur crie dessus, les insulte, va jusqu'à frapper un gamin sans qu'aucun membre du clan n'intervienne ni ne réagisse. Ils semblent tous complètement lobotomisés, apathiques.
Je vous invite à lire la critique d'un vrai connaisseur de cette histoire mise en lien ci dessous.
Lien : http://www.sogip.ehess.fr/sp..
Le vrai Narcisse Pelletier n'avait que 14 ans quand il fut abandonné sur la plage (et non 18), et a beaucoup témoigné sur son histoire. Rongé par la solitude et la faim, il surmonta ses craintes et suivi des femmes aborigènes. Le chef de la tribu en question décida qu'il n'était pas dangereux et l'adopta car il n'avait pas d'enfants. Narcisse étant d'une nature plutôt conciliante s'intégra rapidement. Le neveu du chef, qui avait son âge, lui enseigna leurs coutumes et tout ce qu'il devait savoir. Voilà, de façon très résumée, comment le vrai Narcisse Pelletier s'est retrouvé avec des "sauvages".
Car c'est bien la description des aborigènes faite par François Garde qui est indigne. J'ai très vite eu des doutes à la lecture du livre sur les quelques passages qui mettent en scène le jeune mousse et les aborigènes. Leur comportement était plus qu'étrange; ils le sauvent d'une mort certaine, puis le repoussent. Ils acceptent sa présence, mais l'ignorent totalement. Les "sauvages" de ce livre vont jusqu'à commettre un viol publiquement, sans que personne n'y prête la moindre attention... Leur sexualité se pratique au sus et à la vue de tous. L'auteur de cette fiction (le mot est laché !) confond nudité et sexualité.
Narcisse n'est pas en reste niveau bizarrerie du comportement: il les suit mais leur crie dessus, les insulte, va jusqu'à frapper un gamin sans qu'aucun membre du clan n'intervienne ni ne réagisse. Ils semblent tous complètement lobotomisés, apathiques.
Je vous invite à lire la critique d'un vrai connaisseur de cette histoire mise en lien ci dessous.
Lien : http://www.sogip.ehess.fr/sp..
Ce qu'il advint du sauvage blanc, prix Goncourt du premier roman, a révélé le talent singulier de François Garde, dans un domaine pas si fréquenté que cela, le roman d'aventures mâtiné de sagesse philosophique et de quête identitaire. Avec Pour trois couronnes, l'auteur renouvelle sa mise, avec un bonheur certain. Le livre parait certes moins original que son précédent mais n'est-ce pas simplement parce que l'effet de surprise ne joue plus ? Le roman débute avec un mystère et l'on croit s'embarquer pour un thriller au long cours. Oui, mais non. S'il y a bien enquête, à la recherche d'un possible enfant caché, en des terres tropicales et exotiques, qui plus est, Garde prend son temps, il n'est pas un auteur de l'urgence, tire le portrait de nombreux personnages secondaires, s'autorise des digressions, bref, il vagabonde quelque peu, dans un style coulé et une érudition jamais prise en défaut. Mais il ne perd pas pour autant de vue le secret initial qui lui permet d'évoquer une myriade de thèmes adjacents : la filiation, l'identité, la réussite ou l'échec d'une vie, le hasard et la nécessité, les effets de la décolonisation, l'émollient climat des contrées équatoriales, le venin des rumeurs dans un microcosme ilien. On en passe et des meilleurs. Plutôt que de caracoler comme dans un polar basique, Pour trois couronnes est aussi un espace de méditation avec son alternance de moments de révélations et de réflexions plus ou moins philosophiques. Et tout cela donne un excellent roman mené avec brio et délectation.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Musique & Littérature
BiblioJoy
60 livres
Auteurs proches de François Garde
Quiz
Voir plus
Ce qu'il advint du sauvage blanc
Pour François Garde, ce livre est son
1er ouvrage
3ème ouvrage
5ème ouvrage
7ème ouvrage
8 questions
131 lecteurs ont répondu
Thème : Ce qu'il advint du sauvage blanc de
François GardeCréer un quiz sur cet auteur131 lecteurs ont répondu