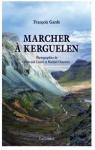Critiques de François Garde (379)
Narcisse Pelletier, jeune marin breton, est abandonné par le capitaine du navire sur lequel il opère comme mousse. Recueilli par une tribu aborigène, il va vivre 18 ans en leur compagnie, avant d'être aperçu par l'équipage d'un navire anglais et "ramené à la civilisation".
François Garde récupère un fait divers historique pour élaborer une fiction. Du simple fait historique, il tire un questionnement sur le rapport à autrui, au niveau inividuel, mais aussi sociétal, voire scientifique.
Narcisse Pelletier a donc bien existé. Il est effectivement resté 18 ans dans la jungle australienne à désapprendre les habitudes françaises et à apprendre les techniques de survie aborigènes. A se faire tatouer. A apprendre un langage, et désapprendre le français... Puis il a dû refaire tout le trajet dans l'autre sens, une fois ramené en France. On devine qu'il a été l'objet d'une curiosité malsaine, intéressée, ou scientifique (ce qui n'exclut pas les deux autres adjectifs).
François Garde imagine Octave de Vallombrun, jeune géographe exalté qui prend Narcisse Pelletier sous son aile et essaie de tirer des enseignements de ses observations. Le personnages d'Octave de Vallombrun est (à mon avis) le personnage central du roman. Ses fièvres exploratoires, ses emportements, ses errements scientifiques, tout cela est très bien amené et rendu par l'auteur. On voit les apprentissages de Narcisse Pelletier quand il revient en France au travers d'Octave. Par contre, les passages où on suit Narcisse aux prises avec sa vie d'aborigène, m'ont semblé moins intéressants (voire moins crédibles, ce qui est un comble).
Le fait que le vrai Narcisse ait été abandonné à 14 ans alors que François Garde modifie l'âge et donne 18 ans à son héros, cela m'a gêné. Je pense que le twist est problématique. A 18 ans, Narcisse aurait dû (à mon avis) être davantage formaté qu'à 14 ans (même en 1860). Cela m'a un peu empêché de m'immerger complètement dans le récit.
Reste une très belle langue française adéquatement utilisée au service d'une histoire séduisante.
François Garde récupère un fait divers historique pour élaborer une fiction. Du simple fait historique, il tire un questionnement sur le rapport à autrui, au niveau inividuel, mais aussi sociétal, voire scientifique.
Narcisse Pelletier a donc bien existé. Il est effectivement resté 18 ans dans la jungle australienne à désapprendre les habitudes françaises et à apprendre les techniques de survie aborigènes. A se faire tatouer. A apprendre un langage, et désapprendre le français... Puis il a dû refaire tout le trajet dans l'autre sens, une fois ramené en France. On devine qu'il a été l'objet d'une curiosité malsaine, intéressée, ou scientifique (ce qui n'exclut pas les deux autres adjectifs).
François Garde imagine Octave de Vallombrun, jeune géographe exalté qui prend Narcisse Pelletier sous son aile et essaie de tirer des enseignements de ses observations. Le personnages d'Octave de Vallombrun est (à mon avis) le personnage central du roman. Ses fièvres exploratoires, ses emportements, ses errements scientifiques, tout cela est très bien amené et rendu par l'auteur. On voit les apprentissages de Narcisse Pelletier quand il revient en France au travers d'Octave. Par contre, les passages où on suit Narcisse aux prises avec sa vie d'aborigène, m'ont semblé moins intéressants (voire moins crédibles, ce qui est un comble).
Le fait que le vrai Narcisse ait été abandonné à 14 ans alors que François Garde modifie l'âge et donne 18 ans à son héros, cela m'a gêné. Je pense que le twist est problématique. A 18 ans, Narcisse aurait dû (à mon avis) être davantage formaté qu'à 14 ans (même en 1860). Cela m'a un peu empêché de m'immerger complètement dans le récit.
Reste une très belle langue française adéquatement utilisée au service d'une histoire séduisante.
L'Effroi, même pas peur ! Bon, je suis d'accord, elle est facile ! Tout ça pour dire que je ne suis pas parvenue à entrer dans la peau de ce pauvre altiste, que j'ai trouvé l'enchaînement des faits invraisemblable, les motivations, réactions et ratiocinations des uns et des autres convenues, peu naturelles. Le récit est comme lissé, alors que le clash de départ était à même d'enfanter une fable moderne sur tous nos travers actuels : la communication de crise, le marketing institutionnel, l'emprise de l'univers médiatique, moloch jamais repu, dévorant chaque jour les proies que ses fidèles lui offrent en sacrifice, le sacrifié marchant d'ailleurs de lui-même au sacrifice ! Oui, l'outrance aurait été bienvenue, mais non cette retenue de bon aloi, qui fait que la famille elle-même du héros fait de la figuration : pas de crise de nerfs de l'épouse trompée, pas de révolte des adolescents, et des fanatiques qui rentrent dans le rang au premier coup de semonce. Une distorsion me semble-t-il entre l'idée et la réalisation.
Certaines destinées sont plus grandes que les hommes qui les vivent. C’est le cas de Narcisse Pelletier. La vie du moussaillon échoué sur une plage d’Australie en 1861 va au-delà des événements, les dépasse.
Ça démarre par un manque d’eau sur la goélette Saint Paul ; une chaloupe à la mer pour que les marins partent à recherche d’une rivière, d’une mare… point d’eau. Quand Narcisse revient sur la plage, il découvre que pour des raisons floues le bateau est reparti l’abandonnant là. Au terme de quelques jours d’errance, il se trouve aux portes de la mort par déshydratation quand il est sauvé par une très vieille aborigène nue.
Le récit fait alors un bon de 17 ans et on retrouve Narcisse, capturé par des marins alors qu’il ramassait des coquillages en compagnie de sa tribu, identifié différents des autres, il est « sauvé » et pris en charge par un membre éminent de la Société de Géographie française, Octave de Vallombrun. Ce voyageur fortuné après avoir traversé la moitié du monde, envisage la rééducation de Narcisse comme une mission ethnologique pour comprendre les us et coutumes des aborigènes australiens.
C’est là que le récit devient passionnant car Narcisse ne livrera rien de sa vie avec sa tribu. Il vit au présent, c’est la condition de sa survie ici et ailleurs. Il ne se rebelle pas, il s’adapte. La narration divisée en deux parties met en miroir deux facettes de l’adaptation de Narcisse. Un chapitre raconte l’étrange intégration de Narcisse au sein de la tribu, un autre relate son difficile réapprentissage de la vie occidentale. Au fil des chapitres on se demande qui apprend le plus de l’autre, Narcisse ou Octave ? qui est le plus « humain » ? A travers les silences de Narcisse, sa simplicité, son naturel et sa capacité d’adaptation Octave découvre - ce que le XIX° siècle veut gommer - que l’homme blanc n’est pas au sommet d’une pyramide, que ce qu’il nomme sauvage dispose de valeurs souvent bien supérieures aux siennes.
Un récit jamais caricatural, tout en finesse qui nous conduit aux confins de la nature humaine ; qui remet en question la colonisation du monde par une seule vision de l’univers, en pensant n’avoir rien à apprendre des autres cultures, l’occident ne devient-il pas le grand sauvage de l’histoire. Savons-nous ce que nous avons perdu en anéantissant les cultures dites sauvages ?
Ça démarre par un manque d’eau sur la goélette Saint Paul ; une chaloupe à la mer pour que les marins partent à recherche d’une rivière, d’une mare… point d’eau. Quand Narcisse revient sur la plage, il découvre que pour des raisons floues le bateau est reparti l’abandonnant là. Au terme de quelques jours d’errance, il se trouve aux portes de la mort par déshydratation quand il est sauvé par une très vieille aborigène nue.
Le récit fait alors un bon de 17 ans et on retrouve Narcisse, capturé par des marins alors qu’il ramassait des coquillages en compagnie de sa tribu, identifié différents des autres, il est « sauvé » et pris en charge par un membre éminent de la Société de Géographie française, Octave de Vallombrun. Ce voyageur fortuné après avoir traversé la moitié du monde, envisage la rééducation de Narcisse comme une mission ethnologique pour comprendre les us et coutumes des aborigènes australiens.
C’est là que le récit devient passionnant car Narcisse ne livrera rien de sa vie avec sa tribu. Il vit au présent, c’est la condition de sa survie ici et ailleurs. Il ne se rebelle pas, il s’adapte. La narration divisée en deux parties met en miroir deux facettes de l’adaptation de Narcisse. Un chapitre raconte l’étrange intégration de Narcisse au sein de la tribu, un autre relate son difficile réapprentissage de la vie occidentale. Au fil des chapitres on se demande qui apprend le plus de l’autre, Narcisse ou Octave ? qui est le plus « humain » ? A travers les silences de Narcisse, sa simplicité, son naturel et sa capacité d’adaptation Octave découvre - ce que le XIX° siècle veut gommer - que l’homme blanc n’est pas au sommet d’une pyramide, que ce qu’il nomme sauvage dispose de valeurs souvent bien supérieures aux siennes.
Un récit jamais caricatural, tout en finesse qui nous conduit aux confins de la nature humaine ; qui remet en question la colonisation du monde par une seule vision de l’univers, en pensant n’avoir rien à apprendre des autres cultures, l’occident ne devient-il pas le grand sauvage de l’histoire. Savons-nous ce que nous avons perdu en anéantissant les cultures dites sauvages ?
Dans ce livre qui n'est ni un roman, ni un livre scientifique, ni un documentaire, l'auteur de façon très originale et très plaisante nous aide à méditer sur le sort du vivant. Si comme pour moi, la baleine représente plus qu'un animal , plus qu'un mythe, laissez vous entraîner dans les questionnements, les digressions, les rêveries de François GARDE on en sort plus fort pour défendre l'humanité dans son environnement.
Je dois reconnaître que je sors de la lecture de ce roman de François Garde avec un sentiment mitigé. Parmi les points positifs, une entame particulièrement réussie, un sentiment de dépaysement et d’aventure lors de la lecture, et une très belle écriture. En revanche, j’ai trouvé que l’enquête s’enlisait à un moment donné, que certains passages n’amenaient pas grand-chose… et j’ai aussi été un peu perturbé par l’existence, au milieu du monde tel que nous le connaissons, de cette île tropicale fictive avec pour capitale Bourg-Tapage, dans laquelle se déroule une grande partie de l’histoire. Enfin, je n’ai pas vraiment vu l’intérêt des digressions du narrateur concernant les relations avec son propre père.
En dépit de cet avis un peu partagé, je compte bien persévérer dans ma découverte des romans de François Garde, et, suivant les précieux conseils qui me sont donnés, j’inscris sur ma (longue) liste de livres à lire le précédent roman de François Garde, « ce qu’il advint du sauvage blanc »…
En dépit de cet avis un peu partagé, je compte bien persévérer dans ma découverte des romans de François Garde, et, suivant les précieux conseils qui me sont donnés, j’inscris sur ma (longue) liste de livres à lire le précédent roman de François Garde, « ce qu’il advint du sauvage blanc »…
ISBN 9782070453207
ATTENTION ! SPOILERS ! ;o)
"Ce Qu'Il Advint Du Sauvage Blanc" est une biographie (largement) romancée, inspirée de la tragique aventure de Narcisse Pelletier, un marin vendéen qui passa dix-sept années de son existence dans une tribu aborigène d'Australie. Je vous recommande de lire la page Wikipedia - la page anglaise est évidemment plus complète - sur le sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_Pelletier
Vous le savez, j'ai en général la plus grande méfiance pour les biographies de ce type. Mais là, je ne pouvais pas y couper, ma fille cadette m'ayant demandé de lui dire ce que je pensais de ce livre, qu'elle étudie en classe de 1ère L.
Je l'ai donc lu.
Le texte se répartit en dix-sept chapitres et seize lettres, ces dernières étant numérotées en chiffres romains. Les chapitres sont essentiellement consacrés à la vie de Pelletier, les lettres (sauf les deux dernières) aux "rapports" qu'envoie périodiquement Octave de Vallombrun au président de la Société de Géographie, à Paris. Lorsque l'on a ramené Narcisse à la civilisation, le gouverneur de Sydney a en effet eu l'idée de demander à certaines de ses connaissances de lui adresser la parole, afin de voir si, oui ou non, le naufragé était un vrai muet ou s'il se rappelait tout de même quelques rudiments de sa langue natale. Or, c'est en entendant les phrases françaises de Vallombrun que Narcisse a réagi. Du coup, le gouverneur, bien content de se débarrasser à si bon compte de son "Sauvage blanc", l'a confié à Vallombrun, à charge pour ce dernier de lui réapprendre un peu les usages et d'éclaircir au maximum sa situation.
Passionné de cartographie et de géographie, Vallombrun, après quelques hésitations, a sauté sur l'occasion. Il est en effet un correspondant assez modeste de la Société de Géographie de Paris et entretient, nous l'avons dit plus haut, d'excellentes relations avec son président. Dans les lettres qu'il lui adresse, Vallombrun raconte ses espoirs, ses déceptions (remettre Narcisse "en état" n'est pas une mince affaire) puis, lorsque Narcisse est apte à retrouver les siens, tous les incidents qui jalonnent leur retour commun en France : Narcisse avec les femmes, Narcisse sympathisant, on ne sait par quel miracle, avec l'Impératrice Eugénie - nous sommes sous le Second Empire - et évoquant pour la première fois devant elle ce que fut sa vie sur l'île où il s'était retrouvé naufragé, les retrouvailles de Narcisse avec sa famille, en Vendée, le poste de gardien-assistant que l'Impératrice lui a fait donner ensuite au Phare des Baleines et puis, en dernier, après que Vallombrun ait tenté, sans le savoir, une espèce de régression à la Freud pour obtenir enfin de Narcisse qu'il lui parle de sa vie "là-bas", la disparition, brutale et inexpliquée (le suicide ?) de l'ancien marin.
Désenchanté, hanté par le remords, la culpabilité et la honte de son "échec", Vallombrun meurt à son tour et les deux dernières lettres sont de la main de sa soeur, bien résolue, avec le frère qu'il lui reste, à attaquer le testament d'Octave, testament qui lègue l'essentiel de sa fortune à Narcisse et aux enfants éventuels qu'il aurait eu là-bas, sur l'île australienne.
Le dernier chapitre - le meilleur à mon sens - est une sorte d'échappée mi-réaliste, mi-onirique, qui fantasme sur le "bonheur" véritable du "Sauvage blanc", enfin intégré à la tribu aborigène qui l'a recueilli.
Notez le bien : le texte n'est pas inintéressant. Le problème, c'est que, peu à peu, un malaise insidieux vous saisit devant certaines coutumes généreusement prêtées aux indigènes par un François Garde qui, de son propre aveu, n'a effectué aucune enquête sur l'ethnie susceptible d'avoir accueilli Narcisse. François Garde connaît bien la Nouvelle-Calédonie et s'est rendu plusieurs fois à Sydney. Mais, du bush australien du Nord-Est, il ne connaît absolument rien. M. Garde, qui a tout de même reçu pour ce livre le Prix Goncourt 2012 du Premier roman, se contente de confier : "J'espère que mes sauvages sont vraisemblables."
Vraisemblables ? Quand on les voit ne pas enterrer leurs morts et laisser le corps de ceux-ci à la merci du tout venant, sans aucun rite religieux alors que, de l'avis unanime, tout le monde sait que les rites aborigènes en la matière sont très complexes ? Vraisemblables ? Alors que l'on apprend que les coutumes des Maoris sont très différentes de celles des Nouveaux-Calédoniens et qu'aucune de ces deux ethnies n'a de coutumes semblables à celles du peuple du bush australien ? Vraisemblables ? Quand on voit un membre de la tribu violer une toute jeune fille sous les yeux indifférents de toute la tribu rassemblée ? ...
Plus j'avançais dans ce récit, plus je me sentais mal et - oui - en colère. La vision du peuple aborigène australien que nous transmet ainsi M. Garde me paraît rassembler tout un tas de clichés des plus nauséabonds qui datent, au minimum du XIXème siècle, et qui se sont concrétisés dans toute leur horreur quand, au XXème, des enfants aborigènes ont été enlevés à leurs parents pour être éduqués par des Blancs. Par le Diable Lui-même, comment, mais comment cette chose qui s'appelle "Ce Qu'Il Advint du Sauvage Blanc" a-t-elle pu obtenir le Prix Goncourt 2012 du Premier roman ? Le style ici n'est pas en cause. Il ne casse pas trois pattes à un canard mais enfin, depuis le temps, les jurés Goncourt nous ont habitués au pire et ce n'est pas là l'important. Non, l'important, c'est cette façon rampante, insidieuse, odieusement naturelle, de prêter à un peuple qui ne les pratique pas des coutumes tout bonnement indignes.
Ce livre est, pour moi, une véritable escroquerie. On peut "romancer" une biographie. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Curieux de constater que notre pays, d'habitude si chatouilleux sur la question du racisme et autres "-ismes", n'ait pas sanctionné M. Garde au lieu de l'encenser ! Mais les Aborigènes d'Australie ont certainement moins d'importance que disons ... d'autres peuples dont il ne faut surtout pas évoquer certains agissements pourtant traditionnels et même recommandés par leurs textes sacrés - par exemple. ;o)
Allez donc voir d'ailleurs ce que pense de ce livre une directrice d'édition australienne : c'est ici, sur cet article paru dans "Le Koala Lit" : http://lekoalalit.wordpress.com/2012/11/06/ya-de-leau-dans-le-gaz-la-verite-sur-ce-quil-advint-du-sauvage-blanc/
N'oubliez pas non plus de lire "Ce Qu'il Advint ..." : ainsi, vous pourrez vous faire votre opinion personnelle sur un ouvrage que, pour ma part, je ne relirai de ma vie. ;o)
ATTENTION ! SPOILERS ! ;o)
"Ce Qu'Il Advint Du Sauvage Blanc" est une biographie (largement) romancée, inspirée de la tragique aventure de Narcisse Pelletier, un marin vendéen qui passa dix-sept années de son existence dans une tribu aborigène d'Australie. Je vous recommande de lire la page Wikipedia - la page anglaise est évidemment plus complète - sur le sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_Pelletier
Vous le savez, j'ai en général la plus grande méfiance pour les biographies de ce type. Mais là, je ne pouvais pas y couper, ma fille cadette m'ayant demandé de lui dire ce que je pensais de ce livre, qu'elle étudie en classe de 1ère L.
Je l'ai donc lu.
Le texte se répartit en dix-sept chapitres et seize lettres, ces dernières étant numérotées en chiffres romains. Les chapitres sont essentiellement consacrés à la vie de Pelletier, les lettres (sauf les deux dernières) aux "rapports" qu'envoie périodiquement Octave de Vallombrun au président de la Société de Géographie, à Paris. Lorsque l'on a ramené Narcisse à la civilisation, le gouverneur de Sydney a en effet eu l'idée de demander à certaines de ses connaissances de lui adresser la parole, afin de voir si, oui ou non, le naufragé était un vrai muet ou s'il se rappelait tout de même quelques rudiments de sa langue natale. Or, c'est en entendant les phrases françaises de Vallombrun que Narcisse a réagi. Du coup, le gouverneur, bien content de se débarrasser à si bon compte de son "Sauvage blanc", l'a confié à Vallombrun, à charge pour ce dernier de lui réapprendre un peu les usages et d'éclaircir au maximum sa situation.
Passionné de cartographie et de géographie, Vallombrun, après quelques hésitations, a sauté sur l'occasion. Il est en effet un correspondant assez modeste de la Société de Géographie de Paris et entretient, nous l'avons dit plus haut, d'excellentes relations avec son président. Dans les lettres qu'il lui adresse, Vallombrun raconte ses espoirs, ses déceptions (remettre Narcisse "en état" n'est pas une mince affaire) puis, lorsque Narcisse est apte à retrouver les siens, tous les incidents qui jalonnent leur retour commun en France : Narcisse avec les femmes, Narcisse sympathisant, on ne sait par quel miracle, avec l'Impératrice Eugénie - nous sommes sous le Second Empire - et évoquant pour la première fois devant elle ce que fut sa vie sur l'île où il s'était retrouvé naufragé, les retrouvailles de Narcisse avec sa famille, en Vendée, le poste de gardien-assistant que l'Impératrice lui a fait donner ensuite au Phare des Baleines et puis, en dernier, après que Vallombrun ait tenté, sans le savoir, une espèce de régression à la Freud pour obtenir enfin de Narcisse qu'il lui parle de sa vie "là-bas", la disparition, brutale et inexpliquée (le suicide ?) de l'ancien marin.
Désenchanté, hanté par le remords, la culpabilité et la honte de son "échec", Vallombrun meurt à son tour et les deux dernières lettres sont de la main de sa soeur, bien résolue, avec le frère qu'il lui reste, à attaquer le testament d'Octave, testament qui lègue l'essentiel de sa fortune à Narcisse et aux enfants éventuels qu'il aurait eu là-bas, sur l'île australienne.
Le dernier chapitre - le meilleur à mon sens - est une sorte d'échappée mi-réaliste, mi-onirique, qui fantasme sur le "bonheur" véritable du "Sauvage blanc", enfin intégré à la tribu aborigène qui l'a recueilli.
Notez le bien : le texte n'est pas inintéressant. Le problème, c'est que, peu à peu, un malaise insidieux vous saisit devant certaines coutumes généreusement prêtées aux indigènes par un François Garde qui, de son propre aveu, n'a effectué aucune enquête sur l'ethnie susceptible d'avoir accueilli Narcisse. François Garde connaît bien la Nouvelle-Calédonie et s'est rendu plusieurs fois à Sydney. Mais, du bush australien du Nord-Est, il ne connaît absolument rien. M. Garde, qui a tout de même reçu pour ce livre le Prix Goncourt 2012 du Premier roman, se contente de confier : "J'espère que mes sauvages sont vraisemblables."
Vraisemblables ? Quand on les voit ne pas enterrer leurs morts et laisser le corps de ceux-ci à la merci du tout venant, sans aucun rite religieux alors que, de l'avis unanime, tout le monde sait que les rites aborigènes en la matière sont très complexes ? Vraisemblables ? Alors que l'on apprend que les coutumes des Maoris sont très différentes de celles des Nouveaux-Calédoniens et qu'aucune de ces deux ethnies n'a de coutumes semblables à celles du peuple du bush australien ? Vraisemblables ? Quand on voit un membre de la tribu violer une toute jeune fille sous les yeux indifférents de toute la tribu rassemblée ? ...
Plus j'avançais dans ce récit, plus je me sentais mal et - oui - en colère. La vision du peuple aborigène australien que nous transmet ainsi M. Garde me paraît rassembler tout un tas de clichés des plus nauséabonds qui datent, au minimum du XIXème siècle, et qui se sont concrétisés dans toute leur horreur quand, au XXème, des enfants aborigènes ont été enlevés à leurs parents pour être éduqués par des Blancs. Par le Diable Lui-même, comment, mais comment cette chose qui s'appelle "Ce Qu'Il Advint du Sauvage Blanc" a-t-elle pu obtenir le Prix Goncourt 2012 du Premier roman ? Le style ici n'est pas en cause. Il ne casse pas trois pattes à un canard mais enfin, depuis le temps, les jurés Goncourt nous ont habitués au pire et ce n'est pas là l'important. Non, l'important, c'est cette façon rampante, insidieuse, odieusement naturelle, de prêter à un peuple qui ne les pratique pas des coutumes tout bonnement indignes.
Ce livre est, pour moi, une véritable escroquerie. On peut "romancer" une biographie. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Curieux de constater que notre pays, d'habitude si chatouilleux sur la question du racisme et autres "-ismes", n'ait pas sanctionné M. Garde au lieu de l'encenser ! Mais les Aborigènes d'Australie ont certainement moins d'importance que disons ... d'autres peuples dont il ne faut surtout pas évoquer certains agissements pourtant traditionnels et même recommandés par leurs textes sacrés - par exemple. ;o)
Allez donc voir d'ailleurs ce que pense de ce livre une directrice d'édition australienne : c'est ici, sur cet article paru dans "Le Koala Lit" : http://lekoalalit.wordpress.com/2012/11/06/ya-de-leau-dans-le-gaz-la-verite-sur-ce-quil-advint-du-sauvage-blanc/
N'oubliez pas non plus de lire "Ce Qu'il Advint ..." : ainsi, vous pourrez vous faire votre opinion personnelle sur un ouvrage que, pour ma part, je ne relirai de ma vie. ;o)
Alternance entre le récit d'un matelot Narcisse Pelletier, abandonné en Australie dans une contrée inconnue et les lettres de son tuteur qui cherche à lui faire dire ce qu'il a vécu pendant ces dix-huit années dans un but scientifique.
Un récit qui se révèle intéressant, surtout quand on sait qu'il est inspiré d'une histoire vraie, il engendre une réflexion sur la perception des autres cultures au XIXe siècle, le colonialisme mais sous un angle différent : un blanc est devenu sauvage... De quoi troubler les idées de l'époque sur la suprématie d'une race...
Au-delà, on a aussi un récit très prenant sur ce matelot, on attend toujours la suite, comment s'acclimate-t-il à cette tribu ? Mais le récit est aussi décevant, sur l'histoire de la tribu, beaucoup de questions restent en suspens, la fin arrive et tout n'est pas élucidé. Certes c'est une histoire qui reste mystérieuse, mais quand on est dans la tête et les souvenirs de Narcisse Pelletier, on a l'impression de ne pas aller au bout, nous sommes un peu comme cet Octave de Vallombrun qui n'arrive pas à obtenir toutes les réponses.
Un récit bien mené, une belle écriture, un bon moment à passer avec ce roman.
Un récit qui se révèle intéressant, surtout quand on sait qu'il est inspiré d'une histoire vraie, il engendre une réflexion sur la perception des autres cultures au XIXe siècle, le colonialisme mais sous un angle différent : un blanc est devenu sauvage... De quoi troubler les idées de l'époque sur la suprématie d'une race...
Au-delà, on a aussi un récit très prenant sur ce matelot, on attend toujours la suite, comment s'acclimate-t-il à cette tribu ? Mais le récit est aussi décevant, sur l'histoire de la tribu, beaucoup de questions restent en suspens, la fin arrive et tout n'est pas élucidé. Certes c'est une histoire qui reste mystérieuse, mais quand on est dans la tête et les souvenirs de Narcisse Pelletier, on a l'impression de ne pas aller au bout, nous sommes un peu comme cet Octave de Vallombrun qui n'arrive pas à obtenir toutes les réponses.
Un récit bien mené, une belle écriture, un bon moment à passer avec ce roman.
Narcisse Pelletier, jeune matelot vendéen de 18 ans est abandonné par son navire sur les côtes australiennes. Pendant 18 ans, il va partager la vie des aborigènes avant d'être recueilli par un navire anglais. Arrivé à Sydney, il sera pris en charge par Octave de Vallombrun, un voyageur au long cours passionné de géographie.
Le récit va alterner entre l'adaptation de Narcisse Pelletier à cette tribu d'aborigènes et les lettres qu'envoie régulièrement Octave de Vallombrun au président de la société de Géographie pour le tenir au courant de ses échanges avec Narcisse.
Inspiré d'une histoire vraie, ce roman fait penser par certains aspects à "Robinson Crusoë" lorsque l'auteur décrit le sentiment d'abandon du matelot oublié par son équipage. Quant aux lettres d'Octave de Vallombrun, je n'ai pas assez de connaissances dans les échanges de correspondances de ce type, mais elles me paraissent assez crédibles et nous en apprennent beaucoup sur leur auteur, un personnage humble, généreux et d'une insatiable curiosité.
J'ai trouvé ce livre intéressant à bien des égards, notamment sur le choc des civilisations, la curiosité suscitée par une telle aventure alors que l'ethnologie, la sociologie et la psychologie n'étaient que des sciences humaines balbutiantes et que les thèses darwinistes commençaient à se faire connaître.
J'ai été aussi très sensible à l'approche psychologique des personnages et ce parallèle entre l'adaptation de Narcisse à la vie aborigène et son retour à la "civilisation". Un livre à l'image de ses protagonistes, d'une profonde humanité.
Le récit va alterner entre l'adaptation de Narcisse Pelletier à cette tribu d'aborigènes et les lettres qu'envoie régulièrement Octave de Vallombrun au président de la société de Géographie pour le tenir au courant de ses échanges avec Narcisse.
Inspiré d'une histoire vraie, ce roman fait penser par certains aspects à "Robinson Crusoë" lorsque l'auteur décrit le sentiment d'abandon du matelot oublié par son équipage. Quant aux lettres d'Octave de Vallombrun, je n'ai pas assez de connaissances dans les échanges de correspondances de ce type, mais elles me paraissent assez crédibles et nous en apprennent beaucoup sur leur auteur, un personnage humble, généreux et d'une insatiable curiosité.
J'ai trouvé ce livre intéressant à bien des égards, notamment sur le choc des civilisations, la curiosité suscitée par une telle aventure alors que l'ethnologie, la sociologie et la psychologie n'étaient que des sciences humaines balbutiantes et que les thèses darwinistes commençaient à se faire connaître.
J'ai été aussi très sensible à l'approche psychologique des personnages et ce parallèle entre l'adaptation de Narcisse à la vie aborigène et son retour à la "civilisation". Un livre à l'image de ses protagonistes, d'une profonde humanité.
Cher François Garde,
ce fut une très belle surprise de découvrir votre livre. Passant à la librairie, et le voyant exposé, le dernier exemplaire, sur la table des nouveautés, je l'achetai aussitôt car j'avais lu et aimé votre précédent et premier roman "Ce qu'il advint du sauvage blanc". Je ne m'attendais pas cette fois à y rencontrer mon propre personnage.
Je suis resté ami avec Philippe Zafar dont je fis effectivement la connaissance lorsqu'il vint enquêter sur le passé de Thomas Colbert. Enfin, je veux dire celui que vous nommez "Thomas Colbert" car hormis le nom de Philippe et le mien, vous avez par discrétion maquillé tous les autres patronymes. Vos choix m'ont d'ailleurs bien amusé et il faut avoir bourlingué comme vous à travers l'outre-mer lointain ou disposer d'un bon ouvrage de toponymie pour savoir d'où vous vous êtes principalement inspiré.
Vous avez brillamment transcrit, sous forme romanesque et dans un style alerte, la substance de cette enquête. Bien sûr, les choses ne furent pas aussi simples et tranchées. Les Troubles n'atteignirent pas ce degré d'embrasement (mais peut-être le feu couve-t-il encore ?) et le vrai Benjamin Tobias ne fut pas à ce point le héros exalté et intègre que vous peignez. Mais pour servir le conte philosophique, car il s'agit bien de cela, au sens politique de la tradition des Lumières, vous êtes allé à l'essence du drame.
De vos paysages naturels et sociaux recomposés, d'aucuns voudront y reconnaitre d'abord la Nouvelle-Calédonie à cause des Evènements qui s'y déroulèrent, mais nous savons bien que l'image obsédante du nonchaloir est avant tout baudelairienne. Dans ce melimélo tropical, où se glisse une profusion de scieries que l'on trouverait plutôt près de Saint-Claude que de Saint-Denis, même les jubartes se sont embrouillé les hémisphères jusqu'à venir bizarrement nous visiter à contre-saison.
Parce qu'elles faisaient miroir à cette histoire, j'ai aussi trouvé beaucoup d'intérêt à vos digressions historiques et numismatiques et à aucun moment je n'ai eu le sentiment qu'elles servaient à bourrer la page.
Comme vous l'aurez compris, emporté dans l'aventure par le fil du récit, touché par la sensibilité de vos réflexions sociologiques, réchauffé par le soleil du voyage, j'ai adoré votre livre et c'est désormais pour moi un réel plaisir d'en recommander la lecture à mes amis.
Ah, un dernier détail ! Mon prénom est Arthur, pas Alexandre !
Vous êtes le bienvenu,
A. Channer
ce fut une très belle surprise de découvrir votre livre. Passant à la librairie, et le voyant exposé, le dernier exemplaire, sur la table des nouveautés, je l'achetai aussitôt car j'avais lu et aimé votre précédent et premier roman "Ce qu'il advint du sauvage blanc". Je ne m'attendais pas cette fois à y rencontrer mon propre personnage.
Je suis resté ami avec Philippe Zafar dont je fis effectivement la connaissance lorsqu'il vint enquêter sur le passé de Thomas Colbert. Enfin, je veux dire celui que vous nommez "Thomas Colbert" car hormis le nom de Philippe et le mien, vous avez par discrétion maquillé tous les autres patronymes. Vos choix m'ont d'ailleurs bien amusé et il faut avoir bourlingué comme vous à travers l'outre-mer lointain ou disposer d'un bon ouvrage de toponymie pour savoir d'où vous vous êtes principalement inspiré.
Vous avez brillamment transcrit, sous forme romanesque et dans un style alerte, la substance de cette enquête. Bien sûr, les choses ne furent pas aussi simples et tranchées. Les Troubles n'atteignirent pas ce degré d'embrasement (mais peut-être le feu couve-t-il encore ?) et le vrai Benjamin Tobias ne fut pas à ce point le héros exalté et intègre que vous peignez. Mais pour servir le conte philosophique, car il s'agit bien de cela, au sens politique de la tradition des Lumières, vous êtes allé à l'essence du drame.
De vos paysages naturels et sociaux recomposés, d'aucuns voudront y reconnaitre d'abord la Nouvelle-Calédonie à cause des Evènements qui s'y déroulèrent, mais nous savons bien que l'image obsédante du nonchaloir est avant tout baudelairienne. Dans ce melimélo tropical, où se glisse une profusion de scieries que l'on trouverait plutôt près de Saint-Claude que de Saint-Denis, même les jubartes se sont embrouillé les hémisphères jusqu'à venir bizarrement nous visiter à contre-saison.
Parce qu'elles faisaient miroir à cette histoire, j'ai aussi trouvé beaucoup d'intérêt à vos digressions historiques et numismatiques et à aucun moment je n'ai eu le sentiment qu'elles servaient à bourrer la page.
Comme vous l'aurez compris, emporté dans l'aventure par le fil du récit, touché par la sensibilité de vos réflexions sociologiques, réchauffé par le soleil du voyage, j'ai adoré votre livre et c'est désormais pour moi un réel plaisir d'en recommander la lecture à mes amis.
Ah, un dernier détail ! Mon prénom est Arthur, pas Alexandre !
Vous êtes le bienvenu,
A. Channer
Au XIXème siècle, un navire français rallie une côte inconnue en quête de vivres quand, rappelé d'urgence, l'équipage remonte à bord en vitesse, oubliant un matelot sur place. Dans ce pays aride Narcisse, le matelot, ne trouve ni eau ni nourriture, mais il sera secouru par une tribu indigène qui l'adopte.
17 ans plus tard, le navire revient. Remarquant un homme blanc parmi les autochtones, l'équipage entreprend de capturer Narcisse terrifié par ces hommes blancs. L'ancien matelot est entièrement tatoué, il parle une langue aux sons étranges et n'a aucun tabou, ce qui surprend le savant passionné d'exotisme à qui Narcisse sera confié à son retour en France
Deux récits s’entremêlent alors : Celui de Narcisse avant qu'il ne se fonde dans cette tribu, un récit chargé de tous les préjugés d'un français confronté à l'étranger absolu, ; et celui du savant français qui interprète les mœurs de ce sauvage blanc avec sa propre culture sans jamais effleurer la vérité de ce qui constitue la pensée et le monde de l'autre
Ce roman prodigieusement construit et passionnant est un bonheur d’intelligence et d’émotions. Il nous amène à réfléchir sur ce qu'est l'autre Cet autre homme qui habite le monde d'une façon totalement différente de la nôtre peut-il être compris ? Non répond ce roman puisque la seule manière de comprendre l’autre est de s’y fondre intégralement ou de faire silence. L’autre, inconnaissable, ne peut être qu’accepté et accueilli, en silence
17 ans plus tard, le navire revient. Remarquant un homme blanc parmi les autochtones, l'équipage entreprend de capturer Narcisse terrifié par ces hommes blancs. L'ancien matelot est entièrement tatoué, il parle une langue aux sons étranges et n'a aucun tabou, ce qui surprend le savant passionné d'exotisme à qui Narcisse sera confié à son retour en France
Deux récits s’entremêlent alors : Celui de Narcisse avant qu'il ne se fonde dans cette tribu, un récit chargé de tous les préjugés d'un français confronté à l'étranger absolu, ; et celui du savant français qui interprète les mœurs de ce sauvage blanc avec sa propre culture sans jamais effleurer la vérité de ce qui constitue la pensée et le monde de l'autre
Ce roman prodigieusement construit et passionnant est un bonheur d’intelligence et d’émotions. Il nous amène à réfléchir sur ce qu'est l'autre Cet autre homme qui habite le monde d'une façon totalement différente de la nôtre peut-il être compris ? Non répond ce roman puisque la seule manière de comprendre l’autre est de s’y fondre intégralement ou de faire silence. L’autre, inconnaissable, ne peut être qu’accepté et accueilli, en silence
François Garde a été administrateur de l'une des Terres Australes et Antarctique sFrançaises (TAAF) durant les années 2000. il avait l'administration des Iles Kerguelen dans l'Océan Indien à 2 000 km du Continent Antarctique. Durant son mandat il vint une dizaine de fois sur les Iles Kerguelen. Il lui restera une nostalgie pour ces Iles du Bout du Monde.
et c'est tout naturellement qu'il reviendra sur Kerguelen pour un trek de 24 jours.
Pour cela il sera accompagné de Mika alpiniste et photographe , de Bertrand ancien officier de marine et photographe et de Fred alpiniste et patron de l'unité de haute montagne de Chamonix.
A quatre avec 25 kgs chacun sur le dos ils vont traverser Kerguelen du Nord à l'Ouest et au sud.
Mika et Bertrand vont relater cette marche à travers leur site photos.
Pour Mika sur Latitudes Nord et sur Flickr
Pour Bertrand sur son blog www.linstantinne.com/
François Garde lui va tenir un journal de cette longue marche jour après jour.
Marcher à Kerguelen nous relate ce journal
C'est un journal simple , plein d'humilité mais ô combien représentatif de cette marche et de l'état d'esprit de ces quatre marcheurs.
Il faut dire qu'il y a besoin d'une grande humilité devant Kerguelen.
Île battue continuellement par le vent et non les vents.
Île aux mille lacs , rivières et cascades
Iles aux souilles , aux falaises de basalte
Iles de la pluie et de la neige.
Et François Garde de nous raconter cette marche en reprenant régulièrement cette litanie : vent - neige -pluie- humidité-col-falaise - souille....
Cela aurait pu être répétitif. Sachant que toute les pages François Garde nous abreuve des noms des lieux qu'il traverse. Par-ici la Baie de L'oiseau, ou le lac de Rochegude. un peu plus loin le couloir Mangin ou le Val du Retour. Et puis encore des noms sortis de nulle part :le fjord des Portes Noires, la baie de Chimay, la vallée de la Mouche, la cabane Mortadelle, ou encore la péninsule Raillier du Baty sans oublier le Grand Rempart , le Petit et le Grand Ross.
Et bien au contraire cette énumération de vaux, de cabanes , de lacs , de montagnes, de fjords nous emmène dans la marche et dans l'intérieur de Kerguelen.
Bien que les hommes aient eu besoin de nommer pour se reconnaître , pour prendre la propriété des Iles Kerguelen , celles -ci restent un territoire inhabité , à découvrir et hostile à la vie humaine.
Cette longue marche confronte ces quatre hommes à cette réalité.
La vie humaine ne s'installe pas sur Kerguelen hormis la base scientifique de Port aux Français.
A l'inverse la vie naturelle explose : l'eau , le ciel, les nuages , les éléphants de mer, les manchots royaux, les pingouins gorfou, mais aussi les pétrels ,les skuas, les goélands .
Des tentatives d'implantation des hommes il reste des rennes , des chats de rats. Ceux ci conquièrent l'intérieur des terres de Kerguelen alors que la faune originelle reste sur les plages et au abords de l'Océan car c'est là qu'il y a la vie.
Et puis il y a ces paysages que nous imaginons : Ces falaises de basaltes ruisselantes d'eau dans lequel le vent vient s'engouffrer. Ces longues vallées souilleuses et spongieuses , le vert tentant d'éliminer le gris. Ce ciel bas avec dans la brume les langues glacières.
Dans son journal François Garde nous raconte tout cela , mais il nous raconte bien plus .
Il nous raconte la marche. Il nous raconte le vent , le vent de l'Esprit. Il nous raconte nos rêves.
Extrait page 233 : "Les trésors de Kerguelen ne sont ni monétisables ni exploitables. cette île n'a jamais enrichi personne. Tout ce que la nature donne à profusion reste sur place. Un seul produit d'exportation : le rêve -le rêve décliné n souvenirs, en désirs, en timbres, en nostalgies, en images, en contemplations. De ce fret là, je me revendique négociant."
C'est un beau livre sur la recherche de nos rêves mais aussi sur la recherche de soi.
A la fin de la lecture , se confronter au photos de Mika ou de Bertrand donne une autre couleur à ce journal. Les couleurs sombres qui dominent durant la lecture prennent un éclat extraordinaire.
Ventus est vita mea
C'est inscrit sur la Chapelle Notre Dame du Vent à Port aux Français.
Le Vent est ma vie.
"il faut le silence des vents au dehors pour être attentif et présent au Vent de l'Esprit "François Garde.
et c'est tout naturellement qu'il reviendra sur Kerguelen pour un trek de 24 jours.
Pour cela il sera accompagné de Mika alpiniste et photographe , de Bertrand ancien officier de marine et photographe et de Fred alpiniste et patron de l'unité de haute montagne de Chamonix.
A quatre avec 25 kgs chacun sur le dos ils vont traverser Kerguelen du Nord à l'Ouest et au sud.
Mika et Bertrand vont relater cette marche à travers leur site photos.
Pour Mika sur Latitudes Nord et sur Flickr
Pour Bertrand sur son blog www.linstantinne.com/
François Garde lui va tenir un journal de cette longue marche jour après jour.
Marcher à Kerguelen nous relate ce journal
C'est un journal simple , plein d'humilité mais ô combien représentatif de cette marche et de l'état d'esprit de ces quatre marcheurs.
Il faut dire qu'il y a besoin d'une grande humilité devant Kerguelen.
Île battue continuellement par le vent et non les vents.
Île aux mille lacs , rivières et cascades
Iles aux souilles , aux falaises de basalte
Iles de la pluie et de la neige.
Et François Garde de nous raconter cette marche en reprenant régulièrement cette litanie : vent - neige -pluie- humidité-col-falaise - souille....
Cela aurait pu être répétitif. Sachant que toute les pages François Garde nous abreuve des noms des lieux qu'il traverse. Par-ici la Baie de L'oiseau, ou le lac de Rochegude. un peu plus loin le couloir Mangin ou le Val du Retour. Et puis encore des noms sortis de nulle part :le fjord des Portes Noires, la baie de Chimay, la vallée de la Mouche, la cabane Mortadelle, ou encore la péninsule Raillier du Baty sans oublier le Grand Rempart , le Petit et le Grand Ross.
Et bien au contraire cette énumération de vaux, de cabanes , de lacs , de montagnes, de fjords nous emmène dans la marche et dans l'intérieur de Kerguelen.
Bien que les hommes aient eu besoin de nommer pour se reconnaître , pour prendre la propriété des Iles Kerguelen , celles -ci restent un territoire inhabité , à découvrir et hostile à la vie humaine.
Cette longue marche confronte ces quatre hommes à cette réalité.
La vie humaine ne s'installe pas sur Kerguelen hormis la base scientifique de Port aux Français.
A l'inverse la vie naturelle explose : l'eau , le ciel, les nuages , les éléphants de mer, les manchots royaux, les pingouins gorfou, mais aussi les pétrels ,les skuas, les goélands .
Des tentatives d'implantation des hommes il reste des rennes , des chats de rats. Ceux ci conquièrent l'intérieur des terres de Kerguelen alors que la faune originelle reste sur les plages et au abords de l'Océan car c'est là qu'il y a la vie.
Et puis il y a ces paysages que nous imaginons : Ces falaises de basaltes ruisselantes d'eau dans lequel le vent vient s'engouffrer. Ces longues vallées souilleuses et spongieuses , le vert tentant d'éliminer le gris. Ce ciel bas avec dans la brume les langues glacières.
Dans son journal François Garde nous raconte tout cela , mais il nous raconte bien plus .
Il nous raconte la marche. Il nous raconte le vent , le vent de l'Esprit. Il nous raconte nos rêves.
Extrait page 233 : "Les trésors de Kerguelen ne sont ni monétisables ni exploitables. cette île n'a jamais enrichi personne. Tout ce que la nature donne à profusion reste sur place. Un seul produit d'exportation : le rêve -le rêve décliné n souvenirs, en désirs, en timbres, en nostalgies, en images, en contemplations. De ce fret là, je me revendique négociant."
C'est un beau livre sur la recherche de nos rêves mais aussi sur la recherche de soi.
A la fin de la lecture , se confronter au photos de Mika ou de Bertrand donne une autre couleur à ce journal. Les couleurs sombres qui dominent durant la lecture prennent un éclat extraordinaire.
Ventus est vita mea
C'est inscrit sur la Chapelle Notre Dame du Vent à Port aux Français.
Le Vent est ma vie.
"il faut le silence des vents au dehors pour être attentif et présent au Vent de l'Esprit "François Garde.
Au milieu du XIXe siècle, un jeune matelot français, âgé de dix-huit ans, se retrouve abandonné sur une île. Après quelques jours, alors qu'il est sur le point de mourir de soif et de faim, il rencontre une vieille femme noire qui le nourrit.
Il s'impose dans sa tribu et restera dix-sept années avec eux, jusqu'à ce qu'un navire anglais le retrouve. Les marins le ramènent au gouvernement d'Australie, où il rencontre Octave de Vallombrun, membre de la société française de géographie, qui est fasciné par cet homme revenu à l'état sauvage et ayant oublié sa langue.
Octave prend sous son aile le "sauvage blanc", Narcisse Pelletier, il lui réapprend la langue française et les mœurs civilisées.
Le lecteur est vite fasciné par de destin de Narcisse Pelletier au point d'anticiper la suite de ses aventures, tel un spectateur de télé réalité australienne, baigné par le rendu vivant de ses affres, on reste scotché au récit, abandonnant pour un temps la lecture fastidieuse des lettres au Président
Puis le personnage intrigue, peu de choses transpirent des coutumes de ces Aborigènes, François Garde est-il sincère ou n'invente-il pas le récit sans s'appuyer sur des sources récentes et fiables ? Que savons nous de ces Aborigènes, aux manières frustres, aux tatouages si étranges,beaux et envoûtants,et même si leur adaptation à leur milieu est totale ?
Puis comme souvent, face à des événements si extrêmes, on prie pour qu'Octave de Vallombrun trouve les ressources pour percer ces mystères, qu'a-t-il vu, connu, puisse t-il nous révéler cette vie « sauvage », comme Octave, on reste perplexe face aux mystères entretenus par ce «sauvage blanc» qui, semble-t-il, garde la nostalgie de ces années passées chez les «primitifs» .
Nos interrogations comme celles Octave, rythment les fameuses « lettres au président », la prise de conscience d'Otave, est progressive, il finit par demander au président pourquoi il n'est pas pris au sérieux, les publications de la Sté de géographie lui sont même hostiles, et n'est-il pas un imposteur? Sans témoins comment faire croire que Narcisse cette figure si vendéenne est devenue, ou a été un bon sauvage pendant 17ans ?
Ce sont ceux qui devraient le protéger, qui vont au contraire l'accabler, la parole du Révèrent Père Leroy, écumant devant ses pairs toutes les clichés de son temps, va définitivement le discréditer.La présentation de Narcisse devant l'assemblée de savants bornés, jaloux et vétilleurs de la Société de géographie permet alors à François Garde de s'interroger sur l'arrogance occidentale de cette époque.
Avec la distance, le personnage d'Octave de Vallombrun nous semble tout aussi fascinant et bizarre, que son protégé. C'est un fils des Lumières, un esprit curieux, ouvert - on songe en lisant ses lettres au mémoire de Jacques Itard sur Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron -, mais il demeure imbu de certains préjugés de son temps. Si attaché soit-il à Narcisse, il tient pour certain qu'un scientifique "ne peut s’arrêter à un simple sentiment d'effroi ou de sympathie". Ou que"La recherche scientifique est mon seul mobile".
Toute sa fortune comme sa réputation vont y passer, laisant au lecteur un goût amer car rejeté par tous et par Narcisse qui n'aura rien cédé, car "Parler, c'est comme mourir". Deux mondes, deux cultures inconciliables, François Garde aura posé le problème.
Les anthropologues tentent aujourd'hui de tendre des ponts, de comprendre les Aborigènes, problématique difficile car ces peuples disparaissent avec leurs secrets.
Faut il y voir la naissance de l'anthropologie, incarnée par deux personnages juste assez caricaturaux pour être exemplaires ?
Pour ma part ce récit nous livre une réflexion sur l'identité, à l'heure des débats sur ce qui fonde une identité culturelle et à l'heure aussi où des jeunes se disent citoyens du monde.
Il s'impose dans sa tribu et restera dix-sept années avec eux, jusqu'à ce qu'un navire anglais le retrouve. Les marins le ramènent au gouvernement d'Australie, où il rencontre Octave de Vallombrun, membre de la société française de géographie, qui est fasciné par cet homme revenu à l'état sauvage et ayant oublié sa langue.
Octave prend sous son aile le "sauvage blanc", Narcisse Pelletier, il lui réapprend la langue française et les mœurs civilisées.
Le lecteur est vite fasciné par de destin de Narcisse Pelletier au point d'anticiper la suite de ses aventures, tel un spectateur de télé réalité australienne, baigné par le rendu vivant de ses affres, on reste scotché au récit, abandonnant pour un temps la lecture fastidieuse des lettres au Président
Puis le personnage intrigue, peu de choses transpirent des coutumes de ces Aborigènes, François Garde est-il sincère ou n'invente-il pas le récit sans s'appuyer sur des sources récentes et fiables ? Que savons nous de ces Aborigènes, aux manières frustres, aux tatouages si étranges,beaux et envoûtants,et même si leur adaptation à leur milieu est totale ?
Puis comme souvent, face à des événements si extrêmes, on prie pour qu'Octave de Vallombrun trouve les ressources pour percer ces mystères, qu'a-t-il vu, connu, puisse t-il nous révéler cette vie « sauvage », comme Octave, on reste perplexe face aux mystères entretenus par ce «sauvage blanc» qui, semble-t-il, garde la nostalgie de ces années passées chez les «primitifs» .
Nos interrogations comme celles Octave, rythment les fameuses « lettres au président », la prise de conscience d'Otave, est progressive, il finit par demander au président pourquoi il n'est pas pris au sérieux, les publications de la Sté de géographie lui sont même hostiles, et n'est-il pas un imposteur? Sans témoins comment faire croire que Narcisse cette figure si vendéenne est devenue, ou a été un bon sauvage pendant 17ans ?
Ce sont ceux qui devraient le protéger, qui vont au contraire l'accabler, la parole du Révèrent Père Leroy, écumant devant ses pairs toutes les clichés de son temps, va définitivement le discréditer.La présentation de Narcisse devant l'assemblée de savants bornés, jaloux et vétilleurs de la Société de géographie permet alors à François Garde de s'interroger sur l'arrogance occidentale de cette époque.
Avec la distance, le personnage d'Octave de Vallombrun nous semble tout aussi fascinant et bizarre, que son protégé. C'est un fils des Lumières, un esprit curieux, ouvert - on songe en lisant ses lettres au mémoire de Jacques Itard sur Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron -, mais il demeure imbu de certains préjugés de son temps. Si attaché soit-il à Narcisse, il tient pour certain qu'un scientifique "ne peut s’arrêter à un simple sentiment d'effroi ou de sympathie". Ou que"La recherche scientifique est mon seul mobile".
Toute sa fortune comme sa réputation vont y passer, laisant au lecteur un goût amer car rejeté par tous et par Narcisse qui n'aura rien cédé, car "Parler, c'est comme mourir". Deux mondes, deux cultures inconciliables, François Garde aura posé le problème.
Les anthropologues tentent aujourd'hui de tendre des ponts, de comprendre les Aborigènes, problématique difficile car ces peuples disparaissent avec leurs secrets.
Faut il y voir la naissance de l'anthropologie, incarnée par deux personnages juste assez caricaturaux pour être exemplaires ?
Pour ma part ce récit nous livre une réflexion sur l'identité, à l'heure des débats sur ce qui fonde une identité culturelle et à l'heure aussi où des jeunes se disent citoyens du monde.
Ce livre a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2012. Tiré d'une histoire vraie.
Narcisse Pelletier, jeune Vendéen et matelot de 18 ans, embarque sur un navire français, le Saint Paul. Afin de se ravitailler en eau et nourriture, le navire débarque sur une côte australienne puis lève l'ancre en oubliant le jeune homme. D'abord, ce dernier espère que le navire reviendra le chercher puis il rencontre une tribu aborigène qui l'adopte. Petit à petit, Narcisse se fait à cette vie bien malgré lui avec l'espoir vain qu'un jour, le navire débarquera sur la plage. Mais les jours passent et toujours rien à l'horizon.
Dix sept ans plus tard, un navire anglais débarque sur la plage, trouve ce sauvage blanc et le ramène à Sidney où Octave de Vallombrun va le prendre sous son aile et tout lui réapprendre.
Ce roman, tiré d'une histoire véridique, m'a passionnée. La réflexion s'effectue sous deux facettes: D'abord l'histoire de Narcisse et de sa vie avec les aborigènes, puis celle vue par Octave Vallombrun explorateur français) sous forme de lettres qu'il écrit au Président de la Société de Géographie. Dans ses lettres, il lui fait un rapport de l'étude de son protégé et des progrès qu'il fait au quotidien. Octave aimerait faire parler Narcisse de son expérience avec les aborigènes. Mais ce dernier se refuse à parler de sa vie passée. Aurait-il tout oublié comme il a oublié sa vie en France ? Octave de Vallombrun en doute mais respecte le silence de Narcisse même s'il aimerait plus que tout en tant qu'anthropologue et ethnologue, en savoir plus.
J'étais curieuse de savoir pourquoi Narcisse gardait le silence. On apprend la raison de cet état en toute fin de roman. Je n'en parlerai donc pas dans cet avis.
Je me suis laissée embarquer par cette aventure et la plume de François Garde est tellement efficace et pointue que je me suis crue quelquefois au côté de ce jeune homme comme si une caméra le filmait.
Certes, les passages de la vie de Narcisse avec les aborigènes sont truffés de clichés les faisant passer pour un peuple peu évolué, dépourvu d'interdits sexuels et anthropophage (ils ne mangent que leur ennemis). Le tableau archaïque dépeint ici de la société aborigène est loin de correspondre à la réalité puisque bien au contraire, les sauvages australiens sont bien au-deçà de ces idées reçues avec une religion établie et des rites de vie. Certes, ils ne vivent pas comme nous mais ils ont l'air heureux, se contentant de peu.
A mon avis, François Garde a abusé de ces clichés, afin de montrer la mentalité des européens au XIXème siècle. A cette époque, ils imaginaient les sauvages comme des êtres stupides, sans âme, mangeurs d'hommes, sans doute pour se dédouaner de les formater à leur image en les « européanisant ».
Coup de cœur !
Narcisse Pelletier, jeune Vendéen et matelot de 18 ans, embarque sur un navire français, le Saint Paul. Afin de se ravitailler en eau et nourriture, le navire débarque sur une côte australienne puis lève l'ancre en oubliant le jeune homme. D'abord, ce dernier espère que le navire reviendra le chercher puis il rencontre une tribu aborigène qui l'adopte. Petit à petit, Narcisse se fait à cette vie bien malgré lui avec l'espoir vain qu'un jour, le navire débarquera sur la plage. Mais les jours passent et toujours rien à l'horizon.
Dix sept ans plus tard, un navire anglais débarque sur la plage, trouve ce sauvage blanc et le ramène à Sidney où Octave de Vallombrun va le prendre sous son aile et tout lui réapprendre.
Ce roman, tiré d'une histoire véridique, m'a passionnée. La réflexion s'effectue sous deux facettes: D'abord l'histoire de Narcisse et de sa vie avec les aborigènes, puis celle vue par Octave Vallombrun explorateur français) sous forme de lettres qu'il écrit au Président de la Société de Géographie. Dans ses lettres, il lui fait un rapport de l'étude de son protégé et des progrès qu'il fait au quotidien. Octave aimerait faire parler Narcisse de son expérience avec les aborigènes. Mais ce dernier se refuse à parler de sa vie passée. Aurait-il tout oublié comme il a oublié sa vie en France ? Octave de Vallombrun en doute mais respecte le silence de Narcisse même s'il aimerait plus que tout en tant qu'anthropologue et ethnologue, en savoir plus.
J'étais curieuse de savoir pourquoi Narcisse gardait le silence. On apprend la raison de cet état en toute fin de roman. Je n'en parlerai donc pas dans cet avis.
Je me suis laissée embarquer par cette aventure et la plume de François Garde est tellement efficace et pointue que je me suis crue quelquefois au côté de ce jeune homme comme si une caméra le filmait.
Certes, les passages de la vie de Narcisse avec les aborigènes sont truffés de clichés les faisant passer pour un peuple peu évolué, dépourvu d'interdits sexuels et anthropophage (ils ne mangent que leur ennemis). Le tableau archaïque dépeint ici de la société aborigène est loin de correspondre à la réalité puisque bien au contraire, les sauvages australiens sont bien au-deçà de ces idées reçues avec une religion établie et des rites de vie. Certes, ils ne vivent pas comme nous mais ils ont l'air heureux, se contentant de peu.
A mon avis, François Garde a abusé de ces clichés, afin de montrer la mentalité des européens au XIXème siècle. A cette époque, ils imaginaient les sauvages comme des êtres stupides, sans âme, mangeurs d'hommes, sans doute pour se dédouaner de les formater à leur image en les « européanisant ».
Coup de cœur !
Le livre est basé sur une histoire vraie: Narcisse Pelletier (1844-1894) a vraiment existé et a vraiment été recueilli par une tribu arborigène.
Assez décalé comme livre. Surtout par le style qui se veut genre fin XIX. L'auteur a parfaitement su imiter la suffisance des propos des pseudo scientifiques de l'époque et le ridicule de leur position vis-à-vis des "sauvages" des femmes et des gens de petite condition, l'obséquiosité du ton de celui qui s'adresse à quelqu'un qui tient une position qui lui donne sa valeur sans regard pour ce qu'il a réalisé (cela en devient même ennuyant).
J'aurais aimé plus de passages sur la vie de Narcisse au milieu de sa tribu que les reflexions et échanges épistolaires du Vicomte Octave de Vallombrun. 3 étoiles: pour la performance.
Assez décalé comme livre. Surtout par le style qui se veut genre fin XIX. L'auteur a parfaitement su imiter la suffisance des propos des pseudo scientifiques de l'époque et le ridicule de leur position vis-à-vis des "sauvages" des femmes et des gens de petite condition, l'obséquiosité du ton de celui qui s'adresse à quelqu'un qui tient une position qui lui donne sa valeur sans regard pour ce qu'il a réalisé (cela en devient même ennuyant).
J'aurais aimé plus de passages sur la vie de Narcisse au milieu de sa tribu que les reflexions et échanges épistolaires du Vicomte Octave de Vallombrun. 3 étoiles: pour la performance.
François Garde est un romancier qui me réjouit toujours. Quel bonheur, si l'on est un peu amateur d'histoire, de se plonger dans ce joli roman qui explore la galaxie des maréchaux d'empire, ces soldats souvent sortis du rang que Janus Napoléon sut élever sur des trônes et renier tout aussi naturellement dans nombre de cas. Joachim Murat, roi de Naples, fut l'un des plus prestigieux. Modeste fils d'aubergiste du Sud-Ouest il devint le beau-frère de l'empereur en épousant Caroline Bonaparte.
Octobre 1815, quatre mois après Waterloo, Napoléon navigue vers un caillou perdu en plein Atlantique. Murat, désormais ex-roi, tente de revenir en grace auprès de ses anciens sujets. Dans la grande débandade qui suit la fin de l'empire chacun essaie de sauver sa fortune et sa peau. Fait prisonnier par les fidèles des Bourbons il va vivre six journées de réclusion, un procès bâclé, une exécution sans délai. Le prince Joachim Murat se penche sur sa vie. Et c'est absolument passionnant. Roi par effraction, habilement bâti avec alternance du court emprisonnement du souverain de circonstance et des années de conquêtes, de victoires et de déboires, est une sacrée aventure, digne de Dumas, probablement sertie de quelques libertés avec la grande histoire. Peu importe, les Français qui aiment justement l'histoire, que je crains peu nombreux tant règne l'ignorance, se régaleront. Rares sont les époques où l'ascenseur social, certes assez guerrier, pouvait fonctionner. Sachant qu'un ascenseur peut parfois vous envoyer par le fond.
Murat, en quelques jours de geôle, réinterprète les étapes de sa vie exceptionnelle, de son enfance gasconne aux batailles impériales, de son mariage dans l'ombre de Napoléon au palais de l'Elysée qui fut sa résidence. Murat, une vie d'action, de hauts et de bas, des brutalités de sa répression en Espagne (Goya) aux rêves d'unité italienne. En quelques sorte un précurseur même si cela tourna court. Joachim Murat, roi de Naples périt sous les balles des Bourbon, jugement pour le moins expéditif.
Roi par effraction, à lire comme un feuilleton de cape et d'épée, chevauchées et intrigues, trahisons et ingratitudes, une Europe à feu et à sang, et l'extraordinaire destin d'un gamin d'un village du Quercy. L'Aigle déchu dans son île hors du monde avait au moins permis ceci. Il arrive que les aigles ressemblent aux vautours.
Octobre 1815, quatre mois après Waterloo, Napoléon navigue vers un caillou perdu en plein Atlantique. Murat, désormais ex-roi, tente de revenir en grace auprès de ses anciens sujets. Dans la grande débandade qui suit la fin de l'empire chacun essaie de sauver sa fortune et sa peau. Fait prisonnier par les fidèles des Bourbons il va vivre six journées de réclusion, un procès bâclé, une exécution sans délai. Le prince Joachim Murat se penche sur sa vie. Et c'est absolument passionnant. Roi par effraction, habilement bâti avec alternance du court emprisonnement du souverain de circonstance et des années de conquêtes, de victoires et de déboires, est une sacrée aventure, digne de Dumas, probablement sertie de quelques libertés avec la grande histoire. Peu importe, les Français qui aiment justement l'histoire, que je crains peu nombreux tant règne l'ignorance, se régaleront. Rares sont les époques où l'ascenseur social, certes assez guerrier, pouvait fonctionner. Sachant qu'un ascenseur peut parfois vous envoyer par le fond.
Murat, en quelques jours de geôle, réinterprète les étapes de sa vie exceptionnelle, de son enfance gasconne aux batailles impériales, de son mariage dans l'ombre de Napoléon au palais de l'Elysée qui fut sa résidence. Murat, une vie d'action, de hauts et de bas, des brutalités de sa répression en Espagne (Goya) aux rêves d'unité italienne. En quelques sorte un précurseur même si cela tourna court. Joachim Murat, roi de Naples périt sous les balles des Bourbon, jugement pour le moins expéditif.
Roi par effraction, à lire comme un feuilleton de cape et d'épée, chevauchées et intrigues, trahisons et ingratitudes, une Europe à feu et à sang, et l'extraordinaire destin d'un gamin d'un village du Quercy. L'Aigle déchu dans son île hors du monde avait au moins permis ceci. Il arrive que les aigles ressemblent aux vautours.
Marcher à Kerguelen, est le récit de la traversée à pied de cette île se situant aux confins des 40èmes rugissants et faisant partie des terres australes et antarctiques françaises.
Un périple de quelques trois semaines et demies, mené quasi en autarcie par 4 marcheurs invétérés.
Ce récit alterne descriptions des paysages, de parcours, de difficultés mais aussi réflexions diverses sur l'équipe et digressions quasi philosophiques.
Un récit que j'ai pris le temps de lire sur trois semaines aussi, un hasard ? Plutôt un cheminement au diapason des protagonistes de cette aventure.
Un beau récit qui m'a fait rêver, qui m'a transporté dans des contrées inhospitalières et, à l'arrivée, un beau moment d'évasion comme je les aime!
Les magnifiques photos agrémentant cette très belle édition sont un régal et participent pleinement au plaisir de la découverte à distance!
Reçu dans le cadre d'une Masse Critique, merci à Babelio et aux Editions Gallimard pour cette dépaysante découverte...
Un périple de quelques trois semaines et demies, mené quasi en autarcie par 4 marcheurs invétérés.
Ce récit alterne descriptions des paysages, de parcours, de difficultés mais aussi réflexions diverses sur l'équipe et digressions quasi philosophiques.
Un récit que j'ai pris le temps de lire sur trois semaines aussi, un hasard ? Plutôt un cheminement au diapason des protagonistes de cette aventure.
Un beau récit qui m'a fait rêver, qui m'a transporté dans des contrées inhospitalières et, à l'arrivée, un beau moment d'évasion comme je les aime!
Les magnifiques photos agrémentant cette très belle édition sont un régal et participent pleinement au plaisir de la découverte à distance!
Reçu dans le cadre d'une Masse Critique, merci à Babelio et aux Editions Gallimard pour cette dépaysante découverte...
Autant le dire tout de suite, cette lecture a été une grosse déception.
Avec son magnifique "Ce qu'il advint du sauvage blanc", François garde m'avait régalée. Une histoire prenante, une écriture somptueuse, un vrai bonheur. C'est donc avec avidité que j'ai attaqué ce second roman. Hélas, les livres se suivent... et ne se ressemblent pas.
Ici, le point de départ est bien alléchant, cette lettre au contenu surprenant retrouvée dans un tiroir nous accroche tout de suite. Mais après, les choses se gâtent. Certes, l'ensemble est très bien écrit, mais l'enquête pour reconstituer toute l'histoire traîne en longueur, de longues digressions ennuyeuses coupent le récit. Des pages entières sur des considérations de numismatique m'ont semblé aussi peu intéressantes que la lecture d'un acte notarié.
Monsieur Garde, je suis bien désolée d'être aussi sévère avec vous, mais comprenez que ma déception est à la hauteur de l'attente que votre superbe premier roman avait fait naître. J'attends donc avec impatience votre prochain ouvrage !
Avec son magnifique "Ce qu'il advint du sauvage blanc", François garde m'avait régalée. Une histoire prenante, une écriture somptueuse, un vrai bonheur. C'est donc avec avidité que j'ai attaqué ce second roman. Hélas, les livres se suivent... et ne se ressemblent pas.
Ici, le point de départ est bien alléchant, cette lettre au contenu surprenant retrouvée dans un tiroir nous accroche tout de suite. Mais après, les choses se gâtent. Certes, l'ensemble est très bien écrit, mais l'enquête pour reconstituer toute l'histoire traîne en longueur, de longues digressions ennuyeuses coupent le récit. Des pages entières sur des considérations de numismatique m'ont semblé aussi peu intéressantes que la lecture d'un acte notarié.
Monsieur Garde, je suis bien désolée d'être aussi sévère avec vous, mais comprenez que ma déception est à la hauteur de l'attente que votre superbe premier roman avait fait naître. J'attends donc avec impatience votre prochain ouvrage !
Aujourd’hui je vais évoquer Mon oncle d'Australie roman autofictionnel de François Garde. Il est notamment l’auteur de L’effroi, de Roi par effraction ou d’A beau mentir qui vient de loin. Il est d’ailleurs insolite que dans la page « du même auteur » tous ses titres ne soient pas répertoriés. D’un texte à l’autre François Garde se renouvelle et explore de nouveaux thèmes et différentes formes littéraires. Cette fois il scrute son histoire familiale à la recherche de la vérité sur un secret de famille et un oncle qu’il n’a jamais connu.
Mon oncle d'Australie est organisé en trois parties intitulées : exil, autobiographie d’une absence et un caillou ovale noir strié de gris. Le livre est dédié à Paul Garde le père de l’écrivain décédé en 2021. Dans le préambule il explique la genèse de sa recherche et explique pourquoi il n’a publié ce récit qu’après la mort de son père. Chaque partie est liée à un lieu : l’Australie du titre, Avignon (la famille est dans la production électrique à Vaucluse) et la Guyane. A l’origine de cette histoire, un oncle, Marcel, qui est oublié et même effacé de l’arbre généalogique familial. De quelques bribes et fragments connus il appert qu’en 1900 il a quitté Toulon et est parti à bord d’un paquebot à destination des antipodes. Après une escale en Nouvelle Calédonie il aurait rejoint l’Australie sans jamais revenir ni donner de nouvelles. François Garde en a vaguement entendu parler sans savoir précisément quand, puis son père vieillissant a évoqué cet homme qu’il n’a jamais connu lui-même dans ses mémoires rédigés pour lui et ses proches. Alors le romancier à partir des rares éléments à sa disposition va inventer la vie de son aïeul, son arrivée sur l’île continent, ses conditions difficiles de logement et d’apprentissage de l’anglais ; il va imaginer ce qu’a pu être sa vie loin des siens. Mais au-delà de l’exercice fictionnel il s’interroge sur la réelle motivation de ce départ ; cet exil était-il consenti ou forcé, le jeune homme a-t-il eu le choix ou a-t-il obéi à une injonction paternelle ? Plus de cent ans après il ne reste pas de témoin, il est donc extrêmement difficile de savoir s’il a eu une descendance, s’il existe en Australie des cousins éloignés. L’enquête prend une autre tournure en plongeant dans les greniers et les souvenirs. Cet oncle lointain a eu un passé en Provence, il faut exhumer les traces et reconstituer les épisodes cruciaux. L’écrivain a la conviction qu’un secret de famille explique la vraie raison de cet oubli, de l’effacement volontaire de la mémoire collective. Il élabore des hypothèses qu’il va tester, confronter au réel et aux archives administratives et militaires. Alors l’exil ne prend plus la même signification, l’aventurier baroudeur en quête d’horizons lointains prend un autre visage. Dans sa jeunesse Marcel s’est engagé dans la Marine, il a été militaire à l’époque où il était censé avoir quitté la France. Le bannissement pourrait s’expliquer par des larcins, des délits ou des crimes. Pour sauvegarder l’image de la famille et la respectabilité vis-à-vis du voisinage le choix aurait été fait du départ permettant ensuite l’oubli progressif, jusqu’à l’amnésie presque totale. Force est de constater que le secret reste globalement bien gardé mais fuite suffisamment pour que des décennies plus tard il intrigue avec cette absence au sein de l’arbre généalogique. De façon assez improbable, sur les conseils d’un ami, François Garde va poursuivre les recherches et découvrir des preuves qui changent totalement le récit familial ainsi que la destination du bateau sur lequel a embarqué Marcel. La Guyane est le siège du fameux bagne de Cayenne, le lecteur découvrira ce qu’il en est en allant au bout de ce récit intime qui touche à l’universel.
Mon oncle d'Australie est un roman épatant qui progressivement change de focale. L’exercice initial de réactivation de la mémoire et de réhabilitation d’un aïeul oublié se transforme en introspection et en réflexion sur les secrets de famille, leur fonctionnement et les conséquences psychiques qu’ils peuvent avoir.
Voilà, je vous ai donc parlé de Mon oncle d'Australie de François Garde paru aux éditions Grasset.
Lien : http://culture-tout-azimut.o..
Mon oncle d'Australie est organisé en trois parties intitulées : exil, autobiographie d’une absence et un caillou ovale noir strié de gris. Le livre est dédié à Paul Garde le père de l’écrivain décédé en 2021. Dans le préambule il explique la genèse de sa recherche et explique pourquoi il n’a publié ce récit qu’après la mort de son père. Chaque partie est liée à un lieu : l’Australie du titre, Avignon (la famille est dans la production électrique à Vaucluse) et la Guyane. A l’origine de cette histoire, un oncle, Marcel, qui est oublié et même effacé de l’arbre généalogique familial. De quelques bribes et fragments connus il appert qu’en 1900 il a quitté Toulon et est parti à bord d’un paquebot à destination des antipodes. Après une escale en Nouvelle Calédonie il aurait rejoint l’Australie sans jamais revenir ni donner de nouvelles. François Garde en a vaguement entendu parler sans savoir précisément quand, puis son père vieillissant a évoqué cet homme qu’il n’a jamais connu lui-même dans ses mémoires rédigés pour lui et ses proches. Alors le romancier à partir des rares éléments à sa disposition va inventer la vie de son aïeul, son arrivée sur l’île continent, ses conditions difficiles de logement et d’apprentissage de l’anglais ; il va imaginer ce qu’a pu être sa vie loin des siens. Mais au-delà de l’exercice fictionnel il s’interroge sur la réelle motivation de ce départ ; cet exil était-il consenti ou forcé, le jeune homme a-t-il eu le choix ou a-t-il obéi à une injonction paternelle ? Plus de cent ans après il ne reste pas de témoin, il est donc extrêmement difficile de savoir s’il a eu une descendance, s’il existe en Australie des cousins éloignés. L’enquête prend une autre tournure en plongeant dans les greniers et les souvenirs. Cet oncle lointain a eu un passé en Provence, il faut exhumer les traces et reconstituer les épisodes cruciaux. L’écrivain a la conviction qu’un secret de famille explique la vraie raison de cet oubli, de l’effacement volontaire de la mémoire collective. Il élabore des hypothèses qu’il va tester, confronter au réel et aux archives administratives et militaires. Alors l’exil ne prend plus la même signification, l’aventurier baroudeur en quête d’horizons lointains prend un autre visage. Dans sa jeunesse Marcel s’est engagé dans la Marine, il a été militaire à l’époque où il était censé avoir quitté la France. Le bannissement pourrait s’expliquer par des larcins, des délits ou des crimes. Pour sauvegarder l’image de la famille et la respectabilité vis-à-vis du voisinage le choix aurait été fait du départ permettant ensuite l’oubli progressif, jusqu’à l’amnésie presque totale. Force est de constater que le secret reste globalement bien gardé mais fuite suffisamment pour que des décennies plus tard il intrigue avec cette absence au sein de l’arbre généalogique. De façon assez improbable, sur les conseils d’un ami, François Garde va poursuivre les recherches et découvrir des preuves qui changent totalement le récit familial ainsi que la destination du bateau sur lequel a embarqué Marcel. La Guyane est le siège du fameux bagne de Cayenne, le lecteur découvrira ce qu’il en est en allant au bout de ce récit intime qui touche à l’universel.
Mon oncle d'Australie est un roman épatant qui progressivement change de focale. L’exercice initial de réactivation de la mémoire et de réhabilitation d’un aïeul oublié se transforme en introspection et en réflexion sur les secrets de famille, leur fonctionnement et les conséquences psychiques qu’ils peuvent avoir.
Voilà, je vous ai donc parlé de Mon oncle d'Australie de François Garde paru aux éditions Grasset.
Lien : http://culture-tout-azimut.o..
Ce qu’il advint du sauvage blanc/François Garde//Prix Goncourt du premier roman 2012
Quelle incroyable histoire (vraie !) que celle de Narcisse Pelletier, ce marin vendéen âgé de 18 ans, abandonné accidentellement par une goélette française sur une plage déserte du Nord Queensland en Australie au milieu du XIX é siècle !!
« Alors, il découvrit qu’il était seul…Il alla au bord de la falaise, face à la mer dont le bleu dur s’assombrissait, mit les mains en porte voix et hurla : « Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la goélette Saint Paul. »
Retrouvé 18 ans plus tard par une frégate anglaise, il est confié alors à un membre de la Société de Géographie de France, Octave de Vallombrun de passage à Sydney, et sera rapatrié en France. Mais il va s’avérer que :
« L’avenir de Narcisse, qui n’était plus en Australie et pas en mer, n’était pas davantage à Saint Gilles sur Vie. »
Son mutisme définitif concernant sa singulière aventure et son séjour de près de vingt ans chez Aborigènes qui l’a totalement décivilisé, crée alors une ambiance mystérieuse dont on attend qu’elle s’éclaire au fil des pages de ce bon roman. Malgré tous ses efforts et son idéalisme humaniste, Octave de Vallombrun ira de déception en déception, malgré quelques progrès notamment dans l’expression orale, quant à l’élucidation du mystère entourant ce silence. Octave suppute sur le ressenti de Narcisse : « Deux fois il a franchi ce passage impossible d’un monde à l’autre… »
Le talent de l’auteur est de savoir créer grâce à une construction habile un double suspense.
Mais comme d’autres lecteurs, alors que tout le roman tient en haleine, je n’ai pas compris la fin du récit. C’est pourquoi je ne mets que ***.
Quelle incroyable histoire (vraie !) que celle de Narcisse Pelletier, ce marin vendéen âgé de 18 ans, abandonné accidentellement par une goélette française sur une plage déserte du Nord Queensland en Australie au milieu du XIX é siècle !!
« Alors, il découvrit qu’il était seul…Il alla au bord de la falaise, face à la mer dont le bleu dur s’assombrissait, mit les mains en porte voix et hurla : « Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la goélette Saint Paul. »
Retrouvé 18 ans plus tard par une frégate anglaise, il est confié alors à un membre de la Société de Géographie de France, Octave de Vallombrun de passage à Sydney, et sera rapatrié en France. Mais il va s’avérer que :
« L’avenir de Narcisse, qui n’était plus en Australie et pas en mer, n’était pas davantage à Saint Gilles sur Vie. »
Son mutisme définitif concernant sa singulière aventure et son séjour de près de vingt ans chez Aborigènes qui l’a totalement décivilisé, crée alors une ambiance mystérieuse dont on attend qu’elle s’éclaire au fil des pages de ce bon roman. Malgré tous ses efforts et son idéalisme humaniste, Octave de Vallombrun ira de déception en déception, malgré quelques progrès notamment dans l’expression orale, quant à l’élucidation du mystère entourant ce silence. Octave suppute sur le ressenti de Narcisse : « Deux fois il a franchi ce passage impossible d’un monde à l’autre… »
Le talent de l’auteur est de savoir créer grâce à une construction habile un double suspense.
Mais comme d’autres lecteurs, alors que tout le roman tient en haleine, je n’ai pas compris la fin du récit. C’est pourquoi je ne mets que ***.
Le problème quand on marche à Kerguelen, c'est qu'on n'y rencontre personne. Il n'y a que la nature et les marcheurs. Kerguelen est le pays de la pierre, du vent et de l'eau. Curieusement ici, les trois camarades de marche de l'auteur n'existent pas ou si peu. Dans ces conditions que raconter ? Les pierres, le vent, et l'eau ? La nature écrase tout et cela devient lassant.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Musique & Littérature
BiblioJoy
60 livres
Auteurs proches de François Garde
Quiz
Voir plus
Ce qu'il advint du sauvage blanc
Pour François Garde, ce livre est son
1er ouvrage
3ème ouvrage
5ème ouvrage
7ème ouvrage
8 questions
131 lecteurs ont répondu
Thème : Ce qu'il advint du sauvage blanc de
François GardeCréer un quiz sur cet auteur131 lecteurs ont répondu