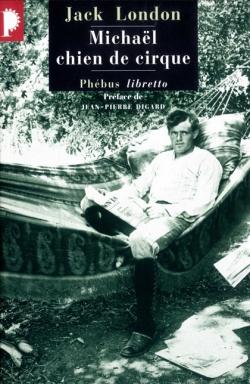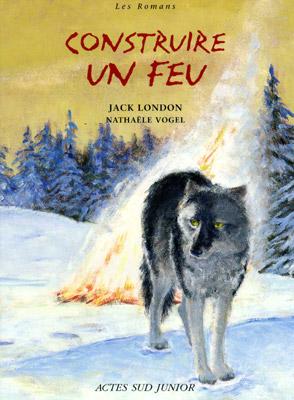Critiques de Jack London (2239)
A chaque fois que je lis un nouveau livre de Jack London, je suis ébahie… Comment diable ai-je pu gâcher tant d’années à ignorer l’œuvre de ce merveilleux auteur, alors que j’aurais dû passer des nuits blanches à béer d’admiration devant chacun de ses romans ? « Martin Eden » ne fait pas exception et je suis un peu honteuse d’avoir tant tardé à l’ouvrir, alors qu’il trainait depuis plus d’une année sur mon bureau. Un plaisir retardé n’en est pas moins intense et, une fois la première page tournée, le roman m’a littéralement fondu entre les mains. Ce bouquin est absolument brillant ! Si brillant, si complexe, si riche que je ne sais par quel bout l’aborder pour faire partager mon enthousiasme. Histoire de ne pas déroger à une routine bien établie, je débuterai donc par la traditionnelle présentation de l’intrigue, parce que c’est facile et que cela me permet de débroussailler mes idées pour la suite.
Alors, « Martin Eden », de quoi ça parle ? Ou plutôt qui est « Martin Eden » ? Eh bien, Martin est un marin de vingt ans, aux épaules larges et aux bras musclés, un petit dur capable de dérouiller n’importe poivrot en quelques crochets bien ajustés, pas stupide – loin s’en faut – mais complètement ignorant comme la majorité des malheureux de sa classe sociale. Après avoir sauvé un jeune homme de bonne famille d’un pugilat, il est invité à dîner dans la famille de celui-ci. L’épreuve est terrible pour ce jeune colosse, terrifié à l’idée de commettre une maladresse et de ne pas savoir que répondre à ces riches bourgeois bien habillés et cultivés. Mais à l’arrivée chez les Morse, Martin voit une apparition, un éblouissement : Ruth Morse, la fille de la maison ! Aussitôt fou amoureux de la jeune femme, Martin désespère d’être jamais digne d’elle, si belle, si pure et si savante.
Afin de devenir son égal et de la conquérir, Martin se lance à cœur perdu dans l’étude. Doté d’une intelligence, d’une sensibilité et d’une force de volonté hors-du-communs, il se passionne pour tous les champs de la culture, de la poésie à la biologie en passant par la politique, et découvre dans les livres un univers plus vaste et plus magnifique que tout ce qu’il avait pu rêver auparavant. De l’apprentissage, il passe naturellement à la création et se lance sur le terrain périlleux de la littérature, confiant dans son génie et dans son imagination fertile. Ce que Martin ne comprend pas et qu’il ne saisira que trop tard, c’est que ces beaux et riches bourgeois ne sont guère différents des matelots ivrognes et des ouvrières aux mains couturées de cicatrices qu’il souhaite si ardemment laisser derrière lui ; qu’ils sont tout aussi obtus, bornés et refermés sur eux-mêmes. De rêves fous en échecs, d’échecs en cruelles désillusions, Martin Eden fera son apprentissage amer du monde dit « civilisé », jusqu’à que, par miracle, ses yeux se dessillent enfin, mais trop tard, bien trop tard pour sauver son âme et son talent...
Considéré à juste titre comme l’un des chefs d’œuvre de Jack London, « Martin Eden » s’est révélé pour moi la plus belle expérience de lecture de ces derniers mois. L’écriture de London est d’une force rare et rend captivante l’épopée intellectuelle de ce jeune marin affamé de reconnaissance sociale. On suit les épreuves traversées par Martin Eden, ses nuits à trimer sur quelques vers de poésie, ses journées d’étude et de labeur exténuantes avec autant de passion que l’on en mettrait à lire un récit d’aventures maritimes ou polaires – à ceci près qu’ici le voyage est cérébral, ce qui ne le rend pas moins dangereux et désespéré.
L’analyse de la société américaine de l’époque est brillante, subtile et d’une acidité à retourner l’estomac des âmes trop sensibles. Elle reste d’ailleurs d’une actualité féroce malgré le siècle écoulé depuis la mort de Jack London. Quant à l’analyse des caractères, n’en parlons même pas… Il y a du thriller psychologique dans Martin Eden et d’une très grande qualité, qui plus est ! L’ensemble du livre est sublime, mais j’avoue avoir été particulièrement soufflée par la fin. Les tout derniers paragraphes sont parmi les plus puissants que j’ai eu l’occasion de lire et j’en suis encore un peu sonnée. Un roman semi-autobiographique tristement prophétique quand on pense à la fin tragique de London : glaçant mais superbe !
Alors, « Martin Eden », de quoi ça parle ? Ou plutôt qui est « Martin Eden » ? Eh bien, Martin est un marin de vingt ans, aux épaules larges et aux bras musclés, un petit dur capable de dérouiller n’importe poivrot en quelques crochets bien ajustés, pas stupide – loin s’en faut – mais complètement ignorant comme la majorité des malheureux de sa classe sociale. Après avoir sauvé un jeune homme de bonne famille d’un pugilat, il est invité à dîner dans la famille de celui-ci. L’épreuve est terrible pour ce jeune colosse, terrifié à l’idée de commettre une maladresse et de ne pas savoir que répondre à ces riches bourgeois bien habillés et cultivés. Mais à l’arrivée chez les Morse, Martin voit une apparition, un éblouissement : Ruth Morse, la fille de la maison ! Aussitôt fou amoureux de la jeune femme, Martin désespère d’être jamais digne d’elle, si belle, si pure et si savante.
Afin de devenir son égal et de la conquérir, Martin se lance à cœur perdu dans l’étude. Doté d’une intelligence, d’une sensibilité et d’une force de volonté hors-du-communs, il se passionne pour tous les champs de la culture, de la poésie à la biologie en passant par la politique, et découvre dans les livres un univers plus vaste et plus magnifique que tout ce qu’il avait pu rêver auparavant. De l’apprentissage, il passe naturellement à la création et se lance sur le terrain périlleux de la littérature, confiant dans son génie et dans son imagination fertile. Ce que Martin ne comprend pas et qu’il ne saisira que trop tard, c’est que ces beaux et riches bourgeois ne sont guère différents des matelots ivrognes et des ouvrières aux mains couturées de cicatrices qu’il souhaite si ardemment laisser derrière lui ; qu’ils sont tout aussi obtus, bornés et refermés sur eux-mêmes. De rêves fous en échecs, d’échecs en cruelles désillusions, Martin Eden fera son apprentissage amer du monde dit « civilisé », jusqu’à que, par miracle, ses yeux se dessillent enfin, mais trop tard, bien trop tard pour sauver son âme et son talent...
Considéré à juste titre comme l’un des chefs d’œuvre de Jack London, « Martin Eden » s’est révélé pour moi la plus belle expérience de lecture de ces derniers mois. L’écriture de London est d’une force rare et rend captivante l’épopée intellectuelle de ce jeune marin affamé de reconnaissance sociale. On suit les épreuves traversées par Martin Eden, ses nuits à trimer sur quelques vers de poésie, ses journées d’étude et de labeur exténuantes avec autant de passion que l’on en mettrait à lire un récit d’aventures maritimes ou polaires – à ceci près qu’ici le voyage est cérébral, ce qui ne le rend pas moins dangereux et désespéré.
L’analyse de la société américaine de l’époque est brillante, subtile et d’une acidité à retourner l’estomac des âmes trop sensibles. Elle reste d’ailleurs d’une actualité féroce malgré le siècle écoulé depuis la mort de Jack London. Quant à l’analyse des caractères, n’en parlons même pas… Il y a du thriller psychologique dans Martin Eden et d’une très grande qualité, qui plus est ! L’ensemble du livre est sublime, mais j’avoue avoir été particulièrement soufflée par la fin. Les tout derniers paragraphes sont parmi les plus puissants que j’ai eu l’occasion de lire et j’en suis encore un peu sonnée. Un roman semi-autobiographique tristement prophétique quand on pense à la fin tragique de London : glaçant mais superbe !
On ne parle pas très souvent de la technique narrative des auteurs. On réserve généralement ce sujet aux auteurs qui, ouvertement, décident d'enfreindre les règles " habituelles ", c'est-à-dire les Faulkner, les Cortázar et consort. J'ai rarement lu qu'on faisait grand cas de la technique narrative de Jack London. Et pourtant…
Voici un auteur, qui fut longtemps étiqueté " jeunesse ", avec une certaine nuance de condescendance dans ce terme alors que les écrits pour la jeunesse devraient justement être ceux auxquels on apporterait le plus grand soin. C'est aussi un auteur étiqueté " aventure ", avec au moins autant de sous-entendus méprisants que je ne vais pas m'attarder à battre en brèche mais qui sont à mes yeux tout aussi déplorables que les précédents.
Alors pour tâcher de contrecarrer certaines idées reçues, je vais argumenter le fait que, selon moi, Jack London est un grand, grand maître de la technique narrative. Si je vous pose la question à brûle-pourpoint, comment vous y prendriez-vous pour nous présenter la vie difficile d'un chien-loup des environs du Yukon au confluent des XIXème et XXème siècles ?
Pas facile, n'est-ce pas ? Comment intéresser son lecteur (ou son auditeur si l'on raconte oralement) ? Sincèrement, faites l'expérience, vous verrez que c'est loin d'être évident. Jack London, lui, a trouvé. Sa réponse se situe au niveau de la technique narrative. Pour ça, il a dû résoudre au moins trois problèmes majeurs :
Premièrement, faire en sorte que le lecteur s'identifie ou du moins éprouve une certaine dose d'empathie pour le protagoniste principal, en l'occurence, un chien-loup pas hyper sympa, qui égorge son prochain pour un oui pour un non. Déjà, c'est coriace comme affaire.
Deuxièmement, faire ressentir au lecteur la sensation d'écoulement du temps, de modification progressive du comportement ou de la relation, qui se noue ou se dénoue avec différents protagonistes au cours de la narration. Car une vie de chien, ce n'est pas fantastiquement long, et présenter le lent et progressif travail des interactions, voilà de quoi occuper vos soirées à vous arracher des cheveux pour découvrir la formule de la fameuse quadrature du cercle.
Troisièmement, il faut parvenir à nous faire pénétrer dans le cerveau de l'animal sans recourir à la formulation directe ni au dialogue, ce qui, convenons-en, est bien pratique d'ordinaire pour parler d'un héros. Imaginez, votre histoire parle d'un héros dont vous ne pourrez jamais faire entendre la voix, au sens articulé et signifiant du terme. Drôle de gageure, non ?
Premier coup de génie de l'auteur, faire débuter sa narration avant la naissance du héros, peut-être même avant sa conception, en prenant le point de vue des humains. le lecteur expérimente le grand Nord, vit le grand Nord, souffre du grand Nord, de son obscurité, de la rudesse de ses températures, de sa famine latente, etc., etc.
Et, là-dessus s'ajoute la peur ; la peur de la bête fauve ; la bête qui souffre plus encore que vous, humain, de la famine ; la bête qui joue sa survie auprès de la vôtre ; la bête qui n'a d'autre choix que de risquer de vous attaquer ; la bête qui en connaît pourtant tous les risques ; la bête qui doit sa survie à une intelligence peut-être pas aussi aiguisée que celle des humains mais qui s'en approche. Et vous, l'humain, vous savez, vous sentez que vous êtes sur le terrain de la bête, que votre belle intelligence vous sera peut-être moins utile que des sens aiguisés et deux bonnes rangées de crocs. Vos mains commencent à trembler, votre sommeil n'est plus ce que l'on peut appeler reposant : c'est une lutte.
Voilà exactement ce que Jack London cherche à vous faire éprouver, la lutte, l'âpre lutte pour la moindre miette de viande, manger ou être mangé. Et une fois que vous avez compris, en tant qu'être humain, vous êtes mûr, vous êtes prêt pour enfiler le costume de la bête. Vous avez compris que pour elle aussi, pour elle surtout, c'est une lutte de tous les instants, vous savez ce que c'est que de courir les pattes dans la neige pendant des heures et des heures sans même l'assurance d'une demie bouchée de viande au bout de la course.
On suit la louve, demie louve d'ailleurs ; on découvre le loup, un vieux borgne qui en a vu beaucoup avec son oeil avant de le perdre au combat ; on comprend que la lutte ne concerne pas que la nourriture : elle touche aussi l'accouplement. Tout n'était qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté chez Baudelaire, ici, mes petits amis, hormis la beauté vous pouvez oublier tout le reste. Et c'est de ça qu'il nait notre Croc-Blanc, de deux géniteurs qui auraient fait un malheur dans Survivor et auraient atteint la finale, soyez-en certains.
Et comme si ça ne suffisait pas, viennent se greffer une série d'embuches qui sont autant de chances que de douleurs. On finit même par se demander si rester en vie dans le grand Nord, dans cet authentique Wild, oui, on finit par se demander si c'est vraiment une chance, si finalement, tous ceux qui sont morts en bas âge n'ont pas tiré un meilleur numéro. Mais Croc-Blanc, lui, semble né pour la souffrance, c'est un champion toute catégorie dans ce domaine.
Il se fait recueillir par une poignée d'Indiens qui lui attribuent au passage son nom de scène. Il expérimente auprès des tipis la loi des chiens-loups plus gros que lui, notamment celle de cette peste incarnée de Lip-Lip, mais également la rude sympathie de son maître Castor-Gris qui n'est pas beaucoup plus tendre qu'une planche à laver lorsqu'il envoie des beignes au petit chiot.
(L'épisode des batailles répétées de Croc-Blanc avec Lip-Lip est extraordinairement ressemblant à celui du chapitre XV de Martin Eden où le héros, dans sa jeunesse, se bat jour après jour contre plus âgé que lui, Tête-de-fromage. Le jeune Martin s'en prend plein la figure pendant des années avant de lui mettre une raclée définitive. Un indice, probablement, du fait que l'auteur aura puisé ce motif de sa propre expérience personnelle tant on sait que Martin Eden colle à beaucoup d'égards à la biographie de Jack London.)
Et de tout cela, Croc-Blanc se forge un corps et un caractère d'airain trempé. Il devient rapidement un leader de meute des plus efficaces quand il est branché sur un traineau, et, bien sûr, doublé d'un batailleur des plus redoutables. Si redoutable que lorsqu'il échoue avec son maître dans une petite ville où les Blancs font étape avant de se lancer dans la ruée vers l'or en Alaska, un sinistre hère répondant au nom de Beauty Smith s'imagine qu'il ferait un as du ring en qualité de chien de combat.
Mais c'est sûrement mal connaître les liens indéfectibles qui unissent l'Indien et son meilleur chien. Peut-être connaissons-nous mal également jusqu'où peut aller un Beauty Smith qui a flairé un magot ? le flair de l'un surpassera-t-il le flair de l'autre ? Je m'en voudrais de vous le révéler si vous ne connaissez pas cette histoire, pourtant archi classique.
Ce que j'en sais, pour ma part, c'est que Croc-Blanc est une sorte de symétrique inversé du précédent grand succès de l'auteur : j'ai nommé L'Appel de la forêt (ou L'Appel sauvage dans la nouvelle traduction de chez Libretto). Il a su renouveler l'histoire tout en adoptant une architecture relativement similaire mais en sens inverse (Buck devenait de plus en plus sauvage tandis que Croc-Blanc se civilise peu à peu).
Mais surtout, et c'est ce que j'ai développé tout au long de cet avis, en l'améliorant grandement tant sa narration au moyen d'une technique irréprochable, que la crédibilité du personnage principal, à savoir ici un animal. (Buck, à beaucoup d'endroits, apparaissait comme par trop exceptionnel.)
Ce que j'en sais encore, eu égard à ce qui vient d'être écrit, c'est que ce John Griffith Chaney, qui s'est fait connaître en littérature sous le pseudonyme de Jack London est un véritable orfèvre de la technique narrative. Si j'avais un petit reproche à lui faire, ce serait peut-être au niveau de la caractérisation de ses personnages humains : que ses méchants soient peut-être un peu moins méprisables et que ses gentils soient peut-être un peu moins exemplaires.
Mais pour le reste, un vrai bon roman efficace et joliment retraduit par l'éditeur Libretto, que je tiens à saluer au passage pour cette entreprise. Toutefois, souvenez-vous, qu'un avis ait la dent dure ou molle, qu'il arbore d'horribles chicots ou d'étincelants crocs blancs, ce ne sera toujours qu'un malheureux avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Voici un auteur, qui fut longtemps étiqueté " jeunesse ", avec une certaine nuance de condescendance dans ce terme alors que les écrits pour la jeunesse devraient justement être ceux auxquels on apporterait le plus grand soin. C'est aussi un auteur étiqueté " aventure ", avec au moins autant de sous-entendus méprisants que je ne vais pas m'attarder à battre en brèche mais qui sont à mes yeux tout aussi déplorables que les précédents.
Alors pour tâcher de contrecarrer certaines idées reçues, je vais argumenter le fait que, selon moi, Jack London est un grand, grand maître de la technique narrative. Si je vous pose la question à brûle-pourpoint, comment vous y prendriez-vous pour nous présenter la vie difficile d'un chien-loup des environs du Yukon au confluent des XIXème et XXème siècles ?
Pas facile, n'est-ce pas ? Comment intéresser son lecteur (ou son auditeur si l'on raconte oralement) ? Sincèrement, faites l'expérience, vous verrez que c'est loin d'être évident. Jack London, lui, a trouvé. Sa réponse se situe au niveau de la technique narrative. Pour ça, il a dû résoudre au moins trois problèmes majeurs :
Premièrement, faire en sorte que le lecteur s'identifie ou du moins éprouve une certaine dose d'empathie pour le protagoniste principal, en l'occurence, un chien-loup pas hyper sympa, qui égorge son prochain pour un oui pour un non. Déjà, c'est coriace comme affaire.
Deuxièmement, faire ressentir au lecteur la sensation d'écoulement du temps, de modification progressive du comportement ou de la relation, qui se noue ou se dénoue avec différents protagonistes au cours de la narration. Car une vie de chien, ce n'est pas fantastiquement long, et présenter le lent et progressif travail des interactions, voilà de quoi occuper vos soirées à vous arracher des cheveux pour découvrir la formule de la fameuse quadrature du cercle.
Troisièmement, il faut parvenir à nous faire pénétrer dans le cerveau de l'animal sans recourir à la formulation directe ni au dialogue, ce qui, convenons-en, est bien pratique d'ordinaire pour parler d'un héros. Imaginez, votre histoire parle d'un héros dont vous ne pourrez jamais faire entendre la voix, au sens articulé et signifiant du terme. Drôle de gageure, non ?
Premier coup de génie de l'auteur, faire débuter sa narration avant la naissance du héros, peut-être même avant sa conception, en prenant le point de vue des humains. le lecteur expérimente le grand Nord, vit le grand Nord, souffre du grand Nord, de son obscurité, de la rudesse de ses températures, de sa famine latente, etc., etc.
Et, là-dessus s'ajoute la peur ; la peur de la bête fauve ; la bête qui souffre plus encore que vous, humain, de la famine ; la bête qui joue sa survie auprès de la vôtre ; la bête qui n'a d'autre choix que de risquer de vous attaquer ; la bête qui en connaît pourtant tous les risques ; la bête qui doit sa survie à une intelligence peut-être pas aussi aiguisée que celle des humains mais qui s'en approche. Et vous, l'humain, vous savez, vous sentez que vous êtes sur le terrain de la bête, que votre belle intelligence vous sera peut-être moins utile que des sens aiguisés et deux bonnes rangées de crocs. Vos mains commencent à trembler, votre sommeil n'est plus ce que l'on peut appeler reposant : c'est une lutte.
Voilà exactement ce que Jack London cherche à vous faire éprouver, la lutte, l'âpre lutte pour la moindre miette de viande, manger ou être mangé. Et une fois que vous avez compris, en tant qu'être humain, vous êtes mûr, vous êtes prêt pour enfiler le costume de la bête. Vous avez compris que pour elle aussi, pour elle surtout, c'est une lutte de tous les instants, vous savez ce que c'est que de courir les pattes dans la neige pendant des heures et des heures sans même l'assurance d'une demie bouchée de viande au bout de la course.
On suit la louve, demie louve d'ailleurs ; on découvre le loup, un vieux borgne qui en a vu beaucoup avec son oeil avant de le perdre au combat ; on comprend que la lutte ne concerne pas que la nourriture : elle touche aussi l'accouplement. Tout n'était qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté chez Baudelaire, ici, mes petits amis, hormis la beauté vous pouvez oublier tout le reste. Et c'est de ça qu'il nait notre Croc-Blanc, de deux géniteurs qui auraient fait un malheur dans Survivor et auraient atteint la finale, soyez-en certains.
Et comme si ça ne suffisait pas, viennent se greffer une série d'embuches qui sont autant de chances que de douleurs. On finit même par se demander si rester en vie dans le grand Nord, dans cet authentique Wild, oui, on finit par se demander si c'est vraiment une chance, si finalement, tous ceux qui sont morts en bas âge n'ont pas tiré un meilleur numéro. Mais Croc-Blanc, lui, semble né pour la souffrance, c'est un champion toute catégorie dans ce domaine.
Il se fait recueillir par une poignée d'Indiens qui lui attribuent au passage son nom de scène. Il expérimente auprès des tipis la loi des chiens-loups plus gros que lui, notamment celle de cette peste incarnée de Lip-Lip, mais également la rude sympathie de son maître Castor-Gris qui n'est pas beaucoup plus tendre qu'une planche à laver lorsqu'il envoie des beignes au petit chiot.
(L'épisode des batailles répétées de Croc-Blanc avec Lip-Lip est extraordinairement ressemblant à celui du chapitre XV de Martin Eden où le héros, dans sa jeunesse, se bat jour après jour contre plus âgé que lui, Tête-de-fromage. Le jeune Martin s'en prend plein la figure pendant des années avant de lui mettre une raclée définitive. Un indice, probablement, du fait que l'auteur aura puisé ce motif de sa propre expérience personnelle tant on sait que Martin Eden colle à beaucoup d'égards à la biographie de Jack London.)
Et de tout cela, Croc-Blanc se forge un corps et un caractère d'airain trempé. Il devient rapidement un leader de meute des plus efficaces quand il est branché sur un traineau, et, bien sûr, doublé d'un batailleur des plus redoutables. Si redoutable que lorsqu'il échoue avec son maître dans une petite ville où les Blancs font étape avant de se lancer dans la ruée vers l'or en Alaska, un sinistre hère répondant au nom de Beauty Smith s'imagine qu'il ferait un as du ring en qualité de chien de combat.
Mais c'est sûrement mal connaître les liens indéfectibles qui unissent l'Indien et son meilleur chien. Peut-être connaissons-nous mal également jusqu'où peut aller un Beauty Smith qui a flairé un magot ? le flair de l'un surpassera-t-il le flair de l'autre ? Je m'en voudrais de vous le révéler si vous ne connaissez pas cette histoire, pourtant archi classique.
Ce que j'en sais, pour ma part, c'est que Croc-Blanc est une sorte de symétrique inversé du précédent grand succès de l'auteur : j'ai nommé L'Appel de la forêt (ou L'Appel sauvage dans la nouvelle traduction de chez Libretto). Il a su renouveler l'histoire tout en adoptant une architecture relativement similaire mais en sens inverse (Buck devenait de plus en plus sauvage tandis que Croc-Blanc se civilise peu à peu).
Mais surtout, et c'est ce que j'ai développé tout au long de cet avis, en l'améliorant grandement tant sa narration au moyen d'une technique irréprochable, que la crédibilité du personnage principal, à savoir ici un animal. (Buck, à beaucoup d'endroits, apparaissait comme par trop exceptionnel.)
Ce que j'en sais encore, eu égard à ce qui vient d'être écrit, c'est que ce John Griffith Chaney, qui s'est fait connaître en littérature sous le pseudonyme de Jack London est un véritable orfèvre de la technique narrative. Si j'avais un petit reproche à lui faire, ce serait peut-être au niveau de la caractérisation de ses personnages humains : que ses méchants soient peut-être un peu moins méprisables et que ses gentils soient peut-être un peu moins exemplaires.
Mais pour le reste, un vrai bon roman efficace et joliment retraduit par l'éditeur Libretto, que je tiens à saluer au passage pour cette entreprise. Toutefois, souvenez-vous, qu'un avis ait la dent dure ou molle, qu'il arbore d'horribles chicots ou d'étincelants crocs blancs, ce ne sera toujours qu'un malheureux avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
L'histoire de Martin Eden commence par l'ouverture d'une porte chez un inconnu. Dès la première page, la portée symbolique est posée : ouvrir une porte vers l'inconnu. (C'est cruellement d'actualité !) Qu'y aura-t-il derrière cette porte ? Si on l'ouvre, c'est qu'on en espère quelque chose. Et si nos attentes s'avèrent déçues, libre à nous de faire marche arrière et de refermer cette porte, non ?
Eh bien, d'après moi, c'est là tout l'enjeu du roman. Que se passe-t-il lorsqu'on franchit le seuil d'une porte ? Y a-t-il un retour en arrière possible ? Martin Eden est un rude gaillard de la classe populaire. Un gars qui s'est forgé à la force des poings et à la sueur de son front. Il est né dans une famille qui avait déjà bien d'autres chats à fouetter pour se maintenir à flot que d'offrir au jeune Martin le confort, le savoir ou l'affection.
En pareil cas, certains tombent dans l'alcool, la délinquance ou vivotent en s'érodant la santé pour un misérable salaire de cacahuètes à décortiquer. Martin a connu ça et même un peu plus que ça. Il a versé dans presque tous les travers qui s'offrent aux gens de sa catégorie. En plus, il a baroudé, il a connu des filles, il a commencé d'user sa fringante jeunesse sur les bateaux et dans les ports du Pacifique. Trente-six métiers, trente-six misères, comme on dit…
Mais Martin a soif de vivre ; il aime la vie : il la mord à pleines dents et brûle les journées par les deux bouts. Il sait qu'il est malin et il a foi en lui. Il sait, tout au fond de lui-même, qu'il n'est pas exactement de la même étoffe que celles et ceux qu'il côtoie ordinairement. Il a une volonté de réussir, mais pas de cette volonté vulgaire qui consiste à s'assurer une aisance matérielle, pas de cette réussite ordinaire qui se mesure à l'épaisseur du matelas de dollars sur lequel vous pouvez vous endormir chaque soir.
Non, la réussite qu'il vise, lui, concerne les choses de l'esprit. Il a soif d'apprendre, d'apprendre sur tout et partout, d'apprendre tout le temps, d'apprendre encore. C'est un observateur aigu des choses, du monde et des gens qu'il côtoie. Il en sait déjà très long sur la vie malgré son jeune âge (autour de la vingtaine) mais, au hasard d'une rixe dans la rue (à laquelle il décidera de prendre part, juste pour satisfaire à un noble instinct mais aussi, peut-être, pour la joie, pour la satisfaction intime de pouvoir coller un pain dans la gueule de quelqu'un), une rixe, disais-je, (entre un rupin et un homme de rien), une rixe donc, à l'issue de laquelle Martin Eden ouvrira une porte… une porte sur l'inconnu…
Quand Martin ouvre cette porte, entre chez ce jeune bourgeois ou, plus exactement, chez ses parents, il se sent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'un coup, sa langue lui semble aussi épaisse et gluante que celle d'un gros lézard, propre à faire un sort aux insectes mais certainement pas de cueillir les raffinés pétales de l'existence, affreusement inapte à siroter les nectars ou les perles de rosée sur les flûtes en cristal. Lui trébuche, écorche, écorne, éborgne l'anglais à chaque virage quand eux, eux, ces gens éthérés, aux mains si blanches, si fines, si impeccables qu'on pourrait presque voir au travers, tandis qu'eux volent dans les nuages de la syntaxe, utilisent des mots précieux, inconnus de lui, qui brillent en leur bouche comme un chapelet d'étoiles sur le drap noir des nuits immaculées… immaculées…
Immaculée aussi cette jeune femme aux yeux, au teint, aux cheveux, si bleus, si blanc, si blonds, la soeur de celui qu'il a aidé dans la rue. Qu'est-il, lui, Martin Eden ? Lui le sait, lui s'en doute, lui le sent palpiter dans ses veines. Mais eux, eux, qu'en savent-ils ? S'imaginent-ils seulement qu'il puisse avoir une quelconque parcelle d'étoile cachée en lui, ensevelie sous les tonnes de fange qu'ont déjà remuées ses mains et sa langue ?
Il aimerait pourtant tellement le lui dire à elle, le lui faire comprendre, le lui faire vivre, qu'il possède lui aussi des trésors. Elle est si belle, si gracieuse, si distinguée quand elle parle, si cultivée quant aux livres. Les livres ! Les livres ! Bon dieu, oui, c'est cela, les livres ! L'abîme, le fossé, l'escarpe qui existe entre lui et elle est un gouffre empli de livres qu'il lui faudra traverser s'il escompte un jour la rejoindre, sur l'autre rive du savoir et de la culture…
L'écart mais aussi le lien entre elle et lui est un livre. Un livre entre sa main à elle et sa main à lui. Et s'il l'avalait, ce livre ? Il n'y aurait ainsi plus d'écart entre sa main à elle et sa main à lui, n'est-ce pas ? Aïe, aïe, aïe. Bien plus facile à dire qu'à faire cette affaire-là. Mais il en faudrait d'avantage pour l'effrayer notre Martin Eden. S'il lui faut gravir une montagne de livres pour atteindre le sommet, il se fera alpiniste du savoir ; et s'il lui faut franchir des crevasses vertigineuses, il utilisera le piolet de son courage et de sa bouillante énergie.
Car les espoirs qu'il met en Ruth Morse justifient pour lui tous les efforts, tous les sacrifices. (Je m'arrête quelques secondes pour souligner que Ruth est bien le prénom de la jeune fille et ne fait nullement référence à un quelconque état sexuel qu'éprouverait le jeune homme. Il en va de même du nom de famille qui est à rapprocher de l'inventeur de l'alphabet du même nom, bip - bip - biiiip - bip - bip - biiiip, et non de celui d'un quelconque animal à dents longues, aussi malhabile sur terre ferme que graisseux et dont l'anatomie ne rappelle en rien celle de la jeune fille.)
C'est donc tout cela que nous raconte Jack London dans ce roman très fréquemment autobiographique (à cet égard, la scène de la jeunesse de Martin Eden, obligé de se battre quasi-quotidiennement avec un enfant plus grand que lui, Tête-de-fromage, rappelle à s'y méprendre une scène similaire de Croc-Blanc où le jeune loup se fait rosser de la même façon par Lip-Lip jusqu'à ce qu'il parvienne à le battre). La lutte d'un jeune homme des classes populaires pour se faire une petite place dans un milieu lettré et intellectuel presque exclusivement gardé par les cerbères de la haute bourgeoisie.
Il est vrai qu'il n'a pas choisi le plus simple car en plus d'apprendre à parler correctement, il entend également apprendre à écrire. Il souhaite en effet faire sa route en tant qu'écrivain et même, espoir suprême, vivre dignement, honnêtement de sa plume. À ce prix et à ce prix seulement, pense-t-il, les bras de Ruth lui seront ouverts.
Vous aurez compris que le roman soulève beaucoup de questions : Est-il possible de s'extraire de son monde pour en atteindre un autre dont on ignore tous les codes ? L'amour est-il assez puissant pour surpasser les préjugés de classe ? Peut-on supporter le poids de vivre dans le no man's land situé entre les deux lignes de front constituées par l'ignorance crasse de vos anciens camarades et l'apparente inaccessibilité intellectuelle de ceux que vous aimeriez rallier ? Peut-on supporter l'étrange mélasse d'hypocrisie, d'effet de mode, de calcul, de flagornerie, de bienséance, de stratégies retorses et de sourires convenus dans les mondanités quand on a toujours eu à faire qu'à des gens vrais, aussi francs et généreux qu'un coup de poing dans le groin, aussi directs et naturels qu'un bon gros rot de marin après son verre de rhum ?
Et l'argent ? L'argent, oh, l'argent, l'argent… Tout le monde en veut de l'argent, et Martin Eden le premier. Il est tout prêt à jouer des poings pour lui. Et si les parents Morse ont une dent contre lui (pardonnez encore ce jeu de mots facile) c'est peut-être grandement et uniquement pour cela, l'argent. Car vous conviendrez qu'en terme de retour sur investissement, quand on dresse le bilan comptable de tout ce que l'on a déboursé dans l'élevage bio d'une jeune fille, intérêts et principal, et qu'on voit se pointer à la porte un Martin Eden avec ses gros bras et sa veste crasseuse, on se dit tout de même que c'est bien mince comme à valoir. Bon, imaginons le même Martin Eden, mais avec des billets plein les poches et une rente à vie proportionnée, on pourrait éventuellement se permettre de tolérer ses gros bras et sa veste crasseuse, et même peut-être de l'entendre débiter à longueur de journée des propos communistes, anarchistes, ou toute autre sorte de trucs en "iste" en rapport avec les classes populaires…
Je ne pense pas qu'il soit judicieux que j'en dévoile davantage. En ce qui concerne mon ressenti de lecture, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé ce roman de Jack London même si je lui trouve certains défauts. Au premier rang de ceux-ci, je considère qu'hormis le personnage principal, tous sont monolithiques, simplistes voire caricaturaux. Les deux beaux-frères de Martin, par exemples, unilatéralement bêtes et méchants. Maria, sa logeuse portugaise, qui, elle, est bonne et secourable à l'excès, presque toujours de façon univoque.
On voit beaucoup Martin Eden évoluer dans le roman, tant dans sa façon d'être, de s'exprimer que dans sa psychologie. Ceci se comprend facilement en raison de sa jeunesse et des expériences formatrices qu'il vit. En revanche, et bien qu'il côtoie d'autres jeunes personnes, au premier rang desquelles figure bien évidemment Ruth, j'ai le sentiment qu'elles demeurent toujours et invariablement telles qu'elles étaient quand l'auteur nous les a présentées plusieurs années auparavant. Elles ne s'épaississent ni ne se complexifient au fil de la narration.
Martin lui-même est toujours le bon Samaritain, qui vient toujours en aide aux démunis, qui donne même parfois les dollars qu'il n'a pas, tel un agneau sacrificiel alors qu'on nous l'a montré constamment comme un taureau écumant lancé dans l'arène de la vie. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire d'un point de vue psychologique.
J'irai même encore un peu plus loin sur ce volet de psychologie paradoxale du personnage. Tout au long du roman, il passe son temps à considérer pour rien la reconnaissance financière. Et que fait-il, lui, lorsqu'il se donne pour objectif de témoigner son estime à quelqu'un ? Il lui donne de l'argent… Surprenant, non ?
Bref, je vais m'arrêter là. En somme, d'après mes critères, un roman de formation intéressant, une sorte d'Illusions Perdues à la sauce américaine, mais pas un chef-d'oeuvre pour tout un tas de petites incohérences psychologiques dont je n'ai pas l'intention de faire le panorama complet. (J'aurais pu, par exemple, m'étendre sur le tableau à mon goût trop idyllique que l'auteur peint de l'amour de Martin pour Ruth, évoquer les personnages de Lizzie ou Joe le blanchisseur, etc.) Mais le mieux, c'est bien évidemment de vous en faire votre propre opinion par vous-même en le lisant et, si possible, en partageant votre ressenti afin que chacun s'enrichisse de la vision de l'autre.
Tout bien considéré, aurez-vous le coeur d'ouvrir une porte sur ce roman ? Pourrez-vous la refermer tranquillement lorsque vous l'aurez entrouverte ? Telle est la question. Pour le reste, ceci n'est qu'un avis, un de plus, et avait-il lieu d'être, car qu'est-il dans le fond ? Pas grand-chose, par les temps qui courent…
P. S. : Bon sang, 10 ans !… Je n'arrive pas à y croire : voilà aujourd'hui pile dix ans, jour pour jour, que je me suis inscrite sur Babelio… Je ne pensais pas que l'histoire aurait duré aussi longtemps… Depuis tout ce temps, vous avez sans doute constaté que j'ai eu des hauts et des bas — plus ou moins haut ou plus ou moins bas selon l'estime ou l'intérêt qu'on porte à ce que j'écris…
Ainsi, en dix ans, j'ai reçu des tonnes de messages vraiment sympas, vraiment stimulants, vraiment intéressants ; j'ai aussi reçu, comme tout le monde, des monceaux de messages ineptes ou orduriers, méprisants, vomissants, dégoulinants d'on-ne-sait-quoi, en somme, l'exact reflet de ce qu'on croise ailleurs dans le monde, le meilleur comme le pire s'y côtoient en permanence, parfois étroitement imbriqués, parfois à quelques secondes d'intervalle, parfois au même endroit…
Bref, c'est la vie ! (J'aime cette expression typiquement francophone que beaucoup de langues nous envient. Je l'aime parce qu'elle rend bien compte du hasard, de l'absence de sens qu'il y a dans l'enchaînement des faits et des événements, du caractère éminemment contingent de l'existence, de son imprévisibilité, de son insoutenable légèreté, comme aurait écrit quelqu'un…)
Eh bien, d'après moi, c'est là tout l'enjeu du roman. Que se passe-t-il lorsqu'on franchit le seuil d'une porte ? Y a-t-il un retour en arrière possible ? Martin Eden est un rude gaillard de la classe populaire. Un gars qui s'est forgé à la force des poings et à la sueur de son front. Il est né dans une famille qui avait déjà bien d'autres chats à fouetter pour se maintenir à flot que d'offrir au jeune Martin le confort, le savoir ou l'affection.
En pareil cas, certains tombent dans l'alcool, la délinquance ou vivotent en s'érodant la santé pour un misérable salaire de cacahuètes à décortiquer. Martin a connu ça et même un peu plus que ça. Il a versé dans presque tous les travers qui s'offrent aux gens de sa catégorie. En plus, il a baroudé, il a connu des filles, il a commencé d'user sa fringante jeunesse sur les bateaux et dans les ports du Pacifique. Trente-six métiers, trente-six misères, comme on dit…
Mais Martin a soif de vivre ; il aime la vie : il la mord à pleines dents et brûle les journées par les deux bouts. Il sait qu'il est malin et il a foi en lui. Il sait, tout au fond de lui-même, qu'il n'est pas exactement de la même étoffe que celles et ceux qu'il côtoie ordinairement. Il a une volonté de réussir, mais pas de cette volonté vulgaire qui consiste à s'assurer une aisance matérielle, pas de cette réussite ordinaire qui se mesure à l'épaisseur du matelas de dollars sur lequel vous pouvez vous endormir chaque soir.
Non, la réussite qu'il vise, lui, concerne les choses de l'esprit. Il a soif d'apprendre, d'apprendre sur tout et partout, d'apprendre tout le temps, d'apprendre encore. C'est un observateur aigu des choses, du monde et des gens qu'il côtoie. Il en sait déjà très long sur la vie malgré son jeune âge (autour de la vingtaine) mais, au hasard d'une rixe dans la rue (à laquelle il décidera de prendre part, juste pour satisfaire à un noble instinct mais aussi, peut-être, pour la joie, pour la satisfaction intime de pouvoir coller un pain dans la gueule de quelqu'un), une rixe, disais-je, (entre un rupin et un homme de rien), une rixe donc, à l'issue de laquelle Martin Eden ouvrira une porte… une porte sur l'inconnu…
Quand Martin ouvre cette porte, entre chez ce jeune bourgeois ou, plus exactement, chez ses parents, il se sent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'un coup, sa langue lui semble aussi épaisse et gluante que celle d'un gros lézard, propre à faire un sort aux insectes mais certainement pas de cueillir les raffinés pétales de l'existence, affreusement inapte à siroter les nectars ou les perles de rosée sur les flûtes en cristal. Lui trébuche, écorche, écorne, éborgne l'anglais à chaque virage quand eux, eux, ces gens éthérés, aux mains si blanches, si fines, si impeccables qu'on pourrait presque voir au travers, tandis qu'eux volent dans les nuages de la syntaxe, utilisent des mots précieux, inconnus de lui, qui brillent en leur bouche comme un chapelet d'étoiles sur le drap noir des nuits immaculées… immaculées…
Immaculée aussi cette jeune femme aux yeux, au teint, aux cheveux, si bleus, si blanc, si blonds, la soeur de celui qu'il a aidé dans la rue. Qu'est-il, lui, Martin Eden ? Lui le sait, lui s'en doute, lui le sent palpiter dans ses veines. Mais eux, eux, qu'en savent-ils ? S'imaginent-ils seulement qu'il puisse avoir une quelconque parcelle d'étoile cachée en lui, ensevelie sous les tonnes de fange qu'ont déjà remuées ses mains et sa langue ?
Il aimerait pourtant tellement le lui dire à elle, le lui faire comprendre, le lui faire vivre, qu'il possède lui aussi des trésors. Elle est si belle, si gracieuse, si distinguée quand elle parle, si cultivée quant aux livres. Les livres ! Les livres ! Bon dieu, oui, c'est cela, les livres ! L'abîme, le fossé, l'escarpe qui existe entre lui et elle est un gouffre empli de livres qu'il lui faudra traverser s'il escompte un jour la rejoindre, sur l'autre rive du savoir et de la culture…
L'écart mais aussi le lien entre elle et lui est un livre. Un livre entre sa main à elle et sa main à lui. Et s'il l'avalait, ce livre ? Il n'y aurait ainsi plus d'écart entre sa main à elle et sa main à lui, n'est-ce pas ? Aïe, aïe, aïe. Bien plus facile à dire qu'à faire cette affaire-là. Mais il en faudrait d'avantage pour l'effrayer notre Martin Eden. S'il lui faut gravir une montagne de livres pour atteindre le sommet, il se fera alpiniste du savoir ; et s'il lui faut franchir des crevasses vertigineuses, il utilisera le piolet de son courage et de sa bouillante énergie.
Car les espoirs qu'il met en Ruth Morse justifient pour lui tous les efforts, tous les sacrifices. (Je m'arrête quelques secondes pour souligner que Ruth est bien le prénom de la jeune fille et ne fait nullement référence à un quelconque état sexuel qu'éprouverait le jeune homme. Il en va de même du nom de famille qui est à rapprocher de l'inventeur de l'alphabet du même nom, bip - bip - biiiip - bip - bip - biiiip, et non de celui d'un quelconque animal à dents longues, aussi malhabile sur terre ferme que graisseux et dont l'anatomie ne rappelle en rien celle de la jeune fille.)
C'est donc tout cela que nous raconte Jack London dans ce roman très fréquemment autobiographique (à cet égard, la scène de la jeunesse de Martin Eden, obligé de se battre quasi-quotidiennement avec un enfant plus grand que lui, Tête-de-fromage, rappelle à s'y méprendre une scène similaire de Croc-Blanc où le jeune loup se fait rosser de la même façon par Lip-Lip jusqu'à ce qu'il parvienne à le battre). La lutte d'un jeune homme des classes populaires pour se faire une petite place dans un milieu lettré et intellectuel presque exclusivement gardé par les cerbères de la haute bourgeoisie.
Il est vrai qu'il n'a pas choisi le plus simple car en plus d'apprendre à parler correctement, il entend également apprendre à écrire. Il souhaite en effet faire sa route en tant qu'écrivain et même, espoir suprême, vivre dignement, honnêtement de sa plume. À ce prix et à ce prix seulement, pense-t-il, les bras de Ruth lui seront ouverts.
Vous aurez compris que le roman soulève beaucoup de questions : Est-il possible de s'extraire de son monde pour en atteindre un autre dont on ignore tous les codes ? L'amour est-il assez puissant pour surpasser les préjugés de classe ? Peut-on supporter le poids de vivre dans le no man's land situé entre les deux lignes de front constituées par l'ignorance crasse de vos anciens camarades et l'apparente inaccessibilité intellectuelle de ceux que vous aimeriez rallier ? Peut-on supporter l'étrange mélasse d'hypocrisie, d'effet de mode, de calcul, de flagornerie, de bienséance, de stratégies retorses et de sourires convenus dans les mondanités quand on a toujours eu à faire qu'à des gens vrais, aussi francs et généreux qu'un coup de poing dans le groin, aussi directs et naturels qu'un bon gros rot de marin après son verre de rhum ?
Et l'argent ? L'argent, oh, l'argent, l'argent… Tout le monde en veut de l'argent, et Martin Eden le premier. Il est tout prêt à jouer des poings pour lui. Et si les parents Morse ont une dent contre lui (pardonnez encore ce jeu de mots facile) c'est peut-être grandement et uniquement pour cela, l'argent. Car vous conviendrez qu'en terme de retour sur investissement, quand on dresse le bilan comptable de tout ce que l'on a déboursé dans l'élevage bio d'une jeune fille, intérêts et principal, et qu'on voit se pointer à la porte un Martin Eden avec ses gros bras et sa veste crasseuse, on se dit tout de même que c'est bien mince comme à valoir. Bon, imaginons le même Martin Eden, mais avec des billets plein les poches et une rente à vie proportionnée, on pourrait éventuellement se permettre de tolérer ses gros bras et sa veste crasseuse, et même peut-être de l'entendre débiter à longueur de journée des propos communistes, anarchistes, ou toute autre sorte de trucs en "iste" en rapport avec les classes populaires…
Je ne pense pas qu'il soit judicieux que j'en dévoile davantage. En ce qui concerne mon ressenti de lecture, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé ce roman de Jack London même si je lui trouve certains défauts. Au premier rang de ceux-ci, je considère qu'hormis le personnage principal, tous sont monolithiques, simplistes voire caricaturaux. Les deux beaux-frères de Martin, par exemples, unilatéralement bêtes et méchants. Maria, sa logeuse portugaise, qui, elle, est bonne et secourable à l'excès, presque toujours de façon univoque.
On voit beaucoup Martin Eden évoluer dans le roman, tant dans sa façon d'être, de s'exprimer que dans sa psychologie. Ceci se comprend facilement en raison de sa jeunesse et des expériences formatrices qu'il vit. En revanche, et bien qu'il côtoie d'autres jeunes personnes, au premier rang desquelles figure bien évidemment Ruth, j'ai le sentiment qu'elles demeurent toujours et invariablement telles qu'elles étaient quand l'auteur nous les a présentées plusieurs années auparavant. Elles ne s'épaississent ni ne se complexifient au fil de la narration.
Martin lui-même est toujours le bon Samaritain, qui vient toujours en aide aux démunis, qui donne même parfois les dollars qu'il n'a pas, tel un agneau sacrificiel alors qu'on nous l'a montré constamment comme un taureau écumant lancé dans l'arène de la vie. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire d'un point de vue psychologique.
J'irai même encore un peu plus loin sur ce volet de psychologie paradoxale du personnage. Tout au long du roman, il passe son temps à considérer pour rien la reconnaissance financière. Et que fait-il, lui, lorsqu'il se donne pour objectif de témoigner son estime à quelqu'un ? Il lui donne de l'argent… Surprenant, non ?
Bref, je vais m'arrêter là. En somme, d'après mes critères, un roman de formation intéressant, une sorte d'Illusions Perdues à la sauce américaine, mais pas un chef-d'oeuvre pour tout un tas de petites incohérences psychologiques dont je n'ai pas l'intention de faire le panorama complet. (J'aurais pu, par exemple, m'étendre sur le tableau à mon goût trop idyllique que l'auteur peint de l'amour de Martin pour Ruth, évoquer les personnages de Lizzie ou Joe le blanchisseur, etc.) Mais le mieux, c'est bien évidemment de vous en faire votre propre opinion par vous-même en le lisant et, si possible, en partageant votre ressenti afin que chacun s'enrichisse de la vision de l'autre.
Tout bien considéré, aurez-vous le coeur d'ouvrir une porte sur ce roman ? Pourrez-vous la refermer tranquillement lorsque vous l'aurez entrouverte ? Telle est la question. Pour le reste, ceci n'est qu'un avis, un de plus, et avait-il lieu d'être, car qu'est-il dans le fond ? Pas grand-chose, par les temps qui courent…
P. S. : Bon sang, 10 ans !… Je n'arrive pas à y croire : voilà aujourd'hui pile dix ans, jour pour jour, que je me suis inscrite sur Babelio… Je ne pensais pas que l'histoire aurait duré aussi longtemps… Depuis tout ce temps, vous avez sans doute constaté que j'ai eu des hauts et des bas — plus ou moins haut ou plus ou moins bas selon l'estime ou l'intérêt qu'on porte à ce que j'écris…
Ainsi, en dix ans, j'ai reçu des tonnes de messages vraiment sympas, vraiment stimulants, vraiment intéressants ; j'ai aussi reçu, comme tout le monde, des monceaux de messages ineptes ou orduriers, méprisants, vomissants, dégoulinants d'on-ne-sait-quoi, en somme, l'exact reflet de ce qu'on croise ailleurs dans le monde, le meilleur comme le pire s'y côtoient en permanence, parfois étroitement imbriqués, parfois à quelques secondes d'intervalle, parfois au même endroit…
Bref, c'est la vie ! (J'aime cette expression typiquement francophone que beaucoup de langues nous envient. Je l'aime parce qu'elle rend bien compte du hasard, de l'absence de sens qu'il y a dans l'enchaînement des faits et des événements, du caractère éminemment contingent de l'existence, de son imprévisibilité, de son insoutenable légèreté, comme aurait écrit quelqu'un…)
Magnifique livre jeunesse qui peut être lu à tout âge. C'est l'histoire d'un chien volé qui est conduit dans le grand nord pour servir d'équipier à un attelage. Cette malheureuse bête en fonction des maîtres auxquels elle sera vendue connaîtra un sort divers. Il subira parfois la violence des hommes, sera battu, connaîtra la faim. Il rencontrera aussi l'amitié des hommes et celle des autres chiens. Il redécouvrira aussi l'instinct de sa race, celui de ses ancêtres chiens, et livré à lui-même, redevenu libre, répondra à l'appel de la forêt.
Un bon roman à lire ou à redécouvrir.
Lien : http://araucaria.20six.fr
Un bon roman à lire ou à redécouvrir.
Lien : http://araucaria.20six.fr
Du conte apocalyptique à la fable humaniste.
En 2073, cela fait 60 ans que toute trace de civilisation a disparue. Si quelques tribus d’hommes survivent dans ses ruines, depuis longtemps ceux-ci n’en comprennent plus aucun signe. Le langage lui-même s’est modifié. L’art est devenu inutile, la culture se résumant à satisfaire ses besoins primaires.
Pourtant un homme se souvient. Le dernier à avoir connu les temps anciens d’une humanité que l’on disait moderne tient à partager son savoir avant qu’il ne soit trop tard. Même s’il est miraculeux qu’il soit encore en vie, il sait qu’il n’est pas éternel. Le phare de la mémoire dont il est le gardien va bientôt s’éteindre. Son appel sonne comme un avertissement aux anciennes générations que nous sommes, et aux nouvelles qui vont bientôt repeupler la Terre.
Jack London écrivit ce texte en 1912, quatre ans avant sa mort. Il sera publié pour la première fois en français, de façon posthume, en 1924 accompagné de "Construire un feu " et de "Comment disparut Marc O’Brien". Un récit d’anticipation qui peut se lire aujourd’hui encore comme une mise en garde pour toute l’humanité.
Lorsqu’on retrouve le vieil homme sur le sentier d’animaux sauvages, lui seul sait qu’il s’agit en fait d’une « antique voie ferrée ». Le jeune garçon qui l’accompagne est trop occupé à rester aux aguets pour prévenir toute attaque de grizzly qu’à comprendre et analyser le paysage qui l’entoure et dans lequel il est né. Une nature florissante à en effet envahi et petit à petit fait disparaître toute trace de constructions humaines. Mais même s’il doit passer encore pour un vieux radoteur d’histoires impossibles, le vieillard est bien décidé à lui expliquer comment était la vie avant le retour à la « la barbarie des premiers âges du monde ». Comment « dix mille années de culture et de civilisation s’évaporèrent comme l’écume, en un clin d’œil. »
C’est une épidémie foudroyante qui atout anéanti. Les hommes tombaient comme des mouches terrassés par une maladie qui les étreignait dans d’atroces souffrances, l’âme consciente et le corps « flamboyant d’écarlate ». Mais ce qui acheva la société est un tout autre fléau : « le temps n’était plus où l’on se dévouait pour les autres. Chacun lutter pour soi. » La folie se répandit dans le sillage de la pandémie, contaminant le cœur des hommes valides, mais dévastés par la peur : « ils lâchaient la bride à leur bestialité, s’enivraient et s’entretuaient. Peut-être, au fond, avaient-ils raison ? Ils ne faisaient rien que d’avancer la mort. »
Miraculeusement épargné, le vieil homme a vu le monde s’écrouler et s’il raconte tout aux enfants ce soir au coin du feu de leur campement, c’est parce qu’il a peur plus encore pour l’avenir. L’homme s’adapte, mais il ne change pas : « l’univers a été anéanti, bouleversé, et l’homme demeure toujours identique. » Les embryons de société qui se sont reconstruites, mais disparates et dispersées qu’elles le sont pour le moment, lui font craindre le pire. Car « les hommes se multiplieront, puis ils se battront entre eux. » La quête du pouvoir de l’Homme est tel qu’il rebâtira les mêmes esclavages : « les trois types éternels de domination, le prêtre, le soldat, le roi y repartiront d’eux-mêmes. »
Bien sûr on reconnaît dans ce dernier avertissement les engagements politiques de l’auteur, mais plus qu’un débat stérile sur sa rhétorique que d’aucuns trouveront surannée, l’alerte qu’il nous adresse il y a de cela plus d’un siècle est riche d’enseignement. Fondamentalement humaniste, ce texte plus que jamais actuel renferme aussi un formidable espoir. Le vieil homme a préféré prévenir que seulement avertir, en conservant les écrits du passé et en fabriquant un code pour leur compréhension, c’est une clé de la connaissance qu’il leur offre pour une construire une culture en accord avec la nature et dans le respect de toute l’humanité, car « un jour viendra où les hommes, moins occupés des besoins de leur vie matérielle, réapprendront à lire. »
En 2073, cela fait 60 ans que toute trace de civilisation a disparue. Si quelques tribus d’hommes survivent dans ses ruines, depuis longtemps ceux-ci n’en comprennent plus aucun signe. Le langage lui-même s’est modifié. L’art est devenu inutile, la culture se résumant à satisfaire ses besoins primaires.
Pourtant un homme se souvient. Le dernier à avoir connu les temps anciens d’une humanité que l’on disait moderne tient à partager son savoir avant qu’il ne soit trop tard. Même s’il est miraculeux qu’il soit encore en vie, il sait qu’il n’est pas éternel. Le phare de la mémoire dont il est le gardien va bientôt s’éteindre. Son appel sonne comme un avertissement aux anciennes générations que nous sommes, et aux nouvelles qui vont bientôt repeupler la Terre.
Jack London écrivit ce texte en 1912, quatre ans avant sa mort. Il sera publié pour la première fois en français, de façon posthume, en 1924 accompagné de "Construire un feu " et de "Comment disparut Marc O’Brien". Un récit d’anticipation qui peut se lire aujourd’hui encore comme une mise en garde pour toute l’humanité.
Lorsqu’on retrouve le vieil homme sur le sentier d’animaux sauvages, lui seul sait qu’il s’agit en fait d’une « antique voie ferrée ». Le jeune garçon qui l’accompagne est trop occupé à rester aux aguets pour prévenir toute attaque de grizzly qu’à comprendre et analyser le paysage qui l’entoure et dans lequel il est né. Une nature florissante à en effet envahi et petit à petit fait disparaître toute trace de constructions humaines. Mais même s’il doit passer encore pour un vieux radoteur d’histoires impossibles, le vieillard est bien décidé à lui expliquer comment était la vie avant le retour à la « la barbarie des premiers âges du monde ». Comment « dix mille années de culture et de civilisation s’évaporèrent comme l’écume, en un clin d’œil. »
C’est une épidémie foudroyante qui atout anéanti. Les hommes tombaient comme des mouches terrassés par une maladie qui les étreignait dans d’atroces souffrances, l’âme consciente et le corps « flamboyant d’écarlate ». Mais ce qui acheva la société est un tout autre fléau : « le temps n’était plus où l’on se dévouait pour les autres. Chacun lutter pour soi. » La folie se répandit dans le sillage de la pandémie, contaminant le cœur des hommes valides, mais dévastés par la peur : « ils lâchaient la bride à leur bestialité, s’enivraient et s’entretuaient. Peut-être, au fond, avaient-ils raison ? Ils ne faisaient rien que d’avancer la mort. »
Miraculeusement épargné, le vieil homme a vu le monde s’écrouler et s’il raconte tout aux enfants ce soir au coin du feu de leur campement, c’est parce qu’il a peur plus encore pour l’avenir. L’homme s’adapte, mais il ne change pas : « l’univers a été anéanti, bouleversé, et l’homme demeure toujours identique. » Les embryons de société qui se sont reconstruites, mais disparates et dispersées qu’elles le sont pour le moment, lui font craindre le pire. Car « les hommes se multiplieront, puis ils se battront entre eux. » La quête du pouvoir de l’Homme est tel qu’il rebâtira les mêmes esclavages : « les trois types éternels de domination, le prêtre, le soldat, le roi y repartiront d’eux-mêmes. »
Bien sûr on reconnaît dans ce dernier avertissement les engagements politiques de l’auteur, mais plus qu’un débat stérile sur sa rhétorique que d’aucuns trouveront surannée, l’alerte qu’il nous adresse il y a de cela plus d’un siècle est riche d’enseignement. Fondamentalement humaniste, ce texte plus que jamais actuel renferme aussi un formidable espoir. Le vieil homme a préféré prévenir que seulement avertir, en conservant les écrits du passé et en fabriquant un code pour leur compréhension, c’est une clé de la connaissance qu’il leur offre pour une construire une culture en accord avec la nature et dans le respect de toute l’humanité, car « un jour viendra où les hommes, moins occupés des besoins de leur vie matérielle, réapprendront à lire. »
Alors là, je dois avouer que j'en reste comme deux ronds de flan... Whaou, si on m'avait dit qu'à la lecture d'un roman mettant en scène la vie d'un animal je ressentirais autant d'émotions et que je me fendrais même d'une petite larme, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant... petite nature, va.
La Nature justement, parlons-en. Elle occupe tout le paysage du roman. Le Wild, le Grand Nord, territoire hostile et sauvage, livre ses secrets sous la houlette d'un écrivain de grand talent. L'écriture est simple et précise, elle fait mouche à chaque phrase. Le début du roman, incroyablement fort et angoissant, happe instantanément le lecteur le plus impavide. La suite ne démérite en rien, où l'on suit la croissance puis le parcours de Croc-Blanc, un jeune loup abâtardi de sang canin. Un voyage au royaume des hommes qui donne à réfléchir encore aujourd'hui.
Ma première réaction une fois ma lecture achevée fut l'étonnement. Je suis en effet très surprise que ce roman soit classé en catégorie jeunesse car je le trouve d'une violence terrible et les émotions qu'il fait naître me semblent de nature à fortement impressionner les jeunes lecteurs.
J'aime quand un livre me surprend, surtout en bien. J'avais ouvert "Croc-Blanc" parce qu'il évoquait des souvenirs d'enfance ; j'ai découvert un roman brillant que je ne suis pas prête d'oublier.
Challenge de lecture 2015 - Un livre de votre enfance
La Nature justement, parlons-en. Elle occupe tout le paysage du roman. Le Wild, le Grand Nord, territoire hostile et sauvage, livre ses secrets sous la houlette d'un écrivain de grand talent. L'écriture est simple et précise, elle fait mouche à chaque phrase. Le début du roman, incroyablement fort et angoissant, happe instantanément le lecteur le plus impavide. La suite ne démérite en rien, où l'on suit la croissance puis le parcours de Croc-Blanc, un jeune loup abâtardi de sang canin. Un voyage au royaume des hommes qui donne à réfléchir encore aujourd'hui.
Ma première réaction une fois ma lecture achevée fut l'étonnement. Je suis en effet très surprise que ce roman soit classé en catégorie jeunesse car je le trouve d'une violence terrible et les émotions qu'il fait naître me semblent de nature à fortement impressionner les jeunes lecteurs.
J'aime quand un livre me surprend, surtout en bien. J'avais ouvert "Croc-Blanc" parce qu'il évoquait des souvenirs d'enfance ; j'ai découvert un roman brillant que je ne suis pas prête d'oublier.
Challenge de lecture 2015 - Un livre de votre enfance
L'Appel de la forêt (ou L'Appel sauvage dans sa plus récente traduction) est chronologiquement le premier roman de Jack London ayant pour personnage principal un chien. Il y aura ensuite Croc-Blanc ; Jerry, chien des îles et enfin Michael, chien de cirque. Ce premier ouvrage est resté probablement le plus célèbre (quoique talonné de fort près par Croc-Blanc).
L'Appel de la forêt raconte comment, après moult péripéties, un chien californien, arraché à ses maîtres, finira par redevenir sauvage dans les montagnes arctiques d'Alaska à l'époque de la ruée vers l'or, au tout, tout début du XXème siècle.
À de très multiples égards, Croc-Blanc est un symétrique inversé de cet Appel de la forêt : la situation finale de l'un étant le début de l'autre et réciproquement. J'imagine que suite au succès rencontré par le premier (et donc aux rentrées d'argent subséquentes), grande était la tentation pour Jack London — qui entendait vivre de sa plume —, de resservir le couvert sur un thème équivalent. C'est ce qu'il fit avec Croc-Blanc et il le fit très bien car, selon moi, il a su gommer dans le deuxième roman bon nombre des petites maladresses qui émaillaient ce premier opus.
En premier lieu, le côté « super héros » du héros. Ici, le héros se prénomme Buck, c'est un croisé saint-bernard et berger écossais, qui vit paisiblement dans une sorte de grande hacienda californienne, jusqu'au jour où… sa vie bascule. Et là, de rudoiement en périple, d'odyssée en calvaire, Buck va s'avérer, dans le grand nord américain situé entre Alaska et Canada, être un super athlète du genre canin, un colosse d'airain, plus intelligent, plus puissant, plus endurant, plus résistant, plus menaçant, plus je-ne-sais-quoi encore en « ant » que tous les autres, huskies et loups compris. Bref, tellement plus « plus » que cela en devient peu crédible, et c'est selon moi un défaut que l'auteur corrigera quelque peu avec son héros dans Croc-Blanc.
En second lieu, la succession un peu artificielle des différents propriétaires de Buck. Car Buck, il faut bien le reconnaître, en ces contrées hostiles du Klondike, où la découverte de l'or faisait tourner les têtes au tournant du XXème siècle, comme tous les autres chiens de traîneau, était ravalé au statut de marchandise, et, en qualité de marchandise, avait non pas un maître mais un propriétaire. Et on peut tout de même considérer que de propriétaires, Buck en a eu beaucoup : j'en ai dénombré au moins six sans compter l'infâme Manuel, l'assistant jardinier, par l'entremise duquel tout arrive. Ça fait peut-être un peu trop, six propriétaires dans une vie de chien, sachant que sa vie est encore loin d'être terminée en fin d'ouvrage. On a l'impression que dès que l'auteur n'a plus besoin d'un personnage, il le jette et s'empresse de redonner un nouveau maître à Buck. Jack London se limitera à trois pour Croc-Blanc.
En troisième lieu, j'ai tendance à être assez mitigée, voire très, lorsqu'à plusieurs reprises l'auteur nous fait état d'un supposé atavisme, à mi-chemin entre le chamanisme et la génétique, qui ferait que Buck « ressentirait » au fond de son être une disposition primitive et aurait comme « en mémoire » une représentation de l'homme préhistorique et de ses attributs, ce qui faciliterait son retour à la vie sauvage. Ça ne correspond ni à ce dont j'avais l'intuition auparavant, ni à ce que dit la recherche actuelle après vérification, c'est même tout le contraire : les chiens sont de plus en plus adaptés à la sphère anthropique et plus loin que jamais de leur ancêtre sauvage, le loup. Des compétences nouvelles apparaissent (comme suivre le pointage du doigt d'un humain) et d'anciennes disparaissent (comme se déplacer dans une même direction sur des centaines de kilomètres) : on est sur la voie d'une spéciation. le portrait comportemental de Croc-Blanc me semble beaucoup plus réaliste sur ce point : même à la fin, il demeure « handicapé » des attributs propres au chien.
Ma quatrième remarque, quelque peu en lien avec la troisième, a trait à une espèce de destinée qui transparaît en fil conducteur tout au long de la narration et qui ferait état d'une manière de prédestination de Buck à la vie sauvage. En fait, ce qui me pousse à croire qu'il s'agit d'une maladresse, c'est que cela n'est présent que pour étayer la symbolique et le message que souhaite distiller Jack London : faire l'éloge du côté brut de la nature, du retour à la force originelle, loin de l'affaiblissement généralisé de la vie civilisée. Buck est fort et il a le caractère franc, il fait les choses par conviction et non par intérêt ; bref, tout le contraire de l'image que se faisait London du citadin moyen. Donc le roman sonne à mes oreilles comme un message à l'adresse des humains, où l'animal n'est que le moyen de véhiculer ce message. C'est tout à fait différent dans Croc-Blanc et surtout dans les deux derniers romans sur les chiens où la relation homme-chien est réellement au coeur des ouvrages et me semble tellement plus pertinente.
J'imagine qu'il n'est pas utile de continuer plus longuement ce bilan « à charge » de L'Appel de la forêt comparativement aux autres romans de l'auteur dédiés aux chiens. Cela avait juste pour objectif (et non pour prétention) de comparer et peut-être de rééquilibrer les « valeurs » supposées des uns et des autres pour des lecteurs qui n'auraient lu aucun de ceux-là. L'Appel de la forêt est extrêmement célèbre, les deux derniers comparativement beaucoup moins alors que leurs qualités respectives ne m'apparaissent pas significativement inférieures, c'est même, à mes yeux, tout le contraire.
Pour le reste, c'est tout de même un roman très agréable à lire, même s'il est un tout petit peu téléphoné par moments, on ne s'y ennuie guère. Toutefois et ce sera mon dernier mot, si vous n'aviez qu'un seul roman de cet auteur à choisir concernant les chiens, et en dépit de sa popularité, j'aurais tendance à ne pas vous conseiller celui-ci. Mais comme d'habitude, vous savez à présent que ceci n'est que mon avis, qu'il n'engage absolument que moi (et encore) et surtout que comme chacun de nous possède un avis différent, celui-ci, à lui tout seul ne signifie pas grand-chose.
L'Appel de la forêt raconte comment, après moult péripéties, un chien californien, arraché à ses maîtres, finira par redevenir sauvage dans les montagnes arctiques d'Alaska à l'époque de la ruée vers l'or, au tout, tout début du XXème siècle.
À de très multiples égards, Croc-Blanc est un symétrique inversé de cet Appel de la forêt : la situation finale de l'un étant le début de l'autre et réciproquement. J'imagine que suite au succès rencontré par le premier (et donc aux rentrées d'argent subséquentes), grande était la tentation pour Jack London — qui entendait vivre de sa plume —, de resservir le couvert sur un thème équivalent. C'est ce qu'il fit avec Croc-Blanc et il le fit très bien car, selon moi, il a su gommer dans le deuxième roman bon nombre des petites maladresses qui émaillaient ce premier opus.
En premier lieu, le côté « super héros » du héros. Ici, le héros se prénomme Buck, c'est un croisé saint-bernard et berger écossais, qui vit paisiblement dans une sorte de grande hacienda californienne, jusqu'au jour où… sa vie bascule. Et là, de rudoiement en périple, d'odyssée en calvaire, Buck va s'avérer, dans le grand nord américain situé entre Alaska et Canada, être un super athlète du genre canin, un colosse d'airain, plus intelligent, plus puissant, plus endurant, plus résistant, plus menaçant, plus je-ne-sais-quoi encore en « ant » que tous les autres, huskies et loups compris. Bref, tellement plus « plus » que cela en devient peu crédible, et c'est selon moi un défaut que l'auteur corrigera quelque peu avec son héros dans Croc-Blanc.
En second lieu, la succession un peu artificielle des différents propriétaires de Buck. Car Buck, il faut bien le reconnaître, en ces contrées hostiles du Klondike, où la découverte de l'or faisait tourner les têtes au tournant du XXème siècle, comme tous les autres chiens de traîneau, était ravalé au statut de marchandise, et, en qualité de marchandise, avait non pas un maître mais un propriétaire. Et on peut tout de même considérer que de propriétaires, Buck en a eu beaucoup : j'en ai dénombré au moins six sans compter l'infâme Manuel, l'assistant jardinier, par l'entremise duquel tout arrive. Ça fait peut-être un peu trop, six propriétaires dans une vie de chien, sachant que sa vie est encore loin d'être terminée en fin d'ouvrage. On a l'impression que dès que l'auteur n'a plus besoin d'un personnage, il le jette et s'empresse de redonner un nouveau maître à Buck. Jack London se limitera à trois pour Croc-Blanc.
En troisième lieu, j'ai tendance à être assez mitigée, voire très, lorsqu'à plusieurs reprises l'auteur nous fait état d'un supposé atavisme, à mi-chemin entre le chamanisme et la génétique, qui ferait que Buck « ressentirait » au fond de son être une disposition primitive et aurait comme « en mémoire » une représentation de l'homme préhistorique et de ses attributs, ce qui faciliterait son retour à la vie sauvage. Ça ne correspond ni à ce dont j'avais l'intuition auparavant, ni à ce que dit la recherche actuelle après vérification, c'est même tout le contraire : les chiens sont de plus en plus adaptés à la sphère anthropique et plus loin que jamais de leur ancêtre sauvage, le loup. Des compétences nouvelles apparaissent (comme suivre le pointage du doigt d'un humain) et d'anciennes disparaissent (comme se déplacer dans une même direction sur des centaines de kilomètres) : on est sur la voie d'une spéciation. le portrait comportemental de Croc-Blanc me semble beaucoup plus réaliste sur ce point : même à la fin, il demeure « handicapé » des attributs propres au chien.
Ma quatrième remarque, quelque peu en lien avec la troisième, a trait à une espèce de destinée qui transparaît en fil conducteur tout au long de la narration et qui ferait état d'une manière de prédestination de Buck à la vie sauvage. En fait, ce qui me pousse à croire qu'il s'agit d'une maladresse, c'est que cela n'est présent que pour étayer la symbolique et le message que souhaite distiller Jack London : faire l'éloge du côté brut de la nature, du retour à la force originelle, loin de l'affaiblissement généralisé de la vie civilisée. Buck est fort et il a le caractère franc, il fait les choses par conviction et non par intérêt ; bref, tout le contraire de l'image que se faisait London du citadin moyen. Donc le roman sonne à mes oreilles comme un message à l'adresse des humains, où l'animal n'est que le moyen de véhiculer ce message. C'est tout à fait différent dans Croc-Blanc et surtout dans les deux derniers romans sur les chiens où la relation homme-chien est réellement au coeur des ouvrages et me semble tellement plus pertinente.
J'imagine qu'il n'est pas utile de continuer plus longuement ce bilan « à charge » de L'Appel de la forêt comparativement aux autres romans de l'auteur dédiés aux chiens. Cela avait juste pour objectif (et non pour prétention) de comparer et peut-être de rééquilibrer les « valeurs » supposées des uns et des autres pour des lecteurs qui n'auraient lu aucun de ceux-là. L'Appel de la forêt est extrêmement célèbre, les deux derniers comparativement beaucoup moins alors que leurs qualités respectives ne m'apparaissent pas significativement inférieures, c'est même, à mes yeux, tout le contraire.
Pour le reste, c'est tout de même un roman très agréable à lire, même s'il est un tout petit peu téléphoné par moments, on ne s'y ennuie guère. Toutefois et ce sera mon dernier mot, si vous n'aviez qu'un seul roman de cet auteur à choisir concernant les chiens, et en dépit de sa popularité, j'aurais tendance à ne pas vous conseiller celui-ci. Mais comme d'habitude, vous savez à présent que ceci n'est que mon avis, qu'il n'engage absolument que moi (et encore) et surtout que comme chacun de nous possède un avis différent, celui-ci, à lui tout seul ne signifie pas grand-chose.
Il fallait que j’aille au bout et je ne cache pas que ce fut long et pénible, comme la vie de Martin Eden, sortie de l’imagination du grand Jack London (1876 – 1916), de son vrai nom John Griffith Chaney, dont je me souviens avoir lu Croc-Blanc, il y a bien longtemps…
C’est le film superbe de Pietro Marcello que j’ai vu dans le cadre du Festival international du Premier film d’Annonay, qui a motivé la lecture du roman. Durant celle-ci, j’ai eu l’image de Luca Marcinelli qui campe un formidable Martin Eden. Mais quelle belle idée d’avoir situé l’histoire en Italie, à Naples, en lieu et place d’Oakland, de l’autre côté de la baie de San Francisco où Jack London a vu le jour et a vécu ! J’aurais adoré que le roman se passe dans ce cadre napolitain qui offre tellement plus de ressources à l’imaginaire et au rêve.
Malgré tout, je reconnais que le tableau de la société californienne du début du XXe siècle, dressé par l’auteur de L’Appel de la forêt, est fort instructif et éloquent. Le peuple se débat dans la misère, constituant une classe laborieuse exploitée au maximum alors que la bourgeoisie étale insolemment sa richesse tout en méprisant celles et ceux qui créent cette richesse par leur travail. Ah bon ? Ça n’a pas beaucoup changé ?...
Même si Philippe Jaworski, professeur émérite à l’Université Paris Diderot, qui préface longuement le livre et assure un dossier complet, le conteste, il est certain que Jack London a mis beaucoup de son vécu dans son récit.
Avec une verve incroyable, un débit littéraire abondant, il campe un homme parti de rien, issu des plus basses couches du peuple, qui tente de se faire une place dans la littérature par la seule force de son travail, de l’étude solitaire. Il réussit à écrire, met sa santé en danger, souffre de la faim, se prive de sommeil pour réussir à parvenir au bout de son rêve fou.
Martin Eden était marin, se battait facilement pour se faire respecter mais, pour avoir porté secours à un jeune bourgeois, découvre un autre monde qui le fascine au début et tombe amoureux de Ruth qui l’éblouit et l’émerveille.
Séduit d’abord par les idées socialistes, ses lectures le poussent vers toujours plus d’individualisme. L’argent lui manque terriblement. Il tente de faire publier ses textes dans des magazines mais tous refusent. Malgré tout, il continue, écrit sans cesse, rêve de succès, suit les conseils de Russ Brissenden, un poète social et suicidaire.
Dans Martin Eden, Jack London montre toute la vanité du succès littéraire. Un écrivain de grand talent peut rester méconnu jusqu’au bout si personne ne lui donne sa chance. Le succès peut survenir par le plus grand des hasards et un phénomène de mode s’empare alors du public, phénomène que les médias et les réseaux sociaux aujourd’hui tentent toujours d’amplifier.
À ce moment-là, que devient l’homme ? Ici, Jack London se montre très pessimiste. Dès que le succès tant attendu arrive, Martin Eden est incapable d’écrire. Il ne rédige plus une ligne et j’ai trouvé cela la pire chose qui puisse arriver à un homme qui a tout sacrifié à la littérature.
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
C’est le film superbe de Pietro Marcello que j’ai vu dans le cadre du Festival international du Premier film d’Annonay, qui a motivé la lecture du roman. Durant celle-ci, j’ai eu l’image de Luca Marcinelli qui campe un formidable Martin Eden. Mais quelle belle idée d’avoir situé l’histoire en Italie, à Naples, en lieu et place d’Oakland, de l’autre côté de la baie de San Francisco où Jack London a vu le jour et a vécu ! J’aurais adoré que le roman se passe dans ce cadre napolitain qui offre tellement plus de ressources à l’imaginaire et au rêve.
Malgré tout, je reconnais que le tableau de la société californienne du début du XXe siècle, dressé par l’auteur de L’Appel de la forêt, est fort instructif et éloquent. Le peuple se débat dans la misère, constituant une classe laborieuse exploitée au maximum alors que la bourgeoisie étale insolemment sa richesse tout en méprisant celles et ceux qui créent cette richesse par leur travail. Ah bon ? Ça n’a pas beaucoup changé ?...
Même si Philippe Jaworski, professeur émérite à l’Université Paris Diderot, qui préface longuement le livre et assure un dossier complet, le conteste, il est certain que Jack London a mis beaucoup de son vécu dans son récit.
Avec une verve incroyable, un débit littéraire abondant, il campe un homme parti de rien, issu des plus basses couches du peuple, qui tente de se faire une place dans la littérature par la seule force de son travail, de l’étude solitaire. Il réussit à écrire, met sa santé en danger, souffre de la faim, se prive de sommeil pour réussir à parvenir au bout de son rêve fou.
Martin Eden était marin, se battait facilement pour se faire respecter mais, pour avoir porté secours à un jeune bourgeois, découvre un autre monde qui le fascine au début et tombe amoureux de Ruth qui l’éblouit et l’émerveille.
Séduit d’abord par les idées socialistes, ses lectures le poussent vers toujours plus d’individualisme. L’argent lui manque terriblement. Il tente de faire publier ses textes dans des magazines mais tous refusent. Malgré tout, il continue, écrit sans cesse, rêve de succès, suit les conseils de Russ Brissenden, un poète social et suicidaire.
Dans Martin Eden, Jack London montre toute la vanité du succès littéraire. Un écrivain de grand talent peut rester méconnu jusqu’au bout si personne ne lui donne sa chance. Le succès peut survenir par le plus grand des hasards et un phénomène de mode s’empare alors du public, phénomène que les médias et les réseaux sociaux aujourd’hui tentent toujours d’amplifier.
À ce moment-là, que devient l’homme ? Ici, Jack London se montre très pessimiste. Dès que le succès tant attendu arrive, Martin Eden est incapable d’écrire. Il ne rédige plus une ligne et j’ai trouvé cela la pire chose qui puisse arriver à un homme qui a tout sacrifié à la littérature.
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
Je dirais que Jack London a eu cette magie de nous illustrer aussi simplement ce que c'est l'esclavage, l'oppression ou encore le manque de liberté à travers un chien Buck, qui, vendu, par le jardinier de son patron, d'un maître à un autre, se retrouvera au nord soumis aux ordres des chercheurs d'or...
Un beau récit, fluide et poignant en même temps. On suit le parcours de Buck tout en oubliant que c'est d'un chien qu'il s'agit tant l'auteur sait nous faire vivre ses émotions, ses angoisses, cette volonté de vouloir exister, de résister... Buck va connaitre plusieurs moments troublants pour parvenir à avoir la maîtrise sur ce petit monde aussi bien entre eux les chiens qu'avec leurs maîtres, les hommes. L'auteur lui fait porter une intelligence qui lui permettra d'avoir aussi lentement et surement une quelconque influence ...et de là mijoter une voie vers la liberté...
Un beau récit, fluide et poignant en même temps. On suit le parcours de Buck tout en oubliant que c'est d'un chien qu'il s'agit tant l'auteur sait nous faire vivre ses émotions, ses angoisses, cette volonté de vouloir exister, de résister... Buck va connaitre plusieurs moments troublants pour parvenir à avoir la maîtrise sur ce petit monde aussi bien entre eux les chiens qu'avec leurs maîtres, les hommes. L'auteur lui fait porter une intelligence qui lui permettra d'avoir aussi lentement et surement une quelconque influence ...et de là mijoter une voie vers la liberté...
Bon, je crois que tout le monde connait l'histoire de Buck, le chien du juge Miller, qui coulait des jours heureux dans une belle propriété de Californie. Mais en ce temps-là, des hommes partaient par milliers dans le grand froid à la recherche de l'or, en poudre ou en paillettes. Et pour conduire leurs aventures, ils avaient besoin de chiens de traineau. Manuel, le jardinier des Miller, en est bien conscient, et vend Buck, qui quitte la douceur du climat californien pour les terres neigeuses et désertiques du grand nord américain.
Buck apprend sa nouvelle vie, à grands coups de bâton et l'estomac creux, au milieu d'hommes pas vraiment tendres, et dans une troupe de chiens, pas vraiment indulgents envers sa naïveté. Mais sous son pelage habitué à la caresse, la vraie nature de Buck ne va pas tarder à poindre.
L'appel de la forêt, c'est un livre que j'ai lu à 10 ans, et qui m'avait laissé un souvenir fabuleux. J'avoue avoir eu peur d'être déçue en reprenant cette lecture, mais c'était sans compter le talent de Jack London. On peut lire ce livre pour l'histoire, pour vivre et souffrir avec Buck, découvrir le plaisir grisant des grandes terres désertiques, se battre pour atteindre la position de mâle dominant, se confronter à des hommes aussi bêtes que frustres, quand ils ne sont pas simplement méchants et cruels, s'épanouir dans le regard du "Maitre", celui à qui l'on dédie sa vie quand on le trouve, et écouter le bruissement de la forêt, qui porte les secrets et les mystères de la nature de Buck. Et, et c'est là à mon sens un des grands points forts de l'œuvre, on ne tombe jamais dans l'anthropomorphisme !
On peut aussi apprécier cette ode au grand nord, cette admiration sous-jacente pour ceux qui tentent d'apprivoiser un univers encore sauvage. Au-delà des mauvais traitements cruels que narre London, on sent bien que la vie dans ce grand nord est rude, qu'elle nécessite des lois dures, mais pas forcément exemptes de justice. La synergie chiens-hommes est indispensable pour parcourir les territoires désolés et humaniser ces grands espaces.
Enfin, et forcément, c'est mon cas, on peut être sensible à la transformation du chien du juge en loup. J'ai toujours aimé les histoires de "Loups", celles qui font peur aux petits enfants. Et dans la plupart de ces histoires, le loup se cache dans la forêt, et l'on n’entend que le bruit de sa présence, et parfois, quand le temps est venu, son appel… Je ne peux donc être que charmée par cet Appel de la forêt, dans lequel London réussit le tour de force de faire d'un chien, qui a un comportement de chien, qui agit comme un chien, un héros universel : grattons le pelage bien brossé du chien de compagnie, et nous trouverons, au fur et à mesure que tombent les diverses couches posées par la civilisation, ce qu'il y avait au départ, à l'origine : le loup !
Un livre parle, nourrit son lecteur, qui en fonction de ses expériences, de ses préoccupations, de ses affinités, y prendra ce qui lui sera le plus utile. Mais quoi que l'on prenne dans L'appel de la forêt, on pourra toujours apprécier l'écriture fluide et rude d'un grand écrivain !
Buck apprend sa nouvelle vie, à grands coups de bâton et l'estomac creux, au milieu d'hommes pas vraiment tendres, et dans une troupe de chiens, pas vraiment indulgents envers sa naïveté. Mais sous son pelage habitué à la caresse, la vraie nature de Buck ne va pas tarder à poindre.
L'appel de la forêt, c'est un livre que j'ai lu à 10 ans, et qui m'avait laissé un souvenir fabuleux. J'avoue avoir eu peur d'être déçue en reprenant cette lecture, mais c'était sans compter le talent de Jack London. On peut lire ce livre pour l'histoire, pour vivre et souffrir avec Buck, découvrir le plaisir grisant des grandes terres désertiques, se battre pour atteindre la position de mâle dominant, se confronter à des hommes aussi bêtes que frustres, quand ils ne sont pas simplement méchants et cruels, s'épanouir dans le regard du "Maitre", celui à qui l'on dédie sa vie quand on le trouve, et écouter le bruissement de la forêt, qui porte les secrets et les mystères de la nature de Buck. Et, et c'est là à mon sens un des grands points forts de l'œuvre, on ne tombe jamais dans l'anthropomorphisme !
On peut aussi apprécier cette ode au grand nord, cette admiration sous-jacente pour ceux qui tentent d'apprivoiser un univers encore sauvage. Au-delà des mauvais traitements cruels que narre London, on sent bien que la vie dans ce grand nord est rude, qu'elle nécessite des lois dures, mais pas forcément exemptes de justice. La synergie chiens-hommes est indispensable pour parcourir les territoires désolés et humaniser ces grands espaces.
Enfin, et forcément, c'est mon cas, on peut être sensible à la transformation du chien du juge en loup. J'ai toujours aimé les histoires de "Loups", celles qui font peur aux petits enfants. Et dans la plupart de ces histoires, le loup se cache dans la forêt, et l'on n’entend que le bruit de sa présence, et parfois, quand le temps est venu, son appel… Je ne peux donc être que charmée par cet Appel de la forêt, dans lequel London réussit le tour de force de faire d'un chien, qui a un comportement de chien, qui agit comme un chien, un héros universel : grattons le pelage bien brossé du chien de compagnie, et nous trouverons, au fur et à mesure que tombent les diverses couches posées par la civilisation, ce qu'il y avait au départ, à l'origine : le loup !
Un livre parle, nourrit son lecteur, qui en fonction de ses expériences, de ses préoccupations, de ses affinités, y prendra ce qui lui sera le plus utile. Mais quoi que l'on prenne dans L'appel de la forêt, on pourra toujours apprécier l'écriture fluide et rude d'un grand écrivain !
Martin Eden, un solide marin de 20 ans ayant quitté l'école à 11 pour travailler à l'usine, n'a pas les bonnes manières de Nadine de Rotschild et il en a conscience quand il s'assoit à la table des Morse, une famille bourgeoise de San Francisco.
Nous sommes à peu près au début de 20ème siècle. Et les conditions de travail sont difficiles pour les ouvriers, l'alcool les aide souvent à oublier. D'ailleurs avant de faire la connaissance de la délicate Ruth Morse, Martin Eden n'envisageait pas une bonne soirée sans une bonne bagarre pour terminer son parcours éthylique.
Mais cette rencontre va changer sa vie. Quand le lecteur entre dans le carré de lumière que fait la porte ouverte de Martin Eden, il l'aperçoit, allongé sur son lit couvert de livres ouverts, lisant puis prenant des notes.
Un long et riche cheminement s'en suivra, parsemé de livres, de rencontres et d'obstacles jusqu'aux 50 dernières pages avec un dénouement qui laisse pantois. Mais c'est sublime!
Jack London se réfère souvent à la pensée nietzschéenne de surhumain/surhomme et l' illustre de manière très compréhensible avec le parcours de Martin Eden. Pour mieux la contrer finalement et avec, le schéma très américain de la réussite grâce à l'individualisme.
Pour tirer un enseignement sur un point toujours d'actualité qui m'est cher: alors que l'ascenseur social est en panne, comment ne pas s'interroger pour un meilleur système éducatif. Ce point m'a hanté pendant cette lecture et me hantera encore..
Et avec ceci, c'est un livre qui aborde bien d'autres thèmes: une histoire d'amour entre une belle et une bête, le monde éditorial au début du 20ème, le monde ouvrier et le roulis des épaules de Martin Eden qui entre dans un monde bourgeois où il va tenter de briller, mais à sa manière...
Nous sommes à peu près au début de 20ème siècle. Et les conditions de travail sont difficiles pour les ouvriers, l'alcool les aide souvent à oublier. D'ailleurs avant de faire la connaissance de la délicate Ruth Morse, Martin Eden n'envisageait pas une bonne soirée sans une bonne bagarre pour terminer son parcours éthylique.
Mais cette rencontre va changer sa vie. Quand le lecteur entre dans le carré de lumière que fait la porte ouverte de Martin Eden, il l'aperçoit, allongé sur son lit couvert de livres ouverts, lisant puis prenant des notes.
Un long et riche cheminement s'en suivra, parsemé de livres, de rencontres et d'obstacles jusqu'aux 50 dernières pages avec un dénouement qui laisse pantois. Mais c'est sublime!
Jack London se réfère souvent à la pensée nietzschéenne de surhumain/surhomme et l' illustre de manière très compréhensible avec le parcours de Martin Eden. Pour mieux la contrer finalement et avec, le schéma très américain de la réussite grâce à l'individualisme.
Pour tirer un enseignement sur un point toujours d'actualité qui m'est cher: alors que l'ascenseur social est en panne, comment ne pas s'interroger pour un meilleur système éducatif. Ce point m'a hanté pendant cette lecture et me hantera encore..
Et avec ceci, c'est un livre qui aborde bien d'autres thèmes: une histoire d'amour entre une belle et une bête, le monde éditorial au début du 20ème, le monde ouvrier et le roulis des épaules de Martin Eden qui entre dans un monde bourgeois où il va tenter de briller, mais à sa manière...
Beaucoup d'écrivains aiment les chiens. Normal me direz-vous, beaucoup de gens aiment les chiens. Et, jusqu'à preuve du contraire, les écrivains sont encore des gens, donc, ça semble naturel et sans rapport évident avec le fait d'être écrivain. Constatons cependant qu'ils sont déjà moins nombreux, dans la catégorie « écrivains qui aiment les chiens », à avoir choisi un canidé pour tenir le rôle du héros de leur création.
Mais on en trouve, si l'on cherche bien, on en trouve : les Simak, les Boulgakov, les Quiroga, les Tchékhov, les Steinbeck, les Auster, les Fante, les Kazakov, les Mirbeau, les Woolf, les Gary & Cie… On en trouve mais c'est déjà nettement plus rare et, détail important, ce ne sont généralement pas leurs plus prestigieuses créations.
Par contre, trouver un auteur capable d'écrire non pas un, ni deux, ni trois mais au moins quatre romans (sans compter les nouvelles) dont les héros sont des chiens, là, pas d'erreur possible, vous êtes en présence d'un vrai passionné : j'ai nommé Jack London. Et, excusez du peu, au moins deux d'entre eux figurent parmi les ouvrages phares de l'auteur : L'Appel de la forêt et Croc-Blanc.
Qu'en est-il des deux autres ? Déjà, nouveau phénomène inouï dans l'histoire de la littérature, il s'agit d'un diptyque dont les héros sont respectivement deux frères de la race terrier irlandais. le premier s'intitule Jerry of the islands et le second Michael, brother of Jerry. Les traducteurs français ont choisi : Jerry, chien des îles et Michael, chien de cirque.
Pour leur malheur, ces deux livres ont paru en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, après la mort de l'auteur (car ils sont les derniers qu'il ait entièrement rédigés avant de s'éteindre précocément à l'âge de 40 ans.) et n'ont peut-être pas connu en Europe le succès qu'ils auraient mérité justement en raison de ce décès. On s'est empressé de coller à Jack London une jolie étiquette de romancier « pour la jeunesse », ou de romancier « d'aventure », des trucs qui ne dérangent personne comme le spécifiait Guy de Maupassant dans l'une de ses nouvelles à propos de Robinson Crusoë.
Tout ce qui pouvait déranger chez l'auteur a été savamment passé sous silence ou discrètement glissé sous le tapis. Notamment le fait qu'il était un auteur engagé. Dans le livre qui m'occupe aujourd'hui, deuxième volet du diptyque, l'engagement de Jack London en faveur de la cause animale est patent. J'ai souvent entendu parler du roman de Romain Gary de 1956, Les Racines du ciel, comme du premier roman « écolo », engagé en faveur de la cause animale, mais je puis affirmer que l'implication dans la protection animale et la volonté de faire évoluer les pratiques humaines à l'encontre des animaux sont encore bien plus marquées ici dès 1916.
Le problème, justement, c'est qu'en Europe, en 1917, les hommes tombaient tellement comme des mouches que le sort réservé aux chiens (notamment mais pas seulement) avait peu de chance d'émouvoir dans les chaumières. Tandis qu'en 1956, le monde, vaguement remis de ses dernières plaies, avait quelques secondes de temps de cerveau disponible à consacrer à la tragédie vécue par les animaux sur la planète. Histoire de timing…
Pourtant, croyez-moi si vous voulez, mais si vous avez apprécié Croc-Blanc, vous aurez tout autant de chances d'apprécier Michael, chien de cirque. Je ne crois pas qu'il y en ait un de franchement supérieur à l'autre quoique l'un soit fort célèbre et l'autre quasi inconnu. Les lois du succès éditorial sont parfois impénétrables…
Dans ce livre, Jack London est et demeure l'immense conteur que l'on sait. Il est au sommet de sa verve. Il brosse des portraits humains qui ont justement cette incomparable qualité, à savoir, l'humanité. L'humanité dans ce qu'elle a de vil et de merveilleux. Pas l'humanité fantasmée où il y aurait les bons vraiment bons d'un côté et les moins que rien, vraiment pendables de l'autre.
Non. L'humanité surprenante, l'humanité qui, au moment précis où l'on croit bien la cerner, se révèle tout autre. Tous individuellement, nous ne sommes ni des monstres ni des anges mais un inextricable mélange de ces qualités contradictoires, le tout saupoudré d'autres " qualités " bien plus neutres. Nous accomplissons tous des monstruosités en ayant parfois des desseins angéliques ou avons des velléités adorables qui conduisent à des horreurs.
Interrogez n'importe qui : il ou elle se croira toujours du côté du " bien ". Ou, ce qui est extrêmement rare, si il ou elle se réclame du " mal ", il ou elle s'empressera de le justifier " pour un bien " ultérieur. Et donc, naturellement, si vous vous questionnez sur quelqu'un qui fait souffrir des animaux, il aura toujours une batterie d'authentiques justifications " pour un bien ".
Et je crois que c'est cela (entre autres sujets) auquel Jack London essaie de nous sensibiliser. Voler un chien pour le revendre et en tirer un bénéfice : c'est bien ou c'est mal ? Question de point de vue. Torturer des animaux dans le but ultime de divertir et donner de la joie à des milliers de gens : c'est bien ou c'est mal ? Là encore, question de point de vue.
Eh bien le point de vue, justement, parlons-en car c'est aussi à cela que nous convie Jack London. Et si nous prenions, pour une fois, le point de vue du chien ? Qu'aurait-il à nous apprendre ? Que le voleur est peut-être moins pendable que le propriétaire légitime. Et en vertu de quoi, je vous prie ?
De l'amour. Oui, vous m'avez bien lue, de l'amour. Car il y est aussi question d'amour, peut-être même est-ce le principal sujet ici développé, l'amour qui peut naître entre un animal et un humain. L'amour, l'authentique amour, l'inconditionnel amour, celui qui n'a aucune arrière pensée de plaisir sexuel, de reproduction, de confort matériel ou d'ascension sociale. L'amour pur, cristallin comme celui que sont capables de développer un steward aux trois-quarts ivrogne et un terrier irlandais.
Il n'est peut-être plus tant question de bien et de mal que d'amour entre nous autres, humains, et les animaux, quels qu'ils soient. Avant d'entrer en relation avec eux, posons-nous sérieusement la question sur ce qui nous anime : est-ce de l'amour ou tout autre chose ?
Ce roman, à beaucoup d'instants, est bouleversant d'humanité. Sa force et son propos sont totalement intacts après un siècle d'existence. le seul bémol que j'y apposerais, comme pour Croc-Blanc, c'est un final peut-être un tout petit peu en-dessous du reste de la narration et pour les mêmes raisons. Pour le reste, d'après moi, un très bon roman. Mais de ceci comme du reste et de tout ce cirque, vous savez à présent que ce n'est pas grand-chose, un avis glissé dans une bouteille et une bouteille offerte à l'océan…
Mais on en trouve, si l'on cherche bien, on en trouve : les Simak, les Boulgakov, les Quiroga, les Tchékhov, les Steinbeck, les Auster, les Fante, les Kazakov, les Mirbeau, les Woolf, les Gary & Cie… On en trouve mais c'est déjà nettement plus rare et, détail important, ce ne sont généralement pas leurs plus prestigieuses créations.
Par contre, trouver un auteur capable d'écrire non pas un, ni deux, ni trois mais au moins quatre romans (sans compter les nouvelles) dont les héros sont des chiens, là, pas d'erreur possible, vous êtes en présence d'un vrai passionné : j'ai nommé Jack London. Et, excusez du peu, au moins deux d'entre eux figurent parmi les ouvrages phares de l'auteur : L'Appel de la forêt et Croc-Blanc.
Qu'en est-il des deux autres ? Déjà, nouveau phénomène inouï dans l'histoire de la littérature, il s'agit d'un diptyque dont les héros sont respectivement deux frères de la race terrier irlandais. le premier s'intitule Jerry of the islands et le second Michael, brother of Jerry. Les traducteurs français ont choisi : Jerry, chien des îles et Michael, chien de cirque.
Pour leur malheur, ces deux livres ont paru en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, après la mort de l'auteur (car ils sont les derniers qu'il ait entièrement rédigés avant de s'éteindre précocément à l'âge de 40 ans.) et n'ont peut-être pas connu en Europe le succès qu'ils auraient mérité justement en raison de ce décès. On s'est empressé de coller à Jack London une jolie étiquette de romancier « pour la jeunesse », ou de romancier « d'aventure », des trucs qui ne dérangent personne comme le spécifiait Guy de Maupassant dans l'une de ses nouvelles à propos de Robinson Crusoë.
Tout ce qui pouvait déranger chez l'auteur a été savamment passé sous silence ou discrètement glissé sous le tapis. Notamment le fait qu'il était un auteur engagé. Dans le livre qui m'occupe aujourd'hui, deuxième volet du diptyque, l'engagement de Jack London en faveur de la cause animale est patent. J'ai souvent entendu parler du roman de Romain Gary de 1956, Les Racines du ciel, comme du premier roman « écolo », engagé en faveur de la cause animale, mais je puis affirmer que l'implication dans la protection animale et la volonté de faire évoluer les pratiques humaines à l'encontre des animaux sont encore bien plus marquées ici dès 1916.
Le problème, justement, c'est qu'en Europe, en 1917, les hommes tombaient tellement comme des mouches que le sort réservé aux chiens (notamment mais pas seulement) avait peu de chance d'émouvoir dans les chaumières. Tandis qu'en 1956, le monde, vaguement remis de ses dernières plaies, avait quelques secondes de temps de cerveau disponible à consacrer à la tragédie vécue par les animaux sur la planète. Histoire de timing…
Pourtant, croyez-moi si vous voulez, mais si vous avez apprécié Croc-Blanc, vous aurez tout autant de chances d'apprécier Michael, chien de cirque. Je ne crois pas qu'il y en ait un de franchement supérieur à l'autre quoique l'un soit fort célèbre et l'autre quasi inconnu. Les lois du succès éditorial sont parfois impénétrables…
Dans ce livre, Jack London est et demeure l'immense conteur que l'on sait. Il est au sommet de sa verve. Il brosse des portraits humains qui ont justement cette incomparable qualité, à savoir, l'humanité. L'humanité dans ce qu'elle a de vil et de merveilleux. Pas l'humanité fantasmée où il y aurait les bons vraiment bons d'un côté et les moins que rien, vraiment pendables de l'autre.
Non. L'humanité surprenante, l'humanité qui, au moment précis où l'on croit bien la cerner, se révèle tout autre. Tous individuellement, nous ne sommes ni des monstres ni des anges mais un inextricable mélange de ces qualités contradictoires, le tout saupoudré d'autres " qualités " bien plus neutres. Nous accomplissons tous des monstruosités en ayant parfois des desseins angéliques ou avons des velléités adorables qui conduisent à des horreurs.
Interrogez n'importe qui : il ou elle se croira toujours du côté du " bien ". Ou, ce qui est extrêmement rare, si il ou elle se réclame du " mal ", il ou elle s'empressera de le justifier " pour un bien " ultérieur. Et donc, naturellement, si vous vous questionnez sur quelqu'un qui fait souffrir des animaux, il aura toujours une batterie d'authentiques justifications " pour un bien ".
Et je crois que c'est cela (entre autres sujets) auquel Jack London essaie de nous sensibiliser. Voler un chien pour le revendre et en tirer un bénéfice : c'est bien ou c'est mal ? Question de point de vue. Torturer des animaux dans le but ultime de divertir et donner de la joie à des milliers de gens : c'est bien ou c'est mal ? Là encore, question de point de vue.
Eh bien le point de vue, justement, parlons-en car c'est aussi à cela que nous convie Jack London. Et si nous prenions, pour une fois, le point de vue du chien ? Qu'aurait-il à nous apprendre ? Que le voleur est peut-être moins pendable que le propriétaire légitime. Et en vertu de quoi, je vous prie ?
De l'amour. Oui, vous m'avez bien lue, de l'amour. Car il y est aussi question d'amour, peut-être même est-ce le principal sujet ici développé, l'amour qui peut naître entre un animal et un humain. L'amour, l'authentique amour, l'inconditionnel amour, celui qui n'a aucune arrière pensée de plaisir sexuel, de reproduction, de confort matériel ou d'ascension sociale. L'amour pur, cristallin comme celui que sont capables de développer un steward aux trois-quarts ivrogne et un terrier irlandais.
Il n'est peut-être plus tant question de bien et de mal que d'amour entre nous autres, humains, et les animaux, quels qu'ils soient. Avant d'entrer en relation avec eux, posons-nous sérieusement la question sur ce qui nous anime : est-ce de l'amour ou tout autre chose ?
Ce roman, à beaucoup d'instants, est bouleversant d'humanité. Sa force et son propos sont totalement intacts après un siècle d'existence. le seul bémol que j'y apposerais, comme pour Croc-Blanc, c'est un final peut-être un tout petit peu en-dessous du reste de la narration et pour les mêmes raisons. Pour le reste, d'après moi, un très bon roman. Mais de ceci comme du reste et de tout ce cirque, vous savez à présent que ce n'est pas grand-chose, un avis glissé dans une bouteille et une bouteille offerte à l'océan…
ATTENTION ! Si vous lisez ce livre dans les transports en commun (genre métro comme moi) assurez-vous d'avoir une bonne âme (mon mari dans mon cas) à vos côtés pour vous signaler que vous arrivez à destination !
Oui, j'étais tellement plongée dans ma lecture que je ne me rendais même pas compte que le métro allait arriver à la station de destination...
C'est vous dire comme il fut prenant ! Pourtant, ce livre n'étant dans ma PAL que depuis deux mois, il n'aurait pas dû être lu aussi tôt.
Bizarrement, j'ai eu une envie folle de le lire, de le découvrir puisque je n'ai jamais vu le film. Pourquoi cet empressement ?
Et bien, le temps étant à la canicule - au moins 11 degrés - (mhouahaha), je me suis dit qu'un peu de fraîcheur serait la bienvenue et me voilà partie pour le Grand Nord, les pieds enfoncés dans la neige, les loups à mes trousses.
Cette première partie avec un traineau tiré par des chiens, poursuivi sans relâche par une meute de loups affamés - dont un viendra manger avec les chiens sans que le musher s'en rende compte tout de suite - était plus que prenante.
Comme dans "Dix petits nègres" et ses invités qui meurent l'un après l'autre, ici, c'est un chien qui disparaissait chaque nuit, dévoré après avoir été entrainé par la louve qui n'a pas peur de l'homme (la mère du futur Croc-Blanc). Elle est à moitié louve, à moitié chien et a grandi parmi les hommes. La ruse, elle connait. Les hommes aussi.
D'emblée, cette entrée en matière avec la course poursuite entre des loups affamés, hurlants et le traineau avec les deux hommes était flippante... Pourtant, c'est considéré comme littérature jeunesse. Nous sommes loin de l'univers de la Bibliothèque Rose, là !
Cet aparté terminé, je dois vous avouer que ce que j'aime dans ces livres de Jack London, c'est que cet auteur a une manière de vous parler du Grand Nord qui fait que, même si vous étiez au bord d'une piscine par 40 degrés à l'ombre, vous vous croiriez dans le blizzard en train de grelotter, le trouillomètre à zéro, la vision du Petit Chaperon Rouge, dévoré, dansant devant vos yeux épouvantés.
Nous sommes dans le Grand Nord, oui, et il ne fait pas de cadeau. Un jeune louveteau va le découvrir très vite, lui qui sera le seul survivant de la nichée. Pas le choix, faut manger si on ne veut pas être mangé. Sa rencontre avec une belette sera décisive, la bête étant vicieuse et vindicative (hem, c'est mon totem).
Les premiers hommes qu'il rencontre seront des Indiens qui le baptiseront Croc-Blanc. Auprès d'eux, il connaîtra la chaleur du feu de camp, mais aussi le goût du sang et la main qui frappe au lieu de caresser.
Sa condition de "plus loup que chien" fera qu'il sera rejeté par les autres chiots, agressé et mis à l'écart. Pas d'amour, pas de tendresse, mais des bagarres. Cela va déjà lui forger le caractère.
Comme dans "L'appel sauvage", cette histoire nous est contée à travers l'animal, ici, Croc-Blanc, ce qui donne au récit une émotion qui vous prendra aux tripes plus que si c'était raconté par un narrateur humain.
Oui, j'ai souffert avec Croc-Blanc, j'ai partagé ses émotions, ses peurs, ses découvertes, ses ruses, j'étais dans sa peau et j'avais envie de mordre les autres chiens qui l'emmerdaient. Oui, j'ai regardé les humains avec un regard de haine brûlante, avec l'envie d'en mordre certain et de leur trancher la jugulaire.
Je n'ai pas l'âme d'une violente, mais le récit atteint une intensité tellement féroce à certains moments que vous ne pouvez vous empêcher de vous dire que l'être humain peut-être une crapule.
Jack London nous dépeint plusieurs facettes de l'homme : l'indien qui deviendra aussi con que l'homme blanc après avoir goûté à l'eau-de-feu et qui vendra Croc-Blanc à l'homme cupide et pleutre qui veut le loup pour se sentir puissant et organiser des combats. Après cette brute et ses airs de truand, viendra le bon.
Mais dressé pour le combat, notre Croc-Blanc a basculé du côté obscur de la Nature et à cause des hommes, il a découvert la haine, il est devenu sauvage, hargneux.
Pas besoin de dictionnaire, il a vite compris ce que voulaient dire "injustice", "cruauté gratuite" et "vraie sauvagerie". Dans la nature, jamais il ne serait parvenu à un seuil pareil, le rendant irrécupérable tant la rage coule dans ses veines, tant il n'a plus confiance en l'homme.
Et pourtant...Tout le monde a droit à une rédemption.
Je remercie Jack London de m'avoir plongé dans cette aventure mi-humaine et mi-animale très bouleversante, sans m'épargner la vision de la cruauté humaine envers l'animal.
Les civilisés ne sont pas ceux que l'on dit. C'étaient les hommes qui hurlaient leur plaisir lors des combats de Croc-Blanc contre des ours, des lynx, un bouledogue... Eux qui voulaient voir le sang couler.
Un roman fort, prenant, dur, violent, sauvage, mais avec de l'espoir et des grands espaces. Tous les hommes ne sont pas des salauds...
Maintenant, je change de registre et je vais aller le dorer la pilule en Afrique du Sud avec le roman "Zulu". C'est l'agence de voyage de Caryl Férey qui m'y emmène.
Avec cet auteur bucolique, ce sera petites fleurs, poésie et douceur au menu. Un peu de douceur dans ce monde de brute. Tiens, pourquoi ceux qui ont lu "Zulu" toussent-ils aussi fort ?
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Oui, j'étais tellement plongée dans ma lecture que je ne me rendais même pas compte que le métro allait arriver à la station de destination...
C'est vous dire comme il fut prenant ! Pourtant, ce livre n'étant dans ma PAL que depuis deux mois, il n'aurait pas dû être lu aussi tôt.
Bizarrement, j'ai eu une envie folle de le lire, de le découvrir puisque je n'ai jamais vu le film. Pourquoi cet empressement ?
Et bien, le temps étant à la canicule - au moins 11 degrés - (mhouahaha), je me suis dit qu'un peu de fraîcheur serait la bienvenue et me voilà partie pour le Grand Nord, les pieds enfoncés dans la neige, les loups à mes trousses.
Cette première partie avec un traineau tiré par des chiens, poursuivi sans relâche par une meute de loups affamés - dont un viendra manger avec les chiens sans que le musher s'en rende compte tout de suite - était plus que prenante.
Comme dans "Dix petits nègres" et ses invités qui meurent l'un après l'autre, ici, c'est un chien qui disparaissait chaque nuit, dévoré après avoir été entrainé par la louve qui n'a pas peur de l'homme (la mère du futur Croc-Blanc). Elle est à moitié louve, à moitié chien et a grandi parmi les hommes. La ruse, elle connait. Les hommes aussi.
D'emblée, cette entrée en matière avec la course poursuite entre des loups affamés, hurlants et le traineau avec les deux hommes était flippante... Pourtant, c'est considéré comme littérature jeunesse. Nous sommes loin de l'univers de la Bibliothèque Rose, là !
Cet aparté terminé, je dois vous avouer que ce que j'aime dans ces livres de Jack London, c'est que cet auteur a une manière de vous parler du Grand Nord qui fait que, même si vous étiez au bord d'une piscine par 40 degrés à l'ombre, vous vous croiriez dans le blizzard en train de grelotter, le trouillomètre à zéro, la vision du Petit Chaperon Rouge, dévoré, dansant devant vos yeux épouvantés.
Nous sommes dans le Grand Nord, oui, et il ne fait pas de cadeau. Un jeune louveteau va le découvrir très vite, lui qui sera le seul survivant de la nichée. Pas le choix, faut manger si on ne veut pas être mangé. Sa rencontre avec une belette sera décisive, la bête étant vicieuse et vindicative (hem, c'est mon totem).
Les premiers hommes qu'il rencontre seront des Indiens qui le baptiseront Croc-Blanc. Auprès d'eux, il connaîtra la chaleur du feu de camp, mais aussi le goût du sang et la main qui frappe au lieu de caresser.
Sa condition de "plus loup que chien" fera qu'il sera rejeté par les autres chiots, agressé et mis à l'écart. Pas d'amour, pas de tendresse, mais des bagarres. Cela va déjà lui forger le caractère.
Comme dans "L'appel sauvage", cette histoire nous est contée à travers l'animal, ici, Croc-Blanc, ce qui donne au récit une émotion qui vous prendra aux tripes plus que si c'était raconté par un narrateur humain.
Oui, j'ai souffert avec Croc-Blanc, j'ai partagé ses émotions, ses peurs, ses découvertes, ses ruses, j'étais dans sa peau et j'avais envie de mordre les autres chiens qui l'emmerdaient. Oui, j'ai regardé les humains avec un regard de haine brûlante, avec l'envie d'en mordre certain et de leur trancher la jugulaire.
Je n'ai pas l'âme d'une violente, mais le récit atteint une intensité tellement féroce à certains moments que vous ne pouvez vous empêcher de vous dire que l'être humain peut-être une crapule.
Jack London nous dépeint plusieurs facettes de l'homme : l'indien qui deviendra aussi con que l'homme blanc après avoir goûté à l'eau-de-feu et qui vendra Croc-Blanc à l'homme cupide et pleutre qui veut le loup pour se sentir puissant et organiser des combats. Après cette brute et ses airs de truand, viendra le bon.
Mais dressé pour le combat, notre Croc-Blanc a basculé du côté obscur de la Nature et à cause des hommes, il a découvert la haine, il est devenu sauvage, hargneux.
Pas besoin de dictionnaire, il a vite compris ce que voulaient dire "injustice", "cruauté gratuite" et "vraie sauvagerie". Dans la nature, jamais il ne serait parvenu à un seuil pareil, le rendant irrécupérable tant la rage coule dans ses veines, tant il n'a plus confiance en l'homme.
Et pourtant...Tout le monde a droit à une rédemption.
Je remercie Jack London de m'avoir plongé dans cette aventure mi-humaine et mi-animale très bouleversante, sans m'épargner la vision de la cruauté humaine envers l'animal.
Les civilisés ne sont pas ceux que l'on dit. C'étaient les hommes qui hurlaient leur plaisir lors des combats de Croc-Blanc contre des ours, des lynx, un bouledogue... Eux qui voulaient voir le sang couler.
Un roman fort, prenant, dur, violent, sauvage, mais avec de l'espoir et des grands espaces. Tous les hommes ne sont pas des salauds...
Maintenant, je change de registre et je vais aller le dorer la pilule en Afrique du Sud avec le roman "Zulu". C'est l'agence de voyage de Caryl Férey qui m'y emmène.
Avec cet auteur bucolique, ce sera petites fleurs, poésie et douceur au menu. Un peu de douceur dans ce monde de brute. Tiens, pourquoi ceux qui ont lu "Zulu" toussent-ils aussi fort ?
Lien : https://thecanniballecteur.w..
L'Apocalypse selon Jack London !
Incroyable de redécouvrir ce grand auteur, adulé ( je voue un culte à Martin Eden, un des plus beaux livres qu'il m'ait été donné de lire ), au travers d'une nouvelle d'anticipation.
Ça démarre comme La Route de Cormac McCarthy avec l'errance de deux personnages, un vieux monsieur accompagné de son petit-fils, en 2073 dans un monde ravagé par la peste écarlate qui a quasi éradiqué toute vie humaine sur Terre 60 ans auparavant.
Rapidement, on retrouve la patte London dans la façon d'aborder ces événements, un formidable conteur : nous découvrons ce nouveau monde à travers le récit du seul survivant qui a connu l'ancien monde, le civilisé, le technologique, le lettré. Il en fait le récit à ces petits-fils sauvageons et c'est à travers leurs oreilles et leurs yeux que nous aussi découvrons ce qui est arrivé. Tout est simple et fluide.
La thématique de la nature est bien là. Le fléau a totalement bouleversé l'ordre naturel, le monde est revenu à l'état sauvage. Les animaux se sont parfaitement adaptés à ce nouvel état et on reprit d'une certaine façon le pouvoir sur les hommes qui vivent comme des néo-préhistoriques.
Le récit prend également une tournure plus politique, plus moralisatrice comme dans Martin Eden, avec beaucoup de douceur. L'humanité est réduite à quelques hordes néo-préhistoriques, sillonnant des villages en ruine et des campagnes à l'abandon. Le redémarrage de l'humanité est laborieux. La solitude du grand-père est magnifiquement présentée dans ce monde qui a perdu l'usage de l'écriture et de la lecture. Dans ce constat pessimiste, reste cette image lumineuse de la grotte-trésor emplie de livres et d'instructions pour alphabétiser le monde. Candide mais tellement puissant.
Incroyable de redécouvrir ce grand auteur, adulé ( je voue un culte à Martin Eden, un des plus beaux livres qu'il m'ait été donné de lire ), au travers d'une nouvelle d'anticipation.
Ça démarre comme La Route de Cormac McCarthy avec l'errance de deux personnages, un vieux monsieur accompagné de son petit-fils, en 2073 dans un monde ravagé par la peste écarlate qui a quasi éradiqué toute vie humaine sur Terre 60 ans auparavant.
Rapidement, on retrouve la patte London dans la façon d'aborder ces événements, un formidable conteur : nous découvrons ce nouveau monde à travers le récit du seul survivant qui a connu l'ancien monde, le civilisé, le technologique, le lettré. Il en fait le récit à ces petits-fils sauvageons et c'est à travers leurs oreilles et leurs yeux que nous aussi découvrons ce qui est arrivé. Tout est simple et fluide.
La thématique de la nature est bien là. Le fléau a totalement bouleversé l'ordre naturel, le monde est revenu à l'état sauvage. Les animaux se sont parfaitement adaptés à ce nouvel état et on reprit d'une certaine façon le pouvoir sur les hommes qui vivent comme des néo-préhistoriques.
Le récit prend également une tournure plus politique, plus moralisatrice comme dans Martin Eden, avec beaucoup de douceur. L'humanité est réduite à quelques hordes néo-préhistoriques, sillonnant des villages en ruine et des campagnes à l'abandon. Le redémarrage de l'humanité est laborieux. La solitude du grand-père est magnifiquement présentée dans ce monde qui a perdu l'usage de l'écriture et de la lecture. Dans ce constat pessimiste, reste cette image lumineuse de la grotte-trésor emplie de livres et d'instructions pour alphabétiser le monde. Candide mais tellement puissant.
"Il devait dominer ou être dominé, toute manifestation de pitié était signe de faiblesse." L'appel de la forêt.
Mais quel titre, pour cet essai?
Loin de "L'appel de la forêt", c'est plutôt l'appel de l'argent et les refus à la pelle...
Loin aussi de "Croc blanc", même si Jack London est assez mordant, envers les éditeurs et autres rédacteurs de tout poil!
Car avant le succès, en 1903, il fut un loup enragé (comme son premier livre "Le fils du loup", "Le loup des mers") vivant d'expédients: dans les bas fonds de Londres, sur les lointaines terres glacées ou les champs de bataille de Corée...
"Jack London parle de l'écrivain obligé de se prostituer, pour vivre...Et montre du doigt une société où l'argent est roi."
Mais, Jack London est un écrivain talentueux, le voilà riche et célèbre avec "L'appel de la forêt".
"Il milite pour l'émancipation des pauvres ("Le peuple de l'abîme"), même si cela va à l'encontre de sa fierté naïve d'être l'auteur le mieux payé de son temps, " et de son individualisme forcené...
Mais de livre en livre, il se livre parfois, ivre souvent...
Il recherchera toujours le bonheur, l'Eden sur terre, même s'il faut se renier comme le héros de "Martin Eden".
"Sur les rayons des bibliothèques, je vis un monde surgir de l'horizon." Martin Eden.
Mais quel titre, pour cet essai?
Loin de "L'appel de la forêt", c'est plutôt l'appel de l'argent et les refus à la pelle...
Loin aussi de "Croc blanc", même si Jack London est assez mordant, envers les éditeurs et autres rédacteurs de tout poil!
Car avant le succès, en 1903, il fut un loup enragé (comme son premier livre "Le fils du loup", "Le loup des mers") vivant d'expédients: dans les bas fonds de Londres, sur les lointaines terres glacées ou les champs de bataille de Corée...
"Jack London parle de l'écrivain obligé de se prostituer, pour vivre...Et montre du doigt une société où l'argent est roi."
Mais, Jack London est un écrivain talentueux, le voilà riche et célèbre avec "L'appel de la forêt".
"Il milite pour l'émancipation des pauvres ("Le peuple de l'abîme"), même si cela va à l'encontre de sa fierté naïve d'être l'auteur le mieux payé de son temps, " et de son individualisme forcené...
Mais de livre en livre, il se livre parfois, ivre souvent...
Il recherchera toujours le bonheur, l'Eden sur terre, même s'il faut se renier comme le héros de "Martin Eden".
"Sur les rayons des bibliothèques, je vis un monde surgir de l'horizon." Martin Eden.
La vie était facile pour Buck dans le « Domaine du juge Miller », confortable et insouciante, même ; accompagnée de quelques congénères, des chiens d’écurie, Toots le carlin et Isabel, le mexicain. Quand on est croisé de terre-neuve et de colley, on est le maître ! de par la taille d’abord, et enfin par l’affectueuse attention que votre maître vous porte.
Danger ! : nous sommes à la fin XIX ème siècle, au début de la ruée vers l’or et les aventuriers qu’elle tente sont à la recherche de grands chiens rustiques capables de tirer des traîneaux dans le grand nord canadien… Et puis il y a Manoël, le jardinier de la propriété. Il fait preuve d’un goût quelque peu immodéré pour les jeux d’argent…
On retrouvera Buck, sous les ordres de différents maîtres qui lui feront découvrir la faim, la misère et les coups, la fatigue, aussi, jusqu’à l’épuisement ; la bêtise humaine, également, et la cruauté…
Un beau texte, sans fioriture, sec comme le vent du grand nord… on verra Buck faire l’apprentissage de la vie de captif. Une vie où il devra ressusciter ses instincts sauvages pour survivre, et pour finalement dominer.
« L’appel de la forêt », de la littérature jeunesse, lit-on partout… peut-être… Bien que Jack London ne l’ait jamais considéré comme tel. Un beau récit d’aventures dans le grand nord, touchant et solidement bâti sur la propre expérience de l’auteur comme chercheur d’or dans les dernières années du XIXème siècle, en Alaska.
Danger ! : nous sommes à la fin XIX ème siècle, au début de la ruée vers l’or et les aventuriers qu’elle tente sont à la recherche de grands chiens rustiques capables de tirer des traîneaux dans le grand nord canadien… Et puis il y a Manoël, le jardinier de la propriété. Il fait preuve d’un goût quelque peu immodéré pour les jeux d’argent…
On retrouvera Buck, sous les ordres de différents maîtres qui lui feront découvrir la faim, la misère et les coups, la fatigue, aussi, jusqu’à l’épuisement ; la bêtise humaine, également, et la cruauté…
Un beau texte, sans fioriture, sec comme le vent du grand nord… on verra Buck faire l’apprentissage de la vie de captif. Une vie où il devra ressusciter ses instincts sauvages pour survivre, et pour finalement dominer.
« L’appel de la forêt », de la littérature jeunesse, lit-on partout… peut-être… Bien que Jack London ne l’ait jamais considéré comme tel. Un beau récit d’aventures dans le grand nord, touchant et solidement bâti sur la propre expérience de l’auteur comme chercheur d’or dans les dernières années du XIXème siècle, en Alaska.
J’ai toujours pensé que je ne lirais jamais « Croc blanc ». Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, la principale étant que ce livre n’était pas passé à ma portée à l’âge où on le lit habituellement.
Ensuite, au fil des années je me suis persuadée qu’il était trop tard pour moi pour ce genre de lecture.
En réalité, je crois que la seule véritable raison de ce « rejet » est mon extrême sensibilité à la souffrance animale.
La nouvelle traduction proposée par les Editions Libretto, mise en valeur par une magnifique couverture ont eu raison de mes réticences.
Et quelle découverte ! Quel bonheur ! Ces quelques heures passées en compagnie de ce chien font désormais partie de mes grands souvenirs de lectrice.
Bien sûr, j’ai souffert avec lui, j’ai eu peur pour lui. Le destin de Croc Blanc qui ne connaît, dès son plus jeune âge, que la dureté du Grand Nord, la violence des coups et la cruauté des hommes pour devenir un loup sauvage et féroce m’a émue, jusqu’aux larmes parfois.
J’ai savouré les descriptions de cette nature belle et hostile, majestueusement servie par la plume d’un auteur exceptionnel que je n’avais, j’ose à peine le dire, jamais lu.
Ensuite, au fil des années je me suis persuadée qu’il était trop tard pour moi pour ce genre de lecture.
En réalité, je crois que la seule véritable raison de ce « rejet » est mon extrême sensibilité à la souffrance animale.
La nouvelle traduction proposée par les Editions Libretto, mise en valeur par une magnifique couverture ont eu raison de mes réticences.
Et quelle découverte ! Quel bonheur ! Ces quelques heures passées en compagnie de ce chien font désormais partie de mes grands souvenirs de lectrice.
Bien sûr, j’ai souffert avec lui, j’ai eu peur pour lui. Le destin de Croc Blanc qui ne connaît, dès son plus jeune âge, que la dureté du Grand Nord, la violence des coups et la cruauté des hommes pour devenir un loup sauvage et féroce m’a émue, jusqu’aux larmes parfois.
J’ai savouré les descriptions de cette nature belle et hostile, majestueusement servie par la plume d’un auteur exceptionnel que je n’avais, j’ose à peine le dire, jamais lu.
Pas le manuel du parfait petit scout. Renard agile, loutre bigleuse et autres faces de totems peuvent s’abstenir de cette lecture glaçante. Ces 40 Pages sont à tourner avec des moufles, ce qui n’est pas simple, mais chez London, on n’est pas dans la petite sortie en raquettes après la raclette dominicale.
Il fait aux alentours de – 50 ° - Evelyne on se les gèle ! - température idéale pour conserver tout type de vaccins, mais pas un temps à mettre un pied dehors, même dans une paire d’après ski des années 80. Pourtant, un homme marche dans la neige, le con, dans le Yukon, claudiquant le long du Klondike, rivière gelée canadienne, aussi hospitalière l’hiver qu’un grizzly qui a une écharde plantée dans la papatte…
Comme Jean-Jacques, l’homme marche seul. Sans témoins, sans personne…Enfin, pas tout à fait, puisqu’il est accompagné par un chien, qui a forcément les crocs blancs dans la neige.
London connait la région puisqu’au cours de ses 1000 vies, il a trimé comme chercheur d’or dans la région. A défaut de trouver la pépite, il nous en a écrit une et cet épisode lui a inspiré cette nouvelle du début du vingtième siècle.
Récit d’aventure qui a donc pour principaux protagonistes, un homme, son chien, le froid et quelques allumettes récalcitrantes.
Après une première pause qui permet à l’homme épuisé d’allumer un premier feu pour se réchauffer, à la dure, ce n’est pas le barbecue du 4 juillet avec les voisins non plus, l’emmitouflé dans ses peaux de bêtes, repart pour rejoindre des compagnons. Patatras, son pied passe à travers la neige et entre en contact de l’eau glacé de la rivière. Pas terrible la séance de balnéo. Dans le coin, c’est la certitude de voir ses petits petons transformés en Mr Freeze.
Pour se sauver, l’homme, qu’on pourrait appeler Johnny, doit allumer un nouveau feu avec ses dernières allumettes. Je ne parle pas en expert puisque je suis un pyromane pitoyable. Je n’arrive jamais à faire démarrer le feu dans ma cheminée sans un litre d’essence, trois numéros de mon journal, un lance flamme et un vent de force 8.
Dans ce froid arctique, attiser la brindille relève encore plus de la torture et Jack London fait de chaque geste de l’homme un moment d’extrême tension. L’auteur décrit merveilleusement le froid. Le lecteur est assis dans la neige et regarde chaque allumette avec les yeux d’un Homo sapiens qui vient d’avoir une étincelle. L’homme enlève un gant et le liseur souffre d’onglée, la neige tombe des branches d’un sapin et c’est comme si les flocons nous glissaient le long du dos.
En très peu de pages, London est parvenu à m’immerger totalement dans son récit. Dans ce froid extrême, il n’est plus question de psychologie mais d’instinct de survie, l’homme redevient bête. On ne saura rien de l’avant de cet homme. Ce n’est pas le sujet. L’important : la description d’un milieu hostile, le caractère impitoyable de la nature et le récit d'une vie qui ne tient que dans les caprices d’une allumette. Une aventure sans destination.
Le feu et la glace. Un classique sans remontées mécaniques.
Il fait aux alentours de – 50 ° - Evelyne on se les gèle ! - température idéale pour conserver tout type de vaccins, mais pas un temps à mettre un pied dehors, même dans une paire d’après ski des années 80. Pourtant, un homme marche dans la neige, le con, dans le Yukon, claudiquant le long du Klondike, rivière gelée canadienne, aussi hospitalière l’hiver qu’un grizzly qui a une écharde plantée dans la papatte…
Comme Jean-Jacques, l’homme marche seul. Sans témoins, sans personne…Enfin, pas tout à fait, puisqu’il est accompagné par un chien, qui a forcément les crocs blancs dans la neige.
London connait la région puisqu’au cours de ses 1000 vies, il a trimé comme chercheur d’or dans la région. A défaut de trouver la pépite, il nous en a écrit une et cet épisode lui a inspiré cette nouvelle du début du vingtième siècle.
Récit d’aventure qui a donc pour principaux protagonistes, un homme, son chien, le froid et quelques allumettes récalcitrantes.
Après une première pause qui permet à l’homme épuisé d’allumer un premier feu pour se réchauffer, à la dure, ce n’est pas le barbecue du 4 juillet avec les voisins non plus, l’emmitouflé dans ses peaux de bêtes, repart pour rejoindre des compagnons. Patatras, son pied passe à travers la neige et entre en contact de l’eau glacé de la rivière. Pas terrible la séance de balnéo. Dans le coin, c’est la certitude de voir ses petits petons transformés en Mr Freeze.
Pour se sauver, l’homme, qu’on pourrait appeler Johnny, doit allumer un nouveau feu avec ses dernières allumettes. Je ne parle pas en expert puisque je suis un pyromane pitoyable. Je n’arrive jamais à faire démarrer le feu dans ma cheminée sans un litre d’essence, trois numéros de mon journal, un lance flamme et un vent de force 8.
Dans ce froid arctique, attiser la brindille relève encore plus de la torture et Jack London fait de chaque geste de l’homme un moment d’extrême tension. L’auteur décrit merveilleusement le froid. Le lecteur est assis dans la neige et regarde chaque allumette avec les yeux d’un Homo sapiens qui vient d’avoir une étincelle. L’homme enlève un gant et le liseur souffre d’onglée, la neige tombe des branches d’un sapin et c’est comme si les flocons nous glissaient le long du dos.
En très peu de pages, London est parvenu à m’immerger totalement dans son récit. Dans ce froid extrême, il n’est plus question de psychologie mais d’instinct de survie, l’homme redevient bête. On ne saura rien de l’avant de cet homme. Ce n’est pas le sujet. L’important : la description d’un milieu hostile, le caractère impitoyable de la nature et le récit d'une vie qui ne tient que dans les caprices d’une allumette. Une aventure sans destination.
Le feu et la glace. Un classique sans remontées mécaniques.
Martin Eden a 21 ans, l'âge de toutes les audaces. Il est marin, une vie faite d'embarquements et d'escales. En sauvant Arthur Morse d'une rixe il ne se doutait pas de la tournure qu'allait prendre sa vie.
" Martin Eden" est l'histoire d'une métamorphose, celle d'une chenille qui se transforme en papillon pour les beaux yeux de Ruth, une femme enfant issue de la bourgeoisie californienne.
A force de travail Martin va s'élever intellectuellement, son rêve d'écrire et sa reconnaissance artistique vont être sa raison de vivre au grand désespoir de Ruth et de ses proches.
S'ensuit une vie de misère, la faim, le découragement, les refus des maisons d'éditions, mais Martin s'en moque, il en rit même de cette vie de galère.
" Martin Eden" est un roman dense, je dirais un roman à tiroir, d'abord l'écriture est la pièce maitresse de ce roman, la sociologie évolutionniste du philosophe anglais Herbert Spencer, ce fameux fossé des nantis comme la famille Morse et ces miséreux dont Martin est issu. Jack London décrit Martin comme un individualiste rappelant la pensée Nietzschéenne " le monde appartient aux forts."
La fin du roman est surprenante, mais quelle fin ; une sorte de mantra
" J'étais le même ! c'était à cette époque que j'ai écrit ces ouvrages ! et maintenant vous me gavez quand alors vous m'avez laissé mourir de faim, vous m'avez fermé votre maison, vous m'avez renié, tout ça parce que je ne voulais pas chercher une situation."
Surprenant personnage qu'est Martin Eden tantôt plein d' humanité, tantôt imbu de sa personne.
Un merveilleux roman qui va finir sur mon île déserte.
" Martin Eden" est l'histoire d'une métamorphose, celle d'une chenille qui se transforme en papillon pour les beaux yeux de Ruth, une femme enfant issue de la bourgeoisie californienne.
A force de travail Martin va s'élever intellectuellement, son rêve d'écrire et sa reconnaissance artistique vont être sa raison de vivre au grand désespoir de Ruth et de ses proches.
S'ensuit une vie de misère, la faim, le découragement, les refus des maisons d'éditions, mais Martin s'en moque, il en rit même de cette vie de galère.
" Martin Eden" est un roman dense, je dirais un roman à tiroir, d'abord l'écriture est la pièce maitresse de ce roman, la sociologie évolutionniste du philosophe anglais Herbert Spencer, ce fameux fossé des nantis comme la famille Morse et ces miséreux dont Martin est issu. Jack London décrit Martin comme un individualiste rappelant la pensée Nietzschéenne " le monde appartient aux forts."
La fin du roman est surprenante, mais quelle fin ; une sorte de mantra
" J'étais le même ! c'était à cette époque que j'ai écrit ces ouvrages ! et maintenant vous me gavez quand alors vous m'avez laissé mourir de faim, vous m'avez fermé votre maison, vous m'avez renié, tout ça parce que je ne voulais pas chercher une situation."
Surprenant personnage qu'est Martin Eden tantôt plein d' humanité, tantôt imbu de sa personne.
Un merveilleux roman qui va finir sur mon île déserte.
Ce livre monumental dans l'oeuvre de Jack London est publié en 1904, c'est son dixième ouvrage. London a 28 ans.
Loup Larsen est le capitaine du "Fantôme" sur lequel il pratique la chasse aux phoques. C'est un homme puissant, brutal. Danois de naissance, il est d'origine modeste, mais a rapidement gravi les échelons, de mousse à capitaine, pour devenir, finalement à 40 ans, propriétaire de son bâtiment.
Son équipage, de sacs et de cordes, est composé de brutes, d'ivrognes et de repris de justice qu'aucun marin "digne de ce nom n'accepterait à son bord. Mais il entretient, grâce à la peur qu'il inspire, un semblant d'ordre à son bord.
Il recueille, afin de le sauver de la noyade, Humphrey Van Weyden - homme de lettres réputé - qu'il maintient, ensuite, prisonnier à son bord au lieu de le faire porter à la côte ou sur un bâtiment de rencontre.
Loup Larsen, même s'il est une brute consommée, a une culture solide, c'est un homme intelligent, de cette sorte d'intelligence brutale et sauvage qui fait de l'homme parfois un prédateur dangereux.
Il engage, alors, un jeu pervers et cruel aux dépens d'Humphrey Van Weyden, puis d'autres marins qu'il recueille, également à son bord, ainsi que d'une femme Maud Brewster - femme de lettres et poétesse...
Jack London, ne s'embarrasse pas de fioritures, il décrit simplement, d'un style plus efficace que jamais, la brutalité, la cruauté qui règne à bord.
Pour Larsen le seul droit légitime est celui de la force, le faible a tort du fait même de sa faiblesse et la vie est une chose malpropre sans beauté aucune qui cesse aussi brutalement qu'elle a commencé.
Tandis que Van Weyden oppose à cet individualisme forcené une conception de solidarité, de fraternité et d'entraide du fort au faible.
La lutte entre ces deux hommes est en fait, celle qui oppose ces deux modes de pensée, celle de l'homme civilisé contre la brute survenue du fond des âges luttant pour sa survie.
Loup Larsen est le capitaine du "Fantôme" sur lequel il pratique la chasse aux phoques. C'est un homme puissant, brutal. Danois de naissance, il est d'origine modeste, mais a rapidement gravi les échelons, de mousse à capitaine, pour devenir, finalement à 40 ans, propriétaire de son bâtiment.
Son équipage, de sacs et de cordes, est composé de brutes, d'ivrognes et de repris de justice qu'aucun marin "digne de ce nom n'accepterait à son bord. Mais il entretient, grâce à la peur qu'il inspire, un semblant d'ordre à son bord.
Il recueille, afin de le sauver de la noyade, Humphrey Van Weyden - homme de lettres réputé - qu'il maintient, ensuite, prisonnier à son bord au lieu de le faire porter à la côte ou sur un bâtiment de rencontre.
Loup Larsen, même s'il est une brute consommée, a une culture solide, c'est un homme intelligent, de cette sorte d'intelligence brutale et sauvage qui fait de l'homme parfois un prédateur dangereux.
Il engage, alors, un jeu pervers et cruel aux dépens d'Humphrey Van Weyden, puis d'autres marins qu'il recueille, également à son bord, ainsi que d'une femme Maud Brewster - femme de lettres et poétesse...
Jack London, ne s'embarrasse pas de fioritures, il décrit simplement, d'un style plus efficace que jamais, la brutalité, la cruauté qui règne à bord.
Pour Larsen le seul droit légitime est celui de la force, le faible a tort du fait même de sa faiblesse et la vie est une chose malpropre sans beauté aucune qui cesse aussi brutalement qu'elle a commencé.
Tandis que Van Weyden oppose à cet individualisme forcené une conception de solidarité, de fraternité et d'entraide du fort au faible.
La lutte entre ces deux hommes est en fait, celle qui oppose ces deux modes de pensée, celle de l'homme civilisé contre la brute survenue du fond des âges luttant pour sa survie.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jack London
Quiz
Voir plus
l'appel de la foret
comment s'appelle le chien ?
holly
Buck
Billy
Rachid
3 questions
231 lecteurs ont répondu
Thème : L'appel sauvage (ou) L'appel de la forêt de
Jack LondonCréer un quiz sur cet auteur231 lecteurs ont répondu