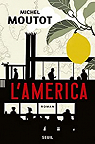Citations de Michel Moutot (82)
Ils lèvent l'ancre le lendemain, cap sur l'archipel des Galápagos.
Dans l'exemplaire, relié de cuir noir, du voyage dans l'Atlantique Sud et autour du Cap Horn dans l'océan Pacifique, par le capitaine James Colnett, de la Royal Navy -1798, Mercator trouve une carte sommaire. Sur l'île de Floreana, la mention "Post Office Bay".
Dans l'exemplaire, relié de cuir noir, du voyage dans l'Atlantique Sud et autour du Cap Horn dans l'océan Pacifique, par le capitaine James Colnett, de la Royal Navy -1798, Mercator trouve une carte sommaire. Sur l'île de Floreana, la mention "Post Office Bay".
Sur une majestueuse chaloupe blanche, la plus belle embarcation de l’île, Ana Fontarossa, longs cheveux châtains, sourire de madone, fixe Vittorio Bevilacqua. Elle a remarqué dès son arrivée ce beau jeune homme mince mais musclé, brun au regard clair, les cheveux coupés court, une petite tache de naissance au coin de l’œil gauche, comme une larme. Elle ne l’a pas quitté des yeux depuis qu’il s’est jeté à l’eau, corps d’athlète parmi les pêcheurs poilus et ventrus. Quand il remonte à bord de sa barque, à la force des bras, les pieds dans le filet, leurs regards se croisent.
Depuis le début, s'il s'agit du corps d'un pompier ou d'un flic, ou de qui que ce soit qui porte un uniforme, c'est le grand branle-bas. Ils arrivent à vingt, recouvrent le brancard d'un drapeau, forment une garde d'honneur, casque bas, main sur le coeur, tout s'arrête. C'est tout juste s'il ne jouent pas l'hymne. Mais si c'est le morceau d'un corps de civil, on évacue ça dans un sac plastique, comme à la poubelle ! Trois minutes et ça repart. Je veux parler à l'enfoiré qui a demandé dans la radio si c'était un sac ou un drapeau. Les civils ont le droit au même respect que tout le monde ici.
Quand tout le monde est un héros, plus personne ne l'est.
Avez-vous un problème d'alcool?
Je tente de minimiser. je lis dans ses yeux que ça ne marche pas. Alors je lui dis tout. La première gorgée de bourbon à quinze ans, pour franchir le Vieux Pont à Kahnawake. La bouteille cachée dans le vestiaire au centre d'apprentissage. Le vertige paralysant que seul l'alcool permet d'apprivoiser. La trouille. La honte. La petite flasque toujours dans la poche. Les stratagèmes pour se cacher. Les regards de ceux qui ont compris. Le mépris des veinards pour lesquels c'est facile. Le courage de mon père, sa mort foudroyé. La légende des cowboys du ciel, valeureux guerriers mohawks qui ignorent la peur, équilibristes des gratte-ciels, héros de leur peuple, bâtisseurs de l'Amérique...
Je tente de minimiser. je lis dans ses yeux que ça ne marche pas. Alors je lui dis tout. La première gorgée de bourbon à quinze ans, pour franchir le Vieux Pont à Kahnawake. La bouteille cachée dans le vestiaire au centre d'apprentissage. Le vertige paralysant que seul l'alcool permet d'apprivoiser. La trouille. La honte. La petite flasque toujours dans la poche. Les stratagèmes pour se cacher. Les regards de ceux qui ont compris. Le mépris des veinards pour lesquels c'est facile. Le courage de mon père, sa mort foudroyé. La légende des cowboys du ciel, valeureux guerriers mohawks qui ignorent la peur, équilibristes des gratte-ciels, héros de leur peuple, bâtisseurs de l'Amérique...
Si vous passez dans le trou, ça ne garantit pas que vous ne serez pas blessés, vous le serez probablement mais vous survivrez, dit le formateur. Dans les années 20, dix pour cent des monteurs d'acier de ce pays étaient tués ou gravement blessés. En cinq ans la moitié de la force de travail disparaissait. Et ce n'était pas grave, il y avait toujours de nouveaux émigrants pour les remplacer. On donnait deux cents dollars à la famille du mort pour les obsèques, et on n'en parlait plus.
Dans certaines villes, même les chefs croyaient que, parce qu'on était indiens, on n'avait pas le vertige. On ne les contredisait pas, on en rajoutait. On bossait à la même vitesse que les autres, mais ils auraient juré que nous étions plus rapides.
Ground Zero a commencé à agir sur certains d'entre nous comme une drogue. "Dedans" c'est dur, épuisant, effrayant, dangereux, mais nous nous sentons plus qu'utiles: indispensables, admirés, investis d'une mission patriotique, sacrée, presque divine ! "Dehors", une fois passée la joie de retrouver les siens, la vie ordinaire semble fade, mièvre, médiocre, sans importance. "Ils ne savent pas, ne peuvent pas comprendre. Il faut avoir vu".
Aussi loin qu'on s'en souvienne, les Mohawks ont aimé bâtir, charpenter le bois, édifier des voûtes complexes. Les villages, établis sur des collines, entourés de fortifications de rondins, avec des rues et des places, étaient si bien conçus que les Français les appelaient "forts" ou "châteaux".
« Le mien allait si mal, hier, qu’il refusait même de manger. Je suis passé chez le véto de notre unité. Vous savez quoi ? Il m’a dit que ce n’est pas le premier. Les chiens dépriment. A force de ne tomber que sur des morts, ils perdent leur motivation. Pour eux, trouver des humains ensevelis est comme un jeu. Mais à n’importe quel jeu, quand vous perdez sans cesse, vous perdez l’envie de continuer. »
Roman passionnant qui relate depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours la vie dangereuse des indiens MOHAWK
(tribu iroquoise du Canada) chargés d'édifier les ponts et les gratte ciel de génération en génération en
travaillant au péril de leur vie au dessus du vide et à des hauteurs vertigineuses. Ce sont les IRONWORKERS les "travailleurs de l'acier".
(tribu iroquoise du Canada) chargés d'édifier les ponts et les gratte ciel de génération en génération en
travaillant au péril de leur vie au dessus du vide et à des hauteurs vertigineuses. Ce sont les IRONWORKERS les "travailleurs de l'acier".
Bienvenue à San Francisco, jeune homme, le paradis de la liberté. Ici, la règle c'est chacun pour soi.
Il glisse dans son étui l'outil des ironworkers : la spudwrench - clef à mâchoire. En acier noir, d'un côté elle sert à visser les gros boulons, de l'autre, avec son extrémité pointue, elle se glisse dans les trous percés en usine et permet d'aligner les orifices pour y glisser les boulons. C'est son arme, son trésor, son fétiche, son tomahawk. Dans la famille depuis trois générations, elle est émoussée côté clef et marquée de mille entailles côté pointe, mais rien ne la lui fera remplacer.
Les six flèches gothiques du grand temple mormon, visibles à des kilomètres à la ronde au-dessus des toits de Salt Lake City, lui servent de repère. (..)
Il vient de passer trois jours éprouvants dans les Grandes Plaines, enfilant d'interminables lignes droites au rythme entêtant du bicylindre qui, à soixante-dix ou quatre-vingt kilomètres à l'heure, tourne à bas régime. Les paysages du Midwest, avec leurs champs de blé ou de maïs, leurs fermes flanquées d'éoliennes et leurs granges peintes en rouge, ont fait place à des prairies sans fin, océans d'herbes qui ondulent sous le vent, où paissent des troupeaux de vaches parfois surveillés par des hommes à cheval qui saluent sur son passage, en agitant leurs chapeaux, le cavalier mécanique. Il s'est longuement arrêté près d'une rivière en s'apercevant que ces animaux à l'épaisse fourrure qui s'abreuvaient n'étaient pas des boeufs mais des bisons, comme sur les gravures des journaux illustrés qu'il dévorait, enfant, au coin de la cheminée à Bangor.
Il vient de passer trois jours éprouvants dans les Grandes Plaines, enfilant d'interminables lignes droites au rythme entêtant du bicylindre qui, à soixante-dix ou quatre-vingt kilomètres à l'heure, tourne à bas régime. Les paysages du Midwest, avec leurs champs de blé ou de maïs, leurs fermes flanquées d'éoliennes et leurs granges peintes en rouge, ont fait place à des prairies sans fin, océans d'herbes qui ondulent sous le vent, où paissent des troupeaux de vaches parfois surveillés par des hommes à cheval qui saluent sur son passage, en agitant leurs chapeaux, le cavalier mécanique. Il s'est longuement arrêté près d'une rivière en s'apercevant que ces animaux à l'épaisse fourrure qui s'abreuvaient n'étaient pas des boeufs mais des bisons, comme sur les gravures des journaux illustrés qu'il dévorait, enfant, au coin de la cheminée à Bangor.
Sur une majestueuse chaloupe blanche, la plus belle embarcation de l’île, Ana Fontarossa, longs cheveux châtains, sourire de madone, fixe Vittorio Bevilacqua. Elle a remarqué dès son arrivée ce beau jeune homme mince mais musclé, brun au regard clair, les cheveux coupés court, une petite tache de naissance au coin de l’œil gauche, comme une larme. Elle ne l’a pas quitté des yeux depuis qu’il s’est jeté à l’eau, corps d’athlète parmi les pêcheurs poilus et ventrus. Quand il remonte à bord de sa barque, à la force des bras, les pieds dans le filet, leurs regards se croisent.
INCIPIT
Trapani (Sicile) – Juillet 1902
La table est dressée au cœur du verger, à l’abri des regards sur les hauteurs de Trapani. Bergerie centenaire, murs de pierres sèches, toit de tuiles caché sous le feuillage, fenêtres étroites aux vitres brisées. Les branches ploient sous les citrons ; vert profond des feuilles, brise légère, ombre bienfaisante dans la chaleur de juillet. L’air embaume les agrumes, la terre chaude et le jasmin. Une source jaillit entre deux rochers. Ses eaux chantent entre les pierres, roulent sur des cailloux blancs jusqu’à un abreuvoir taillé dans un bloc de marbre veiné de gris. Assis dans un fauteuil d’osier, quand les autres se contentent de tabourets ou de caisses retournées, Salvatore Fontarossa plonge la main dans le ruisseau, en boit une gorgée puis la passe sur sa nuque de taureau. À cinquante ans, ses cheveux bouclés, plantés bas sur le front, et sa barbe se teintent de gris. Sa mâchoire carrée et ses yeux noirs au regard intense, toujours en mouvement, lui donnent un air de prédateur. Il porte, malgré la chaleur, un pantalon de velours à grosses côtes, une chemise blanche et un gilet brun orné d’une chaîne de montre et d’un étrange insigne rappelant une décoration maçonnique avec compas et couteau.
Un homme vêtu en paysan sicilien s’avance à petits pas, les yeux baissés, épaules voûtées, chapeau de paille tenu à deux mains devant lui.
– Pipo. C’est gentil de me rendre visite. Comment vont votre femme et vos charmantes filles ? Vous la connaissiez, la source ?
– Non, don Salva. Je n’étais jamais…
– Eh bien, la voilà. Belle et si fraîche. Même en août, elle ne se tarit pas. Un trésor. Le seul trésor. Vous comprenez pourquoi nous autres, les fontanieri, on nous appelle les maîtres de l’eau ? Vous avez vu les canaux, les réservoirs, les clapets en montant ? Vous savez qui les contrôle ?
– C’est vous, don Salva.
– Oui, c’est moi. Et mes fils, que vous connaissez, je crois. Maintenant, parlons sérieusement. Vous vous souvenez de ce qui s’est passé l’an dernier ?
– Si je m’en souviens… Ma récolte de citronniers divisée par deux, faute d’arrosage. Les orangers, pire encore. Les canaux à sec. Les barriques à dos d’âne. Une catastrophe.
– Vous ne voudriez pas que ça recommence, n’est-ce pas ?
– Oh non, don Salva. Une autre saison comme ça et je suis ruiné. Mais j’ai un accord avec le duc da Capra a Carbonaro, le propriétaire. Un contrat. Je devais…
– Pipo, don Pipo… Vous n’avez toujours rien compris. Il vit où, le duc ?
– À Palerme… Ou à Naples.
– Ou plutôt à Rome. Dans l’un de ses palais. Quand l’avez-vous vu à Trapani pour la dernière fois ? Ou même en Sicile ? Maintenant, qui est ici, sur cette terre ? Chaque jour et chaque nuit ? Qui veille sur elle ? Qui a été chargé par le duc de gérer le domaine et son irrigation ? De répartir l’eau de cette source entre les voisins ?
– C’est vous, bien sûr, don Salva… Fontaniero…
– Voilà ! Moi, mes fils et mes amis.
Autour de la table, les hommes, casquettes ou chapeaux de paille, approuvent de la tête. Certains ont des pistolets à la ceinture. Ils ont posé près des fourchettes un San Fratello, un couteau à manche de corne ou d’olivier. Les pantalons sont en grosse toile ; bretelles, manches de chemises retroussées. Une femme en fichu noir apporte un plat de légumes grillés, une autre une casserole fumante. Une adolescente les suit, avec deux pichets de vin rouge et une miche de pain.
– Faites-nous l’honneur de déjeuner avec nous, Pipo. Nous allons parler. Je suis sûr que nous pouvons nous entendre. Aldo, approche une chaise pour notre ami, il ne va quand même pas s’asseoir sur une caisse.
Pietro « Pipo » Pistola prend place à la droite du chef de clan. Ses vergers d’agrumes, plus bas dans la vallée, font vivre sa famille depuis des générations. Aussi loin qu’il se souvienne, les Pistola ont expédié oranges et citrons à Rome, Paris, Londres et ailleurs. Son père a ouvert la ligne avec La Nouvelle-Orléans, quand Pipo était enfant. Mais l’exportation des agrumes ne date pas d’hier, elle a commencé il y a deux siècles, racontent les anciens, quand les navigateurs ont compris l’importance des vitamines contre le scorbut et que la Navy anglaise et la Royale française ont embarqué des caisses de citrons pour les longues traversées. Une manne. Nulle part ailleurs terre n’est aussi bénéfique pour les agrumes, le climat aussi parfait. Les bonnes années, les branches ploient à se rompre sous les fruits. Mais si cet été l’eau ne coule pas dans les rigoles, c’est fini. Il faudra vendre les terres. C’est peut-être ce qu’il cherche, ce voleur. Fontaniero, tu parles. Mafioso, oui. Et celui-là est le pire de tous. Il tient la source, les sentiers dans la montagne, les barrages, il nous tient tous.
– Excusez-moi, don Salva, mais je voudrais éclaircir quelque chose. Sans vous offenser, bien sûr. J’ai reçu le mois dernier une lettre du duc m’annonçant qu’il avait changé de fontaniero. Que désormais, pour l’eau je devais m’adresser à un certain Emilio Fontana. Mais…
– Mais quoi ?
– Il est mort.
– Oui, il est mort. Une décharge de chevrotine en pleine poitrine, à ce qu’on dit. Pas loin d’ici. Il n’a pas eu de chance, des voleurs sans doute. Ce n’est pas à vous que je vais apprendre que nos collines sont mal famées à la tombée du jour. À partir d’une certaine heure, je ne me déplace pas sans arme, ni sans un de mes fils. Oubliez ce Fontana. Je ne sais pas ce qui lui a pris, au duc, de vouloir me remplacer. Notre famille gère l’eau depuis toujours par ici. Même lui n’y peut rien. Il faudra qu’il s’y fasse. Alors, don Pipo, voilà ce que je vous propose : la garantie de ne plus jamais être à sec, contre trente pour cent de la récolte.
– Trente pour cent ? Mais, c’est énorme ! Comment…
– Vous préférez en perdre la moitié, comme l’an dernier ? Ou davantage ? En plus, si je passe le mot que nous sommes en affaire, vous et moi, personne n’osera vous voler un citron, croyez-moi. Tout le monde y gagne. Vous, surtout.
Pietro Pistola coupe une tranche de courgette, refuse les pâtes, et pour se donner le temps de réfléchir, boit une gorgée de vin.
– Vingt-cinq pour cent ?
– Don Pipo, pensez-vous être en position de négocier ? Trente pour cent, c’est une bonne offre. J’ai du respect pour vous, nos familles se connaissent depuis longtemps. Je ne fais pas cette proposition à tout le monde. Il n’y aura pas d’eau pour tous cet été.
– C’est d’accord, don Salva. Trois caisses sur dix. Mais vous me garantissez…
– Vous aurez assez d’eau pour creuser un bassin et vous baigner dedans, si ça vous chante. Vous pouvez même prévoir d’agrandir les vergers, si vous avez encore des terres. Parole de fontaniero.
– Merci, merci beaucoup, don Salva. Je ne vais pas pouvoir rester, il faut que je redescende.
– Goûtez au moins ces busiate alla trapanese. Maria fait les meilleures de Sicile.
– Une autre fois, peut-être, don Salva. Je dois y aller, on m’attend ce soir à Palerme, et j’ai du chemin à faire.
– Je comprends. Aldo, accompagne notre associé jusqu’à la route. À bientôt, donc, cher ami.
Il montre un papier rempli de paille, d’où émergent des goulots de bouteilles.
– Acceptez ces quelques litres de marsala, en gage d’amitié. Et n’hésitez pas à venir me voir si vous avez des problèmes d’eau, ou de quoi que ce soit d’autre. Je suis votre serviteur.
– Merci, don Salvatore.
– Et si vous pouviez toucher un mot de notre accord à votre voisin, Pepponi, vous lui rendriez service. Il n’est pas raisonnable.
– Bien entendu.
Pietro Pistola se lève, salue la tablée d’un mouvement de tête, remet son chapeau, fait quelques pas à reculons puis se retourne pour suivre, sur le sentier, le fils aîné du chef qui marche en souriant, sa lupara – fusil à canon et crosse sciés – à l’épaule. Les femmes du clan Fontarossa apportent des lièvres rôtis sur le feu de bois d’oranger qui crépite derrière la cabane de pierres sèches où sont stockées, hors saison, les caisses de fruits. Puis des cannoli, en dessert, que les hommes terminent en se léchant les doigts. Antonino, le deuxième des trois fils de Salvatore Fontarossa, murmure quatre mots à l’oreille de son père.
– Je viens après le café. Ils sont prêts ?
– Oui, père. Tremblants comme des feuilles.
– Bien. Laisse-les mariner un peu.
Dix minutes plus tard, le chef du clan se lève, essuie sa bouche du dos de sa main. Les autres replient les couteaux, glissent les armes dans les ceintures. Ils partent à travers le verger, cheminent en file indienne jusqu’au pied d’une colline plantée d’oliviers. Entre deux rochers plats en forme de triangle s’ouvre l’entrée d’une grotte, gardée par deux hommes près d’un feu de bois. L’un est gros, hirsute, barbe blanche, vêtu pour la chasse au sanglier. Il tient, cassé dans le creux de son bras, un tromblon du siècle dernier. L’autre, plus jeune, svelte, regard fiévreux et geste rapide, taille une branche avec un coutelas, s’interrompt à la vue de la colonne.
– Merci, Santo. Tu peux venir avec nous. Toi, petit, file. Tu n’es pas prêt.
Trapani (Sicile) – Juillet 1902
La table est dressée au cœur du verger, à l’abri des regards sur les hauteurs de Trapani. Bergerie centenaire, murs de pierres sèches, toit de tuiles caché sous le feuillage, fenêtres étroites aux vitres brisées. Les branches ploient sous les citrons ; vert profond des feuilles, brise légère, ombre bienfaisante dans la chaleur de juillet. L’air embaume les agrumes, la terre chaude et le jasmin. Une source jaillit entre deux rochers. Ses eaux chantent entre les pierres, roulent sur des cailloux blancs jusqu’à un abreuvoir taillé dans un bloc de marbre veiné de gris. Assis dans un fauteuil d’osier, quand les autres se contentent de tabourets ou de caisses retournées, Salvatore Fontarossa plonge la main dans le ruisseau, en boit une gorgée puis la passe sur sa nuque de taureau. À cinquante ans, ses cheveux bouclés, plantés bas sur le front, et sa barbe se teintent de gris. Sa mâchoire carrée et ses yeux noirs au regard intense, toujours en mouvement, lui donnent un air de prédateur. Il porte, malgré la chaleur, un pantalon de velours à grosses côtes, une chemise blanche et un gilet brun orné d’une chaîne de montre et d’un étrange insigne rappelant une décoration maçonnique avec compas et couteau.
Un homme vêtu en paysan sicilien s’avance à petits pas, les yeux baissés, épaules voûtées, chapeau de paille tenu à deux mains devant lui.
– Pipo. C’est gentil de me rendre visite. Comment vont votre femme et vos charmantes filles ? Vous la connaissiez, la source ?
– Non, don Salva. Je n’étais jamais…
– Eh bien, la voilà. Belle et si fraîche. Même en août, elle ne se tarit pas. Un trésor. Le seul trésor. Vous comprenez pourquoi nous autres, les fontanieri, on nous appelle les maîtres de l’eau ? Vous avez vu les canaux, les réservoirs, les clapets en montant ? Vous savez qui les contrôle ?
– C’est vous, don Salva.
– Oui, c’est moi. Et mes fils, que vous connaissez, je crois. Maintenant, parlons sérieusement. Vous vous souvenez de ce qui s’est passé l’an dernier ?
– Si je m’en souviens… Ma récolte de citronniers divisée par deux, faute d’arrosage. Les orangers, pire encore. Les canaux à sec. Les barriques à dos d’âne. Une catastrophe.
– Vous ne voudriez pas que ça recommence, n’est-ce pas ?
– Oh non, don Salva. Une autre saison comme ça et je suis ruiné. Mais j’ai un accord avec le duc da Capra a Carbonaro, le propriétaire. Un contrat. Je devais…
– Pipo, don Pipo… Vous n’avez toujours rien compris. Il vit où, le duc ?
– À Palerme… Ou à Naples.
– Ou plutôt à Rome. Dans l’un de ses palais. Quand l’avez-vous vu à Trapani pour la dernière fois ? Ou même en Sicile ? Maintenant, qui est ici, sur cette terre ? Chaque jour et chaque nuit ? Qui veille sur elle ? Qui a été chargé par le duc de gérer le domaine et son irrigation ? De répartir l’eau de cette source entre les voisins ?
– C’est vous, bien sûr, don Salva… Fontaniero…
– Voilà ! Moi, mes fils et mes amis.
Autour de la table, les hommes, casquettes ou chapeaux de paille, approuvent de la tête. Certains ont des pistolets à la ceinture. Ils ont posé près des fourchettes un San Fratello, un couteau à manche de corne ou d’olivier. Les pantalons sont en grosse toile ; bretelles, manches de chemises retroussées. Une femme en fichu noir apporte un plat de légumes grillés, une autre une casserole fumante. Une adolescente les suit, avec deux pichets de vin rouge et une miche de pain.
– Faites-nous l’honneur de déjeuner avec nous, Pipo. Nous allons parler. Je suis sûr que nous pouvons nous entendre. Aldo, approche une chaise pour notre ami, il ne va quand même pas s’asseoir sur une caisse.
Pietro « Pipo » Pistola prend place à la droite du chef de clan. Ses vergers d’agrumes, plus bas dans la vallée, font vivre sa famille depuis des générations. Aussi loin qu’il se souvienne, les Pistola ont expédié oranges et citrons à Rome, Paris, Londres et ailleurs. Son père a ouvert la ligne avec La Nouvelle-Orléans, quand Pipo était enfant. Mais l’exportation des agrumes ne date pas d’hier, elle a commencé il y a deux siècles, racontent les anciens, quand les navigateurs ont compris l’importance des vitamines contre le scorbut et que la Navy anglaise et la Royale française ont embarqué des caisses de citrons pour les longues traversées. Une manne. Nulle part ailleurs terre n’est aussi bénéfique pour les agrumes, le climat aussi parfait. Les bonnes années, les branches ploient à se rompre sous les fruits. Mais si cet été l’eau ne coule pas dans les rigoles, c’est fini. Il faudra vendre les terres. C’est peut-être ce qu’il cherche, ce voleur. Fontaniero, tu parles. Mafioso, oui. Et celui-là est le pire de tous. Il tient la source, les sentiers dans la montagne, les barrages, il nous tient tous.
– Excusez-moi, don Salva, mais je voudrais éclaircir quelque chose. Sans vous offenser, bien sûr. J’ai reçu le mois dernier une lettre du duc m’annonçant qu’il avait changé de fontaniero. Que désormais, pour l’eau je devais m’adresser à un certain Emilio Fontana. Mais…
– Mais quoi ?
– Il est mort.
– Oui, il est mort. Une décharge de chevrotine en pleine poitrine, à ce qu’on dit. Pas loin d’ici. Il n’a pas eu de chance, des voleurs sans doute. Ce n’est pas à vous que je vais apprendre que nos collines sont mal famées à la tombée du jour. À partir d’une certaine heure, je ne me déplace pas sans arme, ni sans un de mes fils. Oubliez ce Fontana. Je ne sais pas ce qui lui a pris, au duc, de vouloir me remplacer. Notre famille gère l’eau depuis toujours par ici. Même lui n’y peut rien. Il faudra qu’il s’y fasse. Alors, don Pipo, voilà ce que je vous propose : la garantie de ne plus jamais être à sec, contre trente pour cent de la récolte.
– Trente pour cent ? Mais, c’est énorme ! Comment…
– Vous préférez en perdre la moitié, comme l’an dernier ? Ou davantage ? En plus, si je passe le mot que nous sommes en affaire, vous et moi, personne n’osera vous voler un citron, croyez-moi. Tout le monde y gagne. Vous, surtout.
Pietro Pistola coupe une tranche de courgette, refuse les pâtes, et pour se donner le temps de réfléchir, boit une gorgée de vin.
– Vingt-cinq pour cent ?
– Don Pipo, pensez-vous être en position de négocier ? Trente pour cent, c’est une bonne offre. J’ai du respect pour vous, nos familles se connaissent depuis longtemps. Je ne fais pas cette proposition à tout le monde. Il n’y aura pas d’eau pour tous cet été.
– C’est d’accord, don Salva. Trois caisses sur dix. Mais vous me garantissez…
– Vous aurez assez d’eau pour creuser un bassin et vous baigner dedans, si ça vous chante. Vous pouvez même prévoir d’agrandir les vergers, si vous avez encore des terres. Parole de fontaniero.
– Merci, merci beaucoup, don Salva. Je ne vais pas pouvoir rester, il faut que je redescende.
– Goûtez au moins ces busiate alla trapanese. Maria fait les meilleures de Sicile.
– Une autre fois, peut-être, don Salva. Je dois y aller, on m’attend ce soir à Palerme, et j’ai du chemin à faire.
– Je comprends. Aldo, accompagne notre associé jusqu’à la route. À bientôt, donc, cher ami.
Il montre un papier rempli de paille, d’où émergent des goulots de bouteilles.
– Acceptez ces quelques litres de marsala, en gage d’amitié. Et n’hésitez pas à venir me voir si vous avez des problèmes d’eau, ou de quoi que ce soit d’autre. Je suis votre serviteur.
– Merci, don Salvatore.
– Et si vous pouviez toucher un mot de notre accord à votre voisin, Pepponi, vous lui rendriez service. Il n’est pas raisonnable.
– Bien entendu.
Pietro Pistola se lève, salue la tablée d’un mouvement de tête, remet son chapeau, fait quelques pas à reculons puis se retourne pour suivre, sur le sentier, le fils aîné du chef qui marche en souriant, sa lupara – fusil à canon et crosse sciés – à l’épaule. Les femmes du clan Fontarossa apportent des lièvres rôtis sur le feu de bois d’oranger qui crépite derrière la cabane de pierres sèches où sont stockées, hors saison, les caisses de fruits. Puis des cannoli, en dessert, que les hommes terminent en se léchant les doigts. Antonino, le deuxième des trois fils de Salvatore Fontarossa, murmure quatre mots à l’oreille de son père.
– Je viens après le café. Ils sont prêts ?
– Oui, père. Tremblants comme des feuilles.
– Bien. Laisse-les mariner un peu.
Dix minutes plus tard, le chef du clan se lève, essuie sa bouche du dos de sa main. Les autres replient les couteaux, glissent les armes dans les ceintures. Ils partent à travers le verger, cheminent en file indienne jusqu’au pied d’une colline plantée d’oliviers. Entre deux rochers plats en forme de triangle s’ouvre l’entrée d’une grotte, gardée par deux hommes près d’un feu de bois. L’un est gros, hirsute, barbe blanche, vêtu pour la chasse au sanglier. Il tient, cassé dans le creux de son bras, un tromblon du siècle dernier. L’autre, plus jeune, svelte, regard fiévreux et geste rapide, taille une branche avec un coutelas, s’interrompt à la vue de la colonne.
– Merci, Santo. Tu peux venir avec nous. Toi, petit, file. Tu n’es pas prêt.
Voilà San Francisco, la cité d'or dont rêve le monde entier : une dizaine de maisons de bois et une trentaine de bâtisses, la plupart inachevées, des voiles ou des branchages en guise de toits, jetés comme au hasard sur une grève marécageuse. Des centaines de navires enlisés jusqu'à mi-coque dans la boue, certains éventrés, d'autres démâtés, transformés en dortoirs ou en entrepôts. Des épaves désossées pour leurs planches, leurs mâts, leurs voiles. Les rues sont des chemins défoncés, des sentiers où les roues des brouettes s'enfoncent. Des collines sableuses parsemées de roseaux, de cabans, de tentes, d'abris de fortune faits de troncs mal équarris et de morceaux de navires, bidonville émergeant de la brume et de la fumée des feux de camp, sur lequel flotte un drapeau américain en charpie et ses trente étoiles. Odeurs de vase, de crasse, d'ordures et de viande grillée, cloaque du bout du monde où les rats trottent en file indienne. Des dormeurs hirsutes gisent aux côtés de chiens faméliques dans des tonneaux renversés, des barques tirées sur le sable, des lits de foin sous des lambeaux de focs taillés au couteau, des charrettes sans roues, des abris de branchages.
Pas la peine de s’épuiser à tirer ce poisson. Nous allons l’arrimer au navire et le ramener à Nantucket. Il n’y a pas de requins par ici, en cette saison, pour nous le bouffer en route. Je la vendrai à Coffin, nous avons autre chose à faire que de la cuire, et les fours ne sont pas prêts. Michael, passe sur le canot de ton frère. Je ne supporte plus de t’entendre chialer comme une gamine. Mercator, récupère ce moussaillon, tout juste capable de casser son aviron. Je voulais voir ce que vous valiez, j’ai vu.
Les hommes sautent des hamacs, enfilent leurs vêtements de mer, se bousculent dans les échelles et les escaliers, se précipitent vers les râteliers, les chaloupes. Le capitaine Fleming serre sa ceinture, glisse un long couteau dans son étui de cuir.
C’était un garçon joyeux, il ne rit plus jamais. Il me regarde comme un ennemi, en plissant les yeux, sans les baisser avant que je ne l’ordonne. Je ne suis pas du genre à prendre mes fils dans mes bras, mais quand même. Il ne parle que si je l’interroge, passe ses soirées enfermé dans sa chambre, n’a aucun ami. La vie d’un mousse à bord d’un baleinier de Nantucket n’est pas facile tous les jours. Après leur première campagne, ils reviennent tous différents de l’enfant qui est parti, mais je voudrais bien savoir…
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Michel Moutot
Quiz
Voir plus
Le petit vieux des Batignolles
Qui est Monistrol ?
le neveux
le père
la mère
le grand père
10 questions
104 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur104 lecteurs ont répondu