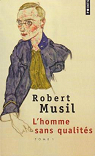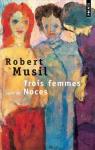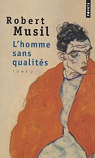Critiques de Robert Musil (134)
Je ne dirais pas exactement que je sors de cette lecture dans un état de désarroi. Mais tout de même, c’est un texte un peu désarçonnant, tant par son contenu (de la psychologie teintée de métaphysique), que par la tournure de ses phrases, souvent longue et tortueuses (publié en 1906).
Ce roman est le récit d’une sorte de rite de passage de l’adolescence. Nous suivons Törless, un adolescent qui rejoint l’internat d’une école militaire prestigieuse autrichienne à la fin du 19e siècle. Un de ses camarades génère chez lui une attirance, un désir, incompréhensible et honteux, tandis que deux autres élèves font de ce même camarade l’objet de manipulations perverses et de sévices. En quête de lui-même, voulant lutter contre son excès de sensibilité, Törless a fait de ces deux élèves pervers ses amis. Il va donc les suivre dans leurs délires, jusqu’à un certain point.
Sa sensibilité particulière le fait régulièrement entrer dans un trouble, une sorte d’état second, qui lui fait percevoir les choses selon un double aspect, à la fois réel et irréel, et se poser mille questions sur le réel et non réel, en résonnance avec les cours sur les nombres imaginaires en mathématiques.
Malgré les phrases parfois alambiquées, les concepts pointus, force est de reconnaitre que c’est de la belle littérature, le fond comme la forme sont creusés, recherchés, travaillés. Il y a un spectaculaire effet de vortex, dans l’aspiration que Törless ressent pour ces garçons, jusqu’au détachement salvateur. Pas forcément simple à lire, donc, mais assez captivant.
Ce roman est le récit d’une sorte de rite de passage de l’adolescence. Nous suivons Törless, un adolescent qui rejoint l’internat d’une école militaire prestigieuse autrichienne à la fin du 19e siècle. Un de ses camarades génère chez lui une attirance, un désir, incompréhensible et honteux, tandis que deux autres élèves font de ce même camarade l’objet de manipulations perverses et de sévices. En quête de lui-même, voulant lutter contre son excès de sensibilité, Törless a fait de ces deux élèves pervers ses amis. Il va donc les suivre dans leurs délires, jusqu’à un certain point.
Sa sensibilité particulière le fait régulièrement entrer dans un trouble, une sorte d’état second, qui lui fait percevoir les choses selon un double aspect, à la fois réel et irréel, et se poser mille questions sur le réel et non réel, en résonnance avec les cours sur les nombres imaginaires en mathématiques.
Malgré les phrases parfois alambiquées, les concepts pointus, force est de reconnaitre que c’est de la belle littérature, le fond comme la forme sont creusés, recherchés, travaillés. Il y a un spectaculaire effet de vortex, dans l’aspiration que Törless ressent pour ces garçons, jusqu’au détachement salvateur. Pas forcément simple à lire, donc, mais assez captivant.
"Les Désarrois de l'élève Törless" qui fait partie de la première vagie des romans de pensionnat est généralement considéré comme une classique du genre. Malheureusement, c'est une lecture qui ne plait pas. Le déroulement des événements manque de fluidité. Les personnages sont tous antipathiques surtout le héros qui est vraiment un type minable. Bien des lecteurs disent que "Les Désarrois de l'élève Törless" annonce toute les crimes commises par l'Allemagne pendant les cinquante années qui ont suivi sa sortie. À mon avis c'est surtout un roman qui représente bien le Zeitgeist de l'Autriche de la "Fin de siècle" et que son esprit est très loin du Reich allemand.
Törless le protagoniste est incapable de choisir son coté. Il trouve que Bozena la prostituée est vulgaire mais il l'a fréquente quand même. Il tombe amoureux de Bassini qui est persécuté par une bande de méchants au pensionnat mais il décide de ne pas l'aider. Törless trouve qui ni la religion ni la mathématique ni la philosophie lui montre le chemin à suivre.
Le dirigeants du pensionnat sont capables de prendre position. Ils expulsent Bassini parce que c'est la voie la plus facile. Il décide aussi de chasser l'indécis Törless qui n'est pas à leurs yeux fait pour leur monde. Törless n'est pas très déçu. Il veut surtout ne pas prendre parti.
Je donne quatre étoiles aux "Désarrois de l'élève Törless" pour son importance dans l'histoire de la littérature et pour la lumière qu'il met sur une époque historique. Comme œuvre littéraire sa réussite est assez modeste.
Törless le protagoniste est incapable de choisir son coté. Il trouve que Bozena la prostituée est vulgaire mais il l'a fréquente quand même. Il tombe amoureux de Bassini qui est persécuté par une bande de méchants au pensionnat mais il décide de ne pas l'aider. Törless trouve qui ni la religion ni la mathématique ni la philosophie lui montre le chemin à suivre.
Le dirigeants du pensionnat sont capables de prendre position. Ils expulsent Bassini parce que c'est la voie la plus facile. Il décide aussi de chasser l'indécis Törless qui n'est pas à leurs yeux fait pour leur monde. Törless n'est pas très déçu. Il veut surtout ne pas prendre parti.
Je donne quatre étoiles aux "Désarrois de l'élève Törless" pour son importance dans l'histoire de la littérature et pour la lumière qu'il met sur une époque historique. Comme œuvre littéraire sa réussite est assez modeste.
Une très belle première oeuvre, avec encore certes quelques maladresses de jeunesse mais déjà on sent l'écrivain naissant et les obsessions qui le méneront à son chef d'oeuvre future, l'homme sans qualité.
La fougue, la noirceur, l'étrangeté, l'ironie, tout est déjà là.
La fougue, la noirceur, l'étrangeté, l'ironie, tout est déjà là.
Tout d'abord c'est un roman novateur pour l'époque et provocateur qui plonge dans les profondeurs de l'âme humaine, explorant les complexités de la jeunesse, de la sexualité et du pouvoir.
Musil présente une histoire qui se déroule dans un pensionnat militaire austro-hongrois, où l'élève Törless est témoin des relations sadomasochistes entre ses camarades de classe. Le récit met en lumière les tourments intérieurs de Törless alors qu'il navigue entre la fascination et le dégoût pour ces événements. À travers le personnage de Törless, Musil explore les thèmes de l'aliénation, de l'homosexualité, de la culpabilité et de la recherche de soi.
La façon dont Musil dépeint les conflits intérieurs des personnages est une des forces du roman. Törless est confronté à des dilemmes moraux complexes alors qu'il tente de comprendre ses propres désirs et ses réactions face à l'injustice et à la cruauté qui l'entourent. Musil utilise également l'histoire pour examiner les dynamiques de pouvoir et de soumission, mettant en lumière les tensions sociales et psychologiques qui sous-tendent les interactions humaines.
C'est aussi un roman sombre et dérangeant. Les scènes de violence et de perversion peuvent être difficiles à lire, et certains lecteurs pourraient être rebutés par le ton nihiliste et désabusé du récit.
"Les Désarrois de l'élève Törless" est un roman complexe et stimulant qui mérite d'être lu pour sa profondeur psychologique et son exploration audacieuse des thèmes universels. Bien qu'il puisse être troublant, il reste un témoignage puissant de la condition humaine et de la recherche perpétuelle de sens dans un monde chaotique.
Musil présente une histoire qui se déroule dans un pensionnat militaire austro-hongrois, où l'élève Törless est témoin des relations sadomasochistes entre ses camarades de classe. Le récit met en lumière les tourments intérieurs de Törless alors qu'il navigue entre la fascination et le dégoût pour ces événements. À travers le personnage de Törless, Musil explore les thèmes de l'aliénation, de l'homosexualité, de la culpabilité et de la recherche de soi.
La façon dont Musil dépeint les conflits intérieurs des personnages est une des forces du roman. Törless est confronté à des dilemmes moraux complexes alors qu'il tente de comprendre ses propres désirs et ses réactions face à l'injustice et à la cruauté qui l'entourent. Musil utilise également l'histoire pour examiner les dynamiques de pouvoir et de soumission, mettant en lumière les tensions sociales et psychologiques qui sous-tendent les interactions humaines.
C'est aussi un roman sombre et dérangeant. Les scènes de violence et de perversion peuvent être difficiles à lire, et certains lecteurs pourraient être rebutés par le ton nihiliste et désabusé du récit.
"Les Désarrois de l'élève Törless" est un roman complexe et stimulant qui mérite d'être lu pour sa profondeur psychologique et son exploration audacieuse des thèmes universels. Bien qu'il puisse être troublant, il reste un témoignage puissant de la condition humaine et de la recherche perpétuelle de sens dans un monde chaotique.
Roman sur le harcèlement, la pression psychologique et la cruauté exacerbée par la dynamique de groupe dans une institution scolaire réputée d'Autiche où trois adolescents en tourmentent un plus jeune.
Törless assiste avec complaisance à ces violences en retirant la fascination et la jouissance perverse de la découverte des travers obscurs de l'humain et l'apprentissage de la sexualité (la victime étant soumise à des abus) et d'une homosexualité non assumée.
Ce récit inspiré de la propre expérience d'internat de Musil dans un lycée militaire, explore la complexité de l'adolescence en quête identitaire avec ses perversions pubertaires, où la personnalité en fusion cherche une voie d'expression entre conformisme et rébellion avec une ambiguïté des actes qui fascine et répulse. Il explore les tensions internes du futur adulte, ses "désarrois" dans son apprentissage du moi et des autres, ce qui semble être le chemin exigeant et indispensable de l'accès à la lucidité et à son âme "L'homme ne peut parvenir à posséder son âme que d'une seule manière : en s'abimant en soi".
Musil a une écriture d'une exceptionnelle qualité proche de celle de Proust, qui fait de ses écrits une lecture exigeante. En synthèse, je dirai de ce roman qu'il est une éthologie de l'adolescence dépeinte à travers l'esthétique littéraire d'un voyage intérieur.
Törless assiste avec complaisance à ces violences en retirant la fascination et la jouissance perverse de la découverte des travers obscurs de l'humain et l'apprentissage de la sexualité (la victime étant soumise à des abus) et d'une homosexualité non assumée.
Ce récit inspiré de la propre expérience d'internat de Musil dans un lycée militaire, explore la complexité de l'adolescence en quête identitaire avec ses perversions pubertaires, où la personnalité en fusion cherche une voie d'expression entre conformisme et rébellion avec une ambiguïté des actes qui fascine et répulse. Il explore les tensions internes du futur adulte, ses "désarrois" dans son apprentissage du moi et des autres, ce qui semble être le chemin exigeant et indispensable de l'accès à la lucidité et à son âme "L'homme ne peut parvenir à posséder son âme que d'une seule manière : en s'abimant en soi".
Musil a une écriture d'une exceptionnelle qualité proche de celle de Proust, qui fait de ses écrits une lecture exigeante. En synthèse, je dirai de ce roman qu'il est une éthologie de l'adolescence dépeinte à travers l'esthétique littéraire d'un voyage intérieur.
L'homme sans qualité. Il y a bien longtemps, j'ai lu le tome 1 en entier et une grande partie du tome 2. A l'époque j'avais apprécié les méandres de la vie d'Ulrich et la description de son rapport catastrophique à la vie et aux autres. Mais aujourd'hui, c'est un ouvrage que je ne relirais pas, trop prise de tête, sombre, avec un personnage principal qui se regarde le nombril. C'est une performance de réussir à lire ces deux Tomes.
Bonjour! Est ce que quelqu’un ayant lu le livre pourrai me dégager et détailler les principales étapes du récit svp! Cela me sauverai vraiment! Merci bcp
Je suis un peu pressé de l’avoir voilà merci à ceux qui prendrons le temps de le faire ça serait adorable !!
Je suis un peu pressé de l’avoir voilà merci à ceux qui prendrons le temps de le faire ça serait adorable !!
Robert Musil c'est un écrivain du dedans, du dedans le cerveau, du dedans le corps, du dedans l'alchimie étrange entre les deux. Et je passe à l'âme.
Une écriture qui ne se laisse pas dompter, vous n'y comprenez rien, juste vous êtes ébloui. Et puis, parfois, y a une résonance et c'est alors immense.
Entre temps, c'est perdu que vous errez sur ces pattes et déliés noirs sur fond blanc.
Entre temps, dedans, perdu.
Les histoires sont des histoires intenses d'amour, d'adultère, de fantasmes, de fidélité et d'infidélité, d'attraction, de cases, de cages et de tourbillons.
Des êtres humains dans quelques-unes de leurs complexités, et si Musil est un européen, nul doute que peu ou prou homo sapiens de partout trouvera correspondances.
Seulement 4 étoiles parce que j'ai un peu trop erré à mon goût et que ce n'est pas ce que je souhaite goûter. Là. Mais, dans l'absolu, rien à reprocher.
Une écriture qui ne se laisse pas dompter, vous n'y comprenez rien, juste vous êtes ébloui. Et puis, parfois, y a une résonance et c'est alors immense.
Entre temps, c'est perdu que vous errez sur ces pattes et déliés noirs sur fond blanc.
Entre temps, dedans, perdu.
Les histoires sont des histoires intenses d'amour, d'adultère, de fantasmes, de fidélité et d'infidélité, d'attraction, de cases, de cages et de tourbillons.
Des êtres humains dans quelques-unes de leurs complexités, et si Musil est un européen, nul doute que peu ou prou homo sapiens de partout trouvera correspondances.
Seulement 4 étoiles parce que j'ai un peu trop erré à mon goût et que ce n'est pas ce que je souhaite goûter. Là. Mais, dans l'absolu, rien à reprocher.
Le premier recueil de nouvelles qui compose ce livre, « Noces », qui date de 1911, six ans après « Les désarrois de l’élève Tӧrless », est une énigme. Sur les cent dix pages composant les deux nouvelles (« L’accomplissement de l’amour » et « La tentation de Véronique la tranquille »), l’écrivain autrichien propose un récit hallucinant (notamment les trente premières pages de la première nouvelle) censé retraduire ce qui se passe dans la tête des personnages principaux au niveau de l’inconscient (nous sommes à l’époque de Freud, son compatriote). Cela donne un galimatias invraisemblable. Robert avait-il consommé quelque chose avant d’écrire ? À force de parcourir des pages entières où, tout en prétendant signifier quelque chose, les mots ne paraissent rien dire, comme si l’auteur s’était ingénieusement employé à les faire subtilement dévier de leur fonction première de porteurs de sens, on se demande si Musil ne se fout pas de nous avec ces deux histoires. Aussi ne faut-il peut-être pas prendre trop à la lettre cette expérimentation étrange, et supposer que l’écrivain (avec l’ironie qu’on lui connaît, son goût des “expériences-limite”, son mépris de “l’esprit de sérieux”) s’est efforcé, sous prétexte de retraduire les tortuosités de l’inconscient, d’écrire des inepties sous le couvert de vraisemblances, ce qui est le propre du galimatias : un « discours confus qui semble dire quelque chose mais ne signifie rien » (CNRTL). Sous cet angle, l’exercice est fascinant. Or on sait que Musil était obnubilé par la bêtise. L’avis d’un psychiatre (Musil fréquentait à cette époque un psychiatre pour une maladie nerveuse d’origine cérébrale) serait le bienvenu. Toujours est-il que l’on comprend pourquoi le recueil « Noces » sera mal accueilli par le public en 1911.
Dans le second recueil, «Trois femmes », écrit en 1924, treize ans après l’échec commercial de « Noces », on constate avec soulagement que l’écrivain a repris ses esprits. Tant mieux. Il faut dire que, ayant participé activement à la Première Guerre mondiale, terminée six ans plus tôt, il n’est plus le même homme ; cela se sent. Les deux premières nouvelles (« Grigia » et « La Portuguaise ») proposent des récits un brin insolites mais bien écrits, avec cette désinvolture, cette dérision qui caractérisent la touche de l’écrivain, comme si l’homme, en arrière-plan, nous soufflait à l’oreille de ne pas prendre trop au sérieux ce qu’il nous raconte. La troisième nouvelle (« Tonka »), plus conventionnelle, est cependant émouvante. On sent toutefois dans ce recueil que l’écrivain se cherche encore, essayant de peaufiner un style qui est propre. C’est le chantier de « L’homme sans qualités », qui commence pratiquement à cette époque, qui lui permettra de concrétiser cette ambition.
Dans le second recueil, «Trois femmes », écrit en 1924, treize ans après l’échec commercial de « Noces », on constate avec soulagement que l’écrivain a repris ses esprits. Tant mieux. Il faut dire que, ayant participé activement à la Première Guerre mondiale, terminée six ans plus tôt, il n’est plus le même homme ; cela se sent. Les deux premières nouvelles (« Grigia » et « La Portuguaise ») proposent des récits un brin insolites mais bien écrits, avec cette désinvolture, cette dérision qui caractérisent la touche de l’écrivain, comme si l’homme, en arrière-plan, nous soufflait à l’oreille de ne pas prendre trop au sérieux ce qu’il nous raconte. La troisième nouvelle (« Tonka »), plus conventionnelle, est cependant émouvante. On sent toutefois dans ce recueil que l’écrivain se cherche encore, essayant de peaufiner un style qui est propre. C’est le chantier de « L’homme sans qualités », qui commence pratiquement à cette époque, qui lui permettra de concrétiser cette ambition.
Ce court texte, publié à titre posthume, cible une thématique complexe et profonde, l’amour. L’auteur nous dépeint ce sujet sous ses différentes formes et il présente l’adultère comme un possible prolongement de l’amour dans le mariage et non comme une fin de l’union. Les descriptions complexes tendent plus à donner un côté abstrait à cette nouvelle, il faut vraiment aimer. Puis l’écriture a un côté philosophique, ce qui demande une attention particulière de la part du lecteur.
Lien : https://instagram.com/plante..
Lien : https://instagram.com/plante..
C’est un livre déconcertant. Avec une précision redoutable, Musil explore le monde trouble, ambivalent de l’adolescence, moment buissonnier qui procure notamment « le privilège d’observer le monde démaquillé ».
Rappelons-nous : c’est le temps du grand étonnement face à l’amplitude du réel. D’où le désir de sortir de la vie routinière, emplie de fades certitudes : « il devait exister une porte pour sortir de l’univers de ces êtres irréprochables et sereins » peuplant le monde ordinaire. « Tous ces hommes mûrs, ces belles intelligences n’ont jamais fait que s’envelopper d’un filet dont chaque maille renforce la précédente, de sorte que l’ensemble a l’air merveilleusement naturel ; mais où se cache la première maille, celle dont tout le reste dépend, nul ne le sait ». Rebelle, entier, l’adolescent refuse « cet émoussement de la sensibilité qui fait qu’on ne s’inquiète même plus de voir un autre jour finir ». C’est le comble. Et le fait est : Tӧrless « n’avait pas appris encore à se coucher tous les soirs pour mourir sans y accorder d’importance », pénétré de l’évidence (nullement relevée par les grands esprits de ce monde) que « nous mourons tous les jours, dans les profondeurs sans rêves du sommeil ». Conjointement à ces interpellations, la poésie (comme souvent à cet âge) surgit : « soudain, et il lui sembla que c’était la première fois de sa vie, il prit conscience de la hauteur du ciel. Mais plus il pénétrait loin dans la hauteur, plus il s’élevait sur les ailes de son regard, plus le fond bleu et brillant reculait ». Mais point de “mysticismeˮ pour autant : « Je cherche rien de surnaturel ; c’est le naturel au contraire que je cherche, comprends-tu ? Je ne cherche rien hors de moi, je poursuis quelque chose en moi, en moi, quelque chose de naturel ! et que pourtant je ne comprends pas ».
Ce que les sages de ce monde appellent « l’Âge ingrat » est aussi le temps de la gestation : « un chemin qui menait aux profondeurs de son être », écrit Musil à propos de Tӧrless. « Son âme était une terre noire sous laquelle les germes déjà bougent, sans qu’on sache encore ce qu’ils donneront ». « Des parcelles de sa personnalité attendaient encore, tels des germes, le moment de la fécondation », « comme si ses racines devaient d’abord descendre à tâtons, et bouleverser le sol qu’elles sont destinées à mieux fixer plus tard ».
Cette gestation difficile passe par une expérimentation parfois sauvage, primitive même, souvent exécutée “dans le noirˮ, en tous les cas en dehors de toute règle, de toute morale. Mais ne nous leurrons pas sur l’importance de ces frasques : « Tout ce qu’il faisait n’était qu’un jeu, l’aidait simplement à supporter cette période larvaire de sa vie, et sans le moindre rapport avec sa véritable personnalité qui ne devait apparaître qu’ensuite, dans un délai encore indéterminé ». Car « le chemin sombre et secret » que l’adolescent emprunte est avant tout une « expérience intérieure » : « ce qui l’intéressait, c’était le phénomène mental que ces actes déclenchaient en lui, ce phénomène dont il continuait à ne savoir presque rien et devant la réalité duquel tout ce qu’il pouvait en penser lui paraissait futile ». Ce que Musil résume en une phrase dont il a le secret : « Je ne connais plus d’énigmes : les choses arrivent, voilà l’unique sagesse ».
Mais comment peut-on retraduire aussi bien cet itinéraire initiatique lorsqu’on a vingt-cinq ans (âge auquel Musil écrit cet ouvrage) ? La modernité du processus narratif, la profondeur des analyses, la complexité des thèmes, l’autorité du style, la justesse des expressions attestent de la surprenante maturité de ce très jeune auteur. C’est stupéfiant de précocité.
Rappelons-nous : c’est le temps du grand étonnement face à l’amplitude du réel. D’où le désir de sortir de la vie routinière, emplie de fades certitudes : « il devait exister une porte pour sortir de l’univers de ces êtres irréprochables et sereins » peuplant le monde ordinaire. « Tous ces hommes mûrs, ces belles intelligences n’ont jamais fait que s’envelopper d’un filet dont chaque maille renforce la précédente, de sorte que l’ensemble a l’air merveilleusement naturel ; mais où se cache la première maille, celle dont tout le reste dépend, nul ne le sait ». Rebelle, entier, l’adolescent refuse « cet émoussement de la sensibilité qui fait qu’on ne s’inquiète même plus de voir un autre jour finir ». C’est le comble. Et le fait est : Tӧrless « n’avait pas appris encore à se coucher tous les soirs pour mourir sans y accorder d’importance », pénétré de l’évidence (nullement relevée par les grands esprits de ce monde) que « nous mourons tous les jours, dans les profondeurs sans rêves du sommeil ». Conjointement à ces interpellations, la poésie (comme souvent à cet âge) surgit : « soudain, et il lui sembla que c’était la première fois de sa vie, il prit conscience de la hauteur du ciel. Mais plus il pénétrait loin dans la hauteur, plus il s’élevait sur les ailes de son regard, plus le fond bleu et brillant reculait ». Mais point de “mysticismeˮ pour autant : « Je cherche rien de surnaturel ; c’est le naturel au contraire que je cherche, comprends-tu ? Je ne cherche rien hors de moi, je poursuis quelque chose en moi, en moi, quelque chose de naturel ! et que pourtant je ne comprends pas ».
Ce que les sages de ce monde appellent « l’Âge ingrat » est aussi le temps de la gestation : « un chemin qui menait aux profondeurs de son être », écrit Musil à propos de Tӧrless. « Son âme était une terre noire sous laquelle les germes déjà bougent, sans qu’on sache encore ce qu’ils donneront ». « Des parcelles de sa personnalité attendaient encore, tels des germes, le moment de la fécondation », « comme si ses racines devaient d’abord descendre à tâtons, et bouleverser le sol qu’elles sont destinées à mieux fixer plus tard ».
Cette gestation difficile passe par une expérimentation parfois sauvage, primitive même, souvent exécutée “dans le noirˮ, en tous les cas en dehors de toute règle, de toute morale. Mais ne nous leurrons pas sur l’importance de ces frasques : « Tout ce qu’il faisait n’était qu’un jeu, l’aidait simplement à supporter cette période larvaire de sa vie, et sans le moindre rapport avec sa véritable personnalité qui ne devait apparaître qu’ensuite, dans un délai encore indéterminé ». Car « le chemin sombre et secret » que l’adolescent emprunte est avant tout une « expérience intérieure » : « ce qui l’intéressait, c’était le phénomène mental que ces actes déclenchaient en lui, ce phénomène dont il continuait à ne savoir presque rien et devant la réalité duquel tout ce qu’il pouvait en penser lui paraissait futile ». Ce que Musil résume en une phrase dont il a le secret : « Je ne connais plus d’énigmes : les choses arrivent, voilà l’unique sagesse ».
Mais comment peut-on retraduire aussi bien cet itinéraire initiatique lorsqu’on a vingt-cinq ans (âge auquel Musil écrit cet ouvrage) ? La modernité du processus narratif, la profondeur des analyses, la complexité des thèmes, l’autorité du style, la justesse des expressions attestent de la surprenante maturité de ce très jeune auteur. C’est stupéfiant de précocité.
« Il est des siècles qui ne suscitent qu’exceptionnellement, dans l’homme profondément solitaire, l’instant profondément solitaire de la Grâce », écrit Musil, qui en sait quelque chose : durant sa jeunesse, l’écrivain a une “ouverture de conscience ”, éclairement qu’il s’efforcera de décrypter tout au long de sa vie, notamment par le biais de la littérature. À travers ses personnages, il commente en effet cet « état de grâce », en particulier dans ce second tome. Sa particularité est de décrire cet état sans jargon ni artifice, d’utiliser un langage clair, précis, non ésotérique, évitant tout imaginaire religieux, tout symbolisme spirituel, toute coloration mystique. Car cet état, selon lui, est plus communément éprouvé par les êtres qu’on l’imagine : « il semble que l’événement fondamental du ravissement mystique, l’expérience nue, dépouillée de tous les voiles de la foi conceptuelle et traditionnelle comme des vieilles images religieuses, cette expérience qu’il n’est peut-être plus possible de juger exclusivement religieuse, se soit en fait extraordinairement répandue, et qu’elle forme l’âme qui hante notre temps comme un oiseau de nuit égaré en plein jour ». Il va d’ailleurs jusqu’à affirmer que « cet état élevé, auquel l’homme est capable d’accéder, est plus ancien que toute religion ». Son originalité est de décrire « cet état étrange, illimité, incroyable et inoubliable, où » ― comme il le relève admirablement ― « tout est “oui ”» en termes concrets, exprimant sans fard ce qu’il ressent : « [c’est] « spirituel et physique à la fois », écrit-il sobrement. En « cet état miraculeux », « toute pensée, ressentie comme un bonheur, un événement et un cadeau, [cesse] de s’associer aux sentiments d’appropriation, de domination, de conservation et d’observation : dans la tête aussi bien que dans le cœur, le goût de la possession de soi [est] remplacé par un don de soi, un entrelacement de soi et d’autrui, illimités ». En cet « instant d’extrême élévation », « on ne possède plus rien au monde, on ne tient plus rien, on n’est plus tenu par rien. Rien ne peut se produire, dans cet état, qui ne soit en accord avec lui. Un désir d’abandon à cet état est l’unique motif, l’unique forme, l’amoureuse détermination de tout acte et de toute pensée qui se produisent en son sein. Il est quelque chose d’infiniment tranquille et d’infiniment vaste, et tout ce qui se passe en lui accroît sa signification régulièrement, tranquillement grandissante. S’il ne l’accroît pas, c’est le mal, mais le mal ne peut pas se produire, parce qu’à l’instant même le silence et la clarté se déchirent et l’état merveilleux se dissout ». En « cet état particulier d’accroissement de la réceptivité et de la sensibilité qui produit, à la fois, une surabondance et un reflux des impressions », l’«unité de la conscience et des sens » qui en résulte est telle que « l’on retire le sentiment d’être lié à toutes les choses comme dans le fluide miroir d’une étendue d’eau, celui aussi de donner et de recevoir sans que la volonté y soit pour rien ; sentiment merveilleux que le dehors comme le dedans, ayant perdu leurs limites, sont devenus illimités ».
Pour lui, le “sacréˮ est ce qui échappe à toute volonté de possession : « La possession [est] la mort de l’esprit », affirme-t-il en ce sens. « Pour atteindre au rayonnement de l’esprit, il [faut] d’abord être bien persuadé de n’en point avoir ». Ce n’est pas juste une boutade : l’esprit n’étant point de nature créée, on ne peut prétendre se l’approprier. C’est pourquoi, écrit-il majestueusement, « la véritable grandeur est toujours sans fondement ». Le Réel est ce qui nous dépasse à chaque seconde. « Ce qui fut une fois ne se retrouvera jamais sous la même forme » : à chaque instant, on est dans une réalité vierge qui, se dérobant à toute prise, nous porte de l’intérieur. C’est dans cet esprit qu’il affirme à plusieurs reprises : « la foi ne doit pas être vieille d’une seule heure.Tout est là ! ».
Celui qui perçoit cette fraîcheur devient immédiatement amoureux. Pas de quelque chose, ni de quelqu’un en particulier : « quand on aime, tout est amour ». « Les sentiments ne supportent pas d’être attachés ». C’est ici « le grand amour » : celui qui, inconditionnel, ne se limitant plus à tel ou tel objet, les embrasse tous d’un seul regard. Car « tout sentiment qui n’est pas illimité est sans valeur ». À la vertu du « grand amour », avait-il commenté dans le premier tome, « on [n’est] plus soumis à aucune des séparations qui caractérisent l’humanité. Une sorte d’intériorité [unit] les êtres et [supprime] l’espace, comme, dans les rêves, deux êtres peuvent se traverser sans se confondre, et cette intimité [transforme] tous leurs rapports. Mais, pour le reste, cet état [n’a] rien de commun avec le rêve. Il [est] clair et [déborde] de claires pensées ; simplement, nulle cause, nul but, nul désir physique n’y [agit] ; toutes choses s’y [éploient] en cercles toujours renouvelés, comme quand un jet d’eau tombe inépuisablement dans une vasque ». En outre, « tous les problèmes et incidents de la vie [prennent] une douceur, une tendresse, une paix incomparables, et en même temps un sens entièrement différent de l’ancien » : en effet, quoi qu’il arrive, « c’est un événement qui [touche] indescriptiblement le cœur. Même pas un événement [d’ailleurs], bien que cela advînt, mais [plutôt] un état ». Car « cet amour [inconditionnel], loin de courir comme un ruisseau vers son but, constitue, comme la mer, un état ». Ainsi, « grâce à ces silencieuses expériences, tout ce qui fait la vie ordinaire [prend] une signification bouleversante, en quelque circonstance que ce fût ».
Du point de vue de la trame romanesque, ce second tome, plus court que le premier, apparaît pourtant moins dense, presque effiloché, comme si l’auteur avait un peu perdu le fil conducteur, ce qui s’illustre d’ailleurs par cette fin qui ne laisse rien entrevoir en débouché, laissant le lecteur sur sa fin. De surcroît, l’action propose comme dans le premier tome une alternance entre chapitres magistralement “éclairés” (au cours desquels on mesure à quel point Musil est un écrivain hors du commun) et des passages conceptuels “à l’allemande” qui rendent la lecture pesante. Mais, quoi qu’il en soit de ces difficultés, il faut accepter l’idée d’emblée, lorsqu’on s’engage dans cette aventure, que cet ouvrage expérimental, non achevé, est tout sauf un roman “classique”.
Pour lui, le “sacréˮ est ce qui échappe à toute volonté de possession : « La possession [est] la mort de l’esprit », affirme-t-il en ce sens. « Pour atteindre au rayonnement de l’esprit, il [faut] d’abord être bien persuadé de n’en point avoir ». Ce n’est pas juste une boutade : l’esprit n’étant point de nature créée, on ne peut prétendre se l’approprier. C’est pourquoi, écrit-il majestueusement, « la véritable grandeur est toujours sans fondement ». Le Réel est ce qui nous dépasse à chaque seconde. « Ce qui fut une fois ne se retrouvera jamais sous la même forme » : à chaque instant, on est dans une réalité vierge qui, se dérobant à toute prise, nous porte de l’intérieur. C’est dans cet esprit qu’il affirme à plusieurs reprises : « la foi ne doit pas être vieille d’une seule heure.Tout est là ! ».
Celui qui perçoit cette fraîcheur devient immédiatement amoureux. Pas de quelque chose, ni de quelqu’un en particulier : « quand on aime, tout est amour ». « Les sentiments ne supportent pas d’être attachés ». C’est ici « le grand amour » : celui qui, inconditionnel, ne se limitant plus à tel ou tel objet, les embrasse tous d’un seul regard. Car « tout sentiment qui n’est pas illimité est sans valeur ». À la vertu du « grand amour », avait-il commenté dans le premier tome, « on [n’est] plus soumis à aucune des séparations qui caractérisent l’humanité. Une sorte d’intériorité [unit] les êtres et [supprime] l’espace, comme, dans les rêves, deux êtres peuvent se traverser sans se confondre, et cette intimité [transforme] tous leurs rapports. Mais, pour le reste, cet état [n’a] rien de commun avec le rêve. Il [est] clair et [déborde] de claires pensées ; simplement, nulle cause, nul but, nul désir physique n’y [agit] ; toutes choses s’y [éploient] en cercles toujours renouvelés, comme quand un jet d’eau tombe inépuisablement dans une vasque ». En outre, « tous les problèmes et incidents de la vie [prennent] une douceur, une tendresse, une paix incomparables, et en même temps un sens entièrement différent de l’ancien » : en effet, quoi qu’il arrive, « c’est un événement qui [touche] indescriptiblement le cœur. Même pas un événement [d’ailleurs], bien que cela advînt, mais [plutôt] un état ». Car « cet amour [inconditionnel], loin de courir comme un ruisseau vers son but, constitue, comme la mer, un état ». Ainsi, « grâce à ces silencieuses expériences, tout ce qui fait la vie ordinaire [prend] une signification bouleversante, en quelque circonstance que ce fût ».
Du point de vue de la trame romanesque, ce second tome, plus court que le premier, apparaît pourtant moins dense, presque effiloché, comme si l’auteur avait un peu perdu le fil conducteur, ce qui s’illustre d’ailleurs par cette fin qui ne laisse rien entrevoir en débouché, laissant le lecteur sur sa fin. De surcroît, l’action propose comme dans le premier tome une alternance entre chapitres magistralement “éclairés” (au cours desquels on mesure à quel point Musil est un écrivain hors du commun) et des passages conceptuels “à l’allemande” qui rendent la lecture pesante. Mais, quoi qu’il en soit de ces difficultés, il faut accepter l’idée d’emblée, lorsqu’on s’engage dans cette aventure, que cet ouvrage expérimental, non achevé, est tout sauf un roman “classique”.
Ulrich est un homme moderne : ayant voulu se laisser la possibilité de laisser advenir en lui tous les possibles, il se découvre finalement sans qualités, vaincu par cette erreur de jeunesse qui fait croire que l’amour sera toujours aussi intense et qu’une vie fondée uniquement sur la passion peut être solide.
Ulrich a passionnément aimé les idées, puis elles se sont révélées pour ce qu’elles sont, d’éphémères attachements intellectuels. Il atteint la trentaine et se promène dans la vie sans s’y attacher. Il observe l’existence que mènent ses amis. Il rencontre une cousine. Il se laisse entraîner dans une campagne pacifiste qui prépare le 70e anniversaire de l’empereur d’Autriche en 1918 sous le signe du triomphe de l’humanisme et de l’idéalisme européens, avec toute l’ironie que suggèrent ces notions. Pour Musil, l’esprit moderne apparaît avec la rupture opérée par Galilée. Il se fait un plaisir de décrire la société du début du 20e siècle comme le pur produit de cette scission.
Relations surfacielles, intérêts éphémères, solitude et errance dans le monde moderne : les hommes attendent sans savoir quoi. L’écriture est placée sous le signe de l’inconscient ("J'ai été soulevé comme un bouchon et déposé où je n'eusse jamais voulu l'être !") et les nouvelles pensées de l’ère moderne cherchent à se matérialiser en en passant par des actions blafardes. « La vie forme une surface qui se donne l'air d'être obligée d'être ce qu'elle est, mais sous cette peau, les choses poussent et pressent. » Le matérialisme, à mesure qu’il se nourrit paradoxalement d’un imaginaire plus affamé qui l’annule, fait du monde vivant une virtualité. La science s’éloigne de l’expérience quotidienne et s’attache aux idées qui permettront de se passer pour toujours des faits. « Il s’est constitué un monde de qualités sans homme, d’expériences vécues sans personne pour les vivre ; on en viendrait presque à penser que l’homme, dans le cas idéal, finira par ne plus pouvoir disposer d’une expérience privée et que le doux fardeau de la responsabilité personnelle se dissoudra dans l’algèbre des significations possibles. »
N'ayant moi-même aucune qualité de constance, je n’ai pas poursuivi la lecture de ce volume, pourtant lu en septembre 2020, par ceux qui suivent. Ma mauvaise conscience me taraude cependant. Je céderai sans doute à ses injures, et j’en parlerais peut-être d’ici trois ans.
Ulrich a passionnément aimé les idées, puis elles se sont révélées pour ce qu’elles sont, d’éphémères attachements intellectuels. Il atteint la trentaine et se promène dans la vie sans s’y attacher. Il observe l’existence que mènent ses amis. Il rencontre une cousine. Il se laisse entraîner dans une campagne pacifiste qui prépare le 70e anniversaire de l’empereur d’Autriche en 1918 sous le signe du triomphe de l’humanisme et de l’idéalisme européens, avec toute l’ironie que suggèrent ces notions. Pour Musil, l’esprit moderne apparaît avec la rupture opérée par Galilée. Il se fait un plaisir de décrire la société du début du 20e siècle comme le pur produit de cette scission.
Relations surfacielles, intérêts éphémères, solitude et errance dans le monde moderne : les hommes attendent sans savoir quoi. L’écriture est placée sous le signe de l’inconscient ("J'ai été soulevé comme un bouchon et déposé où je n'eusse jamais voulu l'être !") et les nouvelles pensées de l’ère moderne cherchent à se matérialiser en en passant par des actions blafardes. « La vie forme une surface qui se donne l'air d'être obligée d'être ce qu'elle est, mais sous cette peau, les choses poussent et pressent. » Le matérialisme, à mesure qu’il se nourrit paradoxalement d’un imaginaire plus affamé qui l’annule, fait du monde vivant une virtualité. La science s’éloigne de l’expérience quotidienne et s’attache aux idées qui permettront de se passer pour toujours des faits. « Il s’est constitué un monde de qualités sans homme, d’expériences vécues sans personne pour les vivre ; on en viendrait presque à penser que l’homme, dans le cas idéal, finira par ne plus pouvoir disposer d’une expérience privée et que le doux fardeau de la responsabilité personnelle se dissoudra dans l’algèbre des significations possibles. »
N'ayant moi-même aucune qualité de constance, je n’ai pas poursuivi la lecture de ce volume, pourtant lu en septembre 2020, par ceux qui suivent. Ma mauvaise conscience me taraude cependant. Je céderai sans doute à ses injures, et j’en parlerais peut-être d’ici trois ans.
Cet ouvrage, on ne peut le résumer, on ne peut que le lire. Déjà ce n’est pas un livre “normal”. Parce que Robert Musil n’est pas un homme ordinaire. C’est un surdoué qui se sert de la littérature pour exprimer ce qu’il ressent dans sa confrontation au réel. En dépit d’un style littéraire de facture éminemment classique, l’écrivain autrichien écrit comme nul autre humain n’a su le faire avant lui, ne le fera sans doute jamais après lui. Par le truchement de ses personnages, on assiste à ce qui se passe dans sa tête. « Il n’est malheureusement rien d’aussi difficile à rendre, dans toutes les belles-lettres, qu’un homme qui pense » écrit-il au chapitre 28 du premier tome. Telle est pourtant l’ambition de cette œuvre de près de 2.000 pages (si on compte les deux tomes) qui, à la lisière entre psychologie, philosophie et métaphysique, constitue selon moi la plus belle création littéraire du XX° siècle.
Cet ouvrage procure le dévoilement d’un univers intérieur, comme chez Proust. On y plonge dedans, ou on reste à la surface. Mais les dimensions, le volume, font qu’il ne peut y avoir de juste milieu. Il y a des passages sans doute longs, parfois peut-être même inutiles (des chapitres très conceptuels “à l’allemande”), mais on est obligé de tout prendre, comme on le fait avec quelqu’un que l’on aime et vis-à-vis duquel on ne peut évidemment pas “trier”. Toujours est-il que, à l’instar de la « Recherche du temps perdu », « L’homme sans qualités » est une des réalisations littéraires les plus stupéfiantes du monde moderne.
Tout respire ici l’intelligence. À chaque mot, chaque phrase. Quel que soit le sujet, la lumière est présente ; car Musil est un être “éclairé”. Au-delà de la pertinence du propos, on sent conjointement l’impertinence, l’humour, la clairvoyance. C’est immensément drôle, presque à chaque chapitre, car il n’y a rien de plus désopilant (c’est le fil conducteur de ce premier tome) que notre âme qui prend (dramatiquement) tout au sérieux. En effet, nous dit-il en filigrane, il n’y a rien de sérieux en ce monde : tout est égal devant l’Infini, ce « principe invisible » qui régit tout.
Du point de vue de l’action, Musil déploie dans ce tome sur sept cents pages la mise en scène d’un invraisemblable événement mondain dont l’inanité révèle la vacuité du monde, n’aboutissant évidemment nulle part. Cela permet à l’écrivain de parler de choses et d’autres, comme ça lui vient ; et c’est très bien comme cela. D’autant que l’essentiel chez lui n’est pas dans les mots qu’il emploie mais dans ce vers quoi ils pointent (non dans les notes, disait Glenn Gould à propos de la musique de Bach, mais dans le silence qui les relie).
Contemporain de Freud et de Zweig (ses compatriotes), Musil excelle dans le portrait des personnages. La psychologie des femmes est admirablement décrite. Personnage-phare, Diotime en particulier ne se limite pas à une figure sociale (une bourgeoise désoeuvrée jouant à l’aristocrate dans les milieux mondains de Vienne), mais incarne de manière avant-gardiste le néo-spiritualisme (ce qu’on appellerait aujourd’hui le « développement personnel »). Chez les hommes, la galerie – qui va de l’aristocrate au haut-fonctionnaire, du militaire au bourgeois ou à l’artiste, du domestique au marginal – est tout aussi saisissante. Personnage emblématique, Arnheim apparaît telle une préfiguration d’un patron actuel du GAFA. Tout l’art de Musil est d’accompagner avec empathie ses personnages les plus excessifs, leur faisant d’ailleurs parfois prononcer des phrases admirables, ce qui témoigne de sa grande subtilité d’esprit.
Quant à Ulrich, le personnage principal, qui observe cette comédie humaine sans s’impliquer, il est qualifié dès le départ comme un « homme sans qualités » (der Mann ohne Eigenschaften) : un être « sans caractéristique propre », « sans qualités particulières ». En fait, un être « sans personnalité », sur qui tout glisse, parce que, émancipé de toute “croyance”, ne ressentant plus la nécessité d’adhérer à quoi que ce soit, il se contente d’être ce qu’il est : un homme à part entière, qu’aucune norme ne saurait qualifier, qu’aucun jugement ne peut atteindre. C’est ce qui rend ce chef d’œuvre, du point de vue ontologique, éminemment actuel.
Cet ouvrage procure le dévoilement d’un univers intérieur, comme chez Proust. On y plonge dedans, ou on reste à la surface. Mais les dimensions, le volume, font qu’il ne peut y avoir de juste milieu. Il y a des passages sans doute longs, parfois peut-être même inutiles (des chapitres très conceptuels “à l’allemande”), mais on est obligé de tout prendre, comme on le fait avec quelqu’un que l’on aime et vis-à-vis duquel on ne peut évidemment pas “trier”. Toujours est-il que, à l’instar de la « Recherche du temps perdu », « L’homme sans qualités » est une des réalisations littéraires les plus stupéfiantes du monde moderne.
Tout respire ici l’intelligence. À chaque mot, chaque phrase. Quel que soit le sujet, la lumière est présente ; car Musil est un être “éclairé”. Au-delà de la pertinence du propos, on sent conjointement l’impertinence, l’humour, la clairvoyance. C’est immensément drôle, presque à chaque chapitre, car il n’y a rien de plus désopilant (c’est le fil conducteur de ce premier tome) que notre âme qui prend (dramatiquement) tout au sérieux. En effet, nous dit-il en filigrane, il n’y a rien de sérieux en ce monde : tout est égal devant l’Infini, ce « principe invisible » qui régit tout.
Du point de vue de l’action, Musil déploie dans ce tome sur sept cents pages la mise en scène d’un invraisemblable événement mondain dont l’inanité révèle la vacuité du monde, n’aboutissant évidemment nulle part. Cela permet à l’écrivain de parler de choses et d’autres, comme ça lui vient ; et c’est très bien comme cela. D’autant que l’essentiel chez lui n’est pas dans les mots qu’il emploie mais dans ce vers quoi ils pointent (non dans les notes, disait Glenn Gould à propos de la musique de Bach, mais dans le silence qui les relie).
Contemporain de Freud et de Zweig (ses compatriotes), Musil excelle dans le portrait des personnages. La psychologie des femmes est admirablement décrite. Personnage-phare, Diotime en particulier ne se limite pas à une figure sociale (une bourgeoise désoeuvrée jouant à l’aristocrate dans les milieux mondains de Vienne), mais incarne de manière avant-gardiste le néo-spiritualisme (ce qu’on appellerait aujourd’hui le « développement personnel »). Chez les hommes, la galerie – qui va de l’aristocrate au haut-fonctionnaire, du militaire au bourgeois ou à l’artiste, du domestique au marginal – est tout aussi saisissante. Personnage emblématique, Arnheim apparaît telle une préfiguration d’un patron actuel du GAFA. Tout l’art de Musil est d’accompagner avec empathie ses personnages les plus excessifs, leur faisant d’ailleurs parfois prononcer des phrases admirables, ce qui témoigne de sa grande subtilité d’esprit.
Quant à Ulrich, le personnage principal, qui observe cette comédie humaine sans s’impliquer, il est qualifié dès le départ comme un « homme sans qualités » (der Mann ohne Eigenschaften) : un être « sans caractéristique propre », « sans qualités particulières ». En fait, un être « sans personnalité », sur qui tout glisse, parce que, émancipé de toute “croyance”, ne ressentant plus la nécessité d’adhérer à quoi que ce soit, il se contente d’être ce qu’il est : un homme à part entière, qu’aucune norme ne saurait qualifier, qu’aucun jugement ne peut atteindre. C’est ce qui rend ce chef d’œuvre, du point de vue ontologique, éminemment actuel.
~ Au commencement était Ulrich ~
C'est lui l'Homme sans qualité.
32 ans. Militaire, ingénieur & mathématicien, cependant, ne fout rien !
Déjà, qualité est à prendre au sens de particularité et non pas dans le sens vertu !
Musil lui-même notera : "Sa particularité essentielle, c’est qu’il n’a rien de particulier. C’est l’homme quelconque, et plus profondément l’homme sans essence - l’homme qui n’accepte pas de se cristalliser en un caractère ni de se figer dans une personnalité stable."
C'est l'homme du possible, surtout pas l'homme du réel. Incapable de décider, de trancher. Une seule certitude, le doute. Toujours !
Parachuté chez sa cousine, le voici en compagnie de la crème de la bourgeoisie viennoise pour préparer le jubilé de François-Joseph prévu pour 1918. Les femmes y sont aussi, Diotime, Bonadea, Clarisse, Rachel, Gerda tantôt pour l’amour & le sexe, tantôt pour l'essence & l'esprit.
L'Action parallèle est un événement que Musil trouve pour entrecroiser tout ce beau monde, les confronter, pour capturer les intérêts, les aspirations, les travers & les rêves de chacun, pour traduire l’état de cette société policée & brillante, qui a vu s'épanouir Freud, Wagner, Schiele, Klimt, Schönberg et tant d'autres, mais où tout s'est mit incidieusement en place pour favoriser la guerre.
Le roman est composé d'une centaine de parties, qui sont autant d'échanges entre les protagonistes. On peut parfaitement l’aborder par fragments, comme une succession de portraits & de débats d'idées.
C'est un ouvrage a la fois philosophique, politique, sociale & historique, d'une richesse inépuisable & d'une beauté inégalable. C'est un livre qui se suffit à lui-même. Duras dira que c’est un livre éminemment obscur, illisible & irrésistible, dont la lecture est une mystérieuse corvée, et un enchantement une fois arrivé au bout ! Et de Musil que “C'est la tentative du tout. Du tout du monde”
Inqualifiable, il est bien plus que cela !
Alors si vous avez du temps & une tendance à l'auto-flagellation, c'est pour vous !
C'est lui l'Homme sans qualité.
32 ans. Militaire, ingénieur & mathématicien, cependant, ne fout rien !
Déjà, qualité est à prendre au sens de particularité et non pas dans le sens vertu !
Musil lui-même notera : "Sa particularité essentielle, c’est qu’il n’a rien de particulier. C’est l’homme quelconque, et plus profondément l’homme sans essence - l’homme qui n’accepte pas de se cristalliser en un caractère ni de se figer dans une personnalité stable."
C'est l'homme du possible, surtout pas l'homme du réel. Incapable de décider, de trancher. Une seule certitude, le doute. Toujours !
Parachuté chez sa cousine, le voici en compagnie de la crème de la bourgeoisie viennoise pour préparer le jubilé de François-Joseph prévu pour 1918. Les femmes y sont aussi, Diotime, Bonadea, Clarisse, Rachel, Gerda tantôt pour l’amour & le sexe, tantôt pour l'essence & l'esprit.
L'Action parallèle est un événement que Musil trouve pour entrecroiser tout ce beau monde, les confronter, pour capturer les intérêts, les aspirations, les travers & les rêves de chacun, pour traduire l’état de cette société policée & brillante, qui a vu s'épanouir Freud, Wagner, Schiele, Klimt, Schönberg et tant d'autres, mais où tout s'est mit incidieusement en place pour favoriser la guerre.
Le roman est composé d'une centaine de parties, qui sont autant d'échanges entre les protagonistes. On peut parfaitement l’aborder par fragments, comme une succession de portraits & de débats d'idées.
C'est un ouvrage a la fois philosophique, politique, sociale & historique, d'une richesse inépuisable & d'une beauté inégalable. C'est un livre qui se suffit à lui-même. Duras dira que c’est un livre éminemment obscur, illisible & irrésistible, dont la lecture est une mystérieuse corvée, et un enchantement une fois arrivé au bout ! Et de Musil que “C'est la tentative du tout. Du tout du monde”
Inqualifiable, il est bien plus que cela !
Alors si vous avez du temps & une tendance à l'auto-flagellation, c'est pour vous !
Dans "le zéro et l'infini" d'Arthur Koestler, le personnage de Roubachov écrit dans son journal : " L'ère industrielle est encore jeune dans l'histoire, et l'écart reste considérable entre sa structure économique extrêmement complexe et la compréhension de cette structure par les masses".
Robert Musil partage ce point de vue, mais l'élargit : ce n'est pas uniquement la structure économique du monde contemporain qui est extrêmement complexe, mais aussi la structure de la connaissance; et "les masses" ne sont pas les seules à ne pas avoir une compréhension exacte de cette structure; "les élites" elles aussi sont incapable d'en avoir une vue d'ensemble.
L'écart entre le progrès des sciences et de la technique et l'inertie des autres compartiments de la société occupe le centre de la réflexion de Musil. Il se trouve symboliser dès la première page où s'opposent la manière scientifique et la façon ordinaire de décrire une "belle après-midi d'automne".
Pour employer un langage vaguement marxiste, il existe une contradiction entre l'infrastructure (scientifique, technique, productive) et la superstructure (Institutions, Arts, Morale...) de la société.
Cette opposition se trouve représentée de manière satirique sur différents plans : rivalité entre la Prusse et l'Autriche-Hongrie, flirt risible entre Arnheim et Diotime, jalousie croissante de Walter pour Ulrich et polémique interminable sur le cas Moosbrugger, rendue insoluble par la contradiction entre une vision scientifique qui voit du continu, là où la pensée juridique veut des distinctions nettes et tranchées.
Les personnages du roman sont à la recherche d'une solution qui apaiserait cette tension fondamentale entre l'incroyable complexité du réel tel que le conçoit la pensée scientifique et les insurmontables difficultés que cette abondance de détails posent à l'esprit qui réclame quelque chose comme une compréhension globale du monde et de l'existence.
Le roman montre l'émergence progressive des tentations irrationnelles face aux insatisfactions et aux frustrations que crée la pensée scientifique, même auprès de ceux qui se réclament du "cercle de la raison": l'impossibilité d'atteindre à une vision unitaire et synthétique de la réalité ouvre la voie à toutes les solutions irrationnelles : Wagner, le nationalisme, la philosophie charlatanesque de Meingast, l'antisémitisme et la pureté raciale... L'action parallèle, tentative ridicule de réconcilier les émotions avec la raison, aboutit à la guerre.
Ulrich cherche lui aussi à reconstituer l'unité perdue de l'homme, mais il refuse de transiger avec la précision scientifique. Il est conscient d'une mutilation. Il sait que le besoin de synthèse ne peut être étouffer sous l'accumulation pléthorique des constatations de détails de la science, mais il ne veut pas sacrifier cette dernière à une illusion d'unité supérieure.
L'attirance qu'il éprouve pour Clarisse, puis pour Agathe témoigne de ce sentiment.
Robert Musil partage ce point de vue, mais l'élargit : ce n'est pas uniquement la structure économique du monde contemporain qui est extrêmement complexe, mais aussi la structure de la connaissance; et "les masses" ne sont pas les seules à ne pas avoir une compréhension exacte de cette structure; "les élites" elles aussi sont incapable d'en avoir une vue d'ensemble.
L'écart entre le progrès des sciences et de la technique et l'inertie des autres compartiments de la société occupe le centre de la réflexion de Musil. Il se trouve symboliser dès la première page où s'opposent la manière scientifique et la façon ordinaire de décrire une "belle après-midi d'automne".
Pour employer un langage vaguement marxiste, il existe une contradiction entre l'infrastructure (scientifique, technique, productive) et la superstructure (Institutions, Arts, Morale...) de la société.
Cette opposition se trouve représentée de manière satirique sur différents plans : rivalité entre la Prusse et l'Autriche-Hongrie, flirt risible entre Arnheim et Diotime, jalousie croissante de Walter pour Ulrich et polémique interminable sur le cas Moosbrugger, rendue insoluble par la contradiction entre une vision scientifique qui voit du continu, là où la pensée juridique veut des distinctions nettes et tranchées.
Les personnages du roman sont à la recherche d'une solution qui apaiserait cette tension fondamentale entre l'incroyable complexité du réel tel que le conçoit la pensée scientifique et les insurmontables difficultés que cette abondance de détails posent à l'esprit qui réclame quelque chose comme une compréhension globale du monde et de l'existence.
Le roman montre l'émergence progressive des tentations irrationnelles face aux insatisfactions et aux frustrations que crée la pensée scientifique, même auprès de ceux qui se réclament du "cercle de la raison": l'impossibilité d'atteindre à une vision unitaire et synthétique de la réalité ouvre la voie à toutes les solutions irrationnelles : Wagner, le nationalisme, la philosophie charlatanesque de Meingast, l'antisémitisme et la pureté raciale... L'action parallèle, tentative ridicule de réconcilier les émotions avec la raison, aboutit à la guerre.
Ulrich cherche lui aussi à reconstituer l'unité perdue de l'homme, mais il refuse de transiger avec la précision scientifique. Il est conscient d'une mutilation. Il sait que le besoin de synthèse ne peut être étouffer sous l'accumulation pléthorique des constatations de détails de la science, mais il ne veut pas sacrifier cette dernière à une illusion d'unité supérieure.
L'attirance qu'il éprouve pour Clarisse, puis pour Agathe témoigne de ce sentiment.
La dynamique souterraine des choses, qui un moment se cristallise dans une action : écrire une lettre à son mari, et puis on fait machine arrière et on ne l’envoie pas. Une décision d’attirer cet autre homme qui fascine et qu’on méprise, puis de le repousser, et finalement de se laisser aller… L’action, c’est ce centre trouvé, après les dérives des stimulus infinis qui s’entrechoquent.
Lien : https://actualitte.com/artic..
Lien : https://actualitte.com/artic..
Pas facile de pénétrer dans l'univers de Musil et de son Elève Törless. Nous voilà plongés au cœur de la bonne société de l'empire austro-hongrois, au tournant des XIXè et XXè siècles. Au sein d'une école, un groupe d'adolescents décide de "prendre en main" un de leurs camarades, coupable de vol, plutôt que de le dénoncer. Un peu entrainé par les autres, mais aussi un peu en écoutant ses propres pulsions, Törless se laisse aller lui aussi au pire : violence, intimidation, viol, pressions psychologiques, cruauté. Avec un air de ne pas y toucher. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Car Törless observe les faits en éprouvant certes bien un malaise, mais guère plus. Il porte sur les événements un regard intellectualisant qui lui permet de rester à peu près à distance. Je suis un peu circonspect après la lecture de ce roman, qui me laisse une impression étrange et désagréable. L'écriture de l'auteur m'a beaucoup plu. J'ai en revanche eu un peu de mal avec les envolées philosophiques et les considérations mathématiques de Törless. La rencontre avec Musil n'a qu'à moitié fonctionné.
L'homme du commun ne vit qu'une fois. Celui qui lit vit mille existences.
L'homme sain a toutes les maladies mentales; le véritable malade mental n'en a qu'une.
De ces phrases qui nous reviennent au détour d'une conversation, le roman de Musil en est plein à foison. Ni philosophe ou moraliste, ni éthicien ou psychologue, Musil s'en inspire pour nous restituer toute la profondeur de sa pensée. Livre de chevet bien mérité.
L'homme sain a toutes les maladies mentales; le véritable malade mental n'en a qu'une.
De ces phrases qui nous reviennent au détour d'une conversation, le roman de Musil en est plein à foison. Ni philosophe ou moraliste, ni éthicien ou psychologue, Musil s'en inspire pour nous restituer toute la profondeur de sa pensée. Livre de chevet bien mérité.
Je sais bien qu'il est trop tard pour changer le titre de cette oeuvre, mais il me semble que "L'homme sans qualités" est une mauvaise traduction de la volonté de l'auteur, ingénieur, exprimée par "Eigenschaften". En effet, Eigenschaft est utilisé en chimie pour parler des propriété d'un élément, d'un corps, de ses particularités. Il me semble donc que "L'homme sans propriétés" aurait mieux reflété le titre originel allemand. Certes, le terme propriétés en français est ambivalent. Alors peut-être que "particularités" aurait mieux convenu.
Quelques jours plus tard…
Quelle que soit la qualité de la traduction, le résultat est assez difficile à lire et certaines phrases m’écorchent les yeux et les oreilles. J’ai donc téléchargé le texte original à partir du site buecher.de pour 0,99€. Un peu presomptueux je suis, sans doute, mais on va voir laquelle des deux versions est la plus difficile.
Quelques jours plus tard…
Quelle que soit la qualité de la traduction, le résultat est assez difficile à lire et certaines phrases m’écorchent les yeux et les oreilles. J’ai donc téléchargé le texte original à partir du site buecher.de pour 0,99€. Un peu presomptueux je suis, sans doute, mais on va voir laquelle des deux versions est la plus difficile.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Robert Musil
Lecteurs de Robert Musil Voir plus
Quiz
Voir plus
les conteurs d'effroi vous mettent au défi
Comment s'appelle la mère de Roanne ?
Kira
Kora
Sora
5 questions
3 lecteurs ont répondu
Thème : Là où règnent les baleines de
Créer un quiz sur cet auteur3 lecteurs ont répondu