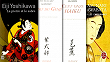Critiques de Ryûnosuke Akutagawa (91)
Ce recueil de contes traînait depuis longtemps dans ma bibliothèque jusqu'au jour où le grand rangement s'est décidé ! J'ai très rapidement lu ce petit recueil rempli de folies ancestrales. Je ne le conseille pas forcément pour ceux qui le liraient pour la fantaisie japonaise. Le seul conte auquel j'ai adhéré est Figures ancestrales même si la fin se prédit facilement, le reste ... pas top du tout.
J’ai très classiquement abordé l’œuvre d’Akutagawa Ryûnosuke avec son plus célèbre recueil en français, Rashômon et autres contes – puis j’ai poursuivi l’expérience avec La Vie d’un idiot et autres nouvelles : si ces deux recueils témoignaient chacun de ce que l’auteur était avant tout un maître du récit court, ils illustraient en même temps combien son œuvre sur ce format était variée – alternant vieux contes issus de la tradition japonaise, par exemple des Histoires qui sont maintenant du passé, et récits contemporains intimistes, davantage tournés vers la psychologie des personnages, et tout particulièrement le ressenti intime d’un narrateur au bout du rouleau qui se fait le porte-parole de l’auteur, à la façon des « romans du moi » dont un Dazai Osamu, notamment, était emblématique (voyez par exemple La Déchéance d’un homme) ; en même temps, quelle que soit l’époque choisie, le ton pouvait osciller entre un plus ou moins naturalisme un peu amer, et des expériences à la lisière du fantastique ou au-delà, éventuellement plus colorées – ce en quoi je suppose qu’il s’associe définitivement à son ami, moins connu de par chez nous, Uchida Hyakken (voyez Au-delà – Entrée triomphale dans Port-Arthur).
La Magicienne, troisième recueil de l’auteur que je lis, témoigne de cette diversité, mais, en même temps, met particulièrement l’accent sur une déchirure déjà sensible dans les deux précédents volumes, et à vrai dire emblématique des écrivains de Taishô : l’opposition parfois douloureuse entre un Japon traditionnel regretté et un déconcertant Japon engagé à marche forcée dans la voie de la modernisation à l’occidentale. En fait, trois des cinq nouvelles ici rassemblées, les trois premières, relèvent d’une sorte de « cycle thématique » qualifié de kaika (ki) mono, ou « histoires du temps de la modernisation » (le cycle comprend deux autres nouvelles figurant dans les recueils antérieurs : « Chasteté d’Otomi » dans Rashômon, et « Le Bal » dans La Vie d’un idiot) ; ce sont des récits assez divers, mais qui ont en commun d’illustrer cette thématique sans véritablement y apporter de solution – ce serait trop simple. Maintenant, on aurait probablement tort, à trop se focaliser sur cette question, de voir en Akutagawa un écrivain « passéiste », ou « réactionnaire » ; sans doute ne commet-il pas l’erreur de trop idéaliser le passé, comme celle de rejeter violemment et l’Occident, et la modernité (il y a trouvé son bonheur plus qu’à son tour, et au premier chef en littérature). Son propos n’est pas essentiellement politique, par ailleurs. Seulement, il fait part d’une vague nostalgie, pas forcément très rationnelle, pas moins poignante… Une vague nostalgie qui ferait alors écho à la « vague inquiétude », lacunaire explication par Akutagawa de son suicide en 1927, à l’âge de 35 ans – je relève au passage que les cinq nouvelles ici rassemblées ont été composées entre 1918 et 1920 pour quatre d’entre elles, et 1923 pour la dernière, toutes en tout cas avant le grand tremblement de terre du Kantô, qui serait un tel traumatisme pour les Japonais d’alors.
Si les trois nouvelles de kaika (ki) mono figurant dans La Magicienne ont une parenté thématique marquée, elles se montrent cependant assez différentes les unes des autres. La première, « Les Poupées » (Hina 雛), qui est la plus tardive (1923), est aussi la plus touchante. Elle est narrée par une petite fille (ou, plus exactement, Akutagawa rapporte les propos d'une vieille dame se remémorant quand elle était une petite fille, durant l'ère Meiji), issue d’une bonne famille toujours plus désargentée – au point où le père décide de vendre une collection de poupées traditionnelles (dont l’histoire remonte à l’époque de Heian) à un collectionneur américain (…) tout disposé à lui payer un gros chèque. La narratrice est horrifiée par ce choix, elle qui accorde une importance sentimentale énorme à ces poupées – y attache-t-elle aussi une valeur symbolique ? Indirectement, c’est probable – d’autant que l’affaire incite à voir en chacun des autres membres de la famille des archétypes au regard de cette question : la mère est enfermée dans le passé, mais pas moins dans l’impuissance, le frère est un jeune homme fort en gueule et qui brûle volontiers les bateaux, tous les bateaux, pour ne surtout pas repartir en arrière, et le père, enfin, prétend naviguer dans un entre-deux nébuleux et comme tel probablement intenable. En définitive, nous verrons bien ce qu’il en est de l’attachement à ces poupées, symbole faussement frivole d’une culture en proie au doute quant à son identité même… C’est une nouvelle très forte, riche d’images puissantes à vrai dire – et si les membres de la famille ont quelque chose d’archétypes, dans un récit au symbolisme marqué, Akutagawa Ryûnosuke parvient pourtant à ne pas trop charger la barque, et surtout à faire que les émotions de ses personnages ressortent avec le plus grand et le plus douloureux naturel ; la voix de la petite narratrice y a sa part, indéniablement.
« Un crime moderne » (Kaika no satsujin 開花の殺人, 1918) aborde la question d’une manière bien différente, dans le fond comme dans la forme. Comme le titre le laisse entendre, cette nouvelle tient du récit policier, au travers de la confession, dans une ultime lettre, d’un crime et de son mobile – avec quelque chose d’un peu pervers, qui me renvoie, peut-être à tort, à certaines œuvres à peine un peu postérieures d’Edogawa Ranpo, les deux écrivains étant des contemporains. En revanche, le qualificatif « moderne » du titre est probablement plus ambigu que dans la nouvelle qui précède et celle qui suit (« Un mari moderne ») ; je tends à croire qu’il renvoie, au moins pour partie, à ce genre policier, avec ses figures occidentales classiques chez Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux, qui s’exportait bien, même si depuis tout récemment, dans le Japon de Taishô ? Bon, je ne sais pas… Cette « modernité » est probablement avant tout d’essence psychologique, en tout cas – éventuellement importée en même temps que le récit policier : dans cette confession, le crime compte peut-être moins que sa justification, ou plus exactement le fait que la justification initiale s’avère à terme, aux yeux mêmes du criminel, comme une imposture aux soubassements obscurs et d’essence égoïste, quand le geste fatidique avait été commis au nom de l’altruisme – et s’il faut encore chercher des équivalents parmi les écrivains japonais du temps, je suppose que c’est ici le nom de Tanizaki Junichirô qu’il faudrait avancer, un auteur qui s’était lui aussi, à l’époque, essayé et à plusieurs reprises au genre policier, avec une ambiguïté morale plus généralement caractéristique de son œuvre ; en tout cas, j’en ai l’impression… Quoi qu’il en soit, dans son registre, c’est une nouvelle sympathique, qui fonctionne bien – sans renverser pour autant.
La troisième nouvelle – et la dernière de ce « cycle » de kaika (ki) mono dans le présent recueil – s’intitule « Un mari moderne » (Kaika no otto 開花の夫, 1919) ; le titre renvoie à la précédente, et nous y croisons là encore un « vicomte Honda », le nom du destinataire (ou plus exactement d’un des destinataires) de la lettre d’aveu du « crime moderne », même si je ne suis pas certain qu’il faille à tout crin y voir un même personnage. Le ton, de toute façon, est très différent : nul aspect policier ici, mais un discours sur la modernité plus ouvert, plus explicite, au travers de ce personnage qui entend conclure un mariage d’amour (à la française, dit-on), et vit dans un univers où le Japon traditionnel n’a tout simplement plus sa place – ce qui ressort notamment de la décoration de sa résidence. Citons le texte (p. 68) : « Tout avait un parfum de nouveauté surannée, la décoration vous plongeait presque dans l’angoisse à force de faste, et si je voulais la qualifier encore, je dirais que l’ensemble faisait songer au son d’un instrument de musique désaccordé, oui, ce cabinet de travail était un reflet fidèle de l’époque. » Mais, au fond, sous couvert d’une discordance, donc, entre la tradition et la modernité, la nouvelle fait probablement autant sinon plus état de ce que le désir d’idéal ne peut conduire qu’à la déception – ceci, pour le coup, n’est peut-être pas propre à ces Japonais d’alors, avides de s’occidentaliser... La peinture (si j’ose dire…) des mœurs est remarquable, dans cette nouvelle, qui trouve donc à s’illustrer dans le mobilier et les œuvres d’art, même si la thématique prétexte du mariage d’amour ne m’a pas parlé plus que cela.
Avec la quatrième nouvelle, qui est de loin la plus longue du recueil (dans les 80 pages, contre une trentaine pour les quatre autres récits – en fait, il semblerait que ce soit une des plus longues nouvelles dans toute l’œuvre d’Akutagawa), on change assez radicalement de registre : « La Magicienne » (Yôba 妖婆, 1919) est en effet, même contemporain, un long récit fantastique qui pioche dans le folklore nippon, mais en se mettant sous le patronage explicite de Poe et de Hoffmann ; à vrai dire, le caractère contemporain de cette aventure est probablement de la première importance, et, en cela, pourrait malgré tout renvoyer au cycle kaika (ki) mono, car, tout aussi expressément, le narrateur insiste sur le fait que son étrange histoire s’est bien produite dans le Japon de Taishô, consacrant beaucoup de pages à assurer son lecteur que le surnaturel et l’inexplicable sont toujours aussi prégnants en cette époque par essence « moderne ». En ce sens, « La Magicienne » explore bien la même tension caractéristique entre Japon ancien et Japon moderne, et le fait de citer expressément des auteurs occidentaux, comme les modèles d’un récit pourtant parfaitement japonais, joue de cette même ambiguïté – et, je suppose, non sans un certain humour. Car si le récit, sur une base classique d’amours contrariées, abonde en séquences cauchemardesques, et si la magicienne du titre est un personnage effrayant, au service d’une divinité à son tour ambiguë, l’histoire cependant se montre avant tout grotesque, délibérément : on ne fait pas du tout dans le fantastique subtil, ici ! À vrai dire, et d’autant plus que, passé donc un assez long préambule, le récit se montre assez frénétique dans ce registre, il m’a à nouveau fait penser à Edogawa Ranpo – mais, bizarrement ou pas, davantage celui du récit policier Le Lézard Noir que celui d’histoires lorgnant plus ouvertement sur le fantastique. Hélas, cela a eu sur moi la même conséquence – un profond ennui… renforcé par une tendance du récit à se montrer bien trop bavard. Amateur de fantastique, et ayant particulièrement prisé certains récits d’Akutagawa dans ce registre qui lui plaisait bien, notamment dans Rashômon et autres contes, j’attendais beaucoup de cette longue nouvelle, mais, en définitive, c’est celle qui m’a le moins parlé – et même, autant le dire, celle qui m’a déçu, celle que je n’ai pas aimé… Le folklore nippon, qui a forcément quelque chose d’original pour un lecteur occidental (ou qui l’avait – mais je dois dire que certaines scènes m’ont évoqué les yôkai de Mizuki Shigeru, par exemple dans NonNonBâ), et de manière concomitante la tournure grotesque du récit, pouvaient jouer en sa faveur, mais son rythme et son débit ont pesé davantage dans la balance, hélas, et je me suis… ennuyé, oui.
Reste une dernière nouvelle, et c’est le jour et la nuit : « Automne » (Aki 秋, 1920) est un récit très délicat, très subtil, tout en notes discrètes, qui tranche on ne peut plus avec la frénésie grotesque de « La Magicienne ». Le thème central du mariage rapproche peut-être « Automne » d’ « Un mari moderne », mais en inversant les rôles, puisque c’est cette fois une femme qui sera notre personnage point de vue, si elle est elle aussi, à sa manière, éprise d’idéal – seulement, ce récit est beaucoup plus poignant, ce qui le rapproche davantage à mes yeux des « Poupées » ; et je me demande, naïvement peut-être, si ce sentiment ne tient pas à ce que ces deux nouvelles mettent au premier plan, et dans le rôle de narratrice dans la première, des femmes ? Non que je sache bien ce qu’il faudrait en déduire, concernant aussi bien l’auteur, son pays, son époque… ou mon ressenti de lecteur. Quoi qu’il en soit, nous y voyons une femme brillante, et qui avait tout notamment pour devenir un grand écrivain, se sacrifier, en n’épousant pas l’homme qu’elle aime, un écrivain lui aussi, afin de laisser sa propre sœur, follement amoureuse, l’épouser à sa place, et en épousant quant à elle un ennuyeux banquier – cette décision fatidique ayant aussi (et peut-être même surtout ?) pour conséquence de mettre un terme à ses ambitions littéraires. L’archétype de la femme qui se sacrifie est très commun dans la culture japonaise, mais cette illustration particulière touche énormément, avec cette décision peut-être imposée par cette culture, ou tout autant par le désir d’idéal, et qui en définitive ne satisfait personne. Notons aussi que cette nouvelle dépeint par moments les milieux intellectuels de Taishô, un tableau qui vaut le détour. « Automne » est une très belle nouvelle, très émouvante.
À vrai dire, c’est probablement celle que j’ai préférée dans ce recueil, avec, à l’autre bout, « Les Poupées », donc. J’ai apprécié, aussi, « Un crime moderne », dans un registre très différent. « Un mari moderne » m’a laissé davantage froid, si j’ai apprécié ses descriptions, y compris morales. « La Magicienne », je suis passé totalement à côté. Le recueil, en prenant en compte ce bémol non négligeable (avec ses 80 pages, la novella occupe presque la moitié du volume auquel elle a donné son titre), m’a plu, toutefois bien moins que La Vie d’un idiot, et incomparablement moins que Rashômon. Mais je poursuivrai certainement l’expérience, probablement avec le quatrième recueil de nouvelles d’Akutagawa qu’est Jambes de cheval. À suivre, donc…
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
La Magicienne, troisième recueil de l’auteur que je lis, témoigne de cette diversité, mais, en même temps, met particulièrement l’accent sur une déchirure déjà sensible dans les deux précédents volumes, et à vrai dire emblématique des écrivains de Taishô : l’opposition parfois douloureuse entre un Japon traditionnel regretté et un déconcertant Japon engagé à marche forcée dans la voie de la modernisation à l’occidentale. En fait, trois des cinq nouvelles ici rassemblées, les trois premières, relèvent d’une sorte de « cycle thématique » qualifié de kaika (ki) mono, ou « histoires du temps de la modernisation » (le cycle comprend deux autres nouvelles figurant dans les recueils antérieurs : « Chasteté d’Otomi » dans Rashômon, et « Le Bal » dans La Vie d’un idiot) ; ce sont des récits assez divers, mais qui ont en commun d’illustrer cette thématique sans véritablement y apporter de solution – ce serait trop simple. Maintenant, on aurait probablement tort, à trop se focaliser sur cette question, de voir en Akutagawa un écrivain « passéiste », ou « réactionnaire » ; sans doute ne commet-il pas l’erreur de trop idéaliser le passé, comme celle de rejeter violemment et l’Occident, et la modernité (il y a trouvé son bonheur plus qu’à son tour, et au premier chef en littérature). Son propos n’est pas essentiellement politique, par ailleurs. Seulement, il fait part d’une vague nostalgie, pas forcément très rationnelle, pas moins poignante… Une vague nostalgie qui ferait alors écho à la « vague inquiétude », lacunaire explication par Akutagawa de son suicide en 1927, à l’âge de 35 ans – je relève au passage que les cinq nouvelles ici rassemblées ont été composées entre 1918 et 1920 pour quatre d’entre elles, et 1923 pour la dernière, toutes en tout cas avant le grand tremblement de terre du Kantô, qui serait un tel traumatisme pour les Japonais d’alors.
Si les trois nouvelles de kaika (ki) mono figurant dans La Magicienne ont une parenté thématique marquée, elles se montrent cependant assez différentes les unes des autres. La première, « Les Poupées » (Hina 雛), qui est la plus tardive (1923), est aussi la plus touchante. Elle est narrée par une petite fille (ou, plus exactement, Akutagawa rapporte les propos d'une vieille dame se remémorant quand elle était une petite fille, durant l'ère Meiji), issue d’une bonne famille toujours plus désargentée – au point où le père décide de vendre une collection de poupées traditionnelles (dont l’histoire remonte à l’époque de Heian) à un collectionneur américain (…) tout disposé à lui payer un gros chèque. La narratrice est horrifiée par ce choix, elle qui accorde une importance sentimentale énorme à ces poupées – y attache-t-elle aussi une valeur symbolique ? Indirectement, c’est probable – d’autant que l’affaire incite à voir en chacun des autres membres de la famille des archétypes au regard de cette question : la mère est enfermée dans le passé, mais pas moins dans l’impuissance, le frère est un jeune homme fort en gueule et qui brûle volontiers les bateaux, tous les bateaux, pour ne surtout pas repartir en arrière, et le père, enfin, prétend naviguer dans un entre-deux nébuleux et comme tel probablement intenable. En définitive, nous verrons bien ce qu’il en est de l’attachement à ces poupées, symbole faussement frivole d’une culture en proie au doute quant à son identité même… C’est une nouvelle très forte, riche d’images puissantes à vrai dire – et si les membres de la famille ont quelque chose d’archétypes, dans un récit au symbolisme marqué, Akutagawa Ryûnosuke parvient pourtant à ne pas trop charger la barque, et surtout à faire que les émotions de ses personnages ressortent avec le plus grand et le plus douloureux naturel ; la voix de la petite narratrice y a sa part, indéniablement.
« Un crime moderne » (Kaika no satsujin 開花の殺人, 1918) aborde la question d’une manière bien différente, dans le fond comme dans la forme. Comme le titre le laisse entendre, cette nouvelle tient du récit policier, au travers de la confession, dans une ultime lettre, d’un crime et de son mobile – avec quelque chose d’un peu pervers, qui me renvoie, peut-être à tort, à certaines œuvres à peine un peu postérieures d’Edogawa Ranpo, les deux écrivains étant des contemporains. En revanche, le qualificatif « moderne » du titre est probablement plus ambigu que dans la nouvelle qui précède et celle qui suit (« Un mari moderne ») ; je tends à croire qu’il renvoie, au moins pour partie, à ce genre policier, avec ses figures occidentales classiques chez Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux, qui s’exportait bien, même si depuis tout récemment, dans le Japon de Taishô ? Bon, je ne sais pas… Cette « modernité » est probablement avant tout d’essence psychologique, en tout cas – éventuellement importée en même temps que le récit policier : dans cette confession, le crime compte peut-être moins que sa justification, ou plus exactement le fait que la justification initiale s’avère à terme, aux yeux mêmes du criminel, comme une imposture aux soubassements obscurs et d’essence égoïste, quand le geste fatidique avait été commis au nom de l’altruisme – et s’il faut encore chercher des équivalents parmi les écrivains japonais du temps, je suppose que c’est ici le nom de Tanizaki Junichirô qu’il faudrait avancer, un auteur qui s’était lui aussi, à l’époque, essayé et à plusieurs reprises au genre policier, avec une ambiguïté morale plus généralement caractéristique de son œuvre ; en tout cas, j’en ai l’impression… Quoi qu’il en soit, dans son registre, c’est une nouvelle sympathique, qui fonctionne bien – sans renverser pour autant.
La troisième nouvelle – et la dernière de ce « cycle » de kaika (ki) mono dans le présent recueil – s’intitule « Un mari moderne » (Kaika no otto 開花の夫, 1919) ; le titre renvoie à la précédente, et nous y croisons là encore un « vicomte Honda », le nom du destinataire (ou plus exactement d’un des destinataires) de la lettre d’aveu du « crime moderne », même si je ne suis pas certain qu’il faille à tout crin y voir un même personnage. Le ton, de toute façon, est très différent : nul aspect policier ici, mais un discours sur la modernité plus ouvert, plus explicite, au travers de ce personnage qui entend conclure un mariage d’amour (à la française, dit-on), et vit dans un univers où le Japon traditionnel n’a tout simplement plus sa place – ce qui ressort notamment de la décoration de sa résidence. Citons le texte (p. 68) : « Tout avait un parfum de nouveauté surannée, la décoration vous plongeait presque dans l’angoisse à force de faste, et si je voulais la qualifier encore, je dirais que l’ensemble faisait songer au son d’un instrument de musique désaccordé, oui, ce cabinet de travail était un reflet fidèle de l’époque. » Mais, au fond, sous couvert d’une discordance, donc, entre la tradition et la modernité, la nouvelle fait probablement autant sinon plus état de ce que le désir d’idéal ne peut conduire qu’à la déception – ceci, pour le coup, n’est peut-être pas propre à ces Japonais d’alors, avides de s’occidentaliser... La peinture (si j’ose dire…) des mœurs est remarquable, dans cette nouvelle, qui trouve donc à s’illustrer dans le mobilier et les œuvres d’art, même si la thématique prétexte du mariage d’amour ne m’a pas parlé plus que cela.
Avec la quatrième nouvelle, qui est de loin la plus longue du recueil (dans les 80 pages, contre une trentaine pour les quatre autres récits – en fait, il semblerait que ce soit une des plus longues nouvelles dans toute l’œuvre d’Akutagawa), on change assez radicalement de registre : « La Magicienne » (Yôba 妖婆, 1919) est en effet, même contemporain, un long récit fantastique qui pioche dans le folklore nippon, mais en se mettant sous le patronage explicite de Poe et de Hoffmann ; à vrai dire, le caractère contemporain de cette aventure est probablement de la première importance, et, en cela, pourrait malgré tout renvoyer au cycle kaika (ki) mono, car, tout aussi expressément, le narrateur insiste sur le fait que son étrange histoire s’est bien produite dans le Japon de Taishô, consacrant beaucoup de pages à assurer son lecteur que le surnaturel et l’inexplicable sont toujours aussi prégnants en cette époque par essence « moderne ». En ce sens, « La Magicienne » explore bien la même tension caractéristique entre Japon ancien et Japon moderne, et le fait de citer expressément des auteurs occidentaux, comme les modèles d’un récit pourtant parfaitement japonais, joue de cette même ambiguïté – et, je suppose, non sans un certain humour. Car si le récit, sur une base classique d’amours contrariées, abonde en séquences cauchemardesques, et si la magicienne du titre est un personnage effrayant, au service d’une divinité à son tour ambiguë, l’histoire cependant se montre avant tout grotesque, délibérément : on ne fait pas du tout dans le fantastique subtil, ici ! À vrai dire, et d’autant plus que, passé donc un assez long préambule, le récit se montre assez frénétique dans ce registre, il m’a à nouveau fait penser à Edogawa Ranpo – mais, bizarrement ou pas, davantage celui du récit policier Le Lézard Noir que celui d’histoires lorgnant plus ouvertement sur le fantastique. Hélas, cela a eu sur moi la même conséquence – un profond ennui… renforcé par une tendance du récit à se montrer bien trop bavard. Amateur de fantastique, et ayant particulièrement prisé certains récits d’Akutagawa dans ce registre qui lui plaisait bien, notamment dans Rashômon et autres contes, j’attendais beaucoup de cette longue nouvelle, mais, en définitive, c’est celle qui m’a le moins parlé – et même, autant le dire, celle qui m’a déçu, celle que je n’ai pas aimé… Le folklore nippon, qui a forcément quelque chose d’original pour un lecteur occidental (ou qui l’avait – mais je dois dire que certaines scènes m’ont évoqué les yôkai de Mizuki Shigeru, par exemple dans NonNonBâ), et de manière concomitante la tournure grotesque du récit, pouvaient jouer en sa faveur, mais son rythme et son débit ont pesé davantage dans la balance, hélas, et je me suis… ennuyé, oui.
Reste une dernière nouvelle, et c’est le jour et la nuit : « Automne » (Aki 秋, 1920) est un récit très délicat, très subtil, tout en notes discrètes, qui tranche on ne peut plus avec la frénésie grotesque de « La Magicienne ». Le thème central du mariage rapproche peut-être « Automne » d’ « Un mari moderne », mais en inversant les rôles, puisque c’est cette fois une femme qui sera notre personnage point de vue, si elle est elle aussi, à sa manière, éprise d’idéal – seulement, ce récit est beaucoup plus poignant, ce qui le rapproche davantage à mes yeux des « Poupées » ; et je me demande, naïvement peut-être, si ce sentiment ne tient pas à ce que ces deux nouvelles mettent au premier plan, et dans le rôle de narratrice dans la première, des femmes ? Non que je sache bien ce qu’il faudrait en déduire, concernant aussi bien l’auteur, son pays, son époque… ou mon ressenti de lecteur. Quoi qu’il en soit, nous y voyons une femme brillante, et qui avait tout notamment pour devenir un grand écrivain, se sacrifier, en n’épousant pas l’homme qu’elle aime, un écrivain lui aussi, afin de laisser sa propre sœur, follement amoureuse, l’épouser à sa place, et en épousant quant à elle un ennuyeux banquier – cette décision fatidique ayant aussi (et peut-être même surtout ?) pour conséquence de mettre un terme à ses ambitions littéraires. L’archétype de la femme qui se sacrifie est très commun dans la culture japonaise, mais cette illustration particulière touche énormément, avec cette décision peut-être imposée par cette culture, ou tout autant par le désir d’idéal, et qui en définitive ne satisfait personne. Notons aussi que cette nouvelle dépeint par moments les milieux intellectuels de Taishô, un tableau qui vaut le détour. « Automne » est une très belle nouvelle, très émouvante.
À vrai dire, c’est probablement celle que j’ai préférée dans ce recueil, avec, à l’autre bout, « Les Poupées », donc. J’ai apprécié, aussi, « Un crime moderne », dans un registre très différent. « Un mari moderne » m’a laissé davantage froid, si j’ai apprécié ses descriptions, y compris morales. « La Magicienne », je suis passé totalement à côté. Le recueil, en prenant en compte ce bémol non négligeable (avec ses 80 pages, la novella occupe presque la moitié du volume auquel elle a donné son titre), m’a plu, toutefois bien moins que La Vie d’un idiot, et incomparablement moins que Rashômon. Mais je poursuivrai certainement l’expérience, probablement avec le quatrième recueil de nouvelles d’Akutagawa qu’est Jambes de cheval. À suivre, donc…
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
L'art de la narration est ici porté à son sommet dans ces brefs récits où il est beaucoup question de cruauté et d'obsession. Ces histoires emportent le lecteur dans un Japon médiéval peuplé de croyances fantastiques, d'êtres dominés par leurs passions, rendant ces contes d'autant plus intemporels. Kurosawa ne s'y est pas trompé en adaptant le conte "Dans la fourré" dans son film Rashômon (?!) qui permettra de faire connaître cet auteur génial et trouble au monde entier.
L'ASIE EN TOUTES LETTRES.
Quelle délicieuse initiative que celle-ci : donner à découvrir, pour l'achat d'un guide de la merveilleuse collection de la «Bibliothèque du Voyageur», cette invite permanente au voyage, aux cultures, à la découverte de contrées et de paysages plus ou moins lointains, trois nouvelles de trois des plus grands auteurs chinois, indiens et enfin japonais du XXème siècle, dans un petit ouvrage répondant au nom, digne de Gobineau (grand orientaliste, bel écrivain voyageur loué par Nicolas Bouvier, mais épouvantable raciste et antisémite notoire par ailleurs), de «Nouvelles asiatiques».
On y rit, non sans grincer des dents, mais d'assez bon cœur avec «Inspiration» de Qian Zhongshu, première nouvelle qui fait le portrait "d'un écrivain célèbre, dont nous ignorons le nom !", tant la notoriété de cet homme fit qu'il était devenu, pour tous "l'Auteur" sans même à s'inquiéter de retenir son patronyme, lequel, ne recevant pas le Prix Nobel pourtant très largement mérité selon ses admirateurs et lui-même (pour la raison que les vieilles badernes de Stockholm ne peuvent lire leurs futurs lauréats que dans des langues européennes de premier plan, et que la traduction de notre impétrant fut passablement loupée), meurt, se retrouve en enfer - un Enfer bien moins terrible que ce qu'on imagine, puisque la vie sur terre en a pris tous les attributs ! - et se retrouve jugé par... ses propres créatures de papier qui lui reprochent de ne les avoir qu'esquissés, rendant leur existence d'outre-monde parfaitement insupportable, monstrueuse !
Un réquisitoire terrible et d'un cynisme assumé contre les écrivains se prenant pour plus qu'ils ne sont réellement...
La seconde nouvelle est de l'indien - et prix Nobel (sic !) - Rabindranath Tagore, aujourd'hui un peu oublié aujourd'hui mais qui connu son heure de gloire internationale dans la première moitié du XXème siècle et même un peu au-delà (avec le "revival" hippie). Il y est question ici d'un vieil homme très riche, un zemindar (une sorte d'équivalent hindou des fermiers-généraux de la fin de l'ancien régime), décidant de se consacrer pleinement à ses affaires spirituelles et qui abandonne pour cette raison ses affaires temporelles à son fils, un être froid, calculateur, rusé, certes dans ses droits quant à sa rigoureuse application de la Loi, mais sans aucune espèce d'état d'âme ni de compassion à l'égard des individus qui vivaient jusque-là sous la conciliante et généreuse administration de son père.
Un seul de ses administrés lui résiste mais lorsque son père apprend que son fils est en train d'acculer cet homme et sa vieille mère à la ruine, celui-ci sort de son temple et de sa retraite pour admonester son héritier et lui intimer l'ordre de rendre toutes ses possessions à cet homme... Un témoin de cette scène fait son enquête et comprend, à partir de ses conclusions, comme les êtres humains peuvent pratiquer une certaine forme de sainteté bien qu'en réalité ce sont, tout au long de leur existence, de parfaits tartufes.
L'ultime nouvelle proposée ici est, sans le moindre doute, la plus profonde, la mieux composée - presque à la manière d'un roman très ramassé, séparé par de courts chapitres -, la plus complexe. On la doit au très grand écrivain japonais (assez méconnu chez nous), Ryunosuke Akutagawa, qui a donné son nom, de manière posthume et parfaitement involontaire, au prix littéraire nippon le plus prestigieux de l'archipel. Celle-ci s'intitule «Engrenage» et elle conte, par des raccourcis saisissant ainsi qu'un sens dramatique implacable au travers d'une écriture précise, presque froide, toujours parfaitement juste, l'engrenage impitoyable de la folie qui atteint, pas après pas, le narrateur du texte qui, double jeu abyssal, semble n'être autre que l'auteur lui-même. Se référant, entre autres, à deux immenses prédécesseurs et, si l'on peut dire, experts en matière de folie, d'hallucinations diverses, de malaises existentiels, à savoir au suédois August Strinberg et à son Inferno (qu'il ne cite jamais directement mais on comprend très bien la référence) ainsi qu'à, peut-être, notre plus grand nouvelliste, le normand Guy de Maupassant (identiquement le Horla n'est jamais explicitement mentionné, mais on saisit très vite la parenté), Akutagawa nous entraîne avec un art consommé du rythme vers les rivages mouvants et flous qui se situent entre fantastique assumé (fantômes, vêtements qui apparaissent et disparaissent sans raison, coïncidences impossibles, etc) et avancée inexorable vers cet autre état de la conscience que nous définissons tellement rapidement sous ce vocable facile de folie.
Cette nouvelle prend un sens encore plus singulier et tragique lorsque l'on sait que, publiée à titre posthume, celle-ci décrit probablement cette angoisse terrible d'un écrivain qui se suicidera de crainte d'être atteint du même mal que celui qui emporta, dans la fleur de l'âge, sa propre mère !
Une nouvelle forte et dérangeante tout à la fois, qui mérite à elle seule l'intérêt que l'on peut porter à ce trop bref recueil.
L'ouvrage n'a, finalement, qu'un seul véritable défaut : dans la mesure où il était offert pour l'achat d'un autre ouvrage, il n'est pas commercialisé - je remercie au passage cette excellente librairie du centre de St Denis (93) mais dont j'ai aujourd'hui oublié le nom, et qui cédait nombre de ces ouvrages gratuits pour l'achat de n'importe quel autre livre ! Il m'aura fallu bien du temps pour le dévorer (il date de 2012 et je n'ai dû me le procurer qu'en 2014), mais comme le veut l'adage : mieux vaut tard que jamais !
Quelle délicieuse initiative que celle-ci : donner à découvrir, pour l'achat d'un guide de la merveilleuse collection de la «Bibliothèque du Voyageur», cette invite permanente au voyage, aux cultures, à la découverte de contrées et de paysages plus ou moins lointains, trois nouvelles de trois des plus grands auteurs chinois, indiens et enfin japonais du XXème siècle, dans un petit ouvrage répondant au nom, digne de Gobineau (grand orientaliste, bel écrivain voyageur loué par Nicolas Bouvier, mais épouvantable raciste et antisémite notoire par ailleurs), de «Nouvelles asiatiques».
On y rit, non sans grincer des dents, mais d'assez bon cœur avec «Inspiration» de Qian Zhongshu, première nouvelle qui fait le portrait "d'un écrivain célèbre, dont nous ignorons le nom !", tant la notoriété de cet homme fit qu'il était devenu, pour tous "l'Auteur" sans même à s'inquiéter de retenir son patronyme, lequel, ne recevant pas le Prix Nobel pourtant très largement mérité selon ses admirateurs et lui-même (pour la raison que les vieilles badernes de Stockholm ne peuvent lire leurs futurs lauréats que dans des langues européennes de premier plan, et que la traduction de notre impétrant fut passablement loupée), meurt, se retrouve en enfer - un Enfer bien moins terrible que ce qu'on imagine, puisque la vie sur terre en a pris tous les attributs ! - et se retrouve jugé par... ses propres créatures de papier qui lui reprochent de ne les avoir qu'esquissés, rendant leur existence d'outre-monde parfaitement insupportable, monstrueuse !
Un réquisitoire terrible et d'un cynisme assumé contre les écrivains se prenant pour plus qu'ils ne sont réellement...
La seconde nouvelle est de l'indien - et prix Nobel (sic !) - Rabindranath Tagore, aujourd'hui un peu oublié aujourd'hui mais qui connu son heure de gloire internationale dans la première moitié du XXème siècle et même un peu au-delà (avec le "revival" hippie). Il y est question ici d'un vieil homme très riche, un zemindar (une sorte d'équivalent hindou des fermiers-généraux de la fin de l'ancien régime), décidant de se consacrer pleinement à ses affaires spirituelles et qui abandonne pour cette raison ses affaires temporelles à son fils, un être froid, calculateur, rusé, certes dans ses droits quant à sa rigoureuse application de la Loi, mais sans aucune espèce d'état d'âme ni de compassion à l'égard des individus qui vivaient jusque-là sous la conciliante et généreuse administration de son père.
Un seul de ses administrés lui résiste mais lorsque son père apprend que son fils est en train d'acculer cet homme et sa vieille mère à la ruine, celui-ci sort de son temple et de sa retraite pour admonester son héritier et lui intimer l'ordre de rendre toutes ses possessions à cet homme... Un témoin de cette scène fait son enquête et comprend, à partir de ses conclusions, comme les êtres humains peuvent pratiquer une certaine forme de sainteté bien qu'en réalité ce sont, tout au long de leur existence, de parfaits tartufes.
L'ultime nouvelle proposée ici est, sans le moindre doute, la plus profonde, la mieux composée - presque à la manière d'un roman très ramassé, séparé par de courts chapitres -, la plus complexe. On la doit au très grand écrivain japonais (assez méconnu chez nous), Ryunosuke Akutagawa, qui a donné son nom, de manière posthume et parfaitement involontaire, au prix littéraire nippon le plus prestigieux de l'archipel. Celle-ci s'intitule «Engrenage» et elle conte, par des raccourcis saisissant ainsi qu'un sens dramatique implacable au travers d'une écriture précise, presque froide, toujours parfaitement juste, l'engrenage impitoyable de la folie qui atteint, pas après pas, le narrateur du texte qui, double jeu abyssal, semble n'être autre que l'auteur lui-même. Se référant, entre autres, à deux immenses prédécesseurs et, si l'on peut dire, experts en matière de folie, d'hallucinations diverses, de malaises existentiels, à savoir au suédois August Strinberg et à son Inferno (qu'il ne cite jamais directement mais on comprend très bien la référence) ainsi qu'à, peut-être, notre plus grand nouvelliste, le normand Guy de Maupassant (identiquement le Horla n'est jamais explicitement mentionné, mais on saisit très vite la parenté), Akutagawa nous entraîne avec un art consommé du rythme vers les rivages mouvants et flous qui se situent entre fantastique assumé (fantômes, vêtements qui apparaissent et disparaissent sans raison, coïncidences impossibles, etc) et avancée inexorable vers cet autre état de la conscience que nous définissons tellement rapidement sous ce vocable facile de folie.
Cette nouvelle prend un sens encore plus singulier et tragique lorsque l'on sait que, publiée à titre posthume, celle-ci décrit probablement cette angoisse terrible d'un écrivain qui se suicidera de crainte d'être atteint du même mal que celui qui emporta, dans la fleur de l'âge, sa propre mère !
Une nouvelle forte et dérangeante tout à la fois, qui mérite à elle seule l'intérêt que l'on peut porter à ce trop bref recueil.
L'ouvrage n'a, finalement, qu'un seul véritable défaut : dans la mesure où il était offert pour l'achat d'un autre ouvrage, il n'est pas commercialisé - je remercie au passage cette excellente librairie du centre de St Denis (93) mais dont j'ai aujourd'hui oublié le nom, et qui cédait nombre de ces ouvrages gratuits pour l'achat de n'importe quel autre livre ! Il m'aura fallu bien du temps pour le dévorer (il date de 2012 et je n'ai dû me le procurer qu'en 2014), mais comme le veut l'adage : mieux vaut tard que jamais !
-Après une succession de guerres, cyclones, incendies et séismes, Kyoto connaît une période de grande misère. Réfugié sous la porte Rashô, un homme regarde la pluie. Derrière la porte, un charnier. Doit-il abandonner tout honneur et piller les cadavres ? Comme le fait justement la vieille femme qu'il rencontre à l'étage, une pauvresse qui arrache les cheveux d'une défunte pour en faire une perruque.
-Le riche seigneur de Horikawa commande un paravent à l'un de ses peintres préférés. Le Paravent des figures infernales va hanter le peintre Yoshihidé. Cet homme vil, avare, mesquin, détesté de tous, ne peut reproduire que des scènes qu'il a vues de ses yeux, alors quand il s'agit de représenter l'enfer...Sa passion créatrice va le conduire au pire, sous le regard impitoyable de son seigneur.
-Dans le fourré, un mort a été découvert. Le policier chargé de l'enquête reçoit les témoignages, parfois contradictoires, de tous les protagonistes de l'affaire, et même celui de l'esprit de la victime.
-Parmi les gens qui servent le Régent Fujiwara Mototsune, un officier de cinquième rang est moqué de tous, de ses collègues jusqu'aux enfants des rues. Son gros nez rouge, ses vêtements décolorés par le temps et la misère, son caractère timide en font un objet de sarcasmes permanents. Le pauvre hère vivote, solitaire, en caressant un unique rêve, celui de se rassasier un jour d'un bon gruau d'ignames, ce mets délicat, réservé aux fêtes, qu'il a déjà goûté sans pouvoir s'en repaître. Ayant eu vent de l'affaire, un seigneur l'entraîne dans un périlleux voyage hivernal jusqu'au cœur de l'abondance. Mais que cache cette générosité inespérée ?
Quatre contes très différents mais baignés par la même ambiance étrange et sombre. Le mal, la violence, la cruauté y sont très présents, sous la forme d'esprits vengeurs, de tentations, de représentations de l'enfer ou de comportements manipulateurs. Nulle rédemption, nulle pitié, nulle douceur dans l'univers d'Akutagawa. L'écriture est précise, ciselée, foisonnante mais malheureusement, le format court des contes laisse un peu sur sa faim...C'est pourtant une bonne introduction à l'oeuvre de cet auteur majeur au Japon, qui s'inspirait aussi bien des grands classiques japonais et chinois que de la culture occidentale.
-Le riche seigneur de Horikawa commande un paravent à l'un de ses peintres préférés. Le Paravent des figures infernales va hanter le peintre Yoshihidé. Cet homme vil, avare, mesquin, détesté de tous, ne peut reproduire que des scènes qu'il a vues de ses yeux, alors quand il s'agit de représenter l'enfer...Sa passion créatrice va le conduire au pire, sous le regard impitoyable de son seigneur.
-Dans le fourré, un mort a été découvert. Le policier chargé de l'enquête reçoit les témoignages, parfois contradictoires, de tous les protagonistes de l'affaire, et même celui de l'esprit de la victime.
-Parmi les gens qui servent le Régent Fujiwara Mototsune, un officier de cinquième rang est moqué de tous, de ses collègues jusqu'aux enfants des rues. Son gros nez rouge, ses vêtements décolorés par le temps et la misère, son caractère timide en font un objet de sarcasmes permanents. Le pauvre hère vivote, solitaire, en caressant un unique rêve, celui de se rassasier un jour d'un bon gruau d'ignames, ce mets délicat, réservé aux fêtes, qu'il a déjà goûté sans pouvoir s'en repaître. Ayant eu vent de l'affaire, un seigneur l'entraîne dans un périlleux voyage hivernal jusqu'au cœur de l'abondance. Mais que cache cette générosité inespérée ?
Quatre contes très différents mais baignés par la même ambiance étrange et sombre. Le mal, la violence, la cruauté y sont très présents, sous la forme d'esprits vengeurs, de tentations, de représentations de l'enfer ou de comportements manipulateurs. Nulle rédemption, nulle pitié, nulle douceur dans l'univers d'Akutagawa. L'écriture est précise, ciselée, foisonnante mais malheureusement, le format court des contes laisse un peu sur sa faim...C'est pourtant une bonne introduction à l'oeuvre de cet auteur majeur au Japon, qui s'inspirait aussi bien des grands classiques japonais et chinois que de la culture occidentale.
J’ai lu ce livre alors que j’étais en pleine « période japonaise ». Et j’avais notamment un intérêt particulièrement marqué pour deux aspects de la question : comment les auteurs japonais vivaient-ils le déchirement de leur société, tiraillée entre sa culture et son histoire et une ouverture revendiquée vers la culture européenne – on sait que Mishima en avait fait un cheval de bataille, donnant à son suicide rituel (seppuku) le sens d’une protestation contre l’envahissement de la culture japonaise par les mœurs occidentales -, d’une part, et en quoi la littérature japonaise repose-t-elle sur un travail stylistique particulier.
Après Mishima – Le pavillon d’or -, par filiation, j’ai commencé à lire Yasunari Kawabata. Tristesse et beauté, Les belles endormies, Pays de neige. Incroyablement peu connu en France pour un prix Nobel de littérature – le premier japonais a avoir reçu ce prix -, considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle, il était d’autant plus attirant pour moi. Pouvoir, au détour d’une phrase, citer un auteur japonais peu connu, quel infini bonheur, non ? Bon, certes, cela a été partiellement gâché lorsque Les belles endormies est devenu un film (Sleeping beauty, 2011), mais l’échec relatif du film et son peu de spectateurs fait que c’est encore jouable…
Avec Tristesse et beauté, la question du style était sur la table. Alors quand j’ai découvert un troisième auteur japonais de la même mouvance mais dont toute l’œuvre tournait autour de la question du style, je ne pouvais plus y échapper. En effet, comme le dit Roger Bozzetto dans « Littérature et cinéma fantastiques au Japon » (La revue des ressources, 2008), Ryunosuke Akutagawa propose, dans Rashômon et autres contes « des textes originaux, [qui] se réfèrent à d’anciens contes recueillis dans le Konjaku monogatari (XII°siècle). [Il reprend] sous des angles neufs et dans un style littéraire moderne les thèmes des anciens contes. [Il répète, à sa manière,] ce que Pu Song Lin au XVIII° siècle avait fait pour les contes chinois de la dynastie des Han, à savoir transposer dans la prose littéraire de son époque les images et les récits venus du folklore ».
C’est à cette occasion que j’ai découvert cet exercice à ma connaissance propre à la littérature japonaise de reprendre des textes de recueils anciens, de les réécrire, avec un objectif qui, s’il est simple à exprimer, est d’une insondable complexité dans les faits : réécrire des « contes » – la définition ici n’est pas celle que nous acceptons habituellement dans la littérature européenne -, en faisant en sorte à la fois – et c’est bien là toute la difficulté – qu’ils conservent le style propre à leur version originale tout en leur donnant un style propre à celui qui les réécrit. Autrement dit, objectif schizophrène, que chaque conte, extrait d’un recueil différent, conserve sa spécificité (un peu du style de son auteur d’origine), tout en faisant en sorte de donner néanmoins une uniformité de style – celui de l’auteur qui mène l’exercice – à ces récits. Une uniformisation qui conserve la typicité, en quelque sorte ! Ou la quadrature du cercle !
C’est à la fois fascinant, et parfois presque trop. Il faut alors se laisser aller à replonger dans l’ambiance, se laisser porter par le texte. L’ambiance est sombre, voire macabre. Faut-il y voir une trace de la mauvaise santé de l’auteur ? Souffrant du cœur, de l’estomac, des intestins, sujet à des hallucinations et à une neurasthénie tenace, il se suicide à l’âge de 35 ans, en laissant pour seul message « vague inquiétude ». Deux de ses nouvelles, Dans le fourré et Rashômon, justement, ont inspiré à Akira Kurosawa son Rashômon…
Bon, avouons le : je l’ai lu, mais je n’y reviendrai sans doute pas. Ce n’est évidemment pas le livre que je recommande à ceux qui voudraient faire une première incursion du côté de la littérature japonaise. Mais il n’y a pas que les block-busters, il n’y a pas que les page-turners…
Lien : https://ogrimoire.wordpress...
Après Mishima – Le pavillon d’or -, par filiation, j’ai commencé à lire Yasunari Kawabata. Tristesse et beauté, Les belles endormies, Pays de neige. Incroyablement peu connu en France pour un prix Nobel de littérature – le premier japonais a avoir reçu ce prix -, considéré comme un écrivain majeur du XXe siècle, il était d’autant plus attirant pour moi. Pouvoir, au détour d’une phrase, citer un auteur japonais peu connu, quel infini bonheur, non ? Bon, certes, cela a été partiellement gâché lorsque Les belles endormies est devenu un film (Sleeping beauty, 2011), mais l’échec relatif du film et son peu de spectateurs fait que c’est encore jouable…
Avec Tristesse et beauté, la question du style était sur la table. Alors quand j’ai découvert un troisième auteur japonais de la même mouvance mais dont toute l’œuvre tournait autour de la question du style, je ne pouvais plus y échapper. En effet, comme le dit Roger Bozzetto dans « Littérature et cinéma fantastiques au Japon » (La revue des ressources, 2008), Ryunosuke Akutagawa propose, dans Rashômon et autres contes « des textes originaux, [qui] se réfèrent à d’anciens contes recueillis dans le Konjaku monogatari (XII°siècle). [Il reprend] sous des angles neufs et dans un style littéraire moderne les thèmes des anciens contes. [Il répète, à sa manière,] ce que Pu Song Lin au XVIII° siècle avait fait pour les contes chinois de la dynastie des Han, à savoir transposer dans la prose littéraire de son époque les images et les récits venus du folklore ».
C’est à cette occasion que j’ai découvert cet exercice à ma connaissance propre à la littérature japonaise de reprendre des textes de recueils anciens, de les réécrire, avec un objectif qui, s’il est simple à exprimer, est d’une insondable complexité dans les faits : réécrire des « contes » – la définition ici n’est pas celle que nous acceptons habituellement dans la littérature européenne -, en faisant en sorte à la fois – et c’est bien là toute la difficulté – qu’ils conservent le style propre à leur version originale tout en leur donnant un style propre à celui qui les réécrit. Autrement dit, objectif schizophrène, que chaque conte, extrait d’un recueil différent, conserve sa spécificité (un peu du style de son auteur d’origine), tout en faisant en sorte de donner néanmoins une uniformité de style – celui de l’auteur qui mène l’exercice – à ces récits. Une uniformisation qui conserve la typicité, en quelque sorte ! Ou la quadrature du cercle !
C’est à la fois fascinant, et parfois presque trop. Il faut alors se laisser aller à replonger dans l’ambiance, se laisser porter par le texte. L’ambiance est sombre, voire macabre. Faut-il y voir une trace de la mauvaise santé de l’auteur ? Souffrant du cœur, de l’estomac, des intestins, sujet à des hallucinations et à une neurasthénie tenace, il se suicide à l’âge de 35 ans, en laissant pour seul message « vague inquiétude ». Deux de ses nouvelles, Dans le fourré et Rashômon, justement, ont inspiré à Akira Kurosawa son Rashômon…
Bon, avouons le : je l’ai lu, mais je n’y reviendrai sans doute pas. Ce n’est évidemment pas le livre que je recommande à ceux qui voudraient faire une première incursion du côté de la littérature japonaise. Mais il n’y a pas que les block-busters, il n’y a pas que les page-turners…
Lien : https://ogrimoire.wordpress...
(EN)VERS LE JAPON MODERNE.
C'est peu de dire que Ryûnosuke Akutagawa est un auteur japonais méconnu en France. Sans doute est-ce lié à ce qu'il fut essentiellement créateur de nouvelles, de poésie et de textes critiques, autant de genres littéraires plutôt modestement prisés du public hexagonal, et si l'on compte environ deux cent de ces œuvres, celles-ci seront par ailleurs écrites en à peine plus d'une dizaine d'années, Ryûnosuke Akutagawa s'étant suicidé à l'âge de trente-cinq ans. Souffrant en effet d'hallucinations, à l'instar de sa mère décédée en 1902 et morte en pleine folie à quarante-deux ans, il préféra mettre fin à ses jours, encore parfaitement lucide... Génie relativement précoce - il n'avait encore que vingt-trois ans lorsque sa première nouvelle, Le Nez, fut remarqué par l'immense Natsume Soseki qui encouragera vivement le jeune écrivain à poursuivre dans cette voie. Esprit ouvert à d'autres cultures que la sienne - il connaissait fort bien la culture chinoise de même que la littérature occidentale de son temps -, intellectuel à l'esprit fin et pénétrant, Ryûnosuke Akutagawa a marqué de son emprunte la littérature japonaise, son nom demeurant par ailleurs célèbre puisqu'en 1935, huit ans après sa disparition, l'un de ses proches donnera son nom en hommage à ce qui deviendra très vite le prix littéraire le plus célèbre du Pays du Soleil Levant, plus ou moins l'équivalent de notre Prix Goncourt.
Les cinq nouvelles proposées ici par les éditions Philippe Picquier, dont on connait le long et passionnant travail de défrichage des littératures extrêmes-orientales, ne sont qu'un avant-goût de celles écrites par Akutagawa, celles proposées ici étant extraites de différents cycles de l'auteur.
Ainsi, les trois premières sont-elles issues d'un cycle nommé «kaika (ki) mono», littéralement "histoires du temps de la modernisation" dont la première, «les poupées» est, sans nul doute la plus saisissante, la plus troublante et douce-amère des trois textes de cette série. Il y est question d'une famille souffrant directement du changement de société lié à la diffusion de la modernisation, voulue sous l'ère Meiji, et dont l'appauvrissement régulier oblige peu à peu le père de famille à vendre tous les trésors - fussent-ils symboliques - de sa lignée. Ainsi en est-il de ces poupées traditionnelles représentant l'Empereur, son épouse et sa cour, au milieu de leur décorum de bois, qu'un intermédiaire de leur connaissance a trouvé moyen de leur vendre à bon prix auprès d'un collectionneur américain (déjà !). Cette histoire, c'est à travers le regard de la cadette que nous la découvrons - c'est à elle qu'avaient été confiées les poupées - et si l'auteur nous fait comprendre la profonde tristesse que la jeune fille peut éprouver à devoir se séparer, presque sans mot dire et sans être autorisée à le pouvoir faire, de ses beaux jouets anciens, la fillette nous permet de comprendre les sentiments plus que divers des autres membres de la famille corrélativement à cette séparation d'une collection hautement symbolique d'objets quasi sacrés. Le fils aîné fait part de sa morgue et de tout son dégoût à l'égard d'objets surgit d'un passé à oublier d'urgence ; la mère n'en finit pas de regretter déjà cette séparation de biens précieux qui la reliait aux valeurs d'un régime en passe d'être définitivement aboli ; quant au père, il tâche de se maintenir dans un entre deux compliqué et instable, ni intensément passéiste ni totalement engagé dans la modernité du moment. L'ensemble est rédigé sur un mode réaliste d'une grande délicatesse contextuelle dans lequel l'auteur exprime les différents points de vue par l'entremise, dans cette première nouvelle, de cette jeune fille ou, dans le cas de «Un crime moderne» et de «un mari moderne», par le principal protagoniste de la narration. Chaque fois, cependant, l'on comprend le point de vue de Ryûnosuke Akutagawa qui, s'il n'est pas de ce passéisme intolérant et stérile, n'en éprouve pas moins une certaine nostalgie douce à l'égard de tout ce que la modernité semble devoir obstinément mettre à bas et détruire, sans commisération aucune à l'égard de ce que ce même passé pouvait avoir de beau, d'équilibré, d'éprouvé. Alors, Ryûnosuke Akutagawa se moque doucement, avec une sensibilité affirmée, beaucoup d'intelligence et d'élégance ainsi qu'une profonde culture (dont il faut rappeler ici qu'elle était en partie tournée vers les auteurs occidentaux de l'époque, nombres de nos auteurs y étant même nommément cités) des travers grands ou petits de ces modernistes effrénés mais confrontés à cette civilisation multi-millénaire tout autant qu'à leurs propres incohérences.
La nouvelle qui donne son nom à l'ensemble du recueil, «La magicienne» est d'un tout autre genre. Scindée en plusieurs brefs chapitres, à la manière d'une "novella", celle-ci présente une autre facette de l'auteur, à mi-chemin entre tradition mystique japonaise et culture magique chinoise. On y découvre l'importance, dans ce Japon pourtant en pleine mutation, des vieilles croyances, des êtres possédants des dons plus ou moins néfastes ou bénéfiques, interférant par les biais de la magie sur l'amourette que vivent deux jeunes gens, la jeune fille n'étant autre que la nièce de cette méchante sorcière ! Un texte placé par l'auteur sous les auspices de Poe, même si, avouons-le, nous en sommes très loin, tant y est prégnante la culture extrême-orientale. Seule la conclusion aux faux airs de relativisme scientifique peut nous faire penser à l'auteur de La chute de la maison Usher ou de Le corbeau.
L'ultime texte, «Automne», est d'une sensibilité extrême qui, bien que d'un réalisme saisissant, pourrait se placer dans la lignée de certains symbolistes français ou, par certains aspects, d'un Francis Jammes tant est nostalgique, d'une douceur spleenétique et empli de références ce texte. On notera, entre autres éléments, la citation d'un aphorisme de Remy de Gourmont, écrivain français aujourd'hui trop oublié mais qui fut un phare auprès d'un grand nombre d'écrivain de son temps. La finesse psychologique de cette nouvelle le partage avec la rudesse de ce destin de femme qui, par obligation envers sa cadette, abandonne l'idée d'épouser l'homme avec lequel elle pourrait être heureuse - mais qu'elle apprécie plus comme un compagnon et un pair que comme un amant -, sa jeune sœur en étant éperdument amoureuse. L'ensemble se joue dans un cercle d'intellectuels de ce début XXème, dans lequel la femme n'a guère d'autre liberté que le choix de son époux (lequel s'avérera désastreux en terme de destinée pour cette femme brillante promise jusque-là à un bel avenir d'écrivain).
«Une vague inquiétude» laissera cet auteur fin, mélancolique, ombrageux comme ultime message à l'heure de la mort qu'il se sera choisi. C'est aussi le sentiment calmement pénétrant qui saisit le lecteur tout au long de ces cinq textes à l'amertume sans violence ni désespoir acerbe, se jouant souvent de notre regard par le biais d'une doucereuse ironie, l'ensemble étant servit par un style sobre et précis - qui en devient poétique alors même que l'écrivain semble fuir tout effet de manche facile, toute "japonaiserie" tellement attendue, et sans jamais donner dans l'imitation abusive des auteurs occidentaux qu'il appréciait - Anatole France, Mérimée, Baudelaire et bien d'autres - faisant sombrer peu à peu le lecteur dans le tragique aussi profond qu'il parait de prime abord impavide. Avec ces nouvelles qui vous environnent longtemps, Ryûnosuke Akutagawa au destin si tragique est à la fois l'envers et l'endroit de ce monde japonais en pleine rupture de ban d'avec lui-même et dont on sait comme cette modernisation tout azimut à marche parfois forcée ne se fera pas que pour le bonheur des peuples... Par ses touches pour ainsi dire impressionnistes, Ryûnosuke Akutagawa l'avait, dans une certaine mesure, pressenti... jusqu'à la folie et à la mort.
C'est peu de dire que Ryûnosuke Akutagawa est un auteur japonais méconnu en France. Sans doute est-ce lié à ce qu'il fut essentiellement créateur de nouvelles, de poésie et de textes critiques, autant de genres littéraires plutôt modestement prisés du public hexagonal, et si l'on compte environ deux cent de ces œuvres, celles-ci seront par ailleurs écrites en à peine plus d'une dizaine d'années, Ryûnosuke Akutagawa s'étant suicidé à l'âge de trente-cinq ans. Souffrant en effet d'hallucinations, à l'instar de sa mère décédée en 1902 et morte en pleine folie à quarante-deux ans, il préféra mettre fin à ses jours, encore parfaitement lucide... Génie relativement précoce - il n'avait encore que vingt-trois ans lorsque sa première nouvelle, Le Nez, fut remarqué par l'immense Natsume Soseki qui encouragera vivement le jeune écrivain à poursuivre dans cette voie. Esprit ouvert à d'autres cultures que la sienne - il connaissait fort bien la culture chinoise de même que la littérature occidentale de son temps -, intellectuel à l'esprit fin et pénétrant, Ryûnosuke Akutagawa a marqué de son emprunte la littérature japonaise, son nom demeurant par ailleurs célèbre puisqu'en 1935, huit ans après sa disparition, l'un de ses proches donnera son nom en hommage à ce qui deviendra très vite le prix littéraire le plus célèbre du Pays du Soleil Levant, plus ou moins l'équivalent de notre Prix Goncourt.
Les cinq nouvelles proposées ici par les éditions Philippe Picquier, dont on connait le long et passionnant travail de défrichage des littératures extrêmes-orientales, ne sont qu'un avant-goût de celles écrites par Akutagawa, celles proposées ici étant extraites de différents cycles de l'auteur.
Ainsi, les trois premières sont-elles issues d'un cycle nommé «kaika (ki) mono», littéralement "histoires du temps de la modernisation" dont la première, «les poupées» est, sans nul doute la plus saisissante, la plus troublante et douce-amère des trois textes de cette série. Il y est question d'une famille souffrant directement du changement de société lié à la diffusion de la modernisation, voulue sous l'ère Meiji, et dont l'appauvrissement régulier oblige peu à peu le père de famille à vendre tous les trésors - fussent-ils symboliques - de sa lignée. Ainsi en est-il de ces poupées traditionnelles représentant l'Empereur, son épouse et sa cour, au milieu de leur décorum de bois, qu'un intermédiaire de leur connaissance a trouvé moyen de leur vendre à bon prix auprès d'un collectionneur américain (déjà !). Cette histoire, c'est à travers le regard de la cadette que nous la découvrons - c'est à elle qu'avaient été confiées les poupées - et si l'auteur nous fait comprendre la profonde tristesse que la jeune fille peut éprouver à devoir se séparer, presque sans mot dire et sans être autorisée à le pouvoir faire, de ses beaux jouets anciens, la fillette nous permet de comprendre les sentiments plus que divers des autres membres de la famille corrélativement à cette séparation d'une collection hautement symbolique d'objets quasi sacrés. Le fils aîné fait part de sa morgue et de tout son dégoût à l'égard d'objets surgit d'un passé à oublier d'urgence ; la mère n'en finit pas de regretter déjà cette séparation de biens précieux qui la reliait aux valeurs d'un régime en passe d'être définitivement aboli ; quant au père, il tâche de se maintenir dans un entre deux compliqué et instable, ni intensément passéiste ni totalement engagé dans la modernité du moment. L'ensemble est rédigé sur un mode réaliste d'une grande délicatesse contextuelle dans lequel l'auteur exprime les différents points de vue par l'entremise, dans cette première nouvelle, de cette jeune fille ou, dans le cas de «Un crime moderne» et de «un mari moderne», par le principal protagoniste de la narration. Chaque fois, cependant, l'on comprend le point de vue de Ryûnosuke Akutagawa qui, s'il n'est pas de ce passéisme intolérant et stérile, n'en éprouve pas moins une certaine nostalgie douce à l'égard de tout ce que la modernité semble devoir obstinément mettre à bas et détruire, sans commisération aucune à l'égard de ce que ce même passé pouvait avoir de beau, d'équilibré, d'éprouvé. Alors, Ryûnosuke Akutagawa se moque doucement, avec une sensibilité affirmée, beaucoup d'intelligence et d'élégance ainsi qu'une profonde culture (dont il faut rappeler ici qu'elle était en partie tournée vers les auteurs occidentaux de l'époque, nombres de nos auteurs y étant même nommément cités) des travers grands ou petits de ces modernistes effrénés mais confrontés à cette civilisation multi-millénaire tout autant qu'à leurs propres incohérences.
La nouvelle qui donne son nom à l'ensemble du recueil, «La magicienne» est d'un tout autre genre. Scindée en plusieurs brefs chapitres, à la manière d'une "novella", celle-ci présente une autre facette de l'auteur, à mi-chemin entre tradition mystique japonaise et culture magique chinoise. On y découvre l'importance, dans ce Japon pourtant en pleine mutation, des vieilles croyances, des êtres possédants des dons plus ou moins néfastes ou bénéfiques, interférant par les biais de la magie sur l'amourette que vivent deux jeunes gens, la jeune fille n'étant autre que la nièce de cette méchante sorcière ! Un texte placé par l'auteur sous les auspices de Poe, même si, avouons-le, nous en sommes très loin, tant y est prégnante la culture extrême-orientale. Seule la conclusion aux faux airs de relativisme scientifique peut nous faire penser à l'auteur de La chute de la maison Usher ou de Le corbeau.
L'ultime texte, «Automne», est d'une sensibilité extrême qui, bien que d'un réalisme saisissant, pourrait se placer dans la lignée de certains symbolistes français ou, par certains aspects, d'un Francis Jammes tant est nostalgique, d'une douceur spleenétique et empli de références ce texte. On notera, entre autres éléments, la citation d'un aphorisme de Remy de Gourmont, écrivain français aujourd'hui trop oublié mais qui fut un phare auprès d'un grand nombre d'écrivain de son temps. La finesse psychologique de cette nouvelle le partage avec la rudesse de ce destin de femme qui, par obligation envers sa cadette, abandonne l'idée d'épouser l'homme avec lequel elle pourrait être heureuse - mais qu'elle apprécie plus comme un compagnon et un pair que comme un amant -, sa jeune sœur en étant éperdument amoureuse. L'ensemble se joue dans un cercle d'intellectuels de ce début XXème, dans lequel la femme n'a guère d'autre liberté que le choix de son époux (lequel s'avérera désastreux en terme de destinée pour cette femme brillante promise jusque-là à un bel avenir d'écrivain).
«Une vague inquiétude» laissera cet auteur fin, mélancolique, ombrageux comme ultime message à l'heure de la mort qu'il se sera choisi. C'est aussi le sentiment calmement pénétrant qui saisit le lecteur tout au long de ces cinq textes à l'amertume sans violence ni désespoir acerbe, se jouant souvent de notre regard par le biais d'une doucereuse ironie, l'ensemble étant servit par un style sobre et précis - qui en devient poétique alors même que l'écrivain semble fuir tout effet de manche facile, toute "japonaiserie" tellement attendue, et sans jamais donner dans l'imitation abusive des auteurs occidentaux qu'il appréciait - Anatole France, Mérimée, Baudelaire et bien d'autres - faisant sombrer peu à peu le lecteur dans le tragique aussi profond qu'il parait de prime abord impavide. Avec ces nouvelles qui vous environnent longtemps, Ryûnosuke Akutagawa au destin si tragique est à la fois l'envers et l'endroit de ce monde japonais en pleine rupture de ban d'avec lui-même et dont on sait comme cette modernisation tout azimut à marche parfois forcée ne se fera pas que pour le bonheur des peuples... Par ses touches pour ainsi dire impressionnistes, Ryûnosuke Akutagawa l'avait, dans une certaine mesure, pressenti... jusqu'à la folie et à la mort.
Etoiles Notabénistes : ******
Hina
Traduction : Elisabeth Suetsugu
ISBN : non usité à l'époque - cette nouvelle est antérieure au 1er septembre 1923 - mais 978280970397 pour "La Magicienne", chez Picquier Poche, dont est extrait ce texte.
Charles Trénet a jadis composé une chanson tout simplement intitulée "Une Noix" et dans laquelle le poète s'interrogeait sur ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'une noix ... De strophe en strophe, il nous présentait un petit monde qu'on avait à peine le temps d'apercevoir avant de croquer la noix et alors, adieu, les découvertes ... Eh ! bien, dans le contexte actuel, après avoir lu et relu "Les Poupées" d'Akutagawa, j'ai eu du mal à me tirer de la tête cette chanson et tout ce qu'elle symbolise.
La "noix" d'Akutagawa, ce sont les poupées mises en scène dans chaque maison japonaise qui se respecte, y compris de nos jours, lors de la "Fête des Filles", fête qui tombe, je crois, le 3 mars. Dans cette nouvelle, ces poupées sont quasiment grandeur nature, fort belles et splendidement vêtues et parées car la famille Kinokuniya, à qui elles appartiennent depuis des générations, a toujours été aisée. Avec le début de l'Ere Meiji, qui voit le Japon quasi féodal faire un bond en avant aussi prodigieux que brutal vers la Modernité, la situation se dégrade un peu et, pour maintenir son clan à flots, le chef de famille se voit peu à peu dans l'obligation de vendre des objets de valeur.
Les derniers en date, ces poupées - l'Empereur, l'Impératrice, cinq musiciens, le page, la dame d'honneur, le cerisier sauvage traditionnellement à gauche du trône, le mandarinier lui faisant pendant à sa droite, sans oublier le paravent et de petits meubles et objets incrustés d'or et d'argent - doivent être remises, contre une somme conséquente, à un Américain de Yokohama, qui les juge, avec raison, magnifiques et les ramènera sans doute avec lui dans son pays quand il quittera l'Empire du Soleil Levant.
La narratrice, qui est aussi la seule fille de la famille, O-Tsuru, raconte à l'écrivain ce qu'elle vécut à l'époque où son père dut se séparer de ces merveilleuses poupées. Elle avait quinze ans et était donc assez âgée pour s'incliner devant l'inévitable : la famille n'était plus aussi riche que dans le temps, sa mère était malade, et le Japon était en marche vers une ère nouvelle qui allait assurer sa prospérité mais au prix de très nombreux sacrifices.
Chez les Kinokinuya, le fils, Eikichi, sensiblement plus âgé, paraît être le seul adepte résolu de la modernisation et tourne en dérision la douleur que sa jeune sœur ne parvient pas entièrement à dissimuler devant le départ des poupées. Tous, d'ailleurs, à l'exception d'Eikichi - et encore, en est-on bien sûr ? - ont conscience, chacun à son niveau et selon son âge et son vécu, de se séparer, avec ces véritables chefs-d'œuvre de l'Art traditionnel japonais, d'une partie de sa culture personnelle, intimement liée à la culture du pays lui-même. Que la chose soit obligée, que M. Kinokinuya père, devenu pharmacien-herboriste, agisse sous la contrainte amère du besoin d'argent et de celle de ne pas perdre la face, ne change rien à l'affaire : au contraire.
La transaction ayant été menée par Marusa, antiquaire tout dévoué à la famille, les poupées, soigneusement rangées dans leurs coffres en bois de paulownia, sont donc sur le départ. O-Tsuru se permet de demander à son père de les sortir une fois encore - une seule fois - mais il refuse. Sans brutalité mais avec fermeté.
Et le jour fatal se rapproche, influant peut-être sur la maladie de Mme Kinokinuya tandis qu'Eikichi se fait si indifférent au départ des poupées que, dans une scène qui se déroule dans un pousse-pousse, entre le conducteur, venu proposer un petit tour gratuit à O-Tsuru pour la distraire un peu, l'adolescente elle-même et son frère, on comprend, l'espace d'un instant, que le jeune homme souffre tout autant que les autres membres de sa famille de cette vente qui, plus qu'une vente, est un véritable symbole : celui de la disparition passagère d'un certain Japon afin que, tel le légendaire Phœnix, il renaisse une fois de plus.
La nuit précédant le départ des poupées, O-Tsuru a l'idée folle d'en sortir au moins une pour un adieu ultime. Mais elle y renonce et plonge sagement dans le sommeil. Elle a alors un rêve étrange. Elle se réveille - en tous cas elle en a l'impression - et aperçoit son père à son chevet, entouré de toutes les poupées, plus belles et plus nobles que jamais ... Son père a le front baissé et une expression grave sur le visage. Il ne lui adresse pas la parole. Elle non plus d'ailleurs. Peu à peu, tout devient flou ... Et c'est le matin.
O-Tsuru a-t-elle rêvé ou son père, rien que pour elle et pour lui - la fille de la maison et lui, le chef du clan, responsable de tout - a-t-il organisé une dernière fois la cérémonie des Poupées ?
Elle ne le saura jamais mais elle aura compris pour toujours tout ce que représentaient, pour sa famille - et pour tant d'autres familles, plus, aussi ou bien moins riches - ces Poupées rituelles de la Fête des Filles. Oui, cette "noix", ici symbolisée par les Poupées de la Fête des Filles, contient tout un monde, toute une tradition, toute une culture - tout un passé qu'un trait de plume, le passage des siècles et celui des Eres impériales n'auront jamais le pouvoir de faire disparaître. Parce que ces Poupées hautaines et cependant protectrices recèlent en fait une partie, en apparence infime et pourtant essentielle, de l'Histoire du Japon.
Et l'Histoire, même si ses vestiges peuvent se vendre - et très cher - ne se vend jamais, Elle.
En ces jours si sombres que nous traversons, il est bon de garder cette vérité en mémoire.
Instillant l'espoir le plus pur sous son désenchantement apparent, "Les Poupées", nouvelle en principe mineure dans l'œuvre d'Akutagawa Ryûnosuke, réchauffe et fait doucement palpiter le cœur de l'Européen qui la lit aujourd'hui. Avec un petit clin d'œil à la fois malicieux et compatissant, elle lui certifie, avec l'assurance tranquille de Celle Qui Connaît L'Avenir Parce Qu'Elle Vient Du Passé, que l'Histoire et la Culture sont des "noix" bien trop dures pour que ceux qui ont l'audace de s'imaginer les croquer sans dommages ne s'y brisent pas inexorablement leur élégante dentition ...
Bonne lecture et protégez les "Poupées" qui sont en vous, aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, si vous ne pouvez les transmettre physiquement à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous leur en transmettrez inéluctablement l'esprit et l'âme. Et cela n'a pas de prix ... ;o)
Hina
Traduction : Elisabeth Suetsugu
ISBN : non usité à l'époque - cette nouvelle est antérieure au 1er septembre 1923 - mais 978280970397 pour "La Magicienne", chez Picquier Poche, dont est extrait ce texte.
Charles Trénet a jadis composé une chanson tout simplement intitulée "Une Noix" et dans laquelle le poète s'interrogeait sur ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'une noix ... De strophe en strophe, il nous présentait un petit monde qu'on avait à peine le temps d'apercevoir avant de croquer la noix et alors, adieu, les découvertes ... Eh ! bien, dans le contexte actuel, après avoir lu et relu "Les Poupées" d'Akutagawa, j'ai eu du mal à me tirer de la tête cette chanson et tout ce qu'elle symbolise.
La "noix" d'Akutagawa, ce sont les poupées mises en scène dans chaque maison japonaise qui se respecte, y compris de nos jours, lors de la "Fête des Filles", fête qui tombe, je crois, le 3 mars. Dans cette nouvelle, ces poupées sont quasiment grandeur nature, fort belles et splendidement vêtues et parées car la famille Kinokuniya, à qui elles appartiennent depuis des générations, a toujours été aisée. Avec le début de l'Ere Meiji, qui voit le Japon quasi féodal faire un bond en avant aussi prodigieux que brutal vers la Modernité, la situation se dégrade un peu et, pour maintenir son clan à flots, le chef de famille se voit peu à peu dans l'obligation de vendre des objets de valeur.
Les derniers en date, ces poupées - l'Empereur, l'Impératrice, cinq musiciens, le page, la dame d'honneur, le cerisier sauvage traditionnellement à gauche du trône, le mandarinier lui faisant pendant à sa droite, sans oublier le paravent et de petits meubles et objets incrustés d'or et d'argent - doivent être remises, contre une somme conséquente, à un Américain de Yokohama, qui les juge, avec raison, magnifiques et les ramènera sans doute avec lui dans son pays quand il quittera l'Empire du Soleil Levant.
La narratrice, qui est aussi la seule fille de la famille, O-Tsuru, raconte à l'écrivain ce qu'elle vécut à l'époque où son père dut se séparer de ces merveilleuses poupées. Elle avait quinze ans et était donc assez âgée pour s'incliner devant l'inévitable : la famille n'était plus aussi riche que dans le temps, sa mère était malade, et le Japon était en marche vers une ère nouvelle qui allait assurer sa prospérité mais au prix de très nombreux sacrifices.
Chez les Kinokinuya, le fils, Eikichi, sensiblement plus âgé, paraît être le seul adepte résolu de la modernisation et tourne en dérision la douleur que sa jeune sœur ne parvient pas entièrement à dissimuler devant le départ des poupées. Tous, d'ailleurs, à l'exception d'Eikichi - et encore, en est-on bien sûr ? - ont conscience, chacun à son niveau et selon son âge et son vécu, de se séparer, avec ces véritables chefs-d'œuvre de l'Art traditionnel japonais, d'une partie de sa culture personnelle, intimement liée à la culture du pays lui-même. Que la chose soit obligée, que M. Kinokinuya père, devenu pharmacien-herboriste, agisse sous la contrainte amère du besoin d'argent et de celle de ne pas perdre la face, ne change rien à l'affaire : au contraire.
La transaction ayant été menée par Marusa, antiquaire tout dévoué à la famille, les poupées, soigneusement rangées dans leurs coffres en bois de paulownia, sont donc sur le départ. O-Tsuru se permet de demander à son père de les sortir une fois encore - une seule fois - mais il refuse. Sans brutalité mais avec fermeté.
Et le jour fatal se rapproche, influant peut-être sur la maladie de Mme Kinokinuya tandis qu'Eikichi se fait si indifférent au départ des poupées que, dans une scène qui se déroule dans un pousse-pousse, entre le conducteur, venu proposer un petit tour gratuit à O-Tsuru pour la distraire un peu, l'adolescente elle-même et son frère, on comprend, l'espace d'un instant, que le jeune homme souffre tout autant que les autres membres de sa famille de cette vente qui, plus qu'une vente, est un véritable symbole : celui de la disparition passagère d'un certain Japon afin que, tel le légendaire Phœnix, il renaisse une fois de plus.
La nuit précédant le départ des poupées, O-Tsuru a l'idée folle d'en sortir au moins une pour un adieu ultime. Mais elle y renonce et plonge sagement dans le sommeil. Elle a alors un rêve étrange. Elle se réveille - en tous cas elle en a l'impression - et aperçoit son père à son chevet, entouré de toutes les poupées, plus belles et plus nobles que jamais ... Son père a le front baissé et une expression grave sur le visage. Il ne lui adresse pas la parole. Elle non plus d'ailleurs. Peu à peu, tout devient flou ... Et c'est le matin.
O-Tsuru a-t-elle rêvé ou son père, rien que pour elle et pour lui - la fille de la maison et lui, le chef du clan, responsable de tout - a-t-il organisé une dernière fois la cérémonie des Poupées ?
Elle ne le saura jamais mais elle aura compris pour toujours tout ce que représentaient, pour sa famille - et pour tant d'autres familles, plus, aussi ou bien moins riches - ces Poupées rituelles de la Fête des Filles. Oui, cette "noix", ici symbolisée par les Poupées de la Fête des Filles, contient tout un monde, toute une tradition, toute une culture - tout un passé qu'un trait de plume, le passage des siècles et celui des Eres impériales n'auront jamais le pouvoir de faire disparaître. Parce que ces Poupées hautaines et cependant protectrices recèlent en fait une partie, en apparence infime et pourtant essentielle, de l'Histoire du Japon.
Et l'Histoire, même si ses vestiges peuvent se vendre - et très cher - ne se vend jamais, Elle.
En ces jours si sombres que nous traversons, il est bon de garder cette vérité en mémoire.
Instillant l'espoir le plus pur sous son désenchantement apparent, "Les Poupées", nouvelle en principe mineure dans l'œuvre d'Akutagawa Ryûnosuke, réchauffe et fait doucement palpiter le cœur de l'Européen qui la lit aujourd'hui. Avec un petit clin d'œil à la fois malicieux et compatissant, elle lui certifie, avec l'assurance tranquille de Celle Qui Connaît L'Avenir Parce Qu'Elle Vient Du Passé, que l'Histoire et la Culture sont des "noix" bien trop dures pour que ceux qui ont l'audace de s'imaginer les croquer sans dommages ne s'y brisent pas inexorablement leur élégante dentition ...
Bonne lecture et protégez les "Poupées" qui sont en vous, aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, si vous ne pouvez les transmettre physiquement à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous leur en transmettrez inéluctablement l'esprit et l'âme. Et cela n'a pas de prix ... ;o)
Etoiles Notabénistes : ******
Yôba
Traduction : Elisabeth Suesutgu pour le recueil de nouvelles "La Magicienne" paru chez Picquier Poche
ISBN : certainement inconnu à l'époque de la sortie de la nouvelle mais 9782809703979 pour l'édition Picquier Poche
Cette "Magicienne", qui donne pourtant son nom au recueil de nouvelles d'Akutagawa sorti chez Picquier Poche, n'est peut-être pas la meilleure du volume bien qu'elle en soit la plus longue. Néanmoins elle fascine par l'art magistral avec lequel l'auteur fait jaillir autour de nous une atmosphère lourde, glauque et maléfique qui, quelles que soient nos croyances (ou notre incroyance) personnelles, ne peut que nous glacer le cœur.
Bien que le fantastique ait ici la partie belle, l'intrigue se veut en principe sentimentale : une jeune fille, Toshi, servante dans une famille dont le fils, Shinzô, est amoureux d'elle, possède des qualités de medium qui intéressent fortement l'une de ses lointaines parentes, la dénommée Shima, elle-même connue par le bouche-à-oreille comme une puissante sorcière ayant puisé sa science dans les rituels shamaniques ; Shima est vouée au culte d'une divinité ambiguë dont on peut croire que, à l'issue de la nouvelle et malgré la mauvaise réputation qui est la sienne, elle se range aux côtés des deux jeunes gens et les aide à échapper à l'affreuse Shima ; mais celle-ci ne peut accéder aux précieuses prédictions du dieu sans la présence d'une medium à ses côtés. Or, Toshi est réellement une excellente medium ...
Toutefois, ce que l'on retient de cette "Magicienne", bien plus que l'histoire, un peu complexe ou alors traitée de façon trop romanesque pour une nouvelle, c'est, répétons-le, l'ambiance. A son sujet, on peut parler de magie, cette magie asiatique si particulière que Lafcadio Hearn a si bien restituée lui-même dans des contes comme "Le Visage." En littérature comme au cinéma, le fantastique asiatique obéit à des codes non pas opposés mais naturellement plus subtils que les codes occidentaux. (Notez que, à l'heure où je tape ceci, il y a peut-être sur le Web un Japonais ou un Chinois qui écrit exactement la même chose mais dans le sens inverse ... )
Il y a d'abord ces petits faits que nous conte l'auteur - car c'est bien l'auteur qui, ici, prend la parole - quand il nous parle de la manière étrange, inquiétante et pourtant impitoyablement logique dont, en certains lieux de la ville, en général non loin d'un carrefour et dans des quartiers très précis, s'élèvent brusquement de petits tourbillons de bouts de papier abandonnés sur le sol et qui semblent vouloir s'élever vers le ciel mais dans un ordre quasi hiérarchique. Et toujours, ces tourbillons sont en quelque sorte "menés" par un papier de couleur rouge. Le vent n'apparaît, semble-t-il, qu'après que ce bout de papier ait décidé, de lui-même, de rallier à sa cause un certain nombre de ses congénères. Dans quel but ? Cela, on l'ignore ...
Vient ensuite l'histoire, qui se déroule toujours de nuit ou au crépuscule, de l'avant-dernier ou du dernier tram ou autobus qui fait halte devant un arrêt où - l'auteur l'a constaté bien souvent, alors qu'il était paisiblement installé à l'intérieur du véhicule - n'attendait aucun passager éventuel. Ce trottoir vide n'empêche cependant pas le conducteur d'ouvrir sa portière pour la refermer presque tout de suite. Et il arrive que ce conducteur soit lui-même frappé par l'inanité de son attitude. Mieux, il arrive au moins une fois - Akutagawa en a été témoin - où, se parlant à lui-même, le malheureux a affirmé avoir vu, oui, bel et bien vu, une file de passagers désireux de grimper dans son bus. D'ailleurs, Akutagawa semble l'avouer, lui aussi a entrevu, de temps à autre et sans qu'il sache pour quelles raisons, toujours au même arrêt, cette file de passagers qui se faisaient remarquer par leur lenteur ou l'inexpressivité (ou encore la fatigue) peinte sur leurs visages.
Et puis, comment ne pas parler de la rivière, la Tategawa, qui vient lécher les quais du port et avec laquelle la vieille Shima semble entretenir un rapport vraiment étrange puisque, même par temps de neige et de gel, elle sort chaque matin, à l'aurore, pour s'immerger dans ses flots glacés ? C'est en effet dans le quartier du port que Shima tient sa boutique d'herboriste et de jeteuse de sorts en tout genre. Nul ne sait à quoi elle a pu ressembler au temps perdu de sa jeunesse mais, dans son âge mûr, c'est indiscutable, elle a - sa voix elle-même a - beaucoup du crapaud, mais un crapaud vraiment hideux, avec quelque chose de lovecraftien dans l'allure et plus encore dans les intentions.
Il est pourtant, sur les quais, comme une correspondance aux endroits mystérieux où s'élèvent parfois les mystérieux petits tourbillons de bouts de papier abandonnés à leur sort sous la pluie d'hiver, un espace, délimité par deux gros chiens en granit, que, en dépit de tous ses pouvoirs, Shima ne parvient pas à "voir." Très précisément, elle ne peut voir ce qui s'y passe. Un refuge idéal pour nos deux amoureux même si Toshi ignore absolument tout des raisons de la cécité provisoire et si localisée de sa redoutable "tante." Et s'il existe un endroit comme celui-là sur les quais, le lecteur est en droit de se demander s'il n'y en a pas d'autres, disséminés dans la ville selon des règles dictées par le monde surnaturel.
Quant à la maison où exerce Shima, en particulier la pièce où elle se tient pour recevoir ses visiteurs, c'est tout un poème. La suie y prédomine : au plafond, sur les poutres ... L'ensemble est miteux mais l'autel réservé au dieu adoré par la sorcière est évidemment soigneusement entretenu. Le lecteur occidental, et qui connaît ses classiques fantastiques par cœur, risque, en lisant la description qu'en donne l'auteur de songer à des lieux comme Ipswich par exemple ou encore Arkham ... Tout cela est nimbé de lueurs d'un verdâtre cafardeux - à tout prendre, la suie, dans sa noirceur grasse, semble au moins plus franche - et l'on voit avec horreur Shima s'y déplacer vers Shinzô, venue la défier, avec des reptations d'anguille ou de serpent de mer ...
Oui, si on lit "La Magicienne", c'est avant tout pour l'ambiance qu'elle dégage, une ambiance à la fois si dense et si étouffante, avec tout plein de petits détails tant à droite qu'à gauche, ayant ou non un rapport direct avec Shima et ses pratiques (comme les affreux papillons noirs qui suivent littéralement Shinzô à la trace à un certain moment), que peu à peu s'insinue dans la sensibilité du lecteur la certitude absolue que, volontairement ou par le seul fait du hasard, Akutagawa Ryûnosuke a été souvent confronté à ce monde distordu, glacé, malveillant ou bienveillant selon les époques et, partant, totalement incompréhensible.
Le privilège du poète, de l'artiste - ou bien celui que vous accordent certaines drogues qui apaisent vos souffrances ? N'oublions pas non plus que, au naturel, l'écrivain souffrit très jeune d'hallucinations et qu'il devait mettre fin à ses jours par une surdose de Véronal.
Akutagawa Ryûnosuke, un prodigieux styliste mais qui paya chèrement le Don qu'il avait reçu. Lorsque nous nous immergeons dans son œuvre, ayons donc une pensée pour les souffrances qu'il dut endurer et brûlons un bâton d'encens dont les volutes parfumées, s'élevant dans les airs comme les petits papiers dans leur tourbillon magique, feront savoir à ses mânes enfin libérées qu'il n'a pas écrit en vain. ,o)
Yôba
Traduction : Elisabeth Suesutgu pour le recueil de nouvelles "La Magicienne" paru chez Picquier Poche
ISBN : certainement inconnu à l'époque de la sortie de la nouvelle mais 9782809703979 pour l'édition Picquier Poche
Cette "Magicienne", qui donne pourtant son nom au recueil de nouvelles d'Akutagawa sorti chez Picquier Poche, n'est peut-être pas la meilleure du volume bien qu'elle en soit la plus longue. Néanmoins elle fascine par l'art magistral avec lequel l'auteur fait jaillir autour de nous une atmosphère lourde, glauque et maléfique qui, quelles que soient nos croyances (ou notre incroyance) personnelles, ne peut que nous glacer le cœur.
Bien que le fantastique ait ici la partie belle, l'intrigue se veut en principe sentimentale : une jeune fille, Toshi, servante dans une famille dont le fils, Shinzô, est amoureux d'elle, possède des qualités de medium qui intéressent fortement l'une de ses lointaines parentes, la dénommée Shima, elle-même connue par le bouche-à-oreille comme une puissante sorcière ayant puisé sa science dans les rituels shamaniques ; Shima est vouée au culte d'une divinité ambiguë dont on peut croire que, à l'issue de la nouvelle et malgré la mauvaise réputation qui est la sienne, elle se range aux côtés des deux jeunes gens et les aide à échapper à l'affreuse Shima ; mais celle-ci ne peut accéder aux précieuses prédictions du dieu sans la présence d'une medium à ses côtés. Or, Toshi est réellement une excellente medium ...
Toutefois, ce que l'on retient de cette "Magicienne", bien plus que l'histoire, un peu complexe ou alors traitée de façon trop romanesque pour une nouvelle, c'est, répétons-le, l'ambiance. A son sujet, on peut parler de magie, cette magie asiatique si particulière que Lafcadio Hearn a si bien restituée lui-même dans des contes comme "Le Visage." En littérature comme au cinéma, le fantastique asiatique obéit à des codes non pas opposés mais naturellement plus subtils que les codes occidentaux. (Notez que, à l'heure où je tape ceci, il y a peut-être sur le Web un Japonais ou un Chinois qui écrit exactement la même chose mais dans le sens inverse ... )
Il y a d'abord ces petits faits que nous conte l'auteur - car c'est bien l'auteur qui, ici, prend la parole - quand il nous parle de la manière étrange, inquiétante et pourtant impitoyablement logique dont, en certains lieux de la ville, en général non loin d'un carrefour et dans des quartiers très précis, s'élèvent brusquement de petits tourbillons de bouts de papier abandonnés sur le sol et qui semblent vouloir s'élever vers le ciel mais dans un ordre quasi hiérarchique. Et toujours, ces tourbillons sont en quelque sorte "menés" par un papier de couleur rouge. Le vent n'apparaît, semble-t-il, qu'après que ce bout de papier ait décidé, de lui-même, de rallier à sa cause un certain nombre de ses congénères. Dans quel but ? Cela, on l'ignore ...
Vient ensuite l'histoire, qui se déroule toujours de nuit ou au crépuscule, de l'avant-dernier ou du dernier tram ou autobus qui fait halte devant un arrêt où - l'auteur l'a constaté bien souvent, alors qu'il était paisiblement installé à l'intérieur du véhicule - n'attendait aucun passager éventuel. Ce trottoir vide n'empêche cependant pas le conducteur d'ouvrir sa portière pour la refermer presque tout de suite. Et il arrive que ce conducteur soit lui-même frappé par l'inanité de son attitude. Mieux, il arrive au moins une fois - Akutagawa en a été témoin - où, se parlant à lui-même, le malheureux a affirmé avoir vu, oui, bel et bien vu, une file de passagers désireux de grimper dans son bus. D'ailleurs, Akutagawa semble l'avouer, lui aussi a entrevu, de temps à autre et sans qu'il sache pour quelles raisons, toujours au même arrêt, cette file de passagers qui se faisaient remarquer par leur lenteur ou l'inexpressivité (ou encore la fatigue) peinte sur leurs visages.
Et puis, comment ne pas parler de la rivière, la Tategawa, qui vient lécher les quais du port et avec laquelle la vieille Shima semble entretenir un rapport vraiment étrange puisque, même par temps de neige et de gel, elle sort chaque matin, à l'aurore, pour s'immerger dans ses flots glacés ? C'est en effet dans le quartier du port que Shima tient sa boutique d'herboriste et de jeteuse de sorts en tout genre. Nul ne sait à quoi elle a pu ressembler au temps perdu de sa jeunesse mais, dans son âge mûr, c'est indiscutable, elle a - sa voix elle-même a - beaucoup du crapaud, mais un crapaud vraiment hideux, avec quelque chose de lovecraftien dans l'allure et plus encore dans les intentions.
Il est pourtant, sur les quais, comme une correspondance aux endroits mystérieux où s'élèvent parfois les mystérieux petits tourbillons de bouts de papier abandonnés à leur sort sous la pluie d'hiver, un espace, délimité par deux gros chiens en granit, que, en dépit de tous ses pouvoirs, Shima ne parvient pas à "voir." Très précisément, elle ne peut voir ce qui s'y passe. Un refuge idéal pour nos deux amoureux même si Toshi ignore absolument tout des raisons de la cécité provisoire et si localisée de sa redoutable "tante." Et s'il existe un endroit comme celui-là sur les quais, le lecteur est en droit de se demander s'il n'y en a pas d'autres, disséminés dans la ville selon des règles dictées par le monde surnaturel.
Quant à la maison où exerce Shima, en particulier la pièce où elle se tient pour recevoir ses visiteurs, c'est tout un poème. La suie y prédomine : au plafond, sur les poutres ... L'ensemble est miteux mais l'autel réservé au dieu adoré par la sorcière est évidemment soigneusement entretenu. Le lecteur occidental, et qui connaît ses classiques fantastiques par cœur, risque, en lisant la description qu'en donne l'auteur de songer à des lieux comme Ipswich par exemple ou encore Arkham ... Tout cela est nimbé de lueurs d'un verdâtre cafardeux - à tout prendre, la suie, dans sa noirceur grasse, semble au moins plus franche - et l'on voit avec horreur Shima s'y déplacer vers Shinzô, venue la défier, avec des reptations d'anguille ou de serpent de mer ...
Oui, si on lit "La Magicienne", c'est avant tout pour l'ambiance qu'elle dégage, une ambiance à la fois si dense et si étouffante, avec tout plein de petits détails tant à droite qu'à gauche, ayant ou non un rapport direct avec Shima et ses pratiques (comme les affreux papillons noirs qui suivent littéralement Shinzô à la trace à un certain moment), que peu à peu s'insinue dans la sensibilité du lecteur la certitude absolue que, volontairement ou par le seul fait du hasard, Akutagawa Ryûnosuke a été souvent confronté à ce monde distordu, glacé, malveillant ou bienveillant selon les époques et, partant, totalement incompréhensible.
Le privilège du poète, de l'artiste - ou bien celui que vous accordent certaines drogues qui apaisent vos souffrances ? N'oublions pas non plus que, au naturel, l'écrivain souffrit très jeune d'hallucinations et qu'il devait mettre fin à ses jours par une surdose de Véronal.
Akutagawa Ryûnosuke, un prodigieux styliste mais qui paya chèrement le Don qu'il avait reçu. Lorsque nous nous immergeons dans son œuvre, ayons donc une pensée pour les souffrances qu'il dut endurer et brûlons un bâton d'encens dont les volutes parfumées, s'élevant dans les airs comme les petits papiers dans leur tourbillon magique, feront savoir à ses mânes enfin libérées qu'il n'a pas écrit en vain. ,o)
Etoiles Notabénistes : ******
Aki
Traduction : Elisabeth Suetsugu pour Picquier Poche
ISBN : Inconnu pour la nouvelle sortie en 1920 mais 9782809703979 pour "La Magicienne & Autres Nouvelles" paru chez Picquier Poche et dont ce texte est tiré
Dernière nouvelle du recueil "La Magicienne", paru chez Picquier Poche en 2003 (ou 2013), "Automne" est à la fois l'une des plus élégantes et des plus délicates que nous devons à ce grand, très grand écrivain perclus de maladie et qui préféra mettre fin à ses jours plutôt que de continuer sur cette terre une vie que troublaient des hallucinations de plus en plus envahissantes, j'ai nommé Akutagawa Ryûnosuke, dont les aficionados aimeraient que Gallimard, par exemple, lui consacrât la Plaïade qu'il mérite. Et si Gallimard n'y tient pas, qu'un éditeur ose : il n'y gagnera que profit et considération !
Rappelons que l'équivalent du Prix Goncourt, au Japon, n'est autre que le Prix Akutagawa et si l'on peut penser que, de nos jours, pour l'un comme pour l'autre, il est accordé à beaucoup d'inconnus qui le resteront, les deux distinctions arrivent néanmoins à révéler çà et là d'authentiques écrivains.
Akutagawa Ryûnosuke, c'est aussi, pour presque tout le monde, y compris les néophytes, l'auteur de "Rashômon", porté à l'écran par Kurosawa en 1950. Mais combien de nouvelles Akutagawa n'a-t-il pas écrites qui égalent celle-ci, pourtant si célèbre à juste titre ?
En France, Philippe Picquier Editions a choisi de nous ouvrir de très nombreuses portes de la littérature d'Extrême-Orient, des textes anciens aux textes plus modernes. Grâces leur en soient rendues d'ailleurs, au passage ! Et c'est grâce à cette maison d'édition que j'ai eu le très grand plaisir de découvrir cette très délicate friandise que constitue "Automne." Vous le savez, j'aime les non-dits et les filigranes qu'il faut regarder au plus près - une certaine façon de surcompenser, sur le plan de la lecture, ma myopie de jadis, qui sait ? Or, "Automne" - nouvelle dépourvue de tout fantastique, je tiens à le préciser - déborde de non-dits, de "blancs" qui n'en sont pas et, en quelque sorte, si vous me permettez ce jeu de mots qui rappelle la fiche établie hier sur "La Porte Condamnée" de Julio Cortázar, de "portes dérobées" derrière lesquelles s'égarent nos questions ...
Comme thème central, deux sœurs de bonne famille, dans le Tôkyô du début du XXème siècle : Nobuko et Teruko. Même si Nobuko a entrepris une scolarité brillante et atteint l'Université où elle a choisi la voie des Lettres ; même si elle a bien avancé (mais en secret car elle manque de confiance en elle) dans l'écriture d'un roman qui compte déjà trois-cents pages et qu'elle espère bien pouvoir éditer un jour, elle n'en reste pas moins la fille aînée. Et la Tradition veille toujours : la fille aînée (ou d'ailleurs le fils aîné, les garçons n'étant pas épargnés sur ce point) se marient toujours les premiers dans toute famille japonaise qui se respecte. C'est ainsi et ce n'est pas autrement.
Cela fait des lustres qu'un sentiment profond, qui s'est assurément développé, au fil des mutations biologiques et sentimentales, en quelque chose qu'on nomme "amour", unit Nobuko à son cousin Shunkichi. Ils vont d'ailleurs tous deux à la même université, étudient les mêmes matières et sont éperdument épris des livres et de la Littérature. Le jeune homme est peut-être plus incisif, plus réaliste, plus railleur dans ses phrases et c'est un grand amateur d'aphorismes. Quant à Nobuko, forcément, elle est plus romantique. Mais enfin, c'est aussi évident que la pleine lune se levant dans la nuit de sa naissance, ces deux jeunes gens sont faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, toutes les compagnes d'université de Nobuko, les unes avec jalousie, les autres avec enthousiasme, estiment que le mariage les attend à la fin de leurs études. Aussi sûr que deux et deux font quatre. Même pour des littéraires.
Et pourtant, voyez comment sont les choses, à la stupeur quasi générale de son entourage proche et éloigné, Nobuko accepte d'épouser un autre homme, élève d'une école de commerce et qui a déjà trouvé un poste à Ôsaka - donc la région opposée à celle de Tôkyô. Plus étonnant encore, elle l'accepte avec gaieté, facilité et son bon-vouloir habituel. Elle a l'air vraiment heureuse d'agir ainsi et c'est un peu comme si Shunkichi, qui doit cependant assister à la cérémonie, n'avait jamais été susceptible de lui demander sa main. Bref, deux et deux ne font plus quatre.
La vérité, c'est que Teruko, la jeune sœur de Nobuko, est de son côté éperdument amoureuse de leur cousin, elle aussi. Et que Nobuko, qui s'en est rendue compte, est une "grande sœur" digne de ce nom. En d'autres termes, elle se sacrifie pour le bonheur de Teruko, à qui elle est fortement attachée. Voilà tout l'explication de son mariage "arrangé" avec un homme qu'elle s'efforce d'aimer, qui n'est certes pas méchant tout au fond de lui mais qui, malgré tout, lui en veut de la culture qu'elle possède et qui n'est pas la sienne, de sa facilité à écrire et à savourer la littérature, de la façon, selon lui négligente, dont elle assure la gestion de leur foyer, de ...
Rien n'est pire, croyez-moi, que d'épouser un être qui, sur le plan intellectuel, vous est inférieur et le restera car, tant par paresse que par orgueil (sans compter le manque de moyens de son intelligence), il ne pourra jamais vous rejoindre. Passés les premiers temps de vos amours - car il peut vous aimer sincèrement, au début - il se lassera de votre esprit dont, pourtant, il fut un temps si fier, vous le jalousera et finira par s'ennuyer auprès de vous et par vous abandonner pour une autre, voire plusieurs ...
La coutume des banquets d'affaires autorisant la présence des geishas et des danseuses, l'éloignement se justifie vite pour le mari de Nobuko. Quand il rentre, même s'il a bu bien trop de saké, il trouve toujours le moyen de lui glisser un mot méchant sur ses prétentions littéraires ou son manque d'économie ... Mais le divorce est impossible. Que penseraient les gens et quel prétexte invoquer dans ce Japon qui vient tout juste de quitter le Moyen-Âge pour plonger dans la Modernité ? Alors, Nobuko s'incline et se tait. Lorsqu'elle apprend que son cousin a enfin demandé Teruko en mariage, une gaieté triste la saisit et elle invoque divers prétexte pour ne pas se rendre à la cérémonie.
Et puis, trois ans à peu près après tout cela, s'offre à elle l'occasion de retrouver sa sœur et son mari à Tôkyô où son propre époux a des affaires à régler. Elle s'y rend, toute heureuse, pour passer en principe une seule après-midi auprès de Teruko. Mais, lorsqu'elle arrive, sa sœur n'est pas encore rentrée. Seul Shunkichi se trouve au logis. Il est sincèrement ravi de revoir Nobuko et la conversation s'engage vite. Au retour de Teruko, elle ne s'éteint pas pour autant. Après tout, Teruko partage avec eux bien des points sur le plan culture et intelligence. La seule chose qui l'étonne, c'est de constater que la servante, malgré ses ordres, s'est absentée, ce qui fait que son mari et sa sœur ont donc passé l'après-midi en tête à tête. Mais peu importe. On parle, on parle, on discute, on se souvient, on mange, on boit ... et le soir tombe. C'est entendu : Nobuko passera la nuit chez sa sœur et son beau-frère.
Et c'est là que se place la scène peut-être la plus admirable - avec celle de la fin - de cette nouvelle toute en douceur, en tendresse, en raffinement, qui, aux yeux de ceux à qui la Vie n'a guère fait de cadeaux, portera toujours en elle la nostalgie des rares jours heureux qu'elle leur a tout de même consentis. Après le repas, alors que chacun a déjà revêtu ses vêtements de nuit, Shunkichi propose à sa femme et à se belle-sœur de le suivre dans le jardin, pour y contempler le clair de lune. Mais seule Nobuko répond à son appel. Pourquoi Teruko n'en fait-elle rien ? Le lecteur la sait plus indolente que son aînée et, d'autre part, elle a fait les magasins ou, en tout cas, s'est promenée toute la journée en ville. Peut-être l'idée de déambuler par son propre jardin pour y admirer la lune ne lui dit-elle rien parce qu'elle se sent trop fatiguée.
Shunkichi et Nobuko contemplent donc tous deux la lune, l'un près de l'autre, près d'un grand pin du Japon, au tronc tout maigre. Nous sommes au treizième jour de septembre du mois lunaire et c'est la Fête de la Lune. Après l'avoir longuement regardée - comme peut-être il leur arrivait jadis de le faire, à l'Université - Shunkichi propose à Nobuko d'aller voir le poulailler, à l'autre bout du jardin, un jardin rempli d'herbes folles, soit-dit en passant. Là encore, Nobuko obéit. Tous deux marchent l'un près de l'autre, avec fierté, avec dignité, presque épaule contre épaule. Ils arrivent au poulailler que la lune seule éclaire et où la poule repose. Et Shunkichi chuchote alors à l'oreille de Nobuko : "Elle dort ..."
A partir de là et de la fin de la nouvelle, qui n'est pas loin, toutes les conclusions sont possibles mais on ne peut en prouver aucune. Au lecteur de choisir, au lecteur de rêver. Nobuko, elle, le lendemain, jour de son départ et après une curieuse phrase là encore prononcée - mais non achevée - par Teruko, accomplira un choix ultime, sous les larmes de la douce pluie d'automne pleurant sur son pousse-pousse.
Et le lecteur referme la nouvelle avec douceur et précaution, en prenant bien soin de ne pas froisser la dernière page et en regrettant, au plus profond de son cœur, de ne pas avoir à sa disposition quelque belle rose d'automne dont il y ferait sécher les délicats pétales en hommage à Akutagawa Ryûnosuke ...
Aki
Traduction : Elisabeth Suetsugu pour Picquier Poche
ISBN : Inconnu pour la nouvelle sortie en 1920 mais 9782809703979 pour "La Magicienne & Autres Nouvelles" paru chez Picquier Poche et dont ce texte est tiré
Dernière nouvelle du recueil "La Magicienne", paru chez Picquier Poche en 2003 (ou 2013), "Automne" est à la fois l'une des plus élégantes et des plus délicates que nous devons à ce grand, très grand écrivain perclus de maladie et qui préféra mettre fin à ses jours plutôt que de continuer sur cette terre une vie que troublaient des hallucinations de plus en plus envahissantes, j'ai nommé Akutagawa Ryûnosuke, dont les aficionados aimeraient que Gallimard, par exemple, lui consacrât la Plaïade qu'il mérite. Et si Gallimard n'y tient pas, qu'un éditeur ose : il n'y gagnera que profit et considération !
Rappelons que l'équivalent du Prix Goncourt, au Japon, n'est autre que le Prix Akutagawa et si l'on peut penser que, de nos jours, pour l'un comme pour l'autre, il est accordé à beaucoup d'inconnus qui le resteront, les deux distinctions arrivent néanmoins à révéler çà et là d'authentiques écrivains.
Akutagawa Ryûnosuke, c'est aussi, pour presque tout le monde, y compris les néophytes, l'auteur de "Rashômon", porté à l'écran par Kurosawa en 1950. Mais combien de nouvelles Akutagawa n'a-t-il pas écrites qui égalent celle-ci, pourtant si célèbre à juste titre ?
En France, Philippe Picquier Editions a choisi de nous ouvrir de très nombreuses portes de la littérature d'Extrême-Orient, des textes anciens aux textes plus modernes. Grâces leur en soient rendues d'ailleurs, au passage ! Et c'est grâce à cette maison d'édition que j'ai eu le très grand plaisir de découvrir cette très délicate friandise que constitue "Automne." Vous le savez, j'aime les non-dits et les filigranes qu'il faut regarder au plus près - une certaine façon de surcompenser, sur le plan de la lecture, ma myopie de jadis, qui sait ? Or, "Automne" - nouvelle dépourvue de tout fantastique, je tiens à le préciser - déborde de non-dits, de "blancs" qui n'en sont pas et, en quelque sorte, si vous me permettez ce jeu de mots qui rappelle la fiche établie hier sur "La Porte Condamnée" de Julio Cortázar, de "portes dérobées" derrière lesquelles s'égarent nos questions ...
Comme thème central, deux sœurs de bonne famille, dans le Tôkyô du début du XXème siècle : Nobuko et Teruko. Même si Nobuko a entrepris une scolarité brillante et atteint l'Université où elle a choisi la voie des Lettres ; même si elle a bien avancé (mais en secret car elle manque de confiance en elle) dans l'écriture d'un roman qui compte déjà trois-cents pages et qu'elle espère bien pouvoir éditer un jour, elle n'en reste pas moins la fille aînée. Et la Tradition veille toujours : la fille aînée (ou d'ailleurs le fils aîné, les garçons n'étant pas épargnés sur ce point) se marient toujours les premiers dans toute famille japonaise qui se respecte. C'est ainsi et ce n'est pas autrement.
Cela fait des lustres qu'un sentiment profond, qui s'est assurément développé, au fil des mutations biologiques et sentimentales, en quelque chose qu'on nomme "amour", unit Nobuko à son cousin Shunkichi. Ils vont d'ailleurs tous deux à la même université, étudient les mêmes matières et sont éperdument épris des livres et de la Littérature. Le jeune homme est peut-être plus incisif, plus réaliste, plus railleur dans ses phrases et c'est un grand amateur d'aphorismes. Quant à Nobuko, forcément, elle est plus romantique. Mais enfin, c'est aussi évident que la pleine lune se levant dans la nuit de sa naissance, ces deux jeunes gens sont faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, toutes les compagnes d'université de Nobuko, les unes avec jalousie, les autres avec enthousiasme, estiment que le mariage les attend à la fin de leurs études. Aussi sûr que deux et deux font quatre. Même pour des littéraires.
Et pourtant, voyez comment sont les choses, à la stupeur quasi générale de son entourage proche et éloigné, Nobuko accepte d'épouser un autre homme, élève d'une école de commerce et qui a déjà trouvé un poste à Ôsaka - donc la région opposée à celle de Tôkyô. Plus étonnant encore, elle l'accepte avec gaieté, facilité et son bon-vouloir habituel. Elle a l'air vraiment heureuse d'agir ainsi et c'est un peu comme si Shunkichi, qui doit cependant assister à la cérémonie, n'avait jamais été susceptible de lui demander sa main. Bref, deux et deux ne font plus quatre.
La vérité, c'est que Teruko, la jeune sœur de Nobuko, est de son côté éperdument amoureuse de leur cousin, elle aussi. Et que Nobuko, qui s'en est rendue compte, est une "grande sœur" digne de ce nom. En d'autres termes, elle se sacrifie pour le bonheur de Teruko, à qui elle est fortement attachée. Voilà tout l'explication de son mariage "arrangé" avec un homme qu'elle s'efforce d'aimer, qui n'est certes pas méchant tout au fond de lui mais qui, malgré tout, lui en veut de la culture qu'elle possède et qui n'est pas la sienne, de sa facilité à écrire et à savourer la littérature, de la façon, selon lui négligente, dont elle assure la gestion de leur foyer, de ...
Rien n'est pire, croyez-moi, que d'épouser un être qui, sur le plan intellectuel, vous est inférieur et le restera car, tant par paresse que par orgueil (sans compter le manque de moyens de son intelligence), il ne pourra jamais vous rejoindre. Passés les premiers temps de vos amours - car il peut vous aimer sincèrement, au début - il se lassera de votre esprit dont, pourtant, il fut un temps si fier, vous le jalousera et finira par s'ennuyer auprès de vous et par vous abandonner pour une autre, voire plusieurs ...
La coutume des banquets d'affaires autorisant la présence des geishas et des danseuses, l'éloignement se justifie vite pour le mari de Nobuko. Quand il rentre, même s'il a bu bien trop de saké, il trouve toujours le moyen de lui glisser un mot méchant sur ses prétentions littéraires ou son manque d'économie ... Mais le divorce est impossible. Que penseraient les gens et quel prétexte invoquer dans ce Japon qui vient tout juste de quitter le Moyen-Âge pour plonger dans la Modernité ? Alors, Nobuko s'incline et se tait. Lorsqu'elle apprend que son cousin a enfin demandé Teruko en mariage, une gaieté triste la saisit et elle invoque divers prétexte pour ne pas se rendre à la cérémonie.
Et puis, trois ans à peu près après tout cela, s'offre à elle l'occasion de retrouver sa sœur et son mari à Tôkyô où son propre époux a des affaires à régler. Elle s'y rend, toute heureuse, pour passer en principe une seule après-midi auprès de Teruko. Mais, lorsqu'elle arrive, sa sœur n'est pas encore rentrée. Seul Shunkichi se trouve au logis. Il est sincèrement ravi de revoir Nobuko et la conversation s'engage vite. Au retour de Teruko, elle ne s'éteint pas pour autant. Après tout, Teruko partage avec eux bien des points sur le plan culture et intelligence. La seule chose qui l'étonne, c'est de constater que la servante, malgré ses ordres, s'est absentée, ce qui fait que son mari et sa sœur ont donc passé l'après-midi en tête à tête. Mais peu importe. On parle, on parle, on discute, on se souvient, on mange, on boit ... et le soir tombe. C'est entendu : Nobuko passera la nuit chez sa sœur et son beau-frère.
Et c'est là que se place la scène peut-être la plus admirable - avec celle de la fin - de cette nouvelle toute en douceur, en tendresse, en raffinement, qui, aux yeux de ceux à qui la Vie n'a guère fait de cadeaux, portera toujours en elle la nostalgie des rares jours heureux qu'elle leur a tout de même consentis. Après le repas, alors que chacun a déjà revêtu ses vêtements de nuit, Shunkichi propose à sa femme et à se belle-sœur de le suivre dans le jardin, pour y contempler le clair de lune. Mais seule Nobuko répond à son appel. Pourquoi Teruko n'en fait-elle rien ? Le lecteur la sait plus indolente que son aînée et, d'autre part, elle a fait les magasins ou, en tout cas, s'est promenée toute la journée en ville. Peut-être l'idée de déambuler par son propre jardin pour y admirer la lune ne lui dit-elle rien parce qu'elle se sent trop fatiguée.
Shunkichi et Nobuko contemplent donc tous deux la lune, l'un près de l'autre, près d'un grand pin du Japon, au tronc tout maigre. Nous sommes au treizième jour de septembre du mois lunaire et c'est la Fête de la Lune. Après l'avoir longuement regardée - comme peut-être il leur arrivait jadis de le faire, à l'Université - Shunkichi propose à Nobuko d'aller voir le poulailler, à l'autre bout du jardin, un jardin rempli d'herbes folles, soit-dit en passant. Là encore, Nobuko obéit. Tous deux marchent l'un près de l'autre, avec fierté, avec dignité, presque épaule contre épaule. Ils arrivent au poulailler que la lune seule éclaire et où la poule repose. Et Shunkichi chuchote alors à l'oreille de Nobuko : "Elle dort ..."
A partir de là et de la fin de la nouvelle, qui n'est pas loin, toutes les conclusions sont possibles mais on ne peut en prouver aucune. Au lecteur de choisir, au lecteur de rêver. Nobuko, elle, le lendemain, jour de son départ et après une curieuse phrase là encore prononcée - mais non achevée - par Teruko, accomplira un choix ultime, sous les larmes de la douce pluie d'automne pleurant sur son pousse-pousse.
Et le lecteur referme la nouvelle avec douceur et précaution, en prenant bien soin de ne pas froisser la dernière page et en regrettant, au plus profond de son cœur, de ne pas avoir à sa disposition quelque belle rose d'automne dont il y ferait sécher les délicats pétales en hommage à Akutagawa Ryûnosuke ...
Ces nouvelles sont le plus souvent glaçantes. Akutagawa avec une maitrise exceptionnelle montre ce qu'il y a de plus cruel ou de plus grotesque dans la condition humaine. En écrivain naturaliste il insiste sur les détails les plus macabres. Les sentiments d'humanité sont vite vaincus par une nécessité implacable ou paraissent inattendus voire surnaturels. Deux des nouvelles présentées dans ce recueil inspirèrent Kurosawa pour son film "Rashômon". A l'époque de Heian Kyôto après plusieurs années de cataclysmes connaît une terrible détresse. La porte de Rashô qui tombe en ruine n'est plus qu'un abri pour les renards et les voleurs. Dans sa galerie on jette des cadavres qui s'y entassent. C'est là qu'un homme attend se protégeant d'une pluie violente. Il vient d'être congédié par son patron et se demande s'il est préférable de devenir voleur ou de mourir de faim. En parcourant la galerie il aperçoit une faible lueur et la silhouette d'une vieille femme qui s'empare de la chevelure d'un cadavre... Cette nouvelle, "Rashômon", est sans doute la plus saisissante du recueil auquel elle donne son titre. Akutagawa plonge avec une inquiétante fascination dans les gouffres du coeur humain.
Je reste assez partagé après la lecture de ces nouvelles.
Encore une fois, comme pour tous les auteurs de cette période - Meiji - Taicho - c'est l'ambiance générale et l'environnement que je préfère.
La plupart de ces courts récits autobiographiques m'ont paru avoir perdu de leur intérêt avec le temps. C'est surtout l'environnement dans lequel évoluent les personnages - la modernisation du Japon -qui me semble intéressant. Je retiens surtout le premier et le dernier récit.
Dans le premier, "L'eau du fleuve", on retrouve ici le thème également cher à Kafu (dans "La Sumida"), du passage du temps, en regardant la ville se moderniser de part et d'autre de la Sumida. Akutagawa, comme Kafu, nous décrit la modification des traversées du fleuve en bac et la nostalgie que lui procure la contemplation de l'eau.
Le dernier, "La vie d'un idiot" représente un peu l'oeuvre-testament de l'auteur. Rédigé peu de temps avant son suicide, il y aborde certains passages de sa vie. Fortement teintée par sa dépression et sa pensée suicidaire, c'est une approche très morbide, mais parfois très lucide, de son existence tourmentée que nous livre Akutagawa.
Donc, recueil de nouvelles d'intérêt inégal, ce livre est à lire, une fois de plus pour l'ambiance d'une époque.
Encore une fois, comme pour tous les auteurs de cette période - Meiji - Taicho - c'est l'ambiance générale et l'environnement que je préfère.
La plupart de ces courts récits autobiographiques m'ont paru avoir perdu de leur intérêt avec le temps. C'est surtout l'environnement dans lequel évoluent les personnages - la modernisation du Japon -qui me semble intéressant. Je retiens surtout le premier et le dernier récit.
Dans le premier, "L'eau du fleuve", on retrouve ici le thème également cher à Kafu (dans "La Sumida"), du passage du temps, en regardant la ville se moderniser de part et d'autre de la Sumida. Akutagawa, comme Kafu, nous décrit la modification des traversées du fleuve en bac et la nostalgie que lui procure la contemplation de l'eau.
Le dernier, "La vie d'un idiot" représente un peu l'oeuvre-testament de l'auteur. Rédigé peu de temps avant son suicide, il y aborde certains passages de sa vie. Fortement teintée par sa dépression et sa pensée suicidaire, c'est une approche très morbide, mais parfois très lucide, de son existence tourmentée que nous livre Akutagawa.
Donc, recueil de nouvelles d'intérêt inégal, ce livre est à lire, une fois de plus pour l'ambiance d'une époque.
Un recueil de nouvelles d’un grand auteur qui nous montre son talent sous différentes formes, en essayant de comprendre l’homme et ses actions qui peuvent parfois sembler contradictoires.
Lien : https://comaujapon.wordpress..
Lien : https://comaujapon.wordpress..
Ce petit livre est composé de deux nouvelles ‘Engrenage’ et ‘La vie d’un idiot’. Datant de 1927, elles ont été publiées à titre posthume après le suicide de l’auteur à l’âge de 35 ans.
Les deux nouvelles sont sombres. On y ressent clairement le malaise de l’auteur, une espèce de folie dont il est conscient, redoutant d’y sombrer comme sa mère avant lui. C’est par moment assez poignant.
Pour autant, je suis assez mitigée sur ces récits. Déjà le style, bien que différent dans les deux nouvelles, ne m’a plus ni dans l’une, ni dans l’autre. Après je ne sais pas trop, il y a beaucoup d’émotions, mais je ne les ai pas ressenti. C’est poignant, mais ça ne m’a pas personnellement touché… Je ne sais pas quoi penser. Peut-être suis-je passée à côté ou peut-être est-ce une lecture qui n’est pas pour moi.
Lien : http://raconte-moi.net/2017/..
Les deux nouvelles sont sombres. On y ressent clairement le malaise de l’auteur, une espèce de folie dont il est conscient, redoutant d’y sombrer comme sa mère avant lui. C’est par moment assez poignant.
Pour autant, je suis assez mitigée sur ces récits. Déjà le style, bien que différent dans les deux nouvelles, ne m’a plus ni dans l’une, ni dans l’autre. Après je ne sais pas trop, il y a beaucoup d’émotions, mais je ne les ai pas ressenti. C’est poignant, mais ça ne m’a pas personnellement touché… Je ne sais pas quoi penser. Peut-être suis-je passée à côté ou peut-être est-ce une lecture qui n’est pas pour moi.
Lien : http://raconte-moi.net/2017/..
L'iris fou - Odieuse vieillesse - Le Maître - Le tableau d'une montagne - L'artiste, Le crime de Han
Ryûnosuke Akutagawa
Ryûnosuke Akutagawa
Je viens de terminer rapidement ce petit recueil de nouvelles japonaises. On peut se demander ce qui a motivé le choix de l'éditeur, tant les écrivains et les thèmes sont différents et n'ont pas grand chose en commun. Des récits de Shiga Naoya de 1913 à celui de Niwa Fumio de 1948, avec des thèmes aussi éloignés que la bombe atomique sur Hiroshima de Ibusé masuji au récit taoïste de Nakajima Atsushi, ces textes, par ailleurs très intéressants, se lisent facilement et ont l'avantage de nous présenter différentes facettes de l'histoire du japon et une littérature encore assez méconnue.
Ce recueil m'a également donné envie de relire les textes plus conséquents de certains de ces auteurs, comme "Pluie noire" de ibuse Masuji ou "Errance dans la nuit" Shiga Naoya.
Ce recueil m'a également donné envie de relire les textes plus conséquents de certains de ces auteurs, comme "Pluie noire" de ibuse Masuji ou "Errance dans la nuit" Shiga Naoya.
Grand amateur de contes, j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque le petit recueil de chez Folio « Rashomon et autres contes » de AKUTAGAWA Ryūnosuke, un auteur que je n'ai jamais eu l'occasion de lire.
Entre deux lectures communes, je me suis dit que c'était le moment de le lire…et quelle déception !
Aucun des contes n'a su retenir mon attention. Je n'ai pas vraiment adhérer au style d'écriture de l'auteur.
Je me suis véritablement ennuyé à la lecture et je n'avais qu'une envie c'était de passer à autre chose. Dommage !
Entre deux lectures communes, je me suis dit que c'était le moment de le lire…et quelle déception !
Aucun des contes n'a su retenir mon attention. Je n'ai pas vraiment adhérer au style d'écriture de l'auteur.
Je me suis véritablement ennuyé à la lecture et je n'avais qu'une envie c'était de passer à autre chose. Dommage !
L'iris fou - Odieuse vieillesse - Le Maître - Le tableau d'une montagne - L'artiste, Le crime de Han
Ryûnosuke Akutagawa
Ryûnosuke Akutagawa
Une anthologie, c'est toujours intéressant pour tous types de lecteurs. Ce livre peut séduire ceux qui veulent tenter une approche avec la littérature japonaise contemporaine, mais aussi les lecteurs plus chevronnés car il y a des auteurs peu traduits qui figurent dans ce recueil. C'est d'ailleurs dommage, si vous voulez mon avis, que certains immenses auteurs japonais doivent ce contenter de ces passages éclairs dans la langue française... mais bon mes récriminations ne changeront pas cet état de fait (je ne cois pas à la parole performative) Sans compter que c'est rudement pratique, une anthologie! On peut picorer à sa guise tel ou tel texte, c'est court (bref idéal pour lire en transport en commun, en téléphonant au service client injoignable de X...)
Toutefois, me direz vous, toutes les anthologies ne se valent pas! Certaines semblent n'avoir que pour but de recycler des textes en un amas attrape tout, véritable piège à lecteur. Tel n'est pas le cas de cette anthologie (du moins à mon humble avis). Elle fait preuve de cohérence et d'ambition. Cohérence avec des auteurs concentrés sur la première moitié du XXème siècle, et ambition par une sélection exigeante avec des figures proéminentes aux styles singuliers, dont les textes sont des classiques lus en classe au Japon.
J'ai ainsi pris beaucoup de plaisir à découvrir cette anthologie. Je connaissais malheureusement déjà Odieuse vieillesse, qui occupe une part conséquente du recueil, mais relire cette nouvelle m'a fait un grand plaisir! Cette nouvelle est dérangeante car elle dépeint la déchéance humaine de la vieillesse et aborde un thème de société très profond et ô combien actuel au Japon, la difficile prise en charge des aînés par leurs famille. J'ai néanmoins eu le plaisir de pouvoir découvrir des auteurs japonais trop rares dans la langue de molière tel que Shiga Naoya, Nakajima Atsushi, Ibusé Masuji. Mon coup de cœur personnel va à L'iris fou, récit très fort sur les souffrances endurées par les civils japonais lors de la seconde guerre mondiale et l'horreur de Hiroshima.
Ce recueil ne manquera pas de vous toucher également, et j'espère qu'il pourra faire office de porte d'entrée dans l'univers fascinant de la littérature Japonaise à de nombreux curieux !
Toutefois, me direz vous, toutes les anthologies ne se valent pas! Certaines semblent n'avoir que pour but de recycler des textes en un amas attrape tout, véritable piège à lecteur. Tel n'est pas le cas de cette anthologie (du moins à mon humble avis). Elle fait preuve de cohérence et d'ambition. Cohérence avec des auteurs concentrés sur la première moitié du XXème siècle, et ambition par une sélection exigeante avec des figures proéminentes aux styles singuliers, dont les textes sont des classiques lus en classe au Japon.
J'ai ainsi pris beaucoup de plaisir à découvrir cette anthologie. Je connaissais malheureusement déjà Odieuse vieillesse, qui occupe une part conséquente du recueil, mais relire cette nouvelle m'a fait un grand plaisir! Cette nouvelle est dérangeante car elle dépeint la déchéance humaine de la vieillesse et aborde un thème de société très profond et ô combien actuel au Japon, la difficile prise en charge des aînés par leurs famille. J'ai néanmoins eu le plaisir de pouvoir découvrir des auteurs japonais trop rares dans la langue de molière tel que Shiga Naoya, Nakajima Atsushi, Ibusé Masuji. Mon coup de cœur personnel va à L'iris fou, récit très fort sur les souffrances endurées par les civils japonais lors de la seconde guerre mondiale et l'horreur de Hiroshima.
Ce recueil ne manquera pas de vous toucher également, et j'espère qu'il pourra faire office de porte d'entrée dans l'univers fascinant de la littérature Japonaise à de nombreux curieux !
Quand j'étais plus petite, j'avais vu le film "Rashômon" d'Akira Kurosawa; je me souvenais du film, mais ni du titre ni du réalisateur (que je ne connaissais évidemment pas à l'époque). Voilà qu'il y a trois semaines, je tombe sur un livre nommé "Rashômon et autres contes" d'un certain Akutagawa; le titre m'inspire (parce que bien sûr mon inconscient avait retenu le titre du film) et je l'achète. Je viens de le lire hier, et quel étrange sentiment à la lecture de "Dans le fourré"! C'est bizarre, cette histoire me dit quelque chose... Et je me souviens du film, que je retrouve sans difficulté. Ce n'est donc peut-être pas très objectif si je dis que cette nouvelle a été m'a préférée des quatre (madeleine de Proust, quand tu nous tiens...), mais il faut avouer que cette succession de témoignages qui ne nous surprennent pas jusqu'à celui de la femme, et enfin, celui du mari, et qui nous laisse tout perplexe, c'est un délice. L'écriture est simple, directe, et pourtant, tout y est. J'aime les dérives, mais ça fait du bien parfois de retourner à des nouvelles de ce genre. A la fin de ces quelques pages, j'ai eu l'impression d'avoir lu un roman de 700 pages, comme si la simplicité de l'écriture se déployait en mille et une images dans l'inconscient du lecteur.
Quant aux autres nouvelles, elles m'ont laissée sceptique, mais j'ai décidé de voir cela comme une caractéristique de l'oeuvre: les nouvelles n'ont pas de chute, ce sont comme des vies prises et abandonnées en route. L'esprit du conte est donc bien présent, car on a l'impression de se promener de monde en monde.
Quant aux autres nouvelles, elles m'ont laissée sceptique, mais j'ai décidé de voir cela comme une caractéristique de l'oeuvre: les nouvelles n'ont pas de chute, ce sont comme des vies prises et abandonnées en route. L'esprit du conte est donc bien présent, car on a l'impression de se promener de monde en monde.
Akutagawa, le plus fameux prix littéraire japonais,équivalent du Goncourt, porte le nom d'un grand écrivain du début du siècle dernier, l'auteur de ces cinq nouvelles.
Comme dans "Ivresse de brocart ", de Hisako Matsubara,récemment lu, le Japon moderne qui peine à terrasser le Japon traditionnel nous marque déjà avec la première nouvelle, "Les Poupées ". On se retrouve avec trente boîtes en bois de paulownia contenant "les poupées",une collection se composant de l'empereur et de l'impératrice , de trois dames du palais, cinq musiciens, pages et chambellans, ainsi que tout le mobilier. Considérées à l'origine comme servant à purifier la maison des vicissitudes de l'année, elles étaient exposées le 3 mars dans les maisons où il y a une fille.Une tradition qui remonte à l'époque Heian (794-1192). Les poupées appartiennent à une famille qui se trouve dans l'obligation matérielle de s'en séparer. Le pére,la mère, la fille ,le fils ont chacun des ressentis différents face à cette séparation lourde de signification.
"Un crime moderne", reflète le résultat de la contradiction entre une union traditionnelle et une union moderne , définit comme celle où l'homme et la femme s'unient par une attirance naturelle, plutôt qu'une union arrangée. Alors que dans "Un mari moderne" , une réflexion sur le concept et la valeur de la dite " modernisation ", à travers l'histoire d'un mariage "moderne", met en doute ce changement de cap à l'occidentale.
" La Magicienne", la quatrième et la plus longue nouvelle du recueil, qui y donne son titre est d'un tout autre ordre, une plongée dans le monde occulte. Comment porter plainte auprès de la police pour un futur crime prévu dans le monde invisible ? Une histoire dans la veine de Poe, qu'on lit comme un mini thriller.
Dans la dernière,"Automne" , un amour sacrifié nous laisse dans le flou de la condition féminine, qui malgré la modernisation ne semble pas vraiment avoir évolué.
À part la dernière nouvelle, l'auteur procède en nous transmettant une histoire qui lui est raconté. L'intrigue toujours présente , le style fluide,et les histoires riches en détails de divers traditions, croyances et superstitions donnent un recueil plaisant et intéressant à lire.
Comme dans "Ivresse de brocart ", de Hisako Matsubara,récemment lu, le Japon moderne qui peine à terrasser le Japon traditionnel nous marque déjà avec la première nouvelle, "Les Poupées ". On se retrouve avec trente boîtes en bois de paulownia contenant "les poupées",une collection se composant de l'empereur et de l'impératrice , de trois dames du palais, cinq musiciens, pages et chambellans, ainsi que tout le mobilier. Considérées à l'origine comme servant à purifier la maison des vicissitudes de l'année, elles étaient exposées le 3 mars dans les maisons où il y a une fille.Une tradition qui remonte à l'époque Heian (794-1192). Les poupées appartiennent à une famille qui se trouve dans l'obligation matérielle de s'en séparer. Le pére,la mère, la fille ,le fils ont chacun des ressentis différents face à cette séparation lourde de signification.
"Un crime moderne", reflète le résultat de la contradiction entre une union traditionnelle et une union moderne , définit comme celle où l'homme et la femme s'unient par une attirance naturelle, plutôt qu'une union arrangée. Alors que dans "Un mari moderne" , une réflexion sur le concept et la valeur de la dite " modernisation ", à travers l'histoire d'un mariage "moderne", met en doute ce changement de cap à l'occidentale.
" La Magicienne", la quatrième et la plus longue nouvelle du recueil, qui y donne son titre est d'un tout autre ordre, une plongée dans le monde occulte. Comment porter plainte auprès de la police pour un futur crime prévu dans le monde invisible ? Une histoire dans la veine de Poe, qu'on lit comme un mini thriller.
Dans la dernière,"Automne" , un amour sacrifié nous laisse dans le flou de la condition féminine, qui malgré la modernisation ne semble pas vraiment avoir évolué.
À part la dernière nouvelle, l'auteur procède en nous transmettant une histoire qui lui est raconté. L'intrigue toujours présente , le style fluide,et les histoires riches en détails de divers traditions, croyances et superstitions donnent un recueil plaisant et intéressant à lire.
Ce recueil est assez différent de La magicienne que j’avais lu précédemment, tout simplement parce que l’action de la magicienne était contemporaine de l’écrivain, se plaçait pour simplifier au début du vingtième siècle, alors que dans ce recueil, la plupart des récits ont lieu dans le passé, et racontent un monde qui a disparu ; même les nouvelles les plus « récentes » se passent à le fin du XIXem siècle. Il s’agit donc d’une époque dans laquelle le mode de vie occidental n’avait pas encore vraiment pénétré au Japon. Mais en même temps c’est raconté par un auteur qui a connu cette pénétration, et les modifications qu’elle a entraînées dans les façons de vivre et dans les mentalités. Il nous raconte donc ces vieux événements d’une façon moderne, et nous les rend accessibles.
Les contes du titre du recueil trouvent aussi leur justification, parce que l’auteur semble ne pas forcement croire complètement tout ce qu’il nous raconte, il y a par moments de l’ironie, du second degré en même temps qu’une indéniable tendresse pour un monde dont le souvenir et les traces sont encore très présents, mais qui n’est plus vraiment.
J’ai vraiment trouvé intéressante cette plongée dans le vieux Japon, et la différence de thèmes entre les deux recueils que j’ai lus me montre à quel point Akutagawa est divers et riche dans sa production littéraire. Encore une fois, dommage que l’on trouve relativement peu de choses traduites, parce que c’est un écrivain qui vaut le détour, bien plus que certains jeunes auteurs actuels.
Les contes du titre du recueil trouvent aussi leur justification, parce que l’auteur semble ne pas forcement croire complètement tout ce qu’il nous raconte, il y a par moments de l’ironie, du second degré en même temps qu’une indéniable tendresse pour un monde dont le souvenir et les traces sont encore très présents, mais qui n’est plus vraiment.
J’ai vraiment trouvé intéressante cette plongée dans le vieux Japon, et la différence de thèmes entre les deux recueils que j’ai lus me montre à quel point Akutagawa est divers et riche dans sa production littéraire. Encore une fois, dommage que l’on trouve relativement peu de choses traduites, parce que c’est un écrivain qui vaut le détour, bien plus que certains jeunes auteurs actuels.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Ryûnosuke Akutagawa
Lecteurs de Ryûnosuke Akutagawa (838)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le Juste Titre
Umberto Eco a écrit le livre : "Comment voyager........................"
avec un saumon
léger
avec ses enfants
11 questions
346 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, livresCréer un quiz sur cet auteur346 lecteurs ont répondu
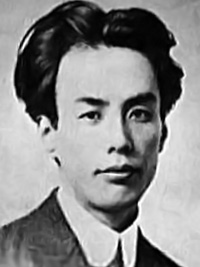

![Rashômon et [trois] autres contes par Akutagawa Rashômon et [trois] autres contes](/couv/cvt_Rashomon-et-trois-autres-contes_251.jpg)