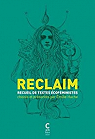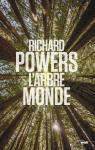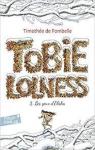Écrivaine turque reconnue internationalement, autrice de romans aux narrations foisonnantes qui empruntent aussi bien aux récits orientaux qu'occidentaux, Elif Shafak vient à la rencontre du public au cours d'un grand entretien où il est question de son oeuvre et de son impressionnant parcours.
On se souvient de « La Bâtarde d'Istanbul », paru en 2006 en Turquie, qui traitait du génocide arménien à travers des regards féminins, immense succès dans le monde entier qui lui a valu d'être poursuivie par l'État turc. Imprégnée par les mysticismes et particulièrement le soufisme, mais fustigeant toute forme de bigoterie, sa littérature s'intéresse à la mémoire et à sa transmission, aux questions de genre, d'appartenance et d'exil.
Son dernier roman, « L'Île aux arbres disparus », se déroule à Chypre, à l'époque de la partition de l'île. Dans ce récit qui questionne le déracinement et les amours interdites, elle fait entendre le cri silencieux de la nature. L'écologie et le féminisme sont des thèmes chers à Elif Shafak, ce que vient rappeler Jeanne Burgart Goutal, professeure de philosophie à Marseille et écoféministe, qui tisse un lien entre la destruction de l'environnement et les violences faites aux femmes.
Écrivant aussi bien en turc qu'en anglais, elle enseigne à l'université aux États-Unis et au Royaume-Uni, travaille pour des journaux internationaux, collabore à l'écriture de séries. Avec la présence sur scène de son éditeur français, Patrice Hoffmann, et le témoignage de sa traductrice Dominique Goy-Blanquet, il est question de l'architecture finement élaborée de ses récits, de la musicalité de sa langue que fait entendre la comédienne Constance Dollé. Car la musique compte beaucoup pour Elif Shafak. Grande mélomane, elle est capable de faire le grand écart entre musique soufie et heavy metal, et a même écrit pour des musiciens rock!
Une rencontre passionnante avec une grande voix littéraire d'aujourd'hui, aux convictions marquées et à la trajectoire exceptionnelle.
Un grand entretien animé par Olivia Gesbert et traduit de l'anglais par Valentine Leÿs et enregistré en public le 28 mai 2022 au Mucem, à Marseille, lors de la sixième édition du festival Oh les beaux jours !
À lire :
— Elif Shafak, « L'île aux arbres disparus », traduit de l'anglais par Dominique Goy-Blanquet, Flammarion, 2022.
— Elif Shafak, « La Bâtarde d'Istanbul », traduit de l'anglais par Aline Azoulay, Phébus, 2007.
— Jeanne Burgart-Goutal, «Être écoféministe. Théories et pratiques », L'Échappée, 2020.
En coréalisation avec le Mucem.
Podcasts & replay sur http://ohlesbeauxjours.fr
#OhLesBeauxJours #OLBJ2022

Jeanne Burgart Goutal/5
37 notes
Résumé :
Oppression des femmes et destruction de la nature seraient deux facettes indissociables d’un modèle de civilisation qu’il faudrait dépasser : telle est la perspective centrale de l’écoféminisme. Mais derrière ce terme se déploie une grande variété de pensées et de pratiques militantes. Rompant avec une approche chic et apolitique aujourd’hui en vogue, ce livre restitue la richesse et la diversité des théories développées par cette mouvance née il y a plus de 4... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Être écoféministeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Jeanne Burgart Goutal est agrégée de philosophie et professeure de yoga. Depuis une dizaine d'années elle mène une recherche sur l'écoféminisme. Elle en présente les résultats dans cet ouvrage ainsi que les réflexions que cela a suscité en elle. La première partie est consacrée à l'histoire de l'écoféminisme. L'écoféminisme c'est l'idée qu'il y a un lien entre les violences faites aux femmes et la destruction de la nature. Ce n'est pas être à la fois écologiste et féministe : on peut être les deux sans être écoféministe.
"Pour les écoféministes, le patriarcat, la domination des femmes par les hommes, est lié à la tentative de dominer la nature. Pour justifier leur exploitation, femmes et nature ont été réduites à des objets, placées dans la catégorie de "l'Autre"; on a nié la connexion de l'humain avec le monde naturel, ainsi que le féminin dans la nature de l'homme". Barbara Epstein
Le mot écoféminisme est créé en France en 1974 par Françoise d'Eaubonne mais le mouvement français n'émerge pas alors qu'aux Etats-Unis il y a de nombreuses actions de masse à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Aux Etats-Unis, l'idée de nature a des sonorités rebelles et émancipatrices tandis qu'en Europe l'écoféminisme est souvent accusé par les féministes d'essentialiser les femmes en mettant en avant leur lien supposé avec la nature et d'être donc réactionnaire. Cela va avec une méfiance concernant les aspects spirituels de l'écoféminisme : magie, rituels, culte de la Déesse... L'autrice montre qu'en fait les mouvements ou groupes écoféministes à travers le monde (il est question aussi des pays du Sud) sont très divers et elle considère cette absence d'unité comme une richesse. Dans les années 1995-2015, l'écoféminisme est victime de polémiques et attaqué de toutes parts, le mouvement décline. Depuis peu il revient sur le devant de la scène et suscite même une sorte de mode.
Après avoir expliqué pourquoi elle ne se reconnaissait pas comme écoféministe, Jeanne Burgart Goutal passe à la pratique en seconde partie : elle va faire des stages chez des écoféministes. Celui sur lequel elle s'étend le plus se déroule à Navdanya, ONG créée par Vandana Shiva qui se réclame clairement de l'écoféminisme, à l'occasion d'un séjour de trois mois en Inde. Avant de partir l'autrice a lu des prises de position très tranchées sur Vandana Shiva. Alors, "Fanatique ou fantastique" ? Sur place, elle ne peut s'empêcher de noter un décalage entre le discours -notamment à destination des occidentaux-et la pratique.En fin de compte elle explique ce hiatus par le contexte -on doit tenir compte de la culture locale- et par le fait que Vandana Shiva a été mal comprise en Occident. Elle a été mal traduite, nous dit-elle, car elle utilise certains mots dans un sens qui lui est propre. Et "maltraiter le langage dominant en utilisant ses mots de travers, c'[est] sans doute de bonne guerre". Il me semble quant à moi que c'est une conclusion un peu trop complaisante.
Si je ne suis pas convaincue par Vandana Shiva j'ai apprécié le voyage en Inde de Jeanne Burgart Goutal, sa volonté de comprendre et de nous faire profiter de son cheminement. Avec Jagori, une autre ONG, elle a l'occasion de rencontrer des femmes ou des familles et évolue dans son approche : "je laissais de plus en plus tomber mes propres questions, et passais de plus en plus de temps à me taire et à écouter, surprise et émerveillée non plus de ce qu'elles ne disaient pas et que j'aurais eu l'idée de demander, mais bien de ce qu'elles disaient et que je n'aurais jamais eu l'idée de demander".
J'ai donc trouvé plutôt intéressante la lecture de cet essai qui m'a permis de découvrir ce qu'est l'écoféminisme et qui pose des questions qui me semblent d'actualité quand il s'agit de féminisme postcolonial et d'eurocentrisme.
Lien : http://monbiblioblog.revolub..
"Pour les écoféministes, le patriarcat, la domination des femmes par les hommes, est lié à la tentative de dominer la nature. Pour justifier leur exploitation, femmes et nature ont été réduites à des objets, placées dans la catégorie de "l'Autre"; on a nié la connexion de l'humain avec le monde naturel, ainsi que le féminin dans la nature de l'homme". Barbara Epstein
Le mot écoféminisme est créé en France en 1974 par Françoise d'Eaubonne mais le mouvement français n'émerge pas alors qu'aux Etats-Unis il y a de nombreuses actions de masse à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Aux Etats-Unis, l'idée de nature a des sonorités rebelles et émancipatrices tandis qu'en Europe l'écoféminisme est souvent accusé par les féministes d'essentialiser les femmes en mettant en avant leur lien supposé avec la nature et d'être donc réactionnaire. Cela va avec une méfiance concernant les aspects spirituels de l'écoféminisme : magie, rituels, culte de la Déesse... L'autrice montre qu'en fait les mouvements ou groupes écoféministes à travers le monde (il est question aussi des pays du Sud) sont très divers et elle considère cette absence d'unité comme une richesse. Dans les années 1995-2015, l'écoféminisme est victime de polémiques et attaqué de toutes parts, le mouvement décline. Depuis peu il revient sur le devant de la scène et suscite même une sorte de mode.
Après avoir expliqué pourquoi elle ne se reconnaissait pas comme écoféministe, Jeanne Burgart Goutal passe à la pratique en seconde partie : elle va faire des stages chez des écoféministes. Celui sur lequel elle s'étend le plus se déroule à Navdanya, ONG créée par Vandana Shiva qui se réclame clairement de l'écoféminisme, à l'occasion d'un séjour de trois mois en Inde. Avant de partir l'autrice a lu des prises de position très tranchées sur Vandana Shiva. Alors, "Fanatique ou fantastique" ? Sur place, elle ne peut s'empêcher de noter un décalage entre le discours -notamment à destination des occidentaux-et la pratique.En fin de compte elle explique ce hiatus par le contexte -on doit tenir compte de la culture locale- et par le fait que Vandana Shiva a été mal comprise en Occident. Elle a été mal traduite, nous dit-elle, car elle utilise certains mots dans un sens qui lui est propre. Et "maltraiter le langage dominant en utilisant ses mots de travers, c'[est] sans doute de bonne guerre". Il me semble quant à moi que c'est une conclusion un peu trop complaisante.
Si je ne suis pas convaincue par Vandana Shiva j'ai apprécié le voyage en Inde de Jeanne Burgart Goutal, sa volonté de comprendre et de nous faire profiter de son cheminement. Avec Jagori, une autre ONG, elle a l'occasion de rencontrer des femmes ou des familles et évolue dans son approche : "je laissais de plus en plus tomber mes propres questions, et passais de plus en plus de temps à me taire et à écouter, surprise et émerveillée non plus de ce qu'elles ne disaient pas et que j'aurais eu l'idée de demander, mais bien de ce qu'elles disaient et que je n'aurais jamais eu l'idée de demander".
J'ai donc trouvé plutôt intéressante la lecture de cet essai qui m'a permis de découvrir ce qu'est l'écoféminisme et qui pose des questions qui me semblent d'actualité quand il s'agit de féminisme postcolonial et d'eurocentrisme.
Lien : http://monbiblioblog.revolub..
J'ai apprécié ce livre. J' ai aimé le fait que l'autrice nous entraine avec elle dans ses questionnements, ses évolutions et ne livre pas de réponses toutes faites. Elle nous présente l'écoféminisme dans toutes ses ramifications et différents mouvements. Ce livre a l'avantage de montrer la complexité de ce mouvement, qui regroupe des formes très différentes voire opposées. Mais c'est un mouvement qui pour l'essentiel, porte attention et bienveillance au monde naturel qui nous entoure, et veut nous faire prendre conscience de son importance pour le bien être de tous. Je conseille vivement ce livre comme une première approche vers ce mouvement. Il apporte des bases et permet ensuite de choisir vers quel courant ou aspect vous souhaiter approfondir. le livre contient d'ailleurs une bibliographie.
Plus on en apprend sur l'écoféminisme, plus on en vient à douter du concept. Mise en pratique, la notion s'avère plus complexe et moins précise. Cette intéressante enquête convainc qu'écologie et féminisme doivent avancer ensemble. C'est là que se trouvent les solutions pour notre avenir.
Videos de Jeanne Burgart Goutal (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Eco-féminisme
emiliedubau
8 livres

Femmes et réflexion écologique
Gabbe
28 livres
Autres livres de Jeanne Burgart Goutal (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'écologiste mystère
Quel mot concerne à la fois le métro, le papier, les arbres et les galères ?
voile
branche
rame
bois
11 questions
255 lecteurs ont répondu
Thèmes :
écologie
, developpement durable
, Consommation durable
, protection de la nature
, protection animale
, protection de l'environnement
, pédagogie
, mers et océansCréer un quiz sur ce livre255 lecteurs ont répondu