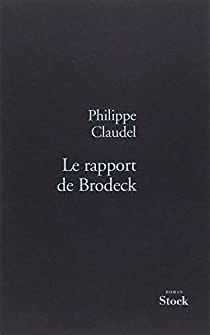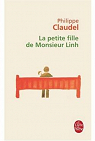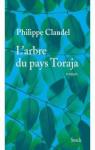Le rapport de Brodeck est un livre qui peut dérouter le lecteur car le village où se situe la majeure partie du roman n'est pas situé géographiquement, en tout cas pas de façon précise. On pense assez naturellement à l'Alsace car on y parle une langue qui est proche de celle d'un grand pays voisin d'où sont arrivés les vainqueurs au début de la guerre mais certains détails infirment cette hypothèse et inciteraient à situer ce village du côté de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie. de même l'époque n'est pas précisée. Bien sûr une guerre qui ressemble fort à la Seconde Guerre Mondiale a eu lieu, des trains emmenaient dans des conditions atroces des hommes, des femmes et des enfants vers des camps de la mort. Pourtant dans ce village, les conditions de vie font penser à des temps beaucoup plus anciens : on y circule encore exclusivement à pied ou à cheval, par exemple. On est donc ici dans le registre du conte moral ou philosophique.
Quelques années après la fin de la guerre, un homme, un étranger, celui que tous dans le village appellent "L'Anderer" - l'Autre - car il n'est pas d'ici, a été assassiné. Il s'agit d'un meurtre collectif, presque tous les hommes valides du village y ont participé. Brodeck, l'un des rares à ne pas faire partie de ceux-là est chargé par les assassins de rédiger un rapport sur les circonstances qui ont conduit à ce meurtre. Parallèlement à la rédaction de ce rapport, Brodeck entreprend de raconter sa vie. Brodeck fait partie d'une communauté persécutée depuis de nombreuses générations. Dans le roman, le mot "juif" n'est jamais utilisé. On peut presqu'aussi bien penser aux tziganes, aux libres-penseurs, aux malades mentaux... Le village a été occupé pendant la guerre par les habitants du pays voisin et Brodeck a été dénoncé puis déporté dans un de ces camps de la mort. Il en reviendra mais rien ne sera plus comme avant.
Le récit de Brodeck avance à pas comptés. Comme il s'en excuse lui-même, il fait de nombreux aller-retours entre présent et passé, le passé de la guerre, ou bien le passé proche, celui d'avant l'assassinat. L'auteur maîtrise parfaitement cette sinueuse narration et nous fait peu à peu découvrir un tableau digne de la partie "Enfer" du triptyque du Jardin des Délices de Jerôme Bosch. A l'abomination du camp de concentration répond celle de ce qui s'est passé pendant l'occupation du village et qu'on découvrira progressivement. On devine alors peu à peu qui est cet Anderer et ce qu'il est venu faire dans ce village (même si un certain mystère demeurera sur ses réelles intentions).
Le roman de Philippe Claudel est d'une beauté crépusculaire, angoissante, terrifiante. Ce village, isolé du reste du monde, est un creuset où les pires instincts, les pulsions les plus honteuses vont s'exacerber. Rien ni personne, pas même Brodeck, ne permet d'échapper à cette descente aux enfers. L'Anderer joue ici le rôle du "Joueur de flûte de Hamelin", qui, n'étant pas été payé par les habitants du village qui lui avaient demandé de les débarrasser des rats qui avaient envahi la ville, est revenu pour emmener cette fois tous les enfants vers un lieu d'où ils ne reviendraient jamais. Philippe Claudel modernise la fable et la rend encore plus cynique, plus désespérante. Pour le caractère absurde de ce "rapport", rédigé pour une mystérieuse administration et sur lequel aucune cour de justice ne pourra statuer, Brodeck m'apparaît comme un frère de K., le personnage du Procès et du Château de Kafka. Un frère démuni dans un monde désespérant.
Quelques années après la fin de la guerre, un homme, un étranger, celui que tous dans le village appellent "L'Anderer" - l'Autre - car il n'est pas d'ici, a été assassiné. Il s'agit d'un meurtre collectif, presque tous les hommes valides du village y ont participé. Brodeck, l'un des rares à ne pas faire partie de ceux-là est chargé par les assassins de rédiger un rapport sur les circonstances qui ont conduit à ce meurtre. Parallèlement à la rédaction de ce rapport, Brodeck entreprend de raconter sa vie. Brodeck fait partie d'une communauté persécutée depuis de nombreuses générations. Dans le roman, le mot "juif" n'est jamais utilisé. On peut presqu'aussi bien penser aux tziganes, aux libres-penseurs, aux malades mentaux... Le village a été occupé pendant la guerre par les habitants du pays voisin et Brodeck a été dénoncé puis déporté dans un de ces camps de la mort. Il en reviendra mais rien ne sera plus comme avant.
Le récit de Brodeck avance à pas comptés. Comme il s'en excuse lui-même, il fait de nombreux aller-retours entre présent et passé, le passé de la guerre, ou bien le passé proche, celui d'avant l'assassinat. L'auteur maîtrise parfaitement cette sinueuse narration et nous fait peu à peu découvrir un tableau digne de la partie "Enfer" du triptyque du Jardin des Délices de Jerôme Bosch. A l'abomination du camp de concentration répond celle de ce qui s'est passé pendant l'occupation du village et qu'on découvrira progressivement. On devine alors peu à peu qui est cet Anderer et ce qu'il est venu faire dans ce village (même si un certain mystère demeurera sur ses réelles intentions).
Le roman de Philippe Claudel est d'une beauté crépusculaire, angoissante, terrifiante. Ce village, isolé du reste du monde, est un creuset où les pires instincts, les pulsions les plus honteuses vont s'exacerber. Rien ni personne, pas même Brodeck, ne permet d'échapper à cette descente aux enfers. L'Anderer joue ici le rôle du "Joueur de flûte de Hamelin", qui, n'étant pas été payé par les habitants du village qui lui avaient demandé de les débarrasser des rats qui avaient envahi la ville, est revenu pour emmener cette fois tous les enfants vers un lieu d'où ils ne reviendraient jamais. Philippe Claudel modernise la fable et la rend encore plus cynique, plus désespérante. Pour le caractère absurde de ce "rapport", rédigé pour une mystérieuse administration et sur lequel aucune cour de justice ne pourra statuer, Brodeck m'apparaît comme un frère de K., le personnage du Procès et du Château de Kafka. Un frère démuni dans un monde désespérant.
Ce récit à la première personne relate la vie de Brodeck, un homme qui a vu sa vie lui être enlevée par l'inhumanité de la guerre et ce qu'elle peut faire ressortir de plus inhumain en l'homme. Une guerre hors du temps.
Quand l'Anderer (un voyageur venu d'on ne sait où) arrive au village, la curiosité et la méfiance se transforment peu à peu en peur et en haine.
D'un côté, on lui demande d'écrire un rapport qui ne dira pas tout, pour justifier d'actes innommables. de l'autre, Brodeck nous raconte son histoire, sa vie et sa version des faits.
Une écriture poétique mais emprunte de mélancolie, imagée mais dure à entendre. Des personnages percutants, qui ont la sanie au coeur. Cette lecture (écoute) m'a vraiment bouleversée. Un récit de guerre qui fait réfléchir aux profondeurs de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus noir. Une réflexion philosophique sur l'homme, décrit avec le détachement de qui se considère hors du monde. Un très beau texte.
Quand l'Anderer (un voyageur venu d'on ne sait où) arrive au village, la curiosité et la méfiance se transforment peu à peu en peur et en haine.
D'un côté, on lui demande d'écrire un rapport qui ne dira pas tout, pour justifier d'actes innommables. de l'autre, Brodeck nous raconte son histoire, sa vie et sa version des faits.
Une écriture poétique mais emprunte de mélancolie, imagée mais dure à entendre. Des personnages percutants, qui ont la sanie au coeur. Cette lecture (écoute) m'a vraiment bouleversée. Un récit de guerre qui fait réfléchir aux profondeurs de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus noir. Une réflexion philosophique sur l'homme, décrit avec le détachement de qui se considère hors du monde. Un très beau texte.
Un roman émouvant portant sur l'intolérance, l'ignorance, la peur de l'autre, de l'étranger, campé dans un pays fictif et une époque fictive qu'on peut tout de même associer à l'Autriche, à la 2e guerre mondiale et à l'holocauste. Les émotions sont fortes mais livrées avec retenue dans une langue imagée et typée. Une très belle découverte que cet auteur que je ne connaissais pas.
Au détour d'une rencontre, une amie me tend un bout de papier, quelques mots griffonnés « Claudel, Brodeck, dis-moi pour la fin ». Une librairie plus tard, j'ai commencé un singulier voyage au pays de Brodeck, un pays de montagnes, d'hommes, de dialecte, de fleurs, de mémoire, de massacre et de mort. Un voyage que j'achève ce soir, sans vraiment savoir que penser de ce que j'ai lu.
Parce que dans un premier temps il m'a marqué, je pourrais vanter le style très fin, très esthétique de Philippe Claudel, un rythme de mots qui berce et emmène facilement, des portraits d'hommes à la Bruegel, l'évocation puissante et sensuelle de la nature et de ses ciels changeants. Et puis la construction subtile, les tensions savamment orchestrée, les zones d'ombres montrées du doigts et laissées à plus tard au fil du texte. Pourtant vint assez vite un second temps où j'ai senti que malgré la grande qualité littéraire du roman, ou peut-être à cause d'elle, je lui résistais. Un peu comme si je regardais un film magnifique, mais depuis le couloir du cinéma, captivé mais sans pouvoir m'y immerger.
J'ai buté sur les colchiques - c'était une aubaine pour m'échapper. Autant le dire de suite, je partage un peu trop de traits avec Brodeck, le narrateur, pour lire ce livre sans me sentir profondément concerné. Comme lui, je vis en montagne, m'intéresse à la nature et aux fleurs, travaille pour une administration, pour laquelle il m'arrive de faire des rapports, ai une poupchette à la maison, suis un étranger dans ma communauté, vis dans un pays au parler ancien. Là s'arrête le parallèle, mais c'est déjà beaucoup trop. Ça a commencé par le style raffiné du simple Brodeck, qui s'est mis à me gêner, et j'ai été presque soulagé en relevant la confusion entre les colchiques et les crocus d'automne, et plus loin l'heure chaude située à trois heures ; j'étais tout à coup rassuré : Brodeck est bien un être de fiction, son pays imaginaire, son histoire la création d'un auteur qui se trompait parfois. le vertige léger que me causait l'idée d'un double s'estompa.
Mais je devrais peut-être commencer par l'ossature du récit. Ce livre n'est pas le Rapport de Brodeck, c'est plutôt sa confession, à la fois témoignage et journal qu'il livre en parallèle à la rédaction du Rapport lui-même. Attelé à la rédaction de ce rapport, Brodeck nous entraine avec lui dans sa mémoire, une mémoire à vif, hantée par la violence, et dans son quotidien, un présent qui se met à ployer sous la peur et les menaces.
Le Rapport, qu'on lui demande aussi brut et factuel que possible, Brodeck l'écrit sur un étranger, l'Anderer. Installé au village depuis quelques mois, cet Autre a été assassiné tantôt par les hommes de son village. Ce sont eux, à peine leur assassinat achevé, qui lui passent commande du fameux rapport.
En contrepoint à ce meurtre, il y a la contrée de Brodeck, un Ander Weld littéraire où les colchiques poussent sur des talus et où le soleil se croit à l'heure d'été. Un décor qui pourrait être rassurant : on est pas si loin de Heidi, cernés par les montagnes, en contact étroit avec la nature, dans une contrée d'hommes frustes, à langue exotique et pourtant familière. Ce lieu imaginaire pourrait être idyllique, mais il y a ses habitants. Je trouve qu'il a une parenté profonde avec la vallée de « Soudain dans la forêt profonde », le conte de Amos Oz.
Au fil du journal de Brodeck, le panorama s'élargit, et nous découvrons son pays. Et la litanie des crimes.
Au pays de Brodeck, comme partout ailleurs dans ce monde là, on ne tue pas seul. Ici le crime est une affaire collective. Pas de duels, pas de crime passionnel et encore moins de roi sans divertissements : massacrer un homme est une affaire de groupe, de meute humaine. Et les massacres ne manquent pas : lynchages, guerres, déportation, camps de concentrations, viols, le programme est suffisamment complet pour épouvanter – et tout à fait plausible au regard du siècle dernier.
Comment et pourquoi un groupe d'humain en vient-il au meurtre ? le crime existe-t-il sans la mémoire du crime ? Et qu'est-ce que la mémoire ? Ce sont pour moi les interrogations au coeur de de cette oeuvre, et l'issue que nous propose Claudel est suffisamment étonnante pour que je vous invite vous aussi à nous dire pour la fin...
De mon côté, je me dis maintenant que tout n'est qu'illusions, les mots peut-être plus que le reste.
Parce que dans un premier temps il m'a marqué, je pourrais vanter le style très fin, très esthétique de Philippe Claudel, un rythme de mots qui berce et emmène facilement, des portraits d'hommes à la Bruegel, l'évocation puissante et sensuelle de la nature et de ses ciels changeants. Et puis la construction subtile, les tensions savamment orchestrée, les zones d'ombres montrées du doigts et laissées à plus tard au fil du texte. Pourtant vint assez vite un second temps où j'ai senti que malgré la grande qualité littéraire du roman, ou peut-être à cause d'elle, je lui résistais. Un peu comme si je regardais un film magnifique, mais depuis le couloir du cinéma, captivé mais sans pouvoir m'y immerger.
J'ai buté sur les colchiques - c'était une aubaine pour m'échapper. Autant le dire de suite, je partage un peu trop de traits avec Brodeck, le narrateur, pour lire ce livre sans me sentir profondément concerné. Comme lui, je vis en montagne, m'intéresse à la nature et aux fleurs, travaille pour une administration, pour laquelle il m'arrive de faire des rapports, ai une poupchette à la maison, suis un étranger dans ma communauté, vis dans un pays au parler ancien. Là s'arrête le parallèle, mais c'est déjà beaucoup trop. Ça a commencé par le style raffiné du simple Brodeck, qui s'est mis à me gêner, et j'ai été presque soulagé en relevant la confusion entre les colchiques et les crocus d'automne, et plus loin l'heure chaude située à trois heures ; j'étais tout à coup rassuré : Brodeck est bien un être de fiction, son pays imaginaire, son histoire la création d'un auteur qui se trompait parfois. le vertige léger que me causait l'idée d'un double s'estompa.
Mais je devrais peut-être commencer par l'ossature du récit. Ce livre n'est pas le Rapport de Brodeck, c'est plutôt sa confession, à la fois témoignage et journal qu'il livre en parallèle à la rédaction du Rapport lui-même. Attelé à la rédaction de ce rapport, Brodeck nous entraine avec lui dans sa mémoire, une mémoire à vif, hantée par la violence, et dans son quotidien, un présent qui se met à ployer sous la peur et les menaces.
Le Rapport, qu'on lui demande aussi brut et factuel que possible, Brodeck l'écrit sur un étranger, l'Anderer. Installé au village depuis quelques mois, cet Autre a été assassiné tantôt par les hommes de son village. Ce sont eux, à peine leur assassinat achevé, qui lui passent commande du fameux rapport.
En contrepoint à ce meurtre, il y a la contrée de Brodeck, un Ander Weld littéraire où les colchiques poussent sur des talus et où le soleil se croit à l'heure d'été. Un décor qui pourrait être rassurant : on est pas si loin de Heidi, cernés par les montagnes, en contact étroit avec la nature, dans une contrée d'hommes frustes, à langue exotique et pourtant familière. Ce lieu imaginaire pourrait être idyllique, mais il y a ses habitants. Je trouve qu'il a une parenté profonde avec la vallée de « Soudain dans la forêt profonde », le conte de Amos Oz.
Au fil du journal de Brodeck, le panorama s'élargit, et nous découvrons son pays. Et la litanie des crimes.
Au pays de Brodeck, comme partout ailleurs dans ce monde là, on ne tue pas seul. Ici le crime est une affaire collective. Pas de duels, pas de crime passionnel et encore moins de roi sans divertissements : massacrer un homme est une affaire de groupe, de meute humaine. Et les massacres ne manquent pas : lynchages, guerres, déportation, camps de concentrations, viols, le programme est suffisamment complet pour épouvanter – et tout à fait plausible au regard du siècle dernier.
Comment et pourquoi un groupe d'humain en vient-il au meurtre ? le crime existe-t-il sans la mémoire du crime ? Et qu'est-ce que la mémoire ? Ce sont pour moi les interrogations au coeur de de cette oeuvre, et l'issue que nous propose Claudel est suffisamment étonnante pour que je vous invite vous aussi à nous dire pour la fin...
De mon côté, je me dis maintenant que tout n'est qu'illusions, les mots peut-être plus que le reste.
Le dénommé Brodeck a été missionné par les notabilités de son village d'adoption, en sa qualité d'homme instruit, pour rédiger un rapport sur les raisons et les circonstances de la mort d'un étranger, être excentrique et incompris, dont on n'a jamais bien su le nom et que le narrateur appelle de Anderer ou Anderer, "l'autre". On s'interroge sur les motifs de cette mission, tant le village a une propension à vouloir oublier ce qui lui rappelle ses compromissions, comme une tentative bien maladroite de nier ce qui a été, pour preuve la disparition, de façon fort horrible on le devine, de la victime, quand on sait que le commanditaire du rapport, bourgmestre fort antipathique, a assis sa fortune sur l'élevage des cochons. On est aussi interloqué sur le choix du scribe, lui-même élément exogène du village, enfant recueilli aux origines mal définies, suspectes par cela même, et qui fut sacrifié par les villageois comme victime expiatoire à la soif de purification de l'occupant et cousin germanisant, bouc émissaire, offrande propitiatoire, qui a dû sa survie et son retour, au reniement contraint de son humanité. Mais sous couvert du rapport, c'est bien, en parallèle, le récit sans concession de la culpabilité collective du village qui occupe les nuits d'insomnie de Brodeck.
Affreux, sales et méchants, pourrait-on dire à la lecture de ce roman poignant. C'est l'illustration atroce de ce que donne le repli sur soi, manifestation irrationnelle de la peur, de la bêtise et de la méchanceté. L'histoire épouse, dans son aspect décousu, le besoin du narrateur, homme traqué tentant de dérouter une meute de démons lancés à sa poursuite, de soulager son âme et ses tripes. le lieu et l'époque ne sont pas définis, mais l'allusion à l'histoire est assez transparente : on se dit vaguement au début, qu'on est devant une énième mouture d'un récit mémoriel, mais l'aspect déstabilisant du côté vague du théâtre des événements et le comportement particulièrement abject de ses gens, sur des personnes paisibles et de bonne volonté, n'ayant de tort que d'être différents, finissent par convaincre.
Affreux, sales et méchants, pourrait-on dire à la lecture de ce roman poignant. C'est l'illustration atroce de ce que donne le repli sur soi, manifestation irrationnelle de la peur, de la bêtise et de la méchanceté. L'histoire épouse, dans son aspect décousu, le besoin du narrateur, homme traqué tentant de dérouter une meute de démons lancés à sa poursuite, de soulager son âme et ses tripes. le lieu et l'époque ne sont pas définis, mais l'allusion à l'histoire est assez transparente : on se dit vaguement au début, qu'on est devant une énième mouture d'un récit mémoriel, mais l'aspect déstabilisant du côté vague du théâtre des événements et le comportement particulièrement abject de ses gens, sur des personnes paisibles et de bonne volonté, n'ayant de tort que d'être différents, finissent par convaincre.
Philippe Claudel - «Le rapport de Brodeck», Stock, 2007 "Livre de poche" (ISBN 978-2-253-12572-3)
Philippe Claudel est né 1962 en Lorraine, l'une de ces contrées où le mot « guerre » a souvent pris hélas toute sa férocité.
Après "la guerre" (comme Camus dans "la peste", l'auteur ne précise pas de quelle guerre il s'agit, il y en eut tant et tant…), Brodeck, un rescapé des camps (la Shoah ?), rentre dans son village perdu dans des confins germanophones. le lieu n'est pas précisé, certains critiques (parisiens) ont inventé qu'il s'agirait d'un village perdu en Alsace-Lorraine (c'est vraiment méconnaître cette région par rapport aux éléments donnés dans le roman), pour moi je pencherais plutôt pour l'ex-empire d'Autriche, en Europe centrale, car certaines phrases concernant l'administration de ce lieu imaginaire sont carrément kafkaïennes.
Au début du récit (émaillé de nombreux retours en arrière), les hommes du village viennent de commettre un meurtre collectif en tuant "l'Anderer", (ce qui signifie "l'autre" en langues tudesques), celui qui était arrivé environ un an auparavant, venant de nulle part. Les hommes coincent Brodeck, perçu comme le seul intellectuel puisqu'il est allé faire des études "dans la grande ville", et le charge de rédiger un rapport de style administratif pour expliquer le meurtre et les disculper. Brodeck rédige ce rapport en tenant la chronique de son élaboration, ce qui constitue la trame du roman.
Au fil des pages, il se remémore le passé, ses études à "la capitale" (Vienne ???), la montée de la peste (le nazisme ? il y en eut tant d'autres, des pestes… allusion à Camus ?), sa déportation en camp de concentration, l'effet que produisit son retour, fort inattendu, sur la population du village, la survenue de l'Anderer. Dès le début, on se doute évidemment de la fin, de la fonction de révélateur que va assumer l'Anderer, mais cela n'ôte rien à la lecture car le récit est magistralement mené.
La description, toute simple, sans effet grandiloquent, de la cruauté humaine, est saisissante. L'auteur réalise le tour de force de restituer l'épouvante, dans ce qu'elle eut de pire lors de la Shoah, sans jamais mentionner spécifiquement "les juifs". le récit est parsemé de termes germaniques intelligemment explicités, ce qui est rarissime dans la littérature française d'aujourd'hui.
Un aspect : la description de la difficulté d'écrire, sans grands effets de manche, comme par exemple au début du chapitre XVI (voir citation).
Ce roman a remporté de nombreux prix (pour une fois, c'était vraiment justifié), dont celui du «Goncourt des lycéens». C'est un fait rarissime à souligner de la part d'un auteur contemporain : ce roman publié en 2007 peut effectivement être chaudement recommandé aux lycéens.
Une belle écriture.
Un beau livre.
Philippe Claudel est né 1962 en Lorraine, l'une de ces contrées où le mot « guerre » a souvent pris hélas toute sa férocité.
Après "la guerre" (comme Camus dans "la peste", l'auteur ne précise pas de quelle guerre il s'agit, il y en eut tant et tant…), Brodeck, un rescapé des camps (la Shoah ?), rentre dans son village perdu dans des confins germanophones. le lieu n'est pas précisé, certains critiques (parisiens) ont inventé qu'il s'agirait d'un village perdu en Alsace-Lorraine (c'est vraiment méconnaître cette région par rapport aux éléments donnés dans le roman), pour moi je pencherais plutôt pour l'ex-empire d'Autriche, en Europe centrale, car certaines phrases concernant l'administration de ce lieu imaginaire sont carrément kafkaïennes.
Au début du récit (émaillé de nombreux retours en arrière), les hommes du village viennent de commettre un meurtre collectif en tuant "l'Anderer", (ce qui signifie "l'autre" en langues tudesques), celui qui était arrivé environ un an auparavant, venant de nulle part. Les hommes coincent Brodeck, perçu comme le seul intellectuel puisqu'il est allé faire des études "dans la grande ville", et le charge de rédiger un rapport de style administratif pour expliquer le meurtre et les disculper. Brodeck rédige ce rapport en tenant la chronique de son élaboration, ce qui constitue la trame du roman.
Au fil des pages, il se remémore le passé, ses études à "la capitale" (Vienne ???), la montée de la peste (le nazisme ? il y en eut tant d'autres, des pestes… allusion à Camus ?), sa déportation en camp de concentration, l'effet que produisit son retour, fort inattendu, sur la population du village, la survenue de l'Anderer. Dès le début, on se doute évidemment de la fin, de la fonction de révélateur que va assumer l'Anderer, mais cela n'ôte rien à la lecture car le récit est magistralement mené.
La description, toute simple, sans effet grandiloquent, de la cruauté humaine, est saisissante. L'auteur réalise le tour de force de restituer l'épouvante, dans ce qu'elle eut de pire lors de la Shoah, sans jamais mentionner spécifiquement "les juifs". le récit est parsemé de termes germaniques intelligemment explicités, ce qui est rarissime dans la littérature française d'aujourd'hui.
Un aspect : la description de la difficulté d'écrire, sans grands effets de manche, comme par exemple au début du chapitre XVI (voir citation).
Ce roman a remporté de nombreux prix (pour une fois, c'était vraiment justifié), dont celui du «Goncourt des lycéens». C'est un fait rarissime à souligner de la part d'un auteur contemporain : ce roman publié en 2007 peut effectivement être chaudement recommandé aux lycéens.
Une belle écriture.
Un beau livre.
Un roman d'une profonde noirceur qui met à nu les lâchetés de l'âme humaine
Ce sera peut-être notre seule contribution à l'effervescence de la rentrée littéraire et de ses innombrables sorties qui s'empilent chez les libraires.
Mais nous étions sortis frustrés de notre lecture précédente de Philippe Claudel : le Café de l'Excelsior; sa plume méritait donc une seconde chance : le rapport de Brodeck.
Bien sûr, on y retrouve les tournures savamment peaufinées qui nous avaient un peu agacés dans le Café.
Toutefois le rapport de Brodeck s'avère plus consistant et au fil des pages les effets «m'as-tu-lu» de Philippe Claudel se diluent dans une histoire prenante et oppressante.
Une histoire qui se dit intemporelle et universelle mais qui fait clairement référence à deux guerres (la deuxième avec son cortège d'exactions et d'exterminations) et à un petit pays d'Europe centrale au dialecte germanique.
À la fin de cette deuxième guerre, quand Brodeck, réchappé d'un camp, retrouve son village, c'est pour être pratiquement le témoin d'un assassinat collectif, le quasi lynchage d'un étranger, d'un «Autre» (ils l'appellent l'Anderer). Les villageois vont lui demander d'écrire un rapport sur cet événement et les causes qui les ont amenés à cet acte abominable.
L'enquête de Brodeck constitue un roman construit de façon astucieuse et savante : tout est prétexte pour passer du coq à l'âne et du fil à l'aiguille. On navigue sans cesse d'un personnage à un autre, d'une époque à une autre. Sans que cela devienne confus ou embrouillé, on devine par petites touches successives le passé, la face cachée des uns et des autres, de Brodeck aussi. C'est ce qui fait tout le charme de cette lecture.
Un peu comme si l'on découvrait peu à peu les pièces d'un grand puzzle.
Un puzzle où il s'agirait de reconstituer un tableau.
Mais un tableau de Jérôme Bosch. Car c'est bien l'horreur et la noirceur que l'on découvre derrière chaque image.
Brodeck vit dans un village où le curé est devenu un ivrogne : obligé de boire pour «oublier» tout ce qu'on est venu lui confier sous le sceau du secret de la confession.
Très vite, on a bien sûr une vague idée du tableau d'ensemble et l'on se doute que le lynchage de l'Anderer cache en réalité un drame encore plus sombre, comme si l'on disposait du modèle pour notre puzzle.
Mais cela ne suffit pas à la démonstration et tout l'art de Philippe Claudel est bien de nous amener, pièce par pièce, à prendre conscience de cette mécanique infernale et sous une apparence anodine de fable philosophique, il nous entraîne au plus noir de l'âme humaine.
Si certains croyaient encore que le rire est le propre de l'homme, ils découvriront que Brodeck est d'un tout autre avis : pour lui, c'est de lâcheté qu'est pétrie l'humanité.
Ce sera peut-être notre seule contribution à l'effervescence de la rentrée littéraire et de ses innombrables sorties qui s'empilent chez les libraires.
Mais nous étions sortis frustrés de notre lecture précédente de Philippe Claudel : le Café de l'Excelsior; sa plume méritait donc une seconde chance : le rapport de Brodeck.
Bien sûr, on y retrouve les tournures savamment peaufinées qui nous avaient un peu agacés dans le Café.
Toutefois le rapport de Brodeck s'avère plus consistant et au fil des pages les effets «m'as-tu-lu» de Philippe Claudel se diluent dans une histoire prenante et oppressante.
Une histoire qui se dit intemporelle et universelle mais qui fait clairement référence à deux guerres (la deuxième avec son cortège d'exactions et d'exterminations) et à un petit pays d'Europe centrale au dialecte germanique.
À la fin de cette deuxième guerre, quand Brodeck, réchappé d'un camp, retrouve son village, c'est pour être pratiquement le témoin d'un assassinat collectif, le quasi lynchage d'un étranger, d'un «Autre» (ils l'appellent l'Anderer). Les villageois vont lui demander d'écrire un rapport sur cet événement et les causes qui les ont amenés à cet acte abominable.
L'enquête de Brodeck constitue un roman construit de façon astucieuse et savante : tout est prétexte pour passer du coq à l'âne et du fil à l'aiguille. On navigue sans cesse d'un personnage à un autre, d'une époque à une autre. Sans que cela devienne confus ou embrouillé, on devine par petites touches successives le passé, la face cachée des uns et des autres, de Brodeck aussi. C'est ce qui fait tout le charme de cette lecture.
Un peu comme si l'on découvrait peu à peu les pièces d'un grand puzzle.
Un puzzle où il s'agirait de reconstituer un tableau.
Mais un tableau de Jérôme Bosch. Car c'est bien l'horreur et la noirceur que l'on découvre derrière chaque image.
Brodeck vit dans un village où le curé est devenu un ivrogne : obligé de boire pour «oublier» tout ce qu'on est venu lui confier sous le sceau du secret de la confession.
Très vite, on a bien sûr une vague idée du tableau d'ensemble et l'on se doute que le lynchage de l'Anderer cache en réalité un drame encore plus sombre, comme si l'on disposait du modèle pour notre puzzle.
Mais cela ne suffit pas à la démonstration et tout l'art de Philippe Claudel est bien de nous amener, pièce par pièce, à prendre conscience de cette mécanique infernale et sous une apparence anodine de fable philosophique, il nous entraîne au plus noir de l'âme humaine.
Si certains croyaient encore que le rire est le propre de l'homme, ils découvriront que Brodeck est d'un tout autre avis : pour lui, c'est de lâcheté qu'est pétrie l'humanité.
On peut entrer confiant dans un livre de Claudel tous différents mais très plaisants. Celui-ci n'échappe pas à la règle c'est terrifiant mais captivant. Claudel fouille ses personnages et ses intrigues et rien n'est laissé au hasard mais est fin intelligent pour notre plus grand plaisir
Fin seconde guerre mondiale. Un petit village dont on ne connaître jamais le nom. Un homme est tué. Un étranger. Brodeck, dans son rapport, aura a écrire chaque détail qui aura mené à ce drame. Claudel joue avec les non-dits, les phrases ambigües, les sous-entendus. Tout est dit, mais rien en même temps... Claudel dissèque, analyse, dénonce l'âme humaine. Son côté noir, son côté sombre. Sans jugement, sans justification. Claudel nous dit : voici les faits et c'est tout. Ça dérange, ça ébranle, ça glace le sang. Mais ça fonctionne. Un livre qui ne s'oubliera pas facilement.
Un village près d'une frontière. Un dialecte, une langue proche de celle qui est parlée de l'autre côté de la frontière, et la langue ancienne parlée seulement par Brodeck et la vieille Fédorine qui l'a recueilli, au milieu des ruines, au milieu des morts, lorsqu'il était enfant.
Des évènements qui renvoient à la deuxième guerre mondiale, mais le récit veut être intemporel. Il apparaît, même si les personnages ont une présence physique réelle, comme une fable sur la condition humaine, un récit sur la présence du mal.
Le récit s'ouvre sur un meurtre collectif, l'Ereigniës, qui peut se traduire par « ce qui s'est passé ». Celui qui a été sacrifié, c'est l'Anderer, l'Autre, l'étranger. Brodeck, le narrateur, est chargé par le groupe, parce qu'il a fait des études, de faire le rapport de ce qui s'est passé et cette demande est comme une menace. « Je me suis simplement trouvé dans l'auberge, au mauvais moment, quelques minutes après l'Ereigniës, à ce moment de stupeur qui est un moment de bascule et d'indécision, où l'on se raccrochera au premier qui ouvrira la porte, soit pour en faire un sauveur, soit pour le tailler en pièces. »
Qui est l'Anderer ? Il arrive dans le village, quelques mois après la fin de la guerre et s'y installe sans que personne sache pourquoi . Il ne dit ni son nom ni ses intentions. Il se promène un carnet à la main et fait des croquis. La peur s'installe. On ignore qui il est et ce qu'il sait. N'est-il pas venu pour dévoiler les turpitudes de chacun ? Il est celui qui empêche l'oubli, celui qui conserve la mémoire de ce qui a été fait. Ses croquis dévoilent la réalité cachée. Sans l'oubli, impossible de continuer à vivre. Il doit donc disparaître. Il doit être sacrifié au nom de la survie collective.
« La vérité, ça peut couper les mains et laisser des entailles à ne plus pouvoir vivre avec, et la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, c'est vivre. »
L'Anderer est un double de Brodeck, étranger lui aussi et dénoncé comme tel. Revenu vivant des camps de concentration, il est un témoin qui empêche l'oubli.
La noirceur du récit est éclairée par la beauté des paysages et par la limpidité du style de Philippe Claudel. Les images et le style sont une douceur, un onguent posé sur les choses.
« La nuit avait jeté son manteau sur le village comme un roulier sa cape sur les restes de braises d'un feu de chemin ».
Un roman pour nous faire comprendre que ce n'est pas la haine mais la peur qui provoque la violence, et qu'elle sommeille en chacun, prête à se réveiller si les circonstances la favorisent. Un récit philosophique également sur la vérité et l'illusion. Un récit magnifiquement mis en images dans la BD de Manu Larcenet.
Des évènements qui renvoient à la deuxième guerre mondiale, mais le récit veut être intemporel. Il apparaît, même si les personnages ont une présence physique réelle, comme une fable sur la condition humaine, un récit sur la présence du mal.
Le récit s'ouvre sur un meurtre collectif, l'Ereigniës, qui peut se traduire par « ce qui s'est passé ». Celui qui a été sacrifié, c'est l'Anderer, l'Autre, l'étranger. Brodeck, le narrateur, est chargé par le groupe, parce qu'il a fait des études, de faire le rapport de ce qui s'est passé et cette demande est comme une menace. « Je me suis simplement trouvé dans l'auberge, au mauvais moment, quelques minutes après l'Ereigniës, à ce moment de stupeur qui est un moment de bascule et d'indécision, où l'on se raccrochera au premier qui ouvrira la porte, soit pour en faire un sauveur, soit pour le tailler en pièces. »
Qui est l'Anderer ? Il arrive dans le village, quelques mois après la fin de la guerre et s'y installe sans que personne sache pourquoi . Il ne dit ni son nom ni ses intentions. Il se promène un carnet à la main et fait des croquis. La peur s'installe. On ignore qui il est et ce qu'il sait. N'est-il pas venu pour dévoiler les turpitudes de chacun ? Il est celui qui empêche l'oubli, celui qui conserve la mémoire de ce qui a été fait. Ses croquis dévoilent la réalité cachée. Sans l'oubli, impossible de continuer à vivre. Il doit donc disparaître. Il doit être sacrifié au nom de la survie collective.
« La vérité, ça peut couper les mains et laisser des entailles à ne plus pouvoir vivre avec, et la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, c'est vivre. »
L'Anderer est un double de Brodeck, étranger lui aussi et dénoncé comme tel. Revenu vivant des camps de concentration, il est un témoin qui empêche l'oubli.
La noirceur du récit est éclairée par la beauté des paysages et par la limpidité du style de Philippe Claudel. Les images et le style sont une douceur, un onguent posé sur les choses.
« La nuit avait jeté son manteau sur le village comme un roulier sa cape sur les restes de braises d'un feu de chemin ».
Un roman pour nous faire comprendre que ce n'est pas la haine mais la peur qui provoque la violence, et qu'elle sommeille en chacun, prête à se réveiller si les circonstances la favorisent. Un récit philosophique également sur la vérité et l'illusion. Un récit magnifiquement mis en images dans la BD de Manu Larcenet.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Philippe Claudel (49)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Brodeck
Comment est surnommé l'homme qui a été assassiné?
L'Etranger
L'Anderer
Le Peintre
Le Fou
10 questions
362 lecteurs ont répondu
Thème : Le rapport de Brodeck de
Philippe ClaudelCréer un quiz sur ce livre362 lecteurs ont répondu