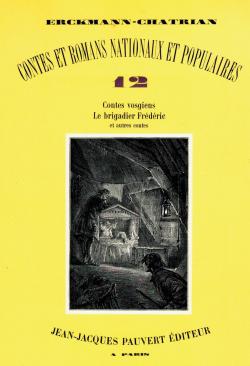Erckmann-ChatrianContes et Romans Nationaux et Po... tome 12 sur 14
550 pages
Jean-Jacques Pauvert éditeur (01/04/1963)
/5
1 notes
Jean-Jacques Pauvert éditeur (01/04/1963)
Résumé :
En 1962, en tête de sa réédition complète – quatorze volumes, belles gravures d’époque – des Contes et Romans nationaux et populaires d’Erckmann-Chatrian, Jean-Jacques Pauvert déplorait que ces textes fondateurs de L’identité républicaine aient disparu du paysage littéraire. Cette édition Pauvert, dont le dernier avatar date des années quatre-vingt-dix, est aujourd’hui introuvable, et Erckmann – Chatrian est à peu près retombé dans l’oubli.
Le Tome 12... >Voir plus
Le Tome 12... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Contes et Romans Nationaux et Populaires, tome 12Voir plus
Citations et extraits (2)
Ajouter une citation
J’ai connu dans ma jeunesse, à Sainte-Suzanne, un vieux tailleur appelé Mauduy.
Cet homme demeurait dans la ruelle des Glaneurs, près du rempart, et nous autres, jeunes garçons, en allant à l’école chez le père Berthomé, nous faisions halte à sa fenêtre, le petit sac au dos, pour le voir travailler de son état.
C’était un vieux bonhomme aux tempes chauves, les yeux gris clair, le teint légèrement vineux, et qui, les jambes croisées sur son établi, tirant le fil, ressemblait à une grenouille, tant il avait la bouche largement fendue et l’air rêveur.
De temps en temps, il s’interrompait de coudre et nous regardait, le nez et le menton en carnaval ; et comme l’établi touchait à la petite fenêtre basse, étendant la main, il nous la passait dans les cheveux en souriant.
C’est moi surtout qu’il aimait à caresser, sans doute à cause de mes cheveux blonds, longs et bouclés. Alors il me disait :
« Toi, tu es bon comme un bon mouton. Travaille bien, Antoine, écoute ce que dit M. Berthomé. Tes parents sont de braves gens. »
Il semblait attendri en disant ces choses, puis il se remettait à travailler en silence.
La petite chambre où le bonhomme croupissait ainsi depuis des années était fort sombre ; quelques vieux habits râpés, des pantalons rapiécés, des vestes graisseuses pendaient autour à leurs chevilles, et au fond, dans l’ombre, montait un petit escalier.
Il me semble encore voir ce recoin du monde, avec la traînée de lumière qui tombait de la croisée sur l’établi, toute fourmillante d’atomes et de poussière d’or.
Quelquefois, dans l’obscur réduit, apparaissait une vieille, mais si vieille, qu’on aurait dit une de ces chouettes déplumées que les paysans clouent sur leurs portes de grange pour écarter, par la crainte du même sort, les oiseaux de proie rôdant autour des poulaillers.
C’était la vieille Jacqueline, la mère de Mauduy, qu’il entretenait de son travail.
Elle n’avait qu’un bavolet et une vieille robe à grands ramages, qui datait pour le moins de la République ou de Louis XVI. Elle s’asseyait sur la dernière marche de l’escalier, la tête branlante et parlant toute seule. Sa figure blanche brillait au fond de l’alcôve, et ses cheveux retombaient sur ses épaules comme du lin.
Mauduy, lorsqu’elle venait ainsi, la regardait d’un œil presque tendre et lui disait :
« Mère, approchez-vous de ce côté, près du soleil, vous aurez plus chaud ; tenez, là, devant moi. »
Et, descendant de la table, il poussait un antique fauteuil à crémaillère au pied de l’établi, aidait la pauvre vieille à se lever et l’installait gravement dans son coin, disant tout bas :
« Êtes-vous bien comme ça ? Faut-il que je mette un coussin, quelque chose derrière, pour vous soutenir ?
— Non, Baptiste, je suis bien, » faisait-elle.
Alors, tout joyeux, il remontait sur la table croisait ses jambes et poursuivait son ouvrage, bien heureux de sentir là sa vieille mère qui se réchauffait.
Il lui arrivait aussi quelquefois de siffler de vieux airs, mais si bas qu’on l’entendait à peine ; et, dès que la vieille se mettait à prier, il se taisait pour ne pas l’interrompre, devenant plus sérieux encore.
Nous autres écoliers, au premier son de cloche, nous courions à l’école, criant :
« Bonjour, père Mauduy, bonjour ! »
Il levait alors ses yeux gris et nous regardait jusqu’à ce que nous eussions disparu dans la petite allée de M. Berthomé ; puis il se remettait à coudre.
L’après-midi s’écoulait lentement, tantôt chaude, tantôt pluvieuse ; à cinq heures, nous repassions, voyant toujours le vieux tailleur à la même place, qui tirait son aiguille et rêvait à je ne sais quoi.
Je me rappelle aussi qu’on appelait le père Mauduy, le Vendéen, et que des personnes soi-disant pieuses l’accusaient d’avoir commis des horreurs en Vendée, d’avoir tué des femmes, des enfants, etc.
Mais je n’ai jamais pu le croire, car les personnes qui répandaient ces mauvais bruits étaient de vieilles pécheresses, « des malheureuses », comme le répétait souvent mon père, Jean Flamel, quincaillier dans la rue des Minimes ; il se rappelait les avoir vues, au temps de la République, sur le char de la Liberté, représentant la déesse Raison, et disait que ces honnêtes personnes, revenues à notre sainte religion et pleines de repentance de leurs anciens égarements, croyaient se relever en reprochant à d’autres plus de fautes et d’abominations qu’elles n’en avaient commises elles-mêmes. La seule chose vraie de tout cela, c’est que Mauduy était parti comme volontaire en 92, qu’il avait fait les campagnes de Mayence, de Vendée, d’Italie et d’Égypte, et qu’après le coup de Brumaire, pouvant entrer dans la garde consulaire, il avait mieux aimé reprendre son état de tailleur que de servir Bonaparte.
Voilà ce que disait mon père, auquel j’accorde pour la vérité, le bon sens et la justice, plus de confiance qu’à toute cette race ensemble.
Ainsi se passèrent les années 1816 à 1820, époque où mes parents, voyant que je savais tout ce que M. Berthomé pouvait m’apprendre : un peu d’orthographe, un peu d’arithmétique et le catéchisme, pensèrent qu’il était temps de me faire voir le monde.
Mon père, se rappelant qu’il avait un vieux camarade, Joseph Lebigre, établi comme quincaillier depuis vingt-cinq ans, rue Saint-Martin, à Paris, m’envoya chez lui compléter mon instruction.
M. Lebigre me reçut très bien et m’employa d’abord dans son magasin ; puis il me chargea du placement de ses marchandises ; et en 1824, l’année même du couronnement de Charles X, mon père, déjà vieux, me céda son commerce. J’épousai Mlle Joséphine, la fille cadette de M. Lebigre, et je vins m’établir pour mon propre compte à Sainte-Suzanne.
Cet homme demeurait dans la ruelle des Glaneurs, près du rempart, et nous autres, jeunes garçons, en allant à l’école chez le père Berthomé, nous faisions halte à sa fenêtre, le petit sac au dos, pour le voir travailler de son état.
C’était un vieux bonhomme aux tempes chauves, les yeux gris clair, le teint légèrement vineux, et qui, les jambes croisées sur son établi, tirant le fil, ressemblait à une grenouille, tant il avait la bouche largement fendue et l’air rêveur.
De temps en temps, il s’interrompait de coudre et nous regardait, le nez et le menton en carnaval ; et comme l’établi touchait à la petite fenêtre basse, étendant la main, il nous la passait dans les cheveux en souriant.
C’est moi surtout qu’il aimait à caresser, sans doute à cause de mes cheveux blonds, longs et bouclés. Alors il me disait :
« Toi, tu es bon comme un bon mouton. Travaille bien, Antoine, écoute ce que dit M. Berthomé. Tes parents sont de braves gens. »
Il semblait attendri en disant ces choses, puis il se remettait à travailler en silence.
La petite chambre où le bonhomme croupissait ainsi depuis des années était fort sombre ; quelques vieux habits râpés, des pantalons rapiécés, des vestes graisseuses pendaient autour à leurs chevilles, et au fond, dans l’ombre, montait un petit escalier.
Il me semble encore voir ce recoin du monde, avec la traînée de lumière qui tombait de la croisée sur l’établi, toute fourmillante d’atomes et de poussière d’or.
Quelquefois, dans l’obscur réduit, apparaissait une vieille, mais si vieille, qu’on aurait dit une de ces chouettes déplumées que les paysans clouent sur leurs portes de grange pour écarter, par la crainte du même sort, les oiseaux de proie rôdant autour des poulaillers.
C’était la vieille Jacqueline, la mère de Mauduy, qu’il entretenait de son travail.
Elle n’avait qu’un bavolet et une vieille robe à grands ramages, qui datait pour le moins de la République ou de Louis XVI. Elle s’asseyait sur la dernière marche de l’escalier, la tête branlante et parlant toute seule. Sa figure blanche brillait au fond de l’alcôve, et ses cheveux retombaient sur ses épaules comme du lin.
Mauduy, lorsqu’elle venait ainsi, la regardait d’un œil presque tendre et lui disait :
« Mère, approchez-vous de ce côté, près du soleil, vous aurez plus chaud ; tenez, là, devant moi. »
Et, descendant de la table, il poussait un antique fauteuil à crémaillère au pied de l’établi, aidait la pauvre vieille à se lever et l’installait gravement dans son coin, disant tout bas :
« Êtes-vous bien comme ça ? Faut-il que je mette un coussin, quelque chose derrière, pour vous soutenir ?
— Non, Baptiste, je suis bien, » faisait-elle.
Alors, tout joyeux, il remontait sur la table croisait ses jambes et poursuivait son ouvrage, bien heureux de sentir là sa vieille mère qui se réchauffait.
Il lui arrivait aussi quelquefois de siffler de vieux airs, mais si bas qu’on l’entendait à peine ; et, dès que la vieille se mettait à prier, il se taisait pour ne pas l’interrompre, devenant plus sérieux encore.
Nous autres écoliers, au premier son de cloche, nous courions à l’école, criant :
« Bonjour, père Mauduy, bonjour ! »
Il levait alors ses yeux gris et nous regardait jusqu’à ce que nous eussions disparu dans la petite allée de M. Berthomé ; puis il se remettait à coudre.
L’après-midi s’écoulait lentement, tantôt chaude, tantôt pluvieuse ; à cinq heures, nous repassions, voyant toujours le vieux tailleur à la même place, qui tirait son aiguille et rêvait à je ne sais quoi.
Je me rappelle aussi qu’on appelait le père Mauduy, le Vendéen, et que des personnes soi-disant pieuses l’accusaient d’avoir commis des horreurs en Vendée, d’avoir tué des femmes, des enfants, etc.
Mais je n’ai jamais pu le croire, car les personnes qui répandaient ces mauvais bruits étaient de vieilles pécheresses, « des malheureuses », comme le répétait souvent mon père, Jean Flamel, quincaillier dans la rue des Minimes ; il se rappelait les avoir vues, au temps de la République, sur le char de la Liberté, représentant la déesse Raison, et disait que ces honnêtes personnes, revenues à notre sainte religion et pleines de repentance de leurs anciens égarements, croyaient se relever en reprochant à d’autres plus de fautes et d’abominations qu’elles n’en avaient commises elles-mêmes. La seule chose vraie de tout cela, c’est que Mauduy était parti comme volontaire en 92, qu’il avait fait les campagnes de Mayence, de Vendée, d’Italie et d’Égypte, et qu’après le coup de Brumaire, pouvant entrer dans la garde consulaire, il avait mieux aimé reprendre son état de tailleur que de servir Bonaparte.
Voilà ce que disait mon père, auquel j’accorde pour la vérité, le bon sens et la justice, plus de confiance qu’à toute cette race ensemble.
Ainsi se passèrent les années 1816 à 1820, époque où mes parents, voyant que je savais tout ce que M. Berthomé pouvait m’apprendre : un peu d’orthographe, un peu d’arithmétique et le catéchisme, pensèrent qu’il était temps de me faire voir le monde.
Mon père, se rappelant qu’il avait un vieux camarade, Joseph Lebigre, établi comme quincaillier depuis vingt-cinq ans, rue Saint-Martin, à Paris, m’envoya chez lui compléter mon instruction.
M. Lebigre me reçut très bien et m’employa d’abord dans son magasin ; puis il me chargea du placement de ses marchandises ; et en 1824, l’année même du couronnement de Charles X, mon père, déjà vieux, me céda son commerce. J’épousai Mlle Joséphine, la fille cadette de M. Lebigre, et je vins m’établir pour mon propre compte à Sainte-Suzanne.
Tu sais, Georges, ce que vaut une vache pour nous autres paysans; avec une vache à l'étable, on a du lait, du beurre, du fromage, tout le nécessaire de la vie; une vache c'est l'aisance, deux c'est presque la richesse. Jusqu'alors nous avions pu vendre et faire ainsi quelques sous; maintenant il allait falloir tout acheter dans ces temps de disette, où l'ennemi s'engraissait de notre misère.
Ah! quel affreux passage!... Ceux qui viendront après nous ne s'en feront pas même une idée.
Ah! quel affreux passage!... Ceux qui viendront après nous ne s'en feront pas même une idée.
Video de Erckmann-Chatrian (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Erckmann et Chatrian : Gens d'Alsace et de Lorraine
Olivier BARROT signale la publication aux Presses de la Cité (collection Omnibus) de "Gens d'Alsace et de Lorraine" d'ERCKMANN-CHATRIAN. Ce gros ouvrage rassemble six des Romans et Contes des deux célèbres Alsaciens.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Erckmann-Chatrian (94)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Vous avez dit Erckmann ? Non, Chatrian !
Bonjour, moi c'est Emile
Erckmann
Chatrian
12 questions
9 lecteurs ont répondu
Thème :
Erckmann-ChatrianCréer un quiz sur ce livre9 lecteurs ont répondu