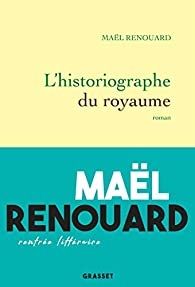Critiques filtrées sur 3 étoiles
Le dernier roman de la deuxième sélection du prix Goncourt 2020 que je lis et j'avoue que j'ai bien aimé mais sans plus. Il est vrai que nous sommes plongés au coeur du royaume chérifien du Maroc à travers la vie du conseiller du roi marocain pour mettre en scène les différentes interrogations sur les grâces et les disgrâces que procure le pouvoir.
Une belle écriture avec une histoire intéressante même si j'ai trouvé que ça manquait un peu de fluidité et le rythme était lent mais je pense que c'est normal pour un livre qui nous livre une réflexion profonde sur les logiques du pouvoir.
Une belle écriture avec une histoire intéressante même si j'ai trouvé que ça manquait un peu de fluidité et le rythme était lent mais je pense que c'est normal pour un livre qui nous livre une réflexion profonde sur les logiques du pouvoir.
Abderrahamane Eljarib a côtoyé le futur roi du Maroc Hassan II au collège royal dans les années 1950 et les liens de collégien qu'il a noué avec lui, lui ont permis de rester plus tard dans sa sphère d'influence. Ce roman illustre la difficulté de trouver sa place auprès d'un monarque tout puissant qui peut, selon son humeur favoriser ou casser une vie.
Cette histoire, se place principalement au Maroc dans le contexte du règne de Hassan II et s'appuie sans doute sur quelques éléments réels, mais également en France et en Iran. de nombreuses références historiques et littéraires jalonnent la narration de façon érudite et on découvre les historiographes de Louis XIV et louis XV, les contes des mille et une nuit, Saint Simon, Sartre… Une fiction qui ressemble étonnamment à un récit, une illusion réussie mais un peu austère !
Cette histoire, se place principalement au Maroc dans le contexte du règne de Hassan II et s'appuie sans doute sur quelques éléments réels, mais également en France et en Iran. de nombreuses références historiques et littéraires jalonnent la narration de façon érudite et on découvre les historiographes de Louis XIV et louis XV, les contes des mille et une nuit, Saint Simon, Sartre… Une fiction qui ressemble étonnamment à un récit, une illusion réussie mais un peu austère !
L'historiographe du royaume
Maël Renouard
roman, Grasset, 2020, 330p
C'est l'histoire d'Abderrahmane Eljarib, né et mort la même année que le roi du Maroc, Hassan II (1929-1979), amateur de golf, qu'il avait accompagné, bien qu'issu d'un milieu très modeste, dans sa scolarité au Collège Royal, sis dans l'enceinte du Palais royal à Rabat, parce qu'il était un très bon élève, et que le roi se souciait de diversité sociale. Il était alors âgé de 15 ans, avait de très bons résultats scolaires, jouait très bien aux échecs, et surpassait donc le futur roi. Il pouvait ainsi faire figure de rival. Les deux élèves avaient un professeur d'histoire, M.Delhaye, un ancien de l'Ecole Normale, de la promotion de Georges Pompidou très doué pour les études, qui ouvrait l'esprit de ses élèves. le futur roi avait beaucoup de goût pour l'histoire. le narrateur, Abderrahmane, montre qu'il faut savoir composer avec Hassan, qui joue avec son entourage au jeu très cruel de distribution arbitraire de grâce et de disgrâce.
Abderrahmane, par la grâce du roi, poursuit ses études à Paris. Il rencontre Sartre. Il écrit, notamment un recueil de poèmes, Elégies barbaresques, qu'il adresse à Senghor, qu'il aura l'occasion de rencontrer. Rencontre des plus superficielles.
Sans savoir pourquoi, Abderrahmane est relégué dans la petite ville quasiment déserte de Tarfaya, proche des Canaries, et connue pour avoir été une escale de l'Aéropostale, avec pour mission d'y installer une université, une fois que les territoires légitimes auront été restitués par les Espagnols. Ces derniers restent indifférents, et Abderrahmane se résigne à l'absurdité de sa mission qui dure 7 longs ans.
Mais voici que le roi le convoque au Palais ; il le fait attendre toute une après-midi, et ne le reçoit pas ; le lendemain, il lui octroie la charge d'historiographe du royaume. Des historiographes, il y en eut d'illustres en France, comme Racine et Boileau au XVII°, et Voltaire au XVIII° sous Louis XV, mais ce sont des historiographes du roi. C'est une charge qui tient de la complaisance, et offre une pension aux écrivains qui useraient mieux de leur temps en écrivant qu'en se traînant sur des champs de bataille pour être témoins des hauts faits du roi. Parmi les historiographes obscurs, on trouve un certain Nicolas Renouard. Cette fonction est bien typique de la France et de son intérêt pour la distinction, intérêt porté au plus haut par Saint-Simon, qui représente la quintessence du style classique au tournant du XVIII°.
Cependant l'historiographe est aussi chargé des affaires culturelles, et à ce titre, Abderrahmane doit étudier s'il y a lieu de célébrer les trois cents ans du règne de 55 ans de Moulay Ismaël, un despote sanguinaire, dont le père est le premier à fonder la dynastie alaouite. Moulay Ismaël est comme un jumeau de Louis XIV pour son charisme et son autorité. Paul Pellisson, qui pourrait être un double d'Abderrahmane, est un des historiographes de Louis XIV. Ce dernier l'a fait sortir de la Bastille où il était emprisonné pour avoir servi Fouquet, et l'a nommé historiographe, parce qu'il était un « homme très savant et très éloquent » aux dires De Voltaire qui ne lui reconnaissait pas de qualités littéraires. Abderrahmane s'établit à Meknès, dont Moulay Ismaël a fait sa capitale, pour parachever ses connaissances sur ce monarque absolu. Il y rencontre Morgiane, issue d'une très grande famille, qui milite contre la corruption des grands et la misère, de qui il s'éprend. Celle-ci lui reproche d'être loyal envers le roi et le fait qu'il avait sauvé ce dernier lors d'un attentat en prenant son identité, au lieu d'en profiter pour se débarrasser de lui, idée qui avait parcouru fugitivement l'esprit d'Abderrahmane. Il assiste ensuite aux festivités de Persépolis en l'honneur de la fondation de l'empire perse vieux de 2500 ans. Mais le roi, sur les conseils du général Oukfir, qui n'aime pas les poètes comme Eljarib, décide de ne pas donner suite à son projet de célébration du règne de Moulay Ismaël.
Abderrahmane apprend l'attentat dont a été victime le roi. Oukfir serait le traître. Un journaliste marocain dit que de toute façon tous les membres de l'entourage du roi ont un pied dedans, un pied dehors. Cependant, le roi le fait mander. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'il prenne femme. Et il lui donne comme épouse Latifa, alias Morgiane. Quel rôle avait-elle donc joué ? Espionne pour le compte du roi ?
On retrouve trois décennies plus tard Abderrahmane à Paris, directeur-adjoint de l'Institut Arabe. Il remet à une jeune normalienne, la narratrice de l 'épilogue, son manuscrit qu'elle ne doit lire qu'après sa mort. Cette dernière l'oublie. Elle le retrouve par hasard alors qu'elle recherche les notes qu'elle avait prises sur Saint-Simon et Les Mille et une nuits dans l'édition de Galland. Abderrahmane lui avait dit que Saint-Simon était un baroque attardé. Elle apprend qu'Abderrahmane est mort en 1999, comme Hassan, et qu'il avait commis l'erreur d'une plaisanterie en se disant le jumeau hétérozygote du roi. Tiens, tiens, le « vieux maître »Delhaye -et l'emploi du mot maître et sa double acception embarrasse le professeur et son ex-disciple un moment, et arrête le lecteur qui verra d'autres significations à cet emploi- à qui Abderrahmane avait conté que vêtu d'un complet il s'était fait passer pour le roi qui se trouvait en tenue très décontractée, alors que les deux hommes ne se ressemblent guère, d'où l'expression de jumeau, parce que Delhaye pensait qu'il était né le même jour que le roi, hétérozygote, serait un mouchard du roi ? Et au fait, comment est mort Abderrahmane ? Quelle valeur alors prend son manuscrit ?
C'est un livre qui mêle des personnages historiques et de fiction. L'ouvrage est très documenté, voire érudit, et n'attirera pas donc tous les lecteurs. On y trouve des passages intéressants, le règne de Moulay Ismaël, l'histoire de Pellisson, le désert de Tarfaya, les fêtes de Persépolis, on y rencontre des personnages connus, on y voit Hassan et comment on se tient à sa cour, jusqu'à quel point on veut complaire au roi, comment on lui manifeste son obéissance et sa fidélité en l'embrassant sur le dos puis la paume de la main, et en approchant sa joue et son front de celle-ci ; la cour est un lieu d'intrigues et on ne sait jamais qui travaille pour qui ou pour quoi. Abderrahmane est un personnage trop passif pour être attachant, qui est sûr de sa supériorité intellectuelle, à l'image de l'auteur, ce qui parfois le perd quand il parle trop pour faire valoir son savoir. Cependant, il sait faire preuve d'auto-dérision, et tant mieux car l'auteur fait de l'historiographe du royaume quelqu'un dont l'entourage ami, aimé, est à la solde du roi. de plus, le choix d'un style classique, ou d'historiographe du roi, ou d'élève de l'ENS, qui serait un double du Collèg Royal, ralentit le rythme, et lui donne une tenue qui interdit les écarts. du coup, le livre plaît mais davantage à l'esprit qu'au coeur à qui les classiques ne donnent pas la première place. Peut-être celui de Saint-Simon eût-il davantage convenu.
Maël Renouard est né à Paris, en 79. Normalien, agrégé de philosophie. Il enseigne, traduit les oeuvres des philosophes allemands, s'occupe de cinéma. C'est une des anciennes plumes de Fillon.
Maël Renouard
roman, Grasset, 2020, 330p
C'est l'histoire d'Abderrahmane Eljarib, né et mort la même année que le roi du Maroc, Hassan II (1929-1979), amateur de golf, qu'il avait accompagné, bien qu'issu d'un milieu très modeste, dans sa scolarité au Collège Royal, sis dans l'enceinte du Palais royal à Rabat, parce qu'il était un très bon élève, et que le roi se souciait de diversité sociale. Il était alors âgé de 15 ans, avait de très bons résultats scolaires, jouait très bien aux échecs, et surpassait donc le futur roi. Il pouvait ainsi faire figure de rival. Les deux élèves avaient un professeur d'histoire, M.Delhaye, un ancien de l'Ecole Normale, de la promotion de Georges Pompidou très doué pour les études, qui ouvrait l'esprit de ses élèves. le futur roi avait beaucoup de goût pour l'histoire. le narrateur, Abderrahmane, montre qu'il faut savoir composer avec Hassan, qui joue avec son entourage au jeu très cruel de distribution arbitraire de grâce et de disgrâce.
Abderrahmane, par la grâce du roi, poursuit ses études à Paris. Il rencontre Sartre. Il écrit, notamment un recueil de poèmes, Elégies barbaresques, qu'il adresse à Senghor, qu'il aura l'occasion de rencontrer. Rencontre des plus superficielles.
Sans savoir pourquoi, Abderrahmane est relégué dans la petite ville quasiment déserte de Tarfaya, proche des Canaries, et connue pour avoir été une escale de l'Aéropostale, avec pour mission d'y installer une université, une fois que les territoires légitimes auront été restitués par les Espagnols. Ces derniers restent indifférents, et Abderrahmane se résigne à l'absurdité de sa mission qui dure 7 longs ans.
Mais voici que le roi le convoque au Palais ; il le fait attendre toute une après-midi, et ne le reçoit pas ; le lendemain, il lui octroie la charge d'historiographe du royaume. Des historiographes, il y en eut d'illustres en France, comme Racine et Boileau au XVII°, et Voltaire au XVIII° sous Louis XV, mais ce sont des historiographes du roi. C'est une charge qui tient de la complaisance, et offre une pension aux écrivains qui useraient mieux de leur temps en écrivant qu'en se traînant sur des champs de bataille pour être témoins des hauts faits du roi. Parmi les historiographes obscurs, on trouve un certain Nicolas Renouard. Cette fonction est bien typique de la France et de son intérêt pour la distinction, intérêt porté au plus haut par Saint-Simon, qui représente la quintessence du style classique au tournant du XVIII°.
Cependant l'historiographe est aussi chargé des affaires culturelles, et à ce titre, Abderrahmane doit étudier s'il y a lieu de célébrer les trois cents ans du règne de 55 ans de Moulay Ismaël, un despote sanguinaire, dont le père est le premier à fonder la dynastie alaouite. Moulay Ismaël est comme un jumeau de Louis XIV pour son charisme et son autorité. Paul Pellisson, qui pourrait être un double d'Abderrahmane, est un des historiographes de Louis XIV. Ce dernier l'a fait sortir de la Bastille où il était emprisonné pour avoir servi Fouquet, et l'a nommé historiographe, parce qu'il était un « homme très savant et très éloquent » aux dires De Voltaire qui ne lui reconnaissait pas de qualités littéraires. Abderrahmane s'établit à Meknès, dont Moulay Ismaël a fait sa capitale, pour parachever ses connaissances sur ce monarque absolu. Il y rencontre Morgiane, issue d'une très grande famille, qui milite contre la corruption des grands et la misère, de qui il s'éprend. Celle-ci lui reproche d'être loyal envers le roi et le fait qu'il avait sauvé ce dernier lors d'un attentat en prenant son identité, au lieu d'en profiter pour se débarrasser de lui, idée qui avait parcouru fugitivement l'esprit d'Abderrahmane. Il assiste ensuite aux festivités de Persépolis en l'honneur de la fondation de l'empire perse vieux de 2500 ans. Mais le roi, sur les conseils du général Oukfir, qui n'aime pas les poètes comme Eljarib, décide de ne pas donner suite à son projet de célébration du règne de Moulay Ismaël.
Abderrahmane apprend l'attentat dont a été victime le roi. Oukfir serait le traître. Un journaliste marocain dit que de toute façon tous les membres de l'entourage du roi ont un pied dedans, un pied dehors. Cependant, le roi le fait mander. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'il prenne femme. Et il lui donne comme épouse Latifa, alias Morgiane. Quel rôle avait-elle donc joué ? Espionne pour le compte du roi ?
On retrouve trois décennies plus tard Abderrahmane à Paris, directeur-adjoint de l'Institut Arabe. Il remet à une jeune normalienne, la narratrice de l 'épilogue, son manuscrit qu'elle ne doit lire qu'après sa mort. Cette dernière l'oublie. Elle le retrouve par hasard alors qu'elle recherche les notes qu'elle avait prises sur Saint-Simon et Les Mille et une nuits dans l'édition de Galland. Abderrahmane lui avait dit que Saint-Simon était un baroque attardé. Elle apprend qu'Abderrahmane est mort en 1999, comme Hassan, et qu'il avait commis l'erreur d'une plaisanterie en se disant le jumeau hétérozygote du roi. Tiens, tiens, le « vieux maître »Delhaye -et l'emploi du mot maître et sa double acception embarrasse le professeur et son ex-disciple un moment, et arrête le lecteur qui verra d'autres significations à cet emploi- à qui Abderrahmane avait conté que vêtu d'un complet il s'était fait passer pour le roi qui se trouvait en tenue très décontractée, alors que les deux hommes ne se ressemblent guère, d'où l'expression de jumeau, parce que Delhaye pensait qu'il était né le même jour que le roi, hétérozygote, serait un mouchard du roi ? Et au fait, comment est mort Abderrahmane ? Quelle valeur alors prend son manuscrit ?
C'est un livre qui mêle des personnages historiques et de fiction. L'ouvrage est très documenté, voire érudit, et n'attirera pas donc tous les lecteurs. On y trouve des passages intéressants, le règne de Moulay Ismaël, l'histoire de Pellisson, le désert de Tarfaya, les fêtes de Persépolis, on y rencontre des personnages connus, on y voit Hassan et comment on se tient à sa cour, jusqu'à quel point on veut complaire au roi, comment on lui manifeste son obéissance et sa fidélité en l'embrassant sur le dos puis la paume de la main, et en approchant sa joue et son front de celle-ci ; la cour est un lieu d'intrigues et on ne sait jamais qui travaille pour qui ou pour quoi. Abderrahmane est un personnage trop passif pour être attachant, qui est sûr de sa supériorité intellectuelle, à l'image de l'auteur, ce qui parfois le perd quand il parle trop pour faire valoir son savoir. Cependant, il sait faire preuve d'auto-dérision, et tant mieux car l'auteur fait de l'historiographe du royaume quelqu'un dont l'entourage ami, aimé, est à la solde du roi. de plus, le choix d'un style classique, ou d'historiographe du roi, ou d'élève de l'ENS, qui serait un double du Collèg Royal, ralentit le rythme, et lui donne une tenue qui interdit les écarts. du coup, le livre plaît mais davantage à l'esprit qu'au coeur à qui les classiques ne donnent pas la première place. Peut-être celui de Saint-Simon eût-il davantage convenu.
Maël Renouard est né à Paris, en 79. Normalien, agrégé de philosophie. Il enseigne, traduit les oeuvres des philosophes allemands, s'occupe de cinéma. C'est une des anciennes plumes de Fillon.
Abderrahmane Eljarib est choisi pour faire partie d'une cohorte très sélecte d'élèves qui étudiera auprès d'Hassan II, futur roi du Maroc, au collège royal.
Cette chance pour cet excellent élève issu d'une famille très pauvre n'est pas forcément un atout. Il est très difficile de savoir se positionner entre flatterie et indépendance d'esprit. Abderrahmane en fera les frais dès les premières parties d'échecs avec Hassan et passera sa vie entre grâce et disgrâce, rongé par ce qu'il est bon de dire et n'aurait pas dû dire.
Il sera tantôt exilé à l'autre bout du royaume, tantôt rappelé à cour du roi, mais chargé de missions diplomatiquement périlleuses en tant qu'historiographe. Historiographe du royaume, mais pas du roi. Où est la frontière ?
On appréciera le style suranné qu'utilise l'auteur en se glissant dans la peau de ce héros d'après-guerre. Un héros soumis au bon vouloir de son souverain, en proie au doute permanent, n'existant que par ce qu'on voudra faire de lui.
Et c'est là que le bât blesse. Comment s'attacher à un personnage qui au lieu d'être séduisant par son intelligence devient médiocre par sa dépendance et sa soumission? On apprend certes beaucoup sur l'histoire du Maroc, ou sur les relations franco-marocaines depuis Louis XIV, mais j'avais hâte de finir ce livre, dont l'histoire m'a laissée en marge.
Lien : https://carpentersracontent...
Cette chance pour cet excellent élève issu d'une famille très pauvre n'est pas forcément un atout. Il est très difficile de savoir se positionner entre flatterie et indépendance d'esprit. Abderrahmane en fera les frais dès les premières parties d'échecs avec Hassan et passera sa vie entre grâce et disgrâce, rongé par ce qu'il est bon de dire et n'aurait pas dû dire.
Il sera tantôt exilé à l'autre bout du royaume, tantôt rappelé à cour du roi, mais chargé de missions diplomatiquement périlleuses en tant qu'historiographe. Historiographe du royaume, mais pas du roi. Où est la frontière ?
On appréciera le style suranné qu'utilise l'auteur en se glissant dans la peau de ce héros d'après-guerre. Un héros soumis au bon vouloir de son souverain, en proie au doute permanent, n'existant que par ce qu'on voudra faire de lui.
Et c'est là que le bât blesse. Comment s'attacher à un personnage qui au lieu d'être séduisant par son intelligence devient médiocre par sa dépendance et sa soumission? On apprend certes beaucoup sur l'histoire du Maroc, ou sur les relations franco-marocaines depuis Louis XIV, mais j'avais hâte de finir ce livre, dont l'histoire m'a laissée en marge.
Lien : https://carpentersracontent...
Un moment l'idée de le commenter à la Olivier Véran (tester-tracer-isoler devenu tester-tracer-protéger ou le récent accélérer-amplifier-simplifier ; que dit-il le soir dans le lit conjugal à son épouse ?) m'effleura mais devant l'ampleur de la réflexion demandée …
Le royaume est celui du Maroc, entre la fin du protectorat et 1972 (attentat contre le Boeing royal), le narrateur, fils d'instituteur, fut choisi par X, grâce, pour intégrer et poursuivre sa scolarité au collège royal avec feu sa Majesté Hassan II ; après sept ans, disgrâce, dans les limbes à Tarfaya, avant que le Sahara Occidental ne se retrouve, de fait province marocaine en novembre 1975, le narrateur se voit nommé, grâce, par décret « historiographe du royaume » ; Hassan II, comme beaucoup de dirigeant.e.s – et là je pense à notre cher président élu en 2017 sur du vent –, désirant s'inscrire dans l'Histoire, pour cela il est nécessaire d'écrire un « roman national », d'éluder des faits et d'en illuminer d'autres même minces (Eric Laurent contribua en 1993, « Hassan II, la mémoire d'un Roi » à cette mascarade historique, je possède également une édifiante BD « Il était une fois … HASSAN II » de 1977) ; l'historiographe sera chargé, en particulier, de réfléchir aux trois cents ans du début du règne de Moulay Ismaïl (1672-1727) et pour cela il se rendra à Persépolis admirer le spectacle grandiose du Shah d'Iran – Iannis Xenakis y créa des oeuvres magistrales avec quand même des controverses ; en 1972 Hassan II qui échappe pour la deuxième fois en un an à un régicide intègre, grâce, le narrateur à son équipe de conseillers après lui avoir arrangé un mariage, grâce/disgrâce ; Mohammed VI qui succède à son père fin juillet 1999 l'enverra à Paris à l'institut du monde arabe, disgrâce.
Un livre « solidement documenté » comme on dit aujourd'hui, l'utilisation par l'auteur de « feu sa Majesté », expression en usage dans tous les médias marocains pour évoquer un roi défunt montre que Maël Renouard par ses lectures a assimilé (au sens digestif du terme, faire du « soi » avec la nourriture ingérée) le rôle donné au narrateur ; le passage sur l'attentat de Skhirat en 1971 ressemble terriblement à ce qu'évoque Jacques Benoist-Méchin dans « deux étés africains » paru en 1972, mais là aussi il y assimilation ; un livre sans dédicace, remerciements et sources consultées, ce qui en fait un véritable roman qui même pour ceux qui possèdent une connaissance superficielle de l'histoire marocaine liront avec plaisir, découvrant peut-être que les caprices d'un roi font et défont des vies en un claquement de doigts, que grâce et disgrâce ressemblent aux deux faces d'une même pièce envoyée en l'air par un facétieux. L'auteur écrit « Hassan II parlait par énigmes, un peu comme François Mitterrand », pourtant Hassan II et Mitterrand se détestaient, peut-être parce qu'ils possédaient tous les deux des jardins secrets nauséabonds, tortures quotidiennes et bagnes mouroirs pour le premier, relations amicales assumées avec d'anciens miliciens voire gestapistes pour le deuxième.
Maël Renouard définit lui-même son style – peu avant le dernier chapitre où le narrateur s'efface pour laisser parler une jeune femme rédigeant un travail universitaire sur Saint-Simon, Proust, les Contes des mille et une nuits, jeune femme à laquelle le narrateur confie son manuscrit (le livre de Renouard) dans une enveloppe à ouvrir après sa mort – ainsi, « français précis et contourné, d'un classicisme insensible aux modes langagières de notre époque » ; passé simple et imparfait du subjonctif, phrases à rallonges abondent, le tout demandant une lecture attentive et paradoxalement pas de phrases ou de paragraphes qui nous bouleverseraient, relus avec avidité, notés, archivés quelque part. Comme Olivier Véran, l'auteur assume son écriture, admirateur probable de Proust, Saint-Simon, des hyper-classiques.
Aujourd'hui, on pourrait penser qu'avec Internet, ce rôle d'historiographe du royaume, au Maroc, est désuet ; non, cette fonction officielle institutionnalisée en 1961 par Hassan II est occupée par Abdelhak El Merini ou Lamrini ou Lemrini depuis 2010. Pierre Vermeren dans un livre « Le Maroc, un royaume de paradoxes, en 100 questions, 2020 » évoque les officines, comme le site 360ma, sur Internet prenant en partie le relais de cette fonction d'historiographe, relais fortement appuyé par quelques auteurs français comme Aymeric Chauprade (Géopolitique d'un Roi, 2019), Charles Saint-Prot ou Jean-Claude Martinez dont le livre « Le Roi stabilisateur » (2015) en tête de gondole à l'entrée des supermarchés marocains se vendait dix fois moins cher qu'en France.
(printemps 2021 modifié en janvier 2024)
Le royaume est celui du Maroc, entre la fin du protectorat et 1972 (attentat contre le Boeing royal), le narrateur, fils d'instituteur, fut choisi par X, grâce, pour intégrer et poursuivre sa scolarité au collège royal avec feu sa Majesté Hassan II ; après sept ans, disgrâce, dans les limbes à Tarfaya, avant que le Sahara Occidental ne se retrouve, de fait province marocaine en novembre 1975, le narrateur se voit nommé, grâce, par décret « historiographe du royaume » ; Hassan II, comme beaucoup de dirigeant.e.s – et là je pense à notre cher président élu en 2017 sur du vent –, désirant s'inscrire dans l'Histoire, pour cela il est nécessaire d'écrire un « roman national », d'éluder des faits et d'en illuminer d'autres même minces (Eric Laurent contribua en 1993, « Hassan II, la mémoire d'un Roi » à cette mascarade historique, je possède également une édifiante BD « Il était une fois … HASSAN II » de 1977) ; l'historiographe sera chargé, en particulier, de réfléchir aux trois cents ans du début du règne de Moulay Ismaïl (1672-1727) et pour cela il se rendra à Persépolis admirer le spectacle grandiose du Shah d'Iran – Iannis Xenakis y créa des oeuvres magistrales avec quand même des controverses ; en 1972 Hassan II qui échappe pour la deuxième fois en un an à un régicide intègre, grâce, le narrateur à son équipe de conseillers après lui avoir arrangé un mariage, grâce/disgrâce ; Mohammed VI qui succède à son père fin juillet 1999 l'enverra à Paris à l'institut du monde arabe, disgrâce.
Un livre « solidement documenté » comme on dit aujourd'hui, l'utilisation par l'auteur de « feu sa Majesté », expression en usage dans tous les médias marocains pour évoquer un roi défunt montre que Maël Renouard par ses lectures a assimilé (au sens digestif du terme, faire du « soi » avec la nourriture ingérée) le rôle donné au narrateur ; le passage sur l'attentat de Skhirat en 1971 ressemble terriblement à ce qu'évoque Jacques Benoist-Méchin dans « deux étés africains » paru en 1972, mais là aussi il y assimilation ; un livre sans dédicace, remerciements et sources consultées, ce qui en fait un véritable roman qui même pour ceux qui possèdent une connaissance superficielle de l'histoire marocaine liront avec plaisir, découvrant peut-être que les caprices d'un roi font et défont des vies en un claquement de doigts, que grâce et disgrâce ressemblent aux deux faces d'une même pièce envoyée en l'air par un facétieux. L'auteur écrit « Hassan II parlait par énigmes, un peu comme François Mitterrand », pourtant Hassan II et Mitterrand se détestaient, peut-être parce qu'ils possédaient tous les deux des jardins secrets nauséabonds, tortures quotidiennes et bagnes mouroirs pour le premier, relations amicales assumées avec d'anciens miliciens voire gestapistes pour le deuxième.
Maël Renouard définit lui-même son style – peu avant le dernier chapitre où le narrateur s'efface pour laisser parler une jeune femme rédigeant un travail universitaire sur Saint-Simon, Proust, les Contes des mille et une nuits, jeune femme à laquelle le narrateur confie son manuscrit (le livre de Renouard) dans une enveloppe à ouvrir après sa mort – ainsi, « français précis et contourné, d'un classicisme insensible aux modes langagières de notre époque » ; passé simple et imparfait du subjonctif, phrases à rallonges abondent, le tout demandant une lecture attentive et paradoxalement pas de phrases ou de paragraphes qui nous bouleverseraient, relus avec avidité, notés, archivés quelque part. Comme Olivier Véran, l'auteur assume son écriture, admirateur probable de Proust, Saint-Simon, des hyper-classiques.
Aujourd'hui, on pourrait penser qu'avec Internet, ce rôle d'historiographe du royaume, au Maroc, est désuet ; non, cette fonction officielle institutionnalisée en 1961 par Hassan II est occupée par Abdelhak El Merini ou Lamrini ou Lemrini depuis 2010. Pierre Vermeren dans un livre « Le Maroc, un royaume de paradoxes, en 100 questions, 2020 » évoque les officines, comme le site 360ma, sur Internet prenant en partie le relais de cette fonction d'historiographe, relais fortement appuyé par quelques auteurs français comme Aymeric Chauprade (Géopolitique d'un Roi, 2019), Charles Saint-Prot ou Jean-Claude Martinez dont le livre « Le Roi stabilisateur » (2015) en tête de gondole à l'entrée des supermarchés marocains se vendait dix fois moins cher qu'en France.
(printemps 2021 modifié en janvier 2024)
Un texte érudit et bien écrit mais extrêmement lent. Peu d’émotions, les personnages et le narrateur semblent lointains et détachés. Plusieurs événements se succèdent dont on attend des rebondissements mais rien ne se produit vraiment. Quelques trouvailles néanmoins, le texte est inégal.
Abderrahmane Eljarib, narrateur, a fait ses études au Collège royal du Maroc en même temps que le futur HassanII. Issu d'u milieu modeste, il faut composer avec Hassan II qui joue avec son Entourage entre grâce et disgrâce. Vision du Maroc sur 30ans depuis le protectorat français jusqu'à l'indépendance souveraine
Abderrahmane Eljarib a été choisi (sur quels critères ? par qui ? il ne peut faire que des hypothèses) pour étudier au collège Royal avec le futur roi du Maroc, Hassan II. le début d'une vie où il devra naviguer entre sincérité et flatterie, entre liberté d'esprit et soumission, entre disgrâce et récompenses… Exil (7 ans dans la contrée reculée de Tarfaya), ou nomination prestigieuse (historiographe pendant 3 ans), il va être le témoin (et l'acteur !) de bien des événements historiques…
C'est seulement à la fin que le lecteur comprend la genèse de ce livre et sa structure. Mais je n'ai pas aimé cette fin « explicative » et trop bavarde : le parallèle avec les « 1001 nuits » et Saint Simon par exemple est pesante (Meilleure est l'anecdote où le narrateur, qui porte le même prénom qu'un conteur des « 1001 nuits » , provoque comme lui, la colère de ceux qui l'écoutent. ). Cette fin trop didactique n'ajoute rien au livre et en réduit même l'intérêt. J'ai préféré les pages où le narrateur raconte la difficulté d'être au service d'un despote, ses anecdotes (les parties d'échec, le titre de son livre « Les Elégies barbares » changé à la suite d'une erreur du souverrain !), les faits historiques (le coup d'état du palais de Skhirat, l'attentat contre l'avion du roi, l'enlèvement de Ben Barka …). Au fil des pages, J.P. Sartre, L. Senghor, mais aussi des figures plus anciennes (Voltaire, Chateaubriand…) permettent de réfléchir aux liens entre le pouvoir et les hommes de lettres.
Un avis plutôt mitigé donc !
C'est seulement à la fin que le lecteur comprend la genèse de ce livre et sa structure. Mais je n'ai pas aimé cette fin « explicative » et trop bavarde : le parallèle avec les « 1001 nuits » et Saint Simon par exemple est pesante (Meilleure est l'anecdote où le narrateur, qui porte le même prénom qu'un conteur des « 1001 nuits » , provoque comme lui, la colère de ceux qui l'écoutent. ). Cette fin trop didactique n'ajoute rien au livre et en réduit même l'intérêt. J'ai préféré les pages où le narrateur raconte la difficulté d'être au service d'un despote, ses anecdotes (les parties d'échec, le titre de son livre « Les Elégies barbares » changé à la suite d'une erreur du souverrain !), les faits historiques (le coup d'état du palais de Skhirat, l'attentat contre l'avion du roi, l'enlèvement de Ben Barka …). Au fil des pages, J.P. Sartre, L. Senghor, mais aussi des figures plus anciennes (Voltaire, Chateaubriand…) permettent de réfléchir aux liens entre le pouvoir et les hommes de lettres.
Un avis plutôt mitigé donc !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Maël Renouard (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3710 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3710 lecteurs ont répondu