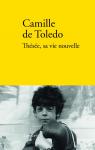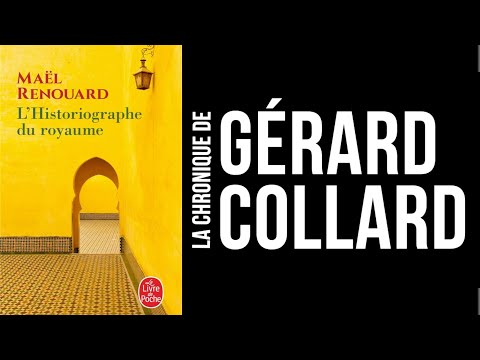Maël Renouard/5
4 notes
Résumé :
Internet a changé notre monde, mais on ne sait pas encore combien il a changé l’existence humaine. Loin de la naïveté des passionnés de la technologie comme du «c’est toujours pareil» des blasés, Maël Renouard fait de lui-même le sujet littéraire et philosophique de l’expérience d’une vie avec Internet.
Il en extrait des fragments, des pensées, des maximes ; il en fait une matrice à récits, et le soubassement d’une élaboration à nouveaux frais de la ... >Voir plus
Il en extrait des fragments, des pensées, des maximes ; il en fait une matrice à récits, et le soubassement d’une élaboration à nouveaux frais de la ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Fragments d'une mémoire infinieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Maël Renouard vient d'écrire la suite de L'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin, ce dernier dénonçant, en 1935 déjà, la déperdition de l'aura des oeuvres à cause de leur reproduction en masse. Cette déperdition d'aura est maintenant démultipliée à l'infini avec internet, et cet essai - Fragments d'une mémoire infinie - se penche avec brio sur le sujet en question, à savoir : notre quotidien connecté. À la façon d'un Paul Valery, Renouard propose une multitude de fragments, parfois drôles, parfois mélancoliques, toujours très érudits, qui nous rappellent qu'il n'y a pourtant pas si longtemps, nous vivions sans internet - ce qui paraît souvent presque impensable maintenant, tant ces changements, que l'on peut nommer progrès éventuellement, ont radicalement transformé notre quotidien. On passe par les cyber-cafés qui sont apparus presque aussi rapidement qu'ils ont disparu des centre-villes, sur les facéties de faux-intellectuels qui tentent de faire passer les textes d'autrui pour les leurs en apportant quelques menus affèteries, et, d'ailleurs, l'auteur de ce livre de signaler : "Pouvait-il ignorer qu'il est devenu aussi facile de copier que d'être surpris à copier?". Google earth et Facebook ont sonné la revanche des coeurs simples, dit-il encore, car oui : tout est là, à disposition, sans avoir le besoin de fatiguer sa bibliothèque, comme dirait Umberto Eco, de prendre du temps à chercher des ouvrages compliqués et longs à lire, non : la page lumineuse de Google attend votre recherche... à tel point que, ne sachant plus ce qu'il avait fait la veille, Maël Renouard le demande à Google ! Et puis il décèle encore à quel point internet est un cimetière mélancolique lorsqu'il répertorie, plusieurs pages durant, des citations trouvées en bas de clips musicaux proposés sur YouTube, clips de musiques datant plutôt des années 70 ou 80, avec des phrases comme "This brings back so many memories" ou "es waren Zeiten". Car oui : "Il y a dans l'internet une fontaine de jouvence où l'on plonge d'abord son visage en s'enivrant, puis où l'on voit son reflet meurtri par le temps, au petit matin." - Un ouvrage pour toutes celles et ceux qui ont fait l'expérience de la gueule de bois après un excès de recherches sur le net, en préparant des vacances, ont abusé de Facebook, à la recherche d'un maximum de "like", mais pas seulement puisque ce livre nous rappelle à point nommé que des intellectuels écrivains comme Derrida ou Michel Butor avaient, en 1967 pour le premier et 1971 pour le second, déjà prophétisé (en quelque sorte) l'arrivée de cet excès d'images qu'est internet, ce qui donne, évidemment, pour certains d'entre nous, l'envie de découvrir tout plein d'autres ouvrages, de courir chez notre libraire le plus proche ou de faire un tour à la bibliothèques - Génial.
critiques presse (1)
Maël Renouard aura démontré que l'immortalité mélancolique est notre lot ordinaire dans le monde numérique, monde qui n'oublie rien et où nous ne mourrons jamais pour de bon.
Lire la critique sur le site : LePoint
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
Nouveaux fragments d'une mémoire infinie
Il m’est arrivé, il y a quelque temps, d’ouvrir à nouveau le Roland Barthes par Roland Barthes. Il m’a toujours semblé que, dans ce livre étrangement exaspérant, où plus d’une fois l’on ne peut s’empêcher de bondir ou de s’esclaffer, Barthes avait perdu le contrôle de son talent – comme par une sorte de phénomène d’usure du pouvoir appliqué à l’écriture – et donné prise inconsidérément à ses détracteurs. Pour le pastiche de Burnier et de Rambaud, sorti deux ou trois ans plus tard, c’était une manne incroyable.
Mais cette fois-ci, je l’ai regardé d’un tout autre œil. Il m’est apparu soudain que ce livre – objet vraiment bizarre du point de vue de l’histoire de l’édition – avait été comme une prémonition singulière, étonnamment exacte, de ce qu’allaient être, quarante ans plus tard, les profils dans lesquels nous nous exposons sur Facebook. Barthes y parle d’ailleurs de lui-même à la troisième personne, comme dans les statuts Facebook d’il y a quelques années – épouvantable manie, encouragée à l’époque par la mise en page de la machine, mais qui est, fort heureusement, en voie de disparition.
Comme livre, il est horripilant ; comme profil Facebook, il fait plutôt partie des meilleurs. Un signe parmi d’autres que notre morale a déjà changé, insensiblement.
*
Je me souviens toujours d’une remarque de Gérard Genette, lue il y a longtemps, disant que le narrateur de À la recherche du temps perdu donne souvent, sur les autres personnages, des informations dont on se demande comment il a bien pu les apprendre, car elles concernent des moments de leur vie auxquels il ne prenait aucune part. Il sait à leur sujet des choses que, logiquement, il ne devrait pas savoir. Du point de vue de la technique du récit, Proust a donc mêlé sans y prendre garde les caractéristiques de la première et de la troisième personne, de la focalisation interne et du point de vue omniscient. Mais ce qui a pu ainsi apparaître pendant près d’un siècle, aux yeux de certains lecteurs scrupuleux, comme une invraisemblance, devient tout à fait réaliste, anachroniquement réaliste, si l’on imagine que le narrateur consacre une grande partie de son temps, dans la solitude de sa chambre aux murs capitonnés, à observer à leur insu les faits et gestes de ses amis sur Facebook, à les « stalker » – ce qui correspondrait assez, à vrai dire, à ce que l’on perçoit de son caractère, et aussi bien à ce que l’on sait de celui de son auteur, qui lui ressemble tant.
*
Dans son journal de l’année 1997, publié vingt ans après, Marc Lambron cite la nécrologie qu’il écrivit pour Madame Figaro au lendemain de la mort de Lady Diana. La première phrase m’a jeté aussitôt, quand je l’ai lue, dans un trouble profond que son aspect plutôt anodin ne présageait en rien : « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis. » Comment écrivait-on une phrase comme celle-ci en 1997, sans l’auxiliaire infini d’Internet ? Il y avait donc des gens qui savaient de telles choses sans les avoir trouvées, quelques minutes auparavant, sur Google ? C’était quelque part dans leur cerveau, et ils pouvaient y accéder instantanément quand ils en avaient besoin, par exemple pour écrire un article ? Était-ce rare ? En aurais-je été capable ? Le plus troublant était qu’il me paraissait impossible de répondre à ces questions ; je ne parvenais pas à me replacer dans l’état d’innocence psychologique de 1997. Ces années au cours desquelles Internet a profondément changé notre rapport à la connaissance empirique faisaient écran devant ma mémoire.
Certes, Internet existait en 1997 et il était accessible au public ; mais ceux qui l’utilisaient étaient rares et ne se connectaient que de loin en loin ; au reste, les informations historiques qu’on y trouvait n’étaient pas nombreuses et souvent peu fiables. Il ne jouait absolument aucun rôle dans ma vie ni dans celle de mes amis d’alors, et pas davantage dans celle de Marc Lambron, telle qu’elle apparaît au fil de son journal. C’était le début de ce qu’on pourrait appeler l’ère proto-numérique, du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, que je caractériserais par le fait que, malgré l’existence et la disponibilité d’Internet, il était encore possible, et même assez courant, d’exercer la plupart ou même la totalité de nos activités pratiques et intellectuelles sans recourir à lui.
Je n’arrivais pas à imaginer l’écriture d’une telle phrase autrement que sur le fond de notre recours permanent à Internet. J’ai tenté l’effort. Je me suis dit, imaginons que je sois privé de réseau et que je doive par exemple écrire quelque chose sur un homme né en 1938. Je saurais noter, sans avoir besoin de Google, quelque chose comme : « Il était né en 1938, l’année de Munich et celle de la Grande Illusion », ou encore : « Il était né en 1938, l’année des accords de Munich, celle où Sartre publia la Nausée. » (Je m’en rends compte en transcrivant cette hypothèse : c’est plus facile que pour 1961, et nombreuses sont les années pour lesquelles, spontanément, je serais bien incapable de citer deux événements significatifs – 1957, par exemple.)
Mais combien de temps durerait mon innocence psychologique ? J’aurais si peur de me tromper et d’être férocement démenti par les lecteurs, qui maintenant peuvent tout savoir, que naturellement je vérifierais sur Google, même en étant sûr de moi, et cette vérification me plongerait dans tout un monde de nouvelles informations, de détails, où je déambulerais par curiosité, où je chercherais peut-être d’autres exemples, totalement différents de ceux auxquels j’avais d’abord pensé – à vrai dire, je les trouverais sans les chercher, ils s’imposeraient à moi dans leur variété et leur surabondance, des exemples amusants, anecdotiques, des exemples qui surprendraient, qui flatteraient encore le désir du lecteur omniscient et rassasié comme Lucullus de données empiriques, je regarderais sur Wikipédia les pages qui s’intitulent « Année 1938 dans le monde », « Année 1938 au cinéma », « Année 1938 en littérature », « Décès en 1938 », « Naissance en 1938 », etc., et tout d’un coup, en quelques minutes, je passerais de la pénurie à l’embarras du choix, je pourrais écrire, parmi des dizaines de combinaisons possibles, plus ou moins spirituelles, plus ou moins astucieuses, des phrases comme : « Il était né en 1938, l’année de la mort d’Atatürk, celle où Raymond Aron publia sa thèse de philosophie chez Gallimard », ou bien : « Il était né en 1938, l’année de la mort de Suzanne Lenglen, celle où Pearl Buck reçut le prix Nobel de littérature. »
Je me sentais d’autant plus renvoyé à l’omniprésence d’Internet que je m’efforçais d’en faire abstraction. Il était presque aussi difficile de reconstituer, ne serait-ce qu’un instant, la vie de l’esprit à l’ère pré-numérique que d’imaginer la manière dont un aveugle de naissance se représente intérieurement une figure géométrique. De même que nous luttons en vain contre notre expérience de la vue quand nous essayons de nous mettre à la place de quelqu’un qui en a toujours été privé, de même nous luttons en vain contre l’expérience de notre recours permanent à Internet comme à un nouvel organe, quand nous essayons de nous replacer dans l’époque où il était absent de notre monde.
Cela ne veut pas dire que nous écrirons nécessairement des choses différentes. Nous pourrons écrire les mêmes choses qu’avant ; nous le ferons souvent, et souvent même nous nous efforcerons de le faire. Mais la genèse de ces phrases, le cheminement qui leur aura donné forme, l’arrière-plan mental sur le fond duquel elles se détacheront ne seront plus jamais les mêmes.
En consignant ce qui précède, je me suis souvenu tardivement du conte de Borges dans lequel le Don Quichotte réécrit mot pour mot à l’identique par un certain Pierre Ménard au xxe siècle est une œuvre absolument différente du Don Quichotte de Cervantes. Ce que j’avais perçu en lisant cette page, c’est tout simplement que cette phrase écrite en 1997, « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis », est absolument différente de la même phrase écrite en 2017, à l’époque de Google et de Wikipédia.
*
Épilogue. Quelques jours plus tard, j’entreprends de lire 1941, le roman que Marc Lambron avait publié à la rentrée de 1997 et dont il parle beaucoup dans son journal. Au début du livre, je tombe sur une phrase où il est justement question de l’année 1938 – « l’année de l’Anschluss et de l’invention des brosses à dents en nylon, l’année où Ray Ventura lançait en France le Lambeth Walk, l’année de l’état de siège à Jérusalem, l’année où Paul Klee peignait Douleur précoce et où Tino Rossi chantait Sérénade sans espoir ».
Alors je m’avoue vaincu, j’abandonne toute tentative de jauger rétrospectivement ce qu’avaient été les capacités de ma mémoire psychologique dans un monde sans Google, et j’imagine les commentaires, devant une telle phrase, de ceux qui, dans quelques décennies ou quelques siècles, se pencheront sur l’époque où Internet avait fait son apparition : « Peu avant la mise en connexion permanente du cerveau humain avec Internet, on a pu observer que certains spécimens étaient parvenus, avec les seules ressources de leur cerveau naturel, à se doter de capacités de rétention assez proches de ce qui deviendrait bientôt la norme. »
Il m’est arrivé, il y a quelque temps, d’ouvrir à nouveau le Roland Barthes par Roland Barthes. Il m’a toujours semblé que, dans ce livre étrangement exaspérant, où plus d’une fois l’on ne peut s’empêcher de bondir ou de s’esclaffer, Barthes avait perdu le contrôle de son talent – comme par une sorte de phénomène d’usure du pouvoir appliqué à l’écriture – et donné prise inconsidérément à ses détracteurs. Pour le pastiche de Burnier et de Rambaud, sorti deux ou trois ans plus tard, c’était une manne incroyable.
Mais cette fois-ci, je l’ai regardé d’un tout autre œil. Il m’est apparu soudain que ce livre – objet vraiment bizarre du point de vue de l’histoire de l’édition – avait été comme une prémonition singulière, étonnamment exacte, de ce qu’allaient être, quarante ans plus tard, les profils dans lesquels nous nous exposons sur Facebook. Barthes y parle d’ailleurs de lui-même à la troisième personne, comme dans les statuts Facebook d’il y a quelques années – épouvantable manie, encouragée à l’époque par la mise en page de la machine, mais qui est, fort heureusement, en voie de disparition.
Comme livre, il est horripilant ; comme profil Facebook, il fait plutôt partie des meilleurs. Un signe parmi d’autres que notre morale a déjà changé, insensiblement.
*
Je me souviens toujours d’une remarque de Gérard Genette, lue il y a longtemps, disant que le narrateur de À la recherche du temps perdu donne souvent, sur les autres personnages, des informations dont on se demande comment il a bien pu les apprendre, car elles concernent des moments de leur vie auxquels il ne prenait aucune part. Il sait à leur sujet des choses que, logiquement, il ne devrait pas savoir. Du point de vue de la technique du récit, Proust a donc mêlé sans y prendre garde les caractéristiques de la première et de la troisième personne, de la focalisation interne et du point de vue omniscient. Mais ce qui a pu ainsi apparaître pendant près d’un siècle, aux yeux de certains lecteurs scrupuleux, comme une invraisemblance, devient tout à fait réaliste, anachroniquement réaliste, si l’on imagine que le narrateur consacre une grande partie de son temps, dans la solitude de sa chambre aux murs capitonnés, à observer à leur insu les faits et gestes de ses amis sur Facebook, à les « stalker » – ce qui correspondrait assez, à vrai dire, à ce que l’on perçoit de son caractère, et aussi bien à ce que l’on sait de celui de son auteur, qui lui ressemble tant.
*
Dans son journal de l’année 1997, publié vingt ans après, Marc Lambron cite la nécrologie qu’il écrivit pour Madame Figaro au lendemain de la mort de Lady Diana. La première phrase m’a jeté aussitôt, quand je l’ai lue, dans un trouble profond que son aspect plutôt anodin ne présageait en rien : « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis. » Comment écrivait-on une phrase comme celle-ci en 1997, sans l’auxiliaire infini d’Internet ? Il y avait donc des gens qui savaient de telles choses sans les avoir trouvées, quelques minutes auparavant, sur Google ? C’était quelque part dans leur cerveau, et ils pouvaient y accéder instantanément quand ils en avaient besoin, par exemple pour écrire un article ? Était-ce rare ? En aurais-je été capable ? Le plus troublant était qu’il me paraissait impossible de répondre à ces questions ; je ne parvenais pas à me replacer dans l’état d’innocence psychologique de 1997. Ces années au cours desquelles Internet a profondément changé notre rapport à la connaissance empirique faisaient écran devant ma mémoire.
Certes, Internet existait en 1997 et il était accessible au public ; mais ceux qui l’utilisaient étaient rares et ne se connectaient que de loin en loin ; au reste, les informations historiques qu’on y trouvait n’étaient pas nombreuses et souvent peu fiables. Il ne jouait absolument aucun rôle dans ma vie ni dans celle de mes amis d’alors, et pas davantage dans celle de Marc Lambron, telle qu’elle apparaît au fil de son journal. C’était le début de ce qu’on pourrait appeler l’ère proto-numérique, du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, que je caractériserais par le fait que, malgré l’existence et la disponibilité d’Internet, il était encore possible, et même assez courant, d’exercer la plupart ou même la totalité de nos activités pratiques et intellectuelles sans recourir à lui.
Je n’arrivais pas à imaginer l’écriture d’une telle phrase autrement que sur le fond de notre recours permanent à Internet. J’ai tenté l’effort. Je me suis dit, imaginons que je sois privé de réseau et que je doive par exemple écrire quelque chose sur un homme né en 1938. Je saurais noter, sans avoir besoin de Google, quelque chose comme : « Il était né en 1938, l’année de Munich et celle de la Grande Illusion », ou encore : « Il était né en 1938, l’année des accords de Munich, celle où Sartre publia la Nausée. » (Je m’en rends compte en transcrivant cette hypothèse : c’est plus facile que pour 1961, et nombreuses sont les années pour lesquelles, spontanément, je serais bien incapable de citer deux événements significatifs – 1957, par exemple.)
Mais combien de temps durerait mon innocence psychologique ? J’aurais si peur de me tromper et d’être férocement démenti par les lecteurs, qui maintenant peuvent tout savoir, que naturellement je vérifierais sur Google, même en étant sûr de moi, et cette vérification me plongerait dans tout un monde de nouvelles informations, de détails, où je déambulerais par curiosité, où je chercherais peut-être d’autres exemples, totalement différents de ceux auxquels j’avais d’abord pensé – à vrai dire, je les trouverais sans les chercher, ils s’imposeraient à moi dans leur variété et leur surabondance, des exemples amusants, anecdotiques, des exemples qui surprendraient, qui flatteraient encore le désir du lecteur omniscient et rassasié comme Lucullus de données empiriques, je regarderais sur Wikipédia les pages qui s’intitulent « Année 1938 dans le monde », « Année 1938 au cinéma », « Année 1938 en littérature », « Décès en 1938 », « Naissance en 1938 », etc., et tout d’un coup, en quelques minutes, je passerais de la pénurie à l’embarras du choix, je pourrais écrire, parmi des dizaines de combinaisons possibles, plus ou moins spirituelles, plus ou moins astucieuses, des phrases comme : « Il était né en 1938, l’année de la mort d’Atatürk, celle où Raymond Aron publia sa thèse de philosophie chez Gallimard », ou bien : « Il était né en 1938, l’année de la mort de Suzanne Lenglen, celle où Pearl Buck reçut le prix Nobel de littérature. »
Je me sentais d’autant plus renvoyé à l’omniprésence d’Internet que je m’efforçais d’en faire abstraction. Il était presque aussi difficile de reconstituer, ne serait-ce qu’un instant, la vie de l’esprit à l’ère pré-numérique que d’imaginer la manière dont un aveugle de naissance se représente intérieurement une figure géométrique. De même que nous luttons en vain contre notre expérience de la vue quand nous essayons de nous mettre à la place de quelqu’un qui en a toujours été privé, de même nous luttons en vain contre l’expérience de notre recours permanent à Internet comme à un nouvel organe, quand nous essayons de nous replacer dans l’époque où il était absent de notre monde.
Cela ne veut pas dire que nous écrirons nécessairement des choses différentes. Nous pourrons écrire les mêmes choses qu’avant ; nous le ferons souvent, et souvent même nous nous efforcerons de le faire. Mais la genèse de ces phrases, le cheminement qui leur aura donné forme, l’arrière-plan mental sur le fond duquel elles se détacheront ne seront plus jamais les mêmes.
En consignant ce qui précède, je me suis souvenu tardivement du conte de Borges dans lequel le Don Quichotte réécrit mot pour mot à l’identique par un certain Pierre Ménard au xxe siècle est une œuvre absolument différente du Don Quichotte de Cervantes. Ce que j’avais perçu en lisant cette page, c’est tout simplement que cette phrase écrite en 1997, « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis », est absolument différente de la même phrase écrite en 2017, à l’époque de Google et de Wikipédia.
*
Épilogue. Quelques jours plus tard, j’entreprends de lire 1941, le roman que Marc Lambron avait publié à la rentrée de 1997 et dont il parle beaucoup dans son journal. Au début du livre, je tombe sur une phrase où il est justement question de l’année 1938 – « l’année de l’Anschluss et de l’invention des brosses à dents en nylon, l’année où Ray Ventura lançait en France le Lambeth Walk, l’année de l’état de siège à Jérusalem, l’année où Paul Klee peignait Douleur précoce et où Tino Rossi chantait Sérénade sans espoir ».
Alors je m’avoue vaincu, j’abandonne toute tentative de jauger rétrospectivement ce qu’avaient été les capacités de ma mémoire psychologique dans un monde sans Google, et j’imagine les commentaires, devant une telle phrase, de ceux qui, dans quelques décennies ou quelques siècles, se pencheront sur l’époque où Internet avait fait son apparition : « Peu avant la mise en connexion permanente du cerveau humain avec Internet, on a pu observer que certains spécimens étaient parvenus, avec les seules ressources de leur cerveau naturel, à se doter de capacités de rétention assez proches de ce qui deviendrait bientôt la norme. »
Leroi-Gourhan, dans le fascinant chapitre IX du Geste et la parole, « la mémoire en expansion », remarque que les premières formes d’écriture présentent avec le flux continu de la parole une similarité qui se défera peu à peu, mais ne sera véritablement rompue qu’avec la nécessité, consécutive à l’invention de l’imprimerie, de s’orienter de l’extérieur dans une masse de textes inassimilable par la mémoire psychologique individuelle. « Au cours des siècles qui séparent Homère ou Yu le Grand des premiers imprimés occidentaux et orientaux, la notion de référence s’est développée avec la masse grandissante des faits enregistrés, mais les écrits sont chacun une suite compacte, rythmée par des sigles et des notes marginales, dans laquelle le lecteur s’oriente à la manière du chasseur primitif, le long d’un trajet plutôt que sur un plan. La conversion du déroulement de la parole en un système de tables d’orientation n’est pas encore acquise. » L’absence de ponctuation ou d’espace entre les mots, l’usage du rouleau qu’on ne peut consulter en un point précis qu’en redéployant le flux dans sa longueur, dans sa durée, caractérisent cette homogénéité archaïque de l’écriture et de la parole. Le codex offre certes la possibilité de feuilleter, de plonger dans le flux compact pour fondre sur sa proie sans être obligé d’en suivre patiemment la trace ; mais faute d’une cartographie quelconque de ce flux, cela suppose de s’être déjà assimilé le contenu du livre. Longtemps, les écrits ne sont en effet que des supports auxiliaires en vue d’une mémorisation extensive. « La matière des manuscrits antiques et médiévaux est faite de textes destinés à être fixés à vie dans la mémoire des lecteurs. » Le flux compact des signes n’est pas seulement le reflet du flux de la parole, il est aussi à l’image du flux intérieur que redevient le texte une fois qu’il a été, comme il se doit, intégralement mémorisé.
Davantage que le codex ou l’imprimerie en tant que telle, ce sont les index alphabétiques et les tables des matières qui constituent, selon Leroi-Gourhan, la plus grande révolution dans le maniement de l’écrit. Même l’invention de l’écriture en tant que telle ne lui apparaît pas comme une rupture aussi décisive, quand il divise en cinq grandes périodes l’histoire de la mémoire collective : « celle de la transmission orale, celle de la transmission écrite avec tables et index, celle des fiches simples, celle de la mécanographie et celle de la sériation électronique. »
Les index alphabétiques et les tables des matières sont les « tables d’orientation » qui permettent d’explorer un texte dont on ignore préalablement le contenu. La mémoire psychologique individuelle n’est plus la condition permanente, ni l’aboutissement du rapport à l’écrit. L’index se souvient à la place du lecteur qui n’a pas retenu le livre par cœur – ou qui ne l’a pas encore lu – de ce qu’il y a dedans, et à quel endroit. Quand il ne s’agit plus seulement de s’orienter dans le flux d’un seul livre, mais dans celui de livres toujours plus innombrables, les fichiers bibliographiques continuent ce processus d’extériorisation de la mémoire. Leroi-Gourhan les compare à « un véritable cortex cérébral extériorisé », avant de nuancer cette image en apportant une précision qui, d’une certaine manière, vaut encore pour l’internet : « si un fichier est une mémoire au sens strict, c’est une mémoire sans moyens propres de remémoration et l’animation requiert son introduction dans le champ opératoire, visuel et manuel, du chercheur. »
Leroi-Gourhan, qui a publié Le Geste et la parole au milieu des années 1960, n’utilise dans ces pages ni le mot d’ordinateur ni celui d’informatique. Il parle de « sériation électronique », de « mémoire électronique », de « cerveau électronique » (expression qu’il met lui-même entre guillemets, comme si elle avait été dans l’air à l’époque) et d’ « intégrateur électronique ». Ce décalage sémantique par rapport à nos usages présents ne l’empêche pas de terminer ce chapitre par quelques paragraphes visionnaires où il se dit certain que « nous savons ou saurons bientôt construire des machines à se souvenir de tout et à juger des situations les plus complexes sans se tromper », et qu’ « il faut donc que l’homme s’accoutume à être moins fort que son cerveau artificiel, comme ses dents sont moins fortes qu’une meule de moulin et ses aptitudes aviaires négligeables auprès de celles du moindre avion à réaction ».
De telles phrases font évidemment écho à l’omniprésence dans nos démarches intellectuelles de cette « machine à se souvenir de tout » qu’est l’internet. Frédéric Metz, dans son remarquable essai, Les Yeux d’Œdipe – Quand le google, face au monde, saura voir et nommer, analyse du point de vue de notre présent ces pages de Leroi-Gourhan en disant que « le google n’est au fond que la table des matières totale du savoir humain total ».
Je choisirais plutôt l’image de l’index, qui dans nos livres n’a d’autre ordre que celui, contingent, de l’alphabet, et dont on sent déjà la tension vers l’infini, limitée par la nécessité pratique de s’en tenir dans l’espace de quelques pages aux notions jugées pertinentes – mais combien de fois n’avons-nous pas regretté de ne pas trouver, dans un index des matières, tel terme probablement écarté comme secondaire dont nous aurions pourtant aimé retracer les apparitions éventuelles au sein du livre ?
Il y a surtout, dans l’internet, quelque chose qui va au-delà de l’amélioration des performances de la mémoire extériorisée, quelque chose qui échappe à la continuité d’un progrès graduel, qu’il soit régulier ou toujours plus accéléré.
La mémoire extériorisée avait depuis toujours procédé par contractions, résumés, réductions, sélections, coupes dans un flux, et par mise en ordre, classement, des éléments contractés. Les fichiers bibliographiques réduisaient des milliers d’ouvrages à quelques notions clefs ; les tables des matières contractaient les centaines de pages d’un livre. Le signe était lui-même la première contraction de l’expérience. L’épopée tissée de mots était une contraction de la guerre, dont les longues années tenaient en quelques soirs de récitation ; le texte écrit qui consignait l’épopée était une contraction de la narration orale, qui en laissait de côté la richesse sensible, la mélodie, la vie aux mille détails. Chaque niveau de contraction, en s’accumulant, reconstituait un flux infini, une nouvelle dilatation qui devait à son tour être contractée. De la pluralité des pages à l’index et à la table des matières ; de la pluralité des livres aux fichiers bibliographiques.
Les éléments contractés étaient en outre rangés, ordonnés, disposés au sein d’un espace cartographié. Plus les données à traiter et à maîtriser étaient nombreuses, plus on avait recours à la contraction et au classement hiérarchisé, pyramidal, procédant par subdivisions, arborescences, etc., des contractions de contractions. Pour retrouver quelque chose, il fallait qu’il soit rangé quelque part. Le désordre était ennemi de la mémoire. De ce point de vue, les technologies de la mémoire collective extériorisée ressemblaient encore aux arts de la mémoire individuelle psychologique – ces procédés cultivés par les rhapsodes et les orateurs de l’Antiquité pour retenir de longs développements à partir d’unités élémentaires.
Tout cela a changé. Nous usons, sur l’internet, d’une immense mémoire extériorisée qui se présente à nous sans réduction ni ordre. Nous n’avons plus besoin de savoir où sont rangées les choses. Nous n’avons plus besoin de « mettre en fiches » quoi que ce soit. Une idée nous traverse, et l’inscription de quelques mots sur la barre d’un moteur de recherche nous rapporte instantanément la proie visée, si loin soit-elle. Cette mémoire sans ordre nous est devenue à ce point familière que nous sommes singulièrement déconcertés, lorsque, n’ayant pas rangé un livre à la place qui aurait dû lui revenir dans notre bibliothèque, ou étant incapables de remettre la main sur nos clefs déposées par mégarde à un endroit inhabituel, nous sommes privés de la faculté d’interroger Google pour répondre instantanément à la question de savoir où se trouvent ces objets. Il y a dans l’internet un crépuscule du classement, de l’organisation, de la préparation, et l’esquisse d’un nouveau genre de vie, fait d’une perpétuelle improvisation assistée, avec nos smartphones comme planches de salut de tous les instants.
C’est aussi une mémoire sans contraction ; une mémoire qui n’est plus obligée de s’en tenir à la parcimonie des signes ; une mémoire qui n’est plus sténographique, mais cinématographique ; une mémoire qui conserve les images, les sons, la durée des choses, et n’est plus forcée de sélectionner ce qu’elle gardera ; une mémoire qui tend de plus en plus à être le film du monde, le film monadologique de chaque instant du monde, en tous les points de vue du monde.
Davantage que le codex ou l’imprimerie en tant que telle, ce sont les index alphabétiques et les tables des matières qui constituent, selon Leroi-Gourhan, la plus grande révolution dans le maniement de l’écrit. Même l’invention de l’écriture en tant que telle ne lui apparaît pas comme une rupture aussi décisive, quand il divise en cinq grandes périodes l’histoire de la mémoire collective : « celle de la transmission orale, celle de la transmission écrite avec tables et index, celle des fiches simples, celle de la mécanographie et celle de la sériation électronique. »
Les index alphabétiques et les tables des matières sont les « tables d’orientation » qui permettent d’explorer un texte dont on ignore préalablement le contenu. La mémoire psychologique individuelle n’est plus la condition permanente, ni l’aboutissement du rapport à l’écrit. L’index se souvient à la place du lecteur qui n’a pas retenu le livre par cœur – ou qui ne l’a pas encore lu – de ce qu’il y a dedans, et à quel endroit. Quand il ne s’agit plus seulement de s’orienter dans le flux d’un seul livre, mais dans celui de livres toujours plus innombrables, les fichiers bibliographiques continuent ce processus d’extériorisation de la mémoire. Leroi-Gourhan les compare à « un véritable cortex cérébral extériorisé », avant de nuancer cette image en apportant une précision qui, d’une certaine manière, vaut encore pour l’internet : « si un fichier est une mémoire au sens strict, c’est une mémoire sans moyens propres de remémoration et l’animation requiert son introduction dans le champ opératoire, visuel et manuel, du chercheur. »
Leroi-Gourhan, qui a publié Le Geste et la parole au milieu des années 1960, n’utilise dans ces pages ni le mot d’ordinateur ni celui d’informatique. Il parle de « sériation électronique », de « mémoire électronique », de « cerveau électronique » (expression qu’il met lui-même entre guillemets, comme si elle avait été dans l’air à l’époque) et d’ « intégrateur électronique ». Ce décalage sémantique par rapport à nos usages présents ne l’empêche pas de terminer ce chapitre par quelques paragraphes visionnaires où il se dit certain que « nous savons ou saurons bientôt construire des machines à se souvenir de tout et à juger des situations les plus complexes sans se tromper », et qu’ « il faut donc que l’homme s’accoutume à être moins fort que son cerveau artificiel, comme ses dents sont moins fortes qu’une meule de moulin et ses aptitudes aviaires négligeables auprès de celles du moindre avion à réaction ».
De telles phrases font évidemment écho à l’omniprésence dans nos démarches intellectuelles de cette « machine à se souvenir de tout » qu’est l’internet. Frédéric Metz, dans son remarquable essai, Les Yeux d’Œdipe – Quand le google, face au monde, saura voir et nommer, analyse du point de vue de notre présent ces pages de Leroi-Gourhan en disant que « le google n’est au fond que la table des matières totale du savoir humain total ».
Je choisirais plutôt l’image de l’index, qui dans nos livres n’a d’autre ordre que celui, contingent, de l’alphabet, et dont on sent déjà la tension vers l’infini, limitée par la nécessité pratique de s’en tenir dans l’espace de quelques pages aux notions jugées pertinentes – mais combien de fois n’avons-nous pas regretté de ne pas trouver, dans un index des matières, tel terme probablement écarté comme secondaire dont nous aurions pourtant aimé retracer les apparitions éventuelles au sein du livre ?
Il y a surtout, dans l’internet, quelque chose qui va au-delà de l’amélioration des performances de la mémoire extériorisée, quelque chose qui échappe à la continuité d’un progrès graduel, qu’il soit régulier ou toujours plus accéléré.
La mémoire extériorisée avait depuis toujours procédé par contractions, résumés, réductions, sélections, coupes dans un flux, et par mise en ordre, classement, des éléments contractés. Les fichiers bibliographiques réduisaient des milliers d’ouvrages à quelques notions clefs ; les tables des matières contractaient les centaines de pages d’un livre. Le signe était lui-même la première contraction de l’expérience. L’épopée tissée de mots était une contraction de la guerre, dont les longues années tenaient en quelques soirs de récitation ; le texte écrit qui consignait l’épopée était une contraction de la narration orale, qui en laissait de côté la richesse sensible, la mélodie, la vie aux mille détails. Chaque niveau de contraction, en s’accumulant, reconstituait un flux infini, une nouvelle dilatation qui devait à son tour être contractée. De la pluralité des pages à l’index et à la table des matières ; de la pluralité des livres aux fichiers bibliographiques.
Les éléments contractés étaient en outre rangés, ordonnés, disposés au sein d’un espace cartographié. Plus les données à traiter et à maîtriser étaient nombreuses, plus on avait recours à la contraction et au classement hiérarchisé, pyramidal, procédant par subdivisions, arborescences, etc., des contractions de contractions. Pour retrouver quelque chose, il fallait qu’il soit rangé quelque part. Le désordre était ennemi de la mémoire. De ce point de vue, les technologies de la mémoire collective extériorisée ressemblaient encore aux arts de la mémoire individuelle psychologique – ces procédés cultivés par les rhapsodes et les orateurs de l’Antiquité pour retenir de longs développements à partir d’unités élémentaires.
Tout cela a changé. Nous usons, sur l’internet, d’une immense mémoire extériorisée qui se présente à nous sans réduction ni ordre. Nous n’avons plus besoin de savoir où sont rangées les choses. Nous n’avons plus besoin de « mettre en fiches » quoi que ce soit. Une idée nous traverse, et l’inscription de quelques mots sur la barre d’un moteur de recherche nous rapporte instantanément la proie visée, si loin soit-elle. Cette mémoire sans ordre nous est devenue à ce point familière que nous sommes singulièrement déconcertés, lorsque, n’ayant pas rangé un livre à la place qui aurait dû lui revenir dans notre bibliothèque, ou étant incapables de remettre la main sur nos clefs déposées par mégarde à un endroit inhabituel, nous sommes privés de la faculté d’interroger Google pour répondre instantanément à la question de savoir où se trouvent ces objets. Il y a dans l’internet un crépuscule du classement, de l’organisation, de la préparation, et l’esquisse d’un nouveau genre de vie, fait d’une perpétuelle improvisation assistée, avec nos smartphones comme planches de salut de tous les instants.
C’est aussi une mémoire sans contraction ; une mémoire qui n’est plus obligée de s’en tenir à la parcimonie des signes ; une mémoire qui n’est plus sténographique, mais cinématographique ; une mémoire qui conserve les images, les sons, la durée des choses, et n’est plus forcée de sélectionner ce qu’elle gardera ; une mémoire qui tend de plus en plus à être le film du monde, le film monadologique de chaque instant du monde, en tous les points de vue du monde.
David Lodge a publié Small World en 1984. Le livre, un roman universitaire, suit un groupe d'universitaires alors qu'ils parcourent le monde pour assister à des conférences. Mais ce « petit monde » n'est pas seulement celui des cercles universitaires internationaux – sans frontières, mais strictement pour les initiés – où les universitaires débattent des mérites du structuralisme, de la déconstruction et de l'histoire littéraire à l'ancienne. C'est un monde relié par des téléphones et traversé par des avions à réaction. Morris Zapp, l'un des personnages principaux du roman, formule une sorte de théorie qui s'applique au-delà de l'érudition, malgré ce qu'il dit.« Il ya, affirme-t-il, trois choses qui ont révolutionné la vie universitaire au cours des vingt dernières années, bien que très peu de gens en aient pris conscience : les voyages en avion, les téléphones à ligne directe et la machine Xerox . À la lumière de ces innovations,
Ces affirmations peuvent ressembler à celles qui ont surgi une dizaine d'années plus tard, lorsque l'utilisation d'Internet s'est généralisée. Il existe cependant des différences très importantes. Le monde décrit par Lodge laisse encore place à la perte, à la disparition, à la difficulté des retrouvailles, à la recherche désespérée. C'est notamment le cas du personnage de Persse McGarrigle, qui poursuit amoureusement une jeune femme qu'il rencontre lors d'une conférence. Il se demande toujours où elle est. A peine à-il retrouvé sa trace qu'elle est déjà ailleurs. Cela ne lui sert pas à grand choix d'avoir tous les avions à réaction qu'il pouvait espérer ;son agonie est la même que celle de l'amant du Cantique des Cantiques lorsqu'elle demande à chacune des filles de Jérusalem si elles ont vu son bien-aimé.
Il est raisonnable de penser que Google et GPS ont changé la nature de notre expérience bien plus profondément que le gros porteur et la photocopieuse, du moins en ce qui concerne l'oubli et la désorientation. Il y a quelque chose de particulièrement frappant dans le fait qu'un smartphone peut combler les lacunes de notre mémoire ou de nos connaissances concernant presque toutes les questions factuelles susceptibles de nous traverser l'esprit (À quelle heure est le prochain ferry ? le Premier ministre français en 1955 ?), de même qu'un même smartphone peut nous montrer - sur une carte dont l'échelle varie astronomiquement d'Un monde dans lequel Persse McGarrigle peut taper "Angelica Pabst" dans Google, ou trouver son chemin vers elle sur Facebook grâce à de probables connaissances mutuelles,
Cependant, nous pourrions certainement nuancer notre appréciation de l'avènement d'Internet également. Il y a encore des gens dont les traces sur Google sont infinitésimales voire inexistantes, et bon nombre de choses restent insuffisamment archivées. Ou nous pourrions souligner qu'en fait, cela fait longtemps que l'annuaire téléphonique a permis pour la première fois de rechercher un nom, et encore plus longtemps que le sextant et la boussole ont considérablement réduit la désorientation humaine dans des étendues inconnues.
Chaque génération voit les avancées technologiques de l'ère précédente, quelle que soit leur proximité, comme des excroissances d'un monde ancien. Les gens aiment penser que le monde n'a vraiment changé qu'à leur époque. Mais le sentiment d'assister à une accélération spectaculaire qui rejette d'emblée tous les siècles passés, les reléguant dans un bras mort indifférencié incommensurable avec l'expérience actuelle, n'est pas seulement le privilège des enfants qui ont grandi avec Internet et voient les gigantesques ordinateurs conçus après la Seconde Guerre mondiale antiquités non moins étrangères à la vie contemporaine que les perruques poudrées du XVIIIe siècle ou les quadriges du Circus Maximus. « Que le monde n'ait jamais autant changé en un seul siècle (sauf par la destruction) est un fait que nous connaissons tous », écrivait Malraux en 1965. « J'ai moi-même vu les moineaux fondre dans les bus hippomobiles du Palais Royal et le timide et charmant colonel Glenn à son retour du cosmos. Mais une personne qui, née avant Malraux, avait vu naître le cinéma et l'aviation aurait pu légitimement avoir le même sentiment d'assister à un bouleversement fondamental de l'histoire humaine.
Il n'aurait d'ailleurs pas été sans fondement pour une telle personne de dire aux jeunes générations que les exploits de Neil Armstrong étaient essentiellement des ramifications de Clément Ader ou des frères Wright. Et celui qui, même un peu plus tôt, avait aperçu les premiers daguerréotypes aurait pu à son tour prétendre qu'il était celui qui avait assisté à la véritable révolution à partir de laquelle le cinéma n'avait fait que se développer. A contre-courant de cet enthousiasme qui considère le moment présent comme le plus radical, le plus significatif historiquement, il faudrait glisser de plus en plus loin dans le passé, le curseur marquant l'authentique percée, jusqu'à trouver l'événement qui, plus humble peut-être en apparence que les innovations ultérieures, en constituaient néanmoins la condition nécessaire : l'invention véritablement innovatrice,
La théorie du changement exponentiellement croissant a le mérite d'accréditer ces proclamations de révolution de plus en plus fréquentes. Il postule une réelle accélération du progrès technologique à l'origine de notre sentiment, orgueilleux et naïf, mais aussi pertinent, que les bouleversements de l'histoire humaine sont devenus des événements quasi quotidiens. Alors que les gens attendaient des siècles avant de prononcer "Jamais jusqu'à ce jour", nous semblons nous être progressivement autorisés à le dire toutes les quelques décennies, puis toutes les quelques années, bientôt peut-être tous les quelques mois.
Les espoirs que les futuristes tirent de cette théorie sont incertains. Ils semblent moins une conséquence possible des calculs que l'expression d'un rêve fondamental que ces calculs semblent livrer miraculeusement : la promesse d'assister à l'approche, et peut-être même à l'accomplissement, de l'immortalité.
Qu'est-ce qui fait le sentiment révolutionnaire de ces avancées successives ? Qu'est-ce qui les rend si incommensurables avec leurs antécédents ? C'est peut-être le sentiment qu'à travers eux cet objectif d'immortalité prend une forme de plus en plus claire, d'autant plus que chaque pas devient de plus en plus exaltant pour un coureur qui approche de la ligne d'arrivée, même si son rythme n'a pas changé.
Dans son livre Le Phénomène de l'Homme, paru en 1955, le philosophe et prêtre Pierre Teilhard de Chardin contemplait le tournant de l'humanité vers l'intérieur : « J'imagine que notre noosphère est destinée à se refermer sur elle-même dans la solitude — et ce n'est pas dans un direction mentale que nous trouverons notre ligne de fuite, sans avoir à quitter ou même à nous étendre au-delà de la Terre.
Aujourd'hui, les futurologues spéculent qu'un ordinateur pourrait un jour servir de support dans lequel résidera notre réalité mentale – immortelle, à l'abri des allées et venues de la matière.
Deux penchants, distincts mais facilement liés, entraînent l'augmentation de nos capacités techniques : voyager et archiver - au temps de Lodge, voler et Xerox - la possibilité de quitter la Terre, et la possibilité de tout emporter avec nous.
L'invention quasi simultanée de l'avion et de la caméra en est un témoignage frappant. Il est tentant - mais d'autant plus risqué que l'échelle de temps devient alors très condensée - de chercher d'autres conjonctions : celle de Spoutnik et du premier disque dur, des premiers pas de lune et du premier microprocesseur.
Mais en fait, ce développement parallèle relève plus d'un état d'esprit que d'une quelconque préméditation. Au cours des dernières années, le flux et le stockage d'informations numériques à usage domestique ont augmenté beaucoup plus rapidement que notre capacité de voyager dans l'espace. S'il y avait eu une corrélation fiable, la première clé USB ou le premier smartphone auraient sûrement coïncidé au moins avec un voyage vers Mars. Mais l'air du temps n'est pas le seul à blâmer. A quoi bon quitter physiquement la Terre quand le monde entre de plus en plus profondément dans la dimension de l'esprit, et quand à notre tour, à notre ruine ou à notre salut, nous plongeons dans cet infini intérieur, immatériel ?
Ces affirmations peuvent ressembler à celles qui ont surgi une dizaine d'années plus tard, lorsque l'utilisation d'Internet s'est généralisée. Il existe cependant des différences très importantes. Le monde décrit par Lodge laisse encore place à la perte, à la disparition, à la difficulté des retrouvailles, à la recherche désespérée. C'est notamment le cas du personnage de Persse McGarrigle, qui poursuit amoureusement une jeune femme qu'il rencontre lors d'une conférence. Il se demande toujours où elle est. A peine à-il retrouvé sa trace qu'elle est déjà ailleurs. Cela ne lui sert pas à grand choix d'avoir tous les avions à réaction qu'il pouvait espérer ;son agonie est la même que celle de l'amant du Cantique des Cantiques lorsqu'elle demande à chacune des filles de Jérusalem si elles ont vu son bien-aimé.
Il est raisonnable de penser que Google et GPS ont changé la nature de notre expérience bien plus profondément que le gros porteur et la photocopieuse, du moins en ce qui concerne l'oubli et la désorientation. Il y a quelque chose de particulièrement frappant dans le fait qu'un smartphone peut combler les lacunes de notre mémoire ou de nos connaissances concernant presque toutes les questions factuelles susceptibles de nous traverser l'esprit (À quelle heure est le prochain ferry ? le Premier ministre français en 1955 ?), de même qu'un même smartphone peut nous montrer - sur une carte dont l'échelle varie astronomiquement d'Un monde dans lequel Persse McGarrigle peut taper "Angelica Pabst" dans Google, ou trouver son chemin vers elle sur Facebook grâce à de probables connaissances mutuelles,
Cependant, nous pourrions certainement nuancer notre appréciation de l'avènement d'Internet également. Il y a encore des gens dont les traces sur Google sont infinitésimales voire inexistantes, et bon nombre de choses restent insuffisamment archivées. Ou nous pourrions souligner qu'en fait, cela fait longtemps que l'annuaire téléphonique a permis pour la première fois de rechercher un nom, et encore plus longtemps que le sextant et la boussole ont considérablement réduit la désorientation humaine dans des étendues inconnues.
Chaque génération voit les avancées technologiques de l'ère précédente, quelle que soit leur proximité, comme des excroissances d'un monde ancien. Les gens aiment penser que le monde n'a vraiment changé qu'à leur époque. Mais le sentiment d'assister à une accélération spectaculaire qui rejette d'emblée tous les siècles passés, les reléguant dans un bras mort indifférencié incommensurable avec l'expérience actuelle, n'est pas seulement le privilège des enfants qui ont grandi avec Internet et voient les gigantesques ordinateurs conçus après la Seconde Guerre mondiale antiquités non moins étrangères à la vie contemporaine que les perruques poudrées du XVIIIe siècle ou les quadriges du Circus Maximus. « Que le monde n'ait jamais autant changé en un seul siècle (sauf par la destruction) est un fait que nous connaissons tous », écrivait Malraux en 1965. « J'ai moi-même vu les moineaux fondre dans les bus hippomobiles du Palais Royal et le timide et charmant colonel Glenn à son retour du cosmos. Mais une personne qui, née avant Malraux, avait vu naître le cinéma et l'aviation aurait pu légitimement avoir le même sentiment d'assister à un bouleversement fondamental de l'histoire humaine.
Il n'aurait d'ailleurs pas été sans fondement pour une telle personne de dire aux jeunes générations que les exploits de Neil Armstrong étaient essentiellement des ramifications de Clément Ader ou des frères Wright. Et celui qui, même un peu plus tôt, avait aperçu les premiers daguerréotypes aurait pu à son tour prétendre qu'il était celui qui avait assisté à la véritable révolution à partir de laquelle le cinéma n'avait fait que se développer. A contre-courant de cet enthousiasme qui considère le moment présent comme le plus radical, le plus significatif historiquement, il faudrait glisser de plus en plus loin dans le passé, le curseur marquant l'authentique percée, jusqu'à trouver l'événement qui, plus humble peut-être en apparence que les innovations ultérieures, en constituaient néanmoins la condition nécessaire : l'invention véritablement innovatrice,
La théorie du changement exponentiellement croissant a le mérite d'accréditer ces proclamations de révolution de plus en plus fréquentes. Il postule une réelle accélération du progrès technologique à l'origine de notre sentiment, orgueilleux et naïf, mais aussi pertinent, que les bouleversements de l'histoire humaine sont devenus des événements quasi quotidiens. Alors que les gens attendaient des siècles avant de prononcer "Jamais jusqu'à ce jour", nous semblons nous être progressivement autorisés à le dire toutes les quelques décennies, puis toutes les quelques années, bientôt peut-être tous les quelques mois.
Les espoirs que les futuristes tirent de cette théorie sont incertains. Ils semblent moins une conséquence possible des calculs que l'expression d'un rêve fondamental que ces calculs semblent livrer miraculeusement : la promesse d'assister à l'approche, et peut-être même à l'accomplissement, de l'immortalité.
Qu'est-ce qui fait le sentiment révolutionnaire de ces avancées successives ? Qu'est-ce qui les rend si incommensurables avec leurs antécédents ? C'est peut-être le sentiment qu'à travers eux cet objectif d'immortalité prend une forme de plus en plus claire, d'autant plus que chaque pas devient de plus en plus exaltant pour un coureur qui approche de la ligne d'arrivée, même si son rythme n'a pas changé.
Dans son livre Le Phénomène de l'Homme, paru en 1955, le philosophe et prêtre Pierre Teilhard de Chardin contemplait le tournant de l'humanité vers l'intérieur : « J'imagine que notre noosphère est destinée à se refermer sur elle-même dans la solitude — et ce n'est pas dans un direction mentale que nous trouverons notre ligne de fuite, sans avoir à quitter ou même à nous étendre au-delà de la Terre.
Aujourd'hui, les futurologues spéculent qu'un ordinateur pourrait un jour servir de support dans lequel résidera notre réalité mentale – immortelle, à l'abri des allées et venues de la matière.
Deux penchants, distincts mais facilement liés, entraînent l'augmentation de nos capacités techniques : voyager et archiver - au temps de Lodge, voler et Xerox - la possibilité de quitter la Terre, et la possibilité de tout emporter avec nous.
L'invention quasi simultanée de l'avion et de la caméra en est un témoignage frappant. Il est tentant - mais d'autant plus risqué que l'échelle de temps devient alors très condensée - de chercher d'autres conjonctions : celle de Spoutnik et du premier disque dur, des premiers pas de lune et du premier microprocesseur.
Mais en fait, ce développement parallèle relève plus d'un état d'esprit que d'une quelconque préméditation. Au cours des dernières années, le flux et le stockage d'informations numériques à usage domestique ont augmenté beaucoup plus rapidement que notre capacité de voyager dans l'espace. S'il y avait eu une corrélation fiable, la première clé USB ou le premier smartphone auraient sûrement coïncidé au moins avec un voyage vers Mars. Mais l'air du temps n'est pas le seul à blâmer. A quoi bon quitter physiquement la Terre quand le monde entre de plus en plus profondément dans la dimension de l'esprit, et quand à notre tour, à notre ruine ou à notre salut, nous plongeons dans cet infini intérieur, immatériel ?
Chaque fois que j’écris le récit d’un souvenir personnel, je ressens davantage l’impossibilité de m’en tenir aux seules ressources de ma propre mémoire. Il suffit que je veuille évoquer un quartier d’une ville, ou un fait d’actualité qui aurait eu lieu à une certaine époque, pour que j’aille naturellement demander à Google de préciser ou de compléter mes souvenirs. Toute littérature d’introspection – autobiographie ou roman psychologique – devrait aujourd’hui, si elle voulait décrire aussi fidèlement que possible les cheminements d’un esprit, faire apparaître dans à peu près une phrase sur deux le nom de Google.
Souvent, ayant retrouvé sur mon écran le plan détaillé de la ville où j’étais en voyage, ou bien le déroulement exact des événements qui faisaient alors la une des journaux, je redoute qu’une précision trop grande ne corresponde pas à l’état réel de mes souvenirs et donne une impression d’inauthenticité. Mais il est trop tard, quand on a goûté aux fruits de l’arbre de la connaissance, pour retrouver l’état d’innocence psychologique dans lequel on se trouvait auparavant. Alors je cherche une sorte de compromis entre la fidélité à ma mémoire faillible et la volonté de précision qui est aussi vieille que l’usage représentatif des signes. Je rebats toutes les cartes que j’ai entre les mains, celles que je tiens de mes souvenirs et celles que je tiens de Google, et de temps à autre je leur applique indifféremment, sans me soucier que ce soit vrai ou non, des locutions comme « je ne sais plus si c’est au mois d’avril ou au mois de mai que… », « si ma mémoire ne me trompe pas… », « je crois me rappeler qu’à cette époque-là… ». Quelquefois, cependant, je redoute aussi le jugement d’un lecteur qui ne serait pas du tout sensible à cet effort d’imprécision destiné à me conserver une forme humaine traditionnelle, et serait au contraire consterné par mon inaptitude à recourir à Internet – cet instrument fort utile, facile à manipuler, et qui est entré dans les mœurs depuis un certain temps, tout de même ! – pour corriger les manques de ma mémoire.
Il faudrait un équivalent actuel de Marcel Proust, de James Joyce ou de Virginia Woolf (peut-être même quelqu’un qui serait doté d’une hardiesse encore plus grande, car il faudrait ne pas redouter d’être fastidieux à un degré peu imaginable) pour rendre compte de la condition actuelle de l’écrivain en osant avouer (et surtout répéter cet aveu autant de fois que la vérité l’exigerait, c’est-à-dire à peu près tout le temps) de quelle manière s’enchaînent les souvenirs et les recherches sur Google, et de quelle manière, ensuite, la forme finale du récit résulte d’interrogations assez nombreuses au sujet de leur agencement.
Il n’est pas certain qu’il faille attendre de cette évolution dans l’écriture un surcroît général de vérité, malgré l’afflux de récits réalistes, surchargés de documentation, qu’a provoqué inévitablement l’apparition d’Internet comme source d’informations factuelles infinies. Avec la submersion de la mémoire personnelle sous la mémoire du monde, s’effacent aussi les vieilles frontières entre la mémoire et l’imagination, entre le vrai et le faux, entre le moi et le non-moi. J’avais été frappé par un article de Boris Souvarine qui se moquait sévèrement d’Ilya Ehrenbourg et de la manière dont il avait écrit l’histoire de sa vie1. Il relevait de nombreux passages où, selon lui, il s’inventait toutes sortes de rencontres opportunes, dans ses jeunes années, avec ceux qui allaient devenir les protagonistes de la révolution russe, à une époque où ni eux ni Ehrenbourg n’étaient connus et où la probabilité que leurs chemins se croisent était extrêmement faible ou, pour mieux dire, inexistante. Il semblait avoir écrit son autobiographie en ayant sous les yeux des ouvrages d’histoire et en y prélevant des scènes où il s’était inséré comme un témoin privilégié ou un personnage secondaire. Souvarine jugeait très grossière la manière dont était réalisée cette opération et se disait certain de déceler les faux souvenirs d’Ehrenbourg à vue d’œil.
Il serait aujourd’hui facile de procéder à une chirurgie de la mémoire beaucoup plus fine, beaucoup plus insaisissable. Un professeur habitant à New York m’a raconté récemment – c’était quelques mois après ma lecture de Souvarine – qu’il connaissait quelqu’un qui était en train d’aider une personnalité à écrire ses mémoires, et que cette personnalité, avec la complicité de son ghostwriter, avait entrepris d’inventer un épisode dans sa vie, en feignant d’avoir assisté, trente ou quarante ans auparavant, à un match de base-ball – ou de basket-ball, je ne me souviens plus – qui est aujourd’hui encore considéré aux États-Unis comme historique pour une raison que j’ai également oubliée. Le ghostwriter et le commanditaire ont regardé sur YouTube des archives vidéo du match pour décrire la scène aussi précisément que possible. Ils ont pu savoir si le ciel était nuageux ou ensoleillé ; ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère du stade, de l’humeur du public ; ils ont pu retrouver les actions marquantes, celles dont un homme qui aurait vraiment assisté à ce match n’aurait pas pu ne pas se souvenir.
Ehrenbourg paraphrasait des livres d’histoire pour décrire les événements auxquels il n’avait pas pris part ; son récit sonnait faux parce qu’il ne disposait pas des sensations, des petits faits vrais qui attestent d’une expérience vécue. Nous avons désormais des images et des sons pour décrire ces sensations, ces petits faits vrais. Le risque est alors de se gorger de cette profusion de détails et de provoquer chez le lecteur un sentiment d’invraisemblance en faisant étalage d’une précision qui ne correspond pas à l’expérience commune de la mémoire psychologique humaine. C’est l’excès de netteté et d’infaillibilité qui menace de sonner faux. La vraisemblance requiert de faux aveux d’ignorance, de flou intérieur, d’incapacité à se souvenir de tout.
Mais combien de temps devrons-nous ainsi nous efforcer de rester à l’intérieur des bornes naturelles de nos capacités psychologiques ? Imaginons quelqu’un qui aurait vraiment vécu l’événement, et qui voudrait le raconter, bien des années après ; il utiliserait très probablement, lui aussi, les archives d’Internet – comptes rendus détaillés, images et sons enregistrés le jour même – pour compléter ses souvenirs. Nous ferons tous cela un jour. Que vaut alors la différence entre l’homme qui a été là et l’homme qui n’a pas été là ?
L’expérience vécue a perdu ses privilèges. Elle procurait à celui qui en avait été le sujet des images-souvenirs exclusives. Mais celui qui n’a pas fait cette expérience en a lui aussi des images, désormais. Ce match de base-ball d’il y a quarante ans, qui peut en parler le mieux ? Celui qui y était, mais qui n’a plus que ses lointains souvenirs personnels ? Ou celui qui n’y était pas, mais qui a pu le visionner dix fois sur YouTube, intégralement ? Quand un peu de temps a passé, nous nous retrouvons tous au même point, que nous ayons ou non vécu l’événement : nous n’en avons plus que des images, et celui qui en a le plus grand nombre n’est plus celui que l’on croyait.
Dans Blade Runner (Ridley Scott, 1982), les androïdes les plus élaborés sont ceux qui sont persuadés d’être humains parce qu’ils ont des souvenirs d’enfance – ils ne peuvent donc pas être des machines fabriquées avec une physionomie d’adulte. La scène où Sean Young tend à Harrison Ford une photographie d’elle âgée de quelques années à peine, comme une preuve de son enfance et donc de son humanité, est d’une grande force parce qu’elle nous rappelle un phénomène qui nous est familier, à nous qui ne sommes pourtant pas des robots : celui de ces souvenirs de notre petite enfance qui ressemblent beaucoup à des photographies qu’on nous a montrées quand nous avons grandi, et qui sont probablement, en réalité, des transpositions de ces photographies, mais tellement indiscernables de souvenirs véritables que nous n’aurions aucune raison de mettre en doute leur authenticité, si nous venions à perdre ces clichés ou à oublier leur existence. La zone de nos tout premiers souvenirs est celle où l’indistinction entre l’intériorité et l’extériorité, entre les images mentales et les images mécaniquement enregistrées, entre la mémoire personnelle et la mémoire du monde, est la plus grande. Il n’est pas impossible que notre avenir soit à l’image de cette origine.
Souvent, ayant retrouvé sur mon écran le plan détaillé de la ville où j’étais en voyage, ou bien le déroulement exact des événements qui faisaient alors la une des journaux, je redoute qu’une précision trop grande ne corresponde pas à l’état réel de mes souvenirs et donne une impression d’inauthenticité. Mais il est trop tard, quand on a goûté aux fruits de l’arbre de la connaissance, pour retrouver l’état d’innocence psychologique dans lequel on se trouvait auparavant. Alors je cherche une sorte de compromis entre la fidélité à ma mémoire faillible et la volonté de précision qui est aussi vieille que l’usage représentatif des signes. Je rebats toutes les cartes que j’ai entre les mains, celles que je tiens de mes souvenirs et celles que je tiens de Google, et de temps à autre je leur applique indifféremment, sans me soucier que ce soit vrai ou non, des locutions comme « je ne sais plus si c’est au mois d’avril ou au mois de mai que… », « si ma mémoire ne me trompe pas… », « je crois me rappeler qu’à cette époque-là… ». Quelquefois, cependant, je redoute aussi le jugement d’un lecteur qui ne serait pas du tout sensible à cet effort d’imprécision destiné à me conserver une forme humaine traditionnelle, et serait au contraire consterné par mon inaptitude à recourir à Internet – cet instrument fort utile, facile à manipuler, et qui est entré dans les mœurs depuis un certain temps, tout de même ! – pour corriger les manques de ma mémoire.
Il faudrait un équivalent actuel de Marcel Proust, de James Joyce ou de Virginia Woolf (peut-être même quelqu’un qui serait doté d’une hardiesse encore plus grande, car il faudrait ne pas redouter d’être fastidieux à un degré peu imaginable) pour rendre compte de la condition actuelle de l’écrivain en osant avouer (et surtout répéter cet aveu autant de fois que la vérité l’exigerait, c’est-à-dire à peu près tout le temps) de quelle manière s’enchaînent les souvenirs et les recherches sur Google, et de quelle manière, ensuite, la forme finale du récit résulte d’interrogations assez nombreuses au sujet de leur agencement.
Il n’est pas certain qu’il faille attendre de cette évolution dans l’écriture un surcroît général de vérité, malgré l’afflux de récits réalistes, surchargés de documentation, qu’a provoqué inévitablement l’apparition d’Internet comme source d’informations factuelles infinies. Avec la submersion de la mémoire personnelle sous la mémoire du monde, s’effacent aussi les vieilles frontières entre la mémoire et l’imagination, entre le vrai et le faux, entre le moi et le non-moi. J’avais été frappé par un article de Boris Souvarine qui se moquait sévèrement d’Ilya Ehrenbourg et de la manière dont il avait écrit l’histoire de sa vie1. Il relevait de nombreux passages où, selon lui, il s’inventait toutes sortes de rencontres opportunes, dans ses jeunes années, avec ceux qui allaient devenir les protagonistes de la révolution russe, à une époque où ni eux ni Ehrenbourg n’étaient connus et où la probabilité que leurs chemins se croisent était extrêmement faible ou, pour mieux dire, inexistante. Il semblait avoir écrit son autobiographie en ayant sous les yeux des ouvrages d’histoire et en y prélevant des scènes où il s’était inséré comme un témoin privilégié ou un personnage secondaire. Souvarine jugeait très grossière la manière dont était réalisée cette opération et se disait certain de déceler les faux souvenirs d’Ehrenbourg à vue d’œil.
Il serait aujourd’hui facile de procéder à une chirurgie de la mémoire beaucoup plus fine, beaucoup plus insaisissable. Un professeur habitant à New York m’a raconté récemment – c’était quelques mois après ma lecture de Souvarine – qu’il connaissait quelqu’un qui était en train d’aider une personnalité à écrire ses mémoires, et que cette personnalité, avec la complicité de son ghostwriter, avait entrepris d’inventer un épisode dans sa vie, en feignant d’avoir assisté, trente ou quarante ans auparavant, à un match de base-ball – ou de basket-ball, je ne me souviens plus – qui est aujourd’hui encore considéré aux États-Unis comme historique pour une raison que j’ai également oubliée. Le ghostwriter et le commanditaire ont regardé sur YouTube des archives vidéo du match pour décrire la scène aussi précisément que possible. Ils ont pu savoir si le ciel était nuageux ou ensoleillé ; ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère du stade, de l’humeur du public ; ils ont pu retrouver les actions marquantes, celles dont un homme qui aurait vraiment assisté à ce match n’aurait pas pu ne pas se souvenir.
Ehrenbourg paraphrasait des livres d’histoire pour décrire les événements auxquels il n’avait pas pris part ; son récit sonnait faux parce qu’il ne disposait pas des sensations, des petits faits vrais qui attestent d’une expérience vécue. Nous avons désormais des images et des sons pour décrire ces sensations, ces petits faits vrais. Le risque est alors de se gorger de cette profusion de détails et de provoquer chez le lecteur un sentiment d’invraisemblance en faisant étalage d’une précision qui ne correspond pas à l’expérience commune de la mémoire psychologique humaine. C’est l’excès de netteté et d’infaillibilité qui menace de sonner faux. La vraisemblance requiert de faux aveux d’ignorance, de flou intérieur, d’incapacité à se souvenir de tout.
Mais combien de temps devrons-nous ainsi nous efforcer de rester à l’intérieur des bornes naturelles de nos capacités psychologiques ? Imaginons quelqu’un qui aurait vraiment vécu l’événement, et qui voudrait le raconter, bien des années après ; il utiliserait très probablement, lui aussi, les archives d’Internet – comptes rendus détaillés, images et sons enregistrés le jour même – pour compléter ses souvenirs. Nous ferons tous cela un jour. Que vaut alors la différence entre l’homme qui a été là et l’homme qui n’a pas été là ?
L’expérience vécue a perdu ses privilèges. Elle procurait à celui qui en avait été le sujet des images-souvenirs exclusives. Mais celui qui n’a pas fait cette expérience en a lui aussi des images, désormais. Ce match de base-ball d’il y a quarante ans, qui peut en parler le mieux ? Celui qui y était, mais qui n’a plus que ses lointains souvenirs personnels ? Ou celui qui n’y était pas, mais qui a pu le visionner dix fois sur YouTube, intégralement ? Quand un peu de temps a passé, nous nous retrouvons tous au même point, que nous ayons ou non vécu l’événement : nous n’en avons plus que des images, et celui qui en a le plus grand nombre n’est plus celui que l’on croyait.
Dans Blade Runner (Ridley Scott, 1982), les androïdes les plus élaborés sont ceux qui sont persuadés d’être humains parce qu’ils ont des souvenirs d’enfance – ils ne peuvent donc pas être des machines fabriquées avec une physionomie d’adulte. La scène où Sean Young tend à Harrison Ford une photographie d’elle âgée de quelques années à peine, comme une preuve de son enfance et donc de son humanité, est d’une grande force parce qu’elle nous rappelle un phénomène qui nous est familier, à nous qui ne sommes pourtant pas des robots : celui de ces souvenirs de notre petite enfance qui ressemblent beaucoup à des photographies qu’on nous a montrées quand nous avons grandi, et qui sont probablement, en réalité, des transpositions de ces photographies, mais tellement indiscernables de souvenirs véritables que nous n’aurions aucune raison de mettre en doute leur authenticité, si nous venions à perdre ces clichés ou à oublier leur existence. La zone de nos tout premiers souvenirs est celle où l’indistinction entre l’intériorité et l’extériorité, entre les images mentales et les images mécaniquement enregistrées, entre la mémoire personnelle et la mémoire du monde, est la plus grande. Il n’est pas impossible que notre avenir soit à l’image de cette origine.
Dans son journal de l’année 1997, publié vingt ans après, Marc Lambron cite la nécrologie qu’il écrivit pour Madame Figaro au lendemain de la mort de Lady Diana. La première phrase m’a jeté aussitôt, quand je l’ai lue, dans un trouble profond que son aspect plutôt anodin ne présageait en rien : « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis. » Comment écrivait-on une phrase comme celle-ci en 1997, sans l’auxiliaire infini d’Internet ? Il y avait donc des gens qui savaient de telles choses sans les avoir trouvées, quelques minutes auparavant, sur Google ? C’était quelque part dans leur cerveau, et ils pouvaient y accéder instantanément quand ils en avaient besoin, par exemple pour écrire un article ? Était-ce rare ? En aurais-je été capable ? Le plus troublant était qu’il me paraissait impossible de répondre à ces questions ; je ne parvenais pas à me replacer dans l’état d’innocence psychologique de 1997. Ces années au cours desquelles Internet a profondément changé notre rapport à la connaissance empirique faisaient écran devant ma mémoire.
Certes, Internet existait en 1997 et il était accessible au public ; mais ceux qui l’utilisaient étaient rares et ne se connectaient que de loin en loin ; au reste, les informations historiques qu’on y trouvait n’étaient pas nombreuses et souvent peu fiables. Il ne jouait absolument aucun rôle dans ma vie ni dans celle de mes amis d’alors, et pas davantage dans celle de Marc Lambron, telle qu’elle apparaît au fil de son journal. C’était le début de ce qu’on pourrait appeler l’ère proto-numérique, du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, que je caractériserais par le fait que, malgré l’existence et la disponibilité d’Internet, il était encore possible, et même assez courant, d’exercer la plupart ou même la totalité de nos activités pratiques et intellectuelles sans recourir à lui.
Je n’arrivais pas à imaginer l’écriture d’une telle phrase autrement que sur le fond de notre recours permanent à Internet. J’ai tenté l’effort. Je me suis dit, imaginons que je sois privé de réseau et que je doive par exemple écrire quelque chose sur un homme né en 1938. Je saurais noter, sans avoir besoin de Google, quelque chose comme : « Il était né en 1938, l’année de Munich et celle de la Grande Illusion », ou encore : « Il était né en 1938, l’année des accords de Munich, celle où Sartre publia la Nausée. » (Je m’en rends compte en transcrivant cette hypothèse : c’est plus facile que pour 1961, et nombreuses sont les années pour lesquelles, spontanément, je serais bien incapable de citer deux événements significatifs – 1957, par exemple.)
Mais combien de temps durerait mon innocence psychologique ? J’aurais si peur de me tromper et d’être férocement démenti par les lecteurs, qui maintenant peuvent tout savoir, que naturellement je vérifierais sur Google, même en étant sûr de moi, et cette vérification me plongerait dans tout un monde de nouvelles informations, de détails, où je déambulerais par curiosité, où je chercherais peut-être d’autres exemples, totalement différents de ceux auxquels j’avais d’abord pensé – à vrai dire, je les trouverais sans les chercher, ils s’imposeraient à moi dans leur variété et leur surabondance, des exemples amusants, anecdotiques, des exemples qui surprendraient, qui flatteraient encore le désir du lecteur omniscient et rassasié comme Lucullus de données empiriques, je regarderais sur Wikipédia les pages qui s’intitulent « Année 1938 dans le monde », « Année 1938 au cinéma », « Année 1938 en littérature », « Décès en 1938 », « Naissance en 1938 », etc., et tout d’un coup, en quelques minutes, je passerais de la pénurie à l’embarras du choix, je pourrais écrire, parmi des dizaines de combinaisons possibles, plus ou moins spirituelles, plus ou moins astucieuses, des phrases comme : « Il était né en 1938, l’année de la mort d’Atatürk, celle où Raymond Aron publia sa thèse de philosophie chez Gallimard », ou bien : « Il était né en 1938, l’année de la mort de Suzanne Lenglen, celle où Pearl Buck reçut le prix Nobel de littérature. »
Je me sentais d’autant plus renvoyé à l’omniprésence d’Internet que je m’efforçais d’en faire abstraction. Il était presque aussi difficile de reconstituer, ne serait-ce qu’un instant, la vie de l’esprit à l’ère pré-numérique que d’imaginer la manière dont un aveugle de naissance se représente intérieurement une figure géométrique. De même que nous luttons en vain contre notre expérience de la vue quand nous essayons de nous mettre à la place de quelqu’un qui en a toujours été privé, de même nous luttons en vain contre l’expérience de notre recours permanent à Internet comme à un nouvel organe, quand nous essayons de nous replacer dans l’époque où il était absent de notre monde.
Cela ne veut pas dire que nous écrirons nécessairement des choses différentes. Nous pourrons écrire les mêmes choses qu’avant ; nous le ferons souvent, et souvent même nous nous efforcerons de le faire. Mais la genèse de ces phrases, le cheminement qui leur aura donné forme, l’arrière-plan mental sur le fond duquel elles se détacheront ne seront plus jamais les mêmes.
En consignant ce qui précède, je me suis souvenu tardivement du conte de Borges dans lequel le Don Quichotte réécrit mot pour mot à l’identique par un certain Pierre Ménard au xxe siècle est une œuvre absolument différente du Don Quichotte de Cervantes. Ce que j’avais perçu en lisant cette page, c’est tout simplement que cette phrase écrite en 1997, « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis », est absolument différente de la même phrase écrite en 2017, à l’époque de Google et de Wikipédia.
Certes, Internet existait en 1997 et il était accessible au public ; mais ceux qui l’utilisaient étaient rares et ne se connectaient que de loin en loin ; au reste, les informations historiques qu’on y trouvait n’étaient pas nombreuses et souvent peu fiables. Il ne jouait absolument aucun rôle dans ma vie ni dans celle de mes amis d’alors, et pas davantage dans celle de Marc Lambron, telle qu’elle apparaît au fil de son journal. C’était le début de ce qu’on pourrait appeler l’ère proto-numérique, du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, que je caractériserais par le fait que, malgré l’existence et la disponibilité d’Internet, il était encore possible, et même assez courant, d’exercer la plupart ou même la totalité de nos activités pratiques et intellectuelles sans recourir à lui.
Je n’arrivais pas à imaginer l’écriture d’une telle phrase autrement que sur le fond de notre recours permanent à Internet. J’ai tenté l’effort. Je me suis dit, imaginons que je sois privé de réseau et que je doive par exemple écrire quelque chose sur un homme né en 1938. Je saurais noter, sans avoir besoin de Google, quelque chose comme : « Il était né en 1938, l’année de Munich et celle de la Grande Illusion », ou encore : « Il était né en 1938, l’année des accords de Munich, celle où Sartre publia la Nausée. » (Je m’en rends compte en transcrivant cette hypothèse : c’est plus facile que pour 1961, et nombreuses sont les années pour lesquelles, spontanément, je serais bien incapable de citer deux événements significatifs – 1957, par exemple.)
Mais combien de temps durerait mon innocence psychologique ? J’aurais si peur de me tromper et d’être férocement démenti par les lecteurs, qui maintenant peuvent tout savoir, que naturellement je vérifierais sur Google, même en étant sûr de moi, et cette vérification me plongerait dans tout un monde de nouvelles informations, de détails, où je déambulerais par curiosité, où je chercherais peut-être d’autres exemples, totalement différents de ceux auxquels j’avais d’abord pensé – à vrai dire, je les trouverais sans les chercher, ils s’imposeraient à moi dans leur variété et leur surabondance, des exemples amusants, anecdotiques, des exemples qui surprendraient, qui flatteraient encore le désir du lecteur omniscient et rassasié comme Lucullus de données empiriques, je regarderais sur Wikipédia les pages qui s’intitulent « Année 1938 dans le monde », « Année 1938 au cinéma », « Année 1938 en littérature », « Décès en 1938 », « Naissance en 1938 », etc., et tout d’un coup, en quelques minutes, je passerais de la pénurie à l’embarras du choix, je pourrais écrire, parmi des dizaines de combinaisons possibles, plus ou moins spirituelles, plus ou moins astucieuses, des phrases comme : « Il était né en 1938, l’année de la mort d’Atatürk, celle où Raymond Aron publia sa thèse de philosophie chez Gallimard », ou bien : « Il était né en 1938, l’année de la mort de Suzanne Lenglen, celle où Pearl Buck reçut le prix Nobel de littérature. »
Je me sentais d’autant plus renvoyé à l’omniprésence d’Internet que je m’efforçais d’en faire abstraction. Il était presque aussi difficile de reconstituer, ne serait-ce qu’un instant, la vie de l’esprit à l’ère pré-numérique que d’imaginer la manière dont un aveugle de naissance se représente intérieurement une figure géométrique. De même que nous luttons en vain contre notre expérience de la vue quand nous essayons de nous mettre à la place de quelqu’un qui en a toujours été privé, de même nous luttons en vain contre l’expérience de notre recours permanent à Internet comme à un nouvel organe, quand nous essayons de nous replacer dans l’époque où il était absent de notre monde.
Cela ne veut pas dire que nous écrirons nécessairement des choses différentes. Nous pourrons écrire les mêmes choses qu’avant ; nous le ferons souvent, et souvent même nous nous efforcerons de le faire. Mais la genèse de ces phrases, le cheminement qui leur aura donné forme, l’arrière-plan mental sur le fond duquel elles se détacheront ne seront plus jamais les mêmes.
En consignant ce qui précède, je me suis souvenu tardivement du conte de Borges dans lequel le Don Quichotte réécrit mot pour mot à l’identique par un certain Pierre Ménard au xxe siècle est une œuvre absolument différente du Don Quichotte de Cervantes. Ce que j’avais perçu en lisant cette page, c’est tout simplement que cette phrase écrite en 1997, « Elle était née en 1961, l’année de la mort d’Hemingway, celle où Louis Malle tournait Vie privée – l’histoire d’une idole mondiale traquée par les paparazzis », est absolument différente de la même phrase écrite en 2017, à l’époque de Google et de Wikipédia.
Videos de Maël Renouard (13)
Voir plusAjouter une vidéo
L'Historiographe du royaume de Maël Renouard aux éditions Livre de Poche
https://www.lagriffenoire.com/1103783-romans-l-historiographe-du-royaume.html
•
•
•
Chinez & découvrez nos livres coups d'coeur dans notre librairie en ligne lagriffenoire.com
•
Notre chaîne Youtube : Griffenoiretv
•
Notre Newsletter https://www.lagriffenoire.com/?fond=newsletter
•
Vos libraires passionnés,
Gérard Collard & Jean-Edgar Casel
•
•
•
#lagriffenoire #bookish #bookgeek #bookhoarder #igbooks #bookstagram #instabook #booklover #novel #lire #livres #conseillecture #editionslivredepoche
autres livres classés : essai littéraireVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Maël Renouard (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
853 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre853 lecteurs ont répondu