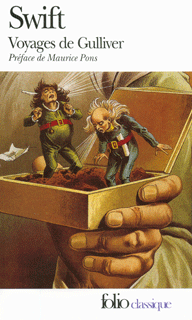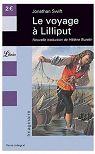Edité en 1965 dans la collection super 1000, avec une adaptation de Claude Radeval, ce vieux texte, publié en 1721 par Swift, devenait plus accessible aux jeunes. Je l'ai donc lu vers 12 ans et j'en garde un bon souvenir; bien sûr au XXIème siècle, nous avons des ouvrages de science-fiction plus élaborés et plus spectaculaires, mais je crois qu'il garde encore de l'intérêt aujourd'hui.
Je viens d'ailleurs reprendre cette lecture et j'y trouve toute la richesse philosophique de l'auteur qui passe au-dessus de l'adolescent que j'étais en quête de science-fiction et d'aventure.
Le parallèle avec Micromégas et d'autres oeuvres voltairiennes est inévitable. Les contemporains de l'auteur ne sont pas plus épargnés que ceux De Voltaire mais, ici, le style britannique apporte des nuances goûteuses différentes de la prose De Voltaire.
L'histoire de Gulliver est teintée des nuances apportées tant par les perceptions du héros lui-même que par celles des habitants de Lilliput. Et celles-ci vont se confronter au point que le héros finit par perdre en quelque sorte son identité et qu'il se réfugie dans la misanthropie.
La relation de Gulliver avec les lilliputiens le met face à ses convictions, l'amène à une réflexion sur ses semblables qui reste d'actualité quatre siècles plus tard.
Je viens d'ailleurs reprendre cette lecture et j'y trouve toute la richesse philosophique de l'auteur qui passe au-dessus de l'adolescent que j'étais en quête de science-fiction et d'aventure.
Le parallèle avec Micromégas et d'autres oeuvres voltairiennes est inévitable. Les contemporains de l'auteur ne sont pas plus épargnés que ceux De Voltaire mais, ici, le style britannique apporte des nuances goûteuses différentes de la prose De Voltaire.
L'histoire de Gulliver est teintée des nuances apportées tant par les perceptions du héros lui-même que par celles des habitants de Lilliput. Et celles-ci vont se confronter au point que le héros finit par perdre en quelque sorte son identité et qu'il se réfugie dans la misanthropie.
La relation de Gulliver avec les lilliputiens le met face à ses convictions, l'amène à une réflexion sur ses semblables qui reste d'actualité quatre siècles plus tard.
Voilà que je continue mes séances de rattrapage en lisant des oeuvres que j'aurais dû découvrir lorsque j'avais dix ans. Cela a un avantage, c'est que bien souvent il y a deux niveaux de lecture (ou davantage). Tous ces romans d'aventure cachent forcément autre chose. Dans le cas de Gulliver, ceux et celles qui cherchent le bon roman d'aventures aux constants rebondissements et à l'intrigue tarabiscotée en seront pour leurs frais. Car, une fois le livre terminé, si on se penche sur la vie de Swift on constate que, comme les dramaturges français de la même époque, il prend un plaisir à mettre en scène des personnages en double jeu. Derrière la caricature se cache des personnes bien vivantes et contemporaines de l'auteur. Ainsi, Swift règle ses comptes. Alors, forcément, 300 ans plus tard, tout ceci semble un peu puéril. Il reste cependant que les vues de Swift sur le monde sont étonnamment modernes. Il suffit de parcourir le passage traitant de l'Angleterre et des habitudes de ses concitoyens dans le chapitre VI de la troisième partie des voyages pour s'apercevoir que, à une virgule près, on peut tenir le même discours actuellement : l'empreinte écologique et la mondialisation y sont purement et simplement décrites!
Sous couvert de voyages fantastiques, Gulliver nous livre un véritable traité philosophique. Tout y passe, à commencer par la question du point de vue. Question centrale du roman. Au fil des chapitres, on se remet en question, on devient malgré soi philanthrope. La perception que nous avons du monde, et de ses habitants par conséquent, diffère selon l'angle de vue. Nous sommes tributaires d'un conditionnement innée. Notre entourage, notre civilisation, notre espèce même nous dictent nos impressions, notre entendement. Nous sommes esclaves de notre style de vie. Il nous est difficile de nous mettre à la place d'autres personnes, alors de là à penser comme un crustacé et partager la vision d'une étoile… Ce même principe explique que pendant des siècles et d'après la simple constations visuelle, on a cru que le soleil tournait autour de la Terre, obstinément plate comme la main. On prétend que les voyages forment la jeunesse; dans le cas de Gulliver ils ouvrent l'esprit. Propulsé d'abord dans un monde miniature, il se retrouve plus tard dans l'exact contraire, devenu lilliputien lui-même. Cela en exprime long sur la différence qui ne doit jamais impliquer l'inégalité. Mais il ne s'agit là que d'humains après tout. Son séjour chez les Houyhnhnms dépasse de loin la notion d'espèce. Au contact de ces chevaux doués d'une grandeur d'âme qu'on ne rencontre guère chez les humains (pardon, les Yahoos), Gulliver va en arriver à exécrer sa propre espèce (Swift était misanthrope) et aura du mal à réintégrer le monde des hommes. N'allez toutefois pas croire que ces voyages se lisent comme un livre de philosophie avec migraine et mal de crane en perspective. On y rit beaucoup et le côté Rabelaisien, limite scatologique, ravira les plus jeunes d'esprit. On découvre les inconvénients de l'immortalité et la futilité voire l'inutilité des inventions scientifiques lorsque celles-ci frisent la psychose (j'ai immédiatement pensé au Catalogue des Objets Introuvables de Carelman ou encore au Codex Seraphinianius). Gulliver invite à l'altruisme. C'est l'anti Robinson Crusoé. Laissez donc s'exprimer le Gulliver qui sommeille en vous et efforcez-vous de regarder le monde par l'autre bout de la lorgnette.
Sous couvert de voyages fantastiques, Gulliver nous livre un véritable traité philosophique. Tout y passe, à commencer par la question du point de vue. Question centrale du roman. Au fil des chapitres, on se remet en question, on devient malgré soi philanthrope. La perception que nous avons du monde, et de ses habitants par conséquent, diffère selon l'angle de vue. Nous sommes tributaires d'un conditionnement innée. Notre entourage, notre civilisation, notre espèce même nous dictent nos impressions, notre entendement. Nous sommes esclaves de notre style de vie. Il nous est difficile de nous mettre à la place d'autres personnes, alors de là à penser comme un crustacé et partager la vision d'une étoile… Ce même principe explique que pendant des siècles et d'après la simple constations visuelle, on a cru que le soleil tournait autour de la Terre, obstinément plate comme la main. On prétend que les voyages forment la jeunesse; dans le cas de Gulliver ils ouvrent l'esprit. Propulsé d'abord dans un monde miniature, il se retrouve plus tard dans l'exact contraire, devenu lilliputien lui-même. Cela en exprime long sur la différence qui ne doit jamais impliquer l'inégalité. Mais il ne s'agit là que d'humains après tout. Son séjour chez les Houyhnhnms dépasse de loin la notion d'espèce. Au contact de ces chevaux doués d'une grandeur d'âme qu'on ne rencontre guère chez les humains (pardon, les Yahoos), Gulliver va en arriver à exécrer sa propre espèce (Swift était misanthrope) et aura du mal à réintégrer le monde des hommes. N'allez toutefois pas croire que ces voyages se lisent comme un livre de philosophie avec migraine et mal de crane en perspective. On y rit beaucoup et le côté Rabelaisien, limite scatologique, ravira les plus jeunes d'esprit. On découvre les inconvénients de l'immortalité et la futilité voire l'inutilité des inventions scientifiques lorsque celles-ci frisent la psychose (j'ai immédiatement pensé au Catalogue des Objets Introuvables de Carelman ou encore au Codex Seraphinianius). Gulliver invite à l'altruisme. C'est l'anti Robinson Crusoé. Laissez donc s'exprimer le Gulliver qui sommeille en vous et efforcez-vous de regarder le monde par l'autre bout de la lorgnette.
De l'orgueil.
Les voyages de Gulliver à Lilliput et ailleurs nous amènent à considérer la position d'un voyageur « civilisé » vis à vis d'autres civilisations. Comme dans n'importe quel récit de voyage, qu'il s'agisse de littérature relevant de l'imaginaire ou de littérature plus scientifique,je pense surtout aux écrits des navigateurs qui rapportent leurs expéditions, le voyageur, tel un colon, se pense plus grand que les autres, il se voit comme un géant, comme un dominant. Mais Gulliver se retrouve très vite et en fait, dans le départ, dans la situation inverse, puisqu'il se retrouve dans la position du prisonnier ou de l'invité, en situation donc de subordination vis à vis de ceux qui l'accueillent, qu'ils soient agressifs (ce qui est rare) ou de bons hôtes, tellement bons parfois qu'ils se ruineraient, comme les Lilliputiens, pour satisfaire son appétit d'ogre. Après Lilliput, Gulliver se retrouve dans la position inverse puisqu'il se retrouve rétréci dans un monde de géants. Et c'est là qu'il en prend un coup à son ego, traité qu'il est comme un animal de foire, comme un animal, comme une vulgaire poupée de chiffon, et il se retrouve même maltraité par un singe. En même temps, en plus de traiter de l'orgueil de tout un chacun, Swift nous parle de l'orgueil des nations et se moque allégrement des peuples colonisateurs, européens (l'Angleterre, la France, l'Espagne, et cie), et par la bouche des autres peuples imaginaires, il accuse les Européens de corruption, dans tous les sens du terme. En effet, Gulliver a beau être un hôte bien élevé, dès qu'il parle de son pays, l'Angleterre, il horrifie ses auditeurs qui découvrent que les Européens sont non seulement denués de raison mais pire, de vertu. Et il s'amuse même en insultant les Européens non pas par l'entremise directe de Gulliver mais en donnant la parole à des chevaux bien plus raisonnables que les humains (c'est en tout cas l'avis de Gulliver). À Laputa, où Gulliver découvre une île flottante et un peuple d'intellectuels ou non plutôt de pédants, de rêveurs dépourvus de bon sens, il s'attaque non pas tant à la vertu mais bien plus à la raison et plus précisément à la science. Dans son voyage précédent, déjà, les géants se moquaient de la technologie, de la poudre à canon par exemple, accusant la technologie de servir le chaos et non l'ordre (Gulliver leur ayant parlé de la guerre, se faisait dans sa description enthousiaste de la guerre plus violent que des géants, ce qui n'est pas sans rappeler certains journalistes qui nous décrivent avec emphase les canons Caesar mais passons). Pour en revenir à Laputa, les ingénieurs, les scientifiques et cie, passent leur temps à faire des calculs compliqués et à viser la Lune mais n'ont vraiment pas les pieds sur terre et ce peuple de géomètres et de philosophes sont plus tournés vers le soleil et vers la lune que vers leur île ; et ils ne sont pas sans rappeler eux qui sont censés être des « lumières », au contraire, des obscurantistes, qui passent leur temps à tenter de démontrer des inepties. Ils craignent sans cesse qu'une comète ne détruise leur planète (voir l'expérience récente de la NASA censée nous démontrer la toute-puissance de la technologie et la suprématie de la science), ils sont aussi effrayés par l'idée que le soleil ne brûle leur planète (réchauffement climatique), et ils pratiquent la géo-ingénierie, décidant de provoquer des sécheresses, en privant telle ou telle partie du monde de pluie, pour se défendre de toute sédition et de toute protestation … C'est à se demander où Swift est allé chercher ses idées, là encore ?! Sûrement chez des complotistes de son temps. Chez les Balnibarbes, il a encore toute une réflexion sur l'écologie en opposant deux parties de la population : il y a la majeure partie du peuple qui vit sur une terre stérile, dans des maisons en ruines, et le peuple se retrouve en haillons et il y a une minorité de personnes qui vit dans des maisons plus honorables, entourées de jardins et de terre fertile alors Gulliver demande l'explication et on lui explique que l'innovation, dans ce pays, a engendré des terres stériles et a fait que le savoir-faire s'est perdu, alors qu'une maigre partie de la population, moquée par les autres, s'est au contraire attachée au savoir-faire de leurs ancêtres, aux techniques agricoles anciennes, et a su se préserver du progressisme … Mais on accuse ces derniers de nuire au bien général du pays, bien qu'il s'agisse des rares qui arrivent à nourrir les autres … On voit bien dans ces extraits où se situe Swift dans la « Querelle des Anciens et des Modernes » qui me paraît plus politique que littéraire, in fine … Sa critique de la science, à Laputa, s'attache énormément à la question de l'écologie, comme je le disais et s'intéresse donc aussi à l'alimentation et je dois dire que j'ai bien ri lorsque Gulliver rencontre en visitant l'Académie un microbiologistes qui a pour tâche de, je cite, « reconstituer les éléments des matières ayant servi à l'alimentation, pour les faire retourner à l'état d'aliment ». Cela expliquerait le pourquoi des matières fécales dans l'alimentation (voir l'affaire des tartes au - chocolat – (Veuillez remplacer par le terme adéquat) d'Ikea). Pour aller plus loin, j'ai lu après avoir fini les Voyages de Gulliver, sa Modeste proposition : Pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public et je dois dire que cette modeste proposition, que cette idée-là, est encore plus ignoble que l'idée du microbiologiste mais je n'encourage pas pour autant le microbiologiste à poursuivre ses études.
Mettons fin à mes digressions sur la science et mettons fin aux voyages de Gulliver, en nous arrêtons sur cette dernière recommandation des Houyhnhnms : Que les Européens, etc. et autres superpuissances s'arrêtent un peu de temps en temps et qu'il serait inutile voire dangereux pour les pays visités d'être colonisés par eux et qu'il serait judicieux au contraire de les laisser se faire civiliser, dompter, par les Houyhnhnms. Gulliver est d'accord avec les Houyhnhnms car en présence des Houyhnhnms et de tous ceux qu'il appelle ses « Maîtres » lors de ses voyages, il s'est rendu compte que les Européens, et même par extension, les humains en règle générale, les yahous, sont des êtres tellement imparfaits, tellement monstrueux, qu'il finit par en avoir horreur et devient misanthrope, lui qui a parcouru le monde et rencontré tant de personnes étonnantes … et il finit par se replier sur lui-même, se sentant toujours à la fin, sans doute supérieur à ses semblables ? Ou la raison n'est-elle pas au contraire qu'il a pris une telle leçon d'humilité sur lui-même et sur ses semblables, sur sa nation vis à vis d'autres nations, et même sur son espèce vis à vis d'autres espèces, qu'il se sent trop « yahou » pour pouvoir revenir à la civilisation ? Ce qui explique pourquoi il s'ensauvage, à la fin … Et Swift lui-même après les Voyages de Gulliver, manque de se retrouver cannibale (mais dans l'intérêt de la civilisation là par contre !)
Les voyages de Gulliver à Lilliput et ailleurs nous amènent à considérer la position d'un voyageur « civilisé » vis à vis d'autres civilisations. Comme dans n'importe quel récit de voyage, qu'il s'agisse de littérature relevant de l'imaginaire ou de littérature plus scientifique,je pense surtout aux écrits des navigateurs qui rapportent leurs expéditions, le voyageur, tel un colon, se pense plus grand que les autres, il se voit comme un géant, comme un dominant. Mais Gulliver se retrouve très vite et en fait, dans le départ, dans la situation inverse, puisqu'il se retrouve dans la position du prisonnier ou de l'invité, en situation donc de subordination vis à vis de ceux qui l'accueillent, qu'ils soient agressifs (ce qui est rare) ou de bons hôtes, tellement bons parfois qu'ils se ruineraient, comme les Lilliputiens, pour satisfaire son appétit d'ogre. Après Lilliput, Gulliver se retrouve dans la position inverse puisqu'il se retrouve rétréci dans un monde de géants. Et c'est là qu'il en prend un coup à son ego, traité qu'il est comme un animal de foire, comme un animal, comme une vulgaire poupée de chiffon, et il se retrouve même maltraité par un singe. En même temps, en plus de traiter de l'orgueil de tout un chacun, Swift nous parle de l'orgueil des nations et se moque allégrement des peuples colonisateurs, européens (l'Angleterre, la France, l'Espagne, et cie), et par la bouche des autres peuples imaginaires, il accuse les Européens de corruption, dans tous les sens du terme. En effet, Gulliver a beau être un hôte bien élevé, dès qu'il parle de son pays, l'Angleterre, il horrifie ses auditeurs qui découvrent que les Européens sont non seulement denués de raison mais pire, de vertu. Et il s'amuse même en insultant les Européens non pas par l'entremise directe de Gulliver mais en donnant la parole à des chevaux bien plus raisonnables que les humains (c'est en tout cas l'avis de Gulliver). À Laputa, où Gulliver découvre une île flottante et un peuple d'intellectuels ou non plutôt de pédants, de rêveurs dépourvus de bon sens, il s'attaque non pas tant à la vertu mais bien plus à la raison et plus précisément à la science. Dans son voyage précédent, déjà, les géants se moquaient de la technologie, de la poudre à canon par exemple, accusant la technologie de servir le chaos et non l'ordre (Gulliver leur ayant parlé de la guerre, se faisait dans sa description enthousiaste de la guerre plus violent que des géants, ce qui n'est pas sans rappeler certains journalistes qui nous décrivent avec emphase les canons Caesar mais passons). Pour en revenir à Laputa, les ingénieurs, les scientifiques et cie, passent leur temps à faire des calculs compliqués et à viser la Lune mais n'ont vraiment pas les pieds sur terre et ce peuple de géomètres et de philosophes sont plus tournés vers le soleil et vers la lune que vers leur île ; et ils ne sont pas sans rappeler eux qui sont censés être des « lumières », au contraire, des obscurantistes, qui passent leur temps à tenter de démontrer des inepties. Ils craignent sans cesse qu'une comète ne détruise leur planète (voir l'expérience récente de la NASA censée nous démontrer la toute-puissance de la technologie et la suprématie de la science), ils sont aussi effrayés par l'idée que le soleil ne brûle leur planète (réchauffement climatique), et ils pratiquent la géo-ingénierie, décidant de provoquer des sécheresses, en privant telle ou telle partie du monde de pluie, pour se défendre de toute sédition et de toute protestation … C'est à se demander où Swift est allé chercher ses idées, là encore ?! Sûrement chez des complotistes de son temps. Chez les Balnibarbes, il a encore toute une réflexion sur l'écologie en opposant deux parties de la population : il y a la majeure partie du peuple qui vit sur une terre stérile, dans des maisons en ruines, et le peuple se retrouve en haillons et il y a une minorité de personnes qui vit dans des maisons plus honorables, entourées de jardins et de terre fertile alors Gulliver demande l'explication et on lui explique que l'innovation, dans ce pays, a engendré des terres stériles et a fait que le savoir-faire s'est perdu, alors qu'une maigre partie de la population, moquée par les autres, s'est au contraire attachée au savoir-faire de leurs ancêtres, aux techniques agricoles anciennes, et a su se préserver du progressisme … Mais on accuse ces derniers de nuire au bien général du pays, bien qu'il s'agisse des rares qui arrivent à nourrir les autres … On voit bien dans ces extraits où se situe Swift dans la « Querelle des Anciens et des Modernes » qui me paraît plus politique que littéraire, in fine … Sa critique de la science, à Laputa, s'attache énormément à la question de l'écologie, comme je le disais et s'intéresse donc aussi à l'alimentation et je dois dire que j'ai bien ri lorsque Gulliver rencontre en visitant l'Académie un microbiologistes qui a pour tâche de, je cite, « reconstituer les éléments des matières ayant servi à l'alimentation, pour les faire retourner à l'état d'aliment ». Cela expliquerait le pourquoi des matières fécales dans l'alimentation (voir l'affaire des tartes au - chocolat – (Veuillez remplacer par le terme adéquat) d'Ikea). Pour aller plus loin, j'ai lu après avoir fini les Voyages de Gulliver, sa Modeste proposition : Pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public et je dois dire que cette modeste proposition, que cette idée-là, est encore plus ignoble que l'idée du microbiologiste mais je n'encourage pas pour autant le microbiologiste à poursuivre ses études.
Mettons fin à mes digressions sur la science et mettons fin aux voyages de Gulliver, en nous arrêtons sur cette dernière recommandation des Houyhnhnms : Que les Européens, etc. et autres superpuissances s'arrêtent un peu de temps en temps et qu'il serait inutile voire dangereux pour les pays visités d'être colonisés par eux et qu'il serait judicieux au contraire de les laisser se faire civiliser, dompter, par les Houyhnhnms. Gulliver est d'accord avec les Houyhnhnms car en présence des Houyhnhnms et de tous ceux qu'il appelle ses « Maîtres » lors de ses voyages, il s'est rendu compte que les Européens, et même par extension, les humains en règle générale, les yahous, sont des êtres tellement imparfaits, tellement monstrueux, qu'il finit par en avoir horreur et devient misanthrope, lui qui a parcouru le monde et rencontré tant de personnes étonnantes … et il finit par se replier sur lui-même, se sentant toujours à la fin, sans doute supérieur à ses semblables ? Ou la raison n'est-elle pas au contraire qu'il a pris une telle leçon d'humilité sur lui-même et sur ses semblables, sur sa nation vis à vis d'autres nations, et même sur son espèce vis à vis d'autres espèces, qu'il se sent trop « yahou » pour pouvoir revenir à la civilisation ? Ce qui explique pourquoi il s'ensauvage, à la fin … Et Swift lui-même après les Voyages de Gulliver, manque de se retrouver cannibale (mais dans l'intérêt de la civilisation là par contre !)
Ah ! si Gulliver n'avait pas existé ! C'est tout une partie de notre imaginaire qui partirait en capilotade ! Déjà le simple concept de la « dimension ». Depuis l'antiquité, on connaissait les géants, Rabelais s'en était emparé, avec le succès que l'on sait, et ils perduraient encore dans l'imaginaire enfantin des contes de fées. Mais Swift ajoutait cette dimension supplémentaire : être petit chez les grands et grand chez les petits, d'où l'idée de « rapport ». Douze ans plus tard, Voltaire s'en souviendra sans doute en écrivant « Micromégas ». Et réduire « Gulliver » à Lilliput et Brobdingnag est pour le moins arbitraire, et de plus totalement inepte, car il ne s'agit là que des deux premières parties (l'ouvrage en compte quatre), les plus propres à frapper l'imagination d'un lecteur moyen qui ne chercherait que l'évasion (quoiqu' une lecture philosophique de cette allégorie est très possible et même recommandée)
Il faut donc lire les « Voyages de Gulliver » dans leur intégralité. le titre original anglais est : « Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships », c'est-à-dire « Voyages dans plusieurs nations du monde. En quatre parties. Par Lemuel Gulliver, ancien chirurgien, et par la suite capitaine de plusieurs bateaux ». On peut comprendre que les traducteurs aient eu quelques réticence à adopter ce titre, et très vite, le roman est devenu populaire sous son nom actuel : « Gulliver's travels », c'est-à-dire « Voyages de Gulliver ».
Les quatre parties correspondent aux quatre voyages principaux :
Voyage à Lilliputt : Gulliver à la suite d'un naufrage, échoue sur l'île de Lilliput où les habitants qui mesurent 15 cm de hauteur, sont en guerre avec ceux de l'île voisine, Blefescu, au sujet d'un problème majeur : faut-il casser les oeufs durs par le gros bout ou par le petit bout ? Gulliver n'arrivera pas à réconcilier les deux peuples et devra fuir.
Voyage à Brobdingnag : Gulliver tombe sur cette fois sur île de Géants où c'est lui qui fait figure de lilliputien. Pris en amitié par une « fillette », Glumdalclitch, il devient le jouet favori de la Cour où il essaie, sans succès, d'expliquer les rouages de la politique anglaise. Enlevé par un aigle, il revient en Angleterre.
Voyages à Laputa et autres contrées lointaines : Pris du démon du voyage, Gulliver repart vers des régions inconnues : il tombe sur des civilisations où règne la science (au point de rendre les gens insensibles à toute autre notion), d'autres où il faut une cloche ramener continuellement les gens à la réalité, d'autres encore où les habitants sont immortels : malheureusement, seule la mort est abolie, pas la vieillesse, ni la maladie, ni la méchanceté, ni la bêtise… Enfin une île peuplée de sorciers qui permettent à Gulliver de converser avec des « sages » de tous les pays et de tous les temps : il se rend compte alors que tout a été dit, et que dans tout ce qui a été dit, une bonne partie est constituée de mensonges, et l'autre de bobards.
Voyage au pays des Houyhnhnms (prononcez comme vous pourrez) : c'est le paradis : des chevaux beaux, intelligents, parvenus au faîte des connaissances, de la raison et de la sagesse sont les maîtres des « Yahoos » (on avait dit Pas de pub !) qui se révèlent être … des humains (ou ce qu'il en reste).
Ayant fait le tour de tous ces monde, Gulliver, comme Candide, n'a pas d'autre souhait que rentrer chez lui et, sinon cultiver son jardin, du moins finir ses jours dans une relative sérénité.
Roman allégorique et satirique, « Les Voyages de Gulliver » appelle une multitude de lectures : philosophique, sociale, politique, religieuse, etc. le style employé, qui s'apparente à l'allégorie ou au conte philosophique, pourrait aussi bien être classé dans le fantastique, la science-fiction, la fantasy (Tolkien s'est-il souvenu de Swift), bref de tous les secteurs de l'imaginaire littéraire.
Le cinéma n'est pas en reste : on retiendra le dessin animé classique de Dave Fleisher (1939), et la plaisant adaptation de Jack Sher en 1960, avec Kerwin Matthews
Rien d'étonnant à ce que l'on connaisse surtout les deux premiers voyages de Gulliver, qui exaltent les vertus de leur héros bien humain : à Lilliput, « l'homme-montagne » impose rapidement sa force et sa sagacité (tandis que le petit peuple qui l'accueille guerroie pour prouver la supériorité de l'oeuf dur écalé par le petit bout plutôt que le gros) ; à Brobdingnag, le minuscule Gulliver est choyé par des géants débonnaires et même si son séjour se termine sur une humiliation sans équivoque, du moins le lecteur peut-il penser que seuls les Anglais, et non les hommes en général, sont concernés par les insultes assassines lancées par le Roi. de fait, l'Irlandais qu'est Swift tape à coups redoublés sur la puissance coloniale qui opprime son pays. Il imagine d'ailleurs l'île de Laputa capable de se maintenir dans les airs au grand dam du territoire qu'elle survole et menace. Jusque là, l'auteur apparaît donc comme un homme des Lumières, humaniste persifflant l'intégrisme religieux et la violence étatique, prônant la justice et la tempérance à grand renfort d'humour pipi-caca. D'ailleurs le nom de son héros résume le programme du conte philosophique cher à Voltaire: « gull », verlan de « lüg », mentir (en allemand), « y » pour et (en espagnol), « ver » pour « vera », choses vraies (en latin); soit mensonge et vérité, la fiction au service de la réflexion.
Le voyage à Balnibardi étonne un peu : l'auteur s'en prend aux savants et aux intellectuels qui manqueraient de bon sens. Mais c'est surtout le pays des Houyhnhnms qui fait sortir les « Voyages » de l'optimisme de combat des Lumières pour le pessimisme radical d'un Pascal: l'être humain y est dépeint comme une brute dégénérée, aussi laide que méchante. Quant aux Houyhnhnms, magnifiques et rationnels chevaux, ils sont d'autant plus aptes à la sagesse qu'ils sont dénués de toute affectivité. Chassé de ce qu'il considère comme un paradis, Gulliver rentre chez lui en haïssant le genre humain, incapable même de supporter la vue de sa femme et de ses enfants.
L'individu qui, fils de Gargantua et de Pantagruel, débarqua à Lilliput, renonce finalement et aux voyages et à l'espoir. L'homme, misérable engeance, est incapable de se reformer et doit son sort moins à des préjugés qu'il conviendrait de combattre qu'aux vices qui lui sont inhérents. Telle est la triste morale que l'épilogue semble transmettre.
Mais avec Swift, sait-on jamais ? Un auteur capable d'exhorter les Anglais à manger les enfants irlandais pour éradiquer la famine ne devrait jamais être lu au premier degré. Et son Gulliver aigri et misanthrope n'est-il pas la meilleure façon de nous pousser à aimer nos semblables ?
Le voyage à Balnibardi étonne un peu : l'auteur s'en prend aux savants et aux intellectuels qui manqueraient de bon sens. Mais c'est surtout le pays des Houyhnhnms qui fait sortir les « Voyages » de l'optimisme de combat des Lumières pour le pessimisme radical d'un Pascal: l'être humain y est dépeint comme une brute dégénérée, aussi laide que méchante. Quant aux Houyhnhnms, magnifiques et rationnels chevaux, ils sont d'autant plus aptes à la sagesse qu'ils sont dénués de toute affectivité. Chassé de ce qu'il considère comme un paradis, Gulliver rentre chez lui en haïssant le genre humain, incapable même de supporter la vue de sa femme et de ses enfants.
L'individu qui, fils de Gargantua et de Pantagruel, débarqua à Lilliput, renonce finalement et aux voyages et à l'espoir. L'homme, misérable engeance, est incapable de se reformer et doit son sort moins à des préjugés qu'il conviendrait de combattre qu'aux vices qui lui sont inhérents. Telle est la triste morale que l'épilogue semble transmettre.
Mais avec Swift, sait-on jamais ? Un auteur capable d'exhorter les Anglais à manger les enfants irlandais pour éradiquer la famine ne devrait jamais être lu au premier degré. Et son Gulliver aigri et misanthrope n'est-il pas la meilleure façon de nous pousser à aimer nos semblables ?
Gulliver
Sept ans après la publication de Robinson Crusoé, le grand essayiste et poète Jonathan Swift compose une satire sur les récits de voyage qui devient immédiatement un best-seller.
Dans son au-delà en tant que classique, Les Voyages de Gulliver fonctionne à plusieurs niveaux.
C'est d'abord un chef-d'oeuvre d'indignation soutenue et sauvage, urieuse, déchaînée, obscène.
La fureur satirique de Swift est dirigée contre presque tous les aspects de la vie du début du XVIIIe siècle :
la science, la société, le commerce et la politique.
Puis, dépouillé de la vision sombre de Swift, il devient un merveilleux fantasme de voyage pour les enfants, un favori éternel qui continue d'inspirer d'innombrables versions, dans des livres et des films.
Enfin, en tant que tour de force polémique, plein d'imagination débridée, il est devenu une source pour Voltaire, ainsi que l'inspiration pour une suite pour violon de Telemann, et, La ferme des animaux de George Orwell.
Voyages dans plusieurs nations éloignées du monde de Lemuel Gulliver (pour donner son titre original) se décline en quatre parties et s'ouvre sur le naufrage de Gulliver sur l'île de Lilliput, dont les habitants ne mesurent que six pouces de haut. La partie la plus célèbre et la plus familière du livre (lilliputien est rapidement devenu un mot commun) est un jeu satirique dans lequel Swift prend des photos mémorables des partis politiques anglais et de leurs bouffonneries, en particulier la controverse sur la question de savoir si les oeufs à la coque devraient être ouvert au grand ou au petit bout.
Ensuite, le navire de Gulliver, l'Adventure, dévie de sa route et il est abandonné sur Brobdingnag dont les habitants sont des géants au paysage proportionnellement gigantesque. Ici, ayant été dominant sur Lilliput, Gulliver est présenté comme un nain curieux et a un certain nombre de problèmes tels que la lutte contre les guêpes géantes. Il peut également discuter de l'état de l'Europe avec le roi, qui conclut – on retrouve l'esprit venimeux de Swift que 'la majeure partie de vos indigènes [sont] la race la plus pernicieuse de petite vermine odieuse que la nature ait jamais laissée ramper à la surface de la terre'.
Dans la troisième partie de ses voyages, Gulliver visite l'île volante de Laputa (un nom de lieu également référencé dans le film de Stanley Kubrick, Dr Folamour), et Swift monte un assaut sombre et compliqué contre les spéculations de la science contemporaine (notamment en usurpant la tentative d'extraction des rayons de soleil des concombres).
Enfin, dans la section qui a influencé Orwell (Les Voyages de Gulliver était l'un de ses livres préférés), Swift décrit le pays des Houyhnhnms, des chevaux aux qualités d'hommes rationnels. Ceux-ci, il les oppose aux répugnants Yahoos, des brutes à forme humaine.
Quand tous ces voyages sont terminés, Gulliver rentre chez lui ; il est devenu sage, purgé et mûri par ses expériences.
J'écris , conclut-il, 'pour la fin la plus noble, pour informer et instruire l'humanité… J'écris sans aucune vue de profit ou de louange. Je ne laisse jamais passer une parole qui puisse offenser le moins du monde, même ceux qui sont le plus disposés à la prendre. de sorte que j'espère pouvoir avec justice me déclarer un auteur parfaitement irréprochable...'
Lorsqu'il mourut en 1745, Swift, fut enterré à Dublin,
sur la pierre tombale, une épitaphe devenue très célèbre:
'ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit'
'où une indignation féroce ne peut plus déchirer son coeur.'
Lien : http://holophernes.over-blog..
C'est un roman agaçant ! Je voulais partir en voyage, suivre la route du pays imaginaire de l'enfance, je n'ai trouvé qu'une parodie aride des romans de navigateurs et des analyses numériques de société trop proches des nôtres pour me faire vraiment rêver. La lecture m'a été réellement difficile avec toutes les références à la vie politique anglaise de l'époque, mes yeux de lecteurs ne sont pas des yeux de journalistes polémistes, je pense avoir loupé une bonne partie de la portée critique du roman. Bien entendu, il y a tout de même des analyses très pointues et qui font réfléchir sur notre organisation sociétale. Dans ses quatre voyages, Gulliver est a la fois observateur extérieur (coucou les Lettres Persanes) et objet lui même de toutes les observations (coucou Candide), forcément cela donne à réfléchir. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire accompagné !
le bon docteur Lemuel Gulliver nous conte son naufrage et son arrivée sur une ile drôlement peuplée.
Un voyage fantastique et une sacrée rencontre avec un petit peuple haut comme trois pommes.
Devenu géant monstrueux Gulliver devient une bête de foire, il ne retrouvera son humanité qu'en réglant le conflit qui empoisonne l'ile de Lilliput et l'ile de Blefuscu.
Au cours d'un déjeuner les deux rois n'ont pas ouvert leur oeufs à la coque par le même bout, chacun voyant dans le geste de l'autre, mépris et provocation.
Entre les Groboutien et les Petiboutien la guerre fut déclarée. C'est un monstre, qui plus est un étranger qui
apaisera ces petits hommes. Tout le monde connait ce premier voyage de Gulliver, un beau et doux souvenir d'enfance, mais le plus souvent c'est
oublier que le roman de Jonathan Swift est, certes, une drôle de fantaisie mais aussi et surtout un conte philosophique et politique.
Une nouvelle lecture plusieurs années après l'avoir découvert nous fait joliment ressortir
le message humaniste et pacifiste de ce cher Jonathan.
De la littérature d'aventure délicieusement et malicieusement joyeuse et enlevée !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Un voyage fantastique et une sacrée rencontre avec un petit peuple haut comme trois pommes.
Devenu géant monstrueux Gulliver devient une bête de foire, il ne retrouvera son humanité qu'en réglant le conflit qui empoisonne l'ile de Lilliput et l'ile de Blefuscu.
Au cours d'un déjeuner les deux rois n'ont pas ouvert leur oeufs à la coque par le même bout, chacun voyant dans le geste de l'autre, mépris et provocation.
Entre les Groboutien et les Petiboutien la guerre fut déclarée. C'est un monstre, qui plus est un étranger qui
apaisera ces petits hommes. Tout le monde connait ce premier voyage de Gulliver, un beau et doux souvenir d'enfance, mais le plus souvent c'est
oublier que le roman de Jonathan Swift est, certes, une drôle de fantaisie mais aussi et surtout un conte philosophique et politique.
Une nouvelle lecture plusieurs années après l'avoir découvert nous fait joliment ressortir
le message humaniste et pacifiste de ce cher Jonathan.
De la littérature d'aventure délicieusement et malicieusement joyeuse et enlevée !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Dans la série "les classiques pour enfants que je n'avais jamais lus", j'ai fini il y a quelques jours Les Voyages de Gulliver !
J'entendais souvent des références au Lilliputiens et voyais régulièrement cette image d'un humain ligoté allongé au sol par ces petits êtres, mais je n'avais encore jamais lu cette aventure.
La belle surprise ce fut de découvrir qu'il arrive d'autres aventures à notre héros.
Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que cet exotisme, ce fantastique, est en fait assez marginal et ne sert en réalité à l'auteur qu'à se mettre hors-contexte afin de pouvoir librement critiquer la société de son époque : en effet, l'histoire passe souvent à l'arrière plan derrière un pamphlet politique omniprésent.
Je ne le savais pas, et comme je voulais lire un roman d'aventures, j'ai forcément été contrarié.
Par contre, force est de constater que je trouve son analyse très bonne, et en plus de contenir des paragraphes franchement bien envoyés, il faut dire que nombres d'entres eux restent tout à fait d'actualité !
Un bon nombre de 'notables' feraient bien de le relire, ça leur remettrait les idées en place !
A leur lecture, je me suis plusieurs fois demandé comment est-ce que l'auteur avait eu le courage, et le culot, de publier une telle satyre ! Il s'est sans aucun doute exposé. Chapeau à lui !
Une sacrée découverte !
J'entendais souvent des références au Lilliputiens et voyais régulièrement cette image d'un humain ligoté allongé au sol par ces petits êtres, mais je n'avais encore jamais lu cette aventure.
La belle surprise ce fut de découvrir qu'il arrive d'autres aventures à notre héros.
Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que cet exotisme, ce fantastique, est en fait assez marginal et ne sert en réalité à l'auteur qu'à se mettre hors-contexte afin de pouvoir librement critiquer la société de son époque : en effet, l'histoire passe souvent à l'arrière plan derrière un pamphlet politique omniprésent.
Je ne le savais pas, et comme je voulais lire un roman d'aventures, j'ai forcément été contrarié.
Par contre, force est de constater que je trouve son analyse très bonne, et en plus de contenir des paragraphes franchement bien envoyés, il faut dire que nombres d'entres eux restent tout à fait d'actualité !
Un bon nombre de 'notables' feraient bien de le relire, ça leur remettrait les idées en place !
A leur lecture, je me suis plusieurs fois demandé comment est-ce que l'auteur avait eu le courage, et le culot, de publier une telle satyre ! Il s'est sans aucun doute exposé. Chapeau à lui !
Une sacrée découverte !
Une lecture atypique que j'ai apprécié dans son approche "extraordinaire" et moins dans son approche "critique". Pour chacun des voyages, c'est l'abord "fantastique" qui m'a emporté et motivé à poursuivre alors que dès que la satyre prenait le pas, mon esprit avait tendance à décrocher. Et ce reproche d'une satyre dominant le fantastique s'origine dans ma nette préférence pour la littérature fantastique.
Je ne dénigrerais donc pas la satyre ici présente, au mieux j'en vanterais certaines qualités, notamment la variabilité du prisme de Gulliver sous l'impulsion de la plume de Swift. En effet, l'auteur joue avec les environnements et les peuplades exotiques pour influer sur la perception de son héros. de sorte que même avec toute la volonté du monde, le prisme de Gulliver est obligé de se transformer.
A chaque fois seul représentant de son peuple, Gulliver expérimente pour de longues durées des changements de conditions relativement extrêmes. D'être infiniment grand à infiniment petit, de raisonné à stupide, il voit le monde tantôt d'en haut, tantôt d'en bas, etc. Toute cette démesure au service d'une critique violente de la société britannique de l'époque et même humaine dans son ensemble au point que Gulliver finisse par souffrir d'une misanthropie aigue.
Une oeuvre intéressante mais que je ne saurais apprécier pour ce qu'elle est réellement. Peu sensible à la satyre littéraire, pas très passionné par les récits de voyages, même moqués, j'ai l'impression de passer à côté du réel propos pour ne retenir que l'imaginaire.
Je ne dénigrerais donc pas la satyre ici présente, au mieux j'en vanterais certaines qualités, notamment la variabilité du prisme de Gulliver sous l'impulsion de la plume de Swift. En effet, l'auteur joue avec les environnements et les peuplades exotiques pour influer sur la perception de son héros. de sorte que même avec toute la volonté du monde, le prisme de Gulliver est obligé de se transformer.
A chaque fois seul représentant de son peuple, Gulliver expérimente pour de longues durées des changements de conditions relativement extrêmes. D'être infiniment grand à infiniment petit, de raisonné à stupide, il voit le monde tantôt d'en haut, tantôt d'en bas, etc. Toute cette démesure au service d'une critique violente de la société britannique de l'époque et même humaine dans son ensemble au point que Gulliver finisse par souffrir d'une misanthropie aigue.
Une oeuvre intéressante mais que je ne saurais apprécier pour ce qu'elle est réellement. Peu sensible à la satyre littéraire, pas très passionné par les récits de voyages, même moqués, j'ai l'impression de passer à côté du réel propos pour ne retenir que l'imaginaire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jonathan Swift (45)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les voyages de Gulliver
Quel est le premier voyage extraordinaire effectué par Gulliver ?
Voyage à Balnibarbes
Voyage à Liliput
Voyage au pays des Houynhnhms
Voyage à Brobdingnag
10 questions
288 lecteurs ont répondu
Thème : Voyages de Gulliver de
Jonathan SwiftCréer un quiz sur ce livre288 lecteurs ont répondu